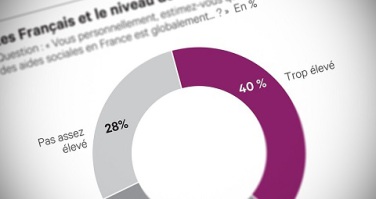Publié le 31/07/2018
Questions-clés sur un « désastre financier »
L’épouvantail de la dette publique
(site le monde-diplomatique.fr)
Chaque fois qu’un gouvernement veut comprimer les dépenses sociales, il tire argument du niveau trop élevé de la dette. En mai, le déficit des caisses de retraite françaises a servi à légitimer l’allongement du temps de travail ; en juin, celui de l’assurance-maladie a justifié le projet gouvernemental de réduire les remboursements de médicaments pour certains traitements prolongés (diabète, cancer, etc.). La dette publique existe bien. Mais est-elle aussi menaçante que certains le prétendent ?
La dette publique a mauvaise réputation. Elle aurait atteint un tel niveau qu’il importerait de réduire, drastiquement et sans tarder, les dépenses de l’Etat et des autres administrations publiques. Fardeau pour les générations futures, elle risquerait par ailleurs d’asphyxier notre économie. Enfin, si elle continuait à croître ou si les taux d’intérêt venaient à augmenter, sa charge deviendrait insoutenable, et la défiance des prêteurs rendrait l’Etat incapable de se financer.
La rengaine catastrophiste, reprise fin juin par la Cour des comptes, n’épargne pas le registre des causes : l’endettement de nos administrations résulterait de la faillite morale des gouvernements précédents, laxistes à force de capituler devant les caprices des électeurs. Pour se racheter de ces condamnables facilités, il conviendrait de prescrire une longue pénitence : les responsables politiques devraient donc avoir le courage d’imposer la rigueur à leurs administrés, pour leur bien et celui de leurs descendants. Examinons une à une ces assertions assénées comme autant d’évidences.
La situation est-elle si grave ?
En valeur nominale, la dette publique (« au sens de Maastricht » — lire « Quelques définitions ») s’élève à 1 209,5 milliards d’euros en 2007 (1). Souhaitant frapper les esprits, certains acteurs de la vie publique n’hésitent pas à calculer cette somme par individu ou par ménage. Ainsi, en 2005, M. Michel Pébereau, à l’époque président de BNP Paribas et président de la commission sur la dette publique, prévenait que « chaque ménage supporte sans le savoir une dette d’environ 41 000 euros. C’est le double [de ce] qu’il a, en moyenne, à titre privé, pour l’ensemble de ses crédits (2) ». M. Jean-Pierre Raffarin, plus paternel (ou plus maternel, comme on voudra), insistait : « Pendant que nous parlons, il y a sans doute un bébé en train de naître dans une clinique, quelque part. Sur ses épaules, dès qu’il va commencer à respirer, il y aura déjà 100 000 francs de dette, soit 15 000 euros (3). » On pourrait multiplier les citations dans ce registre (lire « Commentaires »). Elles reposent toutes sur l’analogie entre l’Etat, présumé dépensier et mal géré, et un ménage, présumé soucieux d’équilibrer son budget.
Une connaissance même rudimentaire de la comptabilité obligerait les redresseurs du « bilan de l’entreprise France » à ne pas tenir compte du seul passif. Si l’Etat doit de l’argent à ses créanciers, il produit aussi des richesses durables. Par exemple, les infrastructures des administrations publiques. « Certes, signalent les économistes Jérôme Creel et Henri Sterdyniak, le nouveau-né français hérite d’une dette publique, mais il hérite aussi d’actifs publics : routes, écoles, maternités, équipements sportifs... Evoquer l’une sans évoquer les autres est peu rigoureux (4). » Ainsi, en 2006 (derniers chiffres connus), les actifs financiers (les créances) et non financiers (essentiellement les infrastructures) des administrations excèdent largement leur passif financier (les dettes) ; la valeur nette de leur patrimoine est de 676,6 milliards d’euros (5), soit l’équivalent du tiers du produit intérieur brut (PIB). Autrement dit, au total, chaque berceau reçoit en héritage 11 000 euros de patrimoine public !
De plus, il convient de ne pas confondre l’endettement des administrations avec celui du pays pris dans son ensemble : la dette publique n’est pas la dette de la France. La richesse nationale totale comprend les actifs non financiers (biens fonciers, immobiliers, équipements, etc.) détenus par l’ensemble des agents publics et privés, qui représentaient plus de six fois le PIB en 2006, contre quatre fois en 1993. Il faut y ajouter les avoirs nets sur l’étranger (c’est-à-dire la somme de toutes les créances privées et publiques sur l’étranger, moins celles détenues par les agents non résidents sur notre économie), lesquels représentaient 6 % du PIB en 2006. Au total, notre pays n’est donc pas endetté vis-à-vis de l’étranger. Comme le notent Creel et Sterdyniak, « la France consomme nettement moins qu’elle produit et ne vit pas “à crédit” (6) ».
Présentée du point de vue d’un comptable d’entreprise, mais cette fois avec rigueur, la dette publique apparaît soudain moins calamiteuse. Elle n’en repose pas moins sur une erreur de perspective : l’Etat est une entité économique et financière différente des autres. Il ne meurt pas, il ne fait pas faillite. On ne peut le comparer ni à un ménage ni à une entreprise.
Un Etat plus endetté aujourd’hui qu’hier ?
Au cours du quart de siècle passé, la part de la dette dans la richesse nationale produite chaque année a augmenté de manière importante : de 20,7 % en 1980, elle représente aujourd’hui 63,9 % du PIB (7). Irrégulier, cet accroissement fut très rapide durant les phases de faible croissance et de crise : au milieu des années 1980 et surtout entre 1991 et 1996, où le ratio gagne plus de 20 points en cinq ans, passant de 36 % à 58 % (M. Nicolas Sarkozy fut ministre du budget entre 1993 et 1995...). A elle seule, la récession de 1992 et 1993 l’a fait bondir de 6,5 points. Notons que, par le passé, les administrations publiques françaises ont déjà connu un niveau d’endettement encore plus élevé. Par exemple, proche de 100 % à la fin du XIXe siècle, le ratio demeurait autour de 80 % à la veille de la première guerre mondiale (8). Inversement, durant les phases de forte croissance, le taux d’endettement se stabilise : c’est le cas à la fin des années 1980. Il peut même se réduire légèrement, comme entre 1998 et 2001, où il passe de 59,4 % à 56,9 %. Depuis lors, le ratio est reparti à la hausse ; il s’est rétracté en 2006, mais pour augmenter à nouveau légèrement en 2007.
Plus l’économie stagne, plus la dette publique rapportée à la production nationale s’accroît. Et, réciproquement, plus l’économie est dynamique, plus cette part se réduit. La plupart des analystes ayant pignon sur rue considèrent le désendettement des administrations comme un préalable à la croissance économique. Il n’en est rien puisque l’endettement, lorsqu’il résulte d’une forte augmentation des dépenses, stimule la croissance. Le lien logique entre endettement public et croissance irait donc plutôt dans l’autre sens : c’est l’endettement des administrations publiques qui tend à favoriser la croissance, et c’est la croissance trop faible qui génère de l’endettement.
La France est-elle le mouton noir de l’Europe ?
Pour la zone euro, la part de la dette dans le PIB s’élève à 66,4 % en 2007 (9). La dette publique française se révèle donc légèrement plus faible que la moyenne européenne. Certains pays sont très endettés, comme l’Italie, avec 104 %, ou la Belgique, avec 84,9 %. D’autres, au contraire, ont un niveau d’endettement plus faible : c’est le cas de l’Espagne, avec 36,2 %, ou de l’Irlande, avec 25,4 %. Le niveau de la dette publique allemande est quasiment identique à celui de la France, 65 %. En dehors de la zone euro, le Royaume-Uni est moins endetté, avec 43,8 %. Toutefois, tout comme la France et l’Allemagne, ce pays se situe sur une trajectoire haussière depuis le début de la décennie 2000. Le niveau de l’endettement des Etats-Unis est un peu moins élevé, avec 62,2 %, tandis que celui du Japon atteint... 180 %. La France n’est certes pas le pays le moins endetté du monde, mais elle n’est pas non plus le plus mauvais élève de la classe.
Un fardeau pour les générations futures ?
On l’entend en boucle dans les médias. Dans la majorité comme dans l’opposition parlementaire, on en appelle à la résorption de la dette, c’est-à-dire à la « réforme » des administrations publiques, à la réduction du nombre de fonctionnaires, à la baisse des dépenses de l’éducation nationale et de santé, des pensions de retraite, de l’indemnisation-chômage, etc. La machine est bien huilée : à part quelques vieux aigris, qui oserait prendre la défense des aînés (10) ? Et puis, l’argument semble plein de bon sens : n’est-ce pas comme cela que les choses se passent dans notre vie de tous les jours ? Justement, non.
Prenons un exemple : celui de l’endettement d’un ménage pour acheter un logement. Si les parents décèdent avant d’avoir remboursé la totalité de leur emprunt, ils ne laissent pas uniquement une dette à leurs enfants, mais également un bien immobilier. La dette est la contrepartie financière d’un actif réel et, souvent, bien utile... Si l’on en revient aux administrations, on constate que l’endettement contracté par les générations passées a pu donner lieu à de belles réalisations (infrastructures, amélioration du niveau d’éducation, amélioration de l’état de santé de la population, etc.). Au total, comme indiqué plus haut, la valeur du patrimoine est supérieure à l’endettement.
De plus, pour s’endetter, l’Etat émet sur les marchés financiers des obligations appelées, dans ce cas, bons du Trésor. Ces titres sont achetés par d’autres agents (assurances, établissements de crédit, organismes communs de placement, non-résidents...), lesquels placent l’épargne des ménages qui ont un revenu suffisamment élevé... pour épargner. Au moment où l’Etat s’endette, ceux qui possèdent ces bons du Trésor appartiennent à la même génération que le reste de la population. Celle qui hérite de la dette publique hérite aussi des titres de cette dette. D’un strict point de vue financier, au niveau global, le transfert net d’une génération à une autre est nul. Prise dans son ensemble, notre génération n’est ni plus ni moins endettée que la génération précédente ou que la génération future.
L’accroissement de l’endettement public donne effectivement lieu à des transferts — non pas entre générations, mais au sein d’une même génération. En effet, les bons du Trésor sont des obligations qui rapportent chaque année à leur détenteur un intérêt, versé par l’Etat et donc, en dernier ressort, par les contribuables. Ces sommes ne sont pas négligeables : le projet de loi de finances pour l’année 2008 prévoit que soient versés environ 40 milliards d’euros d’intérêts au titre de la dette publique, ce qui représente environ 15 % du total des dépenses de l’Etat. A comparer avec, par exemple, le budget de la défense (36,7 milliards d’euros) ou celui de l’enseignement scolaire (59 milliards d’euros). Ces intérêts versés correspondent à peu près au montant prévu du déficit budgétaire.
L’endettement des administrations publiques, question intragénérationnelle, entraîne donc surtout une redistribution à rebours en provenance de tous les contribuables, y compris les plus modestes (à travers la taxe sur la valeur ajoutée [TVA], qu’ils paient dès le premier euro sur leurs achats les plus indispensables), à destination des détenteurs de la dette publique, qui in fine sont essentiellement les ménages les plus fortunés : ceux qui ont placé leur épargne sur les marchés financiers, notamment sous forme de bons du Trésor. Compte tenu de la marginalisation de l’impôt progressif dans la somme des prélèvements fiscaux, résultant des réformes fiscales entreprises depuis une quinzaine d’années en la matière (11), le problème de redistribution à rebours n’a fait qu’empirer.
Les dépenses ont-elles crû de façon inconsidérée ?
Autre monstre fantasmatique, le mythe de l’explosion des dépenses publiques. En fait, les dépenses publiques atteignaient 51,78 % de la richesse produite (PIB) en 1985 ; elles s’élevaient à 52,37 % en 2007. En vingt-deux ans, les dépenses supplémentaires ne représentaient que 0,59 point de PIB. Difficile d’y voir une « explosion » ou un accroissement « inconsidéré » pouvant expliquer à lui seul les 33,6 points supplémentaires de dette publique.
En réalité, depuis 1994, le taux de croissance des dépenses publiques est toujours inférieur au taux de croissance de l’économie (sauf en 2002 et 2003). Sur une période de quarante ans, on s’aperçoit que les dépenses publiques ont plutôt tendance à ralentir quand l’économie est prospère et à accélérer quand l’économie va moins bien. Elles sont donc plutôt contracycliques et viennent partiellement compenser, plus ou moins automatiquement, l’insuffisance de croissance. La nouveauté, plutôt inquiétante, réside dans le grippage de ce mécanisme : malgré la faiblesse de la croissance économique depuis 2002, les dépenses publiques peinent à prendre le relais. Leur augmentation compense beaucoup moins que par le passé le manque de dynamisme de l’économie. Cela explique pour partie que l’économie française entame sa septième année consécutive de croissance molle : en moyenne 1,8 % par an sur la période. Les Français en paient le prix fort en termes de chômage, de précarité et de pouvoir d’achat.
A qui profite l’endettement public ?
Pour saisir la dynamique de la dette publique dans les pays capitalistes avancés, il faut comprendre qu’au niveau global c’est l’épargne qui crée la dette (qu’elle finance). Et non l’inverse. Les épargnants réussiront en effet toujours à prêter la partie de leur revenu qu’ils ne veulent pas consommer. Si, dans l’économie, la volonté d’épargner est supérieure à la volonté d’investir, l’excès d’épargne (par rapport à l’investissement) trouve tout de même à se « placer » sur d’autres supports déjà présents sur les marchés financiers. Lorsque l’Etat s’endette pour financer des dépenses supplémentaires, il évite que cet excès d’épargne ne trouve un débouché stérile ou spéculatif. D’une certaine façon, il s’endette à la place des entreprises, qui n’investissent pas assez, pour dépenser cette épargne, utilement, dans la production de biens publics.
En définitive, l’endettement public vient répondre à la demande de bons du Trésor découlant de l’accroissement de l’épargne placée. Les titres d’Etat émis par un pays comme la France constituent en effet un excellent placement ; ils sont aussi sûrs que la monnaie, et leur rendement est bien meilleur (12). Depuis 1997, à l’initiative de M. Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des finances, il existe même des obligations d’Etat indexées sur l’inflation (les OATi) : le gouvernement à direction socialiste a accordé aux rentiers l’assurance anti-inflation qu’il avait lui-même retirée aux salariés lors de la suppression de l’échelle mobile des salaires en 1982.
Les bons du Trésor sont très prisés. Sans eux, les possibilités de diversification des portefeuilles financiers seraient plus restreintes : les titres publics des principaux pays capitalistes avancés circulant à la surface du globe forment le socle de la finance internationale. La hausse de l’endettement public, depuis une vingtaine d’années, dans l’ensemble de ces économies (13) est concomitante de l’essor de la finance globalisée. Si l’ensemble des Etats se désendettaient complètement et simultanément, la finance en pâtirait... mais il n’est pas certain que ce soit réalisable, à moins de plonger l’économie mondiale dans une récession inimaginable, dont les salariés seraient évidemment les premières victimes.
Les investisseurs institutionnels, qui interviennent sur les marchés financiers pour le compte des épargnants, raffolent des titres de la dette publique. Ils n’accordent d’ailleurs aucun crédit aux discours ambiants sur la « faillite » imminente de nos administrations : lorsque l’Agence France Trésor (AFT) souhaite émettre des obligations pour obtenir de la monnaie en échange, la demande de titres publics est toujours très supérieure à l’offre, plus du double en moyenne (14). Le 20 mars 2008, par exemple, l’AFT a procédé à l’émission de titres avec un taux d’intérêt de 3 % arrivant à échéance en janvier 2010 ; le volume total demandé par les opérateurs s’élevait à 5,525 milliards d’euros pour seulement 1,805 milliard d’euros finalement adjugé (15). Dans ce cas, pour 1 euro effectivement emprunté par l’Etat, les agents financiers sont disposés à en prêter 3,06. Ce n’est donc pas l’Etat qui peine à dénicher des prêteurs, ce sont les prêteurs qui ont du mal à obtenir tous les bons du Trésor qu’ils souhaitent.
Quelles sont les causes de la spirale ascendante ?
Le fait que, à la faveur d’un changement de doctrine chez les banquiers centraux, d’abord aux Etats-Unis, puis en Europe, le taux d’intérêt soit passé au-dessus du taux de croissance depuis le début des années 1980 constitue l’élément déterminant de la montée de l’endettement (16). Il est en effet devenu plus intéressant de gérer son portefeuille de titres que d’investir dans la sphère productive pour développer l’activité, embaucher, innover, etc. La rente a pris le pas sur l’entreprise : on veut posséder sans produire. Or c’est là la condition structurelle de la financiarisation, laquelle requiert pour préalable un ensemble de dispositions légales et institutionnelles, comme, par exemple, la libéralisation de la circulation des capitaux mise en place par l’Acte unique européen, signé en 1986, sous la houlette de M. Jacques Delors.
La financiarisation découle de transformations institutionnelles qui incitent à épargner et qui drainent cette épargne vers les marchés financiers. En retour, cette financiarisation réclame sans cesse de nouvelles transformations : lois sur les retraites, favorables à l’essor d’un régime par capitalisation (« réformes » Balladur en 1993 et Fillon en 2003). Autant de dispositions nouvelles qui expliquent pourquoi les agents économiques privés, plutôt que de consommer et d’investir suffisamment pour assurer le plein-emploi, recherchent si activement des titres.
Mais un élément fiscal s’ajoute à ces déterminants macroéconomiques et institutionnels. D’importantes « réformes » ont substitué à la progressivité de l’impôt de nouveaux prélèvements proportionnels sur les revenus, telles la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En déplaçant la charge fiscale des foyers les plus cossus vers les revenus moyens et modestes, ces « réformes » ont favorisé les contribuables dont la « propension à épargner » est la plus forte. Et alimenté la demande de titres... En baissant les impôts des riches, les gouvernements ont simultanément contribué à déséquilibrer les finances publiques et obligé l’Etat à offrir des titres sur les marchés financiers.
Ce qu’autrefois l’Etat obtenait de la part des ménages aisés sous la forme d’un prélèvement fiscal, il ne peut désormais l’escompter qu’en échange d’un taux d’intérêt payé par l’ensemble des contribuables. Ainsi, les concessions fiscales accordées aux riches ont créé d’un seul coup un surcroît de dette publique et de rente privée. Elles ont mis en place un flux de redistribution à l’envers (17). Les riches bénéficient alors d’une double récompense : le cadeau fiscal d’un côté, et le paiement d’intérêts de l’autre. Le premier leur permet de dégager l’épargne qui financera la dette. Laquelle a été créée par le cadeau fiscal lui-même. Une telle mécanique, que l’on prétend contredire par d’éternels « plans de rigueur », trouverait un meilleur remède dans un retour à l’impôt progressif. Qui le propose ?
Bruno Tinel
Maître de conférences à l’université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Franck Van de Velde
Maître de conférences à l’université de sciences et de technologie Lille-I
(1) Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), « Les comptes de la nation », tableau 3.341, 2007, http://www.insee.fr/fr/themes/compt...
(2) Rapport de la commission sur la dette publique au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (PDF), 14 décembre 2005
(3) Entretien à France 2, 26 septembre 2002.
(4) Jérôme Creel et Henri Sterdyniak, « Faut-il réduire la dette publique ? » (PDF), Lettre de l’OFCE, n° 271, Paris, 13 janvier 2006 ; lire aussi, des mêmes auteurs, « Faut-il réduire la dette publique ? Faut-il réduire les dépenses publiques ? », dans Jean-Pierre Fitoussi et Eloi Laurent (sous la dir. de), France 2012. E-book de campagne à l’usage des citoyens, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Paris, 2007.
(5) Compte de patrimoine des administrations publiques, Insee, 2007.
(6) « Faut-il réduire la dette publique ? », op. cit.
(7) Cf. Insee, tableau 3.341, op. cit.
(8) Il atteindra 180 % à la fin de la guerre puis oscillera entre 80 % et 120 % durant les années 1920 et 1930. Calculs des auteurs à partir des séries longues construites par Pierre Villa, www.cepii.fr/francgraph/bdd/villa/m... (comptes nationaux en base 1938). Le quotidien Les Echos avance même un ratio d’endettement public de 90 % à la veille de la première guerre mondiale (Jean-Marc Vittori, « La France de 2008 dans le miroir de 1908 », 31 mars 2008).
(9) Source : Eurostat, statistiques de finances publiques, http://ec.europa.eu/eurostat
(10) Pour un bel exposé montrant l’absurdité de la thèse du « fardeau intergénérationnel », cf. Bernard Guerrien, « L’endettement public est le fardeau des générations futures », dans Les Econoclastes, Petit Bréviaire des idées reçues en économie, La Découverte, Paris, 2003, et L’Illusion économique, Omniscience, Sophia-Antipolis, 2007.
(11) Cf. Jean-Marie Monnier, « Politique fiscale, une mise en perspective », dans Elisabeth Lau (sous la dir. de), L’Etat de la France 2007-2008, La Découverte, Paris, 2007 ; Liêm Hoang-Ngoc, « En France, retour aux privilèges fiscaux de l’Ancien Régime », Manière de voir, no 99, « L’Internationale des riches », juin-juillet 2008.
(12) En effet, avec l’inflation, le rendement de la monnaie est légèrement négatif, alors que les bons du Trésor sont rémunérés à un taux réel, la plupart du temps positif.
(13) Pour l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les engagements financiers bruts représentaient 57,3 % du PIB en 1990, contre 77,1 % en 2006, cf. OECD Factbook 2008 : Economic, Environmental and Social Statistics.
(14) En 2006, le taux de couverture sur les adjudications concernant le moyen et le long terme s’élevait à 239 % (rapport d’activité 2006-2007 de l’AFT).
(15) Pour d’autres exemples de ce genre, consulter le site de l’AFT : www.francetresor.gouv.fr
(16) Le taux d’intérêt est déterminé en dernière instance par chaque banque centrale.
(17) Cf. Michel Husson, « Dette publique, rente privée » (PDF), avril 2006
>
Publié le 30/07/2018
La SNCF lance des procédures disciplinaires contre certains grévistes
Par Pascale Pascariello (site médiapart.fr)
Les grévistes sont dans le collimateur de la SNCF. Des procédures disciplinaires ont été déclenchées contre plusieurs cheminots, à Paris, Lille, Nîmes et Rennes. Les cheminots visés ont tous participé au mouvement de grève et ont des mandats syndicaux.
La CGT poursuit seule désormais le mouvement de grève contre la réforme de la SNCF. Certains cheminots sont quelque peu découragés, d’autres doivent livrer un tout autre combat, menacés de licenciement par leur direction. Au moment de la publication de cet article, 5 cheminots sont concernés par ces mesures.
À chaque fois, la procédure est la même : lorsque la sanction envisagée par la direction est une mise à pied supérieure à 12 jours, voire une radiation, le salarié doit passer devant un conseil de discipline. Au préalable, il est avisé par courrier des faits qui lui sont reprochés. Sa réponse doit intervenir dans un délai de 6 jours. Il est ensuite convoqué à un entretien puis au conseil de discipline. Celui-ci, composé de trois représentants du personnel et de trois représentants de l’entreprise, vote une sanction. La direction a un mois pour prendre sa décision.
L’histoire de Yannick Dubois, 31 ans, cheminot à la gare de Rennes et représentant du personnel au syndicat SUD Rail, témoigne de la répression exercée par la direction de la SNCF.
Mardi 24 juillet, sa radiation a été votée en conseil de discipline. La direction dispose d’un mois pour prendre la décision finale. Initiatrice de la procédure, elle devrait suivre cet avis.
« J’ai deux enfants à charge, c’est une catastrophe. Ils détruisent ma vie en inventant des charges contre moi. Ils me reprochent d’avoir appliqué la réglementation d’usage. C’est complètement kafkaïen », commente Yannick.
La direction de la SNCF lui reproche d’avoir voulu « nuire à l’entreprise ». Les faits invalident cette affirmation.
Le 1er mai, Yannick Dubois se rend à la manifestation organisée pour la fête du travail. À la fin de la journée, il se trouve dans un boulevard qui longe l’une des voies du chemin de fer. Il aperçoit un policier dans les emprises, c’est-à-dire à proximité des voies. Il demande aux forces de l’ordre présentes sur le boulevard si des dispositions ont bien été prises avec la SNCF afin d’éviter tout danger.
« J’ai présenté mon pass carmillon. Pour les cheminots, c’est un peu notre carte professionnelle. Il y a notre identité et notre matricule SNCF. Mais ils ne me répondaient pas. J’ai donc dit que je devais appeler le poste central de Rennes qui gère la régulation des trains sur la gare et ses environs. Nous devons leur signaler toute intrusion sur ou à proximité des voies. C’est une procédure interne à la SNCF pour travailler en sécurité sur les voies. Je travaille depuis 10 ans à la SNCF, je la connais bien. J’ai donc lancé l’alerte. »
Comme le veut le protocole, Yannick Dubois décline son identité, et relate la situation en détail au poste central. « J’ai précisé qu’il s’agissait d’un policier et qu’à l’instant T, je ne savais pas ce qu’il faisait à deux mètres des voies. » Aucune disposition n’ayant été prise entre la police et la SNCF, le poste central décide d’arrêter temporairement la circulation et d’envoyer par la suite un train en reconnaissance, c’est-à-dire en marche ralentie afin de vérifier qu’il n’y a aucun danger.
Néanmoins, le 22 mai, Yannick Dubois reçoit une convocation de l’hôtel de police. Contestant la présence d’un policier près des voies, le directeur de l’agence locale de surveillance générale de la SNCF a déposé une plainte contre lui, pour « entrave à la mise en marche ou la circulation d’un véhicule de chemin de fer ». Trois jours plus tard, un courrier de la SNCF exige qu’il s’explique, par écrit, sur les faits avant de le convoquer à un entretien préalable à sanction fixé le 15 juin. « J’étais stupéfait. Pourquoi ça se retourne contre moi ? J’ai tenté d’éviter qu’un drame ne se produise et c’est moi qu’on poursuit. »
Publié le 29/07/2018
Un « nouveau monde » de l’ordre et de la sécurité, où se croisent trois protagonistes de l’affaire Benalla
Audrey Loussouarn (site l’humanité.fr)
Qui sont Michel Delpuech, Patrick Strzoda et Vincent Crase, dont les noms sont abondamment cités dans la procédure ? Portraits d’un directeur de cabinet, d’un préfet de police et d’un ancien réserviste.
Gérard Collomb l’a assuré sous serment : en prenant connaissance des agissements d’Alexandre Benalla, le 2 mai, il s’est reposé sur le fait que « tant le cabinet du président de la République que le préfet de police avaient été destinataires de l’information », pensant que « les mesures appropriées avaient été prises ». De quoi reporter la faute sur deux personnages, tout comme lui au cœur du scandale : Michel Delpuech et Patrick Strzoda.
Le premier, préfet de police de Paris, a 65 ans. Il connaît bien Gérard Collomb. Avant d’être nommé dans la capitale en mars 2017 par un François Hollande qu’il a côtoyé à l’ENA, Michel Delpuech a officié dans de nombreuses préfectures, dont celle du Rhône et de la région Rhône-Alpes-Auvergne à partir de 2015. Le préfet exerce ses fonctions alors que le ministre de l’Intérieur n’est encore que maire PS de Lyon et président de la métropole. Là-bas, Delpuech a su caler ses pas sur ceux de son futur supérieur hiérarchique : en janvier 2016, après avoir rasé trois campements réunissant 233 personnes, Delpuech se félicite d’avoir « agi en marchant sur nos deux pieds, celui de l’humanité, de la main tendue, et le pied de la fermeté ». Résultat : 25 obligations de quitter le territoire français et 208 hébergements temporaires avant un départ pour leur pays d’origine, note le Progrès. Mais Delpuech a connu aussi les arcanes du pouvoir, avec un passage en 2007 par le cabinet de Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy. Michel Delpuech et Patrick Strzoda ont un point commun : leur CV, entre un passage à l’ENA et des années de fonctions préfectorales.
Patrick Strzoda est repéré par Emmanuel Macron, qui le veut dans son équipe
Le directeur du cabinet du chef de l’État (théoriquement jusqu’en octobre, période de son départ à la retraite), après avoir occupé le poste de préfet de Corse de 2011 à 2013, lui, arrive en Bretagne alors qu’éclate cette année-là la mobilisation des Bonnets rouges. En octobre, un manifestant a la main arrachée par une explosion de grenade au rassemblement du Pont-de-Buis. « Il n’était que la courroie de transmission des ordres de Paris, qui avait décidé d’avoir la main ferme, et il a eu la main ferme », témoigne Christian Troadec, ancien porte-parole du mouvement. En 2016, il est récompensé pour ses actions et nommé directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve jusqu’à sa promotion, peu avant l’élection présidentielle de 2017, au poste de préfet d’Île-de-France. Il est vite repéré par Emmanuel Macron, qui le veut dans son équipe. C’est ce même Patrick Strzoda qui a déclaré être à l’origine de la mise à pied de quinze jours d’Alexandre Benalla.
Reste un troisième homme, présent, lui, aux côtés de l’ancien chargé de mission lors de ce fameux 1er Mai et qu’on voit dans plusieurs vidéos intervenir pour appréhender le couple. Après avoir été officier de réserve dans l’armée de l’air, puis gendarme, et enfin chef d’escadron de réserve, Vincent Crase s’est reconverti dans la sécurité privée, avant d’être employé par LaREM comme agent d’accueil. Selon le porte-parole de l’Élysée, Bruno Roger-Petit, il était « très ponctuellement mobilisé comme d’autres réservistes par le commandement militaire de l’Élysée ». L’homme, toujours salarié, a été mis en examen, notamment pour « port prohibé d’arme de catégorie B » – une arme bien visible dans une des vidéos. Un compagnon avec qui Benalla a créé en avril 2016 une fédération française de la sécurité privée, rapidement dissoute.
Audrey Loussouarn
Publié le 28/07/2018
TEXTE A L’APPUI. Nos grands entretiens à lire à tête reposée (site labas.org)
Pourquoi la gauche a gouverné si peu et déçu si vite ? Un entretien à lire avec Serge Halimi
Audace et Espérance
Daniel Mermet - Je me demande, en lisant ton livre, si je ne me suis pas complètement trompé, je suis du côté de ceux qui perdent toujours, c’est-à-dire du côté gauche.
Serge Halimi - Disons qu’ils ne gagnent pas souvent ou qu’ils ne gagnent pas longtemps.
1924-1926 : le cartel des gauches
Prenons le XXe siècle. Selon toi, la gauche a été au pouvoir dix ou douze ans au total. On vit avec l’idée qu’il y a une alternance, tantôt c’est gauche, tantôt c’est droite. Commençons par le Cartel des gauches, c’est une période assez peu connue.
Très peu connue et pourtant l’une des plus intéressantes lorsqu’il s’agit de mesurer les difficultés que la gauche affronte avec le monde de la finance, et sa disposition à ne pas faire ce qu’elle devrait faire pour se dégager un peu, obtenir des marges de manœuvre et mener une politique qu’on qualifierait de gauche.
C’est 1924-1926 ; ensuite le Front populaire (1936-1938), deux années ; ensuite la Libération (1944-1947), ça dure trois ans ; et ensuite l’époque mitterrandienne (1981-1986), tu donnes cinq ans, tu as été généreux. Au total, cela fait donc entre dix et douze ans sur un siècle.
Oui, même si, quand on reprend le détail de ces périodes, le Cartel des gauches c’est un radical qui est au pouvoir, Édouard Herriot, qui serait plus qualifié de centre gauche que de gauche aujourd’hui. Mais qui sera perçu comme de gauche parce qu’il affrontera une opposition de droite tellement vociférante, tellement hostile – qui le soupçonnera de traîtrise parce qu’il essaiera d’arranger un peu les choses avec l’Allemagne, qui le soupçonnera de s’en prendre à la religion parce qu’il essaiera d’appliquer les lois laïques –, que cette opposition-là constituera presque Édouard Herriot en personnage plus à gauche qu’il ne fut en réalité lorsqu’il a été président du Conseil. Après, il y a Blum, dont on peut dire effectivement qu’il a mené une politique de gauche. Pas nécessairement parce qu’il en avait l’intention au départ, mais parce qu’il a subi et encouragé d’une certaine manière la pression sociale née des grèves de juin 1936. Et que sans ces grèves de juin 1936 le bilan du Front populaire aurait été sans doute assez médiocre. Après, je crois que de 1944 à 1947, il n’y a pas de doute, c’est une politique de gauche qui est menée. Parce que cette période intervient après la Libération et que la droite et le patronat ont été complètement disqualifiés par la collaboration qu’on leur prête avec les autorités allemandes. On se souvient de cette anecdote où de Gaulle revient à Paris en 1944. Il est accueilli par une délégation du patronat et il leur dit, de manière très méprisante, de son mètre quatre-vingt-dix et plus : « Je n’ai vu aucun de vous, messieurs, à Londres. Ma foi, après tout, vous n’êtes pas en prison ». C’est donc une période où les politiques de gauche peuvent se déployer d’autant plus librement qu’il n’y a pas d’adversaires. À ceci près que le pays étant ruiné, il doit faire appel à l’aide américaine et que, naturellement, cette aide contraint un peu ses marges de manœuvre.
Le sous-titre de ton livre est « Les leçons du pouvoir ». Ce qui est intéressant, c’est de voir en quoi cela peut nous être utile aujourd’hui. Et on a toujours un peu le même mécanisme, c’est-à-dire qu’on a espérance et renoncement. C’est « audace et enlisement, espérance et renoncement », selon tes propres mots. On trouve à chaque fois dans les quatre périodes que tu étudies, à peu près le même mécanisme. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes circonstances historiques. Il est sûr qu’en 1944 c’est très différent de 1981, de 1936 ou de 1924. Comment naissent ces espérances ? Est-ce le résultat d’une volonté, d’un travail politique ou militant sur la longueur ? Est-ce un leader charismatique qui apparaît ? Est-ce un coup de chance, un événement qu’on n’a pas vu venir ? Parce que là, tu n’étudies pas les mouvements. Tu n’étudies pas 68, parce que c’est un mouvement qui n’a pas de débouché politique. Comment naît l’espérance, l’élan ?
Souvent ce n’est pas quelque chose qui est travaillé très en amont, c’est le produit des échecs de la droite et de l’exaspération que provoquent les politiques menées par les conservateurs. En 1924, on ne peut pas dire que ce soit un dirigeant charismatique, Édouard Herriot est tout sauf charismatique. Ce n’est pas vraiment un homme d’État, ce n’est pas quelqu’un qui a une volonté de fer, ce n’est pas non plus un stratège. Mais il est là, le Parti radical socialiste est à l’époque la principale force de gauche, c’est un parti plutôt républicain laïc. Et l’ensemble des Français progressistes sont exaspérés parce que la droite a mené une politique économique et financière très rigoureuse, a pris des initiatives internationales très hasardeuses (comme l’occupation de la Ruhr par exemple), a mené une politique cléricale qui a mécontenté les laïcs et les républicains. Tout ça converge vers le désir d’en finir, de se débarrasser de Poincaré, qui est le président du Conseil à l’époque. Et ce désir est tellement fort que les socialistes, qui pourtant ont toutes les raisons de se méfier des radicaux, estiment qu’ils ne pourront pas empêcher une alliance de front républicain avec les radicaux pour se débarrasser de Poincaré. Et de fait, cette élection qui n’oppose pas des forces très à gauche à des forces très à droite (même si les forces à droite sont vraiment très à droite) suscite un énorme enthousiasme, parce que les gens veulent se débarrasser du Bloc national. On a connu un peu la même chose avec François Hollande. Ce n’est pas que Hollande suscitait un grand enthousiasme – on a compris après pourquoi cet enthousiasme n’existait pas –, mais c’est que les gens voulaient dégager Sarkozy.
Dans l’exemple que tu cites du Cartel des gauches il n’y avait pas de grand projet politique, même réformateur ?
Non. Le seul grand projet c’était en quelque sorte de défaire tout ce que la droite avait fait en matière de politique étrangère, c’est-à-dire arrêter l’occupation de la Ruhr ; en matière de répression syndicale - parce qu’à la suite de la Première Guerre mondiale il y avait eu des mesures de répression antisyndicale particulièrement fortes - c’était d’amnistier les syndicalistes qui avaient été condamnés ; et enfin en matière de lois laïques, c’était de rétablir une forme de laïcité qui avait été mise en cause par ce Bloc national très lié à l’église catholique et à la droite la plus conservatrice. On se souvient que c’est quand même le Bloc national qui avait en 1920 introduit la criminalisation de l’avortement dans le cadre d’une politique nataliste. Il y avait donc ce climat d’ordre moral, de politique financière très à droite, très rigoureuse, et puis une politique étrangère aventuriste qui voulait continuer à faire payer l’Allemagne, alors même que l’Allemagne ne payait pas. Cette conjonction d’échecs et d’exaspération a provoqué cette alliance un peu inattendue que fut le Cartel des gauches.
1936 : le Front populaire, panique de la bourgeoisie
Continuons avec les élans, les espérances et les raisons qui font que la gauche arrive au pouvoir. Le Front populaire c’est différent.
Le Front populaire, c’est très différent, c’est probablement l’un des cas les plus intéressants. Parce que le Front populaire c’est au départ une alliance défensive. Il ne s’agit pas de changer la vie, il ne s’agit pas de transformer la France, il ne s’agit pas de construire le socialisme. Il s’agit d’occuper le pouvoir pour empêcher que les fascistes ne l’occupent, contre le mouvement du 6 février 1934. La crainte que le fascisme triomphe en France – comme ça s’était passé en Italie dix ans plus tôt, et en Allemagne sous une autre forme – est telle que des forces républicaines (qui par ailleurs se détestent, parce qu’avant 1934 il y a des affrontements y compris physiques entre les militants socialistes et les militants communistes) décident qu’il faut occuper le pouvoir. Faute de quoi le danger est trop grand. Et pour occuper le pouvoir, pour avoir une coalition aussi large que possible, pour remporter les élections, il ne faut surtout pas effrayer l’électorat centriste. Donc il faut arriver au pouvoir avec une proposition programmatique extrêmement modeste.
Sauf que la base populaire va aller beaucoup plus loin, va occuper les usines, va exiger les congés payés, etc. Et ce Front populaire fraîchement élu va être obligé de suivre cet élan.
Exactement. Quand la gauche arrive au pouvoir, des ouvriers qui n’ont pas compris ou qui ne pensent pas qu’il faut en rester là disent : puisque la gauche est arrivée au pouvoir, ça veut dire qu’on peut y aller, qu’en tout cas elle n’enverra pas la police contre nous si on occupe les usines. Donc allons-y. Après tout, on a été réprimé par les gouvernements de droite successifs. Les syndicats sont dans un état d’atrophie à peu près totale. On peut tenter quelque chose. Les forces du Front populaire se trouvent donc face à un mouvement qu’elles ne peuvent pas arrêter. Et elles trouvent avec elles, ou face à elles en quelque sorte, le patronat qui a tellement peur de voir ses usines occupées qu’il se tourne vers des syndicalistes qu’auparavant il pourchassait, vers des forces de gauche qu’auparavant il combattait, pour leur dire : s’il vous plaît, aidez-nous à rétablir l’ordre, on est prêt à payer très cher pour que les usines cessent d’être occupées. C’est donc ce paradoxe extraordinaire d’une majorité de gauche qui est élue à l’Assemblée nationale, qui n’a pas dans son programme les conventions collectives, les congés payés, la semaine de 40 heures, mais qui va faire adopter ces mesures non seulement par les députés de gauche qui ne les avaient pas proposées au moment de leur campagne, mais aussi par la quasi-totalité des députés de droite qui veulent que le fleuve ouvrier retrouve son lit le plus vite possible et que l’ordre revienne. Cette période de panique de la bourgeoisie est telle qu’elle permet au gouvernement de gauche de se présenter comme un intermédiaire en disant : si on obtient ceci, si on obtient cela, l’usine cessera d’être occupée. C’est cela qui est très intéressant, parce que quand on analyse la dialectique entre mobilisation sociale et mobilisation politique, on dit - et cette partie-là est la plus connue : il n’y aurait jamais eu de congés payés s’il n’y avait pas eu le mouvement social. Mais il y a une autre partie qui est moins connue, en tout cas qui est moins rappelée : il n’y aurait jamais eu de mouvement social s’il n’y avait pas eu de victoire électorale. Et, en amont, il n’y aurait pas eu de victoire électorale s’il n’y avait pas eu un programme politique extrêmement modéré ! C’est là que les choses sont intéressantes, et si on ne comprend pas ces étapes il y a quelque chose effectivement qui nous échappe. Il faut un programme modéré pour qu’il y ait une victoire électorale. La victoire électorale dit au mouvement social qu’il peut y aller, qu’il ne sera pas réprimé par un gouvernement de droite puisque c’est un gouvernement dirigé par les socialistes. Et après, ce gouvernement de gauche pourra se prévaloir de ce mouvement social pour obtenir, au profit de son électorat, des choses qui ne figuraient pas dans son programme initial.
1944-1947 : la Sociale arrachée
On va revenir ensuite sur les échecs et les raisons pour lesquelles ces mouvements vont s’arrêter. Mais on continue avec la Libération, cette période où la gauche est au pouvoir, 1944-1947. Là, c’est une situation totalement différente. La France est complètement à plat, appauvrie. Tu n’oublies pas de rappeler dans ton livre qu’en fait en 1944 le bilan des Français victimes de cette guerre n’est pas aussi lourd qu’à l’issue de la Première guerre mondiale, mais le pays est complètement en ruine. Et c’est sur ce champ de ruines que la gauche prend le pouvoir ou qu’elle est au pouvoir.
C’est la première fois, dans l’histoire de France, que le Parti communiste et le Parti socialiste ensemble ont une majorité de sièges à l’Assemblée nationale. Mais la majorité idéologique va très au-delà, puisque même des forces centristes parlent comme si elles étaient socialistes voire révolutionnaires. On est donc dans un contexte où, encore une fois, les forces conservatrices, les forces modérées, les mouvements liés au patronat sont balayés, c’est presque la feuille blanche. Le problème de cette feuille blanche est, comme tu viens de l’évoquer, qu’il n’y a rien : ce sont les rationnements, les tickets, et les gens vivent encore plus mal, en tout cas dans les premiers mois suivant la Libération, que sous l’Occupation.
Il y a un vrai élan populaire, patriotique, énorme. Ils s’y sont mis pour redresser le pays, mais ils l’ont fait à gauche.
« Produire est votre devoir de communiste et votre devoir de Français », disait Maurice Thorez dans le Pas-de-Calais pour que la production de charbon s’intensifie. Mais ça se fait encore une fois dans un contexte où les pénuries sont massives et où donc l’aide américaine devient indispensable. Évidemment, cette aide limite un peu les perspectives révolutionnaires à l’époque, et c’est tout le débat qui existera. Il y a deux moments où la question de la révolution sera posée. C’est juin 1936 : est-ce que tout est possible ? Il y a la fameuse phrase de Marceau Pivert, qui est un dirigeant socialiste à l’époque : « tout est possible maintenant à toute vitesse, la chance sourit aux audacieux ». Et la réponse de Maurice Thorez : tout n’est pas possible parce que nous n’avons pas derrière nous la grande masse du pays et qu’il y a le risque de se couper de ces classes moyennes qui votent pour le Parti radical. Alors même que l’objectif du Front populaire c’était de constituer cette alliance.
Est-ce que Marceau Pivert avait raison ?
Le risque qui est signalé par Maurice Thorez est un risque bien réel. C’est que les classes moyennes, les petits commerçants, etc., excédés par ce mouvement de grève qui interrompt l’approvisionnement, basculent du côté de l’extrême droite et des ligues, et réclament le retour à l’ordre, mais un ordre musclé. Cela dit, si on attend pour lancer un mouvement révolutionnaire qu’il soit absolument garanti de réussir, on ne le lance jamais. On sait bien que la même question se posera en Mai-68 et elle s’est posée cent fois dans l’histoire. À aucun moment on a dit : allez-y, c’est garanti.
Ce qu’il ne faut pas oublier évidemment en 1944, c’est que l’oligarchie est complètement discréditée. Le patronat, les forces économiques du pays se sont vautrés dans la collaboration et sont complètement discrédités, on l’a un peu oublié avec le temps.
Absolument, je l’évoque dans le livre. Il y a même des forces conservatrices qui disent que l’heure est venue de construire la France socialiste, que toute autre hypothèse a été balayée par la guerre et par la collaboration. François Mauriac, qui n’est pas un homme de gauche, qui écrivait dans « Le Figaro », qui est un catholique, qui est plutôt gaulliste à l’époque, écrit dans « Le Cahier noir » : seule la classe ouvrière dans sa masse aura été fidèle à la France profanée. Il y a donc ce sentiment qu’une seule classe sociale a en quelque sorte tenu son rang et tenu son rang patriotique. Évidemment c’est « La Bataille du rail », ce sont ces ouvriers qui sabotent les lieux de production, qui prennent des risques. Ce sont ces résistants qui sont fusillés, qui sont très largement associés aux forces de gauche même si la Résistance ne comportait pas que des éléments de gauche. Mais à la Libération, il y a ce sentiment que la Résistance a d’abord été une Résistance de gauche, et que ceux qui ont payé le plus lourd tribut à cette Résistance étaient les communistes. C’est probablement vrai pour une large part, mais il faut dire que les Allemands ont déclenché une telle campagne de propagande en attribuant tous les actes de résistance à des « terroristes communistes » qu’ils ont en quelque sorte entretenu le sentiment que la victoire – qui n’était pas uniquement une victoire liée à une libération par des armées étrangères, mais également liée à l’action des résistants et de l’armée française – était en partie liée à l’action du Parti communiste. Dans ce contexte, il est évident qu’il est très difficile pour les forces de droite, qui sont quand même très largement associées aux thématiques de Pétain, de redresser la tête. Ce qui est presque stupéfiant, c’est qu’elles le fassent aussi vite. Parce que dès 1948, donc très vite, l’équation a changé du tout au tout à cause de l’apparition de la guerre froide.
Et en 1944, l’Union soviétique bénéficie d’un prestige considérable. Depuis Stalingrad, l’Union soviétique c’est la force libératrice, avec des collaborations tout à fait surprenantes. Je me souviens de textes de George Orwell vis-à-vis de ce qu’il appelait « la Russie » mais qui était l’Union soviétique. C’était des amis, des alliés.
Oui, au point qu’il y a toujours une chose amusante et intéressante sur le souvenir historique à avoir à l’esprit. C’est qu’on a interrogé les Français tous les dix ans en leur demandant quel était le pays qui avait le plus contribué à la victoire contre le fascisme en 1945. On les interroge en 1945. La réponse est je crois 60 ou 65 % l’Union soviétique, 20 % les États-Unis, 10 ou 12 % le Royaume-Uni. Dix ans plus tard, la proportion reste à peu près la même. On l’a refait il y a vingt ans et puis il y a dix ans, les proportions étaient complètement renversées : l’Union soviétique était passée de 60 à 20 %, les États-Unis de 20 à 60 % ; naturellement à cause de l’influence de la culture populaire qui valorise au cinéma les œuvres d’Hollywood, à cause de Spielberg, à cause des images du débarquement. Il est certain que les gens en France ont beaucoup plus à l’esprit (ça se comprend d’une certaine manière) le débarquement sur les côtes de Normandie avec les troupes anglo-américano-canadiennes, que Stalingrad. Mais au moment où ils sont libérés, ils savent bien qu’en 1943 ils veillaient près de leur radio pour écouter des programmes interdits qui leur annonçaient que Von Paulus avait capitulé en février 1943 [1]. Et ils savent bien que c’est à partir de ce moment que le grand retournement s’est produit. Ils savent aussi que plus de 60 % des troupes allemandes ont été fixées sur le front russe. Ils savent enfin que les deux divisions allemandes qui ont occupé Paris en 1940 seront détruites à Stalingrad trois ans plus tard.
1981-1983 : le Programme commun
L’autre période, 1981-1983 ou 1986, comme on veut, là c’est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Quel est le prétexte en 1981, qu’est-ce qui fait que la gauche l’emporte à ce moment-là ?
D’abord, il faut avoir à l’esprit que François Mitterrand avait failli être élu sept ans plus tôt, qu’il a été battu d’extrême justesse (50,8 % contre 49,2 %) par Valéry Giscard d’Estaing. Là, nous sommes sept ans plus tard, entre-temps le nombre des chômeurs a été multiplié par quatre, l’inflation atteint 15 %. Le bilan économique de Valéry Giscard d’Estaing est très mauvais. Par ailleurs, il avait développé un style monarchique qui avait exaspéré les Français et très libéral. En 1976, à partir de Raymond Barre, qui est son Premier ministre, il a déjà un ton un peu arrogant – vous n’avez qu’à créer vos entreprises, vous n’avez qu’à vous remuer un peu –, un ton qui rappelle ce qu’on entend de nos jours. Donc la droite bénéficie, pendant le septennat de Valéry Giscard d’Estaing, du fait que la rupture du Programme commun entre le Parti communiste et le Parti socialiste lui donne l’impression que la menace s’est en quelque sorte dissipée. Et au moment où François Mitterrand se présente, en 1980, personne ne lui donne la moindre chance d’être élu. Lui, qui est dans cette optique de la rivalité avec le Parti communiste, comme on lui reproche en permanence d’avoir viré à droite, se présentera sur la base d’un programme qui est très à gauche, pour en quelque sorte se défaire du reproche qu’on lui fera. Et, contre toute attente, il va l’emporter avec exactement le même score que François Hollande quand il bat Nicolas Sarkozy, au point près. Il va l’emporter en bénéficiant de cette espèce de fatigue, d’exaspération qu’avait provoquée le septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Et il va l’emporter sur la base d’un programme qui est de loin le plus radical que la gauche ait jamais proposé aux électeurs depuis le début du siècle. Il n’y a pas de doute, ça va beaucoup plus loin que le Front populaire, ça va plus loin que la Libération.
Plus loin que ce que propose La France insoumise aujourd’hui ?
Sans doute. Je pense d’ailleurs que les gens de La France insoumise seraient les premiers à l’admettre. Là, il s’agit carrément de rupture avec le capitalisme, de nationalisation de la quasi-totalité des banques importantes, de nationalisation de secteurs industriels considérables, d’augmentation massive des dépenses publiques, du salaire minimum… Donc ça va extrêmement loin. Encore une fois, ça va extrêmement loin parce que c’était un programme qui avait été en quelque sorte élaboré pas nécessairement pour être appliqué, mais pour être une carte électorale utile dans le cadre de cette concurrence entre les socialistes et les communistes. Toujours est-il que le 10 mai 1981, voilà, c’est le Programme.
Enlisement et Renoncement
On va voir maintenant pourquoi ça a planté. Quelles sont les raisons ? Le cliché qui vient tout de suite à l’esprit, c’est le « mur de l’argent ». À chaque fois c’est ça : le Cartel des gauches c’est le mur de l’argent, le Front populaire c’est les riches qui partent avec leurs sous. C’est la même chose, c’est la réaction des puissants, des riches, des capitalistes, qui s’organisent et qui font que ça échoue.
« Je vais vous dire qui est mon véritable adversaire… ». Ça vous rappelle quelque chose. C’est la phrase la plus connue, mais quand Hollande dit cela au Bourget, il ajoute : « Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses, de menacer des États… ». Il est certain que cette idée qu’il y a un mur de l’argent est une idée très ancienne qui remonte au Cartel des gauches. On a constaté la même chose au moment du Front populaire. On constatera la même chose au moment de l’élection de François Mitterrand avec la fuite des capitaux qui sera massive dans les jours qui suivent le 10 mai 1981. C’est donc cette idée qu’il y a le mur de l’argent, et qui est une réalité. Le cas le plus net qui a conduit à réfléchir à cette question sérieusement, ça a été le Cartel des gauches. Parce que là, vous avez un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui ne contrôle pas la finance puisque la Banque de France n’est pas encore nationalisée à l’époque, et qui doit faire appel en permanence aux plus gros actionnaires de la Banque de France, qui sont ses adversaires politiques, pour financer ses fins de mois.
C’est comme demander aux banques de financer la révolution.
Voilà. Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que quand Herriot arrive au pouvoir, pour financer ses fins de mois, il faut qu’un plafond de prêt fixé par la loi ne soit pas dépassé. Or ce plafond a déjà été dépassé un certain nombre de fois, mais ça n’est pas su, ça n’est pas public. La Banque ne le dit pas, le gouvernement de Poincaré bien sûr ne le dit pas. Comme Herriot arrive au pouvoir, les banquiers lui disent : le plafond a été dépassé, ce n’est pas un problème, on peut continuer à le dépasser… tant que la politique d’Herriot ne les gêne pas trop, ou qu’ils pensent qu’il serait trop tôt pour l’affronter. Et dès qu’ils sentent que les difficultés s’accumulent autour d’Herriot, dès que sa politique les gêne, dès que Herriot parle d’instaurer un impôt sur le capital, aussitôt ils font connaître le fait que le plafond a été dépassé, et que donc le gouvernement de la République a menti en prétendant qu’il s’en tenait aux limites imposées par la loi. Et plutôt que d’imposer, dès son arrivée au pouvoir, des mesures financières pour que ce piège soit déjoué – relever le plafond ou que sais-je –, il accepte en quelque sorte de rester dans ces paramètres qui vont le conduire à être étouffé. Léon Blum, qui est le chef du Parti socialiste, qui soutient à l’époque le Cartel des gauches, écrit une lettre à Edouard Herriot et il lui dit ceci :
« Nos embarras de trésorerie, legs de l’ancienne législature, nous ont mis à la discrétion des banques et de la Banque de France. Trop souvent, pour régler une échéance difficile, il a fallu faire appel à leur complaisance qu’elles sont libres de refuser ou de faire payer. Un gouvernement démocratique ne peut pas accepter une telle servitude, il ne peut pas continuer de vivre ainsi. De mois en mois, de semaine en semaine, les mesures indispensables dont le gouvernement reconnaissait la nécessité ont été ajournées. Nous savons de quels conseils, de quels avertissements le gouvernement était entouré par les spécialistes de banque et de finance. Les mêmes hommes qui nous ont détournés des actes nécessaires au nom de la confiance se sont retournés un jour vers nous en déclarant : la confiance, le pays ne peut pas l’accorder au gouvernement actuel, à la politique actuelle. »
Et la réponse d’Herriot, c’est : « Léon Blum avait raison. J’avais voulu préparer des mesures. Malheureusement, le ministre des Finances n’a pas donné suite, et les fonctionnaires du ministère ont saboté les décisions que je souhaitais prendre. »
Cet exemple-là nous conduit à penser qu’il peut arriver – et ça arrive peut-être assez souvent – que la gauche, au lieu de prendre le pouvoir et d’accomplir les espérances populaires, renforce au contraire son adversaire, le rajeunit, constitue un bain de jouvence au lieu de l’abattre, de le subvertir et de le dominer.
Oui, c’est ce qui se passera au moment du Cartel des gauches. À ceci près que l’étranglement du gouvernement d’Edouard Herriot par les régents de la Banque de France sera tellement visible que, quand la gauche reviendra au pouvoir, elle aura ce souvenir en tête et elle se dira : on ne peut pas recommencer comme ça. Et donc le Front populaire décidera de nationaliser la Banque de France. Après, il fera d’autres erreurs financières. Mais en général, on peut dire que jusqu’en 1981 il y avait un certain nombre de leçons qui avaient été retenues, et contre lesquelles on essayait de bâtir des défenses afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.
Mais en 1938 il y a la fuite des capitaux.
Et puis en 1981. Mais en 1981 et à la Libération, il n’y a pas de complot de la Banque de France contre le gouvernement, parce que la Banque de France dépend vraiment du ministre des Finances et obéit à la politique du gouvernement français. Ce qui est intéressant, c’est qu’en général ce à quoi on assiste c’est que certains gouvernements de gauche se disent qu’ils peuvent s’accommoder du système maintenant qu’ils ont les commandes. Et ils n’affrontent pas leur véritable adversaire.
Il y a une chose qui a une influence et dont on n’a pas parlé, dans l’histoire de ces quatre périodes, c’est l’Europe. C’est-à-dire qu’après la Seconde Guerre mondiale, la place de l’Europe va devenir importante et va définir et influencer la politique française.
Ça va énormément contraindre les politiques de la gauche quand elle arrive au pouvoir. On le remarquera en particulier au moment de l’élection de François Mitterrand, puisque ça sera tout le débat sur le Système monétaire européen, la nécessité d’avoir une politique coordonnée avec l’Allemagne qui à l’époque est gouvernée par les conservateurs, la nécessité de maintenir une alliance avec Margaret Thatcher qui à l’époque est au pouvoir au Royaume-Uni. Et à un moment, la question se pose de savoir si les socialistes ou la gauche peuvent mener une politique de gauche dans cette espèce de suite de contraintes qui existent à partir des années 1980 et – c’est un peu le paradoxe – qui seront en quelque sorte installées et durcies par François Mitterrand lui-même. C’est-à-dire qu’on a toute une période où les socialistes apprennent de l’histoire pour essayer de se dégager des contraintes qu’ils avaient observées auparavant (la Banque de France, le mur d’argent qu’on a évoqué). Et avec les deux septennats de Mitterrand, ce sont les socialistes qui eux-mêmes créent des contraintes qui les empêcheront de faire autre chose que des politiques néolibérales.
Si la gauche (je pense à La France insoumise) veut aller au pouvoir, il faut absolument qu’elle ait une position claire par rapport à l’Europe.
Je pense qu’elle l’a. Il est certain que la possibilité d’un verrou européen est connue et comprise maintenant par toutes les formations de gauche. Il y en a qui s’en accommodent. Il y en a qui disent : on essaie de faire l’Europe sociale malgré cela. Et il y en a qui disent : on ne peut pas imaginer mettre en œuvre notre programme si on ne remet pas en cause les traités européens. Maintenant, je crois que ce qu’on sait c’est que le discours sur l’Europe sociale sans remise en cause des traités est une illusion, une imposture. Toutes les expériences précédentes permettent de savoir d’avance qu’une politique de transformation économique et sociale en France serait interdite par les traités européens. Après, si on estime que rester dans l’Europe est plus important que le reste, on renonce à l’essentiel des transformations économiques et sociales qu’on promet. Autant le dire, autant ne pas se payer de mots.
Ce qu’on verra par la suite, c’est par exemple le gouvernement de Jospin qui se présentera comme un gestionnaire, qui dira : le capitalisme, il faut lui donner du sens, il faut le gérer, en somme. Ce qui fait que ces pouvoirs de gauche deviennent des fondés de pouvoir, en l’occurrence du néolibéralisme. Ils renoncent très tôt.
Oui. Quand le livre est sorti il y a une bonne vingtaine d’années, le chapitre qui traitait de François Mitterrand était titré « La chute finale ». Parce qu’il me semblait que ça n’était pas très intéressant de voir ce qui se passerait ensuite, y compris avec Lionel Jospin. Une fois que vous déclarez, comme en 1986 Henri Emmanuelli, qui est le chef de la gauche socialiste : « Les socialistes ont longtemps rêvé d’une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, à l’évidence elle n’est plus possible. La solution, c’est de choisir clairement l’un des deux systèmes et d’en corriger les excès. Nous avons choisi l’économie de marché », on peut dire que c’est terminé. « Quand la gauche essayait »… elle n’essaie plus. C’est l’idée que le capitalisme est l’horizon historique des socialistes. D’ailleurs, dans la charte du Parti socialiste en 1990, ça sera l’une des phrases les plus remarquées : « Le capitalisme borne notre horizon historique. » Dès lors que le capitalisme borne notre horizon historique, les cas que j’évoque dans ce livre relèvent de l’Histoire. Il n’y a plus de possibilité de changer quelque chose.
Ça n’a pas porté chance aux socialistes puisque aujourd’hui ils ont complètement disparu.
C’est peut-être une bonne chose. En tout cas, ce qui est certain c’est que la poursuite de ces reniements socialistes a conduit assez logiquement à Emmanuel Macron. À la fois parce que nous avons (ou nous eûmes) des socialistes qui sont en très mauvais état et qui sont libéraux, donc qui ont été d’une certaine manière démocratiquement sanctionnés du fait qu’ils n’avaient pas tenu leurs promesses. Il faut tout de même souligner que cette sanction historique, on ne l’a jamais connue avant François Hollande. François Hollande est élu avec 52 % des voix, il y a la majorité des socialistes à l’Assemblée nationale, il y a la majorité des socialistes au Sénat, une majorité des villes, une majorité des régions. Et cinq ans plus tard, ils passent de près de 275 sièges à 30, ils perdent 90 % de leurs sièges. Et ils passent de 28 ou 29 % des voix au premier tour à 6 % des voix. C’est donc une sanction extraordinaire, plus forte encore que la sanction que les socialistes ont essuyée en 1993. Là, d’une certaine manière, justice est faite.
Les leçons du pouvoir
Ton livre porte donc sur les quatre moments où la gauche a été au pouvoir au XXe siècle. Il y a une chose importante à avoir à l’esprit, c’est l’influence que la gauche peut avoir à certains moments sur un gouvernement de droite. Ça a été le cas par exemple dans les années 1960, où le Parti communiste en France était puissant, arrivait à 20-25 % aux élections. Le pouvoir gaulliste qui dirigeait le pays devait tenir compte de cette puissance-là. Ce n’est pas être au pouvoir, mais c’est influencer le pouvoir, et ça c’est important.
C’est vrai que le pouvoir gaulliste devait tenir compte de cette influence-là. Mais en même temps, du temps du général de Gaulle, il y avait une volonté de ne pas être le fondé de pouvoir des grandes entreprises et des multinationales. Il y avait une vision un peu jacobine, un peu impérieuse d’une droite qui pensait que l’État c’était quelque chose, ce n’était pas le fondé de pouvoir des marchés. On se souvient que quand François Hollande a été élu, il a dit : mon seul adversaire, le monde de la finance. Et pour montrer que son adversaire était le monde de la finance, il a proposé un impôt de 75 % pour les gens qui gagnent plus de 1 million d’euros par mois. Cette histoire est assez intéressante, parce qu’il a proposé cet impôt tout en n’y croyant pas du tout lui-même, uniquement parce qu’à l’époque, dans les sondages Mélenchon monte, lui ne monte pas, il stagne, parce qu’on lui reproche finalement de ne pas vraiment vouloir la rupture avec Sarkozy. Donc il veut faire quelque chose de symboliquement fort. En l’occurrence, je connais l’histoire parce qu’elle concerne « Le Monde diplomatique », puisque l’un de ses conseillers, Aquilino Morelle, a lu un article dans « Le Monde diplomatique » qui évoque l’imposition des revenus par Roosevelt au moment du New Deal. Et, s’inspirant de cet article, Aquilino Morelle propose à Hollande, à Valls, à Moscovici cette mesure spectaculaire d’imposition des revenus de plus de 1 million d’euros par mois. Hollande la propose quelques jours plus tard. D’ailleurs il la connaît assez mal, puisqu’il bafouille en la proposant lors du journal télévisé de TF1. Et que se passe-t-il pour cette mesure ? Maintenant on le sait, puisque Pierre Moscovici, qui était son directeur de campagne à l’époque, qui a été son ministre des Finances et qui est maintenant Commissaire européen, vient de publier un livre où il raconte cette histoire. Il explique – et c’est là que j’en reviens à de Gaulle – que lorsqu’en tant que ministre des Finances il rencontre pour la première fois les grands patrons, il en rencontre un que nous connaissons bien qui s’appelle Bernard Arnault. Qui lui dit ceci – et Pierre Moscovici cite le passage : « si vous taxez à 75 % tous les revenus à plus de 1 million d’euros, eh bien je délocaliserai tous mes cadres. Parce que si je veux attirer des créateurs en France, je ne peux pas les rémunérer correctement avec vos 75 %. Tout le monde partira. Donc il faut absolument que cette mesure ne soit pas appliquée ». On imagine mal Bernard Arnault disant une chose pareille à de Gaulle. Vous avez été élu sur la base de cet engagement, parce que tout le monde considère que ça a été important dans l’élection de François Hollande, ce discours du Bourget et cet engagement à frapper le Capital. Et vous, patron, vous me dites que je ne peux pas appliquer, moi, gouvernement souverain, une mesure que réclament les Français ? Moscovici commente cet échange en disant : « renoncer à cette mesure sur instruction de Bernard Arnault ? Inimaginable ! C’était l’une des mesures, et il y en avait peu, qui avaient créé un électrochoc dans la campagne, et elle avait sans doute été nécessaire pour gagner l’élection ». Mais il ajoute : « Sur le fond, Bernard Arnault avait raison et nous le savions. Ce qui explique qu’elle ait été d’emblée présentée comme une mesure provisoire, comme si nous étions pressés d’enterrer cette ficelle électoraliste, et nous l’étions. Autant dire que nous n’avons pas été fâchés que le Conseil constitutionnel la censure ». Là, dans cette scène, vous avez tout. Vous avez le patron qui avec arrogance dit à un ministre de la République qu’il ne doit pas appliquer une mesure à laquelle le président de la République vient de s’engager et grâce à laquelle il a été élu. Vous avez le verbalisme de la gauche socialiste destiné à tromper l’électeur et à couper l’herbe sous le pied d’un candidat vraiment de gauche qui monte dans les sondages. Vous avez l’improvisation pour donner le change, puisque Hollande ne connaît pas vraiment le détail de sa mesure. L’opposition du patronat et des grandes fortunes qui fait le chantage à l’emploi et aux délocalisations. Et enfin le barrage du Conseil constitutionnel qui, un peu comme la Cour des comptes, joue le rôle de cerbère de l’ordre social – le Conseil constitutionnel dont il faut rappeler qu’il avait déjà retardé la mise en œuvre des nationalisations en 1982. Après, la question qui se pose pour une gauche qui reviendrait au pouvoir, c’est : que faire dans un cas pareil ? Vous avez annoncé telle mesure qui figure à votre programme, vous y croyez ou vous n’y croyez pas, peu importe. Vous avez un patron qui a déjà la réputation d’avoir quitté la France au moment de l’élection de François Mitterrand, et qui l’a effectivement fait, qui vous dit : cette mesure-là, vous ne pouvez pas l’appliquer. Qu’est-ce que vous faites ?
Ça veut dire quoi ?
Je n’ai pas la réponse, mais il vaut mieux se poser la question avant.
Là, on est en France dans une période qu’on peut appeler de renoncement. On ne voit pas que la gauche arrive au pouvoir dans les jours prochains.
Ça, franchement, on ne peut pas le savoir. Les échéances électorales sont ce qu’elles sont, mais en 1935 personne ne voit la gauche au pouvoir très vite, et en 1993 on ne pense pas non plus que Jospin remportera les élections législatives quatre ans plus tard.
Donc on n’est pas à l’abri d’une bonne nouvelle.
D’abord, on est en train de danser sur un volcan qui est celui des marchés financiers. Vous avez vu que la Bourse bouge très vite. On est dans un contexte aussi où la guerre menace. Je pense que c’est un contexte international particulièrement menaçant entre l’Ukraine, entre l’Iran, entre la Corée. Il est très difficile de dire que dans deux ans on sera tranquillement là où nous en sommes, à se demander si la gauche de Macron va s’opposer à la droite de Macron. Les choses sont un peu imprévisibles. Disons que les forces sociales qui appuient un projet de gauche semblent totalement démoralisées à l’heure actuelle.
Elles semblaient aussi démoralisées il y a cinquante ans, quelques semaines avant le 22 mars 1968.
Et en 1936, où on a un syndicalisme français qui passe en quelques mois de 600 000 membres à plus de 3 millions.
Il y a toujours ce mystère de l’événement. Après on sait pourquoi, mais avant on ne sait jamais comme cela peut surgir, ce qui est à l’œuvre dans le souterrain des choses. On ne sait jamais, même si on a quand même (comme tu l’indiques dans la préface de cette édition-là) des forces, des courants, des mouvements de gauche appelons-la « radicale ». En France on a le mouvement des Insoumis avec Mélenchon, on a Corbyn en Grande-Bretagne, on a Sanders aux États-Unis, Podemos en Espagne… Il n’y a pas rien, il y a des choses qui travaillent, qui cherchent, qui se constituent, qui existent bel et bien.
Oui, et c’est d’une certaine manière la bonne nouvelle. Quand les socialistes sont balayés du pouvoir en 1993, les forces qui existent ailleurs dans les autres pays, ce sont des forces néolibérales de gauche. C’est Clinton, c’est Blair, c’est les sociaux-démocrates et autres allemands. Maintenant, ce courant-là est dévalué, pas seulement en France, il est en quelque sorte en déroute un peu partout. La logique de cette collaboration avec le système économique que nous connaissons avec l’ordre libéral a été tellement poussée qu’est apparue sur sa gauche une force qui veut transformer les choses. Ça n’a pas toujours été le cas. Sanders aux États-Unis, on ne pense pas à un précédent dans les années écoulées. Il y en a eu très peu aussi au Royaume-Uni. Après tout, Corbyn est sans doute le dirigeant travailliste le plus à gauche depuis les années 1980, et il n’est pas impossible qu’il arrive au pouvoir.
Tu es plus pessimiste là, en parlant, que tu ne l’es dans le dernier paragraphe de ton livre quand on arrive à la page 610. Tu sais très bien ce que tu veux dire, et je le lis : « Tout au long du XXe siècle, la gauche a accédé au pouvoir grâce à la puissance des passions collectives, dont celle de l’égalité. Et puis, elle a accepté de les tamiser avant de les étouffer sous une couverture de rationalité technique. Cette retraite bureaucratique, cette nouvelle conscience qui ne voit dans le monde que moyens et machines ont forgé les barreaux de sa cage de fer. » Donc nous sommes dans une cage de fer.
C’est la gauche de gouvernement dont je parle là.
Tu ne parles pas de la gauche de mouvement ?
Non. C’est la gauche de gouvernement qui a entériné un certain nombre de contraintes.
Mais elle aspire au pouvoir. Qu’est-ce qui pourrait faire qu’elle ne se laisse pas enfermer à nouveau dans cette cage de fer ?
À mon avis, l’une des conditions préalables, c’est qu’elle étudie les difficultés qu’elle a à affronter, et qu’elle mesure quels sont les moyens qui lui permettront de s’y soustraire, pour ne pas être surpris par des choses qui maintenant ne sont pas surprenantes. Ce qui est assez intéressant quand on étudie l’histoire de la gauche, c’est que jusqu’à une date récente les dirigeants socialistes et communistes avaient une très bonne connaissance de leur histoire, et pourtant ils avaient tendance à refaire les mêmes erreurs. Il y a même un passage que je cite à un moment, en 1982, quand Mauroy explique pourquoi il n’a pas fait la dévaluation au moment où François Mitterrand a été élu. Il dit : je sais que la gauche a pris des mauvaises mesures dans le passé, je décide qu’il faut tenir bon et ne pas dévaluer. On se dit : mais quelle est la leçon de l’histoire qu’il a retenue ? Puisqu’il est en train de refaire exactement la même erreur que celle de Léon Blum en 1936. Léon Blum arrive au pouvoir, il ne veut pas dévaluer, il dévaluera cinq mois plus tard quand son crédit est déjà atteint. Et puis il dévaluera une deuxième fois en juin 1937. François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981, il ne veut pas dévaluer. Il sera obligé de dévaluer cinq mois plus tard quand son crédit est déjà un peu atteint, en octobre 1981. Et il dévaluera une deuxième fois en juin 1982. Alors on se dit que s’il avait vraiment voulu éviter les erreurs de son prédécesseur, il s’y serait pris sans doute autrement.
Tu t’adresses aux dirigeants, aux professionnels de la politique. Il semblerait qu’ils auraient besoin de rafraîchir leur mémoire et de connaître un peu mieux leur histoire. En tous les cas, l’histoire qu’on vient d’évoquer là, l’opinion, de façon générale, l’ignore tout à fait.
Je pense qu’il y a des épisodes qui sont connus quand même. Je crois que le Front populaire c’est connu, Mitterrand c’est connu. La Libération, ce qui est connu, c’est la Sécurité sociale. Les gens doivent quand même avoir l’idée que la Sécurité sociale n’est pas tombée du ciel, c’est le produit d’une victoire politique inouïe et on vit encore avec elle ; et que s’il n’y avait pas eu un gouvernement tripartite, avec la gauche, avec le Parti communiste qui a joué un rôle majeur dans cette affaire, il n’est pas évident qu’on aurait cette conquête que bien des pays du monde nous envient.
Une conquête qui est très menacée aujourd’hui
Oui, bien sûr. Il y a des tas de choses qui sont menacées. Ce sont des discussions qu’on a souvent. À force d’annoncer que tout est démantelé, on se dit que vraiment, on est cuit. Mais on annonce que tout est démantelé, ou qu’une nouvelle réforme va démanteler l’hôpital tous les cinq ans. Ça veut dire que la précédente n’a pas tout démantelé, qu’il reste quelque chose. Donc il faut aussi insister sur ce qui reste, en quoi c’est utile et comment on l’a obtenu.
C’est un défaut que nous avons tous de noircir le tableau dans l’espoir de susciter l’indignation, la colère et la mobilisation. Alors qu’ ainsi souvent on ne fait que déprimer le monde un peu plus, en oubliant qu’il faut au contraire noter les avancées et les progrès. Ce qui ne nous dispense absolument pas de continuer le combat.
journaliste : Daniel Mermet
transcription : Josette Barrerra et Jérémie Younes
Publié le 27/07/2018
précarité « J’aurais pu partir en vacances depuis des années, mais… »
Ixchel Delaporte (site l’humanité.fr)
En cette période estivale, nombre de familles n’imaginent même pas pouvoir voyager, ignorant les aides sociales qui leur permettent de faire valoir ce droit. Grâce au soutien d’une association, Christine, elle, va enfin goûter aux joies de la campagne avec son fils.
Le jour où Christine a appris qu’elle partirait en août avec son fils en vacances, elle a pleuré de joie. Dans son deux-pièces, situé dans la résidence sociale Albert-Camus, dans le nord de Paris, Christine sort une pochette rouge où elle consigne précieusement les documents de son séjour : billets de train, feuille de route, photos de la caravane au milieu des pins et du plan d’eau. Du 7 au 20 août, elle quittera enfin la rumeur et le rythme infernal de la capitale pour « la verdure », dans un camping en bord de Garonne à une demi-heure de Bordeaux. Pour la première fois de sa vie, cette maman de trois enfants (3 ans, 16 ans et 17 ans), femme de ménage dans une école, bénéficiera de bons de la caisse d’allocations familiales (CAF) et des chèques-vacances. Sa participation à elle ne sera que de 68,80 euros. « En fait, j’aurais pu partir depuis des années mais je n’ai jamais profité des bons CAF car je ne comprenais pas très bien leur fonctionnement… »
C’est grâce à une autre maman qu’elle apprend l’existence de l’association Vacances et familles, basée à Montreuil, dont la vocation est d’accompagner les bénéficiaires d’aides aux vacances. Arwa Zaarra, salariée de cette association qui aide près de 1 000 familles par an à partir, explique les nombreux obstacles : « Nous voyons souvent arriver des familles monoparentales qui ne comprennent pas le système des bons CAF et qui ne feront pas la démarche pour partir en séjour. Les familles ne connaissent pas toujours leurs droits. » Mais lorsqu’elles font la démarche de prendre un rendez-vous, souvent aiguillées par les CAF ou par des assistantes sociales, ces familles ont déjà fait la moitié de la route pour les vacances.
« Lorsqu’on les reçoit, on examine leur situation, poursuit Arwa Zaarra. On leur demande où elles aimeraient aller. Certaines n’ont pas quitté leur appartement depuis des années, donc nous adaptons le séjour dans un village vacances, un camping ou un gîte. Nos 1 500 bénévoles sont là pour aider au bon déroulement de ces congés. » Créée en 1962 par Malou Barbe, une assistante sociale blanc-mesniloise, l’association vise un deuxième objectif à long terme : l’acquisition d’une autonomie suffisante pour que les familles envisagent un départ en vacances seules.
« Je n’ai jamais pu faire ça avec mes deux grands »
Pour Christine, la proposition de l’association est tombée comme un cadeau. Lorsqu’elle se présente à l’association en avril dernier, elle expose sa situation de maman célibataire. « Mes deux grands enfants ne souhaitent pas partir en vacances avec moi. Mais le plus petit, lui, a besoin de prendre le bon air de la campagne. J’ai besoin de silence et de repos. La seule chose que je voulais, c’était aller dans le Sud ! »
Voilà huit ans que Christine vit dans un petit appartement rudimentaire. Et voilà trois ans qu’elle dort dans le même lit que son fils et que ses deux adolescents partagent une chambre. « Cette résidence est censée être un point de transit de trois ans au plus, explique-t-elle. Mais la plupart des gens sont comme moi, sans autre solution d’hébergement. ça fait dix-huit ans que j’attends un logement social », se désole cette quadragénaire. Avant son arrivée dans cette résidence, Christine et ses deux enfants ont vécu dans des hôtels d’urgence pendant quelques années. « Je me suis occupée d’eux comme j’ai pu. Il m’était impossible de travailler. Aujourd’hui, j’ai enfin trouvé un travail pour quelques heures par semaine, mais nous vivons comme des rats ici. C’est précaire. Je n’invite jamais personne. Pour joindre les deux bouts, j’ai recours à l’épicerie solidaire. » Cette maman a pourtant été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable.
Très impatiente de prendre le train avec son fils Benjamin, Christine sait qu’un bénévole de l’association viendra la chercher à la gare de La Réole pour la conduire au camping du Fontet. Depuis plusieurs semaines déjà, Jean-Pierre Malirat, bénévole girondin de l’association depuis 2009 et membre du conseil d’administration, s’affaire pour préparer l’accueil. En août, il recevra Christine et son enfant. « Nous attendons les familles à la gare avec un écriteau puis nous les aidons à s’installer. Nous organisons ensuite un pot d’accueil avec une animation de cirque. Nous sommes des référents, un peu pour les rassurer, mais le but reste l’autonomie des familles », explique-t-il. Pendant la durée du séjour, elles peuvent solliciter la vingtaine de bénévoles présents pour faire des courses ou de petites réparations. Mais surtout des activités sont proposées deux fois par semaine à la dune du Pilat sur le bassin d’Arcachon ou encore au parc d’attractions Walibi à Agen. « Pour ces sorties, c’est essentiellement le soutien de l’Agence pour les chèques-vacances, qui rend ces offres possibles. C’est une dotation très importante sans laquelle on ne pourrait pas faire sortir les familles dans la région », précise Jean-Pierre Malirat.
Avec un grand sourire, Christine ne se lasse pas de regarder la photo de la petite caravane posée sur un bout d’herbe, entourée de grands pins parasols, et celle aussi de la base nautique du Fontet. « Quand je vois ce petit lagon bleu et cette plage, je sens que ça va être magnifique, je vais bien dormir ! Je n’ai jamais pu faire ça avec mes deux grands. Je suis très émue de pouvoir le faire avec mon fils. J’enverrai une carte avec une photo de nous à l’association. »
Le tourisme, levier d’action sociale et solidaire
Créée en 1982, l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont le but premier est de favoriser le départ en vacances des Français, a fait évoluer ses propositions pour toucher des publics qui échappaient aux dispositifs existants. C’est le cas du dispositif « Ville, vie, vacances » à destination des jeunes des quartiers prioritaires. « Plus de 2 500 jeunes filles et garçons sont partis, avec pour but de profiter de vacances mais aussi d’acquérir des compétences et de les réinsérer dans un parcours professionnel, explique la directrice de l’action sociale, Dominique Ktorza. Cela permet de lutter contre l’isolement et a même un impact sur la santé. »
Ixchel Delaporte
>
Publié le 26/07/2018
Benalla et l’arc d’extrême
droite
de : Frédéric Lordon (site bellaciao.org)
L’affaire Benalla, c’est la police qui en parle le mieux. « Nous avons le sentiment que d’une affaire Benalla, on est en train de faire une affaire de police (1) », déclare un syndicaliste policier. Précisément. Et d’ajouter dans un éclair de lucidité dévastatrice : « Ce n’est pas ça la police. Il a ruiné notre image. » Bien sûr, avant d’être dévastatrice, cette lucidité est paradoxale puisqu’elle prend la forme retournée de la dénégation, ce tour du psychisme qui fait dire la vérité mais en énonçant le contraire de la vérité. En lieu et place de « ça n’est pas ça la police » et « il a ruiné notre image », le lecteur attentif aura évidemment rectifié de lui-même pour entendre « la police, c’est tout à fait ça (si ça n’est pas bien pire) » et « il a mis en pleine lumière ce que nous sommes ».
La mise au débat public des manières réelles de la police via les méfaits d’un séide de seconde zone fait irrésistiblement penser à Al Capone, tombé pour fraude fiscale. Hegel appelait « ruse de la raison » cette manière particulière qu’emprunte parfois l’histoire pour s’accomplir : les tournants majeurs se négocient au milieu des broutilles, et l’Histoire majestueuse avance par les forces des histoires de cornecul. L’Histoire de la période présente, c’est qu’il y a un problème de police, et même de police-justice, dans ce pays, un problème de première grandeur, où il faudra bien se décider à voir un symptôme politique.
Au reste, il appartiendrait à une minutieuse enquête de sociologie des médias d’éclairer ce mystère de l’émoi qui a saisi les rédactions au spectacle d’une scène de violence que, dans leur propre norme désormais déformée, les manifestants ne seraient pas loin de trouver « ordinaire ». C’est que depuis deux ans, en fait depuis la manifestation COP 21 du 29 octobre 2015, date d’inauguration de l’état d’urgence à usage des opposants politiques, la violence policière déployée contre les manifestants n’a cessé de passer des seuils. La police matraque, la police éborgne, la police grenade, mutile et tue. À qui veut se donner la peine de simplement regarder, les réseaux sociaux offrent depuis deux ans des tombereaux de vidéos de brutalités policières proprement ahurissantes, dont le centième suffirait à horrifier la population… si seulement on les lui donnait à voir. Mais à cette exposition, qui entre normalement dans le minimum minimorum des devoirs de la presse, la population n’a jamais eu droit. Sauf aujourd’hui.
Mais pourquoi ? Parce que, misère du journalisme politique, ce concentrat de toutes les tares de la presse contemporaine, il est question de « l’Élysée ». Et la séquence, alors, redevient intéressante. C’est pourtant tout autre chose qui se passe depuis deux ans, autre chose que les méfaits d’un voyou monté en grade : une entreprise d’intimidation généralisée de toute opposition politique sérieuse, méthodiquement conduite par les institutions de la police et de la justice. Intimider systématiquement par la violence institutionnelle et par la violence physique : menace de la garde-à-vue dans des conditions dégradantes qui glaceraient les spectateurs d’un film sur quelque dictature d’autres latitudes, menace de la prison pour des faits inexistants : un étudiant de Paris 1 a pris de la prison (de la prison ! – 4 mois avec sursis) pour avoir simplement été pris avec dans son sac un sweat à capuche, du sérum physiologique, un masque et des lunettes de piscine, c’est-à-dire le viatique minimal pour faire face aux agissements de la police. Menace de violence institutionnelle, donc, et menace de violence ouverte, expressément faite pour que les manifestants soient envahis du sentiment de mettre en jeu leur intégrité physique au moment où ils s’apprêtent à exercer leurs droits politiques fondamentaux. Ici se pose une question lexicale presque insoluble à force de complexité : sous quelle catégorie, en « isme » par exemple, résumer les pratiques d’un pouvoir qui s’attache ainsi à méthodiquement terroriser ses citoyens ? Pour la police elle-même, c’est parfois trop : un gardé à vue d’Arago témoigne ainsi que l’OPJ auquel il avait affaire restait interloqué des consignes venues d’en-haut d’administrer pareils traitements à une poignée d’adolescents.
De tout cela, les médias n’ont jamais sérieusement parlé. Et le pire est que, même avec un Benalla sous le nez, ils n’en parleront pas. Comme ils ne feront aucun des liens pourtant évidents que cette pitoyable affaire suggère de faire. À commencer par celui de la scène et de son contexte. Car Benalla tabasse hardiment, comme la police, mais en plein mouvement social contre les ordonnances SNCF. Mouvement social, opposants, contestation, contestation débordante même étant donnée la nullité des principales confédérations syndicales : par conséquent faire peur. Faire peur en massacrant le premier venu et, sous le regard terrorisé des autres, faire passer à tous l’envie de revenir. Voilà le régime politique dans lequel nous vivons, dont les médias, dans un mélange de collusion fondamentale et d’insuffisance intellectuelle, ne diront jamais le moindre mot en toute généralité – l’affaire Benalla de ce point de vue est idéalement faite pour leur (re)donner l’impression d’être le fer de lance de la démocratie : parbleu, ils enquêtent ! ils soulèvent, ils sont intransigeants, ils n’hésitent pas à fièrement bousculer le pouvoir, ils sont la liberté en marche (pardon – enfin oui quand même, justement, la « liberté en marche », c’est-à-dire la version « En marche » de la liberté, la liberté Potemkine qui ne sait rien, ne veut rien savoir, et ne rien dire, de toutes les offenses aux libertés réelles).
Il est vrai qu’on ne passe pas facilement de la pâmoison devant Macron-le-disciple-de Paul Ricoeur à Macron chef de bande à la tête d’un État-racaille. Il est plus vrai encore qu’ouvrir les yeux sur toutes ces choses immontrables forcerait à des révisions autrement déchirantes, une révision des catégories générales, les plus difficiles à bouger puisqu’elles commandent une entière vision du monde, dont l’abandon se paye de tous les coûts psychiques de s’avouer à soi-même s’être si longtemps, et si profondément, trompé. Ainsi, de même qu’on n’a jamais réussi à faire reconnaître à l’éditorialisme que le Parti socialiste n’avait plus rien à voir avec le signifiant « gauche », dont l’étiquette lui avait été maintenue dans un mélange d’inertie et de cécité volontaire, de même il n’y aura probablement pas moyen de faire entendre que le néolibéralisme est un anti-démocratisme, qu’il est, par essence et non par accident, un illibéralisme, catégorie précisément formée pour être appliquée aux « autres » (les Hongrois, les Polonais…), c’est-à-dire pour mieux se dédouaner soi-même.
Et, pour revenir dans le registre des étiquettes politiques, il y aura, a fortiori, moins d’espoir encore de faire voir, et de faire nommer, la part d’extrême droite de ce pouvoir élu pour, selon l’expression désormais couverte de ridicule, faire barrage à l’extrême droite. C’est qu’il n’y va plus ici de simplement reconnaître s’être trompé, mais – on ne voit pas trop comment le dire autrement – de s’être chié dessus. Dieu sait pourtant qu’il y aurait beaucoup à dire sur les rapports nombreux, variés, repérables dans une multitude de plans théoriques, qui relient la forme quintessentielle du néolibéralisme donnée par le macronisme et l’extrême droite.
On savait déjà, au moins pour qui avait le désir de savoir, que ces deux formes entretiennent, et depuis bien avant même le macronisme, des rapports de parfaite complémentarité externe : l’extrême droite comme opérateur de toutes les prises d’otage électorales. Nous découvrons depuis quelques années que ce rapport de complémentarité externe se double d’un rapport de fonctionnalité interne : tout pouvoir néolibéral requiert son pôle d’extrême droite, puisque la violence sociale sans limite, à quoi s’ajoute l’abyssale carence des médiateurs syndicaux, voue la contestation à prendre des formes moins standard, moins benoîtement ritualisées, et moins inoffensives, contre lesquelles l’État ne trouve plus que sa violence physique à opposer.
C’est ce mouvement général qui n’a pas manqué d’émerger au fur et à mesure que s’opérait l’approfondissement du néolibéralisme, particulièrement sous gouvernement « socialiste » (Hollande-Valls), à un point tel qu’on n’avait aucun sentiment de pareille dangerosité à aller manifester sous Sarkozy ! – nous l’aurons découvert avec le solférinisme. En réalité, c’est bien moins une affaire de personnes et d’étiquettes (elles n’ont plus aucun sens à ce degré d’indifférenciation) que de dynamique structurelle, la dynamique de l’obstination forcenée à administrer le néolibéralisme à des populations qui n’en veulent pas, et des caps que fait immanquablement franchir cette obstination.
Comme une illustration supplémentaire de cette propension des médias à croire s’acquitter d’un devoir de rapporter sans en fait jamais rien montrer, on devrait se souvenir de cette étude d’un chercheur américain (2), reprise aussi platement que possible et sans aucun esprit de suite dans la presse française, s’appuyant sur le World Values Survey et l’European Values Survey pour établir ce paradoxe que les électeurs du centre, et non les « extrémistes » comme on l’aurait attendu (souhaité), sont les moins attachés aux principes de la démocratie. Ici, il faut sans doute en revenir à la catégorie d’extrême centre, proposée par Alain Deneault (3) pour dire comme il convient cette forme inaperçue de fanatisme qu’emporte le néolibéralisme, et être un peu plus au clair quant à la question de savoir qui sont les vrais radicalisés dans la société – ils sont au pouvoir.
C’est ainsi qu’émerge, à l’encontre de l’indigence médiatique du « nouveau monde », cette forme politique pour le coup inédite de l’arc d’extrême droite, précisément parce que tout pouvoir néolibéral appelle fonctionnellement son pôle interne d’extrême droite, si bien qu’il y a désormais de l’extrême droite partout dans le paysage des « partis de gouvernement », et non plus seulement dans le dépotoir FN où l’on aurait tant voulu qu’elle demeurât confinée. Décidément préposé à dire la vérité du régime, Gérard Collomb aura donné sa formulation la plus achevée à la compatibilité, voire à la convergence, du néolibéralisme et de l’extrême droite avec son propos sur « les migrants qui font du benchmarking (4) », aussi remarquable par le cap d’ignominie joyeusement franchi que par le caractère inédit de la synthèse qu’il opère. Alors fatalement, les débordements s’appellent l’un l’autre : au débordement de la contestation, qui n’a plus aucune autre solution que de déborder, répond le débordement de l’extrême droite interne : celle de Valls, de Collomb, de Macron – et ce malheureux Benalla n’a probablement pas idée de son personnage hégélien, du statut de « ruse de la raison » incarnée qui lui échoit aujourd’hui.
Un malheur n’arrivant jamais seul, l’affaire Benalla éclate à quelques jours de la marche pour Adama. Pour le syndicalisme poulaga qui s’escrime à jurer que « la police, ça n’est pas ça », la collision est terrible. On ne répétera jamais assez combien les marges de la société servent de terrain d’expérimentation aux pratiques de l’ordre vouées à s’appliquer par extensions successives à des fractions de plus en plus larges de la société. Ce que les médias laissent à l’état dispersé, poussière de faits divers sans conséquence et sans lien, bref sans aucune leçon générale, là encore rapportés sans être montrés, un événement comme le rassemblement de Beaumont le concentre de la plus effrayante des manières. Doublement effrayante en vérité, d’abord par le simple récit des meurtres, et de la manière dont les institutions, de concert, mentent pour les couvrir. Mais, plus fondamentalement, à faire découvrir la nature particulière de la violence d’État qui s’exerce ici, non pas d’après quelque fait de contestation, mais à raison de l’existence même, nue, des individus, constitués en indésirables ontologiques – et l’on peine à croire dans ces conditions qu’il y ait tant de résistance à vaincre pour en venir à la conclusion évidente d’un racisme institutionnel.
Il fallait entendre en tout cas, ce 21 juillet, les prises de parole de tous les proches des tués sans raison, sans droit, sans rien, oui, comme des chiens, mères, frères, sœurs, le cœur brisé, voix étranglée de sanglots au moment de prendre la parole, racontant des choses proprement hallucinantes, des choses qu’on ne peut pas croire, et pourtant qu’il faut croire : parce qu’elles sont vraies.
Alors désormais nous attendons. Nous attendons de voir s’il se trouve quelque média pour enfin montrer toutes ces choses, entendons : pour les montrer vraiment, c’est-à-dire autrement que comme une série d’articles factuels mais sans suite ni cohérence, par-là voués à l’oubli et l’absence d’aucun effet politique, quelque média pour connecter ce qui doit l’être, non pas donc en en restant au confortable FN, mais en dessinant enfin l’arc qui est maintenant sous nos yeux, l’arc qui emmène de Marine Épouvantail Le Pen à Valls, Collomb, Macron, qui fait le rapport entre la violence pluri-décennale dans les banlieues et celle plus récente dans la rue, ou contre les syndicalistes trop remuants, et ceci quitte, s’il le faut (on sent qu’il le faudra…), à demander aux journalistes-remparts-de-la-démocratie d’aller puiser dans leurs souvenirs d’enfance : « relie les points dans l’ordre des numéros et tu verras apparaître une figure ». Avertissons d’emblée ces âmes sensibles : ici on va voir apparaître une sale gueule.
En guise de complément
Un ami suggère de voir dans l’affaire Benalla une manifestation inattendue, mais finalement très cohérente, du managérialisme macronien : en quelque sorte l’organisation au sommet de l’État d’une start-up de la « répression agile » – hors institutions, hors règle, hors tout protocole formel, orientée par la seule « efficacité » –, et c’est une interprétation qui ne manque pas d’intérêt. Assez curieusement, on pourrait y voir aussi, et plus classiquement, une parfaite illustration de la souveraineté devenue folle, c’est-à-dire en fait se comprenant elle-même dans la pureté de son concept, comme puissance absolue et absolument déliée, n’ayant à répondre de rien à personne, faisant valoir l’arbitraire de sa volonté comme acte politique par construction licite, le pur « je veux » d’un pouvoir complètement désorbité.
Il se pourrait qu’il n’y ait pas à choisir entre les deux lectures, comme le suggère d’ailleurs le fait qu’il se soit trouvé des éditorialistes assez complaisants ou assez idiots pour donner, selon son souhait, du « Jupiter » au président de la start-up nation, conjonction en soi tératologique, mais qui dit assez la compatibilité de l’absolutisme politique et de la soi-disant « modernité managériale ». Et le paradoxe de cet accolement contre-intuitif se résout complètement si l’on voit dans la revendication de l’« agilité » l’expression d’un désir du capital de jouir de latitudes indéfiniment étendues, d’y manœuvrer entièrement à sa guise – d’être lui aussi, dans son ordre, souverain. L’agilité, la souveraineté, deux manières de dire, chacune dans leur domaine, le désir des puissances de s’exercer sans la moindre contrariété, sans la moindre force de rappel institutionnelle, la détestation de toute limitation.
Il a fallu trois décennies de transformation profonde des structures économiques pour que le capital acquière la possibilité objective de faire ce qu’il veut, et la certitude subjective de sa toute-puissance. D’une toute-puissance l’autre, en quelque sorte. Celle du capital en miroir de celle de l’État. Et en quel personnage mieux qu’en Macron, fondé de pouvoir du capital, devenu zinzin à se prendre pour un roi de France, ces deux formes de la souveraineté absolue pouvaient-elles mieux se rejoindre, fusionner même ? L’absolutisme politique donne alors la main à l’absolutisme économique, l’aide à mieux s’accomplir, lui ouvre la voie juridique à coups d’ordonnances, et dégage les oppositions en faisant donner les cogneurs « agiles » du cabinet privé.
Les « barragistes » ont vraiment bonne mine.
(1) Jean-Paul Megret, secrétaire national du Syndicat indépendant des commissaires de police, entretien : « Affaire Benalla : “Ce ne sont pas les barbouzes qui doivent assurer la sécurité de l’Elysée” », Le Monde, 21 juillet 2018.
(2) David Adler, « Centrists are the most hostile to democracy, not extremists », New York Times, 23 mai 2018.
(3) Alain Deneault, Politiques de l’extrême centre, Lux éditeur, 2017.
(4) Gérard Collomb, audition Sénat, 30 mai 2018.
Publié le 25/07/2018
À Calais, les violences policières contre les migrants se poursuivent malgré les protestations
par Olivier Favier (site bastamag.net)
À Calais et alentours, les candidats à l’exil vers l’Angleterre continuent à installer des campements de fortune en attendant de réussir à traverser la Manche. Éparpillés dans les dunes, ils survivent dans des conditions extrêmement précaires et doivent faire face à un niveau élevé de harcèlement policier. Destruction de téléphones, fonctionnaires qui urinent sur les tentes, matériel de camping jeté dans l’eau ... les associations présentes sur le terrain rapportent des témoignages effarants. Reportage.
C’est une étape importante de « La Marche citoyenne et solidaire avec les migrants », partie le 30 avril de Vintimille en direction de Londres. Sous le soleil de juillet, elle relie Grande-Synthe à Calais par la route de Gravelines. Les marcheur(euse)s longent ainsi la lande qui de 2015 à 2016 a accueilli jusqu’à plus de 10 000 candidats à l’émigration pour l’Angleterre. Depuis lors, le bidonville a été évacué et nombre de ses habitant(e)s ont été emmenés vers des Centres d’accueil et d’orientation (CAO) répartis sur l’ensemble du territoire français. À première vue, dans la région de Calais, la situation semble désormais entièrement contrôlée par les pouvoirs publics. Le matin-même à l’Office du tourisme, une hôtesse d’accueil qui ne semble rien savoir du passage de la « Marche citoyenne » exprime son soulagement : « La crise des migrants c’est fini. Les médias vont enfin pouvoir parler d’autre chose. »
Des migrants de plus en plus vulnérables
Près des dunes situées à sept kilomètres à l’est de la ville, un campement rassemble une cinquantaine de Soudanais. La zone portuaire qui est déjà officiellement en territoire anglais est toujours surveillée et protégée de toute incursion par de hauts grillages. Dans Calais et dans ses alentours, on parle de quelques 700 personnes disséminées sur plusieurs sites. C’est un nombre et une situation assez semblables en apparence avec ce que la ville a connu depuis l’évacuation du centre de Sangatte en 2002. Les associatif(ve)s en témoignent par les appels reçus : chaque semaine, les migrants continuent de passer par petits effectifs. En langage bureaucratique, on dira qu’un « flux discret » empêche que le « stock » devienne un « point de fixation ».
En février dernier, toutefois, une rixe d’abord présentée dans la presse comme un affrontement entre migrants érythréens et afghans — en fait une agression des premiers par des passeurs — a fait cinq blessés par balle. L’un d’eux, touché à la nuque, est resté tétraplégique. Une violence d’une telle ampleur, en plein jour, témoigne d’une situation particulièrement chaotique, où les trafiquants se font plus menaçants par peur d’en perdre le contrôle. D’un côté, les migrants ont plus que jamais besoin de leurs « services ». De l’autre, la dispersion les rend encore plus vulnérables.
Des atteintes aux personnes d’une inédite gravité
Le décor répressif qui s’est pérennisé autour des embarcadères s’accompagne d’un niveau élevé de harcèlement policier. Constamment dénoncé par de nombreuses associations depuis plus d’un an, il est d’abord le fait d’une présence massive des Compagnies républicaines de sécurité — six ou sept compagnies selon Christian Salomé, le président de l’Auberge des migrants — soit un effectif comparable à celui des migrants eux mêmes ! En janvier, cette association s’est jointe au Secours catholique en portant plainte contre X pour « destruction et dégradation de biens ». À l’origine par ailleurs de la Marche solidaire, elle s’est déjà unie à Utopia 56 en juin 2017 dans une lettre envoyée au nouveau président de la république et au ministre de l’Intérieur.
Quelques jours plus tôt, le Défenseur des droits avait évoqué une « sorte de traque » et des atteintes aux personnes « d’une inédite gravité ». En juillet 2017, un rapport de l’ONG Human Rights Watch dénonçait lui aussi « un usage excessif et disproportionné » de la force. En octobre, devant tant de voix concordantes, un rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA), de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) diligenté par le ministre de l’Intérieur reconnaît a minima que « l’accumulation des témoignages écrits et oraux, bien que ne pouvant tenir lieu de preuves formelles, conduit à considérer comme plausibles des manquements à la doctrine d’emploi de la force et à la déontologie policière, principalement à Calais ».
Destruction de matériel et violences sur les corps
Des témoignages du même ordre sont encore portés à la connaissance d’un plus large public par le réalisateur Yann Moix, dans son documentaire Re-Calais, diffusé le 9 juin 2018 sur Arte. Professionnelle ou bénévole, chaque personne présente sur le terrain en a long à dire sur le sujet. G., par exemple, de l’association Utopia 56, fait état d’innombrables abus rapportés par les migrants : destruction de téléphones, fonctionnaires qui urinent sur les tentes, matériel de camping jeté dans l’eau, agents se photographiant avec les personnes qu’ils contrôlent comme les colons d’autrefois avec les « indigènes ». Les corps aussi portent des traces suspectes. « Du temps du bidonville, nous emmenions constamment des gens à l’hôpital, un peu moins maintenant, depuis que les médias se sont emparés du sujet. La semaine dernière pourtant, j’ai accompagné un jeune. Lorsque j’ai dit au médecin que la marque sur son dos pouvait être la conséquence d’un coup de matraque, il m’a répondu que ce n’était pas son problème. »
Si les associatif(ve)s apportent ou relaient de très nombreux témoignages, tous soulignent la difficulté — l’impossibilité souvent — de constituer des preuves. Les violences les plus caractérisées se déroulent en effet à l’abri des regards et des caméras. À leur égard, professionnel(le)s et bénévoles dénoncent des contrôles d’identité répétés, des interdictions de filmer, des verbalisations abusives. G. raconte ainsi qu’à la suite d’un contrôle, il a eu une amende pour absence de roue de secours dans son véhicule de service. Elle avait été changée une heure plus tôt suite à une crevaison. Des fonctionnaires recourent à l’intimidation : d’autres associatif(ve)s disent avoir été suivi(e)s jusqu’à leur domicile.
Si la brutalité débridée se cache, le harcèlement constant mené par les forces de police à l’encontre des migrants est visible au grand jour. En mars 2017, la maire Les Républicains Natacha Bouchart interdit les distributions de nourriture dans la zone de l’ancien bidonville, un arrêté aussitôt annulé par le tribunal de Lille. Deux mois plus tard cependant, les associations témoignent d’une distribution empêchée par les forces de l’ordre. En juin, réagissant à une saisie des associations réclamant la création d’un nouveau lieu d’accueil, le tribunal de Lille y oppose une fin de non recevoir. Il oblige néanmoins la ville et l’État à installer sous dix jours des points d’eau et des sanitaires.
Un harcèlement constant et largement documenté
Si l’hostilité affichée par la commune ne faiblit pas, Christian Salomé explique que la situation lui échappe désormais totalement. « Quelle que soit leur position sur le sujet qui peut être radicalement différente, comme à Grande-Synthe et Calais, les maires sont hors-circuit depuis l’arrivée de Macron à l’Élysée. Les préfets et sous-préfets prennent des décisions sans prévenir. » Dans un rapport d’avril 2018 — qui fait suite à un autre de décembre 2017 — L’Auberge des migrants fait état de deux types d’opérations menées très régulièrement par les CRS.
Pour les opérations de « confiscation », elles agissent en convoi de 5 à 12 camions, accompagnées d’une voiture de police du commissariat local. Un périmètre de sécurité est défini, duquel journalistes et associatifs sont tenus à l’écart. Puis les agents de nettoyage de la ville de Calais ramassent l’intégralité ou presque du matériel dévolu au couchage et à la nourriture des migrants. Dans certains cas, des agents de la sous-préfecture sont présents sur les lieux. Interrogés par les associatifs, qui s’efforcent d’être présents à toutes les évacuations, ils expliquent leur présence par la nécessité d’informer sur les possibilités de demande d’asile en France. Dans les faits, ils n’ont avec les occupants qu’une « communication limitée ».
Ces opérations durent entre une demi-heure et plusieurs heures. Elles ont lieu chaque jour ouvré dans les différents lieux de vie des migrants. La fréquence de passage dans un même campement est hebdomadaire. Dans un cas cependant, il ne s’est écoulé qu’un jour et demi entre la distribution de tentes et une nouvelle évacuation. En tout 142 évacuations ont été recensées entre octobre 2017 et avril 2018. L’autre type d’opération est la destruction pure et simple des biens des migrants. Ces actions-là ne durent que quelques minutes, généralement à l’aube ou à la nuit tombée, à l’abri des regards. Les effets personnels sont rendus inutilisables au moyen d’objets coupants, de matraques ou de gaz lacrymogènes. À l’arrivée des associations, il est déjà trop tard. Les responsables ont quitté les lieux.
Des opérations menées au grand jour et dans l’illégalité
Les conséquences immédiates sont évidentes : l’extrême précarisation de personnes se trouvant déjà en situation de grande fragilité et un coût supplémentaire occasionné par le renouvellement incessant du matériel de couchage et de nourriture. Mais l’association alerte aussi sur « l’absence de base légale apparente » pour la mise en œuvre de ces opérations. Dans son rapport, l’Auberge des migrants cite un seul cas où un document a été présenté comme justificatif : une réquisition du procureur de Boulogne-sur-Mer pour procéder à des contrôles d’identité dans différents quartiers de Calais, laquelle n’autorise en rien l’expulsion de terrain ou la confiscation d’effets personnels. Ces actions menées en-dehors de tout cadre juridique clairement établi et signifié correspond à ce que l’ONU définit comme des « évacuations forcées ».
Parmi la population locale, on perçoit parfois une sourde hostilité envers les personnes migrantes. Mais pour G., « les gens en ont surtout marre d’être abandonnés par des gouvernements successifs qui ne font rien. » Au soir du 6 juillet 2018, la « Marche citoyenne » s’approche de la cour du « Channel », la Scène nationale de Calais. Toute la journée, des militants ont préparé un grand repas solidaire pour accueillir les marcheurs. Aux fenêtres, quelques habitant(e)s sourient ou applaudissent. Les forces de l’ordre encadrent le cortège à distance, attentives aux photographes venus couvrir l’événement.
Peu avant d’arriver à destination, quatre militant(e)s vêtus de tee-shirts blancs, avec le mot « police » écrit au feutre indélébile, entament un happening. Ils/elles feignent d’appliquer une nouvelle règle fantaisiste inventée par l’État : « Tous ceux qui font plus d’1 mètre 70 ne passeront pas la frontière ». Les manifestant(e)s se prêtent au jeu, les rires fusent. En dénonçant par l’absurde l’arbitraire de la loi, la saynète dévoile en un instant l’inanité du système derrière son plus visible rouage. Par delà la question « Que fait la police ? » obstinément répétée, s’en pose une autre tout aussi essentielle : « Mais pourquoi agit-elle ainsi ? Au nom de qui et de quoi ? »
Olivier Favier
Publié le 24/07/2018
« Un pognon de dingue » : les médias tombent dans le panneau de la communication élyséenne
par Patrick Michel, (site acrimed.org)
La vidéo montrant Emmanuel Macron parlant du budget des aides sociales en des termes inhabituels pour un responsable politique a été à l’origine d’une vaste campagne médiatique. La diffusion nocturne de cette vidéo sur le compte Twitter de l’Élysée, autant que son contenu étaient visiblement destinés à nourrir le « buzz » dont raffolent les médias dominants. Ces derniers se sont d’ailleurs empressés de couvrir « l’événement » au cours d’une séquence centrée sur la forme des déclarations présidentielles et faisant la part belle au « commentariat » le plus dépolitisé. Et quand, rarement, il fut question du fond, éditocrates et experts épousèrent le cadrage et les préoccupations (austéritaires et néolibérales) élyséennes, et ne donnèrent pas la moindre place à des questionnements plus généraux (et encore moins à des discours alternatifs) sur le système de protection sociale, son niveau, son financement et sa raison d’être, préparant ainsi le terrain médiatique (et politique) à un nouveau recul social.
Coup d’envoi : une fuite et quelques déclarations ministérielles
Dans un article daté du 18 mai, Le Monde inaugurait le nouveau cycle d’un débat récurrent dans l’espace public : se basant sur une note interne des services du budget, le journal révélait « les pistes explosives de Bercy pour réduire les aides sociales. » Cette note avait-elle été transmise à dessein au journaliste du Monde pour donner le coup d’envoi d’une campagne médiatique, ou bien est-ce la fuite de ce document qui incita plusieurs membres du gouvernement à réagir ? Impossible de le savoir, mais toujours est-il que dans les jours ayant suivi la publication de l’article du Monde, plusieurs médias ont ouvert micros et colonnes aux responsables politiques pour « expliquer » le projet : Bruno Le Maire le 20 mai dans « Le grand rendez-vous » sur Europe 1, Benjamin Griveau dans Le Parisien le 27 mai, Gérald Darmanin le 29 mai sur RTL, tandis que les déclarations d’Édouard Philippe le 30 mai à l’issue d’un séminaire gouvernemental ont été reprises dans Le Monde, Les Echos, le JDD, Le Parisien, Le Point, Challenges, etc.
Dans les jours qui suivirent ces déclarations, plusieurs médias ont proposé une synthèse du projet [1]. Certains journalistes politiques lui ont porté un intérêt d’autant plus grand que l’annonce de ces mesures à venir avait, selon la formule consacrée, « suscité la désapprobation dans les rangs de la majorité ». Il s’agissait donc « d’éteindre le début d’incendie » (Les Echos, 1er juin), ou de cheminer en « terrain miné » (Le Monde, 30 mai), voire d’une « cacophonie gouvernementale » (France Bleu, 30 mai).
Comme toute bonne campagne médiatique, celle-ci fut accompagnée d’un sondage ad hoc, commandé par deux médias et un « think tank », tous ouvertement favorables au projet gouvernemental de réduction des aides sociales : Les Echos, Radio Classique, et l’Institut Montaigne. Ce sondage, largement repris dans la presse après avoir été relayé par l’AFP, charrie les mêmes biais que tout sondage d’opinion, auxquels il ajoute l’incohérence [2] et la malhonnêteté de la photo d’illustration de l’article, occultant le chiffre de 32% de sondés considérant le niveau de ces aides à « juste ce qu’il faut » pour laisser apparaître les 40% de « trop d’aides » comme majoritaires. (photo en tête de l'article)
C’est ainsi que l’angle du débat médiatique autour des aides sociales s’est d’emblée imposé, à l’unisson des problématiques posées par le gouvernement : faut-il ou non les réduire ?
Un débat médiatique amputé
Déjà bien limité par les termes dans lesquels il est posé, ce débat politique est encore amputé dans sa version politicienne, où seuls comptent les enjeux d’alliances et de popularité dans les sondages – c’est-à-dire, in fine, les enjeux potentiellement électoraux. Un bon exemple de ce journalisme politique dépolitisé fut donné à entendre dans sa version cultivée lors de l’émission du 3 juin de « L’esprit public » sur France Culture. Recevant comme chaque dimanche des invités idéologiquement proches du gouvernement actuel, Émilie Aubry leur posait la question : « Faut-il poser la question des aides sociales ? » Son texte introductif, stylisé à la façon d’un récit, vaut d’être cité in extenso :
Que ferait le jeune président avec [les aides sociales] ? En condamnerait-il certaines ou se contenterait-il de revoir les conditions d’accès et la revalorisation de ces prestations ? Comment ferait-il pour n’apparaître ni comme l’incarnation d’un état technocrate mettant à mal un état social, ni comme celui qui à force de plaider le « en même temps » n’accomplissait comme son prédécesseur que des réformes cosmétiques sans effet réel sur l’ampleur de nos déficits ? Que devait-on lire entre les lignes de ses sibyllins propos élyséens : « nous allons faire des économies sans toucher aux paramètres » ?
Heureusement que le service public est là pour nous aider à réfléchir aux enjeux de la communication gouvernementale (« comment faire pour n’apparaître ni comme ceci ni comme cela »), et pour organiser ces « débats » où toutes les opinions peuvent s’exprimer : aussi bien celles qui encouragent la diminution des aides sociales que celles qui plaident pour leur suppression.
Certes, cette présentation caricaturale ne représente pas la tonalité générale de la campagne médiatique qui aura suivi les déclarations ministérielles de la fin mai : nombres d’articles firent également état de « l’attachement des Français » à leur « modèle social ». Autrement dit, la question se posait souvent sous la forme d’une alternative : réduire les aides sociales (éventuellement jusqu’à en supprimer certaines), ou les conserver.
C’est selon cette alternative que le débat fut posé dans les médias dominants : rares furent par exemple les articles mentionnant le fait bien établi que de très nombreuses personnes éligibles à une allocation n’en bénéficient pas parce qu’elles ne la demandent pas – alors même que ce « non-recours » concerne au moins 30% des allocataires potentiel du RSA par exemple [3]. Et ce sans parler de poser la question des moyens à envisager pour réduire ce non-recours !
Rares également furent les médias à s’emparer de visions politiques de la gauche radicale – par exemple celles qui jugent que ces aides devraient être augmentées, ou que le principe de redistribution devrait être généralisé, par exemple sur le modèle du salaire à vie [4]. Des visions qui comptent pourtant des représentants, responsables politiques, intellectuels, militants, soit autant de potentiels invités qui pourraient venir les défendre sur un plateau ou dans les colonnes d’un journal. Mais les invitations leur furent distribuées au compte-goutte [5], et aucun de nos grands médias n’emploie d’éditorialiste idéologiquement proche de ces courants politiques. Tant et si bien qu’ils restèrent quasiment invisibles durant toute cette séquence – aussi invisibles que d’habitude pourrait-on dire, et le périmètre du débat en fut particulièrement restreint, aussi restreint que d’habitude pourrait-ton dire !
Acte deux : la fabuleuse histoire médiatique du « pognon de dingue » ou la misère du journalisme politique
C’est dans la nuit du 12 ou 13 juin, soit après trois semaines de débat médiatique sur la question de la nécessité, ou non, de réduire les aides sociales, que la fameuse vidéo du « pognon de dingue » est mise en ligne sur le compte Twitter de la directrice de communication d’Emmanuel Macron.
Cet épisode intervient à la suite de deux révélations du Canard Enchaîné : une première affirmant que le montant des coupes budgétaires dans les aides sociales a été fixé à 7 milliards d’euros par le gouvernement ; et une seconde retranscrivant les propos d’un « conseiller gouvernemental » regrettant justement cette première révélation : « Pour éviter que les oppositions se coagulent contre les économies budgétaires, il était prévu qu’aucune donnée chiffrée ne devrait sortir avant que l’opinion soit préparée par des sondages opportuns et par une communication gouvernementale justifiant par avance ces mesures. Au nom de l’efficacité et de la nécessaire réforme. »
Et ce « coup de com’ » suscita en effet une large couverture dans les médias dominants, qui se sont une nouvelle fois illustrés par un suivisme sans borne à l’égard de la communication gouvernementale : en dissertant sur la forme et le vocabulaire d’une part, et en recentrant d’autre part quasi systématiquement les débats autour de la question de « l’efficacité » des aides sociales.
Dans la presse écrite tout d’abord, nombre d’articles se contentent de rapporter les propos de la vidéo, et parfois de la présenter comme une volonté d’Emmanuel Macron de « clarifier la politique sociale après quelques couacs » (Ouest France, 13 juin). D’autres, comme Le Figaro ou le site de BFM-TV, prétendent raconter « les dessous d’un coup de com’ », mais ne font en réalité que le prolonger en rapportant des détails du tournage, du montage ou de la mise en ligne fournis par les conseillers d’Emmanuel Macron… D’autres encore choisissent de poser la question de l’efficacité de ce « coup de com’ », à l’instar de Libération et du Huffington Post – le premier jugeant que le « coup de com’ » ne passe pas, et le second estimant que c’est un « pari gagnant ». Sur le fond, de nombreux médias ont repris à leur compte la question de « l’efficacité » des aides sociales, se basant notamment sur une dépêche AFP reprenant des statistiques officielles de la DREES. Comme le montre un article d’Arrêt sur images, cette même dépêche aura été reprise très différemment d’un média à l’autre :
Le journal Les Échos reprend la quasi-totalité de la dépêche AFP, en titrant sur le montant de ces dépenses : « La France, championne d’Europe des dépenses de protection sociale ». Très différent est le titre du Monde : « Le « pognon de dingue » investi dans la protection sociale est efficace et apprécié par les Français. » D’autres médias ont choisi également la même mise en perspective. C’est le cas de Libération, de France Bleu, ou encore du Parisien |...] ou du site de BFMTV Business.
Les journaux télévisés du 13 juin consacreront tous un sujet à cette vidéo, à 13h comme à 20h, sur TF1 comme sur France 2. Qu’il s’agisse de brefs reportages ou de commentaires en plateau, il s’agit de noter la singularité du ton et du vocabulaire et de pointer le « coup de com’ », tout en relayant la volonté proclamée d’Emmanuel Macron de rendre les aides sociales « plus efficaces ». Nathalie Saint-Cricq, grande spécialiste du style jupitérien était évidemment au rendez-vous du JT d’Anne-Sophie Lapix :
C’est la quintessence du « en même temps » macronien : un coup de social, on l’a vu ce matin à Montpellier et au même moment il parle aussi à la droite du genre « bah moi, j’ai le courage de dire ce que beaucoup pensent tout bas. » Alors finalement le style n’est pas très jupitérien et on a l’impression ce soir d’un message franchement brouillé, mais vous savez, tout ça, c’est de la com’, c’est de la politique car in fine ce qui comptera ce ne sont pas les paroles, ce seront les actes, les arbitrages, les priorités, les aides sociales, et ça on sera fixé très très vite, probablement d’ici juillet.
Car oui, dans le petit monde des éditorialistes, la politique, c’est de la com’. Et inversement.
Du côté des matinales radio, le sujet est cadré à l’identique. Sur RTL le 13 juin, Yves Calvi y ajoute son sens particulier du pluralisme, qui a peut-être encore rétréci depuis qu’il a quitté France 5 et l’émission « C dans l’air »... Au sommaire de cette matinale, il annonce un entretien téléphonique avec le Président de la Mutualité française [6] qui, à la surprise générale, déclare que « chaque euro doit être utilement dépensé ». Pas peu fier de pouvoir diffuser des propos aussi hostiles aux projets gouvernementaux, le présentateur poursuit :
Et comme nous aussi à RTL nous sommes curieux et obstinés, à l’autre bout de la chaîne, c’est Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, qui répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux [...]. Bref, on ne peut pas être plus complets.
Plus complet qu’Yves Calvi ? Impossible ! Ou comme disait Pierre Desproges,ce serait comme être « plus rockeur que Tino Rossi. »
Le 14 juin, recevant François Hollande dans la matinale d’Europe 1, Patrick Cohen mène l’enquête. Il demande d’abord « Vous les prépariez de cette façon vos discours ? », avant de poser une question sur le fond… de la forme : « Et sur le contenu... contenu et vocabulaire ? Ce ’’pognon de dingue’’ qui n’aide pas les pauvres à sortir de la pauvreté ? »
Le même jour, Jean-Michel Apathie et Bruce Toussaint sollicitent l’éclairage de Daniel Cohn-Bendit sur France Info. Jean-Michel Apathie tente l’exégèse du vocabulaire présidentiel, en se demandant si le mot « pognon » ne veut pas dire « trop de pognon ». Et à Daniel Cohn-Bendit qui répond qu’Emmanuel Macron a raison de pointer le problème de l’efficacité des aides sociales, Bruce Toussaint réplique : « Vous avez raison sur le fond, on peut entendre ce qu’il dit, mais sur la forme ... »
Toujours le 14 juin, dans la matinale de France Inter, Thomas Legrand consacre son édito à décrire les « 2 lignes de com’ [qui] s’affrontent à l’Elysée ». « Et le fond alors ? » lui demande Nicolas Demorand à 40 secondes la fin de sa chronique (de trois minutes). Réponse de l’éditorialiste : « Ah bah j’ai plus le temps ». Hilarité dans le studio. Et pour les auditeurs qui doutaient encore de la fascination du petit monde des éditocrates à l’égard du petit monde de la communication élyséenne, l’échange qui eut lieu quelques minutes plus tard entre Léa Salamé et son invité Raphaël Enthoven, a clarifié la situation :
- Léa Salamé : Quand vous voyez la conseillère com’ de l’Elysée balancer sur les
réseaux sociaux une vidéo, avec un vrai-faux « off » d’Emmanuel Macron qui prépare son discours devant ses conseillers, Thomas Legrand a parlé de « trumpisme de salon », vous en
pensez quoi vous de cette vidéo ?
- Raphaël Enthoven : […] C’est ça qui est intéressant ici, c’est qu’on est dans une mise en scène au carré alors que l’enjeu c’est de donner le sentiment qu’on est sorti de la mise en scène
parce qu’on le filme à l’iphone.
- Léa Salamé : Donc c’est raté ?
- Raphaël Enthoven : À mon avis.
- Léa Salamé : Sur le vocabulaire […], ce vocabulaire-là, il est disruptif, il est transgressif, ou au fond il est furieusement dans l’air du temps et conformiste ?
D’un entretien entre la journaliste élue « meilleure intervieweuse » en 2015 et le philosophe de studios, on n’attendait pas moins.
Le 25 juin, Léa Salamé semble avoir fait le tour de la forme, et peut donc embrasser le fond dans sa question à Thomas Piketty : « Au-delà de la forme [...], est-ce que c’est forcément faux de dire qu’il y a trop d’argent dans les prestations sociales ? » Mais son compère Nicolas Demorand n’en démord pas. Le 28 juin, au premier président de la Cour des comptes qui lui explique qu’il n’a pas à commenter les propos tenus dans cette vidéo, l’animateur demande, rigolard : « Vous parlez cette langue à la cour des comptes ou pas ? »
Entre temps, dans sa matinale du 15 juin sur RMC, Jean-Jacques Bourdin a lui aussi pris soin d’aborder le sujet avec son invité Nicolas Dupont-Aignan, en poussant un cran plus loin la logique du discours gouvernemental : « La France est généreuse, vous avez raison. Elle est trop généreuse ? Donc il faut réduire la dépense publique, on est bien d’accord ? »
Conseillers en com’ cherchent plateaux télé
Les principaux « talk-show » n’ont pas été en reste [7], et ont apporté leur pierre à l’édifice des commentaires sur la communication gouvernementale, avec, comme toujours, des invitations multiples de spécialistes en communication, aux profils, parcours et avis sensiblement identiques !
Dans « 24h Pujadas » (LCI), la moitié des invités (soit deux sur quatre) ont occupé le poste de « conseiller en communication » d’un Président de la République [8]. Un tiers de la séquence intitulée « Aides sociales : ’’un pognon de dingue’’ ? » est consacré à « décrypter » la stratégie de communication d’Emmanuel Macron – soit tout de même 7 minutes de discussion, au terme desquelles David Pujadas propose d’orienter la discussion sur le fond : « Bien, alors on va sur le fond. Parce qu’il y a la forme, il y a le choix de ce vocabulaire, et puis il y a le fond. Est-ce qu’il a raison quand il dit ’’ces aides sociales coûtent cher, elles coûtent de plus en plus cher, et elles sont relativement inefficaces’’ ? »
Dans « L’info du vrai » sur Canal + le 13 juin, Yves Calvi (encore lui) poursuit sa campagne en recevant un sondeur, un « politologue spécialiste de communication politique » et un économiste médiatique macroniste. Dans un style plus tranché, la prestation du journaliste dépolitiseur revendiqué consistera essentiellement à ventriloquer les éléments de langage du Président, au point qu’on se demande parfois qui de Calvi ou de Macron fait un discours :
La France championne du monde de l’aide sociale : on pourrait en être fiers si elles étaient réellement utiles, alors nous allons essayer de dépolitiser en quelque sorte le débat pour en parler le plus normalement possible. La république française fonctionne sur un principe de solidarité, de redistribution, c’est sans doute notre fierté, encore faut-il qu’il soit efficace. C’est finalement ce que nous a dit Emmanuel Macron avec un sens consommé de la provocation.
Dans « L’heure des pros » sur CNews, le même jour, Pascal Praud reprend les deux questions qui auront finalement cadré la majorité de cette campagne médiatique dans les médias dominants : « ’’Pognon’’, un président ne devrait pas dire ça ? À moins qu’il ait raison, et que le fond justifie la forme ? »
Et le service public n’est pas en reste. Dans un débat organisé en marge du congrès de la Mutualité française sur Public Sénat, la présidente de la région Occitanie doit répondre à des questions telles que : « [Cette] formule choc, ’’un pognon de dingue’’, ça vous a choquée ? », ou encore : « Mais quand Emmanuel Macron dit que sur ces aides sociales il y a un problème d’efficacité, un problème d’effectivité, est-ce qu’il n’a pas raison ? »
Quant à l’émission « C dans l’air », petit salon de l’éditocratie, la discussion a été menée comme chaque soir entre amis [9]. Les deux premières questions posées par sa présentatrice montrent que la discussion fut encore largement consacrée aux objectifs et aux effets de la stratégie de communication de l’Elysée :
- Première question : Il faut qu’on commence cette émission par cette vidéo. C’était assez inattendu, donc c’est une scène un petit peu volée, à l’Elysée, une séance de travail… Alors pas du tout volée puisque c’est l’attachée de presse d’Emmanuel Macron qui la filme, en tout cas ça ressemble à une séance de travail avec les conseillers d’Emmanuel Macron. Et là, il y va avec une formule dont il a le secret.
- Deuxième question : Une formule qui a été diversement reçue […], ça a hérissé une partie de la gauche et même parfois de sa majorité dont certains ont des états d’âme. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de prendre les Français à témoin d’une séance de travail à l’Elysée, en utilisant […] une façon de parler assez triviale ? Est-ce que c’est choquant ?
Dans notre article « Le pouvoir des médias : entre fantasmes, dénis et réalités », nous pointions certains des pouvoirs que les médias exercent réellement. Parmi ceux-ci, nous relevions le pouvoir d’agenda, puisqu’ « en déterminant quelles informations sont dignes d’être traitées, les médias définissent les événements qui font ’’l’actualité’’, suggérant au public non pas ce qu’il doit penser, mais ce à quoi il faut penser » ; et le pouvoir de cadrage découlant du fait que « les médias ont le pouvoir de suggérer sous quel angle doivent être abordées les questions dont ils traitent et comment il faut y penser ».
Ces pouvoirs s’exercent avec d’autant plus de force que le niveau d’uniformité du traitement médiatique est élevé : moins les informations et les opinions diffusées sont diverses, notamment dans les médias dominants, plus l’agenda et le cadrage proposés relégueront les autres sujets et les autres points de vue aux marges de l’espace médiatique. Or il existe des acteurs extérieurs aux médias qui ont la possibilité d’imposer des sujets dans le débat médiatique, notamment, comme ici, le pouvoir politique, dont les choix annoncés ou effectifs font partie des centres d’intérêts évidents du travail de journaliste.
Dans ces conditions, la surexposition des débats consacrés à la communication d’Emmanuel Macron (qui est un sujet parfaitement mineur au regard des enjeux), ainsi que la reprise du cadre suggéré par l’Elysée lors des quelques occasions où le sujet de fond était abordé (« les aides sociales sont-elles efficaces ? ») ont permis au pouvoir politique d’utiliser les effets d’agenda et de cadrage à son bénéfice. En effet, pour voir exprimer des points de vue qui ont contesté cette façon de poser les problèmes ou en ont suggéré d’autres, c’est une nouvelle fois aux marges de l’espace médiatique qu’il aura fallu chercher.
Bref, dans les conditions de fonctionnement actuelles de l’univers médiatique, lorsqu’il s’agit de « préparer l’opinion » à « la nécessité et l’efficacité de la réforme », l’autonomie des médias dominants vis-à-vis du pouvoir politique semble si faible qu’il suffit d’un simple « coup de com’ », filmé sur un iPhone.
Patrick Michel
Publié le 23/07/2018
Lobbying : comment les entreprises font leur loi en influant sur le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État
par Olivier Petitjean (site bastamag.net)
Mal connus du grand public, Conseil d’État et Conseil constitutionnel disposent d’un pouvoir considérable sur le destin des législations fiscales, sociales ou environnementales. Les milieux d’affaires l’ont bien compris, qui ont réussi à se saisir de ces institutions pour imposer en toute discrétion une protection de plus en plus forte de la « liberté d’entreprendre » et des « attentes légitimes » des titulaires de droits de propriété contre toute réforme qui nuirait aux intérêts des multinationales et des investisseurs. Plongée dans un lobbying peu connu, mais extrêmement efficace pour les entreprises.
Avec les projets d’accords de libre-échange comme le Tafta ou le Ceta, beaucoup ont découvert les dangers des tribunaux d’arbitrage privés. Ceux-là mêmes qui permettent aux multinationales et aux spéculateurs de poursuivre les gouvernements qui adopteraient des règles sociales, fiscales ou environnementales contraires à leurs intérêts. Le risque est soudain apparu au grand jour que des acteurs économiques puissent empêcher des États de réformer leur fiscalité, d’introduire de nouvelles régulations environnementales ou de créer de nouvelles obligations pour les multinationales. Et si la même logique était justement en train d’être appliquée, discrètement, en France, sans qu’il y ait besoin de signer un traité de commerce et d’investissement supplémentaire, tout simplement en instrumentalisant de vénérables institutions de notre République ?
C’est exactement ce qui est en train de se passer, selon un nouveau rapport publié par les Amis de la Terre et l’Observatoire des multinationales, intitulé Les Sages sous influence ?, qui se penche sur le lobbying auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État. Deux institutions mal connues du grand public, et encore plus rarement envisagées comme des lieux d’influence, mais qui disposent d’un pouvoir énorme sur le destin des lois, sans avoir à rendre de comptes ou presque, et qui ne se sont pas dotées des procédures transparentes et contradictoires nécessaires.
Un lobbying qui ne dit pas son nom
Les acteurs économiques, leurs lobbies et leurs armées d’avocats se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont réussi à faire censurer par le Conseil constitutionnel plus d’une douzaine de projets de loi dans le domaine fiscal (par exemple la taxe à 75 % voulue par François Hollande ou des règles de transparence fiscale ciblant les multinationales), mais aussi des mesures de justice sociale comme les dispositions de la loi Florange interdisant les fermetures de sites industriels rentables, ou encore une proposition de loi contre l’accaparement des terres. Ces censures ont presque toutes été prononcées au nom de grands principes comme la « liberté d’entreprendre » ou les « attentes légitimes » liées aux droit de propriété. Ces mêmes arguments ont été mobilisés par l’Afep (Association française des entreprises privées), le lobby du CAC40, et le Medef contre la loi sur le devoir de vigilance des multinationales début 2017 (lire notre enquête). Avec moins de succès, les partisans de la loi ayant vu venir le coup et déployé une stratégie de « contre-lobbying ».
Par quels moyens les lobbies peuvent-ils influencer le Conseil constitutionnel ? Chercheurs et journalistes d’investigation ont mis en lumière la pratique des « portes étroites », consistant à transmettre aux Sages des « contributions », rédigées par d’éminents professeurs de droit constitutionnel, pour faire pencher leurs décisions dans tel ou tel sens. Le tout dans la plus grande opacité, puisque leur contenu n’est pas rendu public, même pas au bénéfice des fonctionnaires du gouvernement chargés de défendre leurs lois devant le Conseil [1]. Un lobbying d’autant plus efficace qu’il ne dit pas son nom, déguisé dans le langage du droit. Et les acteurs qui le portent jouissent d’un accès privilégié aux Sages. Dans ses mémoires, l’ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré raconte de manière faussement ingénue comment il recevait des délégations de grands patrons ou le président du Medef Pierre Gattaz [2].
L’histoire de la loi Hulot sur la fin des hydrocarbures en France, finalement adoptée fin 2017, est venue montrer que le mal était peut-être encore plus profond, en attirant l’attention sur une autre institution : le Conseil d’État. Les deux Conseils sont extrêmement proches l’un de l’autre, non seulement géographiquement (puisqu’ils sont tous deux situés au Palais-Royal), mais également parce que le secrétaire général du Conseil constitutionnel provient du Conseil d’État, lequel lui fournit l’essentiel de son expertise juridique. D’où l’efficacité de la manœuvre d’étranglement effectuée sur la loi Hulot : dans son avis rendu sur la première mouture du projet de la loi, la Conseil d’État s’est prononcé contre le non-renouvellement des concessions d’hydrocarbures existantes après 2040, parce que cela porterait atteinte aux « espérances légitimes » des détenteurs de ces concessions, et que porter ainsi atteinte au droit de propriété contreviendrait à la « Convention européenne des droits humains » (lire notre article).
Régulations sociales et environnementales remises en cause au nom des « droits et libertés économiques » ?
Vous avez bien lu : les droits des multinationales et des institutions financières (conçus en un sens extrêmement large puisque incluant le droit à un renouvellement de leurs permis et aux profits qu’ils peuvent en espérer) sont désormais protégés au nom des « droits humains ». Une tendance extrêmement inquiétante, particulièrement exacerbée dans les tribunaux d’arbitrage privé ou aux États-Unis, où la Cour suprême a levé toute limite aux financements politiques des entreprises en arguant qu’en tant que « personnes », elles avaient une totale liberté d’expression (lire notre article). Mais cette tendance se retrouve aussi en France et au niveau des cours de justice européennes.
Cette mise en avant de la « liberté d’entreprendre » et des « attentes légitimes » liées aux droits de propriété n’est pas totalement nouvelle. Ces principes ont été utilisés au début du siècle par le Conseil d’État pour limiter l’expansion des services publics locaux créés par le « socialisme municipal ». La première fois que le Conseil constitutionnel a invoqué la « liberté d’entreprendre » a été en 1982, à propos de la loi de nationalisations du gouvernement socialiste. Mais la tendance s’est considérablement renforcée depuis quelques années pour contrecarrer les velléités de réformes fiscales ou autres initiées dans la foulée de la crise financière mondiale. Elle semble avoir été accélérée par la création, il y a dix ans, de la procédure de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), qui permet à toute partie d’un procès de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité d’une disposition législative existante à la Constitution de la Ve République. Conçue pour rapprocher la Constitution des citoyens, la procédure de la QPC a surtout été utilisée par des acteurs économiques et des cabinets d’avocats d’affaires pour remettre en cause des législations et des normes existantes, tout d’abord dans le domaine fiscal, puis également sur des questions sociales, environnementales et autres. Dernier exemple en date : la plateforme de location Airbnb a annoncé son intention, avec son cabinet d’avocats Bredin Prat, de lancer une « question prioritaire de constitutionnalité » sur la loi Lemaire pour une République numérique, qui l’oblige à partager certaines informations avec les collectivités locales [3].
Ce ne donc pas seulement les nouvelles réformes, mais virtuellement toutes les régulations sociales et environnementales mises en place depuis des décennies qui pourraient se retrouver ainsi « re-jugées » par le Conseil constitutionnel, pour vérifier si elles ne portent pas excessivement atteinte à la liberté d’entreprendre et aux attentes légitimes des propriétaires, conçus comme des droits humains fondamentaux alors même qu’il ne s’agit plus d’individus, mais de multinationales et d’institutions financières. C’est pourquoi, dans le cadre de la réforme constitutionnelle actuelle, un groupe de parlementaire de tous bords — soutenus par des intellectuels qui ont cosigné une tribune dans les colonnes du Monde — a proposé un amendement pour encadrer l’invocation de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété et pour protéger l’intérêt général.
Le poids d’un grand corps d’État
En ce qui concerne la loi Hulot, le gouvernement français a choisi d’emblée de ne pas mener cette bataille. Il a fait comme si l’avis rendu par le Conseil d’État — qui n’avait même pas, selon nos sources, été adopté de manière unanime — avait valeur d’oracle, et que les « attentes » des détenteurs de concessions devaient inévitablement primer sur l’exigence de protéger le climat, y compris par des mesures aussi modestes que de limiter le renouvellement de ces concessions à l’horizon 2040. Le gouvernement a donc revu sa copie à la dernière minute et constamment opposé l’argument du risque de censure constitutionnelle pour refuser toute amélioration du texte au regard de ses objectifs initiaux.
Il faut dire que le Conseil d’État exerce un monopole de fait sur l’expertise juridique de l’État. Premier des grands corps, créé en 1799, il conseille le gouvernement sur les projets de loi et constitue la plus haute juridiction administrative. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel, les fonctionnaires du Secrétariat général du gouvernement, les directeurs juridiques de tous les ministères et les dirigeants de nombreuses autorités et agences indépendantes sont traditionnellement issus du Conseil d’État.
Il est pourtant lui aussi ouvert à l’influence du secteur privé. Comme le Conseil constitutionnel, il accepte des « contributions extérieures » dans le cadre de l’examen des projets de loi, dans le cadre d’une procédure opaque et non contradictoire. Lors de l’examen de la loi Hulot, selon nos sources, il a reçu deux contributions extérieures du Medef et de l’Ufip, lobby du secteur pétrolier. Surtout, même si c’est à un moindre degré que d’autres grands corps comme l’Inspection générale des finances (voir l’enquête de Basta !), il est lui aussi concerné par les problématiques de conflits d’intérêts, de pantouflages et d’allers-retours entre secteur public et privé qui semblent être devenus la norme au sommet de l’État. Exemple emblématique : celui d’Édouard Philippe, l’actuel Premier ministre, issu du Conseil d’État, qui a navigué entre cabinets ministériels, cabinet d’avocat d’affaires (Debevoise & Plimpton) et grande entreprise (Areva) avant d’occuper ses fonctions actuelles. Ou encore Laurent Vallée, conseiller d’État, qui est passé par le secrétariat général du gouvernement, le cabinet d’avocats d’affaires anglo-saxon Clifford Chance, puis le ministère de la Justice, puis le groupe Canal+, avant d’être parachuté secrétaire général du Conseil constitutionnel et de finalement rejoindre le groupe Carrefour en août 2017.
Entre conseillers d’État et grandes entreprises, c’est la culture de l’entre-soi
Même si ces pratiques ne concernent pas, loin de là, tous les conseillers d’État, on retrouve des membres (anciens ou actuels) de ce grand corps dans les directions et conseils d’administration de plusieurs entreprises publiques et privées (y compris à la tête de La Poste, de la SNCF et de Vallourec), et dans de nombreux cabinets d’avocats d’affaires. Les conseillers d’État exercent aussi parallèlement à leurs fonctions des activités rémunérées de conseil juridique auprès d’autres entités publiques, et certains d’entre eux ont même créé leurs propres entreprises individuelles pour exercer le même type d’activité au bénéfice du secteur privé [4]. Les tentatives récentes pour introduire davantage de garde-fous déontologiques ont toutes été tuées dans l’œuf.
Au final, davantage que les « portes étroites » et les « contributions extérieures », ce sont plutôt les réseaux de relations incestueuses et de connivences entre Conseil constitutionnel, Conseil d’État et secteur privé qui créent un risque pour la démocratie. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a pu confier la mission de réfléchir au statut à donner aux « portes étroites » à Denys de Béchillon, lequel n’est autre, selon nos informations, que le principal rédacteur de portes étroites pour le Medef et l’Afep depuis la mort du constitutionnaliste Guy Carcassonne. Membre fondateur du Club des juristes dont il copréside la commission « Constitution et institutions », professeur de droit à l’université de Pau (historiquement très liée à Total), Denys de Béchillon est aussi « consultant juridique auprès de grandes entreprises » selon son propre CV, et auteur de nombreux articles sur la valeur constitutionnelle de la « liberté d’entreprendre ».
De la même manière, le président de la section du Conseil d’État chargé de rendre son avis sur la loi Hulot était issu de la même promotion de l’ENA (École nationale d’administration) que Philippe Crouzet, autre conseiller d’État présidant désormais aux destinées de l’entreprise parapétrolière Vallourec, fer de lance du gaz de schiste en France, mais aussi que la directrice de cabinet de Nicolas Hulot. Le tout étant soumis à l’arbitrage d’un autre conseiller d’État encore, le Premier ministre Édouard Philippe. Pas étonnant dans ces conditions qu’on n’ait pas beaucoup entendu d’opinions juridiques discordantes.
De plus en plus assiégés par les lobbys, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État continuent à opérer sans règles claires ni mécanismes transparents. Pour les Amis de la Terre, il est plus que temps que cela change. L’association écologiste a officiellement saisi le Conseil constitutionnel d’une demande formelle d’adoption d’un règlement pour mieux encadrer la procédure de contrôle de constitutionnalité et le rôle des contributions extérieures dans les décisions. Elle saisir parallèlement la Commission d’accès aux documents administratifs, avec l’Observatoire des multinationales, sur la question de l’accès aux contributions extérieures reçues par les deux instances. Autant de démarches nécessaires si l’on ne veut pas que toute réforme ambitieuse en matière sociale ou environnementale se trouve désormais sous l’épée de Damoclès d’une conception fondamentaliste des « droits et libertés économiques ».
Olivier Petitjean
>
Publié le 22/07/2018
Violences. Le retour des « barbouzes » de l’exécutif
Grégory Marin, avec Olivier Morin et Lola Ruscio (site l’humanité.fr)
Alexandre Benalla, collaborateur de l’Élysée, a fait le coup de poing dans la manif du 1er Mai sans être sérieusement sanctionné. Une illustration du clanisme qui règne au cœur du pouvoir.
«Je n’ai aucune indulgence pour la grande violence ou les tenants du désordre. » C’est ainsi qu’Emmanuel Macron commentait, depuis Sydney en Australie, les heurts du 1er Mai, préjudiciables avant tout à l’image du mouvement social. Mais le président de la République ne s’est toujours pas exprimé sur cette « grande violence » qu’a commise, le même jour, un adjoint au chef de son propre cabinet ! Sur une vidéo tournée par un manifestant place de la Contrescarpe, dans le Quartier latin, et mise en ligne par le Monde, on voit ce collaborateur, Alexandre Benalla, étrangler et violemment frapper un jeune homme au sol. Il s’avère que Benalla, alors chargé d’organiser « la sécurité des déplacements du président », avait « demandé l’autorisation d’observer les opérations de maintien de l’ordre pour le 1er Mai », précisait hier le porte-parole de l’Élysée, Bruno Roger-Petit, autorisation qui lui avait été donnée car « il agissait dans le cadre d’un jour de congé et ne devait avoir qu’un rôle d’observateur ». Or on l’a vu, portant un brassard de la police, casqué comme les CRS qu’il accompagnait, une radio Acropol du même modèle qu’eux à la ceinture, intervenir à plusieurs reprises.
il y a « usurpation de fonction » selon l’article 433-13
Hier matin, la ministre de la Justice estimait, devant l’Assemblée nationale, que « les agressions (...) témoignent de gestes absolument inadaptés ». D’autant, jugeait Nicole Belloubet, que Benalla « avait usurpé (...) une identification qui l’assimilait aux forces de police et tel n’était pas le cas ». En effet, outre les « violences par personne chargée d’une mission de service public », sanctionnées par l’article 222-13 du Code pénal de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, il y a « usurpation de fonction », délit condamné (article 433-13) d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le parquet de Paris a annoncé hier l’ouverture d’une enquête préliminaire sur ces deux délits, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Quant aux policiers présents, qui en vertu de l’article 40 du Code pénal auraient dû empêcher toute violence, ils sont visés par une enquête de l’Inspection générale de la police, décidée hier.
Des actes judiciaires à mettre au crédit de la presse, car, à tous les étages du pouvoir, on a couvert le collaborateur. Alexandre Benalla a bien été « mis à pied pendant quinze jours avec suspension de salaire », soulignait hier le porte-parole de l’Élysée, et « démis de ses fonctions en matière d’organisation de la sécurité des déplacements du président » pour « punir un comportement inacceptable ». Mais ce « dernier avertissement avant licenciement » n’a eu que peu d’impact : on a pu voir le collaborateur assurer la sécurité, à la cérémonie du Panthéon pour Simone Veil, début juillet, ou autour du bus des champions du monde de football, cette semaine. En matière de sanction, on fait pire…
Benalla n’est pas ce qu’on appelle un perdreau de l’année. Militant du Parti socialiste, il assurait, lors de la primaire du parti, en 2011, la sécurité de Martine Aubry. Il entre au service d’ordre de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012, avant de devenir chauffeur d’Arnaud Montebourg… une semaine seulement : selon l’ancien ministre du Redressement productif, Benalla, après avoir été impliqué dans un accident de la circulation, aurait voulu prendre la fuite, provoquant la colère de son patron. Viré ! Mais le pouvoir ne le lâche pas puisque, selon le Monde, il intègre en 2015, sur arrêté du premier ministre Manuel Valls, la session « jeunes » de l’Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Pour mieux revenir en 2016, comme responsable de la sécurité du candidat d’En marche ! (lire encadré).
Il se « distinguera » plusieurs fois. En novembre 2016, Emmanuel Macron officialise sa candidature au campus des métiers de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Grégoire (1), alors militant des Jeunes communistes, assure avoir été violemment poussé vers la sortie et frappé par Alexandre Benalla et la sécurité (la vidéo est visible sur la page Facebook des Jeunes communistes de Bobigny-Drancy). « On était quatre ou cinq militants à avoir réussi à rentrer à l’intérieur, témoigne-t-il à l’Humanité. Ils sont venus directement me voir, Benalla m’a dit de dégager et m’a agrippé pour me faire sortir. » Une fois dans le couloir, poursuit-il, « j’ai essayé de me débattre pour qu’ils arrêtent de me tenir et ils m’ont mis deux coups au visage, et Benalla m’a mis une béquille. » Rebelote en mars 2017. Au meeting du candidat Macron à Caen, Benalla empoigne un photographe qui s’était approché un peu trop près du fondateur d’En marche !, relate le Monde, et le soulève du sol…
« à l’Élysée, on se croit au-dessus de tout »
Plus que sa personnalité, c’est « l’impunité » dont a bénéficié Benalla qui fait réagir l’opposition. Le président des « Républicains », Laurent Wauquiez, se demandait hier sur Europe 1 si « à l’Élysée, on se croit au-dessus de tout », supposant qu’il y a eu « des manœuvres pour tenter d’étouffer l’affaire ». Le député PCF Sébastien Jumel pointe « l’absence de réaction appropriée au sommet de l’État », sans compter que « le chef de cabinet du président de la République n’a pas jugé utile d’en informer le procureur de la République, en contradiction avec ses obligations ». Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) va plus loin, demandant des démissions : « L’autorité de l’État a été engagée d’une manière tellement ample et tellement forte que la sanction doit être exemplaire. » Encore faut-il dégager les responsabilités, estime sur Twitter le député PCF Stéphane Peu, espérant que « François de Rugy et la majorité accepteront (sa) proposition de commission d’enquête ». Éliane Assassi, au nom du Groupe communiste du Sénat, a demandé au président de la commission des Lois, Philippe Bas, d’auditionner de toute urgence le ministre de l’Intérieur, ainsi que la garde des Sceaux et le premier ministre, « pour faire la lumière sur cette affaire » : « L’intervention des barbouzes du nouveau monde dans les mouvements sociaux » ne saurait, selon elle, être tolérée.
(1) Le prénom du militant, qui souhaite conserver l’anonymat, a été modifié.
Pendant la campagne présidentielle, les curieuses dérives sécuritaires des chefs du service d’ordre d’en marche !
C’est un épisode de la campagne présidentielle révélateur de l’état d’esprit d’Alexandre Benalla et de ses proches que révèle la lecture attentive des Macronleaks, ces échanges de courriels internes à En marche ! authentifiés par Wikileaks. En mars 2017, une société de matériel de sécurité demande confirmation à la direction du mouvement d’une commande passée par Vincent Crase, le gendarme réserviste que l’on voit aux côtés de Benalla dans les vidéos du 1er mai. Alors « prestataire » pour En marche !, il souhaitait – démarche validée par Ludovic Chaker, directeur des opérations, et Alexandre Benalla, chef de la sécurité – obtenir deux pistolets Gomm Cogne avec leurs munitions et deux holsters, des boucliers, un Flash-Ball, un équipement en kevlar… Le directeur de campagne d’Emmanuel Macron, Jean-Marie Girier – devenu directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, et étrangement muet depuis l’explosion de l’affaire –, avait tranché : « Hors de question ! » Le trésorier de campagne, Cédric O, lui, s’interrogeait : « Je n’ai jamais entendu dire que les partis politiques avaient des vigiles armés. Je trouve même ça dangereux… » La commande est annulée. Mais, même après que le directeur financier de la campagne, Raphaël Coulhon, a signalé que Benalla « a un port d’arme, c’est sûrement aussi le cas de Christian Guedon (autre membre de l’équipe de campagne), et peut-être Vincent Crase », et qu’il « ne (savait) pas s’ils sont armés au QG », personne ne les a écartés du service d’ordre.
Grégory Marin, avec Olivier Morin et Lola Ruscio
Publié le 21/07/2018
Europe. Les pros de l’évasion fiscale tirent les ficelles
Emeline Rojo (site l’humanité.fr)
Surnommés les Big Four, quatre cabinets spécialistes du conseil pour éviter l’impôt sont aussi ceux qui assistent l’Union européenne dans ses politiques fiscales, révèle une ONG.
La Commission européenne semble appliquer un peu trop à la lettre l’adage « Soigner le mal par le mal ». Selon un rapport inédit de l’ONG Corporate Europe Observatory (1), les Big Four, cartel ultra-influent des quatre principaux cabinets d’audit financier mondiaux et « poids lourds de l’industrie de la planification fiscale », sont omniprésents dans l’élaboration des politiques européennes anti-évasion fiscale, malgré un conflit d’intérêts plus que flagrant. Ils comptent Deloitte, qui représente HSBC, Ebay ou encore Bayer ; Ernst & Young (EY), impliqué dans divers scandales bancaires ; KPMG, commissaire aux grands comptes de Total, Carrefour ou Vinci ; et PricewaterhouseCoopers (PwC), le cabinet impliqué dans les Luxembourg Leaks (ou LuxLeaks).
Ce sont ces mêmes cabinets qui facilitent l’évitement fiscal et facturent dans un même temps des dizaines de millions d’euros leurs conseils à la Commission de Bruxelles. Selon le rapport, PwC, Deloitte et EY ont été payés 7 millions d’euros en 2014 par la direction générale de la Commission dédiée à la fiscalité. En janvier 2018, KPMG, PwC et Deloitte ont encore perçu 10,5 millions d’euros pour leur expertise sur les « enjeux liés à la taxation des douanes ». Ces maîtres dans l’art de l’évitement fiscal bénéficient ainsi de marchés publics européens.
En relation étroite avec le Medef
Mais l’influence des Big Four ne s’arrête pas là. Ils se montrent extrêmement actifs dans différentes structures de lobbying peu connues du grand public, comme European Business Initiative on Taxation, European Contact Group, Accountancy Europe, ou dans des groupes consultatifs mis en place par la Commission. Le rapport pointe également du doigt la pratique des portes tournantes, « les allers-retours généralisés et normalisés » entre la Commission et le monde de l’audit. Des attachés chargés des questions fiscales de certains États comme l’Allemagne ou l’Irlande qui viennent de KPMG et PwC, des agents de la direction générale fiscalité de la Commission tout droit sortis des Big Four : le conflit d’intérêts est omniprésent.
Les Big Four sont aussi en étroites relations avec le Medef, son homologue allemand le BDI ou encore les lobbies patronaux européens AmCham EU et Business Europe. Ils ont activement fait pression contre le « reporting pays par pays », une proposition de la Commission en avril 2016 qui oblige les entreprises à déclarer publiquement leurs profits dans tous les pays où elles opèrent. Cet intense lobbying a abouti à édulcorer sérieusement le reporting public, dans la mesure où il ne doit pas dévoiler d’« informations sensibles du point de vue commercial », une nuance qui change tout. Même chose en juin 2017. De nouvelles règles de transparence pour les conseillers fiscaux devaient les obliger à déclarer les dispositifs d’évitements fiscaux « agressifs ». Mais les critères définissant la notion d’« agressif » se sont significativement restreints dans la version adoptée par le Conseil européen en mars 2018.
Des partenaires illégitimes
Theresa Crysmann, responsable médias de Corporate Europe Observatory, est catégorique : « C’est la première fois qu’une étude documente pleinement la manière dont les Big Four sont intégrés dans les politiques européennes en matière d’évasion fiscale. » L’ONG rappelle que l’évasion fiscale des grandes entreprises coûte à l’Europe 50 à 70 milliards d’euros par an, et peut même aller jusqu’à 160 à 190 milliards d’euros, selon le rapport. Des fonds qui pourraient être affectés aux services publics, à l’éducation, aux hôpitaux. L’association scande qu’il est temps « d’arrêter de traiter les Big Four dans les cercles de prise de décision comme des partenaires neutres et légitimes ». Selon l’ONG, aucune des deux parties n’est prête à reconnaître l’existence de conflits d’intérêts massifs. Mais Theresa Crysmann se montre optimiste : « Les Big Four sont au bord de la défaite : tous les jours, de nouveaux médias remettent en question le rôle qu’ils jouent sur la fiscalité. Ils menacent la prise de décision dans l’intérêt général et doivent être stoppés. Il est maintenant temps pour les politiques de résister et de les évincer une fois pour toutes des processus européens de décision en matière de fiscalité. »
Télécharger le rapport complet (en anglais) et sa synthèse (en français)
émeline Rojo
Publié le 20/07/2018
Constitution. Cet été, Emmanuel Macron veut se tailler un régime sur mesure
Aurélien Soucheyre (site l’humanité.fr)
L’Assemblée nationale examine en ce moment le premier texte d’une réforme qui vise à soumettre définitivement le Parlement aux desiderata de l’exécutif. Face à ce projet, qui menace aussi la Sécurité sociale, les parlementaires PCF réclament un référendum.
Depuis la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde, des montages montrant un Emmanuel Macron qui exulte dans les gradins à l’idée de pouvoir dorénavant faire passer n’importe quelle réforme tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Tout y passe : retraites à 75 ans, explosion de la TVA, suppression de la Sécurité sociale… Ce qui pourrait ici ressembler à une bonne blague sur l’opportunisme et le cynisme du président de la République n’en est pourtant pas une : depuis le 10 juillet, l’Assemblée nationale examine en séance publique un projet de réforme des institutions. En catimini, en plein été, souvent au cœur de la nuit, la Macronie se livre à une réécriture de la Constitution. Elle ne fait absolument rien – bien au contraire – pour provoquer et nourrir le grand débat public et citoyen nécessaire et indispensable, en démocratie, lorsqu’il s’agit de toucher à la loi fondamentale d’un pays. C’est pourquoi les parlementaires communistes, députés et sénateurs, ont fait le serment, le 9 juillet à Versailles, devant la salle du Jeu de paume, de tout faire pour obtenir un référendum (voir ci-contre). « Nous pétitionnerons dans tout le pays jusqu’à obtenir satisfaction », a prévenu Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Car le projet de réforme en cours entend s’attaquer frontalement au cœur même du fonctionnement démocratique de la République, à la séparation des pouvoirs, et même à la Sécurité sociale, comme l’ont démontré les débats au Parlement.
Une diminution de 30% du nombre de parlementaires
Certes, tout le monde s’est entendu, ou presque, pour supprimer le mot « race » de la Constitution, comme le proposaient les communistes depuis des années, et pour y assurer l’égalité de tous « sans distinction de sexe ». L’action pour « la préservation de l’environnement » a également été consacrée. Mais le torchon a très vite brûlé lorsque plusieurs groupes d’opposition ont souhaité fixer le nombre actuel de parlementaires dans la loi fondamentale, afin d’empêcher le gouvernement d’amputer demain les effectifs de la représentation nationale. L’exécutif considère en effet que la démocratie sera plus « représentative, responsable et efficace » avec beaucoup moins de députés et de sénateurs. Il souhaite faire adopter trois textes pour 2019 : un constitutionnel, un organique et un ordinaire, qui, additionnés, composeront une réforme globale des institutions. Et l’une des mesures phares prévoit justement une diminution de 30 % du nombre de parlementaires, soit la plus drastique depuis Napoléon III, qui ferait de la France le pays comptant le moins de parlementaires par habitants en Europe. Une autre propose de restreindre fondamentalement le droit d’amendement. Soit en ne l’autorisant qu’en commission, soit en augmentant la possibilité de les considérer comme « hors sujet », réduisant de fait considérablement le rôle législatif des parlementaires. Raccourcir le temps d’examen des projets de loi au Parlement, inclure une dose homéopathique de proportionnelle aux législatives, redessiner à la hache les circonscriptions, transformer le Conseil économique, social et environnemental (Cese) en « chambre de la société civile », en plus de l’amputer d’un tiers de ses membres, sont aussi, entre autres, au menu.
Face à un tel programme, la majorité des députés LR a dénoncé « la domestication, la décomposition et la démolition de l’Assemblée nationale », dans une tribune publiée par le Journal du dimanche. Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche (PS), y voit aussi une « réduction du pouvoir parlementaire » impossible à cautionner. André Chassaigne, chef de file des députés PCF, a tancé lors du Congrès de Versailles un régime « brutalisant la démocratie », dont l’objectif est de constitutionnaliser une « dérive oligarchique » afin de mettre en place une « technocrature ». Le coprésident du groupe UDI-Agir, Jean-Christophe Lagarde, a, lui, annoncé qu’il ne votera qu’en fonction de la globalité des trois textes, à condition que le Parlement en sorte renforcé. « La présidentialisation, ça veut dire un vrai Parlement. Sinon, c’est une monarchisation », a-t-il prévenu.
« Une atteinte gravissime, à la séparation des pouvoirs »
Fait inédit, Emmanuel Macron lui-même, en plein Congrès, le 9 juillet, a annoncé un amendement présidentiel visant la réforme de la Constitution, afin qu’il puisse écouter les réponses des parlementaires avant d’avoir le dernier mot à Versailles. « Une atteinte sans précédent, gravissime, à la séparation des pouvoirs », s’indigne le député PCF Sébastien Jumel. Au motif que le premier ministre est normalement seul responsable devant le Parlement, de nombreux groupes parlementaires ont dans la foulée accusé Macron de vouloir devenir « président-premier ministre ». Non seulement parce que le président n’a pas à amender les lois, mais aussi parce qu’il n’a pas à débattre avec le Parlement. Macron pensait ici répondre à ses détracteurs. À l’instar des députés FI, qui ont boycotté le Congrès, refusant d’assister à un discours du trône unilatéral. Mais le président s’est au final enfoncé davantage, selon Jean-Luc Mélenchon. « S’il écoute et répond, c’est un discours de politique générale. Cela le met à un doigt d’un vote de confiance », c’est-à-dire d’une possible censure par le Parlement, a ironisé l’insoumis.
L’hôte de l’Élysée maîtrise en tout cas ses troupes à l’Assemblée, totalement caporalisées et allongées devant ses desiderata, ce qui est en soi déjà un grave problème démocratique. La preuve, c’est que Richard Ferrand, président du groupe LaREM et rapporteur général du texte constitutionnel, s’était, plusieurs jours avant le Congrès, opposé à ce que le président de la République puisse écouter et répondre lors d’un Congrès. Lors des débats en commission des Lois, il estimait que cela revenait à remettre « en jeu la position de non-responsabilité devant le Parlement ». Mais ça, c’était avant que le monarque ne dise l’inverse. Depuis, Ferrand soutient l’idée d’un débat au Congrès, et a fort opportunément appuyé un amendement allant en ce sens en séance publique. Les députés LaREM n’ont même pas eu à le rédiger, puisque c’est Jean-Christophe Lagarde qui l’a déposé. Le député UDI s’est d’ailleurs défendu d’être « le poisson-pilote » de Macron sur cette question, argumentant qu’il est favorable à un débat au Congrès depuis 2008, et qu’il avait rédigé cet amendement avant la parole du roi…
Des tractations de couloirs entre le gouvernement et le Sénat
Reste que des questions fondamentales d’équilibre et de concentration des pouvoirs sont actuellement débattues dans le plus grand silence de juillet. « Nous allons tout droit vers un système présidentialiste à l’américaine, mais avec un Parlement français beaucoup moins fort que le Congrès américain. Nous allons cumuler tous les défauts de ces deux systèmes », s’alarme le député FI Éric Coquerel. Le tout grâce à des tractations de couloirs entre le gouvernement et le Sénat, dont le président, Gérard Larcher (LR), a obtenu qu’il y ait demain au moins un sénateur et un député par département. En matière de représentativité des territoires, de lien avec les citoyens et de garantie de pluralisme, on a sans doute vu mieux…
Quant aux électeurs, il n’est absolument pas prévu qu’ils soient consultés. Certes, il serait pour le moins surprenant de voir la majorité LaREM lancer un processus constituant. « Nous n’avons pas été élus pour ça », rappelait en novembre le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy. Mais examiner au milieu de la nuit des amendements rédigés le plus discrètement possible est plus que problématique, surtout quand ils concernent, par exemple, la Sécurité sociale, qui touche de très près la vie de tous les jours des Français. Après avoir écrit une proposition de suppression de quasiment toutes les mentions de la Sécurité sociale dans la Constitution, le député LaREM Olivier Véran a reformulé un amendement qui vise toujours à transformer fondamentalement ce pilier de notre modèle social, sans prévenir, et « sans mener les débats nécessaires dans la société », regrette le communiste Pierre Dharréville. Voilà pourquoi les parlementaires PCF lancent une pétition pour un référendum. « On ne peut pas imaginer de changer notre Constitution sans organiser un référendum (…). Nous exigeons donc que les Français et les Français, toutes celles et ceux qui vivent et travaillent dans notre pays, soient consultés », insiste Pierre Laurent.
Aurélien Soucheyre
Publié le 19/07/2018
En Guadeloupe, les ouvriers de la banane malades d’un pesticide dévastateur et oubliés de l’État français
par Samy Archimède (site bastamag.net)
Pendant plus de deux décennies, le chlordécone, un insecticide ravageur, a contaminé la quasi totalité de la population antillaise. Malgré son interdiction définitive il y a 25 ans, ce puissant perturbateur endocrinien utilisé dans les bananeraies ne disparaîtra pas des sols de Guadeloupe et de Martinique avant plusieurs siècles. Les premiers touchés sont les ouvriers agricoles. Ils sont pourtant les grands laissés pour compte de ce scandale sanitaire. Certains ont décidé de lever le voile sur leurs conditions de travail. Ils veulent que leurs problèmes de santé, dont de nombreux cancers de la prostate et leucémies, liés aux différents pesticides employés et à la pénibilité du métier, soient enfin reconnus comme maladie professionnelle. Reportage en Guadeloupe.
Il est 15 heures à Capesterre-Belle-Eau, « capitale » de la banane en Guadeloupe. Ce lundi de Pentecôte, une vingtaine d’ouvriers ont pris place sur les bancs du petit local de la CGT Guadeloupe (CGTG), près du stade. Ils sont venus témoigner de la pénibilité de leur travail, et parler du chlordécone, un insecticide extrêmement toxique utilisé jusque dans les années 1990 dans les plantations antillaises. Mais les visages restent fermés et les mots ne sortent pas. « Camarades, lâchez-vous ! Il y a un journaliste parmi nous ! », lâche en créole Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG, syndicat majoritaire dans le secteur de la banane.
Quelques minutes plus tôt, une femme avait rompu le silence. Elle s’était avancée, le regard fixe et déterminé, pour raconter son histoire. Le récit d’une vie d’ouvrière de la banane : 32 ans au service de la plus grosse plantation de l’île, la SA Bois Debout, dirigée aujourd’hui par Guillaume Block de Friberg, l’héritier des Dormoy, grande famille de propriétaires, installée en Guadeloupe depuis 1870. Pendant 20 ans, Marie-Anne Georges a épandu à la main, « sans masque, avec juste un gant et un seau », plusieurs types d’insecticides extrêmement toxiques, dont le Képone et le Kurlone, les deux formules du chlordécone utilisées aux Antilles. Jusqu’à ce qu’elle tombe malade, d’un cancer du sang.
La « banane française », qui vient de Martinique et de Guadeloupe, est cette année fournisseur officiel du Tour de France. « Je suis fier d’accueillir sur le Tour un partenaire aussi soucieux des valeurs familiales et des bonnes pratiques agricoles », se réjouissait il y a deux mois Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Des paroles qui ont dû en surprendre plus d’un dans les plantations antillaises. Car encore aujourd’hui, les travailleurs de la banane française font les frais, par leur santé, de pratiques agricoles toxiques qui ont perduré aux Antilles alors même qu’elles étaient interdites en métropole.
Un produit si toxique qu’il est interdit en métropole, mais pas aux Antilles
Bonnes pratiques agricoles ? Pendant plus de 20 ans, de 1972 à 1993, les planteurs de Guadeloupe et de Martinique ont utilisé un insecticide hyper-puissant afin d’éliminer les charançons qui ravageaient les pieds des bananiers [1]. Le chlordécone a été interdit aux États-Unis en 1976, suite à l’intoxication des ouvriers de l’usine qui fabriquait la molécule. Largement utilisée aux Antilles françaises, ce pesticide a finalement été interdit en 1990 en métropole, mais il a pu être utilisé jusqu’en 1993 en Guadeloupe et en Martinique [2]. Un traitement « spécial » rendu possible par le lobbying des grands planteurs et l’inconséquence de l’État français. Cela au mépris de la santé de la population [3].
Le problème de ce perturbateur endocrinien neurotoxique, reprotoxique et classé potentiellement cancérogène dès 1979 par le Centre international de recherche contre le cancer, c’est qu’il reste actif plusieurs siècles une fois qu’il a été introduit dans la terre. Et il contamine tout sur son passage : eau douce, eau de mer, légumes et organismes vivants. Selon l’agence nationale de santé publique (Santé publique France), 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais seraient aujourd’hui contaminés au chlordécone [4].
Conférence sur la santé le 20 mai 2018, à Sainte-Anne.
Au cœur de ce scandale sanitaire, les travailleurs de la banane sont les plus exposés aux conséquences terribles du pesticide. Aujourd’hui encore, ils sont quasiment tous en contact — de manière directe ou indirecte — avec la terre empoisonnée. Dans les plantations, les cas de cancers de la prostate et de leucémies sont nombreux. Or, le lien entre exposition aux pesticides organochlorés (dont le chlordécone fait partie) et ces cancers est maintenant établi [5]. « Toutes les parcelles ont été contrôlées et sont touchées. On charrie la terre, on laboure la terre et ça se déplace en poussière, détaille Albert Cocoyer, secrétaire général de la section banane de la CGT Guadeloupe. Ceux qui travaillent dans les champs mangent sur les parcelles. Et ensuite, ils emmènent cette terre chez eux. »
Les patrons du secteur communiquent sur une filière verte, mais refusent de nous répondre
Interrogé par Basta ! sur l’évolution des pratiques agricoles et sur les conditions de travail au sein de son « habitation » — un terme qui désignait les plantations de cannes à sucre au temps de l’esclavage et qui est aujourd’hui utilisé par les ouvriers de la banane — le directeur général de la SA Bois Debout n’a pas souhaité nous répondre. Même refus de la part du président du groupement des producteurs de Guadeloupe, Francis Lignières. Impossible également de visiter une plantation ou de rencontrer des ouvriers sur leur lieu de travail. De quoi les planteurs ont-ils donc peur ?
Depuis quelques années, l’Union des producteurs de Martinique et de Guadeloupe (UGPBAN) axe sa communication sur la propreté de la banane antillaise. Ses dirigeants affirment avoir réduit de 75 % l’emploi d’insecticides et d’herbicides en une décennie. « La banane de Guadeloupe et de Martinique est la plus verte au monde », affirment-ils dans leur dossier de presse. Ils se félicitent même du retour des colibris, des chauve-souris et des abeilles dans les plantations, symboles d’une « filière durable ». La pratique de la jachère et de la rotation des cultures (alternance banane-canne) a permis de faire quasiment disparaitre les charançons des bananeraies. Et de se passer d’insecticides. Voilà pour le volet vert.
L’UGPBAN est moins loquace lorsqu’il s’agit d’évoquer les conditions de travail des ouvriers agricoles. Et pour cause : les plantations antillaises sont un véritable nid de maladies professionnelles non reconnues, d’accidents du travail, d’arrêts maladie non payés et d’interminables conflits sociaux. Seule société de la filière guadeloupéenne à avoir mis en place un comité d’entreprise et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la SA Bois Debout présente pourtant un pâle bilan social. L’an dernier, elle a été condamnée par les Prud’hommes à payer, entre autres, des heures supplémentaires non prises en compte ainsi que les 13ème mois de plus de 60 de ses salariés. En 2015, l’ancien patron, Louis Dormoy, avait écopé d’un an de prison avec sursis pour homicide involontaire. L’un de ses salariés avait trouvé la mort lors d’une opération d’élagage effectuée sans dispositif de sécurité.
De plus en plus d’Haïtiens travaillent dans les plantations : « Ils meurent aussi de cancers »
Ces conditions de travail, Roméo Donineaux, 40 ans, et Elin Jaffard, 52 ans, en ont assez de les subir. Ils ne cachent pas leur colère. Travailler dans la banane est pénible et dangereux, et pas seulement à cause des pesticides. Il y a quatre ans, Roméo, père de cinq enfants, a failli perdre sa cheville lorsqu’une palette lui est tombée sur le pied. Elin a été intoxiqué au Temik, un redoutable insecticide qui tue tout sur son passage. Un poison utilisé dans les plantations jusque dans les années 2000 en remplacement du chlordécone…
Cancers, accidents mortels, eczéma, hypersensibilité chimique multiple, hernies discales… Les risques auxquels les ouvriers sont exposés, parfois sans protection, ne font pas rêver les jeunes Guadeloupéens. Même plombés par un taux de chômage de 47 %, ils préfèrent chercher du travail ailleurs. D’où le recours à une importante main d’œuvre étrangère dans les plantations de bananes, majoritairement haïtienne. Des employés au profil idéal aux yeux de certains patrons, car peu syndiqués, durs à la tâche et moins regardants sur la fiche de paie. Mais tout aussi exposés aux risques, notamment au chlordécone. « Ils meurent eux aussi de cancers. Et quand ils rentrent chez eux en Haïti, ils se retrouvent privés d’une part de leur pension de retraite et privés de soins », déplore Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG.
Les planteurs ont livré une véritable guerre chimique contre le charançon qui s’attaque au bulbe du bananier.
Haïtiens ou Français, les ouvriers de la banane sont pris dans un paradoxe : ils ont beau voir leurs collègues, amis ou parents mourir du cancer, la poudre blanche du chlordécone, devenue invisible avec les années, reste très abstraite comparée aux 150 régimes de bananes de 60 kg chacun qu’ils doivent porter sur leur épaules chaque jour sur des kilomètres. Dans l’esprit des ouvriers, travailler sur une terre contaminée « n’est pas plus dangereux que de devenir infirme en transportant ces charges-là », soupire Albert Cocoyer. Le cancer de la prostate est pourtant bien le grand fléau des îles productrices de bananes d’exportation. Dans son dernier ouvrage, le toxicologue André Cicolella confirme qu’il y a aux Antilles trois fois plus de décès dus à ce type de cancer qu’en métropole [6].
« L’État a choisi de laisser crever les ouvriers agricoles »
Sur les hauteurs de Capesterre, où beaucoup d’ouvriers agricoles ont passé leur vie, Constant Jaffard regarde avec son fils le match amical France-Irlande. Cédric, 37 ans, dernier de la famille, est aujourd’hui au chômage. Mais pour rien au monde il n’irait travailler dans la banane. « Beaucoup sont morts du cancer de la prostate. Quand quelqu’un tombe malade, tu sais qu’ils ont travaillé toute leur vie là-dedans », dit-il. Constant, le père, ose quelques mots de français avant de poursuivre en créole : « J’ai commencé à 18 ans. J’ai tout fait : nettoyer les parcelles, arracher les plants, emballer les bananes une fois lavées… Il y avait beaucoup de produits dans l’eau, dans l’emballage. Je passais le désherbant et le chlordécone ». Sans protection adaptée et sans connaissance du danger. « Ils ont passé toute leur vie sans porter de masque ! » s’insurge Cédric, son fils. « Tous les patrons de la banane devraient être en prison ! Mais les ravets [cafards, ndlr] n’ont pas raison devant les poules : quand tu es plus fort, tu resteras toujours plus fort. » Constant a découvert son cancer de la prostate quelques années avant la retraite. Aujourd’hui âgé de 73 ans, il veut être indemnisé pour sa maladie. Mais il lui faudra encore patienter. Ce cancer n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle dans le régime agricole.
Constant Jaffard, atteint d’un cancer de la prostate, comme beaucoup d’autres ouvriers des plantations.
Faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle est aujourd’hui très improbable. Et quand certains y parviennent, cela ne suffit pas pour bénéficier d’une prise en charge complète. Marie-Anne Georges, salariée de Bois Debout, atteinte d’une hémopathie maligne (cancer du sang), en a fait l’amère expérience. En arrêt maladie depuis un an et demi, elle touche seulement 450 euros de l’Assurance maladie. Il lui manque un certificat médical initial qu’aurait dû établir un des médecins consultés à l’hôpital. « L’État a choisi de laisser crever les ouvriers agricoles, fulmine Philippe Verdol, président de l’association EnVie-Santé et maître de conférence en économie à l’université des Antilles. Beaucoup sont morts non indemnisés. La stratégie de l’État a été d’attendre le plus longtemps possible. » [7].
Mais les responsables de la CGTG n’ont pas abdiqué. Avec leurs camardes martiniquais, ils veulent faire pression sur le préfet et sur l’agence régionale de santé afin d’obtenir la gratuité des soins pour les ouvriers malades. Dernièrement, ils se sont rapprochés de Jean-Michel Macni, médecin basé en Martinique, l’un des rares à accepter d’accompagner les salariés victimes du chlordécone. Jean-Michel Macni veut réaliser des tests sur une centaine d’ouvriers agricoles afin d’évaluer la présence de chlordécone et d’autres pesticides comme le glyphosate dans leur sang. Objectif : établir les facteurs de risque et faire reconnaître les maladies de ces salariés comme des maladies professionnelles. Encore faudrait-il que le préfet accepte de débloquer la somme de 1,5 million d’euros nécessaire à l’achat de trois appareils destinés à mesurer le taux de pesticides sanguin. C’est pourtant bien peu comparé au puits sans fond que représentent les conséquences sanitaires du chlordécone, qui détruit encore la santé des travailleurs antillais un quart de siècle après son interdiction.
Samy Archimède
Publié le 18/07/2018
Interventions policières mortelles : les autorités publient pour la première fois des chiffres officiels
par Ludo Simbille (site bastamag.net)
Le 14 juin, Basta ! publiait une base de données inédite sur les interventions policières létales. Nous y recensions 478 morts des suites d’interventions policières en France entre 1977 et mai 2018. Moins de deux semaines plus tard, l’Inspection générale de la police nationale présentait, lors d’une conférence de presse, des chiffres sur le nombre de blessés et de tués par l’action de la police nationale. Un premier pas. Mais les données livrées par la police des polices diffèrent sensiblement de notre recensement. Explications.
L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) vient-elle de mettre fin à un déni de l’État français ? Pour la première fois de son histoire, l’IGPN a communiqué le 26 juin le nombre de blessés et de tués par l’action de la police nationale à l’occasion de la présentation de son rapport annuel d’activité. La police des polices fait état de 14 morts entre le 1er juillet 2017 et le 31 mai 2018 ainsi que d’une centaine de blessés. « Ce recensement n’est pas le recensement des bavures policières. Cela ne préjuge pas de l’illégitimité de ces blessures et de ces morts », a précisé en conférence de presse la directrice du service, Marie-France Monéger Guyomarc’h. Peuvent y figurer les personnes tuées par arme à feu par un policier lors d’une intervention, à cause d’un accident avec un véhicule de police ou en raison d’une crise cardiaque lors d’une garde à vue.
Annoncée depuis plusieurs mois, ce nouvel outil de collecte a d’abord été testé dans deux départements (Yvelines et Gironde), puis sur l’ensemble du territoire depuis janvier 2018. Les informations sont donc parcellaires, bien que non loin d’être exhaustives, selon l’IGPN. C’est de toute façon une première. Jusqu’à présent, aucune donnée officielle n’existait en France sur les homicides commis par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions. L’État français ne publiait aucun chiffre, aucune liste de victimes, aucun document statistique, aucun « débriefing ». « Mais dans une démocratie, il n’est pas anormal que l’on puisse savoir combien de tués sont recensés en intervention de police », admet Marie-France Monéger Guyomarc’h. Sauf qu’à ce jour, ce rapport a seulement été présenté en conférence de presse. Il n’est toujours pas consultable publiquement [1].
Basta ! compte 26 morts, l’État seulement 14
Coïncidence ? Cet exercice de transparence intervient deux semaines après la publication par Basta ! d’une infographie détaillant les interventions létales des forces de l’ordre sur les 40 dernières années. Notre base de données inédite s’étend de 1977 à 2018. Sur la courte période couverte par l’IGPN - de juillet 2017 au 31 mai 2018 — Basta ! comptabilise pour sa part 26 décès suite à une action de la police nationale, toutes unités confondues. S’y ajoutent quatre morts liés à la gendarmerie et six liées à des interventions de policiers municipaux. Bien plus, donc, que les 14 morts comptés par l’IGPN.
Comment expliquer cette différence de chiffres entre les deux décomptes ? Serait-ce parce que l’IGPN n’a pris en compte que les affaires pour lesquelles elle a été saisie ? Environ une dizaine selon nos données. Ou serait-ce en raison de la prise en compte par Basta ! également des morts causées par des policiers hors-service, responsables d’une dizaine de victimes en 2017 (Voir ici notre méthodologie de recensement) ? Impossible de répondre avec certitude sans un accès aux données détaillées.
L’IGPN affirme par ailleurs que quatre personnes se seraient suicidées ou seraient décédées en ayant pris la fuite lors d’accidents ou de noyades, sans qu’il soit possible d’en savoir plus sur les circonstances de ces cas. De qui s’agit-il ? Basta ! relève 13 personnes décédées alors qu’elles fuyaient la police – 8 en véhicule et 5 à pieds – entre juillet 2017 et mai dernier. Trois l’ont été dans un accident routier et deux se sont noyées. C’est le cas de Blessing Matthew, une migrante Nigériane noyée dans la Durance, dans les Hautes-Alpes, ou de Steven, détenu fuyant son transfert en juillet 2017. Selom et Matisse, eux, ont été fauchés par un train en tentant d’échapper à des policiers. Ismaël Deh est mort dans des circonstances troubles lors d’une tentative d’interpellation sur le parvis du château de Versailles en avril 2018.
Sur les 15 personnes abattues par un policier, seulement 5 étaient armées
Durant la même période, trois personnes ont aussi perdu la vie des suites d’un malaise ou d’une asphyxie alors qu’elles étaient entre les mains des gardiens de la paix. Massar, 24 ans, meurt après 13 jours de coma suite à une interpellation, gare du Nord à Paris, le 9 novembre dernier. Ce jeune Espagnol soupçonné de vendre des stupéfiants avait été maintenu au sol par plusieurs agents de la brigade ferroviaire avant de faire un arrêt cardiaque. En juillet 2017, Lucas, 34 ans, est retrouvé pendu à une bouche d’aération du commissariat d’Arpajon (Essonne) après avoir été placé en garde à vue pour excès de vitesse. Les policiers présents évoquent un suicide par pendaison avec les chaussettes. La famille conteste cette version et leur avocat a porté plainte pour « homicide involontaire par manquement à une obligation ». Le parquet d’Évry a ouvert une instruction pour « recherche des causes de la mort », une autre enquête a été confiée à l’IGPN.
D’après notre décompte, 15 personnes ont été abattues par l’arme d’un policier durant la période étudiée par l’IGPN. Deux d’entre elles étaient des personnes armées tuées après qu’elles aient elles-mêmes assassiné ou blessé plusieurs personnes : le premier en mai dernier dans le quartier Opéra à Paris, le second à la gare Saint-Charles de Marseille en octobre. « La plupart des tués l’ont été alors qu’ils avaient commis, qu’ils commettaient ou tentaient de commettre des actes terroristes, les autres attentaient délibérément à la vie de policiers », a réagi le syndicat classé à droite Alliance Police dans un communiqué. Pourtant, sur les 15 personnes abattues par un policier, Basta ! en compte seulement cinq qui étaient armées : trois étaient munies d’une arme à feu, deux d’une arme blanche (couteau).
L’IGPN recense aussi 394 usages d’arme à feu par les agents sur la période, soit une hausse de 54 % par rapport à 2017. Marie-France Moneger-Guyomarch’ ne fait pas le lien entre cette augmentation du nombre de tirs et l’évolution législative récente. Depuis février 2017, une loi permet aux policiers, au même titre que les gendarmes, de tirer en dehors du cadre de la légitime défense, notamment sur un véhicule « dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à l’intégrité physique d’autrui ». L’augmentation de l’usage de l’armes à feu était « déjà sensible avant février 2017 », a dit la responsable de l’IGPN. Un seul cas correspondrait à ce nouveau cadre juridique selon Marie-France Moneger-Guyomarch’ : un homme tué à Montargis en août 2017.
Flashballs et grenades en cause dans de nombreuses blessures
L’administration policière a assuré que les fonctionnaires concernés ont agi en état de légitime défense dans la totalité des affaires. Que dire de la mort de Gaye Camara, tué d’une balle dans la tête par un agent de la brigade anti-criminalité (BAC), en janvier, alors qu’il était à bord d’une voiture fuyant un contrôle d’identité ? L’IGPN explique l’augmentation de l’ouverture du feu par les policiers par une hausse de 10 % des refus d’obtempérer chez les personnes contrôlées. Cette propension à ouvrir le feu dans le cadre d’un simple contrôle d’identité s’est encore manifestée à Nantes, ce 3 juillet. Un CRS a tué d’une balle dans la nuque Aboubakar Fofana, 22 ans. Cette intervention mortelle a provoqué plusieurs jours d’émeute. La « légitime défense » initialement invoquée par le policier, mis en examen, s’est transformée en « tir accidentel ».
Autre nouveauté, la police nationale a comptabilisé les blessés que ses actions ont provoqués lors du deuxième semestre de 2017. Elle dénombre une centaine de « blessés sérieux » ayant plus de huit jours d’interruption temporaire de travail (ITT). Les deux-tiers d’entre eux se sont vu délivrer des ITT comprises entre 10 et 29 jours. Là encore, il est difficile d’avoir une vue d’ensemble sur ces violences en l’absence des informations complètes. En 2015, des étudiants du Centre de formation des journalistes avaient fourni une infographie assez détaillée sur le sujet, visible ici. Le site Reporterre avait aussi lancé une mission civile d’information suite aux violences policières lors des manifestations contre la loi Travail de 2016.
Les armes dites "intermédiaires" sont dans ces cas régulièrement mises en cause. Les grenades à main causent des séquelles corporelles graves, comme pour Maxime qui a perdu sa main en mai à Notre-Dame-des-Landes. Leur usage aurait baissé de 8 % sur les 12 derniers mois. Mais les emplois du pistolet à impulsion électrique – dit taser – et du lanceur de balles de défense – le flashball – ont respectivement augmenté de 20 % et 46 %. « Malgré sa très mauvaise réputation, le pistolet à impulsion électrique permet de faire baisser la pression et de sauver des vies », a voulu rassurer Marie-France Monéger-Guyomarc’h. Ces armes dites "non létales" ont pourtant ôté la vie à neuf personnes en France. Dernière en date : Cyrille Faussadier, tuée par un tir de flashball en janvier 2017.
Une timide réponse aux revendications des associations de défense des droits
Bien qu’encore flous et non accessibles en détail à ce jour, les chiffres communiqués par la police nationale mettent toutefois fin à une exception française. De tels recensements, officiels ou indépendants, existent en Allemagne, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, établi par le quotidien Washington Post, ou au Royaume-Uni. En France, seul le nombre de personnels des forces de l’ordre tués et blessés dans l’exercice de leurs fonctions était connu. En 2016, 26 fonctionnaires de sécurité sont morts en mission et en service, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. 14 gendarmes et 2 policiers sont décédés en mission lors d’une opération. 10 agents ont perdu la vie durant des formations, des trajets domicile-travail ou dans leur logement de fonction.
Avec ce rapport, l’IGPN répond, même timidement, à l’une des revendications des associations de défense de droits humains et des collectifs de lutte contre les violences policières, qui dénoncent depuis des années un déni des autorités publiques sur la question. En 2015, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat) recommandait de publier « le nombre de personnes blessées ou tuées dans le cadre d’interventions de police ou de gendarmerie ». Afin de mieux comprendre comment les éviter ?
Ludo Simbille
Publié le 17/07/2018
Cette Europe à bras ouverts
(site l’humanité.fr)
Palerme, Grande-Synthe, Tilos... des villes inventent et coordonnent leur politique d’accueil des migrants. Toutes dénoncent l’accord scélérat de l’UE. Reportage à Valence l’espagnole.
«Moi, qui ai sur la peau la saveur / Amère du pleur éternel / Qu’ont versé en toi cent peuples/d’Algésiras à Istanbul », chante Joan Manuel Serrat dans sa « Méditerranée » : « Je porte ta lumière et ton odeur / N’importe où, où que j’aille. »
Le village de Cheste, bourgade entourée de vignes, d’orangers et d’oliviers dans l’arrière-pays de Valence, semble n’avoir rien connu des événements qui ont agité la ville et la région deux semaines auparavant. Et l’accostage à Valence de l’« Aquarius » et de deux navires militaires italiens le 15 juin dernier, avec 630 rescapés des eaux méditerranéennes à leur bord, semble déjà loin. Si dans les heures qui ont suivi leur arrivée dans le port, quelques images ont été volées aux réfugiés installés sur le site d’un complexe universitaire situé à 6 kilomètres du campanile du village valencien, le calme s’est vite imposé autour d’eux. Sous la garde de la Croix-Rouge, porte close aux visiteurs extérieurs en dehors des membres des associations engagées dans la seconde phase de l’accueil. En cause, un protocole élaboré par les autorités de la ville, du département et de la région de Valence pour les soustraire à la pression publique, afin de leur donner le temps nécessaire pour récupérer d’un calvaire que les médias locaux et nationaux ont qualifié d’« odyssée ». Mais, à la manière de ces palmiers agités par le garbi, ce vent de mer qui vient briser la touffeur de l’après-midi, les apparences, dans la région de Valence, sont trompeuses. Hors champ, l’élan de solidarité et l’esprit de responsabilité n’ont pas faibli.
« Le village a toujours été une terre de lutte et de solidarité », explique Xavier Vivia, militant à Cheste de la Plateforme des victimes du crédit hypothécaire – PAH –, avant de détailler les mobilisations locales des premiers jours ainsi que celles qui se déroulent, sur place, au quotidien, loin des regards. « La grande majorité des gens de Cheste, qui ont toujours été prêts à aider et à accueillir, ont vu l’arrivée des réfugiés comme une chose positive », souligne-t-il. « Même si, tient-il à préciser, quelques-uns, sous l’influence des discours des représentants du Parti populaire du village, ont été manipulés dans l’autre sens. Notamment les plus pauvres. »
L’arrivée de l’« Aquarius » a suscité de nombreux débats dans la ville et la région. À l’occasion de la Journée internationale des réfugiés du 20 juin, c’est dans une annexe de l’université de Valence située dans la vieille ville que la Commission espagnole d’aide aux réfugiés – Cear – a organisé une conférence au cours de laquelle elle a présenté son rapport annuel. À leur siège valencien, le 27 juin, c’est en présence de représentants de la région et de la mairie de Valence que les CCOO – Commissions ouvrières – ont organisé pour leur part un débat sur la défense des droits des travailleurs migrants. Une occasion, pour José Antonio Moreno, représentant des CCOO au Conseil économique et social de l’UE, de souligner, aux côtés d’Isabel Barrajon, Lola Santallina et Arturo Leon, responsables locaux et confédéraux du syndicat, que l’intervention des ONG en mer, dénoncées comme « faisant le jeu des passeurs », n’était pas une « question de solidarité » mais de « droit » et de « responsabilité de la part des États ».
Devant les portes du centre de Zapadores de Valence, dans le quartier de Russafa, les militants de la campagne CIEs NO manifestent, comme chaque dernière semaine du mois depuis huit ans, afin d’obtenir la fermeture des centres d’internement pour les étrangers – CIE. Créés en 1985, ces CIE avaient été formellement dénoncés dans un rapport commandé par le Parlement européen en 2007 pour leur dimension carcérale, violente et dégradante. Le rapport de l’association Steps Consulting Social fut laissé sans suite. Les CIE, avec celui de Zapadores, à Algésiras, Archidona, Barcelone, Las Palmas, Madrid, Murcie et Tenerife, sont au nombre de huit en Espagne. C’est le modèle des établissements d’« accueil » des « migrants » que le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a fait valoir au cours du Conseil européen du 28 juin, dénoncent les militants de la plateforme citoyenne. C’est aussi celui qui a été présenté par Emmanuel Macron comme l’objet d’un accord obtenu soi-disant de haute lutte face aux réticences des autres représentants des pays de l’Union européenne, sourire de satisfaction de ses dirigeants d’extrême droite en prime. Depuis, les condamnations par les associations et les mouvements de défense des droits de l’homme se sont multipliées.
un accord européen « gravissime »
« Nous ne sommes pas d’accord avec l’agrément qu’a conclu le gouvernement espagnol », explique Alberto Ibanez, secrétaire de la vice-présidence à l’Inclusion et à l’Égalité au siège de la région de Valence. « L’optique de l’accord vise à freiner l’immigration et non à garantir l’accueil. L’Europe, avec cet accord, ne garantit pas les droits humains fondamentaux. En Espagne, nous avons déjà l’expérience des CIE que le gouvernement régional de Valence ne partage pas mais dénonce. » « Cet accord est un accord lâche, minimaliste, qui essaye de mettre un frein à l’extrême droite en se faisant d’extrême droite, précise-t-il. C’est gravissime. »
Une profonde déception, donc, pour les représentants d’une ville, d’un département et d’une région qui s’étaient préparés depuis 2015 à devenir « cités refuges » et qui, s’étant heurté à l’opposition constante du gouvernement de Mariano Rajoy et du Parti populaire pendant trois ans, avaient vu avec satisfaction le feu vert leur être donné par le premier ministre socialiste pour accueillir les réfugiés de l’« Aquarius ». Une déception, mais une résolution constante avec l’appel de la région, par la voix de son président, Ximo Puig, à lancer une conférence des villes de la Méditerranée à Valence cet automne afin de peser sur l’UE.
À Cheste, à Valence et sa région, loin du « coup de com » permanent, les palmiers « entre la plage et le ciel » affrontent le vent mauvais de l’histoire. Ce n’est pas à ses racines, qu’elles se prétendent « c
Publié le 16/07/2018
Chili. La justice tonne enfin du chant de Victor Jara
Cathy Dos Santos (site l’humanité.fr)
Neuf ex-militaires chiliens ont été condamnés pour leur implication dans l’assassinat du célèbre auteur-compositeur-interprète communiste.
L’alerte rouge a été lancée. Des rapaces d’acier survolent le palais présidentiel de la Moneda. Ce 11 septembre 1973, le président chilien Salvador Allende lance un appel à la résistance. Les putschistes guidés par le général Augusto Pinochet, et soutenus par la CIA et les États-Unis, veulent faire mordre la poussière à l’Unité populaire. Victor Jara entend à la radio ce qui sera l’ultime discours du chef de l’État socialiste. La confédération syndicale enjoint les travailleurs et les étudiants à occuper les usines et les centres universitaires, à faire corps pour défendre les transformations progressistes. L’auteur-compositeur-interprète, qui a été nommé ambassadeur culturel en 1971 par le gouvernement d’Allende, se rue vers l’université technique de l’État. Très vite, un couvre-feu est décrété. La Moneda est pilonnée et la mort de Salvador Allende annoncée. Les tanks se postent devant la faculté. L’armée donne l’assaut. Les occupants sont rossés. Comme des milliers d’autres, Victor Jara est conduit au stade Chili. Les enceintes sportives sont désormais transformées en d’immenses camps de concentration où les « subversifs » sont déshumanisés.
Le chanteur chilien a connu la souffrance de la torture
L’icône communiste de la nouvelle chanson chilienne est aussitôt repérée. Voilà des années que sa puissante voix est entrée dans les foyers. Le troubadour guitariste fustige l’exploitation et la misère des paysans et des ouvriers ; il encense l’anti- impéralisme ; il sublime les combats des siens et de ses frères voisins. « Je ne chante pas pour chanter ni parce que j’ai une belle voix, je chante parce que la guitare a du sens et de la raison », rappelle-t-il dans son célèbre Manifeste. Avec sarcasme, un gradé le mime, jouant de son instrument de prédilection ; il lui fait surtout comprendre que ses dernières heures sont comptées. Victor Jara connaît alors l’insondable souffrance de la torture. Le corps meurtri mais la conscience en éveil, il s’emploie à jeter sur le papier un cri de douleur et de révolte. « Comme mon chant sort mal quand je dois chanter l’épouvante. Le sang du camarade Allende frappe plus fort que les bombes et la mitraille. Notre poing frappera, à nouveau, de la même manière », griffonne-t-il. Ce seront ses derniers vers.
Dans les bas-fonds des vestiaires, les soldats s’acharnent sur ce barde à l’immense talent. Ses mains, dont il disait qu’elles étaient son unique bien, son « amour et sa subsistance », sont broyées. Il gît dans une marre de sang. Une ultime balle est tirée à bout portant pour être sûr qu’on ne l’entende plus jamais chanter. Il aurait eu 41 ans le 28 septembre.
Près de quarante-cinq ans après ce sinistre événement, la justice chilienne a enfin rendu justice. Huit militaires chiliens à la retraite – Hugo Hernan Sanchez Marmonti, Raul Anibal Jofré Gonzalez, Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, Nelson Edgardo Haase Mazzei, Ernesto Luis Bethke Wulf, Juan Renan Jara Quintana, Hernan Carlos Chacon Soto et Patricio Manuel Vasquez Donoso – ont été condamnés à une peine de quinze ans et un jour comme auteurs des homicides de Victor Jara et de l’ex-directeur de gendarmerie Littré Quiroga, et trois ans de prison supplémentaires pour enlèvement. Un neuvième accusé, l’ex-officier Rolando Melo, a, quant à lui, écopé de cinq ans de prison pour avoir couvert ces assassinats. L’État devra également indemniser les familles des victimes à hauteur de 2,1 millions de dollars.
En juin 2016 déjà, un jury fédéral de l’État d’Orlando avait reconnu coupable du meurtre du célèbre chanteur Pedro Pablo Barrientos Nuñez, un officier chilien réfugié aux États-Unis à la fin de la dictature de Pinochet. Condamné à verser 28 millions de dollars à la famille, il est toujours sous le coup d’une demande d’extradition du Chili. Au moment des faits, ce lieutenant était assigné à la surveillance des prisonniers dans le stade. Un témoin de l’époque a rapporté que Barrientos avait revendiqué la paternité du coup qui aura été fatal à Victor Jara.
Le corps du militant communiste a été jeté dans un terrain vague aux côtés de cinq autres compagnons d’infortune puis transporté dans une morgue. Sa dépouille aurait pu « disparaître » comme nombre des 4 000 morts et disparus. Mais un jeune réquisitionné chargé de répertorier les victimes, Hector Herrera, identifie le célèbre chanteur et prévient aussitôt l’épouse de Victor Jara, la danseuse Joan Turner. Il sera enterré clandestinement à la nuit tombée.
Longtemps, la mort du musicien a été vécue comme le symbole de la répression et de l’impunité au Chili. Ses écrits et ses chants ont été prohibés par le régime du satrape. « Mon chant est une chaîne / Sans commencement ni fin / Et dans chaque chaînon se trouve / Le chant des autres », avait écrit Victor Jara. Le 24 septembre 1973, lors de l’enterrement du prix Nobel de littérature et compagnon de route du Parti communiste chilien Pablo Neruda, des voix osent braver la répression : « Victor Jara présent ! Aujourd’hui et toujours ! »
Ce n’est qu’en décembre 2009 qu’il aura enfin droit à des obsèques publiques après que ses restes ont été exhumés dans le cadre de l’enquête judiciaire censée faire la lumière sur ses derniers jours. Des milliers de Chiliens agitant des drapeaux rouges ont alors accompagné leur idole devenue martyre au cimetière général de Santiago, où il repose depuis. Sur la plaque funéraire de l’auteur de l’incontournable Te recuerdo Amanda, on peut lire un simple « Victor Jara » écrit à la peinture noire, ainsi qu’une date, le 14 septembre 1973.
Publié le 15/07/2018
Ces simples citoyens qui sauvent l’honneur d’une République en faillite morale en ouvrant leurs portes aux exilés
par Linda Maziz (site bastamag.net)
Ils et elles sont plus fidèles aux valeurs de la République que tout le gouvernement réuni : des réseaux de citoyens se sont organisés à Paris et en banlieue, comme dans toute la France, pour héberger chez eux les exilés les plus vulnérables, familles, enfants et adolescents isolés ou femmes seules. Ils font ainsi vivre au quotidien le principe de fraternité, réaffirmé par le Conseil constitutionnel, pendant que le gouvernement abandonne les exilés, démantèle leurs campements sans proposer de solutions, ferme les points d’eau, entrave leurs démarches administratives, ordonne aux forces de l’ordre de les harceler. Rencontre avec une habitante de Saint-Denis, qui a déjà accueilli 200 exilés chez elle et avec des bénévoles qui tentent, chaque jour, de les aider.
C’est toujours un bonheur d’écouter Olympe parler étymologie [1]. « En latin, hostis veut dire l’étranger, qui donne à la fois hospitalité et hostilité. Dans l’action même de l’accueil va se jouer le fait que l’autre se transforme en ennemi ou en ami », explique-t-elle. Cette habitante de Saint-Denis, mère de famille de 45 ans, travaille comme enseignante-chercheuse à l’université. Elle est bien placée pour parler « hospitalité » : depuis l’automne dernier, elle a hébergé plusieurs dizaines de familles en détresse !
« Cela a démarré en octobre, je rentrais d’un séjour à Dakar et je me suis retrouvée toute seule dans un grand appartement vide. Puis je vois passer un message sur Facebook. L’association Utopia 56 qui vient en aide aux migrants Porte de la Chapelle lançait un appel à la solidarité pour héberger le soir-même une cinquantaine de personnes qui n’avaient nulle part où dormir, raconte Olympe. J’avais des chambres libres chez moi et il y avait des gens dehors, je n’ai pas réfléchi plus longtemps. » Quelques heures plus tard, un bénévole arrive accompagné d’une famille afghane qui a ainsi pu trouver chez la Dionysienne un refuge pour la nuit. Rebelote le lendemain soir, et tous les suivants.
« Depuis cet automne, j’ai dû héberger plus de 200 personnes »
« J’ai eu jusqu’à trois familles en même temps. Depuis cet automne, j’ai dû héberger plus de 200 personnes. » En quelques mois, Olympe a l’impression de rencontrer « le monde entier ». Ses hôtes viennent du Burkina, d’Érythrée, d’Éthiopie, du Nigeria, du Mali, de Somalie, du Soudan, mais aussi de Syrie, d’Irak, ou encore du Bangladesh. Des familles, des femmes seules ou accompagnées d’enfants, parfois très jeunes, qui ont tous en commun de chercher asile en France et d’avoir été refoulées des dispositifs d’hébergement d’urgence.
Olympe, comme des dizaines de milliers d’autres citoyens, n’a pas craint d’être accusée de « délit de solidarité ». Ni attendu le 6 juillet, et la réaffirmation par le Conseil constitutionnel du principe de fraternité comme valeur essentielle inscrite dans notre constitution [2]. « La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité". La Constitution se réfère également [...] à l’“idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité". Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national », précise le Conseil constitutionnel. Ce principe de fraternité, les hébergeurs citoyens le mettent en œuvre au quotidien.
« Des familles entières se retrouvaient dehors, avec des enfants, des bébés, des femmes enceintes »
C’est en 2017 que l’association humanitaire Utopia 56 a lancé ce réseau d’hébergement citoyen sur Paris et la petite couronne, pour tenter d’offrir mieux qu’un sac de couchage posé à même le sol aux personnes exilées les plus vulnérables [3]. Son action s’est d’abord concentrée sur la situation des mineurs isolés étrangers contraints d’errer le soir dans les rues faute d’une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance. À leur détresse s’est ajoutée il y a un peu plus d’un an celle de familles et de femmes, laissées pour compte elles aussi par les pouvoirs publics.
« Avec la fin de l’hiver, beaucoup de structures ont fermé. Des familles entières se retrouvaient dehors, avec des enfants, des bébés, des femmes enceintes... On ne pouvait pas laisser faire ça, se souvient la bénévole Fanny Lepoivre, qui assure alors un rôle de coordinatrice de terrain auprès des migrants regroupés par centaines Porte de la Chapelle. J’ai commencé à poster des messages sur Facebook, que je faisais tourner dans les réseaux de soutien aux réfugiés en demandant s’il n’y avait pas quelqu’un qui pouvait accueillir une mère et ses deux enfants, juste pour une nuit. C’est parti comme ça. L’été dernier, nous tournions avec 20 hébergeurs, aujourd’hui nous en avons réuni près de 240. » Malgré cette montée en puissance de la solidarité citoyenne, la situation reste critique. « Aujourd’hui, concrètement, nous manquons de bénévoles sur le terrain. Beaucoup de nos hébergeurs partent en vacances, et, comme l’été dernier, nous constatons une recrudescence du nombre de familles à la rue », témoigne la bénévole.
Points d’eau coupés et harcèlement policier
« Cela fait longtemps que la soirée n’a pas été aussi compliquée », dit aussi Louis, un trentenaire qui vient Porte de la Chapelle un à deux soirs par semaine depuis décembre, après le travail. Vu la situation ce 2 juillet, « compliquée » est un euphémisme. Louis croule sous les demandes. Des centaines de migrants, dans le dénuement le plus total, jouent ici leur survie. Ils ont faim, ils ont soif et n’ont nulle part où aller et rien pour dormir. Après le démantèlement des campements en juin, les points d’eau ont été coupés. Reste le harcèlement policier pour les dissuader de tout nouveau regroupement, ce qui oblige « les exilés à se cacher et à vivre dans une rare précarité », comme l’a dénoncé une nouvelle fois un collectif d’associations dans un communiqué commun fin juin. Après trois opérations de démantèlement des campements parisiens en juin, entre 300 et 500 exilés se retrouvent en errance dans le Nord de Paris et à Saint Denis.
Ce soir-là, il n’y a que très peu de bénévoles pour tenter de répondre à l’urgence et aux besoins. Un homme cherche un pansement, un autre une carte sim. Un troisième attend désespérément un t-shirt, car il n’a à se mettre qu’un pull épais, totalement inadapté en cet épisode de forte chaleur. Louis, qui reçoit toutes ces requêtes, doit aussi rester concentré sur sa mission principale : celle de trouver un hébergement pour les familles et les femmes à qui on a dit qu’elles pouvaient se présenter à partir de 19 h devant ce local associatif du boulevard Ney pour espérer une mise à l’abri.
Pour une famille protégée pour la soirée, treize en attente
Elles étaient quatre dès le début de la soirée, mais il en arrive de nouvelles en permanence. Dans le chaos ambiant, il faut aller à leur rencontre, parfois contacter un service d’interprétariat à distance pour recueillir quelques informations sur leur situation quand la famille ne parle ni français, ni anglais. Date d’arrivée en France, composition familiale... Plusieurs ont rendez-vous le lendemain en préfecture où à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile. La plupart ont appelé le 115, sans succès, alors elles sont venues là. C’est le cas de deux familles moldaves, d’une autre bangladaise et d’un couple éthiopien qui a aussi besoin de lait pour pour ses jumeaux de 18 mois. « Please, no sleep, no food », c’est aussi ce qu’explique une mère afghane, en désignant ses trois enfants.
Il y a également quatre femmes seules qui se sont accroupies côte à côte dans un coin, en espérant être bientôt emmenées loin de cet enfer. Louis saisit toutes les demandes d’hébergement sur son téléphone pour les transmettre au bénévole d’astreinte, chargé de faire le lien depuis chez lui avec les hébergeurs citoyens inscrits sur le réseau, pour savoir si certains sont disponibles pour accueillir. « C’est bon, nous avons trouvé un hébergement sur Paris pour l’une des familles moldaves, celle qui a trois enfants. On attend la distribution de repas à Aubervilliers, et dès qu’ils ont mangé, un bénévole va les accompagner. » Voilà déjà une famille de protégée pour la soirée. Mais le temps passe vite, et il reste encore treize solutions à trouver, soit une quarantaine de personnes à héberger.
« Quand les gens qui ont vécu ces violences se retrouvent dans ton salon, cela devient très concret »
Chez Olympe, certaines familles ne sont restées qu’une nuit, d’autres une semaine, d’autres encore plus d’un mois. « Ce n’est pas prévu comme ça. Normalement, les gens repartent le lendemain matin. C’est moi qui ai demandé à ce que les gens restent quand j’ai vu revenir chez moi des familles que j’avais déjà accueillies trois jours auparavant. Plutôt qu’elles soient ballotées d’un endroit à l’autre, un coup dehors, un coup au chaud, autant qu’elles se posent là le temps d’avoir une solution. » Olympe a pour habitude de ne jamais poser de questions. « Je ne connais leurs histoires que lorsque les gens ont voulu m’en parler. »
Souvent, au bout de deux ou trois jours, ils ont envie de raconter. Leur vie d’avant, le choc traumatique qui a provoqué leur départ et les horreurs subies pour arriver jusqu’ici. « Par les médias, les ONG, on peut s’informer sur les situations d’extrêmes violences, ce qui se passe en Libye et dans quelles conditions les gens traversent la Méditerranée. Mais quand les gens qui ont vécu cela se retrouvent dans ton salon, cela devient très concret. Et c’est souvent pire que tout ce que l’on peut imaginer », rapporte l’universitaire. De ce qu’elle a observé, les gens malgré tout vont « plutôt bien » dès lors que le noyau familial a été préservé. « C’est pour cela que certaines grandes familles refusent des hébergements, parce qu’elles préfèrent rester ensemble à la rue plutôt que séparés. »
« Un gouvernement qui laisse des femmes et des enfants à la rue, c’est cela qui n’est pas normal »
« Chez les gens, tout se passe toujours très bien, tient à préciser Fanny Lepoivre. D’ailleurs, cela fait six mois que nous avons arrêté de communiquer. Le réseau s’agrandit naturellement par le biais du bouche à oreille. Les familles hébergées sont plus que discrètes et reconnaissantes. Quand elles arrivent chez l’habitant, elles sont souvent épuisées. Tout ce qu’elles veulent, c’est éventuellement prendre une douche et dormir avant de repartir le lendemain matin pour poursuivre leurs démarches administratives. »
Ce fonctionnement est d’ailleurs décrit dans une convention qu’un référent vient présenter au domicile de tous ceux qui souhaitent rejoindre le réseau de l’hébergement citoyen. « Nous leur expliquons la démarche, comment cela se passe sur un plan pratique, juridique. S’ils sont d’accord, ils nous donnent leurs disponibilités. Certains vont nous demander de leur envoyer un texto dès qu’il y a un besoin et ils nous répondront par oui ou non. D’autres ne peuvent héberger que le week-end, d’autres que le lundi ou le mercredi, mais pas plus d’une fois par mois, et nous nous adaptons. »
Quand quelqu’un lui fait remarquer que ce qu’elle fait pour ces familles réfugiées est assez exceptionnel, Olympe dément : « Non, ce n’est pas ce que je fais qui est exceptionnel, c’est l’État d’exception dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, avec un gouvernement et des pouvoirs publics qui laissent des femmes, des enfants et des bébés à la rue. C’est cela qui n’est pas normal. Dans ce contexte, où nous sommes poussés à une forme d’acceptation de l’inacceptable, l’évidence, c’est de ne pas les laisser dehors, c’est d’accueillir chez soi. » Hospitalité, toujours.
Linda Maziz
Publié le 14/07/2018
A Blanquefort, l’usine Ford ferme sans un bruit
Par Justine Brabant(site médiapart.fr)
Le groupe Ford a annoncé début juin le lancement d’un plan social en vue de la fermeture de son usine de Blanquefort, qui emploie 872 salariés – dont l’ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou. Les chances de reprise pérenne semblent faibles. Sur place, les ouvriers disent leur colère et leur impuissance.
Blanquefort (Gironde), envoyée spéciale.- Placardé entre une affiche du Futuroscope et des tarifs préférentiels sur une cuvée de champagne de petit producteur, Vincent Lindon tend un regard grave vers le visiteur. L’affiche du film En guerre, de Stéphane Brizé, qui raconte la lutte des salariés d’une usine menacée de fermeture, trône en bonne place dans le hall du comité d’entreprise (CE) de l’usine Ford de Blanquefort, en Gironde. Les ouvriers du site l’ont regardé ensemble, pour se donner du courage. Cela n’a pas suffi : ce mercredi 11 juillet, les visages des élus de la CGT Ford (majoritaire) sont plutôt fermés.
Derrière les stores tirés du hall, on aperçoit les longs murs de tôle jaune de l’usine. Le site, ouvert en 1973, s’étale sur plus de dix hectares de bâtiments, parkings, cuves, installations électriques et portions de terrain vague. On y fabrique des doubles embrayages, des transmissions automatiques et des carters de moteur. Dans ses années fastes, il employait 3 600 salariés. Sans quelques timides autocollants « Sauvons les emplois » posés sur les panneaux à l’entrée, difficile de deviner que l’usine pourrait être en train de vivre ses derniers mois.
Dans les locaux du comité d’entreprise de l’usine Ford de Blanquefort, le 11 juillet 2018. © Justine Brabant
Voilà pourtant plus d’un mois que la direction a annoncé son intention de lancer un plan social (plan de sauvegarde de l’emploi, PSE) en vue de la fermeture de l’usine, qui emploie aujourd’hui 872 salariés et représente 3 000 emplois induits, selon les estimations des syndicats. Le bilan de la mobilisation semble bien maigre au regard des enjeux : quelques débrayages pour tenir des assemblées générales, une irruption au conseil de la métropole, une manifestation qui a réuni 400 personnes à Bordeaux. Pas de grève en vue, encore moins de blocage. Les salariés peuvent pourtant compter sur un atout médiatique : l’ex-candidat à la présidentielle du NPA, Philippe Poutou, qui travaille dans l’usine depuis 1996 et y est élu CGT. Mais même cet habitué des luttes le concède : « Le rapport de force n’est pas avec nous. C’est tellement compliqué, tellement dur, on n’a rien derrière. Tout pousse à lâcher. »
Il y a dix ans pourtant, Poutou et ses collègues avaient réussi, par leur mobilisation, à peser sur une direction qui menaçait déjà de cesser la production. Les ouvriers bloquent alors l’usine pendant une semaine, investissent le mondial de l’automobile, et mettent leurs « patrons » sous pression. Jérôme Coutelle, agent d’assemblage et délégué du personnel, s’en souvient comme si c’était hier. Il pointe du doigt avec un grand sourire le parking écrasé de soleil : « Le 24 octobre 2008, on avait bloqué la direction, juste ici. » « Il y avait eu une grosse mêlée ! » s’enthousiasme Poutou. « Ils avaient fini par s’échapper par un trou dans le grillage », en rit encore Coutelle. « En tout, on leur avait pourri la vie pendant dix semaines. On avait même eu une double page dans Le Monde à l’époque ! » Ford finira par trouver un repreneur allemand, et acceptera de reprendre le site lorsque ce dernier jettera l’éponge, en 2012.
Que s’est-il passé depuis ? Pourquoi cette nouvelle menace de fermeture ne mobilise-t-elle pas les salariés ? La réponse tient au cumul de trois facteurs : la fatigue d’un personnel vieillissant, la stratégie particulièrement efficace de Ford pour dévaloriser un site devenu peu stratégique et l’impuissance apparente des pouvoirs publics à peser face au géant automobile.
« Les gens n’ont plus la niaque »
Début juin, la direction a détaillé le calendrier envisagé pour son PSE : une période de consultation jusqu’à la fin novembre, une vingtaine de jours d’allers et retours entre Ford et les services de l’État qui doivent homologuer (ou non) le plan, les premiers départs volontaires en janvier 2019 et les premiers licenciements en septembre 2019.
« Il n’y a pas eu d’arrêt de travail le jour de l’annonce du PSE, vous vous rendez compte ? souffle Philippe Poutou. Les camarades syndicalistes de Ford Europe nous ont appelé pour nous dire : “La direction dit qu’il n’y a pas d’arrêt, ils essaient de nous enfumer ou quoi ?” Avec notre réputation, tout le monde s’attendait à ce qu’il se passe quelque chose. »
Mais les salariés de Blanquefort sont fatigués. « Ils savent bien qu’avec l’âge qu’on a, il y aura moins de bagarre. C’est sûr qu’il n’y a plus le mordant qu’il y avait en 2008-2012. Il n’y a plus cette niaque », regrette Thierry Captif, un des collègues de l’ancien candidat à la présidentielle. « Mener deux batailles dans sa vie pour la même chose…, on y laisse des forces. Et puis, on n’est plus aussi nombreux », analyse Jérôme Coutelle. En 2008, l’usine comptait 1 600 salariés (contre 872 aujourd’hui), dont « 200 à 300 » très mobilisés, estiment les syndicats. Aujourd’hui, le noyau de la contestation se compte plutôt en dizaines.
Des ouvriers moins nombreux, mais surtout plus vieux. La moyenne d’âge sur le site de Blanquefort est de 51 ans, indique Philippe Poutou, qui estime que « sur les 872 employés, 200 à 300 ont entre 55 et 60 ans, donc sont potentiellement concernés par une pré-retraite ». Et n’ont donc pas forcément le cœur à batailler.
Ambiance générale de résignation
Dans les bureaux du comité d’entreprise, à deux pas des affiches de réclame, les collègues syndicalistes de Poutou se rassemblent autour d’un café. Dehors, la chaleur cogne sur les bâches des camions. L’usine dégage un étrange silence. Parmi les ouvriers rassemblés : Éric Lafargue, tee-shirt de sport orange et petites lunettes sur le nez. Vingt-quatre ans de « boîte » n’ont pas entamé ses convictions. Mais le militant se sent parfois un peu seul : « Il faudrait que les gens retrouvent la niaque. Qu’on réussisse à troubler la paix patronale, à tracter dans toutes les usines du coin pour dénoncer ce règne du pognon. Dire que l’économie devrait être au service de l’humain et pas l’inverse. » L’ouvrier marque une pause et s’excuse presque : « Bon, je sais, moi je suis un militant à l’ancienne. Je sais qu’on n’est plus beaucoup à dire des choses comme ça… »
Dans les locaux du comité d'entreprise de l'usine Ford de Blanquefort, le 11 juillet 2018. Au centre, Philippe Poutou. © Justine Brabant
Pour le petit groupe, c’est clair : Blanquefort fait les frais d’un climat général en France peu favorable aux luttes sociales. « On s’en prend plein la tronche. Avec la loi Travail, les ordonnances… On a envoyé un message au patronat. Aujourd’hui, les patrons, ils déroulent », souffle Jérôme Coutelle. « Macron attaque de partout et les gens ne réagissent pas. Au début on se disait : “Merde, on est nuls ou quoi ?” Et puis les jours passent et on se dit que c’est partout. Il y a une ambiance générale de résignation qui nous atteint ici aussi », admet Poutou.
« Ils nous occupent en attendant la fin »
C’est dans ce contexte que Ford a pu avancer ses pions. Affecté par la concurrence accrue sur le marché chinois, par la saturation du marché américain et par la hausse des matières premières, le constructeur s’est engagé dans une bataille pour réduire ses coûts. L’une des premières victimes de cette stratégie est l’usine de Blanquefort, jugée trop petite pour produire à des coûts intéressants. Alors qu’une nouvelle boîte de vitesses aurait pu y relancer la production, le groupe a finalement décidé de la faire construire par ses usines aux États-Unis – où « Ford s'est engagé à investir 9 milliards de dollars d’ici 2019 en y créant 8 500 emplois », rappelle Le Figaro.
L’expert économique mandaté par le comité d’entreprise, Gérard Godefroy, estime que les arguments avancés pour démontrer la faible rentabilité de l’usine sont de mauvaise foi : « Leur démonstration est biaisée. Ils calculent les coûts de fabrication dans l’usine américaine en prenant en compte des investissements qui ne sont pas encore réalisés. Sans compter que l’on pourrait miser sur des gains de compétitivité à Blanquefort – rien qu’en 2017, on y a déjà baissé les coûts de 8 %, et l’effort pourrait être poursuivi. »
Mais qu’importe : le groupe semble déterminé à se débarrasser de l’usine au plus vite. Les syndicats se demandent même si le constructeur n’a pas délibérément organisé une faible productivité pour justifier son désengagement : « Ils accélèrent les prêts de personnel vers l’usine voisine [qui appartient à 50 % à Ford – ndlr], nous proposent d’arrêter de travailler pour regarder les matchs de l’équipe de France tout en étant payés… C’est quand même étrange », énumère le secrétaire adjoint du comité d’entreprise et élu CGT Gilles Penel. Contactée le 10 juillet, la direction de Ford n’a pas souhaité répondre aux questions de Mediapart, qui concernaient notamment ces accusations de baisse délibérée de l’activité.
Cette production au ralenti, faute de confier au site des boîtes de vitesses innovantes, a fini par user les ouvriers. Éric Lafargue, agent de fabrication au traitement thermique, peut en témoigner : « Dans mon secteur, il y a très peu de boulot. On travaille à 10 % de nos capacités. 55 % de nos locaux sont vides de machines. » Son travail consiste à enfourner des pièces de boîtes de vitesses dans des fours de plusieurs dizaines de mètres de long, afin de les « durcir ». « Il y a huit fours mais seulement quatre qui tournent, et encore, pas tous en même temps. Alors les gens se baladent, discutent un peu, amènent des cartes… On sait qu’ils nous occupent en attendant la fin. C’est usant moralement pour les gars. »
« Occuper les gars » : la direction n’avait pas vraiment le choix. Ford s’est engagé en 2013 à maintenir mille emplois à temps plein sur le site, en échange de 46 millions d’euros de subventions publiques. Le tribunal de grande instance de Bordeaux a estimé en 2017 qu’il n’avait pas tenu ses engagements, et l’a condamné à des dommages-intérêts. Depuis, Ford a interjeté appel.
L’accord-cadre qui l’obligeait à maintenir ces emplois a pris fin en mai 2018. Le constructeur n’a pas attendu un mois avant d’annoncer son plan social. Un calendrier qui laisse planer de sérieux doutes sur la volonté affichée du constructeur de trouver un repreneur pour le site – une usine dont les employés sont sur le départ n’étant pas une perspective très attractive pour un repreneur potentiel. « Un repreneur sérieux a besoin d’activité et de compétences. Or ici, Ford a baissé son activité et annonce un PSE qui va faire partir le personnel », déplore l’expert économique du comité d’entreprise.
Dans les locaux du comité d'entreprise de l'usine Ford de Blanquefort, le 11 juillet 2018. © Justine Brabant
Même si son objectif semble être l’abandon rapide du site, la direction de l’usine sait qu’elle doit, au moins en apparence, faire mine de se préoccuper de la suite : depuis 2014, la loi dite Florange l’oblige à rechercher un repreneur et à associer le comité d’entreprise à cette recherche.
Mais le constructeur a une obligation de moyens, pas de résultats. Rien ne l’oblige à faciliter la reprise – en s’engageant par exemple à maintenir temporairement un certain volant de commandes. Or, l’enjeu est crucial pour l’usine de Blanquefort. Le seul repreneur potentiel à s’être manifesté, le groupe Punch Powerglide, ne semble pas avoir les moyens d’assurer l’avenir de l’usine sans une garantie de commandes. L’État français pourrait-il convaincre le constructeur de le faire ? « Cela fait partie des pistes de négociation », indique le délégué interministériel aux redressements d’entreprises, Jean-Pierre Floris, qui suit le dossier.
La marge de manœuvre incertaine des pouvoirs publics
Depuis quelques mois, Jean-Pierre Floris montre les muscles. « Je considère que Ford est de mauvaise foi. Il nous a baladés des années », tempêtait-il, le 28 mars dernier, lors d’une audition à l’Assemblée nationale. « Nous avons été violents avec Ford. Dans les réunions, il y a eu un peu de boxe, c’était viril. D’ailleurs, nous étions violemment contre le lancement d’un PSE », assure-t-il à Mediapart.
Mais toute la virilité du délégué n’a manifestement pas suffi à empêcher Ford de lancer son plan social. Aujourd’hui, ses marges de manœuvre paraissent réduites : « Nos moyens de pression ? Nous pouvons jouer sur la réputation de Ford. Et puis sur le PSE. Tous les services de l’État éplucheront ce qu’ils font à la ligne près », avance Jean-Pierre Floris.
Un discours qui a le don d’agacer les « Ford ». « S’ils ne servent à rien, qu’ils le disent. Qu’ils assument leur impuissance ! s’emporte Philippe Poutou. Ils disent qu’ils cherchent un repreneur, mais ce qui se dessine, c’est qu’ils vont virer tout le monde. C’est une grosse entourloupe. Même le gouvernement en est conscient. Les pouvoirs publics devraient lancer une campagne contre Ford, mais ils ne le font pas. »
Les salariés de Ford Blanquefort en sauront un peu plus sur leur sort la semaine prochaine – ils enchaîneront trois jours de réunions, avant de se réunir jeudi en assemblée générale. Pour être entendus, vont-ils finir par menacer de faire sauter leur usine, comme les salariés de GM&S en 2017 ? « Le 26 juin, pendant un petit débrayage, un collègue avait amené une fausse bonbonne de gaz et une fausse mèche, pour le symbole, raconte un ouvrier. Mais il y a surtout beaucoup de mannequins pendus dans l’usine. Le premier que vous voyez, ça fait mal quand même. Ça dit un peu la souffrance des gens. »
Publié le 13/07/2018
Manon Aubry : « La suppression de 20 000 postes au sein du fisc est complètement à contre-courant »
Audrey Loussouarn (site l’humanité.fr)
Selon les Echos, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s’apprêterait à opérer une restructuration de l’administration fiscale. Jusqu'à 20 000 postes seraient supprimés d’ici la fin du mandat. Manon Aubry, responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalités à Oxfam, relève les différents paradoxes d’une telle décision, à l’heure où la fraude fiscale suscite de « l’indignation ».
Sur les 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique prévues par le gouvernement, le fisc en prendrait manifestement sa part, si l’on en croît Les Echos. Pour vous, qu’induit la suppression de 20 000 postes ?
Manon Aubry. Le démenti de Gérald Darmanin démontre le malaise autour du sujet. En réalité, je pense qu’il s’agit de jouer sur les mots. En premier lieu, il faut rappeler que 20 000 postes ont déjà été supprimés ces dix dernières années. En quinze ans, nous serons donc à 40 000 postes de moins au sein du fisc. Soit une division par trois des effectifs. Derrière ces suppressions, il existe une multitude de paradoxes. Le premier consiste à faire ce choix et, dans le même temps, d’afficher la lutte contre l’évasion fiscale comme un des objectifs principaux du gouvernement. Lors des « Paradise papers », Bruno Le Maire estimait que cette pratique était une atteinte à la démocratie. Deuxièmement, le gouvernement maintient d’un côté le verrou de Bercy, au prétexte que ce serait à l’administration fiscale de se saisir des fraudes étant donné qu’elle a plus de moyens et de capacités d’investiguer, et de l’autre, il baisse ses effectifs. Sa capacité à traquer des fraudes de plus en plus complexes, et de plus en plus à la frontière de la loi, est déjà limitée. Cette décision, dans ce contexte, donne le sentiment qu’il y a un nouveau cadeau de fait à ceux qui peuvent pratiquer la fraude fiscale, c’est-à-dire les plus fortunés et les grandes entreprises. La petite fraude, elle, est la plus facile à détecter et continuera à l’être. C’est complètement à contre-courant.
Surtout que la fraude fiscale représente un manque à gagner considérable pour l’Etat, à l’heure où le gouvernement prétend qu’il est indispensable de réaliser des économies …
Manon Aubry. On estime que la fraude et l’évasion fiscale coûtent environ 60 à 80 milliards d’euros par an à l’Etat français. C’est à peu près l’équivalent du budget de l’Education nationale. La lutte contre l’évasion fiscale est un investissement rationnel du point de vue de l’Etat. Car, pour chaque euro qu’il y investit, ce sont plusieurs euros qui rentrent dans ses caisses. Dans un contexte de rationalisation des dépenses, elles font partie des dépenses les plus utiles et les plus efficaces étant donné ce qu’elles rapportent.
La levée du verrou de Bercy permettrait de lutter plus efficacement, à terme, contre cette fraude fiscale. En quoi la suppression annoncée par la majorité la semaine dernière n’est pas ce qu’elle paraît ?
Manon Aubry. Le verrou de Bercy consiste en l’incapacité pour la justice de se saisir de dossiers de fraude fiscale. Elle peut le faire uniquement si l’administration fiscale s’en saisit. La semaine dernière, le Sénat a adopté des critères permettant une transmission automatique à la justice. Mais le verrou est maintenu et les conditions sont exactement les mêmes. Le rapporteur LR de la commission des Finances (Albéric de Montgolfier – NDLR) reconnaît que le nombre de dossiers supplémentaires transmis serait assez faible, de l’ordre de quelques centaines de cas seulement. On est loin des au moins 4 000 cas les plus graves qui devraient être transmis à la justice. Aujourd’hui, environ 16 000 infractions font l’objet de 40% de pénalités et sont considérées comme des infractions caractérisées, qui mériteraient potentiellement un examen par la justice. On est donc très loin du compte. C’est une suppression du verrou de Bercy en trompe l’œil, issu d’une communication du gouvernement qui sait qu’il ne peut plus maintenir le statut quo. L’indignation suscitée par la fraude fiscale et l’impunité dont jouissent les fraudeurs n’est plus entendable par l’opinion. Il y aura néanmoins un point de tension au moment du passage à l’Assemblée, étant donné que la rapporteuse LREM Emilie Cariou, qui avait participé à la mission d’information sur ce sujet, propose une réelle suppression de ce verrou.
Cela risque-t-il de creuser un peu plus le sentiment d’injustice fiscale ?
Manon Aubry. Aujourd’hui, le verrou de Bercy institue une justice à deux vitesses : une justice de droit commun et une justice parallèle, pour les fraudeurs fiscaux. Ces derniers ont quasiment la garantie d’échapper à la justice et de s’en sortir avec un accord à l’amiable avec l’administration fiscale. Cela revient à maintenir l’impunité et à considérer que la fraude fiscale est un délit à part. Alors même qu’il est l’un des plus graves puisque nous en payons tous le prix. Le verrou de Bercy est donc à la fois une exception dans le domaine judiciaire, puisque c’est le seul délit à avoir ce système dérogatoire, et une exception française. Conséquence : les fraudeurs préfèrent calculer le rapport coûts/bénéfices. Ce qui empêche de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Le verrou de Bercy est à la fois un enjeu d’équité dans le système judiciaire et d’efficacité.
Publié le 12/07/2018
« Et en même temps », c’est fini !
Par Pablo Pillaud-Vivien (site regards.fr)
Des sondages en berne, une “économie” qui peine à redémarrer, un discours devant le congrès à Versailles sans annonce aucune : rien ne va plus au royaume d’Emmanuel Macron qui a mis fin au « et en même temps ».
En ce moment, les astrologues nous disent que la lune est opposition avec Jupiter. C’est peut-être de là que vient le problème. Depuis maintenant plus d’un an qu’Emmanuel Macron a été élu président de la République, sa majorité à l’Assemblée nationale, comme les Français d’ailleurs, commencent à se lasser du style présidentiel et des réformes qui s’enchaînent s’en même le temps de crier gare. Les sondages sur l’exécutif déclinent de manière significative – pour s’approcher des pires scores de son prédécesseur (détenteur de records d’impopularité) – et l’on voit même certains de ses partisans commencer à faire la grimace. Il est peut-être temps de shooter la lune.
Hier, Emmanuel Macron s’est ainsi adressé aux parlementaires réunis en congrès à Versailles. Quatre-vingt onze minutes de discours. C’est plus que François Hollande et Nicolas Sarkozy réunis en 2015 et 2009 (respectivement trente-sept et quarante-quatre minutes). Mais pour dire quoi ? Plus qu’une adresse à sa majorité, aux députés et aux sénateurs de l’opposition, c’est la plèbe que le président a tenté de convaincre en proposant, une nouvelle fois, sa vision : le macronisme. Oui mais voilà, depuis la première allocution du genre, qui s’est tenue quelques semaines après son élection, il s’est passé un an. Et l’atmosphère n’est pas exactement la même...
Prêcher tout et son contraire - mais surtout son contraire
Au-delà du fond des réformes successives qui s’enchaînent sur un rythme endiablé, c’est surtout sur la qualité du discours que le bât de Macron blesse le plus. Derrière l’hypermédiatisation et l’hyperprésidentialisme, il ne reste souvent plus que des bribes de pensées, souvent paradoxales, parfois absconses, qui n’arrivent plus à émouvoir ni à convaincre personne. Ainsi a-t-il proposé lundi à son public de parlementaires policés, un exercice, classique pour lui, d’affirmations et de contre-affirmations, noyé dans un charabia de concepts mous et d’annonces calendaires. Ne voilà-t-il pas que « tout président de la République connait le doute » tout en étant « résolu », qu’« [il] sai[t] qu[‘il] ne peu[t] pas tout » mais que « pour la France et pour sa mission, le président de la République a le devoir de viser haut et [qu’il] n’[a] pas l’intention de manquer à ce devoir ». Tout et son contraire donc. Dans le même discours. OKLM comme dirait l’autre.
Il faut ajouter à cela, bien sûr, les contre-vérités habituelles, que l’on justifie par une volonté irrépressible de changement – peu importe vers où ou pour quoi, tant qu’il y a du changement, tout est bon dans le cochon. Ainsi, quand Macron affirme qu’il est « impossible de prétendre distribuer, quand on ne produit pas assez », personne n’est là pour lui répondre que c’est faux et que si, on peut redistribuer même en produisant peu. Parce que, contrairement à ce qu’il laisse entendre lorsqu’il affirme que « si l’on veut partager le gâteau, la première condition est qu’il y ait un gâteau », le « gâteau » français existe bel et bien ! Voire, il n’a jamais été aussi gros si l’on s’en réfère à la richesse des patrons du CAC40 ! La France n’a jamais créé autant de richesses donc le « gâteau » est bien plus gros qu’autrefois – notamment quand il s’est agi de créer la Sécurité sociale au lendemain de la guerre alors que l’économie était à la peine.
De même, lorsqu’il propose sa définition pour le moins lâche de la notion d’entreprise qui inclut les « travailleurs », les « dirigeants » mais aussi les « actionnaires », aucun contradicteur ne vient lui rétorquer que c’est hautement problématique de considérer dans un même tout, les producteurs de la richesse et ceux qui en captent les fruits… D’autant qu’il ajoute qu’il veut mener « une politique pour les entreprises » et non pas pour les riches ! Enfin, que dire de sa volonté, qui a l’air sincère lorsqu’il l’énonce, de réformer la France « avec tous les acteurs » mais dont on comprend très bien, dans les phrases qui suivent, que cela va se faire selon ses propres modalités… Honnêtement, c’est à n’y rien comprendre.
Macron a court de voix
Mais ce qui agace le plus, c’est lorsque le discours est utilisé comme adoucissant pour faire passer une mesure particulièrement brutale ou injuste. Et c’est sûrement cela que les Français perçoivent de la façon la plus aiguë : il ne peut continuer à mener la politique migratoire qu’il a initiée depuis un an et affirmer qu’il souhaite « rester fidèle à la Constitution » et « protéger de manière inconditionnelle les demandeurs d’asile. » Tout comme il ne peut se faire le fer de lance d’un « Etat-providence du XXIè siècle » alors même que dans son discours, on comprend très bien qu’il s’agit précisément de le détricoter car il serait aujourd’hui devenu « inadapté » et agirait comme « une barrière. »
Le problème d’Emmanuel Macron aujourd’hui, c’est que son discours ne porte plus. Il n’étonne plus, il lasse, voire il date. Le "nouveau monde" a repris les us et coutumes de l’ancien. Jusque dans le discours : « il faut libérer l’économie de ses contraintes ». On a parfaitement compris qu’il parlait excellemment bien (mépris de classe excepté), qu’il avait une connaissance du système institutionnel parfaite et que lorsqu’il s’attaque à un sujet, on a toujours envie de lui mettre 20 sur 20. Sauf que faire de la politique, diriger un pays, ce n’est pas cela – ou plutôt pas uniquement cela. Surtout dans un cadre démocratique qui nécessite que les débats puissent être productifs et que les corps intermédiaires soient en capacité de co-construire notre société. Pour ça, il faut de l’écoute et de l’empathie – précisément ce que des Français de plus en plus nombreux semblent reprocher à Macron...
Avancer masqué, prêcher le faux pour faire ce que l’on veut, dire à tout le monde de regarder à gauche alors que l’on va à droite : Emmanuel Macron décrédibilise la parole présidentielle et En Marche, celle du politique. Dans leur refus d’assumer qu’ils mènent une politique résolument de droite – voire parfois à la droite de la droite (après tout, la loi Asile et immigration n’a-t-elle pas inspirée le programme italien de la coalition d’extrême-droite en matière d’immigration ?), à sempiternellement répéter que si, la suppression de l’impôt sur la fortune, c’est une mesure qui profite à tous, ils ont fini par tellement brouiller les cartes qu’ils se brouillent eux-mêmes. Et qu’à l’enthousiasme pour la chose nouvelle semble avoir succédé la méfiance… Même Ruth Elkrief commence à se poser des questions et espère que Macron saura lui « redonner espoir », c’est dire.
Les oppositions à l’offensive
Et ça, ce n’est pas bon pour un président de la République qui a fait de sa relation à l’opinion publique un gage de sa réussite. Après la séduction et la lune de miel, les Français seraient-ils en train de se rendre compte qu’ils ont été bernés ? La succession de happenings par les groupes politiques qui a eu lieu hier, en marge du congrès, illustre sans doute cette rupture. Chacun à leur manière, ils ont fait part de leur hostilité avec la méthode Macron. Ainsi, les Insoumis ont-ils déserté Versailles pour envahir les réseaux sociaux pour une manifestation en ligne qui a cartonné. Certains membres de la famille des Républicains ne se sont pas non plus rendus à la convocation du président. De même que les députés communistes se sont réfugiés dans la salle du Jeu de Paume pour prêter serment et exiger un référendum sur la Constitution. Aussi, plus risible sans doute – tant ils semblent ne plus savoir où ils habitent – les parlementaires socialistes (de la Nouvelle Gauche) ont organisé un petit rassemblement pour dire que quand même, Emmanuel Macron pousse le bouchon un peu loin. La députée Valérie Rabault, sans blague, a même fait référence au 9 juin 1789, date à laquelle l’Assemblée nationale s’est transformée en Constituante. De là à dire qu’ils sont pour la VIème République…
Hier, Emmanuel Macron a donc mis fin au « et en même temps »... Le cap est maintenant clair. A droite toute. Mais comme le dit Alain Minc lui-même : « L’inégalité est trop forte, on risque l’insurrection ». Donc rien n’est joué. Et finalement, tout commence peut-être aujourd’hui.
Publié le 11/07/2018
Au Chili, les étudiantes dans la rue depuis trois mois bousculent la domination masculine
par Anne Le Bon (site bastamag.net)
Elles manifestent seins nus, visages cagoulés et poings levés : les étudiantes chiliennes bloquent depuis le mois d’avril les principales universités du pays et défilent régulièrement dans les rues pour protester contre le harcèlement sexuel systématique auquel elles sont confrontées dans le système éducatif. Le mouvement divise l’opinion publique, mais il a déjà poussé l’actuel gouvernement chilien, pourtant de droite, à annoncer des mesures en faveur de l’égalité femme-homme. Les étudiantes chiliennes regardent aussi du côté de leurs sœurs argentines, qui viennent d’obtenir le droit à l’avortement sûr et gratuit. Reportage.
C’est un blocage d’université dans une ville du sud du Chili qui a lancé le mouvement. Le 17 avril dernier, des étudiantes de l’université de Valdivia occupent la faculté de philosophie pour protester contre l’indifférence de la direction face à plusieurs cas de harcèlement sexuel à l’encontre d’élèves et d’employées de la fac. Quelques semaines plus tard, plus de 30 universités et une dizaine de lycées se sont retrouvés paralysés par les étudiantes et les lycéennes, mobilisées contre des cas similaires de harcèlement. Ce mouvement inédit a commencé à rendre visible un problème jusque-là passé sous silence au Chili.
« Nous sommes dans une situation de harcèlement permanent, dû aux relations de pouvoir dans l’enseignement, explique Thania Rojas, étudiante en sociologie à Santiago, la capitale. Les professeurs se sentent en droit de harceler leurs élèves et leurs collègues puisque les sanctions, lorsqu’elles existent, ne sont pas à la hauteur. » En effet, les plaintes pour harcèlement sexuel dans les universités sont traitées en interne par les établissements et aboutissent en général à de simples suspensions des professeurs. « Dans les meilleurs des cas, les enseignants sont renvoyés, mais ils perçoivent des indemnisations honteuses. Et rien n’est inscrit dans leur dossier, donc ils peuvent se faire embaucher ailleurs, et continuer d’agir de la même façon », déplore la jeune femme.
Sanctionner les harceleurs, avoir une éducation non sexiste, et un accès des femmes aux postes de pouvoir
Les mois de mai et de juin ont vu se dérouler des dizaines de manifestations contre le harcèlement dans les principales villes du pays. Des mobilisations presque exclusivement féminines, les étudiants masculins étant exclus des assemblées et des prises de décisions. « C’est une lutte qu’il nous revient à nous les femmes de mener, dit Francisca, étudiante en obstétrique. Il est temps que les hommes arrêtent de décider pour nous, il faut que nous imposions notre point de vue et nos revendications, en tant que femmes. » Parmi ces revendications se trouvent la mise en place de protocoles garantissant l’application de sanctions en cas de harcèlement et d’abus sexuels, la mise en place d’une éducation non sexiste, l’accès des femmes aux postes de pouvoir au sein des universités et, de manière plus globale, l’ouverture d’une réflexion sur la place et le rôle des femmes dans la société chilienne. Une démarche qui devrait conduire, pour les manifestantes, à l’abolition de la violence machiste. « Il y a une banalisation de la violence à l’encontre des femmes : dans la rue, au travail, chez le médecin et même au sein des foyers, la femme est avant tout un corps au service de la société et du désir masculin », constate Amanda, elle aussi étudiante en obstétrique.
Une vision des femmes que les étudiantes – soutenues par de nombreuses enseignantes et employées des établissements scolaires et universitaires – comptent bien faire changer. Pour faire entendre leurs voix, elles ont décidé d’imposer l’image de leurs corps. Elles défilent dans les rues les seins nus, en sous-vêtements tâchés de rouge, symbolisant le sang menstruel, ou même en exposant aux forces spéciales leurs fesses nues surmontées de queues en crins, dénonçant et ridiculisant l’insulte courante assimilant les femmes à des juments (dont l’équivalent français serait l’insulte « chiennes »).
« Les gens sont plus choqués par une femme nue qui manifeste que par le nombre de féminicides »
Des pratiques nouvelles au Chili, qui sont loin d’être consensuelles dans l’opinion publique, mais qui ont réussi leur pari de faire parler du mouvement. « Le but de ces performances est d’attirer l’attention et de dénoncer la sexualisation du corps des femmes. Les réactions témoignent de l’ambiguïté du rapport au corps dans notre pays : on peut montrer des seins siliconés sur les plateaux de télévision mais le sein qui revendique, le sein qui allaite, le sein qui n’est pas l’objet du plaisir masculin, lui, est scandaleux et laid », s’indigne Thania.
En effet, dans la rue, dans les médias et sur les réseaux sociaux, les féministes sont attaquées de toutes parts. Insultes, caricatures et offenses en tous genres font partie de l’arsenal des nombreux anti-féministes. « Au Chili les gens sont plus choqués par une femme nue qui manifeste que par le nombre de féminicides », commente Constanza, étudiante en journalisme. « C’est en montrant ses seins qu’on obtient le respect et l’égalité des droits ? Ça n’a aucun sens, c’est ridicule ! », s’exclame par exemple Victor, informaticien d’une trentaine d’années.
La créativité provocatrice des féministes a en tous cas placé le mouvement sur le devant de la scène, obligeant les autorités à réagir. Le président chilien, Sebastián Piñera, pourtant représentant de la droite conservatrice, a récemment déclaré aux médias qu’il soutenait la lutte des femmes. Par le passé, il s’était au contraire distingué par ses positons rétrogrades : il s’était opposé au divorce, à l’égalité de droits des enfants nés hors mariage ou encore à la légalisation de la pilule du lendemain, et s’est à de nombreuses reprises fait remarquer pour ses blagues sexistes et ses commentaires grossiers. Le mouvement en cours lui a, semble-t-il, fait changer de position. « Je ne sais pas ce que signifie féminisme mais si cela signifie croire en une pleine et totale égalité de droits, de devoirs et de dignité entre les hommes et les femmes, alors oui je suis féministe », a-t-il ainsi récemment affirmé à la presse.
En réaction, le gouvernement chilien veut modifier la constitution
Les déclarations bienveillantes du président à l’égard des femmes – qui font rire jaune dans les rangs féministes – s’accompagnent de 12 propositions de lois et de règlements visant à garantir la fin des violences, des abus, du harcèlement, de la discrimination et de la maltraitance à l’encontre des femmes. Parmi les mesures annoncées, la plus significative consiste en une réforme du premier article de la constitution (datant de la dictature de Pinochet) afin d’établir l’égalité femme-homme comme un devoir de l’État.
Pour les féministes, les mesures annoncées ne sont qu’un vernis destiné à calmer les esprits. Elles ne changent rien aux problèmes de fond. « Toutes ces mesures ont pour thème central le rôle de la femme comme mère : les femmes soldats auront accès au même congé maternité que les civils, la loi obligeant les femmes à attendre 270 jours entre deux unions sera supprimée et la maternité dans les prisons sera mieux protégée. C’est bien, mais il n’y a rien sur les droits reproductifs, l’avortement ou la contraception », regrette Amanda. « De toute façon, nous n’attendons rien de ce gouvernement. Ce que nous voulons, c’est une évolution des mentalités. Et cette évolution doit venir d’en bas, pas d’en haut », ajoute Thania.
La jeune femme est une fervente partisane des « funas », sorte de lynchages publics verbaux qui consistent à se rendre en masse sur le lieu de travail ou devant le domicile d’une personne accusée d’avoir commis un délit (abus sexuel dans le cas présent) mais que la justice n’a pas punie, afin de crier publiquement les actes dont elle est accusée. Une pratique née après la dictature pour dénoncer les personnes accusées d’avoir été tortionnaires durant le régime militaire et que le mouvement féministe a repris à son compte.
La vague féministe chilienne semble bien partie pour durer. Les revendications des étudiantes, jusque-là limitées aux cas de harcèlement sexuel et de violences, tendent de plus en plus à s’élargir à des thèmes plus controversés, comme le droit à l’avortement. Au Chili, c’est seulement depuis septembre 2017 (après 28 ans d’interdiction totale, imposée sous la dictature de Pinochet) que l’interruption volontaire de grossesse en cas de viol, de risque pour la santé de la femme ou de non viabilité du fœtus est légale. C’était déjà une première victoire, obtenue sous le dernier mandat de la présidente de gauche Michelle Bachelet. Mais l’obtention tout récente, en juin, du droit à l’avortement gratuit, sûr et universel en Argentine donne aujourd’hui un peu plus d’espoir aux féministes chiliennes (voir notre article). « Le droit à l’avortement est clairement notre prochain cheval de bataille, annonce Thania. D’ailleurs, nous allons changer la couleur de nos foulards lors des prochaines manifestations : ils seront verts en l’honneur de nos voisines argentines ! »
Anne Le Bon
Publié le 10/07/2018
Entretien par Loïc Le Clerc (site regards.fr)
Marche pour Adama Traoré : « Faire condamner des policiers, c’est quasiment impossible en France »
Le 19 juillet 2016, Adama Traoré perdait la vie après une interpellation des gendarmes de Persan. Deux ans plus tard, ses proches organisent une marche le 21 juillet. Youcef Brakni, membre du Comité Adama, fait le point sur cette affaire.
Regards. Deux ans après la mort d’Adama Traoré, où en est l’enquête ?
Youcef Brakni. Au point mort. Les gendarmes n’ont pas été entendus. Il n’y a toujours pas eu de mise en examen. Ils sont toujours en liberté, ils n’ont pas été inquiétés pour ce qu’ils ont fait à Adama Traoré. Donc deux ans après, la justice est au ralenti. Je ne sais même pas si on peut dire "ralenti". C’est à l’arrêt. Donc là, on va mettre la pression. La marche du 21 est là pour ça, et aussi pour dire qu’on veut un procès au plus vite. C’est un travail politique, à l’image de toutes les actions qu’on mène un peu partout, y compris dans le mouvement social pour dire "il y a une affaire comme ça, ça se passe sous vos yeux, il faut aussi agir".
Donc, pour l’instant, la seule avancée judiciaire a été le dépaysement de l’affaire de Pontoise à Paris à l’automne 2016 ?
Oui. Le rapport de force était là dès le départ. Il y a eu très vite des marches qui ont été organisées, tout un discours politique qui a été mis en place. Le comité, les habitants, la famille ont réussi à démonter les mensonges du parquet de Pontoise, qui avait déclaré que Adama était mort soit des suites d’une prise de drogue, qu’il avait une maladie, bref, tous les mensonges qu’on connaît. Il y a eu cette petite victoire d’obtenir le dépaysement de l’affaire, ce qui n’était pas gagné d’avance. Quand on regarde comment le tribunal de Pontoise juge par ailleurs la famille Traoré, on se dit "heureusement qu’on a dépaysé l’affaire Adama à Paris".
LIRE AUSSI SUR REGARDS.FR >> Assa Traoré : « L’État a peur de notre combat »
À l’inverse, depuis deux ans, combien de frères d’Adama ont été mis en prison ?
Tous les petits frères d’Assa Traoré qui vivent à Beaumont-sur-Oise ont été placés en détention, ou alors c’est en cours. Il y en a eu cinq de condamnés, quatre sont derrière les barreaux. Le dernier, Cheikne Traoré, a été condamné à six mois de prison, une peine suspendue parce qu’on a fait appel. On voit que pour les frères Traoré, en deux ans de lutte, la justice est assez expéditive.
« Il y a une série de bavures, de crimes politiques qui sont impunis. »
Comment percevez-vous ce contraste entre l’absence d’avancée sur la mort d’Adama et la répression à l’encontre de sa famille ?
On l’analyse de manière politique. C’est un système bien huilé, puissant, qui permet de protéger les policiers ou les gendarmes mis en cause dans des crimes ou des bavures. On l’a vu récemment lors du verdict pour la famille Kebe, où le tribunal de grande instance de Bobigny a acquitté complètement les policiers. Une mère a perdu son œil, le fils a été méchamment violenté. Le procureur lui-même a demandé la condamnation des policiers. Mais on voit à chaque fois la justice… les policiers qui s’entraident, les versions qui changent… Les faire condamner, c’est quasiment impossible en France. Ou alors, il faut y laisser une partie de sa vie. Comme c’est le cas pour Assa Traoré qui ne travaille plus [elle est éducatrice, NDLR], elle consacre toute sa vie à ce combat. Et souvent, ça n’aboutit à rien. On l’a vu pour l’affaire Lamine Dieng où Ramata Dieng a fait onze ans de lutte. Pour avoir un non-lieu. Le dernier espoir, c’est la Cour européenne. Ali Ziri, c’est la même chose, Wissam El-Yamni, c’est la même chose, Hakim Ajimi, c’est la même chose. Il y a une série de bavures, de crimes politiques qui sont complètement impunis. Et les arguments sont toujours les mêmes : on parle d’un usage strict et nécessaire de la force, de légitime défense. Ce sont des choses qui passent au niveau judiciaire.
Quand vous apprenez qu’il y a une nouvelle affaire, par exemple Théo, Aboubakar à Nantes il y a quelques jours, comment réagissez-vous ?
Il faut une prise de conscience politique dans ce pays, il faut que politiquement prenne en charge cette question-là, comme une question centrale du mouvement social. Ce sont des personnes qui meurent pour des raisons racistes, sociales – le fait d’habiter dans des quartiers populaires, d’être jeune, etc. Si ça, ce n’est pas central dans un pays, dans une démocratie, si on ne se dit pas qu’il faut qu’on arrête de tuer des gens pour ce qu’ils sont – noirs, arabes, jeunes des quartiers populaires, gitans, etc. – évidemment qu’il y aura toujours cette impunité. Évidemment qu’on ne pourra jamais y mettre un terme.
C’est facile de s’émouvoir pour des crimes outre-Atlantique. On le voit, à chaque fois les politiques, les intellectuels (même les réacs) s’insurgent quand un Noir est tué aux Etats-Unis. Par contre, en France, on est incapable d’analyser ces crimes politiques comme étant la continuité coloniale d’une gestion d’une certaine population. On dirait qu’on n’a pas eu de passé colonial, esclavagiste. Quand on compare la proportion de descendants d’immigrés, de colonisés, dans la population française et la proportion qu’ils représentent dans les morts de la police, c’est hallucinant. Démographiquement, on n’est pas si nombreux dans la société française – même si on est très visible [dit-il avec ironie, NDLR]. Pourtant, on est surreprésenté dans les morts de la police. Comment on explique ça ? Quand on me dit : "Faut arrêter d’exagérer, c’est fini le colonialisme", j’aimerais bien que ça soit vrai, mais ça a évolué, ça prend différentes formes. Les violences policières, c’est celle qui est la plus visible. C’est aussi la plus atroce, celle qui détruit des vies.
De nombreux artistes ont affiché leur soutien à votre combat. Recevez-vous également des appuis politiques ?
On voit qu’il y a une prise de conscience, le groupe parlementaire de La France insoumise appelle à venir à la marche du 21 juillet. C’est une première pour une famille victime de violences policières. On se dit que notre travail paie. Il n’y a rien d’autre que la lutte qui paie. Militer, aller dans des conférences, tout ce travail de pédagogie politique a fonctionné. La Fête à Macron, Génération.s appellent aussi à y aller. On accepte toutes les aides, du moment qu’on respecte notre autonomie, notre discours. Comme quand ils vont soutenir les salariés de Goodyear, les postiers, les cheminots. Il faut accepter les revendications, le discours, l’autonomie et se mettre derrière. Pour nous, c’est ça les conditions d’une véritable alliance.
« Le centre de gravité politique ne va pas être à Paris, place de la République, mais à Beaumont-sur-Oise, en banlieue. »
Lors de la "Marée populaire", le 26 mai dernier, vous étiez en tête de cortège. Pensez-vous que les "Parisiens" vont eux aussi se déplacer jusqu’à Beaumont ?
C’est tout l’enjeu. Le slogan était, de manière un peu humoristique "On a braqué Paris, c’est nous le Grand Paris". On voulait apparaître là où personne ne nous attendait, là où on voulait peut-être pas nous voir. On s’est imposé. Je pense qu’on a impulsé une dynamique. On a aussi eu un cortège de tête à la Marche des fiertés. Tout cela participe au rapport de force, ce qui fait que la gauche s’intéresse à cette question-là. De toute façon, il n’y a pas d’autre solution. Il faut qu’on rentre par effraction, on ne peut pas attendre d’être invité. C’est ce qu’on a fait et ça a bien marché. On a prouvé qu’on était capable de tenir un discours politique, d’être devant, respecté, en s’appuyant sur une force locale tout en s’associant avec les autres secteurs en lutte. Dans le cortège de tête, il y avait les soignants, les cheminots, les postiers. C’est une belle victoire.
Le centre de gravité politique ne va pas être à Paris, place de la République, mais à Beaumont-sur-Oise, en banlieue, dans le quartier populaire de Boyenval. On a mis un car à disposition au départ de gare du Nord vers 12h-12h30. Les militants de Dijon, mobilisés autour de Bure, vont aussi venir en car. Tout le monde est le bienvenu.
Publié le 09/12/2018
Finance. Les profits du CAC 40 ont explosé en 2017
Loan Nguyen (site l’humanité.fr)
Les entreprises cotées à l’indice parisien ont vu leurs bénéfices bondir de 22 % l’an dernier. La santé des grands groupes est au beau fixe, sauf sur l’investissement, qui chute de 15,1 %.
«Un pognon de dingue » : l’expression prend ici tout son sens. Les profits du CAC 40 ont bondi de 22 % par rapport à l’année précédente, d’après le profil financier de l’indice réalisé par les cabinets Ernst & Young et Ricol Lasteyrie Corporate Finance (EY-RLCF). Ce sont 94 milliards d’euros de bénéfices qui ont ainsi été engrangés par les plus grandes cotations boursières l’an dernier, retrouvant quasiment le niveau d’avant la crise de 2008. Les dividendes ont eux connu une hausse de 2 %, pour atteindre 47 milliards d’euros. Un montant légèrement inférieur à l’estimation effectuée mi-mai par l’association de lutte contre la pauvreté Oxfam, qui évaluait à 51 milliards d’euros le montant des dividendes versés par les entreprises de l’indice en 2017. « Toutes les entreprises du CAC 40 distribuent un dividende cette année. 34 entreprises versent un dividende en hausse », souligne en revanche l’étude EY-RLCF. Outre ce niveau de profitabilité exceptionnel, les grands groupes ont également bénéficié d’une reprise d’activité avec une croissance du chiffre d’affaires de 5 %, passant de 1 243 milliards à 1 306 milliards d’euros. Dans le même temps, la marge opérationnelle (l’indicateur de rentabilité) progressait de 7,6 % à 7,9 %. Parallèlement, l’endettement net a continué de diminuer en valeur absolue – après six années consécutives de baisse – et a atteint son plus bas niveau depuis douze ans.
Des profits et toujours des profits
Tous les voyants semblent donc au vert pour les grands groupes. Tous sauf celui de l’investissement. En dehors du secteur banque-assurances, l’investissement a connu son niveau le plus bas depuis 2007, à 69 milliards d’euros contre 75 milliards d’euros dix ans plus tôt. Il représente 6,1 % du chiffre d’affaires, contre 7,7 % en 2016. Pour nuancer légèrement cette baisse, on peut observer que cette chute est en grande partie due aux décisions de Total en la matière. Le géant pétrolier a ainsi revu ses investissements à la baisse de 5 milliards d’euros en 2017. Le groupe hôtelier Accor souffre pour sa part de la comparaison avec l’année 2016, où celui-ci avait investi 3 milliards d’euros.
Enfin, le remplacement d’Alcatel-Lucent par Nokia dans l’indice CAC 40 en 2016 achèverait d’expliquer ce différentiel entre 2016 et 2017, Nokia étant sorti de l’indice l’an dernier. « En dépit de la baisse de ses investissements, Total demeure toutefois le principal investisseur du CAC 40, suivi d’Orange et d’Engie, puis des constructeurs automobiles PSA et Renault. Ces cinq entreprises réalisent ainsi 47 % du total des investissements effectués par les membres du CAC 40 », souligne le rapport EY-RLCF. Au-delà des performances des plus grands groupes cotés à la Bourse de Paris, l’étude constate une stabilisation de la part du chiffre d’affaires des entreprises réalisé en Europe à 56 %. Un niveau stable depuis 2015, après une baisse quasi continue depuis 2006.
Des montants vertigineux
Si l’industrie et le BTP continuent de dominer le CAC 40 en 2017 – avec 16 sociétés sur 40 et 39 % du chiffre d’affaires total –, les données récupérées par EY-RLCF sur le début de l’année 2018 laissent entrevoir un changement dans le podium des secteurs les plus profitables. L’entrée d’Hermès le 18 juin dernier à la place de LafargeHolcim devrait notamment rééquilibrer le rapport de force, souligne le site d’informations économiques la Tribune. Avec Kering (Gucci), l’Oréal et LVMH, ce quatuor du luxe pèserait 380 milliards d’euros de capitalisation, plaçant le secteur des biens de consommation quasiment à égalité avec le BTP.
Au regard de ces montants vertigineux, l’argument selon lequel l’État ne pourrait pas mettre à contribution les grandes entreprises pour participer à l’effort fiscal national semble bien léger. D’autant qu’en parallèle, la dépense totale de minima sociaux s’établissait en 2016 à 26,6 milliards d’euros, celle de la prime d’activité à 4,1 milliards, les prestations familiales et les allocations logement versées aux ménages pauvres atteignaient respectivement 6,4 milliards d’euros et 10 milliards d’euros, d’après les derniers comptes de la protection sociale parus jeudi dernier. D’après les chiffres de l’Insee, sans prélèvements ni prestations, le taux de pauvreté serait 8,9 points supérieur à son niveau actuel (22,8 % contre 13,9 %). Pas de quoi justifier un coup de rabot quand les profits du CAC 40 sont au beau fixe.
Croissance en berne
Si le CAC 40 solde la crise et sabre le champagne, en revanche l’économie française marque un sérieux coup de frein. Après une progression de 2,3 % l’an dernier, elle devrait afficher un taux de croissance de seulement 1,7 %, a annoncé l’Insee, qui a révisé, la semaine dernière, sa prévision. Selon l’institut, le ralentissement se ressentira notamment dans l’investissement des entreprises (+ 3,1 % contre + 4,4 % en 2017) et la production de biens et de services (+ 2 % contre + 2,6 % en 2017). Malgré les alertes, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a affirmé : « 2 % de croissance, ça reste notre obje>>
Publié le 08/07/2018
Quel avenir pour les Kurdes de Syrie, menacés d’« épuration politique » par la Turquie d’Erdogan ?
par Thomas Clerget (site bastamag.net)
Les Kurdes de Syrie sont d’abord connus pour leurs faits d’armes. Leur « projet révolutionnaire », aux antipodes de celui des djihadistes, leur attire également la sympathie d’une partie des gauches européennes. Les vicissitudes de leur trajectoire dans la guerre syrienne sont pourtant largement ignorées. Qu’a signifié la révolution syrienne de 2011 pour la jeunesse kurde ? Comment s’en est-elle éloignée ? Quel rôle ont joué les organisations kurdes telles le PKK, et comment gèrent-elles les territoires conquis ? Quel est l’avenir de ces territoires autonomes, coincés entre la Turquie d’Erdogan et le régime de Bachar al-Assad ? Arthur Quesnay, chercheur de terrain spécialiste des Kurdistans irakien et syrien, co-auteur de l’ouvrage Syrie, anatomie d’une guerre civile, fait une lecture sans concessions de la situation. Entretien.
Basta ! : Comment les populations kurdes de Syrie, en particulier la jeunesse, ont-elles réagi au déclenchement de la révolution de 2011 ?
Arthur Quesnay [1] : Dès les premiers événements de Deraa, le 15 mars 2011, la jeunesse kurde participe aux mobilisations [2]. Elle fréquente les révolutionnaires arabes dans les manifestations, au sein des tanzikiyat, de petits comités de coordination révolutionnaires qui se créent à Damas ou Alep, où habite environ un tiers de la population kurde. Dans les zones majoritairement kurdes, à Afrin, Kobané, Qamishli, dans le nord de la Syrie, les habitants descendent aussi dans la rue, essaient de manifester, se rendent sur les places en adoptant les mêmes moyens de protestation que dans le reste du pays. La révolution est alors multi-communautaire : l’un de ses slogans est « Uni-uni-uni, le peuple syrien est uni ! ». Les Kurdes manifestent avec des arabes chrétiens, musulmans sunnites, alaouites [confession dont est issu Bachar al-Assad, ainsi que de nombreux responsables du régime, ndlr]... À partir de 2012, on retrouve des révolutionnaires kurdes dans les campagnes autour d’Alep, où commencent à se regrouper les protestataires recherchés par le régime, comme dans le village de Marra.
Fortement réprimés sous Hafez al-Assad, puis sous Bachar al-Assad à partir de 2000, les Kurdes ont accumulé un savoir-faire en matière de protestation qu’ils réactivent très vite en 2011. Ils se sont longtemps mobilisés pour revendiquer leurs droits en réaction à la politique d’arabisation musclée des zones kurdes par le régime syrien, depuis les années 60-70. Ces mobilisations se sont intensifiées après l’expulsion du PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan, ndlr] par le régime Assad en 1998. Damas s’appuyait en effet sur le parti pour assurer son contrôle sur les zones kurdes.
Les années suivantes sont marquées par de fortes mobilisations, comme la révolte de Qamishli en 2004, dans la région kurde du nord-est, durant laquelle il faut plusieurs semaines au régime – et une répression qui fait des dizaines de morts – pour stopper la mobilisation. En 2011, les jeunes kurdes réutilisent cette expérience : comment agir face à la police, se regrouper rapidement, organiser de petites mobilisations « flash », sans se faire attraper. De ce point de vue, la jeunesse kurde a même joué un rôle moteur dans la révolution, et transmis à certains révolutionnaires une expérience précieuse.
Les révolutionnaires kurdes portent-ils alors des revendications spécifiques, ou ces dernières sont-elles fondues dans le mouvement national ?
Il faut distinguer les relations entre révolutionnaires syriens et ce qui se passe entre les partis basés à l’étranger. Entre 2011 et 2012, les révolutionnaires kurdes et arabes se coordonnent au sein d’un même mouvement pour faire tomber la dictature – la question de l’identité ethnique, pour eux, ne fait pas débat. Les partis d’opposition kurdes et arabes réfugiés à l’étranger sont quant à eux en opposition sur les objectifs de la révolution. Les deux grands partis kurdes syriens, le PDK et l’UPK, portent une revendication identitaire kurde très forte, en même temps que leur attachement à la révolution. Ils veulent faire valoir les droits culturels et civiques dont le régime les a privés.
Pour les partis arabes, le nationalisme arabe syrien reste au contraire une composante idéologique forte. Ils s’opposent à la prise en compte du particularisme kurde, perçu comme un élément de division de la révolution comme de la Syrie. Or, bien que ces organisations ne représentent qu’elles-mêmes, et n’aient que très peu de relais en Syrie, elles ne vont jamais trouver de terrain d’entente ni s’intéresser aux dynamiques multi-communautaires de la révolution.
Une erreur stratégique aurait donc été commise par les partis d’opposition arabes, annonçant la polarisation, puis la division du mouvement révolutionnaire ?
Oui, mais l’erreur vient aussi des partis kurdes, qui sont d’anciennes structures partisanes, très attachées par leur histoire à la « kurdicité ». Elles considèrent le nationalisme arabe comme négatif et craignent de se faire écraser par ce mouvement comme ce fut le cas par le passé. Les élites qui dirigent ces partis ont quitté la Syrie depuis vingt ou trente ans sous les coups de la politique d’arabisation du régime. Leur fracture est profonde avec les élites arabes sunnites. Alors que sur le terrain, les Kurdes manifestent auprès du reste de la population, leurs représentants, qui tentent de monopoliser la représentation de la révolution, ont des stratégies principalement identitaires.
En 2012, cette dimension identitaire devient prépondérante lorsque le PKK commence à se réinstaller dans les régions kurdes syriennes avec l’accord du régime, qui y voit un moyen efficace pour diviser les révolutionnaires. L’emprise du PKK sur les régions kurdes va enfermer les Kurdes syriens dans une perspective ethnique. Cette ethnicisation s’opère ainsi par le haut, via les organisations politiques.
Sur le terrain, les zones kurdes ont-elles été soumises à la même violence répressive que les autres populations ? Ou leur traitement est-il différent ?
Leur traitement est différent. Le régime met en place une tactique de répression « sélective ». En 2011, dès lors que l’appareil sécuritaire devient dysfonctionnel, débordé par l’ampleur de la mobilisation sur l’ensemble du territoire, le régime devient incapable de réprimer tout le monde. Il va alors modérer sa répression dans les régions kurdes, druzes et chrétiennes afin de casser l’unicité de la révolution, et pour créer des contextes de violence différents selon les populations. Cela lui permet, in fine, de communautariser le mouvement révolutionnaire, puis de s’appuyer sur les minorités pour l’aider à le réprimer.
Comment le régime a-t-il encouragé cette « communautarisation » de la révolution, alors que celle-ci revendiquait justement son caractère multiconfessionnel ?
Dans le cas des Kurdes, le régime s’est appuyé sur les liens historiques qu’il entretient avec le PKK depuis sa création en 1978 par Abdullah Öcalan. Pour faire pression sur la Turquie, le régime Assad avait alors laissé le PKK ouvrir des camps d’entrainement au Liban puis en Syrie, et recruter parmi la population kurde. En retour, les militants du PKK devaient s’assurer de la stabilité des régions kurdes syriennes et réprimer toute opposition au régime, notamment les partis kurdes historiques comme l’UPK et le PDK. Sans la protection de la Syrie, le PKK ne serait jamais devenu ce qu’il est aujourd’hui.
Or dans les années 90, la Turquie menace d’intervenir en Syrie. En 1998, Damas décide finalement d’expulser Öcalan – qui sera arrêté et emprisonné en Turquie – et de fermer les camps du PKK. Le parti se retrouve isolé. Défait militairement en Turquie, il se replie au Kurdistan irakien dans les monts Qandil, et continue à fonctionner grâce à l’important réseau tissé parmi la diaspora kurde en Europe. Le mouvement tente aussi de se recréer, de repenser sa doctrine, à travers plusieurs synthèses idéologiques [3].
Dans les régions kurdes de Syrie, l’expulsion du PKK a pour effet de priver le régime d’un moyen de répression efficace contre la population kurde, qui se révolte notamment en 2004 à Qamishli. En 2012, la déroute du régime le pousse à renouer avec le PKK afin de sécuriser la frontière avec la Turquie et de réprimer la mobilisation. En contrepartie, étant donnée l’alliance étroite de Damas avec l’Iran, le PKK doit aussi fermer sa branche iranienne, le PJAK, tandis que plusieurs centaines de combattants du PKK sont envoyés depuis Qandil vers la Syrie, pour prendre position dans les régions kurdes.
Quels sont les effets du retour du PKK sur la jeunesse kurde, en particulier sur son engagement dans la révolution ?
Les habitants kurdes interrogés décrivent la même chose : entre fin 2011 et début 2012, des chabbihas – du nom des bandes armées au service du régime qui s’en prennent à la population un peu partout en Syrie – arrivent dans les villes kurdes. Sauf qu’à Afrin, Kobané ou Qamishli, ces mercenaires sont des Kurdes, qui parlent parfois le turque ou l’iranien, et ne connaissent pas nécessairement la ville [4]. Les autres partis kurdes, qui avaient fait leur retour, sont attaqués, leurs bureaux incendiés, leur personnel battu. Il y a des assassinats et les jeunes Kurdes capturés par ces bandes sont livrés au régime, dont les services de renseignement restent présents sur place.
Un autre tournant majeur s’opère en 2012 : débordé militairement, le régime doit cette fois évacuer pour de bon le nord de la Syrie, pour concentrer ses forces sur d’autres zones du territoire. C’est alors que le PKK abat ses cartes : le régime lui donne – littéralement – les clés de ses bases et commissariats dans les régions kurdes. Le parti en prend le contrôle, et interdit non seulement aux brigades arabes de pénétrer dans ces régions, mais également aux autres partis kurdes de mobiliser des jeunes, d’organiser des manifestations, ou de monter des groupes armés alternatifs. La ville de Qamishli reste cependant partagée avec le régime. Un système de gouvernance sous l’égide du PKK se met alors en place dans ces régions.
Pouvez-vous nous décrire cette gouvernance ? Est-elle une application du « confédéralisme démocratique » – la doctrine d’inspiration libertaire, à la fois sociale et écologiste, qui est prônée par le parti ?
La surprenante capacité du PKK à se déployer en Syrie provient des expériences turque et nord-irakienne, où le parti essaie de contrôler des zones rurales depuis les années 1990. La principale nouveauté en Syrie est que le PKK, après sa campagne contre l’État islamique (EI), contrôle aussi des villes et des zones non kurdes. Mais le parti reproduit systématiquement le même modèle institutionnel depuis des années : il verrouille la population par des comités locaux élus dans chaque quartier ou village, avec des candidats qui sont en fait présélectionnés ; il crée, par cooptation, un système de représentation multi-communautaire ; il bâtit des forces armées sous contrôle direct de militants du parti. Le budget et les salaires sont contrôlés par les cadres du PKK qui se réservent le droit d’intervenir à n’importe quel niveau des institutions, en qualité de « conseillers ».
Comment ces institutions fonctionnent-elles ?
La prise en main des territoires s’opère à deux niveaux : au niveau de la population, les militants du PKK envoyés en Syrie sont chargés de mettre en place des « maisons du peuple » (mala gal) à partir de l’été 2012. Elles regroupent et coordonnent le travail des institutions – ex-administrations de l’État syrien et tribunaux repris par le PKK – avec la multitude d’associations que le parti crée ou récupère sous sa coupe. Dans les faits, les mala gal servent de façade démocratique au PKK, en dissimulant ses cadres derrière une multitude d’acteurs civils qui sont en fait dépourvus de pouvoir. La structure institutionnelle ne reflète pas la distribution réelle du pouvoir : parmi la population, personne ne sait réellement qui donne les instructions, et qui commande la force armée qui se développe sous le contrôle de plusieurs centaines de combattants du PKK.
Au niveau politique, le PKK met en place à partir de l’été 2012 une coalition d’associations civiles, qui est connue sous le nom de Tevdem [5]. Cette instance compte 354 membres – dont seulement 12 sont issus du PYD [parti souvent perçu comme le principal parti kurde en Syrie ces dernières années, ndlr]. Sa fonction est de rassembler et de contrôler, par le haut, les réseaux qui se créent. Il est aussi censé représenter les « Kurdes syriens » à l’étranger, s’occuper des relations extérieures. Dans les faits, le PKK choisit de passer par d’autres intermédiaires, tel le PYD, pour engager des négociations avec des tiers. Cette stratégie de contrôle, à deux niveaux, permet au PKK de verrouiller les institutions qui se créent, tout en gérant localement les enclaves kurdes et les territoires repris à l’État islamique.
Des élections ont pourtant été organisées sur ces territoires, rebaptisés « Fédération démocratique de Syrie du nord »...
La réalité des processus électoraux est le reflet de cette structure de pouvoir : les élections sont en fait complètement truquées. Les représentants sont désignés par les cadros du PKK. C’est la même chose pour les partis politiques. À la place des partis kurdes historiques, une trentaine de nouveaux partis animent la vie politique. Ils peuvent d’ailleurs avoir des activités très concrètes. Le parti des femmes, par exemple, œuvre à la promotion des droits des femmes dans la région. Mais d’un point de vue politique, ils n’ont aucune autonomie de décision [6].
Comment passe-t-on de cette phase de réimplantation et de consolidation du PKK en Syrie, à partir de 2012, à la conquête d’une grande partie de l’est du pays par les YPG – sa branche militaire en Syrie ?
Jusqu’en 2014, le parti reste isolé, implanté sur trois districts séparés les uns des autres. Il subit comme les autres des attaques de l’État islamique, et est sur le point de perdre ses territoires. C’est alors que la guerre commence vraiment pour le PKK. La bataille de Kobané, de septembre 2014 à début 2015, est un tournant majeur : grâce à un soutien occidental massif, notamment des États-Unis, les YPG [7] repoussent l’EI, avant de se lancer à la conquête de Raqqa puis de Deir-Ezzor. La guerre change la donne : la population kurde, qui rejette les pratiques autoritaires du PKK, n’a plus le choix. Il faut soit partir, soit accepter de soutenir le parti contre l’État islamique.
Les images et témoignages qui nous parviennent depuis plusieurs années font souvent état d’un vrai soutien populaire... Cette représentation est-elle surfaite ? Ou le mouvement bénéficie-t-il d’un soutien réel ?
Le soutien populaire est toujours difficile à mesurer... D’autant plus qu’il évolue avec le temps. Ce qui est certain, c’est que le PKK en 2011 est très impopulaire. Mais à mesure que la révolution évolue en une guerre civile dans laquelle les dynamiques identitaires sont très fortes, les Kurdes vont devoir faire front commun. En 2012-2013, il y a encore de nombreuses brigades kurdes qui se battent avec l’Armée syrienne libre (ASL). Mais en 2014, lorsque l’EI accentue son offensive, le PKK se débrouille pour interdire aux autres brigades kurdes d’opérer. Par conséquent, le PKK devient la seule organisation militaire kurde.
Quid des dimensions sociale et écologique ? Y a-t-il des réalisations concrètes ? Les évolutions sont-elles, peut-être, mises entre parenthèses par la guerre ?
Il y a des avancées. Sur la question du genre, que le parti présente comme un grand bond en avant pour la société, de nouvelles pratiques sont mises en place. Des femmes sont maires, combattent, certaines sont cadres du PKK – venant de Turquie ou d’Iran – et s’imposent. En matière d’écologie il y a quelques réalisations, au niveau de la justice, de l’éducation faite en kurde, aussi [à ce sujet, lire notre reportage : Dans le « Rojava » syrien, une marche vers l’écologie ralentie par la guerre, ndlr]. Mais cette tentative de « changer la société » reste difficile à évaluer. Il y a beaucoup de communication, et le parti garde la main sur les secteurs stratégiques.
Des contraintes assez fortes s’exercent aussi sur les zones kurdes, au niveau économique, militaire…
Bien sûr. Les zones tenues par le PKK sont même actuellement mieux gérées que ne l’étaient les zones de l’insurrection syrienne. Mais cela s’explique aussi par d’autres facteurs que par la gestion du parti : en premier lieu, par le fait que le régime ne les attaque que très peu, ne les bombarde jamais. Et les attaques de l’EI sont repoussées grâce à une aide occidentale massive. Ces facteurs aident le mouvement à organiser le territoire, à le sanctuariser. En outre, la Syrie rapporte beaucoup d’argent au PKK. C’est une manne financière. Il prélève des taxes sur les commerces, des droits de transport sur les marchandises. Sans compter les activités pétrolières dans l’est du pays. Ces rentrées d’argent renforcent énormément les caisses du PKK, d’autant plus que le parti ne le réinvestit pas dans les infrastructures ou dans les services publics.
Depuis leurs victoires sur l’EI, environ un tiers du pays est contrôlé par les Forces démocratiques syriennes (FDS), l’alliance des YPG kurdes avec des brigades arabes. La Turquie a réagi en lançant une offensive sur Afrin au début de l’année. On a également assisté au retrait des YPG de la ville de Manbij, toujours sous pression turque. Comment le régime syrien, qui est en train de reconquérir les zones tenues par les différentes branches de la rébellion, regarde-t-il désormais les territoires déclarés « autonomes » par les Kurdes ? L’accord avec le PKK est-il toujours d’actualité ?
En 2013-2014, le PKK garde plutôt de bonnes relations avec le régime, mais celles-ci vont ensuite se dégrader. Aucun deal n’est trouvé. Pendant l’offensive contre l’EI, le régime observe que les Kurdes tentent, chaque fois qu’ils le peuvent, de grignoter du territoire. En face, les Kurdes considèrent que le régime risque de se retourner contre eux à n’importe quel moment. De plus, le PKK ne parvient pas à transformer ses gains militaires en gains politiques. Les États-Unis sont en position inconfortable : ils soutiennent le PKK, qui est en guerre avec la Turquie, un membre de l’Otan. Cela maintient le PKK à l’écart des négociations. Tout cela aboutit à une impasse : la durée de vie des territoires tenus par les YPG, sa branche armée en Syrie, est désormais limitée au retrait des troupes américaines. Lorsque ce retrait interviendra, ce qui n’est qu’une question de temps puisqu’il a été annoncé, la Turquie d’un côté, le régime syrien de l’autre, vont prendre d’assaut ces territoires.
Au niveau régional, il y a un rapprochement entre la Russie et la Turquie, ce qui a permis à Ankara de gagner la bataille d’Afrin. Le régime était contre l’offensive turque, mais les Russes ont passé un deal laissant la Turquie utiliser son aviation contre Afrin, et avancer sur la région. Pour les Kurdes, la situation est donc difficile : la chute rapide d’Afrin – qui est tombée en deux mois alors qu’il s’agissait de leur principal point fortifié en Syrie – a montré que le retrait américain les mettra immédiatement en difficulté. Le régime mène déjà une politique très agressive pour déstabiliser le nord-est, en tentant d’instrumentaliser les rivalités tribales, de préparer de futures insurrections appelant à son retour, ou encore à travers une campagne d’assassinats des habitants soutenant le PKK, afin de saper son ancrage local.
Quels sont ses objectifs de l’intervention militaire turque ? Ankara a-t-elle l’intention d’occuper la région d’Afrin sur le long terme, et d’en modifier les équilibres démographiques ?
La Turquie veut éliminer le PKK. Actuellement, il y a une autre opération menée dans le Kurdistan irakien, autour des monts Qandil – le fief du parti – où l’armée turque a avancé malgré des pertes importantes. Cela montre la détermination d’Ankara. À Afrin, la Turquie a distribué chaque quartier de la ville aux brigades syriennes qui ont appuyé son offensive. Elles y gèrent le foncier, ce qui leur assure une autonomie financière. Elles louent notamment les logements des Kurdes qui ont fui à des déplacés arabes venus d’autres régions. Il y a une logique d’expropriation et d’accaparement à grande échelle des biens kurdes. Pour autant, je ne parlerais pas d’un « nettoyage ethnique », mais plutôt d’une épuration politique : ceux qui ont été de près ou de loin avec le PKK sont arrêtés, disparaissent, peuvent être exécutés. Cela crée la panique et fait fuir des dizaines de milliers d’habitants kurdes. Ceux qui restent se retrouvent déclassés dans la nouvelle hiérarchie locale : ils sont désormais stigmatisés, placés en bas de l’échelle.
Par ailleurs, Afrin est aujourd’hui sous la tutelle de l’administration turque, qui y
envoie ses propres fonctionnaires, ou forme sur place ou en Turquie de nouveaux fonctionnaires locaux. Des routes sont ouvertes afin de relier la région à la Turquie, des services publics
fonctionnent sous l’autorité des pouvoirs publics turcs, et la population est désormais fichée par l’intermédiaire de visas spécifiques. La mise en place de ce système de contrôle administratif
indique plutôt une stratégie d’occupation de la zone sur le long terme. Difficile, cependant, de dire pour combien de temps. Cela dépendra essentiellement des accords qui interviendront, dans les
mois et les années qui viennent, avec les acteurs régionaux.
Propos recueillis par Thomas Clerget
Publié le 07/07/2018
Salah Hamouri victime, Israël coupable, la France complice.
Bérenger Tourné(site legrandsoir.info)
Dans son opinion N°34/2017 rendue le 25 avril 2018, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a jugé illégales tant l’arrestation que la « détention administrative » de Salah Hamouri par l’Etat d’Israël, auquel il est fait injonction de le libérer immédiatement. Faisant fi de cette décision, l’Etat d’Israël a décidé de prolonger de trois mois la détention arbitraire de Salah. Le droit international, Israël n’en a cure, ce d’autant que la France s’assoit dessus de son côté aussi…
C’est officiel. Salah Hamouri passera tout l’été dans sa geôle israélienne, mais toujours sans savoir pourquoi, la moindre charge ne lui ayant toujours pas été notifiée, après désormais 10 mois de « détention administrative ».
Ce qui est non moins officiel, c’est que le droit vient d’être dit relativement à la « détention administrative » infligée à Salah Hamouri, en regard de la légalité internationale. Dans son opinion N°34/2017 en date du 25 avril 2018, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l’hommes de l’ONU, a en effet jugé illégales l’arrestation et la détention arbitraire de Salah Hamouri par Israël.
On peut y lire que ce sont des forces illégitimes, les « forces d’occupation israélienne » intervenant à Jérusalem-est, territoire illégalement annexé et occupé par ces dernières, qui ont procédé à son arrestation, ce qui l’entache d’emblée d’illégalité.
On peut y lire que Salah Hamouri est enfermé sans aucune base légale, sur le fondement d’un prétendu « dossier secret » et qu’il n’a jamais été inculpé du moindre chef d’incrimination ce jour.
On peut y lire encore que Salah Hamouri a été interrogé dans des « conditions inhumaines », qu’il a été maintenu à l’isolement dans des conditions ne permettant pas de satisfaire aux « besoins minimum de vie humaine », transféré à plusieurs reprises à la prison de Ramleh qui présente des « conditions de détention inhumaines ».
Il y est enfin exposé que dans ces conditions d’arbitraire et de non droit, sa « détention administrative » équivaut à une « torture psychologique ».
Les mots sont forts, et pourtant ils sont choisis.
Aucune de ces allégations n’a été ni démentie, ni contestée par Israël, qui a préféré garder le silence dans le cadre de la procédure contradictoire instruite par le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l’hommes.
L’organisme onusien a par ailleurs constaté que rien ne permet de considérer que
M. Hamouri ait pu constituer une menace actuelle, directe et impérative pour l’Etat d’Israël à l’époque de son arrestation, ni moins encore depuis lors et désormais, après plus de 300 jours
d’enfermement.
Le verdict est clair et net. La détention de M. Salah Hamouri est arbitraire, à
raison de la violation des articles 9 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - dont Israël est signataire - ainsi que les articles 3, 8 et 9 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de la part de l’Etat d’Israël.
Rien moins. Et davantage même, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme assortit sa sentence d’une double injonction à l’encontre d’Israël : libérer immédiatement Salah Hamouri et lui accorder
une juste indemnisation pour les préjudices résultants de sa détention arbitraire.
On aurait ainsi pu penser, non pas qu’Israël puisse revenir au droit international, elle s’assoit dessus depuis si longtemps, mais au moins que la France manœuvre habilement, sur le fondement de cette opinio juris, pour obtenir la remise en liberté de son compatriote, notre concitoyen Salah Hamouri. Ce sera pour une autre fois...
Le 5 juin dernier à Paris, le Président Emmanuel Macron a préféré faire honneur à son hôte d’un jour en visite en Europe, M. Benjamin Netanyahou. Il a tenu à lui rappeler combien ils partagent la même conception du « respect de l’autre ». Le propos ne laisse pas de surprendre ou, plutôt, d’effrayer. M. Macron partagerait-il ainsi la même la conception que son homologue israélien en matière de respect des droits de l’homme en général, et de détention arbitraire en particulier ? Il faut croire, jusqu’à preuve du contraire, que la question appelle, et c’est désolant, une réponse affirmative.
Qu’on en juge puisqu’aussi bien l’Elysée a qualifié de « violences », les massacres perpétrés par l’armée israélienne réprimant la Marche du Retour, pacifique et désarmée, de la population gazaouie. Alors qu’il s’agit de « crimes de guerre », qui plus est des plus ignobles lorsque l’on se figure ses images de manifestants froidement abattus à bonne distance par des snipers israéliens. Aussi bien l’Elysée ne s’insurge pas davantage contre la « détention administrative » de notre compatriote Salah Hamouri, jeune avocat que l’on veut broyer pour sa défense des droits humains en Palestine.
C’est à croire que la Présidence de la République partage la conception israélienne assez singulière de l’habeas corpus, puisque alors que son arrestation a pris la forme d’un enlèvement pur et simple, et que sa détention arbitraire se poursuivra pour atteindre une année complète fin août 2018, le sort réservé à Salah Hamouri n’a toujours pas donné lieu à la moindre protestation, en bonne et due forme, de la part du représentant de la Nation.
Officieusement, ainsi qu’il a pu l’écrire à son épouse Elsa Lefort, M. Emmanuel Macron aurait rappelé à M. Netanyahou « la position de la France qui condamne le recours à la détention administrative lorsque celle-ci est abusive, systématique et viole le droit à un procès équitable » avant de lui « demander la libération de Salah Hamouri ».
Officiellement cependant, à ce jour, la France s’est contentée d’émettre un simple « souhait » de le voir libérer. Ainsi le pays qui se revendique (donc abusivement) d’être la patrie des Droits de l’Homme, se satisfait d’un vœu du bout des lèvres, qui n’engage même pas son auteur, et laisse sans contrainte son destinataire. On reste ainsi avec une vague espérance passive, attentiste, subie : une injonction à se résigner en somme. Comme si la nouvelle place de la France était celle de la servitude.
A ce jour, notre compatriote Salah Hamouri attend toujours que son pays affirme une position claire, audible, ferme, préalable à l’action et potentiellement à la sanction.
On se souvient que pour Florence Cassez, inculpée puis condamnée par la justice mexicaine, Le Président Nicolas Sarkozy avait à l’époque unilatéralement décidé de dédier « l’année du Mexique » à cette dernière, ce qui avait conduit à l’annulation cette opération culturelle programmée entre les deux pays.
Visiblement M. Emmanuel Macron n’assurera pas, de la sorte, son soutien à notre
concitoyen, otage d’Israël. Pas de dédicace ni d’exigence sine qua non, conditionnant la tenue de la « Saison croisée France-Israël », qui battra son plein à Paris sans que l’on ne
s’émeuve...
Si sur les plans politique et diplomatique, cette position, ou plutôt cette non-position du chef de l’Etat est intenable, inacceptable et fait honte, sur le plan du droit, elle signe la complicité de
la France à l’égard d’Israël, pour la privation de liberté arbitraire, injuste et cruelle, infligée à Salah Hamouri.
Non seulement par son silence et son immobilisme, la France conforte Israël quant au sort qu’il réserve à notre concitoyen, mais désormais que l’ONU, par l’entremise de son Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a rendu une opinio juris qui condamne péremptoirement l’Etat d’Israël, ne pas s’en prévaloir caractérise une connivence délibérée.
Le dernier attendu (55.) de la décision du Groupe de travail onusien rappelle en effet, solennellement, à tous les Etats composant la Communauté internationale, qu’ils se doivent de prendre toutes mesures appropriées aux fins de faire cesser toute privation de liberté arbitraire. C’est là que le bât blesse particulièrement pour la France puisque sur le fondement de cette décision, elle est désormais fondée à se subroger dans les droits de son ressortissant, pour faire respecter, à son égard, le droit international. On appelle cela la protection diplomatique, qui ne se confond pas avec la protection consulaire, laquelle ne conduit qu’à des gesticulations diplomatiques ou des coups d’épées dans l’eau.
La protection diplomatique investit en revanche la France de la possibilité de déplacer le litige de la sphère diplomatique vers le terrain de l’action judiciaire internationale. La France est recevable et se doit de sommer l’Etat d’Israël de libérer immédiatement Salah Hamouri sur le fondement de l’opinion du Haut-Commissariat onusien. A défaut, la saisine de la Cour Internationale de Justice (quand bien même Israël n’est – évidemment - pas signataire de ses statuts, la Cour pouvant rendre un avis consultatif, voire une décision en cas de forum prorogatum (1) ) dans le cadre de l’exercice du régime de la protection diplomatique reconnu par le droit des gens (2).
C’est là la prérogative de la France offerte par le droit international. C’est là son honneur en tant qu’Etat souverain. C’est encore son devoir à l’égard de notre concitoyen.
Las, on ne peut tout à la fois, dérouler le tapis à rouge à M. Netanyahou d’une main, et lui signifier de l’autre une citation devant la justice internationale...
Bérenger Tourné
1) http://www.icj-cij.org/fr/fondements-de-la-competence#1 : « Si un Etat n’a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d’une requête introductive d’instance », ce qui est le cas d’Israël, néanmoins « il a toujours la possibilité d’accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l’affaire : en pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum ».
2) Sur la notion de protection diplomatique : http://legal.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_484.pdf
Publiéle 06/07/2018
Coresponsable de l’école de la France insoumise, politologue et essayiste
"La dette, la dette, la dette!", cet argument antisocial que l'on vous rabâche est bidon
Voici pourquoi les partisans du remboursement de la dette par l'austérité budgétaire sont des charlatans.
"Parce que la dette". Tel est l'argument absolu des partisans des politiques anti-services publics et anti-protection sociale.
Première lame des ciseaux: ils s'en servent pour refuser toute mesure de justice sociale. Par exemple, si vous expliquez qu'un tiers du personnel hospitalier est en risque de burn-out (source: ANFH) et qu'il est donc urgent de recruter davantage, ils vous répondront que c'est impossible "parce que la dette".
Seconde lame: ils s'en servent pour présenter leurs réformes antisociales comme des mesures inévitables de saine gestion. Par exemple, si vous rappelez que les aides sociales sont indispensables pour limiter la pauvreté, puisque sans elles la pauvreté toucherait 24% des Français au lieu de 14% (Eurostat), ils vous répondront qu'il faut quand même les baisser "parce que la dette". Ainsi essaient-ils d'enfermer le débat politique dans une camisole de fer: si vous êtes d'accord avec eux vous êtes un gestionnaire vertueux; si vous n'êtes pas d'accord vous êtes un panier percé irresponsable.
Cette argumentation est pourtant fallacieuse, pour plusieurs raisons.
D'abord, leur façon de compter la dette des Etats est absurde. "Dette de la France à 98% du PIB"! "Bientôt 100%"! De bonne foi, le public non-spécialiste va s'imaginer que si l'on dépasse 100% c'est forcément une catastrophe. Il va donc se résigner d'autant plus facilement à des saignées dans nos dépenses sociales. Or, le PIB est la richesse totale produite par le pays sur 1 an; et l'Etat français, actuellement, rembourse ses prêteurs au bout d'un peu plus de 7 ans. En toute rigueur, si l'on compare notre dette publique au PIB du pays sur 7 ans, cela donne alors 14%, et non pas 98%. La baudruche de "l'apocalypse de la dette" se dégonfle immédiatement.
Ensuite, il faut rappeler que la garantie ultime de la dette d'un Etat, ce n'est pas la richesse produite par le pays tout entier sur 1 an. La garantie ultime, c'est l'existence ou pas d'un patrimoine public total supérieur à la dette, car cela signifie que l'Etat détient davantage qu'il ne doit. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle la France, pays doté d'un très vaste patrimoine public (infrastructures, immobilier, entreprises publiques...), est considérée par les prêteurs comme un emprunteur sûr, alors que des Etats pauvres qui n'ont quasiment pas de patrimoine public sont considérés comme des emprunteurs risqués. L'incurie des partisans des politiques antisociales "parce que la dette" éclate alors au grand jour: alors que c'est notamment l'existence d'un puissant patrimoine public qui fait de la France un emprunteur solide, les mêmes ne cessent d'affaiblir cette garantie en multipliant les privatisations! C'est la vieille histoire du pompier pyromane.
Enfin et surtout, l'idée qu'on puisse rembourser la dette publique grâce à d'énormes saignées dans nos dépenses publiques est en soi une idiotie. A titre d'exemple, si la France arrivait, au prix d'une austérité sans précédent, à dégager un excédent budgétaire d'environ 1% du PIB et le consacrait à rembourser sa dette publique, cela prendrait environ...100 ans! Qui peut croire sérieusement à pareil scénario? Cela suffit à prouver que les partisans du remboursement par l'austérité budgétaire sont des charlatans.
Il y a une alternative. La dette publique de la France, et plus largement celle des pays de la zone euro, peuvent parfaitement être résorbées sans politiques antisociales d'austérité. Il suffit pour cela que la Banque centrale européenne (BCE) rachète les dettes aux prêteurs grâce à la création monétaire (la "planche à billets"); et qu'une fois rachetées, elle les efface. C'est légal, car la BCE a déjà le droit de racheter des dettes publiques à des créanciers: elle l'a d'ailleurs déjà fait ces dernières années. Dans un scénario maximaliste, à raison d'une création monétaire de 960 milliards d'euros par an, l'intégralité de la dette publique de la zone euro pourrait ainsi disparaître en une dizaine d'années, sans subir ni la vente à la découpe du patrimoine public, ni des saignées dans nos dépenses sociales. Pour mémoire, la BCE a déjà créé rien qu'en 2017 720 milliards d'euros pour soutenir les banques privées: cet ordre de grandeur n'est donc pas choquant. Et de toute façon, l'on peut aussi imaginer un scénario intermédiaire, qui résorberait une grande partie de la dette publique de la zone euro mais pas sa totalité.
Le grand argument habituel contre cette alternative est bien connu: "la planche à billets provoquera de l'hyperinflation!". En réalité, c'est faux. Tant qu'elle garde des proportions maîtrisées, la création monétaire ne provoque pas d'hyperinflation: en l'occurrence, même le scénario maximaliste que j'évoque accroîtrait la masse monétaire de seulement 4%, et à un rythme assez lent. De surcroît, dans l'économie telle qu'elle est et pas telle qu'on la fantasme, ce qui provoque l'hyperinflation, c'est l'écroulement de la confiance des ménages et des investisseurs dans l'économie du pays, qui se traduit par la fin de la confiance dans la valeur de la monnaie elle-même. Par exemple, dans le cas sans cesse invoqué des brouettes de billets de banque de l'Allemagne de Weimar pour aller acheter du pain, c'est l'écroulement de la confiance collective dans l'économie allemande qui a provoqué l'hyperinflation; et non pas une politique préexistante de création monétaire.
Jadis Molière décrivait les médecins de son époque comme des charlatans cachant leur ignorance derrière des formules obscures en latin, et qui n'étaient bons qu'à multiplier les saignées sur les malades au risque de les tuer. Mutatis mutandis, les partisans des privatisations, des politiques anti-services publics et des politiques anti-protection sociale sont les médecins de Molière d'aujourd'hui: eux aussi justifient des mesures mortifères avec du charabia pseudo-expert; et eux aussi sont de dangereux charlatans.
Oublié le 05/07/2018
La France arme la dictature égyptienne comme jamais
Par Thomas Cantaloube (site mediapart.fr)
Un rapport de plusieurs ONG dénonce les exportations d'armes vers le régime d’Abdel Fattah al-Sissi. En sept ans, les livraisons ont été multipliées par 33 alors que la répression envers l'opposition s'est intensifiée.
C’est la ligne Alliot-Marie qui l’a emporté. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il semble qu’en matière d’exportations d’armes, la France ait adopté la ligne de conduite de l’ancienne baronne de l’UMP et ex-ministre des affaires étrangères qui, au plus fort des manifestations en Tunisie contre la dictature de Ben Ali en décembre 2010 et janvier 2011, avait proposé « le savoir-faire, reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité » pour aider le régime à mater les contestataires. Comment parvenir à une autre conclusion, à la lecture du rapport publié lundi 2 juillet 2018 par la FIDH sur les exportations d’armes et de technologies de surveillance françaises en Égypte ?
Ce document, intitulé de manière volontairement provocante « Égypte : une répression made in France », représente le fruit du travail de plusieurs ONG (la Fédération internationale des droits de l’homme, l’Observatoire des armements et le Cairo Institute for Human Rights Studies) qui se sont coltiné l’obscurité et le flou des différents rapports que le gouvernement est tenu de livrer au Parlement et à l’ONU, ainsi que les annonces de divers contrats militaires par les entreprises elles-mêmes. S’il ne fallait en retenir que quelques chiffres, ce serait ceux-ci : en 2010, la France a livré pour 39 millions d’euros d’armes à l’Égypte, en 2014 pour 838 millions d’euros et en 2016, dernière année connue, pour 1,3 milliard d’euros. Soit une multiplication par 33 en l’espace de sept années. Et c’est sans compter sur les commandes à venir puisqu’en 2015, Paris a conclu un contrat de 5,3 milliards d’euros prévoyant la livraison de 24 Rafale, une frégate furtive et différents assortiments de missiles.
Campagne de la FIDH sur le thème : « En Égypte, exportons nos valeurs, pas nos armes ! » © International Federation for Human Rights
Mais ce qui attire davantage l’œil des ONG, ce sont moins ces gros engins de guerre que toute la batterie de petits matériels militaires et sécuritaires qui ne servent pas tant à se défendre contre des ennemis étrangers qu’à encadrer et réprimer les Égyptiens eux-mêmes : armes légères et de petits calibres, munitions, machines-outils pour confectionner des balles, véhicules blindés légers, drones d’observation et technologies sécuritaires informatiques (interception de masse, collecte de données individuelles, contrôle des foules). Les fournisseurs de ces différents matériels répondent aux noms grand public de Renault, Manurhin, Thales, Safran ou, plus discrets, de Nexa, Amesys, Suneris…
Fait saillant de cette augmentation des livraisons d’armes et de technologies de Paris au Caire, la période 2010-2016 où elle se produit voit la chute de la dictature de Moubarak, son remplacement par le président démocratiquement élu, issu des rangs des Frères musulmans, Mohamed Morsi, puis le coup d’État militaire de 2013 d’Abdel Fattah al-Sissi, et enfin la répression tous azimuts qui s’ensuit et qui fait aujourd’hui de l’Égypte l’un des régimes les plus autoritaires du monde.
Autrement dit, au moment où l’Égypte passait d’une dictature à une dictature encore plus sévère, avec un bref passage par la case libertés, la France lui a fourgué trente-trois fois plus d’armements en tous genres.
Selon Tony Fortin, de l’Observatoire des armements, « la France a saisi l’opportunité d’un léger retrait américain sous l’administration Obama au moment du coup d’État de 2013 pour augmenter son commerce avec l’Égypte, mais aussi avec l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, le Moyen-Orient représente 50 % des ventes d’armes françaises. Paris engrange les profits d’une situation de répression ». Cela découle aussi des nouvelles filières de fournitures d’armes via les Émirats arabes unis, où se sont établis ces dernières années plus de 80 entreprises étrangères dans le domaine de l’armement, dont des françaises, qui permettent une relation plus proche et plus soutenue avec les différents acheteurs moyen-orientaux.
Selon Bahey Eldin Hassan, du Cairo Institute for Human Rights Studies, « ces achats d’armes à la France se font sous le couvert de la lutte antiterroriste, mais ce n’est qu’une façade. Il s’agit en fait de lutter contre l’opposition politique. Dans le Sinaï par exemple, l’armée égyptienne annonce avoir tué des milliers de terroristes, mais n’en apporte aucune preuve puisque aucune instance indépendante ne peut le vérifier. Par ailleurs, il ne s’agit qu’en partie de commerce, il s’agit aussi d’acheter des appuis politiques. Alors que les relations de l’Égypte avec les pays occidentaux étaient au plus mal entre 2011 et 2013, Sissi les a restaurées par le biais des achats de matériels militaires : la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis le soutiennent désormais fermement. S’agissant de ces derniers, Donald Trump a beau assurer Sissi de son amitié, le Congrès américain est plus regardant et il a plusieurs fois bloqué des ventes d’armes prévues. Sissi a été très malin en choisissant de s’équiper en France, où le contrôle parlementaire est bien moindre ».
« La France se compromet auprès d’une dictature militaire »
Cette question de la transparence est en train de prendre de l’ampleur s’agissant de la définition de la politique étrangère française. Un député LREM, Sébastien Nadot, essaie de faire la lumière sur les ventes d’armes à l’Arabie saoudite qui auraient pu servir dans la guerre au Yémen : il a déjà rassemblé plusieurs dizaines de signataires pour la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le sujet, mais sa proposition est pour l’instant bloquée. Mais plutôt que de se concentrer sur les différents pays acheteurs et la manière dont ils utilisent les matériels français les uns après les autres, la FIDH plaide pour une véritable réforme des ventes d’armes qui passerait par la création d’une commission parlementaire permanente, qui aurait droit de regard sur les exportations de ces équipements et qui en organiserait la transparence, comme cela existe dans d’autres pays : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie…
Un véhicule blindé Sherpa fabriqué par Renault fonce dans des manifestants, avant d'être contraint de reculer et de basculer du haut d'un pont en 2013. © Spi0n
« Nous constatons la faillite du système français d’exportation des armes », assène Antoine Madelin, responsable du plaidoyer à la FIDH. « La France a signé des conventions par lesquelles elle s’engage à ne pas vendre de matériel militaire pouvant servir à des pays pour réprimer la population et les voix dissidentes, et pourtant, elle le fait. » En illustration de ses propos, il cite des exemples contenus dans le rapport. En particulier celui des véhicules blindés Sherpa fabriqués par Renault, qui ont servi à plusieurs reprises dans la répression de manifestants en Égypte depuis 2013, sachant que plusieurs ONG avaient déjà documenté l’usage de camions blindés dans la mort de protestataires de rue. Le 14 août 2013, lorsque 500 à 1 000 manifestants ont été tués sur la place Rabia-El-Adaouïa du Caire par les forces de l’ordre, des camions Sherpa ont été aperçus à plusieurs endroits. Et pourtant, leur exportation à destination de l’Égypte a continué au moins jusqu’en 2015.
Autre exemple : les douanes françaises avaient suspendu en 2013 l’exportation d’une machine-outil de Manurhin servant à fabriquer des cartouches, craignant que ce matériel ne soit utilisé dans la confection de balles en caoutchouc et de bombes lacrymogènes. Pourtant, le Secrétariat général de la défense et la sécurité nationale (SGDSN), sous l’autorité du premier ministre, est passé outre les douanes et, depuis, plusieurs dizaines de machines ont été acheminées en Égypte.
Dernier exemple enfin : l’exportation de nombreuses technologies à « double usage », civil comme militaire. Ces dernières années, la France a vendu à l’Égypte des systèmes informatiques de contrôle des foules, des logiciels d’interception des communications et des données personnelles, des serveurs de centralisation des données individuelles, comme celles contenues sur les cartes d’identité biométriques, dont l’Égypte est en train de se doter. Sachant que le régime de Sissi est engagé dans une répression farouche de tout le tissu associatif, militant, politique et même journalistique qui pourrait le contester, il ne fait guère de doute que ce matériel civil trouvera une application sécuritaire pour ce que certains décrivent comme une « architecture orwellienne ».
« La France se compromet auprès d’une dictature militaire qui ressemble à celles qui existaient en Amérique du Sud dans la seconde moitié du XXe siècle, dénonce Bahey Eldin Hassan. Il n’est pas encore trop tard pour qu’Emmanuel Macron change de politique et devienne le président qui aura fait primer les idéaux français. » À moins qu’il ne préfère que l’on se souvienne de lui comme d’un Michèle Alliot-Marie 2.0, le président qui arme les oppresseurs et les tortionnaires ?
Publié le 04/07/2018
Accidents mortels à répétition : quand l’agro-industrie joue avec la vie de ses techniciens cordistes
par Franck Dépretz (site bastamag.net)
Quentin Zaroui-Bruat en juin 2017, Arthur Bertelli et Vincent Dequin en mars 2012. Ces trois jeunes cordistes, des techniciens qui effectuent des travaux en hauteur, sont tous trois morts ensevelis dans les silos du géant du sucre Cristal Union. Aucun de ces accidents, intervenus sur le même site industriel, n’a encore été jugé. En cause à chaque fois ? L’ouverture accidentelle des trappes destinées à vidanger les silos. S’agit-il d’une simple erreur humaine ou de la conséquence d’insuffisances en matière de sécurité, dans un métier précaire et très peu encadré ? Enquête.
« C’est simple, l’accident est arrivé sur ma première mission dans un silo, et dans les dix premières minutes. » Le 13 mars 2012, Frédéric Soulier fait partie des quatre cordistes qui descendent dans ce silo de sucre de Bazancourt, dans la Marne. Et des deux seuls qui en remonteront. Alors qu’ils étaient chargés de décoller les énormes blocs de sucre qui se forment le long des parois, les quatre, tous intérimaires, sont happés vers le fond du silo. Il s’agit d’un énorme réservoir d’une cinquantaine de mètres de haut, appartenant à une sucrerie du géant Cristal union. À 17 km au nord-est de Reims, Bazancourt abrite ce site agro-industriel qui forme, selon l’entreprise, l’« une des plus grandes bioraffineries au monde ». Ce jour-là, trois trappes de désilage de 20 centimètres de diamètre - normalement destinées à vidanger le silo - s’ouvrent alors que les travailleurs sont toujours à l’intérieur. Comme dans un sablier géant, le sucre s’écoule et aspire au cœur de son immense « V » Arthur Bertelli et Vincent Dequin, 23 et 33 ans, deux cordistes arrivés le matin même sur le site.
Cinq ans plus tard, le 21 juin 2017, Quentin Zaroui-Bruat, cordiste de 21 ans, également intérimaire sur un site du groupe à Bazancourt, meurt là encore enseveli en quelques instants, malgré les tentatives désespérées de ses collègues pour le récupérer. « Exactement dans les mêmes conditions », relève Frédéric (lire sur le sujet : « Quentin, un bon gamin, mort enseveli dans un silo à l’issue d’une pénible journée d’un travail ingrat » [1]). Les deux accidents interrogent la sécurité au sein de cette entreprise, mais aussi les conditions d’exercice d’une profession, cordiste, peu encadrée, dans laquelle la « débrouille » a longtemps été la règle. D’autant plus que depuis quelques années, sous l’effet d’une demande croissante des entreprises, le nombre de cordistes en activité s’envole.
« Coupe ta corde, t’es pris dedans ! »
Entre les deux accidents mortels de 2012 et 2017, il y a si peu de différences. Les deux premières victimes travaillaient pour la grande entreprise de sucre Cristal union, la troisième pour sa filiale, la distillerie Cristanol, implantée à quelques mètres de là. Les deux premiers cassaient du sucre à la pioche toute la journée, le troisième des résidus de céréales. « C’est chaque fois le même accident qui a lieu à Bazancourt et qui broie des vies, et chaque fois, ça part de ces trappes qui s’ouvrent mystérieusement... », s’étrangle Frédéric, qui s’est lui aussi retrouvé pris dans le sucre en 2012. « Coupe ta corde, t’es pris dedans ! », lui a hurlé Vincent juste avant de disparaître lui-même. Frédéric s’est exécuté, coupant sa corde qui était avalée par le sucre, avant de se raccrocher à un autre lien. C’est ce qui l’a sauvé. In extremis.
Pour Frédéric comme pour ses collègues, ces accidents auraient dû être évités. Les questions sont nombreuses. Comment des trappes ont-t-elles pu s’ouvrir en pleine intervention ? Le gérant d’une entreprise de travaux sur cordes voisine, qui a souhaité rester anonyme, raconte : « Quand on travaille dans un silo ou en espace confiné, nos techniciens ont leur propre cadenas de consignation, qui empêche toute autre personne d’intervenir dessus, d’y accéder, d’ouvrir les vannes... Ils gardent la clé avec eux. Mais sur ce site, on ne peut pas faire comme ça. » Lors de ces accidents, les cordistes affirment qu’ils n’avaient effectivement rien de tout cela.
« Ni plan de prévention, ni moyen d’évacuer une personne en cas de danger »
« En descendant dans le silo, la première chose que je me suis dite, c’est que s’il nous arrivait quelque chose, on ne pourrait pas remonter », se souvient Frédéric Soulier. S’il y a bien deux « portes » d’accès percées dans les parois pour permettre de sortir à tout moment, elles se trouvent à un et sept mètres du sol. Mais elles sont invisibles : la couche de sucre, ce jour-là, les recouvrait totalement... « J’ai travaillé dans d’autres silos pour d’autres sociétés, poursuit Frédéric. Il y avait une analyse des risques avant notre intervention, et un plan de prévention qui indiquait les solutions à chaque problème. Par exemple, s’il n’y a pas d’accès par le bas, il faut prévoir un treuil d’évacuation en cas de secours. Mais à Bazancourt, il n’y avait ni plan de prévention adapté, ni moyen d’évacuer une personne en cas de danger. » À Bazancourt toujours, mais dans des silos n’appartenant pas à Cristal Union, un cordiste qui a bien connu Vincent Dequin affirme qu’il travaille également « avec un treuil par personne pour remonter en cas d’urgence ». L’inspection du travail de l’époque notera dans son rapport sur l’accident mortel de 2012 que le « plan de prévention [n’était] pas adapté aux lieux » ni à « l’action réelle ».
Rebelotte en 2017. Le jour où Quentin meurt, ses collègues rapportent qu’il n’y a pas davantage de système d’évacuation d’urgence. « Pour sauver Anthony, son binôme qui s’enfonçait aussi, heureusement qu’on avait une corde en plus pour bricoler un système D. Il n’y avait aucun kit de sauvetage, rien... », s’étonne encore Christophe, le chef d’équipe. La législation précise pourtant que « le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ».
« En cinq ans, aucune leçon n’a été tirée »
« Même s’il reste flou, cet alinéa du code du travail est le plus important en termes de prévention à la sécurité. Mais il est trop souvent violé sur le terrain », regrette Luc*, membre de la CGT cordistes. « Le plus fou, juge Frédéric Soulier, c’est qu’en cinq ans, aucune leçon n’a été tirée à Bazancourt. En 2012, au moins, la boite d’intérim faisait preuve d’exigence, sélectionnait les cordistes en fonction de leur expérience. En 2017, toute l’équipe était composée de débutants, et n’était même pas encadrée par un titulaire expérimenté ! » Tous étaient des intérimaires.
Suite à son enquête sur la mort de Quentin, l’inspection du travail a dressé un
procès-verbal, transmis au procureur de Reims, faisant ici encore état d’une « exécution de travaux (...) sans plan de prévention des risques préalables conforme », de
« mise à disposition (...) d’équipement ne préservant pas la sécurité du travailleur », ou encore d’« emploi de travailleur (...) sans dispense d’une formation pratique et
appropriée en matière de santé et de sécurité ».
Quentin Zaraoui-Bruat - Vincent Dequin - Arthur Bertelli (crédit : familles)
Les cinq membres de l’équipe de Quentin possédaient, au mieux, le niveau le plus bas des certifications de qualification professionnelle : le CQP 1. Mais la très officielle association
Développement et promotion des métiers sur corde (DPMC), qui gère le dispositif des formations, reconnaît elle-même qu’un CQP 1 ne peut être considéré comme autonome « dans les prises de
décisions qui traitent des choix techniques à mettre en œuvre pour la sécurisation des accès cordes ou du poste de travail ». En juin 2017, presque au même moment que le deuxième accident
mortel de Bazancourt, DPMC publie même un nouveau référentiel exigeant que l’ouvrier cordiste CQP 1 soit « accompagné sur chacune de ses interventions en hauteur par au minimum un cordiste CQP2 ».
Les silos, un « passage obligatoire » pour les nouveaux
Le niveau CQP 2, Vincent Dequin, mort en 2012, l’avait. Largement, même. Il était, selon son entourage, « un grimpeur né », qui baroudait à travers l’Europe sur toutes sortes de chantiers – voilier, centrale nucléaire... Cela n’a pas empêché celui qui présidait l’antenne marnaise de la Fédération française de la montagne et de l’escalade de se faire ensevelir sous des tonnes de sucre. Dans un silo, le cordiste peut « se retrouver simultanément exposé à autant de dangers mortels ou très graves, et la moindre dégradation de la situation peut s’avérer dramatique », avertit la CGT Cordistes dans un document de travail d’octobre 2017 rédigé suite au deuxième accident. « Devant l’absence de considération de l’ensemble de la profession », le syndicat a tenté de tirer de son côté les leçons des accidents mortels de Bazancourt.
Aucune des victimes de 2012 comme de 2017 n’avaient été formées aux spécificités des milieux confinés. Et pour cause : il n’existe aucune formation officielle et obligatoire dédiée à ce domaine [2]. Lâcher des nouveaux dans un silo, sans même les briefer, n’a rien d’illégal. Au contraire, casser du sucre à la pioche ne réclamant pas la maîtrise précise d’un métier – comme la maçonnerie, la plomberie ou autre – les silos constituent une sorte de « passage obligatoire » pour les débutants. « Là, on peut tester leur vaillance, leur motivation, leur soumission, estime Marc*, ex-cordiste intérimaire qui a travaillé à Bazancourt. D‘autant que les plus expérimentés renâclent à y aller, sachant ce qui les attend. »
« C’est un métier où les débutants ont une pression supplémentaire, confirme Mathieu Piketty, responsable de l’entreprise de travail temporaire spécialisée, Sett Interim, qui employait Arthur et Vincent en 2012. Avec la multiplication des entreprises, et les salaire de plus en plus bas – 10 ou 12 euros de l’heure en moyenne pour les nouveaux – des jeunes sans expérience sont poussés à faire des choses qui ne relèvent pas toujours de leurs compétences. Ou alors ils acceptent de travailler sur des chantiers mal organisés, sans plan de prévention des risques. Ils veulent faire leurs preuves, pour être rappelés le lundi suivant. »
« Tout repose sur les épaules du travailleur plutôt que sur celles de l’employeur »
Zoomer sur les lacunes en matière de réglementation et de prévention à la sécurité dans les milieux confinés a-t-il un sens, quand les règles de la profession toute entière sont elles-mêmes particulièrement floues ? « Notre métier n’est défini par aucune convention collective. On a aucune réelle reconnaissance de notre travail, souffle Pierre*, cordiste formateur et membre de la CGT Cordistes. Les disparités entre les entreprises sont énormes. » Les entreprises de travaux sur cordes choisissent elles-mêmes si elles veulent plutôt dépendre de la branche bâtiment, de la branche propreté, travaux publics, spectacle, paysage, ou encore métallurgie...
S’il existe bel et bien plusieurs types de diplômes de cordistes, rien n’oblige une entreprise à les exiger [3]. Le code du travail exige simplement qu’une « formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage » soit dispensée au futur cordiste. « On passe son CQP de cordiste comme on passerait son brevet de ski, lâche Luc, lui-aussi cordiste formateur. Une fois formés, les cordistes sont lâchés dans la nature. L’entreprise en fait ce qu’elle veut. Il n’y a pas nécessairement d’organisation du travail, pas de planification des sauvetages... Sur les chantiers, tout repose sur les épaules du travailleur plutôt que sur celles de l’employeur. »
Une réglementation à minima
Le syndicat français des entreprises de travaux en hauteur (SFETH), principale organisation de la profession [4], explique cette situation par l’histoire de l’activité : « Quand la profession de cordiste a véritablement démarré, à la fin des années 1970, les autorités publiques – inspections du travail, ministère... – ont longtemps cherché à interdire les travaux sur corde plutôt qu’à les réglementer, développe son président Jacques Bordignon. Ensuite le métier s’est "mondialisé", et les autorités ne pouvaient pas aller contre cette tendance. Quand une directive européenne a été produite, les autorités publiques se sont contentées de la transcrire dans le droit français : c’est ce qui a donné cet embryon de texte dans le code du travail, qui oblige un minimum de formation, de supervision. Mais ça n’a pas été plus loin, il y a une certaine inertie des autorités. » [5]
Le SFETH renvoie également la balle aux donneurs d’ordre : « Pour ne rien vous cacher, même s’il s’agit de nos clients, la vision que l’on a d’eux est assez négative, affirme Jacques Bordignon. Qu’ils viennent du public ou du privé, ils cherchent avant toute chose les entreprises les moins chères. Les conditions de travail passent après. C’est une tendance globale. On en arrive presque à dire qu’il faudrait, aujourd’hui, mener une action contre eux, pour qu’ils prennent conscience qu’ils tirent tout le monde vers le bas. »
L’esprit débrouillard des premiers cordistes, « criminel » aujourd’hui ?
De l’aveu même de Jacques Bordignon, « il n’y a pas de véritable réglementation : théoriquement, n’importe qui demain peut travailler sur cordes ». C’est pourquoi une circulaire du ministère du Travail devrait prochainement pousser à une évolution des pratiques – en précisant les impératifs de formation et de supervision des chantiers – et qu’une « Convention de bonnes pratiques » destinée aux agences d’intérim devrait voir le jour. Parmi les principales dispositions auxquelles ces dernières se sont engagées, on retrouve plusieurs points qui auraient fait défaut à Bazancourt le 21 juin 2017 : « Avoir un référent permanent par agence ou établissement qui possède la compétence métier », « s’assurer que le chantier ne soit pas effectué par 100% de personnel intérimaire », ou « s’assurer qu’il y a à minima un cordiste titulaire du CQP2 sur le poste de travail de l’intérimaire mis à disposition ».
S’en prendre aux agences d’intérim ou au manque de considération des institutions n’est cependant pas suffisant pour Luc, qui est également membre de la CGT Cordistes. « Avant qu’ils ne deviennent patrons des principales boîtes de travaux en hauteur, les cordistes qui ont posé les bases du métier dans les années 1980 et 1990 venaient du milieu de la montagne. De là vient l’esprit débrouillard dont a hérité la profession. Un esprit noble pour les sports de montagne, mais criminel dans le monde du travail. Ce qui était valable pour une poignée de cordistes, ne l’est plus aujourd’hui. »
Des entreprises qui vendent mieux les chantiers qu’elles n’expliquent les missions
Mathieu Piketty, de l’agence Sett Interim, ne connaissait pas les véritables conditions d’emploi de Vincent et Arthur à Bazancourt, en 2012 : « Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient envoyés dans un silo aussi énorme, avec des crêtes de sucre de dix ou douze mètres et du vide en dessous. » Les jeunes cordistes sont envoyés sur place à la demande de Carrard Services, une entreprise de nettoyage industriel, qui était prestataire pour Cristal union. D’après ses souvenirs, « ils étaient censés recevoir une formation de sécurité pour les informer de tous les risques liés au travail en sucrerie. Que faire en cas d’effondrement du sucre, par exemple. Mais ils ont été envoyés dans les silos avant même de l’avoir reçue. » Donneur d’ordre, entreprise de nettoyage, agence d’intérim... Qui est responsable ? La chaîne de sous-traitance dilue les responsabilités au maximum.
Manque de temps et de moyens pour vérifier les chantiers, manque d’infos de la part de l’entreprise utilisatrice, Mathieu Piketty était seul pour coordonner un effectif de 40 à 50 intérimaires. « Carrard ne m’a pas détaillé la mission, dénonce-t-il. Mes infos c’étaient les retours d’expérience des cordistes. Les clients sont peu bavards sur les conditions de travail. On a plutôt affaire aux responsables qui "vendent" le chantier, et techniquement ils ne savent pas toujours comment les gars se débrouillent pour le faire. »
Suite à cette expérience, Mathieu Piketty n’a plus voulu gérer d’agence d’intérim. Il est désormais cordiste indépendant, ce qui lui permet d’essayer de faire face à une tendance marquée à la dévaluation des prix : « Je ne sais pas s’il y a beaucoup d’autres milieux où les tarifs ont baissé aussi fortement en 15, 20 ans. Cordiste est un métier très paradoxal : il nécessite des compétences pointues, le tout pour 10 ou 12 euros de l’heure. Rarement plus de 13 ou 14 euros pour un cordiste expérimenté. »
Entre solidarité du milieu alpin et individualisme du travail précaire
« J’ai vu disparaître Arthur et Vincent sous mes yeux, je les ai vus mourir mais pour moi, dans ma tête, ils n’étaient pas morts. C’est à l’hôpital, plusieurs heures après, que j’ai compris », revoit Frédéric, l’un des deux survivants de 2012. Des années de psychothérapie plus tard, pour combattre la culpabilité et les cauchemars incessants, l’homme est devenu cordiste spécialisé dans l’entretien de murs végétalisés, et formateur au Luxembourg. « Même avec 12 ans d’expérience, je fais toujours des missions d’intérim pour assurer les fins de mois. Mais je refuse de travailler en milieu confiné. C’est trop dangereux, trop mal encadré. »
Fanny Maquin se souvient parfaitement de la dernière discussion qu’elle a eue avec Vincent, son compagnon, la veille de son départ à Bazancourt : « Il me disait qu’il craignait les interventions dans les silos, déjà dures par nature. » Fanny Maquin a noué des liens très forts avec Marion Vernhet, la compagne d’Arthur, le second cordiste décédé dans le silo lors de l’accident de 2012. En septembre 2017, les deux femmes ont co-organisé, avec les collègues de Quentin, un rassemblement « pacifique et solidaire », devant l’usine, en mémoire des trois cordistes morts à Bazancourt. Sans cette impulsion venue « d’en bas », il n’y aurait probablement eu aucun hommage. Ni de la part de Cristal union, ni de la part de la profession.
« C’est très difficile de se sentir épaulée, analyse Marion. Encore plus de s’organiser pour que des mesures soient prises, pour que les cordistes puissent faire valoir leur droit de retrait quand ils se sentent en danger, pour que cela ne se reproduise plus. C’est un métier très paradoxal, qui hérite à la fois de la solidarité du milieu alpin et de l’individualisme lié au travail indépendant et précaire. »
Deux mises en examen liées à l’accident de 2012
Désormais, pour les proches et collègues des victimes, le but est de faire évoluer la profession et de voir la justice désigner les responsables des drames. Aucun jugement n’a encore été prononcé. La juge d’instruction enquêtant sur l’accident de 2012 a cependant prononcé le 11 novembre 2017 la mise en examen d’un responsable de Cristal union et d’un responsable de Carrard, pour « blessures et homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». Après l’accident, la police judiciaire avait entendu les principaux témoins, y compris les responsables et employés de Carrard et de Cristal union – notamment la responsable du silo qui aurait ouvert la trappe de vidange.
Vue la lenteur des procédures, la lumière sur l’accident de Quentin en 2017 est encore loin d’être faite. La mère et les frères du jeune homme se sont constitués partie civile. Cette dernière a été entendue en janvier dernier par la gendarmerie de Reims, dans le cadre d’une enquête toujours en cours. Les inspectrices du travail étaient deux à enquêter, chacune chargée d’un accident. Mais la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) grand-est nous a appris qu’elles ont chacune été mutées en dehors de la Champagne-Ardenne. Une nouvelle inspectrice est en charge des dossiers.
Nos nombreux appels adressés aux donneurs d’ordres, entreprises délégataires et boîtes d’intérim sont restés sans réponse. Seule une chargée de communication a fini par nous répondre au siège de Cristal union. Pour nous avouer qu’elle était parfaitement au courant de l’objet de notre enquête : « Je sais que vous appelez depuis un moment et la réponse est claire : on n’a pas de réponse à vous donner là-dessus. »
Pas de condoléances, mais une « forte rentabilité » revendiquée
Ce silence n’épargne pas les proches des victimes. La mort de l’homme avec qui elle a partagé 12 ans de sa vie, Fanny l’a apprise dans les médias en 2012. Ni Cristal union, ni les gendarmes ne la préviendront officiellement de l’accident de Vincent. « On ne peut pas prévenir tout le monde », lui diront les gendarmes deux jours plus tard. « Le seul échange qu’on a eu avec Cristal union en six ans, déplore également Marion, l’ancienne compagne d’Arthur, c’était avec deux représentants des ressources humaines devant la chambre mortuaire. Ils étaient venus nous "accueillir" juste avant la reconnaissance du corps. Depuis, c’est silence radio. »
Le 22 juin 2017, Cristal union mettait en ligne un communiqué de presse sur son site. Pas un mot sur Quentin, qui était mort la veille. Le but était d’afficher « une forte rentabilité et une excellente situation financière ». Le groupe propriétaire des marques Daddy et Erstein enregistrait un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros sur les 16 derniers mois.
À deux doigts d’un nouvel accident mortel
« La lenteur de la justice n’est pas sans rapport avec la puissance économique qui se trouve face à nous, estime Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims. On a le sentiment que Cristanol et Cristal Union, dans la région, c’est un État dans l’État. Pas touche à l’empire du sucre, en quelque sorte. » Avec son « Centre d’Excellence de Biotechnologies » et autres « start-ups vertes », le site industriel lié à la bioraffinerie de Bazancourt emploie en tout 1200 personnes, dont plus de 500 directement chez Cristal union. L’entreprise y produit chaque année plus de 600 000 tonnes de sucre, ainsi que 3,5 millions d’hectolitres de bio-éthanol.
L’avocat Emmanuel Ludot travaille sur un troisième accident qui a eu lieu sur le site de Bazancourt, et qui a bien failli coûter la vie à Jérémie Devaux. L’homme, cette fois, n’est pas cordiste, mais plombier. Il procédait le 3 juin 2015 à un dépannage d’urgence dans un malaxeur de l’usine. L’opération commence vers 5h30. À 13h30, soit juste après la relève de l’équipe du matin, des particules fines inflammables entrent en contact avec les flammes de son chalumeau. La cuve dans laquelle il se trouve s’enflamme, et « une explosion de poussières » se produit, selon le rapport d’expertise. Brûlé au troisième degré, le trentenaire est héliporté au centre de traitement des grands brûlés de l’hôpital de Metz. Plongé en coma artificiel, il subira de larges greffes de peau. Trois semaines d’hôpital, des mois pour redevenir autonome.
Comment des particules fines ont-elles pu entrer dans le malaxeur ? Maître Ludot met en cause « un gros problème de communication dans cette entreprise. Lorsque le technicien de jour remplace celui de nuit, il n’est pas informé qu’une intervention a lieu dans le conduit. Il rouvre les trappes. » Les trappes, encore et toujours... S’appuyant sur l’enquête de l’inspection du travail, le parquet a décidé de renvoyer directement l’affaire devant le tribunal. Un procès est annoncé pour septembre.
Franck Dépretz
>
Publié le 03/07/2018
Essor des énergies renouvelables : coopératives et citoyens semblent plus efficaces que les logiques de marchés
par Rachel Knaebel (site bastamag.net)
Où en est la France dans le développement de ses énergies renouvelables ? La loi adoptée en 2015, censée donner l’impulsion, fixe un objectif de 40% dans la production d’électricité d’ici 2030. Nous en sommes encore loin ! Seulement 20% de l’électricité hexagonale est actuellement issue des « renouvelables ». D’autres pays européens font pourtant bien mieux, grâce à des politiques volontaristes ou à l’encouragement d’une plus forte participation citoyenne, via des coopératives notamment. Ce modèle est pourtant mis à mal par l’idéologie du marché.
« Make our planet great again » : du slogan présidentiel à la réalité, il reste encore un monde. Car la France reste à la traîne dans la mise en œuvre d’une véritable transition énergétique. À ce jour, seulement 16% de la production énergétique française provient des énergies renouvelables, une proportion qui monte à 20 % en ce qui concerne l’électricité [1]. Les quelques mesures annoncées ce 29 juin en faveur du photovoltaïque ne suffiront pas à rattraper l’immense écart qui se creuse avec nos voisins européens.
La moyenne européenne est bien au-dessus, à 30 % d’énergies renouvelables. Dans le détail, la France n’est que le quatrième pays d’Europe en matière d’éoliennes (plus de 10 000 mégawatts de puissance installée), derrière l’Allemagne (44 000 MW), l’Espagne (23 000 MW), et la Grande Bretagne (13 000 MW). En matière d’électricité photovoltaïque, la France arrive aussi quatrième du continent [2]. En Allemagne, plus de 36 % de l’électricité consommée en 2017 provenait des énergies renouvelables, un taux qui dépasse les 50% au Danemark, le champion européen de l’énergie éolienne qui vise le 100 % renouvelable pour l’électricité en 2035. Le Portugal, quant à lui, vient d’atteindre les 66 % d’électricité issue des renouvelables. En Autriche, ce taux atteignait les 70 % dès 2013, notamment grâce à l’hydroélectrique.
L’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) relevait pourtant il y a plusieurs années qu’une fourniture électrique composée à 80 % ou 100 % d’énergies renouvelables était envisageable à l’horizon 2050 pour la métropole française, y compris en cas de conditions météorologiques défavorables. Pourquoi la France est-elle à la traîne ? « Il y a des pays où les choses vont plus vite, c’est certain. Mais en France le développement des renouvelables, en particulier de l’éolien, a l’avantage d’être constant dans la durée, observe Paul Neau, membre de l’association Négawatt et gérant d’un bureau d’études dédié aux énergies renouvelables. En Espagne, en Pologne, leur développement a été rapide, mais suivi d’un arrêt presque complet. » Il a suffi que les politiques de soutien aux renouvelables soient modifiées pour que leur développement cesse brusquement.
En France, un soutien public en recul au profit du marché
En France, comme dans de nombreux pays européens, les installations d’énergies renouvelables ont longtemps été soutenues par les pouvoirs publics, essentiellement par le biais de tarifs d’achat de l’électricité produite, garantis sur dix à vingt ans [3]. En avril dernier, la Cour des comptes a vertement critiqué le coût de ce soutien : « En France, la somme des dépenses publiques de soutien aux énergies renouvelables est estimée pour 2016 à 5,3 milliards d’euros. » Une somme jugée trop importante au regard des résultats. « Le rapport de la Cour des comptes critique surtout les mécanismes de soutien au photovoltaïque de la période Sarkozy, durant laquelle les tarifs d’achat étaient très élevés, avec des engagements très longs de 15 à 20 ans, tempère Paul Neau. Et puis, le rapport mesure le surcoût des énergies renouvelables par rapport aux prix du kilowattheure sur le marché, alors que l’Europe est en surproduction. S’il y avait moins d’électricité nucléaire en France, ce prix serait bien plus élevé. Les installations nucléaires sont déjà amorties, et leur démantèlement n’est pas pris en compte dans le calcul du coût de l’électricité. »
Ce n’est pas le seul grief de l’expert vis-à-vis du rapport : « Le raisonnement de la Cour des comptes est, de surcroît, purement économique. Il ne prend en compte ni les territoires, ni l’indépendance énergétique de la France. Les énergies renouvelables, c’est de l’argent injecté dans les territoires, pas en Ukraine ou ailleurs en achetant du gaz. Leur raisonnement considère les énergies renouvelables comme de simples kilowattheures, équivalents à ceux issus du charbon ou du nucléaire. »
Mais c’est bien cette logique qui est de plus en plus suivie. Depuis 2016, les plus grandes installations d’électricité renouvelable (au dessus de 500 kWh de puissance installée) ne bénéficient plus en France du système des tarifs d’achat garantis. Tous les projets au dessus de ce seuil doivent dorénavant se faire par le biais d’appels d’offre concurrentiels. C’est la Commission de régulation de l’énergie qui émet les appels d’offre. Ensuite, l’électricité produite par les installations n’est plus vendue comme auparavant à EDF, à un tarif fixe pendant dix ou vingt ans, mais cédée sur le marché de gros de l’électricité. Le producteur bénéficie toujours d’un prix garanti, mais seulement par le biais d’une prime dont le montant est variable, en fonction des écarts avec le prix du marché.
Des aides en demi-teinte pour les projets participatifs
Privilégier la logique de marché à celle du soutien public, c’est la ligne préconisée aujourd’hui par l’Union européenne, même pour les énergies renouvelables. « Historiquement, le développement des énergies renouvelables en France s’est fait grâce aux directives européennes, rappelle Paul Neau. Désormais, la manière d’aborder le sujet est très néolibérale. La logique est d’abord comptable. On privilégie le moins-disant, le kilowattheure le moins cher possible. Alors qu’on pourrait avoir des approches de valorisation territoriale, de valorisation des projets participatifs », regrette-t-il.
La France a toutefois mis en place en 2016, pour la première fois, un « bonus participatif » pour le nouveaux projets d’installations d’énergies renouvelables. Les projets qui associent les citoyens ou les collectivités locales à leur financement reçoivent ainsi un avantage financier. C’est le signe d’une reconnaissance progressive de la famille des projets participatifs », se réjouit Justine Peullemeulle, coordinatrice de l’association Énergie partagée, qui promeut les projets énergétiques citoyens. Elle juge cependant les règles d’attribution peu contraignantes : le projet doit être financé à 40 % ou plus par au moins 20 investisseurs différents, personnes physiques habitant dans les environs ou collectivités locales. Ces investisseurs participatifs doivent s’engager sur au moins trois ans.
« Au bout de trois ans, les porteurs privés du projet peuvent le reprendre en main intégralement, développe Justine Peulleumeulle. Et ce bonus ne fait pas la différence entre un simple financement participatif, qui peut être un recueil de fond type crowdfunding, et un véritable investissement participatif, qui implique une participation à la gouvernance du projet. » En résumé, le « bonus » n’est pas un soutien pensé pour promouvoir spécifiquement les coopératives de production énergétique, dans lesquelles les citoyens seraient les plus engagés, à l’exemple de ce parc éolien citoyen dans le Morbihan.
En Allemagne, 1000 coopératives citoyennes face à une libéralisation en cours
Pourtant, coopératives et projets citoyens peuvent jouer un rôle moteur dans la transition énergétique. L’Allemagne, où plus d’un tiers de l’électricité produite en 2017 vient des énergies renouvelables, compte près d’un millier de coopératives citoyennes, qui regroupent 200 000 coopérateurs [4]. Néanmoins, ce modèle est lui aussi mis à mal par la nouvelle orientation plus « concurrentielle » prise par l’Allemagne dans le développement des énergies renouvelables. Outre-Rhin, la première loi de soutien aux énergies renouvelables (Erneuerbaren energien gesetz, EEG) date de 2000. C’est elle qui a mis en place les tarifs d’achat garantis de l’électricité issue du solaire, de l’éolien, ou de la biomasse. Ce principe a favorisé le développement des énergies alternatives. L’énergie éolienne y compte aujourd’hui pour plus de 13 % de l’électricité consommée, contre seulement 0,01 % en 1990. Le photovoltaïque représentait 0,001 % de la production électrique en 1992, 6,5 % en 2015.
Le tarif d’achat garanti par la loi a d’abord été régulièrement baissé depuis 2000. Puis, en 2016, le gouvernement allemand a amendé ces mécanismes en vue de mettre la loi EEG en accord avec les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne concernant les installations les plus importantes. Aujourd’hui, toutes les installations éoliennes, et toutes les installations photovoltaïque conséquentes – plus de 750 kWh de puissance installée – se font sur appels d’offres concurrentiels, qui aboutissent généralement à des décisions prises selon le principe du moins-disant. Un avantage pour les grosses entreprises, au détriment des petites coopératives.
Au Danemark, des installations éoliennes obligatoirement « participatives »
L’exemple le plus intéressant serait-il à rechercher du côté du Danemark ? Dans le royaume scandinave, les coopératives citoyennes font aussi partie intégrante du modèle de transition vers une électricité sans charbon et sans nucléaire. Déjà en 1996, le pays comptait plus de 2000 coopératives citoyennes d’énergies renouvelables. Une loi adoptée en 2008 oblige même à ouvrir au moins 20 % des parts des installations éoliennes en priorité aux citoyens habitant à moins de 4,5 kilomètres des turbines. Au Danemark, une subvention à l’investissement dans l’éolien a été mise en place au tout début des années 80, en même temps qu’une véritable politique de planification de l’approvisionnement énergétique prenant en compte dès cette époque les possibilités offertes par les énergies renouvelables [5]. En 2016, plus de 40 % de l’électricité produite dans le pays provenait déjà de l’éolien, essentiellement en mer. L’objectif danois est d’atteindre 100 % d’électricité renouvelables d’ici 2035.
En Suède, 65 % de l’électricité consommée vient des renouvelables. Un système de certificats attribués en soutien aux producteurs d’énergies renouvelables existe depuis quinze ans. En 2009, le gouvernement suédois a aussi lancé un programme de subvention aux installations photovoltaïques, encore peu développées dans le pays. L’actuel budget prévoit plus de 320 millions d’euros d’aides à la filière pour la période 2017-2020 (3,34 milliards de couronnes suédoise) [6].
Au Portugal, une austérité fatale pour la transition ?
Au Portugal, où c’est également le vent qui porte la transition énergétique, la première loi soutenant les producteurs d’énergies renouvelables date d’il y a trente ans. Elle ne s’appliquait alors qu’aux installations hydroélectriques de petite taille, avant d’être étendue aux autres sources renouvelables, dont l’éolien. Ce soutien s’est poursuivi jusqu’à la crise du début des années 2010, qui a touché le Portugal comme les autres pays sud-européens. En pleine cure d’austérité imposée alors par la « Troïka » (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international), le Portugal a coupé net dans les aides au développement des renouvelables. « Depuis 2012, il n’existe plus aucun soutien », affirme aujourd’hui à Basta ! l’Association portugaise des énergies renouvelables (Apren).
Cet abandon du soutien public pourrait freiner à terme la transition portugaise. D’autant que la principale compagnie du pays, l’ancien entreprise publique EDP – qui détient un cinquième de la puissance totale d’électricité renouvelable installée au Portugal – est aujourd’hui détenue par une kyrielle d’investisseurs en tous genres. C’est la compagnie chinoise China Three gorges (active principalement dans les immenses barrages hydroélectriques chinois) qui en est l’actionnaire principale, avec 21 % du capital. À ses côtés, le fonds d’investissements états-unien BlackRock, ou encore un fonds d’investissement qatari. Il est peu probable que ces acteurs financiers soient les mieux placés pour porter la transition énergétique portugaise.
Rachel Knaebel
Publié le 02/07/2018
Energie : l’échec annoncé de dix ans de dérégulation
par Alexis Moreau (site bastamag.net)
La promesse est toujours la même. En brisant les monopoles publics au profit d’un marché concurrentiel, la dérégulation permettrait de faire chuter les prix et d’améliorer la qualité pour les usagers, devenus des « clients ». L’argument est de nouveau ressorti par le gouvernement dans le cadre de la réforme ferroviaire, dont l’examen au Sénat a commencé le 23 mai. Et si on jugeait sur pièces ? Basta ! fait le bilan de deux décennies françaises d’ouverture à la concurrence, en visualisant ses effets sur les tarifs, sur l’emploi, ou encore sur les investissements. Troisième et dernier volet : le secteur de l’énergie, libéralisé en 2007.
C’est peu dire que le fiasco était attendu. Il suffit de parcourir, aujourd’hui, les articles consacrés il y a onze ans à la dérégulation des marchés de l’énergie, pour mesurer le scepticisme qui règne déjà à cette époque. Rappelons en deux mots de quoi il s’agit : le gouvernement français s’est alors engagé à libéraliser entièrement le marché de l’électricité et du gaz à partir du 1er juillet 2007, afin de respecter une série de directives européennes, dont la plus ancienne remonte à 1996. A partir de cette date, deux tarifs doivent cohabiter pour les consommateurs : d’abord les tarifs réglementés, fixés par le gouvernement et proposés uniquement par EDF (électricité) et GDF (gaz). Ensuite les tarifs de marché, proposés par tous les fournisseurs.
L’objectif affiché est, comme toujours, de permettre une baisse de prix grâce au libre jeu de la concurrence et à la disparition des monopoles publics. « Notre seule volonté dans cette affaire est de répondre aux besoins des consommateurs français, tant pour la sécurisation de l’énergie que pour les tarifs les plus bas », lance à l’époque Thierry Breton, ministre de l’Économie, afin de clouer le bec aux détracteurs de l’ouverture à la concurrence et de la privatisation de GDF. « L’ouverture ménagée du marché se traduira par une baisse des prix au bénéfice des consommateurs domestiques comme des industriels », promettait déjà le gouvernement d’Alain Juppé dix ans plus tôt.
Une dérégulation qui vient de loin
Les sceptiques sont pourtant nombreux, depuis les syndicats jusqu’aux associations de consommateurs en passant par des responsables politiques, de gauche comme de droite. En juin 2007, un article de Basta ! résumait leurs craintes, et relevait la virulence inhabituelle de l’UFC-Que choisir, traditionnellement plus favorable à la libre concurrence. Même Les Échos, journal peu connu pour son antilibéralisme, émettait de sérieux doutes : « Dans tous les pays européens où les marchés ont déjà été ouverts à la concurrence, les prix de l’électricité et du gaz ont paradoxalement augmenté, parfois même sensiblement. La conséquence, d’abord, de l’explosion du baril de pétrole, sur lequel sont indexés les tarifs du gaz. La conséquence, aussi, de la faiblesse des nouveaux entrants sur le marché, qui n’ont pas les moyens de production nécessaires pour imposer une véritable concurrence. »
Mais les critiques ne font pas reculer le gouvernement. Il faut dire que la libéralisation du secteur de l’énergie, loin d’être une lubie isolée, s’inscrit dans un mouvement plus vaste de dérégulation néolibérale (télécoms, réseau postal, transports), initié dès les années 80 par le duo Reagan-Thatcher puis entériné par la législation européenne. Onze ans plus tard, le bilan n’est guère brillant. La dérégulation n’a pas fait baisser les prix, contrairement aux promesses initiales. Entre 2007 et 2017, la facture moyenne d’un client chauffé à l’électrique a par exemple augmenté d’environ 36%.
Un marché peu propice à la concurrence
Les raisons expliquant ces augmentations sont complexes : évolutions du cours du pétrole – sur lequel est en partie indexé celui du gaz –, investissements de plus en plus lourds afin de prolonger la durée de vie du parc nucléaire, ou encore recherche de marges élevées par les fournisseurs. Une chose est sûre, le fonctionnement même du marché de l’énergie rend peu réaliste les promesses des apôtres de la libre-concurrence. Les factures de gaz et d’électricité intègrent principalement trois postes de dépense : le coût de fourniture de l’énergie (coût de production, frais de personnel, marketing...), son coût d’acheminement, et les taxes. S’ils veulent faire baisser leurs tarifs, les opérateurs privés ne peuvent jouer ni sur les taxes, fixées par l’État, ni sur la distribution, puisque les réseaux d’acheminement du gaz et de l’électricité n’ont pas été ouverts à la concurrence – il est inutile de dédoubler un réseau de distribution.
Reste donc la possibilité de jouer sur les coûts de fourniture. Ce qui n’est pas une mince affaire. Dans l’électricité, aucun acteur privé n’a réellement les moyens de venir concurrencer EDF et ses 58 réacteurs nucléaires. L’électricité se transportant mal et se stockant difficilement, leur possibilité d’en importer de l’étranger est limitée. Les nouveaux arrivants en sont donc réduits à acheter une bonne partie de leur électricité auprès de l’opérateur historique, EDF, à un tarif qu’ils jugent – évidemment – toujours trop élevé.
Des économies limitées pour les utilisateurs
« Dans le secteur du gaz, les choses sont différentes, relève Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie à l’UFC-Que choisir. Le gaz se transporte mieux, et les opérateurs privés peuvent donc faire jouer la concurrence entre différents fournisseurs dans le monde, par exemple en Norvège ou au Maghreb, afin de proposer des tarifs plus concurrentiels. Mais dans l’ensemble, les marges de manœuvre restent limitées. On ne verra probablement jamais d’acteurs dynamiter les prix, comme dans les télécoms ! » L’écart de tarifs entre fournisseurs historiques et fournisseurs « alternatifs » ne dépasse pas 10% en moyenne, ce qui explique en partie le peu d’empressement des clients à quitter les opérateurs traditionnels. Fin 2017, dix ans après la dérégulation, EDF dominait encore 85% du marché résidentiel pour l’électricité, Engie près de 75% pour le gaz.
A cette date, l’offre d’électricité la plus compétitive s’élevait à 415 euros par an – pour un client en tarif « base » – soit 39 euros de moins qu’EDF. C’est à dire une économie mensuelle de l’ordre de 3,25 euros par mois (9% de moins). S’il se chauffe au gaz, un client pourra économiser, dans le meilleur des cas, 7,75 euros par mois en passant sur le secteur dérégulé (1101 euros par an contre 1194 euros s’il reste chez Engie), soit 8% de moins [1].
La privatisation n’a pas non plus rendu les anciens monopoles publics plus vertueux en matière environnementale. En 2015, la part des énergies renouvelables ne pesait qu’un petit 4 % dans les capacités de production d’Engie [2], loin derrière le charbon (15%) et le gaz (53%).
« Une course aux dividendes, au détriment de l’investissement »
Mais le bilan de l’ouverture à la concurrence ne saurait se limiter aux évolutions de tarifs. Les opérateurs historiques ont été sommés de se transformer pour répondre aux demandes du marché. En dépit des promesses solennelles de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Économie en 2004, GDF a été privatisé trois ans plus tard, après un intense débat. Les syndicalistes n’ont cessé de dénoncer depuis la financiarisation de l’entreprise – devenue Engie en 2015 – qui a profondément bouleversé sa culture et ses pratiques.
Coordinateur central du groupe pour la CGT, Eric Butazzoni a suivi le processus de près : « Les gouvernements ont imposé la transformation des opérateurs historiques en sociétés anonymes, en prétextant que c’était la seule manière de rester compétitif face à la concurrence du privé. A GDF, cela s’est traduit par des plans d’austérité et une course aux dividendes, au détriment de l’investissement. Pour permettre au groupe de distribuer d’énormes dividendes, ses filiales sont ponctionnées au-delà du raisonnable. Cette année, en puisant dans ses réserves, GRDF remonte un milliard d’euros de cash à la maison mère, alors qu’elle affiche seulement 150 millions de résultat ! Alors qu’elle n’a plus assez d’effectifs pour mener à bien toutes ses interventions chez les clients. »
Les documents de référence de l’industriel confirment la financiarisation à marche forcée du groupe. Sur la période 2008-2017, l’investissement global a diminué et GDF a distribué trois fois plus de dividendes qu’elle n’a réalisé de bénéfices ! Les syndicats estiment que l’opérateur a dû recourir à l’endettement tout en puisant dans ses réserve. Et pointent, en bout de chaîne, l’avidité de l’État : avec 24% des actions, il est le premier actionnaire du groupe. « Les gouvernements successifs ont de plus en plus tendance à considérer les ex-fleurons publics comme des vache à lait, se désole un observateur. Et à exiger encore plus de « cash » que les actionnaires privés. »
Alexis Moreau
Publié le 01/07/2018
Gaziers et électriciens : l’autre grève que personne ne regarde
Stéphane Ortega (site rapportdeforce.fr)
Alors que depuis trois mois les yeux sont rivés sur la grève des cheminots et le nombre de trains en circulation, Enedis et GRDF sont touchés depuis plusieurs semaines par un mouvement de grève et d’occupation des gaziers et électriciens. À la veille de la journée de grève interprofessionnelle du 28 juin, date de mobilisation des salariés de l’énergie, 140 sites sont bloqués ou occupés dans un silence médiatique assourdissant.
Médiatiquement, c’est un mouvement coincé en région. Si l’ensemble des quotidiens de la presse régionale se font l’écho des occupations, des grèves et des coupures de courant, le sujet est quasiment absent de la presse nationale, des radios et des journaux télévisés. Silence radio, malgré une mobilisation prenant de l’ampleur.
Pourtant, la semaine dernière, la CGT Mines-Énergie à l’origine du mouvement annonçait 285 sites touchés par des grèves, dont 140 par des occupations. Les taux de grévistes données par les directions d’Enedis (ex-ERDF, filiale d’EDF) ou de GRDF (filiale d’Engie, ex-GDF) oscillaient nationalement entre 20 et 25 %. « C’est un mouvement avec des taux équivalents à ceux des grands conflits de 1995, 2004 ou 2009 », assure Loïc Delpech, le coordinateur des luttes de la fédération Mines-énergie de la CGT. Sur les sites mobilisés, les chiffres varient de 30 à 100 %, selon lui. Mardi 26 juin, date du dernier décompte effectué par le syndicaliste, le mouvement reste important.
Une grève peut en cacher une autre
Si un train peut en cacher un autre, une grève, celle des cheminots, a masqué un mouvement prenant de l’ampleur, semaine après semaine, chez les gaziers et électriciens. Présents lors de la journée de grève de la fonction publique du 22 mars, les salariés des secteurs du gaz et de l’électricité ont été appelés dès le mois d’avril par la CGT à un mouvement de défense du service public de l’énergie. La convergence avec les cheminots et les étudiants est à l’ordre du jour. Après un démarrage timide en avril, des actions communes avec les cheminots en mai, le conflit s’ancre à Marseille juste avant le mois de juin.
« Le mouvement s’est transformé en blocage, et s’est inscrit dans la durée », explique Loïc Delpech. Plusieurs sites sont occupés dans les Bouches-du-Rhône. Depuis, la mobilisation fait tâche d’huile site après site, touchant l’ensemble du territoire. Ici, il s’agit d’une grève journalière d’une heure, là d’un blocage du site : charge aux assemblées générales locales de déterminer les formes d’actions les plus appropriées. Parallèlement, les coupures ciblées se multiplient, visant des entreprises, des administrations, et même l’Élysée, privé de gaz pendant trois heures le 21 juin. Une façon de déclarer le cœur de l’exécutif en « précarité énergétique » après la décision de l’État de céder ses dernières parts du capital d’Engie. Les particuliers ne sont pas oubliés avec des passages en heure creuse ou le rétablissement de l’énergie pour les foyers en difficultés financières.
À l’Élysée : pas de dialogue, pas de gaz
Les revendications des gaziers et électriciens se concentrent sur la préservation d’un service public de l’énergie qui réponde aux besoins des usagers. « Ces dix dernières années, les filiales d’Engie et d’EDF ont fait remonter des milliards d’euros aux actionnaires », affirme Loïc Delpech. Pour défendre l’Intérêt général, la CGT Mines-énergie réclame une renationalisation des entreprises du secteur, rappelant que les tarifs du gaz ont augmenté de 75 % en 10 ans de libéralisation. Afin de remplir correctement leurs missions, les grévistes réclament aussi le comblement des départs et une augmentation de leurs rémunérations.
Malgré des demandes de rencontre à l’Élysée, à Matignon et auprès du ministère de tutelle, la CGT n’a pas été reçue par l’exécutif. À l’inverse, les directions d’Enedis et de GRDF ont engagé des discussions, sans parvenir à aucun accord. Sur le statut des entreprises, logiquement, les directions renvoient le sujet vers l’État, muet pour l’heure. Sur les salaires, par contre, elles renvoient vers des négociations de branche, pendant que la question des effectifs patine faute de proposition correspondant aux revendications. Le mouvement est donc appelé à se poursuivre, malgré des négociations site par site sur les demandes locales. « Nous pouvons obtenir le changement de matériel défectueux réclamé depuis des mois par les agents pour pouvoir travailler, mais sur l’essentiel, nous faisons face à une fin de non-recevoir », se désole Loïc Delpech. Du coup, le conflit se durcit.
Signe d’un mouvement prenant de l’ampleur, une intersyndicale composée en plus de CGT, de la CFDT, de FO et de la CGC s’est rassemblée mardi 26 juin, devant le siège d’Engie à La Défense. Elle a protesté contre la décision de l’État de céder ses parts du capital de l’entreprise. Un rassemblement suivi le même jour d’une réunion des fédérations de l’énergie. De leur côté, les grévistes entendent poursuivre la mobilisation. Ils ont déjà reconduit la grève cette semaine et la suivante sur plusieurs sites. L’été ne devrait pas calmer l’ardeur des gaziers et électriciens qui ont à leur disposition un préavis de grève courant au moins jusqu’au 30 août, pour se faire entendre. Et peut-être briser le silence médiatique.