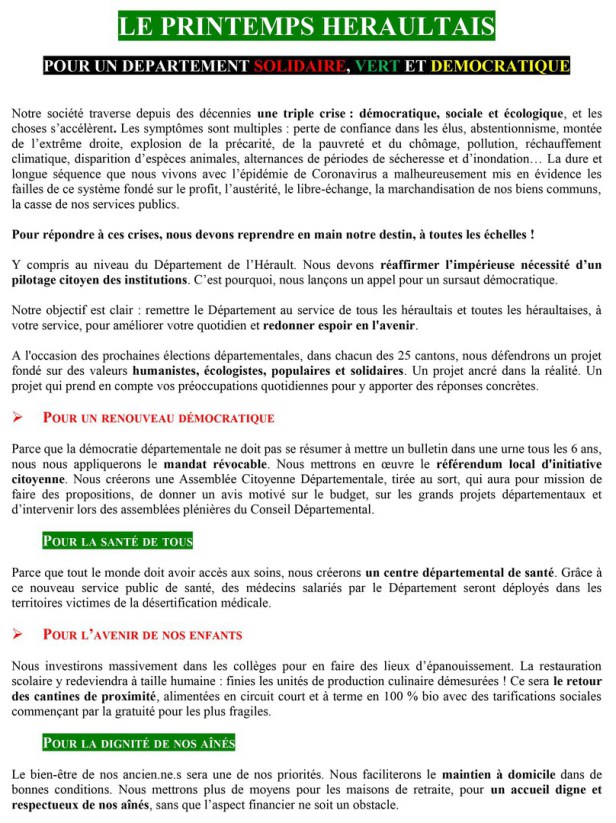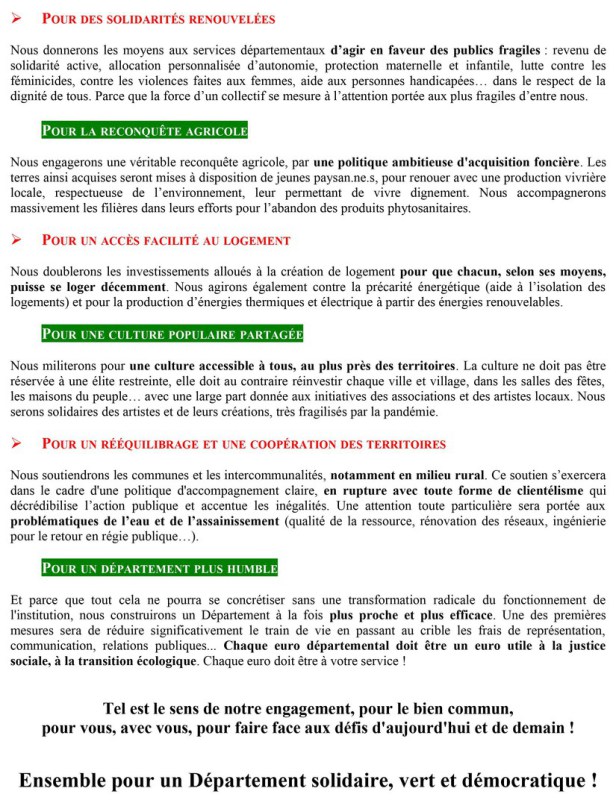Publié le 26/02/2021
Macron au G7: une faute morale et une aberration en santé publique
Communiqué de presse de l'Observatoire de la Transparence dans les politiques du Médicament (OTMEDs) paru sur blogs.mediapart.fr
Le droit à la santé est un principe qui doit être universel et effectif, et nous avons besoin pour cela de politiques ambitieuses. En refusant les réformes politiques, économiques et industrielles, et en privilégiant le caritatif, Emmanuel Macron empêche toute réponse mondiale à la pandémie.
Le président de la République a proposé aux pays riches de donner de 3 à 5 % des doses de vaccins aux pays les plus pauvres. L'accès aux vaccins est aujourd'hui entravé par l'insuffisance de la production mondiale des multinationales, par les barrières de propriété intellectuelle, par une chaine privée et opaque des produits pharmaceutiques qui répond aux besoins des actionnaires, et non à l'intérêt général des populations.
C'est donc tout un système qu'il faut changer, mais le président de la République Emmanuel Macron refuse de le faire. Depuis le 2 octobre 2020, la France s'oppose encore à une proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud à l'Organisation Mondiale du Commerce, qui demande à ce que les droits de propriété intellectuelle soient levés sur les technologies développées contre le COVID, comme les vaccins, les tests et les candidats traitements.
Les ONG estiment que fin 2021, 9 personnes sur 10 en Afrique n'auront pas été vaccinées. Comme l'a rappelé le 9 décembre la coalition d’ONGs People’s Vaccine Alliance, la totalité des doses du vaccin Moderna et 96 % de celles de Pfizer BioNTech ont été acquises par les pays riches. Dans ce contexte, la proposition d'Emmanuel Macron est en même temps ridicule et indécente.
Cette proposition est une faute morale. La défense du droit à la santé par un des dirigeants des pays riches ne peut pas passer par de la charité. Le droit à la santé est un principe qui doit être universel et effectif, et nous avons besoin pour cela de politiques ambitieuses. C'est aussi l'éthique qui est piétinée. Nombre des essais cliniques sur les candidats vaccins sont pratiqués sur le continent africain, qui remplit donc sa part d'effort pour la recherche en exposant une partie de sa population aux risques inhérents à des essais sans pouvoir ensuite faire bénéficier l'ensemble des pays.
Cette proposition est aussi une aberration en terme de santé publique. En refusant les réformes politiques, économiques et industrielles, Emmanuel Macron empêche toute réponse mondiale à la pandémie. Cette menace est globale, elle ne peut être jugulée que si l’ensemble de la population mondiale peut avoir accès aux vaccins - et ce en espérant qu’ils stoppent la transmission et donc qu’ils soient efficaces au niveau populationnel, y compris contre les différents variants. En l'oubliant ou en l'ignorant, Emmanuel Macron ne piétine pas seulement le droit à la santé et l'éthique. Il fait preuve d'un manque de pragmatisme aberrant qui va permettre à la pandémie de se maintenir.
Si jusqu'ici les multinationales ont été incapables de produire les vaccins dont nous avons besoin, alors que leur développement ont été en grande partie financé par de l'argent public, alors les pays en développement doivent pouvoir produire eux-mêmes les vaccins dont ils ont besoin pour répondre à la pandémie.
Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron déclarait : « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. »
Le président de la République doit tenir sa promesse. La France doit maintenant soutenir de tout son poids les propositions des pays en développement à l'OMC demandant de lever les droits de propriété intellectuelle sur les technologies développées contre le COVID-19.
Publié le 26/02/2021
L’impasse de la libéralisation du marché de l’électricité et du projet Hercule
Résumé vu sur www.atterres.org le lundi 22 février 2021
Les gouvernements français ont mené depuis 20 ans une politique d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie, obéissant aux injonctions de la Commission européenne. Le démantèlement d‘EDF et la privatisation d’une partie de ses activités, prévus dans le cadre du projet Hercule, constitueraient le point d’orgue de cette politique néolibérale dans le secteur de l’électricité, si ce projet est adopté par le Parlement.
Or, l’électricité est un secteur appelé à jouer un rôle stratégique pour la transition énergétique, qui ne peut être gouverné par les lois du marché et de la rentabilité financière.
Cette note montre que le bilan de deux décennies de libéralisation du marché de l’électricité est négatif, en France comme à l’étranger, car cette politique a conduit à un alourdissement de la facture des usagers et à un déficit d’investissement, au moment où des investissements massifs sont requis pour décarboner notre économie.
Les auteurs de la note plaident pour la reconstruction d’un service public de l’énergie, piloté par l’Etat et des collectivités locales, sous contrôle des citoyens et des citoyennes. Les choix sur les systèmes énergétiques du futur et leur régulation, ne doivent plus être le résultat de négociations obscures entre Paris et Bruxelles. Ils doivent faire l’objet d’un débat démocratique.
Pour lire l'intégralité de la note rédigée par Anne Debrégeas (ingénieure de recherche à EDF) et Dominique Plihon (membre des Economistes atterrés), le PDF est en ligne
Publié le 23/02/2021
Election présidentielle : rien n’est inéluctable !
Par Thomas Portes sur www.regards.fr
Alors que le service public sert sur un plateau en argent la parole de Marine Le Pen et de Gérald Darmanin, Thomas Portes, porte-parole de Génération.s, appelle à « attaquer l’extrême droite, frontalement, ne pas lui laisser un pouce de terrain » afin de « rallumer les étoiles de l’espoir ».
« Vous dites que l’islam n’est même pas un problème […], je vous trouve un peu molle Madame Le Pen ». Voilà les mots que tout le monde a retenu du débat, enfin plutôt de l’échange, entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, organisé par le service public audiovisuel jeudi soir.
Avec ce concours Lépine de celui qui se montre le plus raciste envers les musulmans et l’islam, Darmanin a réussi le tour de force de faire ce que la présidente du RN consacre toute son énergie à gommer de son image depuis des années : se « diaboliser ».
Dans ce flot de rhétorique guerrière à l’encontre d’une religion, le mot islamisme fut d’ailleurs utilisé plus de 70 fois, les deux camps « amis » poursuivait pourtant un autre objectif : celui d’installer durablement ce duel comme seule alternative possible en 2022.
Darmanin ne s’en est d’ailleurs pas caché, se payant même le luxe d’interpeller la présidente du RN pour lui dire de mieux réviser en prévision du prochain débat, comprendre celui du second tour de 2022.
Et la gauche dans tout ça ?
Parfois si brillante, elle peut se montrer tout aussi désespérante. Alors que nous sommes lancés dans une course contre la montre avant un scrutin présidentiel qui pourrait nous mener au pire, voilà que les forces de gauche sont plus que jamais divisées, se desservant les brevets de respectabilité pour voir laquelle d’entre elle incarne le mieux « La République ».
Mais pour réparer une République divisée, nous devons créer des horizons communs capables de transcender le peuple. Ce qui vient de se passer avec la ville de Trappes, où la faschosphère, bien soutenue pas une partie de la droite, à livrer en pâture un maire et ses habitants témoigne du climat inquiétant qui règne dans le pays. Aucun territoire n’est épargné. À Montauban, c’est la très droitière Brigitte Barèges qui a organisé une manifestation, en présence de Robert Ménard, pour dénoncer une décision de justice actant son inéligibilité pour détournement de fonds. Nous rions de Trump, mais nous sommes sur les prémisses d’une trumpisation de notre société.
Pourquoi la gauche est-elle si « molle », pour reprendre un mot à la mode, face à l’extrême droite ? Qui se souvient encore de la dernière charge publique réelle contre Marine Le Pen ? Au-delà des tweets de bon ton, il ne faut pas avoir peur de le dire, trop souvent la lutte contre l’extrême droite n’est plus la première priorité des organisations politiques ou même syndicales.
C’est dans ce silence que la bête se nourrit et prospère. Trop souvent au sein de la gauche et les écologistes on pense l’accession au pouvoir de ce parti comme impossible. L’histoire nous enseigne pourtant l’inverse, l’actualité aussi.
Regardons autour de nous. Les amis de la famille Le Pen sont aux affaires dans plusieurs pays européens, et ils y restent. Camarades, il faut attaquer l’extrême droite, frontalement, ne pas lui laisser un pouce de terrain. Face à cette urgence, nous devons déployer notre énergie toute entière pour lutter et déconstruire leurs discours !
Non, la possible victoire de Marine Le Pen n’est pas une vue de l’esprit mais un scénario crédible. Et cela ne se résume pas aux sondages, certes inquiétants, mais bien à la détresse d’une population frappée par une crise économique et prête à se jeter dans les bras du RN pour se sentir protéger, considérer. Je partage l’analyse de Cécile Duflot. En braquant le regard médiatique sur la question de l’islam, on passe sous silence ce qui ravage notre pays. Nous avons toutes et tous été frappés par ces centaines d’étudiants faisant la queue pour se nourrir. Dans un pays déjà fracturé par les inégalités, la crise sociale que nous traversons va agir comme un incubateur poussant des millions de personnes dans une paupérisation terrible. Nous avons besoin de mener sur le terrain social un combat sans relâche, pour montrer que oui face à des patrons voyous ou des entreprises qui gavent leurs actionnaires de dividendes alors qu’elles sacrifient des milliers d’emplois, nous pouvons agir. Rien n’est inéluctable. L’État peut imposer d’autres choix. Un certain dirigeant disait « là où il y volonté, il y a chemin ».
Comment faire ?
Un sondage récent indique que huit Français sur dix rejettent le duel annoncé entre Macron et Le Pen pour la prochaine présidentielle. Rien n’est perdu, et l’espoir doit nous animer. Ce qui doit nous occuper dans les semaines à venir, c’est construire un projet de société qui offre des horizons nouveaux. Sortir de l’incantation pour proposer des solutions concrètes. Dans chaque territoire appuyons-nous sur les femmes et les hommes engagés, qui sont des architectes indispensables de ce monde nouveau dont nous avons tant besoin.
Ma génération ne veut pas être celle qui sera sacrifiée par une gauche incapable de se rassembler. Le fatalisme ambiant qui règne est mortifère, et déroule un tapis rouge à l’extrême droite comme aux forces de l’argent. La gravité de la situation n’est plus à démontrer. Collectivement, réveillons-nous, agissons, mettons en mouvement toutes les forces de gauche et écologistes, mais aussi toutes les expertises associatives, syndicales et citoyennes qui sont la richesse de notre démocratie.
C’est à ce prix, celui du collectif au service de la radicalité écologique et de la lutte contre les inégalités sociales, que nous pourrons rallumer les étoiles de l’espoir.
Publié le 20/02/2021
Qui doit payer la dette Covid ?
Les riches et les multinationales sont les profiteurs de la crise : à eux de payer la dette Covid ! Dans une note récente, Attac livre une approche nouvelle de la dette et propose l’instauration d’une Contribution au remboursement de la dette Covid (CRDC) pour une justice fiscale et sociale.
Le gouvernement a nommé une commission sur « l’avenir des finances publiques », présidée par Jean Arthuis, ancien ministre des finances de Jacques Chirac. Son mandat est de faire des propositions sur la façon de rembourser la dette Covid, sans augmenter les impôts, grâce à « une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques » et des « réformes structurelles ». Pour Attac, le mandat donné à cette commission indique clairement une volonté d’en rester aux politiques néolibérales, fondées sur l’austérité budgétaire, dont les effets dévastateurs sur le système de santé et sur les inégalités sont apparus clairement à l’occasion de la crise sanitaire et sociale causée par la pandémie.
Pour Attac, il existe des politiques alternatives face à la dette Covid, utilisant de manière complémentaire les leviers monétaire et fiscal pour développer les politiques publiques nécessaires à notre avenir.
La baisse des taux d’intérêt orchestrée par la Banque centrale européenne (BCE) a permis de rendre soutenable à court terme la dette publique. Mais pour Attac, l’objectif doit être de réduire l’emprise des marchés financiers sur les politiques publiques, et en second lieu de proposer de mobiliser la politique fiscale en instaurant une « contribution pour le remboursement de la dette Covid » (CRDC). Cette dette est estimée à 234,8 milliards d’euros sur l’année 2020.
Dans cette note, Attac livre une approche nouvelle de la dette et propose l’instauration d’une Contribution au remboursement de la dette Covid (CRDC) pour une justice fiscale et sociale.
Pour Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac : « La dette-Covid ne doit pas être instrumentalisée pour renouer avec les politiques néolibérales et l’austérité budgétaire dont la crise sanitaire a démontré les effets tragiques sur les inégalités, sur l’hôpital public et notre système de santé. Il existe des politiques alternatives face à la dette-Covid, utilisant les leviers monétaire et fiscal, pour développer les politiques publiques nécessaires à notre avenir ».
Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac, s’indigne : « Tandis qu’un million de français sous tombés sous le seuil de pauvreté depuis le début de la crise du Covid, les milliardaires français ont déjà retrouvé leur niveau de fortune d’avant la crise. Il serait inacceptable que ce soient aux "Premiers de corvée" de rembourser la dette Covid, alors que celle-ci a été creusée par des aides massives accordées aux grandes entreprises multinationales sans contrepartie sociale, fiscale et écologique. Cela a favorisé une explosion des inégalités en faveur des actionnaires. C’est aux profiteurs de la crise de payer la dette Covid ! ».
Selon Dominique Plihon, co-rédacteur de la note : « Actuellement le coût de la dette publique diminue, même si la dette augmente, car l’État s’endette à des taux d’intérêt négatifs à la suite de la politique monétaire menée par la banque centrale. Pour Attac, l’objectif est de réduire l’emprise des marchés financiers sur les politiques publiques »
Reprendre le contrôle de la dette publique passe par (i) un audit citoyen sur la dette, (ii) une restructuration et une annulation partielle de la dette détenue par la BCE en fonction d’objectifs écologiques, (iii) le financement monétaire des dépenses publiques prioritaires, et (iv) la réduction de la dette détenue par les créanciers étrangers.
Pour Vincent Drezet, co-rédacteur de la note : « Il est également urgent de mobiliser la politique fiscale face à la crise. Nous proposons que soit instaurée une « contribution pour le remboursement de la dette-Covid » (CRDC), qui répond à l’objectif prioritaire de justice fiscale, et sera payée par les grandes entreprises et les ménages les plus riches. »
Contrairement à l’injuste CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) que le gouvernement souhaite prolonger, la CRDC aurait une double caractéristique : (i) elle sera acquittée par les ménages et les entreprises ; (ii) elle exemptera les pauvres, les classes moyennes et les PME qui ont payé un lourd tribut aux politiques de rigueur budgétaire et salariale depuis la crise de 2007-2008.
Au-delà de la CRDC, dont l’objet est spécifique (payer la dette Covid), une réforme globale de notre système fiscal s’impose pour restaurer la justice fiscale et financer les politiques publiques dont la crise sanitaire a montré le rôle stratégique.
Pour accéder à la note : https://france.attac.org/IMG/pdf/note-dette-covid-v3-pajapaj.pdf
Publié le 19/02/2021
L’action sociale doit-elle devenir un service marchand ?
Tribune rédigée par des agents du Conseil Départemental de l’Essonne
publiée sur www.lien-social.com
Cela fait des années que les professionnels de l'action sociale sont soumis aux diktats technocratiques de directions hors-sol. Pourtant, ils sont au plus près de ce que vivent les populations précarisées, connaissant leurs besoins et leurs attentes. Mais, rien n'y fait. Leur expertise est négligée et méprisée, comme le montre ce cri de colère des travailleurs sociaux de l'Essonne.
Nous, travailleurs sociaux du Conseil départemental de l’Essonne nous sommes pris, comme tant d’autres, entre les injonctions de notre hiérarchie et la réalité des personnes que nous recevons de plus en plus nombreuses dans nos services, au quotidien. Nous ne pouvons plus faire face à la charge toujours croissante de travail. La réponse de notre Direction du développement social se résume à : « tu ne t'en sors pas ? Tu dois être mal organisé ! ». Et donc, les réorganisations se succèdent à marche forcée.
Dernièrement, la Direction a envisagé de mettre en place des rendez-vous « accueil » de trente minutes. Se serait-elle inspirée des services commerciaux d’Orange ou de Darty ? C’est la question que l’on peut se poser ! Cette innovation a été imaginée par des personnes qui ont tout fait, sauf justement du social ! Les usagers vont devoir contacter une plateforme à Evry, en dépit de tout souci de proximité, pour une pré évaluation de la demande et une éventuelle transmission au service social local. Puis, ils auront un rendez-vous d’à peine trente minutes avec un travailleur social, pour « faire connaissance », afin d’obtenir ensuite un nouveau rendez-vous pour engager la relation, traiter la demande et éventuellement envisager un accompagnement... Quelle simplification ! Après avoir passé dix minutes à expliquer aux usagers comment l’accueil fonctionne, il ne restera plus que vingt minutes… Avec cette réorganisation, toute la dimension humaine inhérente à la relation d'aide est effacée. En fait, elle n'existe plus. L’usager n’est plus qu’un dossier, un numéro, une statistique. Prendre en compte la personne, ce qui fait sens pour elle, son individualité, son parcours, dans une société de plus en plus complexe, écouter la détresse, engager une réflexion commune... est menacé. Notre travail ne consiste pas à être rentable ou « efficace »... L’efficacité du service social ne se mesure pas au nombre d’aides financières demandées ou de processus suivis à la lettre. Autant, il est facile de parler d’une facture d’électricité, autant il est difficile de dévoiler son intimité à quelqu’un qu'on ne connaît pas. Dévoiler son intimité demande une relation de confiance qui s'y prête ... de percevoir que son interlocuteur est disponible et à l'écoute... Cet accompagnement demande du temps, du temps pour analyser, du temps pour que la personne se l’approprie aussi. Ce temps n'est pas rationalisable comme notre hiérarchie le souhaiterait ... Il est indispensable que les professionnels gardent la maîtrise de leur agenda.
Tous les logiciels à compléter, les nombreux tableaux à remplir, dans l’objectif de mesurer et quantifier notre activité, mobilisent un temps important pour les professionnels, au détriment de la relation aux usagers. Désormais, avec cette nouvelle réorganisation, ce sont les entretiens et la relation humaine qu’il faudra mesurer et toujours plus quantifier, comme un service marchand. Nous, les professionnels du social, savons bien que cette vision de rentabilité et de satisfaction du client est complétement inadaptée. Notre métier c'est un métier d'aide à la personne...avec toute la complexité que revêt l'accompagnement d'un être humain. Cette énième réorganisation censée mieux répondre aux besoins des usagers, est finalement déclencheuse d’une inadaptation majeure du service au but qui lui est donné.
Mieux répondre aux personnes nécessiterait en fait, non pas une réorganisation de l'accueil, mais juste la volonté de mettre plus de moyens humains et de remplacer au moins l’ensemble des postes administratifs et sociaux découverts à ce jour et de laisser le personnel social faire son travail !
Publié le 16/02/2021
Comment qualifier la politique économique
d’Emmanuel Macron ?
Par Pierre Jacquemain sur www.regards.fr
Avec le plan de relance et les milliers d’euros injectés dans l’économie française à coup de « quoi qu’il en coûte », Emmanuel Macron aurait-il changé de doctrine économique ?
« Les électeurs de gauche ont encore plus de raisons de se retrouver aujourd’hui dans l’action d’Emmanuel Macron qu’en 2017 », a plaidé Gabriel Attal dans Le Monde. Ainsi donc le porte-parole du gouvernement s’efforce de vanter la politique sociale, juste et redistributrice du gouvernement, en prenant le soin, toujours, d’insister sur la question sanitaire : « Le Ségur de la santé, représente un investissement historique de 15 milliards d’euros, avec une revalorisation de 200 euros par mois pour tous les soignants ». À ces arguments, il ajoute les milliards d’euros investis dans notre économie, « pour sauver les entreprises et les emplois ». Pour le ministre, on est loin des politiques de rigueur budgétaire, des verrous de Berçy et de la sacro-sainte règle d’or des 3% fixée par les traités européens. La majorité présidentielle le martèle. Les médias aussi. Jamais un pays n’a autant fait pour sauver son économie – même si l’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait beaucoup plus pour aider les ménages et les entreprises, selon Alternative économiques.
Force est de constater que le gouvernement a retrouvé les marges de manœuvre qui lui manquaient il y a de ça quelques mois encore : « Il n’y a pas d’argent magique », avait répondu Emmanuel Macron à une infirmière en avril 2018, alors que les soignants tiraient la sonnette d’alarme sur la situation des hôpitaux. Aujourd’hui, on dépense sans compter à coup de « quoi qu’il en coûte » et on se demande à quelle doctrine économique cette formule se réfère. Emmanuel Macron se serait-il découvert des sensibilités keynésiennes au cours de la crise sanitaire ? Peut-on parler d’une politique de la relance ? Pour comprendre, il faut d’abord s’intéresser à la manière dont se réparti l’argent public. Depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a mené une politique en faveur des entreprises et des actifs privés. Selon l’économiste Gilles Raveaud, « la politique d’Emmanuel Macron est une politique pro-business, c’est-à-dire une politique de l’offre et la crise sanitaire n’y a rien changé. Il poursuit même intensément dans cette voix ».
Peut-on pour autant qualifier la politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement de libérale, comme l’en accuse la gauche ? Pour l’économiste, c’est un piège : « À gauche, il faut arrêter d’utiliser ce mot : libéral. La droite et avec elle Macron ne sont pas dans le camp de la liberté. La liberté appartient à la gauche. La liberté, c’est nos services publics. Macron et ses amis de droite veulent tout privatiser. En privatisant notre santé et nos services publics, ils nous privent de nos libertés ». Alors quand il s’agit de qualifier la politique économique du gouvernement, Gilles Raveaud le reconnait volontiers : « Nous avons un problème de vocabulaire. Macron fait de notre État, un État prédateur. En ce sens il mène une politique néolibérale qui utilise la puissance de l’État au service d’intérêts privés. Et c’est d’ailleurs de cette manière que le plan de relance, qui aurait pu être une opportunité pour augmenter les minimas sociaux et créer un RSA jeune, va être utilisé : pour les intérêts de quelques-uns. »
Etat prédateur
Même constat du côté de l’eurodéputée et économiste Aurore Lalucq qui évoque très spontanément un « État prédateur » sous le quinquennat d’Emmanuel Macron. Elle argumente : « Ceux qui nous gouvernent nous ont fait croire qu’ils étaient des libéraux alors qu’en réalité on n’a pas eu de réductions de l’intervention de l’État. On a même un État qui s’est endetté. Ça veut dire qu’on utilisait des éléments de langage de type libéral – il faut être plus compétitif ou encore il faut moins d’État, etc. – et en même temps ceux qui utilisaient ces éléments de langage demandaient des interventions de l’État pour soutenir les entreprises. C’est ce que l’on fait aujourd’hui. Nous avons un État qui, en plus, vient aider massivement les entreprises, sans contraintes - là où on en met aux plus fragiles, comme les chômeurs. Nous ne sommes pas dans une perspective libérale mais nous avons un État qui se met au service des plus puissants ».
Pourtant, la France a comme la plupart des pays du monde, fait le choix de confiner ses populations en mettant à l’arrêt l’appareil productif et l’activité économique. Emmanuel Macron a même assuré vouloir faire passer les enjeux sanitaires avant les questions économiques. D’où le « quoi qu’il en coûte ». La gauche aurait-elle dit mieux ? Fait mieux ? Différemment ? Pour l’économiste Eloi Laurent, le débat est mal posé. « Le critère n’est pas le coût. Quand on fait une politique, la question c’est : quelle boussole on prend ? Mon analyse de la situation de la réponse française, c’est que contrairement à ce que raconte le gouvernement, on a systématiquement privilégié l’économie. Ce qu’il y a de compliqué à comprendre c’est que parce qu’on a fait ce choix [du quoi qu’il en coûte] on a, à la fois le désastre sanitaire et le désastre économique ». Il se justifie : « Lors de la deuxième vague, les infections repartaient très fortement dès la fin août et les premières mesures ne sont prises qu’à la mi-octobre et se durcissent fin octobre. Pourquoi ? Pour donner priorité à la reprise de l’économie. Il y a une catastrophe économique parce qu’on a laissé les choses se dégrader plutôt que de prendre des mesures graduelles et de mener une politique sanitaire fine. Ça nous a conduit aux politiques drastiques de confinement qui ont tué l’économie. »
… et à la fin, c’est le capitalisme qui gagne
Pour Eloi Laurent, c’est le double déshonneur avec une double catastrophe sanitaire et économique. Et le « quoi qu’il en coûte » réduit à une formule de communication. Parce qu’en réalité, le président Macron n’avait pas le choix. C’est, du moins, ce que pense l’économiste Robert Boyer : « Le virus a déstabilisé toute la politique économique et il mène par le bout du nez toutes les politiques ». Boyer, qui vient de publier Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie aux Éditions de La Découverte, considère que « l’État apparaît comme assureur du risque systémique ». Pour lui, « on ne vit pas le retour du keynésianisme. L’État n’est qu’un assureur. Une fois qu’on aura réglé la pandémie, on va revenir aux stratégies antérieures. On ne vit pas le regain du système de planification à la française : nous sommes dans une parenthèse avant de continuer les réformes structurelles annoncées ». Et le gouvernement nous y prépare déjà : « Le "quoi qu’il en coûte" doit cesser en 2021 », a déclaré le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, en janvier dernier. La ministre du Travail Elisabeth Borne veut remettre à l’ordre du jour la réforme de l’assurance chômage. Bruno Le Maire quant à lui assure que les Français devront travailler plus et plus longtemps – la réforme des retraites en perspective. Sans parler de la dette du Covid que les Français devront naturellement payer. Nous voilà revenu à la case départ et il n’y a plus qu’à attendre que le ruissellement ruisselle…
Finalement, la question est moins de savoir quelle politique économique le président de la République conduit-il mais pour qui conduit-il cette politique économique ? Et selon un rapport Oxfam de janvier dernier, la réponse est sans appel : « Les plus pauvres sont aujourd’hui les grands perdants du quinquennat d’Emmanuel Macron. Alors que le plan de relance devrait être l’occasion de construire un monde plus juste et plus durable, il n’en est rien. En France, moins de 1% du plan de relance est dédié à la lutte contre la pauvreté, tandis que des milliards d’euros ont été versés aux entreprises sans aucune contrepartie contraignante ». Dans le même temps, un million de personnes parmi lesquels les femmes, les jeunes et les travailleurs précaires, seraient tombées dans la pauvreté en France en 2020 selon les associations caritatives. Celui qu’on surnommait le président des riches, dès 2017, n’a donc jamais aussi bien porté son nom qu’en cette fin de quinquennat. Et Robert Boyer en est certain : c’est bien le capitalisme qui va sortir renforcé de la crise sanitaire.
Publié le 16/02/2021
Une idée pour les prochaines élections départementales !
A l'origine il y a Pierre Polard, conseiller départemental et maire de Capestang, ayant porté aux dernières législatives une candidature de rassemblement soutenue par le PC, Ensemble !, la FI et le POI.
Avec des membres de ces mêmes horizons, unis par la même vision de la nécessité de rassembler, au-delà des partis, toutes celles et ceux qui luttent pour un projet d'émancipation sociale, démocratique et écologique, ils appellent à faire vivre ce Printemps Héraultais...
Publié le 12/02/2021
DENIS Sieffert presse la gauche de débattre sereinement des «questions qui fâchent»
Par Laurent Mauduit sur www.mediapart.fr
L’éditorialiste et ancien directeur de Politis dresse un état des lieux préoccupant des forces progressistes. Une analyse lucide qui invite à regarder en face les faiblesses ou dérives que la gauche doit surmonter si elle veut se refonder.
C’est peu dire que pour les citoyens dont les convictions sont ancrées à gauche, les temps présents sont particulièrement désespérants. Alors que la planète brûle et que la transition écologique devrait être accélérée de toute urgence ; alors que le pays traverse une crise économique et sociale majeure, sous les effets conjugués de la politique inégalitaire d’Emmanuel Macron et de la pandémie ; alors que les thématiques privilégiées de l’extrême droite, celles du racisme ou de l’islamophobie, sont constamment au cœur du débat public, la gauche semble en voie de disparition au moment où on aurait plus que jamais besoin d’elle.
Voilà le paradoxe qui constitue le prologue de l’essai revigorant de l’éditorialiste de Politis, Denis Sieffert, qui en fut aussi longtemps le directeur de la publication, sous le titre « Gauche : les questions qui fâchent… et quelques raisons d’espérer » (Éditions Les petits matins, 232 pages, 16 €). « On est frappé, écrit-il, par le grand paradoxe de l’époque. La gauche disparaîtrait au moment où elle n’a peut-être jamais été aussi indispensable. Une gauche évidemment transformée, capable de faire face au péril climatique que la pandémie de Covid-19 a rendu encore plus présent et plus immédiat. Si l’on osait s’approprier la célèbre alternative “socialisme ou barbarie” posée après-guerre par Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, on placerait l’avenir sous le signe d’une nouvelle opposition : “écologie sociale ou barbarie”. »
Le premier parti pris de l’essai, c’est donc celui de la lucidité : comme les temps que nous vivons sont incertains et dangereux, l’auteur invite à bien identifier les raisons pour lesquelles nous sommes encore loin de disposer de cette « gauche transformée » dont il parle – cette gauche rassembleuse, réinventée, généreuse, sans exclusive ni anathème, qui seule serait capable de déjouer les pièges de la prochaine élection présidentielle, et de faire en sorte qu’elle ne soit pas biaisée, comme le fut celle de 2017.
Pour ce faire, Denis Sieffert presse donc de faire avec lui un état des lieux apaisé mais sans concessions des gauches actuelles, de leurs forces et de leurs faiblesses. Et c’est dans cet esprit qu’il demande aussi – faute de quoi l’état des lieux serait incomplet – que l’on réfléchisse à quelques « questions qui fâchent » – lesquelles déclencheront sûrement ici ou là de violents coups de gueule, mais qui sont indispensables si l’on veut sortir de l’ornière actuelle.
Pour réaliser cet état des lieux, Denis Sieffert, qui tout au long de son livre fait des va-et-vient entre l’histoire et nos actualités, dresse donc d’abord le long inventaire des petits reniements ou des grandes trahisons des socialistes, ceux de la SFIO jusqu’à ceux du PS. Du vote des crédits de guerre en 1914 jusqu’au désespérant quinquennat de François Hollande, en passant par le vote des pleins pouvoirs à Pétain, l’abominable naufrage pendant la guerre d’Algérie, il arpente cette histoire longue d’un parti qui a fini par rallier les valeurs du camp d’en face.
Et s’il s’y attarde, c’est parce que cette clarification est décisive pour l’avenir. « Avant toute chose, il nous faudra dire ce que nous entendons par “gauche”, chasser les usurpateurs et défendre la pertinence d’une notion qui a encore du sens pour des millions d’hommes et de femmes », dit-il, avant d’ajouter un peu plus loin : « L’agonie de la social-démocratie s’est accélérée au cours de ces dernières années, au point que l’on peut considérer que les principaux dirigeants de ce mouvement ont cessé d’appartenir à la gauche. Après Manuel Valls, Emmanuel Macron apparaît comme un personnage pivot : celui qui passe d’une gauche ultra-droitière à une droite franche sinon assumée. »
Mais il est d’autres clarifications encore plus utiles, car si nul ne contestera que François Hollande a porté le coup de grâce à la social-démocratie ou que Manuel Valls fait partie des « usurpateurs » ciblés par l’auteur, il est d’autres questions qui ne font pas forcément consensus et qu’il nous faut regarder en face. Au titre de ces « questions qui fâchent », il y a d’abord la question de la République, ou plus précisément une certaine « abstraction républicaine » qui fait des « ravages » dans certains cénacles de gauche.
Dénonçant ceux qui s’appliquent à construire un « roman national », l’auteur leur fait grief de défendre de la sorte une forme d’universalisme qui est très pernicieux car il insère notre histoire dans un récit univoque et trompeur. « Ce que l’on a coutume d’appeler “universalisme” n’est qu’une vision, majoritaire sans doute et culturellement dominante, mais qui ne peut plus être exclusive. Colbert ne peut plus être seulement le précurseur de l’industrialisation et le père de l’administration : il est désormais aussi l’auteur du sinistre Code noir, qui généralise l’esclavage et encourage les mutilations des fuyards trop épris de liberté. De même, Jules Ferry et Paul Bert, glorieux fondateurs de l’école laïque, gratuite et obligatoire, sont désormais identifiés pour ce qu’ils ont été aussi : de fieffés colonialistes auteurs de propos racistes que les connaissances de l’époque ne pouvaient déjà plus excuser », relève-t-il ainsi.
Pour expliquer encore plus nettement les choses, Denis Sieffert dit même de cet universalisme qu’il a été longtemps « l’alibi de l’impérialisme français et de toutes ses aventures coloniales ». Mais un alibi fallacieux car – l’auteur abonde dans le sens de l’historien Olivier Le Cour Grandmaison –, la République française n’a en fait « jamais été véritablement universelle ». Et surtout pas, précise Sieffert, « celle qui a revendiqué le plus bruyamment ce principe, la IIIe République, qui a réduit les colonisés au rang de sujets, les privant de libertés et de droits élémentaires et les traitant en êtres inférieurs dans un code de l’indigénat ».
Cette première « question qui fâche » met donc en cause une certaine gauche républicaniste. D’abord, celle des républicains bon teint, style Jean-Pierre Chevènement hier, ou Arnaud Montebourg aujourd’hui, toujours disposés à tendre la main au camp d’en face, et qui affichent des convictions en réalité non pas socialistes mais nationalistes ou souverainistes.
Mais la critique va au-delà. L’auteur relève que Jean-Luc Mélenchon a parfois joué de l’ambiguïté sur la question. « Maître de l’ambivalence, écrit-il, Jean-Luc Mélenchon cultive lui aussi […] cet ethnocentrisme patriotique tout en manifestant dans la rue – ce qui est à son honneur – aux côtés des antiracistes fustigés par Élisabeth Badinter. »
Parmi les autres questions qui fâchent, et qui peuvent diviser la gauche, il y a aussi, sans surprise, la laïcité. À l’encontre de ceux qui la manipulent, l’auteur rappelle qu’il s’agit d’abord plus d’une « histoire de compromis que de dogmes en bataille ». Soulignant que Jaurès, en son temps, a joué un rôle majeur dans le triomphe de cet esprit de compromis, il ajoute : « La laïcité, la vraie, doit demeurer un principe social, et non l’instrument d’un discours culturel et sociétal que les pouvoirs ressortent chaque fois qu’ils veulent détourner l’opinion de la question sociale ou stigmatiser les victimes du racisme plutôt que de combattre le racisme. »
Autre débat majeur au sein de la gauche, celui qui porte sur la question démocratique. C’est à ce propos que Denis Sieffert lance les interpellations les plus fortes, puisqu’elles concernent Jean-Luc Mélenchon, la figure centrale de la gauche aujourd’hui. De lui, l’auteur parle souvent avec estime, mais aussi avec lucidité. « En dix ans d’action politique hors du Parti socialiste, résume-t-il, Jean-Luc Mélenchon a autant enchanté la gauche qu’il l’a désespérée. »
Denis Sieffert pointe ainsi une « meurtrière ambiguïté », celle qui a conduit le chef file de La France insoumise à ne pas se prononcer entre Macron et Le Pen, à la veille du second tour de l’élection présidentielle de 2017. « Mélenchon, écrit-il, aurait dû se souvenir de l’enseignement de Trotski – dont il fut pourtant un adepte –, qui écrivait en 1932, avec l’intention avouée de “susciter l’effroi sincère ou l’indignation feinte des imbéciles et des charlatans”, que, “dans la lutte contre le fascisme”, il faut être prêt “à conclure des accords pratiques militants avec le diable, avec sa grand-mère et même avec Noske et Zörgiebel” », les deux dirigeants sociaux-démocrates qui avaient réprimé l’insurrection allemande de 1919, assassinant Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg.
Relevant que « ce jeu dangereux trahit la relation conflictuelle que Mélenchon entretient avec la question démocratique », Sieffert apporte à l’appui de ses dires de très nombreuses illustrations. Il pointe la « tentation hégémonique » du leader de La France insoumise qui peut se laisser aller à manier l’insulte ou l’anathème contre certains de ses alliés ou même certains de ses propres camarades, un jour contre le communiste Pierre Laurent (« Vous êtes la mort et le néant »), le lendemain contre sa propre liste LFI à des élections en Corse ou en Guyane. Il pointe encore l’absence de démocratie interne au sein de La France insoumise, qui ne connaît ni courants ni élections. Jean-Luc Mélenchon, observe-t-il, ne « s’embarrasse pas à fabriquer des unanimités puisqu’il n’y a tout simplement pas de vote. Il ne simule pas la démocratie, il la rejette ouvertement ».
Plus sévère encore, Denis Sieffert relève « le faible » de Mélenchon « pour les hommes forts ». « Comment ne pas s’interroger, écrit l’auteur, sur la fascination pour Vladimir Poutine, lui-même soutien de Bachar al-Assad, massacreur de centaines de milliers de Syriens, sur sa défense de leaders sud-américains qui n’ont pas brillé pour leur sentiment démocratique et même sur ses faiblesses pour Donald Trump, pourvu que celui-ci bataille contre “l’État profond” » ? Très bon connaisseur du Moyen-Orient, auquel il a consacré de nombreux ouvrages, l’auteur s’attarde tout particulièrement sur la question syrienne et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet, qu’il juge en connaissance de cause avec une grande sévérité.
Sans doute Jean-Luc Mélenchon prendra-t-il en très mauvaise part ces interpellations. Elles retiennent pourtant d’autant plus l’attention qu’elles viennent du responsable d’un journal qui l’a souvent accompagné. Dans les années 1990, Jean-Luc Mélenchon avait en effet fait de Politis sa petite grotte afghane et y tenait régulièrement sa chronique. Alors qu’il était au fond du trou, en 2006, le même journal lui avait même rendu un service insigne en croyant en ses chances pour la prochaine présidentielle – il était bien le seul ! – et en en faisant cette « manchette » : « Et si c’était lui ? ».
Tout l’intérêt des « questions qui fâchent », soulevées par Denis Sieffert, n’est pas, quoi qu’il en soit, de ressasser de vieilles querelles. Elles visent à identifier les problèmes que la gauche devra surmonter, si elle veut un jour se refonder et dessiner un autre avenir.
« Inventivité ouvrière » et « réformisme révolutionnaire »
Dans cette perspective – et c’est l’autre intérêt de l’essai –, l’auteur sème aussi au fil des pages des petits cailloux qui finissent par tracer un chemin possible pour l’avenir. Prenant ses distances avec les deux grandes révolutions qui ont longtemps constitué la mythologie de la gauche française ou de certains de ses courants – la révolution de 1789, et la révolution d’Octobre –, l’auteur invite plutôt à se replonger dans l’atmosphère de la révolution de 1848 ou de la Commune de Paris – dans le premier cas à cause de la vitalité démocratique, dans le second à cause de « l’inventivité ouvrière ».
De la révolution et de sa mythologie, qui a si fortement pesé sur l’histoire de la gauche française, Denis Sieffert dit d’ailleurs se défier. Il préfère un autre chemin, celui esquissé jadis par Jaurès, celui du « réformisme révolutionnaire ». « J’aime, dit-il, cet oxymore. Point de révolution violente dans cette stratégie, mais des réformes qui se révèlent rapidement incompatibles avec le capitalisme. Il est clair que l’écologie sociale est porteuse de ce réformisme-là. » Il y a donc un petit air de Paul Brousse, remis au goût du jour, dans ces lignes-là ; au détour d’une démonstration, l’auteur fait d’ailleurs lui-même référence au chef de file du possibilisme…
Reste pourtant une difficulté majeure : comment, concrètement, avancer dans cette direction ? En conclusion du livre, Denis Sieffert se prend à espérer que le bon sens l’emportera et que les deux pôles principaux de la gauche actuelle, celui de La France insoumise et celui d’Europe Écologie-Les Verts, finiront peut-être par s’entendre. Il pointe ainsi les appels multiples pour une candidature unique de la gauche mais il connaît trop bien les leçons du passé pour ignorer que « cette élection du président de la République au suffrage universel est pour la gauche une broyeuse d’espoir » car elle abaisse le débat collectif au sort d’un seul homme.
Alors, sans trop y croire, pour surmonter cet obstacle du présidentialisme qui fait des ravages au sein même de la gauche, Denis Sieffert recense les propositions qui sont évoquées ici où là, celle d’une candidature collective ; d’un « shadow » gouvernement à la britannique ; ou celle d’un ticket à l’américaine. « En septembre 2017 – trop tard hélas ! – Jean-Luc Mélenchon avait regretté de n’avoir pas pu présenter un ticket président/premier ministre avec Benoît Hamon », rappelle-t-il.
Quoi qu’en dise l’auteur, et même s’il souligne que « des personnalités de bonne volonté existent dans tous les courants », telle Clémentine Autain ou Manon Aubry, sa conclusion est plutôt pessimiste. Comme si la France devait être perpétuellement prisonnière de ces institutions très antidémocratiques et des rapports d’appareils.
Heureusement, il arrive pourtant, même quand l’histoire apparaît bloquée, que des basculements surviennent. C’est la note optimiste, la seule, qu’évoque en fait l’auteur : « Soyons attentifs à ce que Daniel Bensaïd appelait l’inouï. » Sans doute aurait-on aimé que l’auteur nous en dise un peu plus sur ce que « l’inouï » pourrait être. Sur le surgissement qu’il suggère, venant du mouvement de la société ou du mouvement social.
Mais enfin, il y a aussi, conclut Sieffert, « quelques raisons d’espérer ». On aimerait le croire.
Publié le 12/02/2021
LA MUNICIPALITE DE MONTPELLIER S'ATTAQUE AU DROIT DE GREVE !
10 février 2021 - Communiqué de presse
Fédération CGT des Services Publics et Union Départementale de l'Hérault
Publié le 10/02/2021
Palestine. La justice internationale va enquêter sur les crimes de guerre d’Israël
Par Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
La Cour pénale internationale s’est dite compétente, le 05 février 2021, pour instruire les affaires d’exactions commises dans les territoires occupés et pourra cibler la colonisation. La reconnaissance de la Palestine comme État non membre de l’ONU porte ses fruits.
Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), créée en 2002 pour juger les crimes les plus terribles commis sur la planète, avait prévenu : elle voulait se pencher sur ceux commis lors de la guerre de l’été 2014 menée par Israël contre Gaza. Une offensive terrible contre des populations prisonnières d’un territoire minuscule et fermé, comme nous avions alors pu le constater sur place comme envoyé spécial de l’Humanité en pleine période de ramadan.
Un mois de bombardements incessants, de destructions de quartiers habités par des civils. Des familles entières forcées de fuir leurs maisons comme Madjid Djindiya, sa femme et leurs cinq enfants, dont nous avions publié le témoignage le 24 juillet 2014 : « Nous habitions près de la frontière, racontait-il. Nous avons vu les chars se positionner mais ils n’avançaient pas. Soudain, ça a été pire qu’en 2008-2009. Les missiles ont commencé à tomber, sans arrêt, et s’écrasaient sur les maisons. Nous ne pouvions plus rester. Nous sommes partis pieds nus. Pour sortir de Chudjaiya, nous avons dû marcher sur les corps des morts. J’ai même vu le cadavre d’un enfant sans tête. »
Première enquête indépendante
Cette guerre a fait 2 251 morts côté palestinien – en majorité des civils – et 74 du côté israélien, essentiellement des soldats. Un rapport officiel israélien publié en juin 2015 affirme que les soldats n’ont « pas intentionnellement visé des civils ou des cibles civiles » pendant la guerre de 2014 et que leurs actions étaient « légitimes » et « légales ». La justice militaire israélienne a mené ses propres enquêtes sur les agissements des soldats israéliens pendant la guerre et avait annoncé en avril 2015 l’inculpation de trois d’entre eux pour pillage. Tel-Aviv a affirmé n’avoir pas besoin d’autres investigations.
Mais, jusqu’à présent, Israël n’a jamais été inquiété malgré les suspicions de crimes de guerre. Aucune enquête indépendante n’avait jamais réellement été diligentée, ni à Gaza ni en Cisjordanie. L’Autorité palestinienne (AP) avait bien saisi la Cour pénale internationale en 2009 après la guerre menée déjà contre la bande de Gaza. Mais elle avait été déboutée. Il lui aura fallu attendre 2012 sa reconnaissance en tant qu’État observateur de l’ONU pour adhérer, en 2015, à la CPI, malgré les menaces israéliennes et états-uniennes. L’AP saisit alors, en 2018, la Cour internationale pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité » commis sur son territoire.
La colère de Netanyahou
En dépit des pressions exercées par le gouvernement de Donald Trump notamment contre Fatou Bensouda, les juges de la chambre préliminaire ont enfin décidé vendredi que la compétence de la CPI « s’étend aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est ». Tout en prenant bien soin de préciser que cette cour « n’était pas constitutionnellement compétente pour statuer sur les questions de statut d’État qui lieraient la communauté internationale » et que « la chambre ne se prononce pas sur un différend frontalier en vertu du droit international ni ne préjuge de la question d’éventuelles futures frontières ».
Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a bien compris la portée d’une telle décision de la Cour pénale internationale. Celle-ci peut enquêter sur les crimes de guerre mais également sur la colonisation elle-même, le cœur du projet sioniste. « Quand la CPI enquête sur Israël pour de faux crimes de guerre, c’est purement et simplement de l’antisémitisme », affirme Netanyahou. En droite ligne de sa campagne visant à faire de toute critique contre Israël une parole antisémite. Ce faisant, il place de nombreux dirigeants européens dans une contradiction entre leur adhésion à la CPI (ce qui n’est pas le cas d’Israël ni des États-Unis) et leur acceptation de l’idée que derrière la critique de la politique israélienne se cacherait en réalité un antisémitisme débridé. L’Union européenne est d’ailleurs bien silencieuse depuis l’annonce de la CPI. Ce qui n’est pas le cas de Washington, qui s’est dit « sérieusement préoccupé par les tentatives de la CPI d’exercer une juridiction sur les militaires israéliens », a expliqué le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, de la nouvelle administration Biden.
Le fruit de plusieurs années de lutte
À l’inverse, le premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, s’est félicité de « cette décision (qui) est une victoire pour la justice et l’humanité, pour les valeurs de vérité, d’équité et de liberté, et pour le sang des victimes et de leurs familles ». Même le Hamas, qui pourrait pourtant être visé par les enquêtes de la CPI, a salué une « étape importante ». De son côté, Riyad Mansour, représentant permanent palestinien à l’ONU, fait remarquer que la décision de la CPI est le fruit d’années de combats sur la scène internationale. « Pendant longtemps, les gens étaient sceptiques quant à l’importance de ces efforts internationaux, mais, sans le fait que la Palestine devienne un État observateur non membre de l’ONU, qu’elle se qualifie pour le Statut de Rome et qu’elle rejoigne la CPI, nous n’aurions pas eu cette décision. » Dans ce cadre, la reconnaissance de la Palestine par la France ne peut être qu’un pas de plus pour le respect du droit international et de la justice.
Publié le 10/02/2021
Luxleaks, ou la preuve que l’évasion fiscale est une pratique systématique chez les plus riches
Par Pierric Marissal sur www.humanite.fr
37 des 50 plus riches familles françaises et 279 milliardaires du classement du magazine Forbes ont au moins une société offshore dans le Grand-Duché. C’est ce que révèle la vaste enquête OpenLux, dirigée par un consortium des journalistes d’investigation. Décryptage.
Paradoxalement, ce sont les efforts de transparence effectués par le Luxembourg pour se conformer à une directive de l’Union européenne (UE) passée en 2018 qui permettent de démontrer que ce petit État fondateur de l’UE mérite bien sa place dans le top 5 des pires paradis fiscaux. « Et ce, même s’il n’est toujours pas reconnu comme tel par la Commission européenne ni pas la France, se désole Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac. Cette hypocrisie est terrible, le Luxembourg n’est pas une île exotique, c’est un paradis fiscal de proximité, particulièrement nocif pour ses voisins, c’est-à-dire nous. »
Les chiffres publiés notamment par le Monde – et ce n’est que le début – sont éloquents. Il y a plus de 140 000 entités immatriculées dans le Grand-Duché – soit une pour quatre habitants –, et près de la moitié sont des sociétés offshore, dont la valeur cumulée attendrait 6 500 milliards d’euros… Ces structures sont propriétés de non-résidents et n’exercent aucune activité économique, elles ont pour unique but l’évasion fiscale par des moyens légaux.
La moitié des bénéficiaires des structures reste à identifier
Après un an à compulser les immenses bases de données progressivement rendues publiques, le consortium des journalistes d’investigation OCCRP, rassemblant 16 médias, n’a pas réussi à identifier la moitié des bénéficiaires de ces sociétés. Et nombre de ceux inscrits au registre du commerce ne sont que des prête-noms. C’est dire que le Luxembourg ne se presse pas plus que nécessaire sur son exigence de transparence… D’ailleurs, pour faire respecter cette obligation légale – déclarer les bénéficiaires et contrôler ces déclarations –, il n’y a que 59 salariés au registre du commerce, pour des dizaines de milliers de sociétés dont la moitié n’ont même pas un salarié et se contentent d’une simple boîte aux lettres. Ainsi un seul immeuble luxembourgeois se retrouve siège social de pas moins de 1 800 entreprises. Dans sa défense, le Grand-Duché se targue de près d’un millier d’employés au sein de la Commission de surveillance du secteur financier, mais ceux-ci sont en charge de la bonne marche de la place financière du pays, qui représente un quart de son économie.
Le profil des bénéficiaires identifiés de ces sociétés offshore reste assez divers : des grands sportifs comme Tiger Woods ou précédemment Cristiano Ronaldo, la chanteuse Shakira, le prince héritier d’Arabie saoudite, les mafias italiennes et russes, la Ligue du Nord (parti d’extrême droite italien), ainsi que des centaines de multinationales : JCDecaux, Decathlon, Hermès, LVMH, Kering, Yves Rocher, KFC, Amazon… « Cela confirme que l’évasion fiscale est un sport de riches, pointe Raphaël Pradeau, 37 des 50 plus grandes fortunes de France y ont un compte offshore, preuve que l’évasion fiscale est systématique. Et on ne parle là que du Luxembourg ! » Pas moins de 279 milliardaires présents dans le classement Forbes et 15 000 Français ont ainsi été identifiés comme bénéficiaires d’une société offshore dans le Grand-Duché. Elles abritent « des biens de grande valeur, ici un château francilien détenu par un prince saoudien, là un vignoble dans le Var appartenant à Angelina Jolie et Brad Pitt, et une liste sans fin de villas sur la Côte d’Azur et de cossus appartements parisiens », énumère le Monde.
Une harmonisation fiscale par le bas
Mais le Luxembourg se défend d’être un paradis fiscal et affirme dans un communiqué paru ce lundi qu’il « respecte pleinement toutes les réglementations européennes et internationales en matière de fiscalité et de transparence, et applique toutes les mesures communautaires et internationales en matière d’échange d’informations pour lutter contre les abus et l’évasion fiscale ». Au vu de la définition européenne des paradis fiscaux, ce n’est malheureusement pas faux. « Cela vient confirmer que la concurrence fiscale au sein de l’UE est organisée au vu et au su de tout le monde, regrette Raphaël Pradeau. L’harmonisation fiscale se fait par le bas, la France baisse chaque année son impôt sur les sociétés. » Attac souligne que ce sont ces propriétaires de sociétés offshore qui ont le plus bénéficié de la politique fiscale de ce gouvernement. « Et l’exécutif prépare déjà les esprits à l’idée qu’il va falloir se serrer la ceinture : réduire la dette, sabrer dans les services publics, taper sur les chômeurs et la protection sociale, sans faire payer leur juste part d’impôt aux plus riches ni aux multinationales », dénonce le porte-parole de l’association.
publié le 2 février 2021
Fabrègues, une bouffée d'oxygène de 6 mois
pour Souleymane Sow menacé d'expulsion
Par Clara Guichon sur www.francebleu.fr
Ce vendredi 29 janvier 2021, la Préfecture de l'Hérault a délivré une autorisation de séjour provisoire de 6 mois à Souleymane Sow. Alors qu'il venait de signer un CDI dans une boulangerie de Fabrègues, ce jeune Guinéen avait reçu une obligation de quitter le territoire (OQTF) avant la fin du mois.
La Préfecture de l'Hérault offre un sursis à Souleymane Sow : ce vendredi 29 janvier 2021, elle lui a délivré une autorisation de séjour provisoire de 6 mois. Deux semaines plus tôt, ce jeune Guinéen avait reçu une obligation de quitter le territoire (OQTF) avant la fin du mois, alors qu'il venait de signer un CDI dans la boulangerie Pain et Partage de Fabrègues (Hérault).
Ce samedi 30 janvier, les 150 personnes réunies devant la mairie de Fabrègues, en soutien à Souleymane Sow, partagent les mêmes sentiments : de la satisfaction, mais aussi beaucoup d'inquiétude. "Souleymane peut rester 6 mois de plus, mais dans des conditions compliquées", explique Géraldine Geffriaud. Cette orthophoniste est la "marraine de cœur" du jeune homme de 24 ans. Elle le suit depuis son arrivée en France, lui a donné des cours de français et l'a accompagné dans ses démarches administratives.
La Préfecture a fait ce geste pour que Souleymane Sow, qui souffre de problèmes de santé, puisse se soigner en France, avant de repartir en Guinée pour régulariser sa situation. C'est de là-bas, dit la Préfecture, qu'il pourra faire sa demande de Visa, qui lui permettrait de travailler en France. "Pour lui, c'est une vraie source d'inquiétude, car il se demande s'il pourra revenir en France après", poursuit Géraldine Geffriaud.
"Je ne comprends pas la décision de la Préfecture, lâche Souleymane Sow. Pourquoi ne veut-elle pas me régulariser? J'ai trouvé un travail en France, j'ai appris la langue, je m'intègre à la société. Je n'ai fait que des choses bien! La Préfecture dit que c'est parce que je suis arrivé en France illégalement. Mais je n'avais pas le choix !"