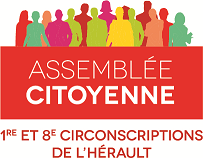juin 2025
mise en ligne le 30 juin 2025
Loi Duplomb :
les agriculteurs sont
les premiers malades
des pesticides
sur https://lareleveetlapeste.fr/
Alors que la loi Duplomd doit être examinée en Commission mixte paritaire à partir de ce lundi 30 juin, la Ligue contre le Cancer dénonce « un recul majeur pour la santé publique ». Et notamment pour celle des agriculteurs, premières victimes de l’exposition aux pesticides.
Des manifestations ont eu lieu tout le weekend contre la loi Duplomb : en Anjou, paysan-es et habitant-es ont bloqué un site de production de pesticides. A Paris, environ un millier de personnes se sont réunies à l’appel du Collectif Nourrir, et 10 000 sur l’ensemble du week-end dans 60 villes, à la veille de l’examen du texte en commission mixte paritaire.
A huis clos, sept députés et sept sénateurs se réunissent, ce lundi 30 juin en début d’après-midi au Sénat, pour trancher sur la proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », et prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire de certains néonicotinoïdes. Or, une large majorité d’élus (dix contre quatre) sont favorables au texte.
Si elle était adoptée, cette loi serait « un recul majeur pour la santé publique » selon la Ligue contre le Cancer. L’association a demandé le retrait des articles réautorisant un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l’acétamipride, particulièrement toxique pour la biodiversité, mais aussi les agriculteurs, fleuristes et riverains des zones d’épandage.
En effet, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) « établit depuis 2013 un lien entre l’exposition aux pesticides et certains cancers, lien reconfirmé en 2021 ». La présomption d’un lien est « forte » pour « les lymphomes non hodgkiniens (cancers du système lymphatique), le myélome multiple (cancers du sang), les cancers de la prostate ainsi que les cancers de l’enfant suite à une exposition pendant la grossesse », « moyenne » pour les leucémies.
Michel est un ancien technicien agricole qui a survécu à un lymphome, reconnu maladie professionnelle. « J’ai employé du glyphosate, des désherbants avec du petit matériel mais sans les protections parce qu’au début, nous n’avions pas conscience du tout que ce soit dangereux à ce point-là. »
En France, depuis le milieu des années 2000, la cohorte AGRIculture & CANcer (AGRICAN) a permis de valider les effets d’expositions professionnelles agricoles – incluant les pesticides – sur les cancers de la prostate, de la vessie, du côlon et du rectum, du système nerveux central, des ovaires ainsi que pour les myélomes multiples ou les sarcomes.
« Cette loi sacrifie le principe de précaution, qui devrait commander à toute décision en matière de santé publique, sur l’autel du court-termisme », affirme Francelyne Marano, toxicologue et présidente du comité de pilotage cancer et environnement de la Ligue, citée par le communiqué. « Nous risquons de payer un jour ou l’autre les surcoûts liés aux futurs cancers », estime-t-elle.
« L’impact des facteurs environnementaux sur la santé fait d’ailleurs l’objet d’inquiétudes légitimes de plus en plus grandes, comme en témoigne la suspicion, en mars dernier, de nouveaux clusters de cancers pédiatriques autour de La Rochelle » note la Ligue.
En mai 2025, la ligue contre le Cancer dévoilait dans une étude un nombre de cancers pédiatriques anormalement élevés sur plusieurs territoires de Charente-Maritime. En cause : l’utilisation intensive des pesticides, notamment pour la viticulture.
Le réseau France Eau publique, qui regroupe 123 collectivités et opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement, a mis en garde les quatorze membres de la CMP contre « la dégradation des milieux naturels, avec des conséquences lourdes sur les pollinisateurs, les sols, la santé humaine – notamment le développement neurologique des jeunes enfants – et bien sûr les ressources en eau, vecteurs majeurs de diffusion de ces substances ».
Pire, le changement continu de molécules de pesticides par les industriels, pour échapper à la régulation, brouille les pistes sur leur niveau de dangerosité car cela ne laisse pas le temps aux scientifiques de l’étudier.
Reste donc à voir ce que va advenir de ce texte de loi : en cas d’accord lors de la CMP, il sera soumis au vote de chaque Chambre du Parlement.
mise en ligne le 30 juin 2025
Comment la réforme
de l’audiovisuel public
fragilise la démocratie
sur www.humanite.fr
Il faut le dire et le redire : la réforme de l’audiovisuel public, dont les députés doivent débattre à partir d’aujourd’hui, représente un péril démocratique de tout premier ordre. Mené tambour battant par Rachida Dati, qui en fait une affaire personnelle, ce projet vise à empiler France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel dans une même holding – France Médias –, dirigée par un seul et unique président.
Tout cela est évidemment enrubanné d’une ribambelle d’éléments de langage. Mais, sous couvert de « rationalisation » et de « pilotage stratégique », c’est bien la tentation d’une reprise en main politique du service public de l’information qui plane au-dessus de ce texte, portant un coup sévère à la diversité des contenus et à l’indépendance des rédactions.
La logique défendue par la ministre de la Culture est très claire. Au financement issu du budget de l’État (et non plus de la redevance) s’ajoutent la nomination des deux principaux directeurs (holding et information) par le pouvoir en place – via l’Arcom – et une fusion des rédactions qui, outre les « économies d’échelle » fantasmées, facilitera la diffusion des exigences éditoriales venues d’en haut.
Cette gouvernance tout en verticalité rappelle furieusement la gaullienne ORTF. Elle met sous pression les personnels, favorise une information uniformisée, accroît la suspicion sur les journalistes du service public, alors même qu’un Français sur deux ne fait déjà plus confiance aux médias pour s’informer.
Cette fragilisation de notre bien commun est inadmissible. Face à une concentration inédite du secteur dans la main de quelques milliardaires, dont certains assument l’utilisation de leurs chaînes, radio et journaux à des fins de propagande d’extrême droite, l’audiovisuel public doit être un rempart par son exemplarité, son professionnalisme, son pluralisme. L’affaiblir dans ses moyens et ses missions est un coup de poignard porté à notre vie démocratique. Et fait le jeu de ceux qui rêvent de privatisation et d’éteindre toute voix critique.
mise en ligne le 29 juin 2025
Gaza : 51 nouveaux morts,
l’Occident détourne toujours le regard
Axel Nodinot sur www.humanite.fr
Samedi 28 et dimanche 29 juin, l’armée israélienne a continué de tuer des civils, des enfants et des personnes attendant de l’aide alimentaire, et a lancé ce dimanche 29 juin une nouvelle offensive. 51 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer. Benyamin Netanyahou ignore les appels au cessez-le-feu depuis plus de vingt mois.
Le cessez-le-feu avec l’Iran n’aura rien changé : Israël continue de massacrer les familles de la bande de Gaza, depuis bientôt un an et neuf mois. Et les images continuent d’affluer, toutes plus terribles, telle la vidéo de ce petit être, sûrement une fille, mort de malnutrition, ses membres rachitiques repliés et son regard figé, comme momifié.
Des milliers d’autres enfants ont été tués, d’autres le seront encore tant que les États-Unis et l’Europe continueront de soutenir Israël. Dimanche 29 juin au matin, l’armée israélienne a annoncé de nouvelles attaques à Gaza-ville et Jabalia, en publiant une carte rouge et ordonnant aux habitants de fuir, une nouvelle fois, sans garantie de survie. « L’armée israélienne opère avec une grande force dans ces zones et ces opérations militaires vont s’intensifier, s’intensifier et s’étendre », a-t-elle menacé.
Des civils tués en attendant l’aide humanitaire
Ce week-end, la défense civile de la bande de Gaza déplorait au moins 51 morts « et des dizaines de blessés (…) à la suite de tirs et de raids israéliens » sur Gaza-ville et Jabalia au Nord, Deir el-Balah au Centre et Khan Younès au Sud. Parmi les victimes des avions de chasse ou des drones, il y a encore douze enfants, prouvant une nouvelle fois la barbarie du gouvernement israélien et l’hypocrisie des grandes puissances occidentales.
Même les personnes qui espèrent avoir un peu d’aide humanitaire, après des mois d’un ignoble blocus, de famine et de maladies, sont visées. Deux d’entre elles ont été tuées par l’armée israélienne samedi alors qu’elles attendaient une distribution de nourriture à Netzarim.
Dimanche, c’était un jeune homme de 18 ans qui était abattu par les soldats israéliens en espérant récupérer des denrées à Al-Alam, dans le sud de l’enclave. Le média israélien Haaretz a récemment publié des témoignages de soldats et d’officiers qui ont confirmé avoir reçu l’ordre de tirer sur celles et ceux qui attendent l’aide alimentaire.
Paris prêt à sécuriser l’aide humanitaire à Gaza
Ces assassinats se multiplient depuis que la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Tel-Aviv et Washington, gère l’aide alimentaire, comme l’a rappelé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, samedi sur LCI. « En un mois, ce sont 500 personnes qui ont perdu la vie et près de 4 000 qui ont été blessées dans des distributions alimentaires alors qu’elles se pressaient, affamées, pour aller chercher un sac de farine », a-t-il déclaré.
La France et l’Europe seraient même prêtes à « concourir à la sécurité des distributions alimentaires », selon Jean-Noël Barrot, qui n’a pas manqué de reprendre la rhétorique de Benyamin Netanyahou en évoquant « le détournement par des groupes armés de l’aide humanitaire ».
Ces déclarations ne restent que tressaillements après plus de vingt mois d’horreur dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu est encore loin, malgré le fait que le médiateur qatari ait évoqué samedi une « fenêtre d’opportunité » et un « élan créé par le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël ». Pas de quoi calmer la soif de sang de Benyamin Netanyahou, soutenu par celui qui ose penser au prix Nobel de la paix, Donald Trump. « Concluez l’accord à Gaza. Libérez les otages !!! » a publié ce dernier sur ses réseaux.
mise en ligne le 29 juin 2025
Après neuf mois de grève,
les femmes de chambre de Suresnes peuvent enfin crier victoire
Par Aurelia de Spirt sur www.humanite.fr
Les femmes de chambre de l’hôtel Campanile et Première Classe de Suresnes ont tenu durant neuf mois leur grève. Ce samedi, elles célébraient à Nanterre leur exploit face à la direction.
Caché au fond du jardin de l’Union locale de la CGT Nanterre, les femmes de chambre de l’hôtel Campanile et Première Classe de Suresnes célèbrent leur victoire. Elles ont troqué leur gilet CGT contre des robes colorées. Sur leurs visages se dessinent à nouveau des sourires. La musique en fond se mélange à l’odeur du barbecue. Les rayons du soleil dansent sur un mur tagué d’un point levé, « Agora » y est écrit en capitales rouges.
Avec beaucoup d’émotion, Kandé Tounkara, déléguée syndicale à la CGT-HPE sur le site, prend le micro. « Après l’humiliation et l’intimidation du patronat, il fallait s’en sortir pour notre dignité », déclame-t-elle. Les femmes entament leur slogan en coeur : « On a mal au dos Louvre Hôtels, il faut payer ! »
Une grève de longue haleine
La direction a enfin cédé le 7 mai dernier, après neuf mois de pression syndicale. En août 2024, dix-sept employés du groupe Louvre Hôtels, détenteurs des filiales Première classe et Campanile débutent une grève, contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils dénoncent des licenciements abusifs, une traque syndicale et exigent une revalorisation des salaires sur l’inflation et le versement d’une prime d’ancienneté.
Ils ont cru que des femmes immigrées ne leur tiendraient pas tête
Parmi eux, des équipiers, des plongeurs mais surtout des femmes de chambre. « Ils ont cru que des femmes immigrées ne leur tiendraient pas tête », scande Kandé sur les speakers. Au fur et à mesure, la direction s’est faite de plus en plus menaçante envers les grévistes. Deux grévistes ont même fini en garde à vue pour nuisance sonore. « Les premiers mois ont été compliqués. La direction ne les prenait pas au sérieux », relate Elisabeth Ornago, secrétaire générale de l’Union CGT des Hauts-de-Seine. Les tensions se sont apaisées à l’arrivée de la nouvelle directrice en début d’année et face à la médiatisation grandissante.
« La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et la figure de proue de la grève des Batignolles et ancienne députée LFI, Rachel Keke, sont venues plusieurs fois sur le piquet de grève », poursuit la syndicaliste. Mais c’est l’intervention de la sous-préfète à l’égalité qui a finalement tout fait basculer. « Elle a tapé du point sur la table en imposant des négociations », rapporte la secrétaire générale.
Tous les emplois précaires ont été transformés en CDI à temps plein. Les housses et les lits sont en train d’être remplacés pour réduire la pénibilité au travail des femmes de chambre. Un suivi régulier par le médecin du travail et la sous-préfecture a été mis en place. Les deux employés licenciés ont, quant à eux, obtenu des garanties d’emploi par la sous-préfète de Nanterre avec indemnité de départ.
Une victoire en demi-teinte
Mais Elisabeth Ornago reste pourtant sur sa faim. « Il n’y a pas eu d’augmentation de salaires et seulement dix jours de grève ont été payés. Certes, elles ont obtenu une neutralisation de leurs jours de grève pour les primes mais pas pour leur jour de congé », précise-t-elle.
Reste que les syndicalistes sont soulagés : le plus dur semble derrière eux. « On a tous beaucoup perdu des deux côtés, conclut un cgtiste. Neuf mois sans salaire, c’est pas rien ! » La reprise du travail le 12 mai s’est passée dans la bonne humeur. « Il n’y a pas de haine. On est de la même famille et on travaille ensemble », poursuit l’ancien gréviste.
La journée de liesse, ce samedi, avait d’ailleurs commencé plus tôt dans la journée, dans la salle de petit déjeuner de l’hôtel Première Classe de Suresnes, au côté de la directrice du site. « Maintenant, ils savent de quoi on est capable », triomphe un cgtiste. « Ces femmes ont pris confiance en elles, confie Kandé Tounkara. C’était la première fois qu’elles demandaient une caisse de grève. On ne s’attendait pas à autant de soutien ».
Renverser le rapport de force
Le mot « fierté » est sur toutes les lèvres. La déléguée syndicale se livre. « Je me sens enfin respectée, ça fait du bien ». La secrétaire générale se risque même à parler d’avenir : « Elles ont envie de remonter un syndicat, de faire des formations, de soutenir les combats d’autres collègues. Ce sont des guerrières. »
Cette lutte, c’est celle des femmes immigrées et sous payées, c’est la reconnaissance de la pénibilité des métiers féminisés
Alors que tout le monde déguste, en cercle, un plat sénégalais, dans des assiettes en carton, la secrétaire générale de l’Union CGT des Hauts-de-Seine interrompt les victuailles et se tourne vers les grévistes. « L’association de solidarité “L’avenir social” et la CGT s’associent pour vous offrir une semaine de vacances tous frais payés », annonce-t-elle.
Kandé explose de joie et sert Élisabeth dans ses bras. Des larmes coulent sur son visage. Une femme discrète, assise sur
sa chaise à l’écart, éponge d’un geste de main ses yeux. Soulagées du poids de neuf mois de grève acharnée, à camper sur le piquet de 9h à 19h, fatiguées par des années de dur labeur, elles disent se
sentir enfin valorisées. « Cette lutte, c’est celle des femmes immigrées et sous payées, c’est la reconnaissance de la pénibilité des métiers féminisés », martelle madame
Ornago.
mise en ligne le 28 juin 2025
À Radio France,
grève illimitée et
ras-le-bol généralisé
Grégory Marin sur www.humanite.fr
Les salariés de Radio France ont déposé un préavis de grève illimitée à partir de ce jeudi. Ils se mobilisent d’abord pour des raisons internes, puis rejoindront lundi le mouvement de contestation de la réforme Dati de l’audiovisuel public.
Dans l’audiovisuel public, le ras-le-bol est général devant les attaques organisées par la ministre de la Culture, Rachida Dati et la majorité macroniste. À Radio France, il se double de l’inquiétude qu’avec la création d’une holding, la radio soit invisibilisée, voire pire.
« On deviendrait une filiale sans PDG », rappelait le délégué central CGT Bertrand Durand en préambule d’une conférence de presse avant l’assemblée générale des personnels, ce mercredi à la Maison de la radio. Et surtout « sans budget » propre, alors que la radio publique, aujourd’hui entreprise de plein exercice, est « le deuxième budget de l’audiovisuel public ». « C’est un danger pour Radio France, pour ses activités et ses personnels », martèle-t-il.
Les représentants de chaque syndicat ont pris la parole tour à tour pour souligner un aspect négatif de la réforme Dati, mais aussi pour préciser les raisons qui les font entrer en grève, quelques jours avant son examen à l’Assemblée nationale. Des raisons « internes », mais qui ne sont pas sans rapport avec les visées de la ministre.
Il s’agit d’abord de protester contre la disparition « brutale » de Mouv’, la radio jeune public du groupe : « On est passés en quelques semaines d’un questionnement (sur son positionnement, NDLR) à une décision ferme », peste Benoît Gaspard, délégué central Sud.
La réussite de Radio France, c’est l’engagement des salariés
À la fin de la semaine, la radio quittera la bande FM pour le DAB + avec « un flux uniquement musical », avant de cesser définitivement d’émettre d’ici un an pour laisser la place à la radio pour enfants voulue par la directrice Sibyle Veil. « C’est très dur pour les salariés, assure Benoît Gaspard, car s’il y avait des questionnements, il y avait aussi des succès. » Mais tout le monde a été « pris de court » par la décision : « pas moyen de discuter de projets alternatifs ».
Parmi les 30 CDI et 32 précaires (CDD d’usage et pigistes) concernés, certains « talents » seront recasés dans le groupe, mais pour les journalistes très spécialisés (en rap par exemple), l’horizon n’est pas clair, reconnaît un membre de la direction.
D’une manière générale, l’intersyndicale reproche à la direction d’appliquer d’ores et déjà une partie des recommandations du rapport Bloch, un plan de rapprochement entre France Bleu et France 3 qui partageront sans doute plus que l’étiquette « Ici », la fermeture de plusieurs émetteurs («France Musique en perd deux », au détriment de son développement, dénonce Guillaume Baldy, de Force ouvrière) et le passage d’une politique centrée sur l’« expertise » à « l’employabilité ».
« Quand on recrute hier un musicologue pour ses compétences et qu’on lui demande aujourd’hui de faire autre chose, ça interroge », lâche Renaud Dalmar, représentant de la CFDT. « Il faudrait faire le deuil de son métier ! » Alors que « la réussite de Radio France (quatre stations, France Inter, France Info, Fip, Ici, figurent parmi les dix plus écoutées de France, selon le relevé de mai de Médiamétrie, NDLR) c’est l’engagement des salariés ».
Ils le paient cher parfois, note Bertrand Durand : les bilans sociaux montrent une recrudescence des risques psychosociaux, une explosion des arrêts de travail… Le délégué CGT dénonce aussi le recours à des entreprises extérieures par souci d’économies de « l’argent public », parfois « sur des compétences qu’on a en interne ». « Insupportable, quand on nous demande de faire des économies sur les reportages, d’abandonner des émetteurs », regrette-t-il.
Même si la directrice de la radio publique, Sibyle Veil, affirme avec eux son désaccord avec le projet de loi Dati, cela n’invalide pas les critiques internes. Les salariés de Radio France vont en débattre jeudi, lors d’une prochaine assemblée générale, et tout le week-end, pour arriver échauffés à la mobilisation commune de lundi avec leurs confrères de France Télévisions, de l’Ina et sans doute de France Médias Monde.
Radio France :
Après l’humour,
France Inter dégomme l’investigation
Caroline Constant sur www.humanite.fr
L’émission secret d’Infos ne comporterait plus qu’une seule émission par mois, le dimanche matin, à l’heure d’Interceptions. Soit une manière d’affaiblir à la fois l’investigation et le reportage sur l’antenne.
On vous dépèce, mais c’est pour votre bien. C’est la petite musique de la direction de France Inter et de Radio France, qui, après avoir dégommé l’an dernier l’humour politique sur la station, remplacé par de tranquilles amuseurs, a décidé de s’attaquer à l’investigation. Céline Pigalle, la directrice de l’information de Radio France, a reçu les journalistes de Secrets d’Info, l’émission d’Inter diffusée le samedi à 13 h 25, pour leur annoncer que leur émission est donc non seulement déplacée dans la grille, mais aussi divisée par quatre. Désormais, elle n’aura lieu qu’une fois par mois, à la place d’Interceptions, l’émission de reportages du dimanche à 9 heures.
Une manière d’affaiblir les deux genres journalistiques : l’enquête et le reportage ? L’information est parue sur le site internet du Nouvel Obs, et a été confirmée par téléphone par l’équipe, qui espère encore pouvoir bouger les lignes. Secrets d’Info est une émission unique en son genre en radio. Elle fait d’ailleurs partie des consortiums internationaux d’investigation : c’est dire son niveau d’exigence. Créée en 2014 par Mathieu Aron et Jacques Monin, elle réunit chaque samedi 1er, 6 millions d’auditeurs. C’est aujourd’hui Benoît Collombat qui en tient les rênes.
Ces dernières années, elle a révélé les scandales de l’eau du robinet polluée, les violences sexuelles exercées par l’abbé Pierre, la façon dont « la big tech » investit l’école de la République. Cinq journalistes travaillent sur ce format exigeant, qui est une spécificité du service public, qui a les moyens de résister aux pressions, économiques comme politiques. D’ailleurs, en 2017, c’est cette même cellule, rappelle l’Obs, qui avait déterré l’affaire des Pots-de-vin du Modem, et conduit à la démission de trois ministres, dont François Bayrou. Un hasard ?
Une petite mort pour Secret d’Info
Les justifications de Céline Pigalle laissent rêveur. Elle explique, en gros, qu’il faut donner plus de temps aux journalistes… histoire qu’ils puissent rebondir davantage sur l’actualité. « Les journalistes sont tellement dévorés par l’émission qu’ils n’ont pas toujours la capacité de prendre à bras-le-corps des sujets qui surgissent dans l’actualité, qui s’imposent car ils doivent nourrir Secrets d’info » , poursuit Céline Pigalle auprès du Nouvel Obs.
« La nouvelle émission mensuelle sera événementielle : les journalistes auront donc plus de temps. Je veux défendre le label « cellule d’investigation »». Elle propose une clause de revoyure à l’automne… une fois les grilles de rentrée démarrées. Cette disparition de l’antenne est une sorte de petite mort, et les journalistes concernés ne s’y trompent pas. « On va être absorbé par Interception, on va perdre notre identité car une fréquence mensuelle, cela existe en télé, pas en radio », assurent-ils.
« Il faut arrêter de tout mélanger : ce n’est pas du tout une reprise en main. Si je voulais cacher l’investigation, je ne ferais pas cela », se défend Céline Pigalle. Pourtant, la directive vient de la direction de Radio France, et pas de France Inter. Et conduit inexorablement à une invisibilisation. Sibyle Veil, la Pdgère de Radio France, Adèle Van Reeth, la directrice de France Inter, peuvent se vanter de ne pas opérer de reprise en main politique de l’antenne : dans les faits, entre l’affaire Guillaume Meurice l’an dernier, la disparition de l’émission oh combien insolente de Charline Vanhonaecker et cette razzia sur l’investigation, c’est le cœur même de l’antenne qui est attaqué. En plein débat sur l’audiovisuel public, et alors que les personnels de Radio France sont appelés à une grève illimitée depuis le 26 juin, l’affaire montre clairement une volonté de casser l’outil public, qui appartient à tous les citoyens.
mise en ligne le 28 juin 2025
Tuée par la chute des subventions,
la maison des écrivains
et de la littérature
contrainte de fermer ses portes
Dorian Vidal sur www.humanite.fr
Les subventions du ministère de la Culture diminuant petit à petit, la Maison des écrivains et de la littérature a été contrainte de cesser son activité. Fondée en 1986, l’association était le premier employeur d’écrivains en France.
En deux ans, les subventions du ministère de la Culture pour la Maison des écrivains et de la littérature (Mél) ont diminué de 60 %. Bien loin des 700 000 euros accordés en 2015, des 500 000 de 2023, la subvention pour l’année de 2025 ne dépasse pas les 200 000 euros. Une somme à laquelle il faut déduire les salaires des 7 salarié.e.s, le loyer de 40 000 euros annuels, l’électricité, le gaz… plus de 50 000 euros chaque mois. Étouffée financièrement, l’association loi de 1901 créée en 1986 sous la direction de Jack Lang essayait de résister à une fermeture prévue depuis des mois. Aux yeux des auteur.e.s aussi, ce site n’avait pas de prix.
« La Mél est pour beaucoup d’autrices et d’auteurs un partenaire privilégié, note l’écrivain Arno Bertina. Parce qu’elle est de taille modeste (une petite dizaine de salariés, NDLR), il nous aura toujours été facile de trouver la personne en charge du dossier qui nous occupait (une rencontre dans un lycée, dans une université, dans un festival ou un colloque). L’écoute aura toujours été d’une grande qualité, et les réponses d’une grande pertinence – notamment celles des deux documentalistes capables d’orienter les adhérents dans la jungle des résidences d’écriture. »
Une structure essentielle pour la culture
« Cette qualité d’échanges reste unique, souligne le titulaire de la chaire artistique de l’EHESS. Quand un enseignant se tourne vers la MEL, il n’a pas affaire à une chambre d’enregistrement. On lui laisse le temps d’expliquer son projet de façon à lui proposer l’autrice ou l’auteur ad hoc, celui ou celle qui saura le mieux représenter la création littéraire, ses questionnements, sa vitalité. »
Une structure essentielle dans le partage et la transmission, alors que le ministère de la Culture de Rachida Dati, accompagné d’Élisabeth Borne à l’Éducation nationale, lançait au début du mois de juin son opération « Cet été je lis », visant à encourager la lecture chez les jeunes. La Mél avait donc sa carte à jouer à ce niveau-là : chaque année, 30 000 collégiens, lycéens et étudiants de la France entière pouvaient rencontrer près de 300 écrivains. Autre action phare de l’association, le prix des lycéens et apprentis en Île-de-France.
« On est tous concernés »
« Tout ça, c’est une histoire de fou, raconte Sylvie Gouttebaron, qui dirigeait la Mél depuis 2005. Cette fermeture semblait absolument inévitable quand on a vu la subvention annoncée. On a eu le combat joyeux ces derniers mois, mais là c’est fini, la Maison n’existe plus, elle est liquidée. » Celle qui est également autrice déplore l’absence totale de réponse du ministère de la Culture et dénonce une politique libérale plus intéressée par l’argent que l’art. « On est tous dans le même bateau, affirme-t-elle. Que ce soit le spectacle vivant, la littérature, l’audiovisuel public, on est tous concernés par la déliquescence du service public. »
Dans Le Monde, le ministère se défend en expliquant que « l’État invite la Mél depuis plusieurs années à se rapprocher des acteurs territoriaux à qui sont désormais confiés les crédits déconcentrés correspondant au développement des activités d’éducation artistique et culturelle ». « On l’a fait, répond Sylvie Gouttebaron. Dès le Covid, on a écrit à toutes les DRAC (Direction régionale des affaires culturelles, NDLR). » Mais l’appel au soutien n’a donc pas suffi à empêcher la fermeture de la Mél.
Continuer de prendre la parole
À quelques jours de la fin, l’équipe de l’association a réussi à payer l’ardoise de 70 000 euros aux 83 écrivains qui attendaient leur dû. Maintenant, il faut trouver une place pour les très riches archives de la structure. « Il y a un fond audiovisuel inouï, des photos, des entretiens, un colloque René Char… Ça ne doit pas partir à la poubelle », martèle l’ex-dirigeante. L’équipe de la Mél est notamment en contact avec la BNF pour sauver des documents inestimables.
Sylvie Gouttebaron l’assure, elle ne va pas se taire. Celle qui est également derrière le collectif Les Soulèvements de la culture et une pétition demandant la démission de Rachida Dati annonce la création d’une nouvelle association, Reprendre la parole. « L’espérance prime, on veut continuer contre ce qui nous menace tous aujourd’hui », appuie-t-elle.
Cette association ambitionne de maintenir le festival « Littérature, enjeux contemporains », création de la Mél, avec cette année le thème « Reprendre la parole : on nous raconte des histoires », du 4 au 6 décembre 2025. « On veut que ce soit un véritable espace d’échanges assez politique en littérature. Et on va le faire, coûte que coûte », affirme Sylvie Gouttebaron, déterminée.
Palais de la découverte :
la culture scientifique dans la ligne de mire du gouvernement
Thomas Lefèvre sur www.politis.fr
L’emblématique musée scientifique parisien est au cœur d’une crise, après le report de sa réouverture, initialement prévue pour le 11 juin 2025. Les attaques contre le secteur culturel se multiplient, sans épargner la culture scientifique.
La culture scientifique n’est pas épargnée par la tronçonneuse budgétaire. Le Palais de la découverte, musée parisien historique, devait rouvrir ses portes le mercredi 11 juin 2025, après plus de quatre ans de rénovation du Grand Palais, auquel il est intégré. Pourtant, dès le 20 mai, les salariés d’Universcience – établissement administratif regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences – apprenaient avec stupeur le report de cette réouverture. À cette nouvelle s’est ajoutée, le 12 juin, la décision en Conseil des ministres de remercier Bruno Maquart, président d’Universcience depuis 2015.
Lors de son discours d’adieu, prononcé devant ses équipes le mercredi 18 juin, ce dernier a évoqué une « situation de crise », précisant toutefois qu’il « ne peut pas en parler davantage », d’après plusieurs sources présentes. Cette opacité ajoute à l’inquiétude générale des salariés. Valentin, médiateur scientifique au Palais, témoigne de cette ambiance délétère : « Ça fait plus d’un mois qu’on nous dit qu’on aura plus d’informations la semaine prochaine. En interne, on n’a aucune information, notre direction nous répète qu’elle ne peut rien nous dire. » Contacté par Politis, la direction de la médiation scientifique d’Universcience n’a pas donné suite.
Inauguré en 1937, le Palais de la découverte est un lieu consacré à la médiation scientifique, situé en plein cœur de Paris, dans une aile du Grand Palais. Cette institution emblématique est aujourd’hui dans la tourmente. « Le limogeage du président est une attaque claire contre le nouveau projet du Palais de la découverte, déplore Valentin. Ça a été une surprise totale pour tout le monde ». La décision du gouvernement a été perçue comme une menace directe sur l’avenir de l’institution et sur les emplois des salariés.
Si une institution historique comme celle-ci est menacée, c’est très inquiétant pour la survie de structures plus petites. C. Aguirre
Rachida Dati, ministre de la Culture, a laissé planer le doute sur un potentiel déménagement de l’établissement à la Villette, à côté de la Cité des sciences. Une proposition vivement critiquée en interne et par l’ensemble des acteurs du secteur. « Il n’y a pas suffisamment d’espaces de culture scientifique en France », souffle Valentin. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche souhaite, quant à lui, le maintien du Palais de la découverte au Grand Palais. Affaire à suivre.
Face à cette crise, une pétition de soutien a été lancée, rassemblant déjà plus de 80 000 signatures, en quelques jours. Parmi les signataires de cette pétition, on retrouve des scientifiques de renom tels que le chercheur Jean Jouzel, le mathématicien Cédric Villani, ou encore Valérie Masson-Delmotte, climatologue et autrice du GIEC.
Claudia Aguirre, directrice de Traces association d’éducation populaire et de médiation scientifique, souligne l’importance cruciale de cette mobilisation : « C’est une situation qui met à risque l’intégralité de la culture scientifique. Si une institution historique comme celle-ci est menacée, c’est très inquiétant pour la survie de structures plus petites comme la nôtre. » Le 12 juin, une tribune de scientifiques internationaux a également paru dans Le Monde appelant à sauver l’établissement.
La culture scientifique : angle mort du ministère
Pour Tania Louis, docteure en biologie et médiatrice scientifique indépendante depuis 2020, cette crise révèle « le symptôme d’un échec ». « Ces derniers temps, le secteur de la culture, et donc celui de la culture scientifique, est durement touché par les politiques budgétaires, précise-t-elle. La culture scientifique est un milieu très peu syndiqué, on est très peu outillé pour se défendre. »
La culture scientifique est à la fois mal intégrée au secteur culturel et mal intégrée au secteur scientifique. T. Louis
La situation critique du Palais révèle un problème plus profond : l’abandon politique et financier de la culture scientifique, placée dans un entre-deux inconfortable entre le ministère de la Culture et celui de l’Enseignement supérieur. En tant que freelance, Tania Louis ressent parfois cet isolement vis-à-vis du reste du milieu culturel : « La culture scientifique est à la fois mal intégrée au secteur culturel et mal intégrée au secteur scientifique. Des actions collectives comme “Cultures en luttes” n’ont pas été rejointes par les acteurs et actrices de la culture scientifique, ça montre une certaine imperméabilité, regrettable, entre les milieux. »
Étant un établissement parisien de référence dans le domaine, les incertitudes autour du Palais de la Découverte reçoivent un certain écho médiatique. Ce qui n’est pas le cas pour des lieux moins connus, qui subissent pourtant le même sort. « Si on s’était mobilisés dès le début pour défendre les petites structures, peut-être que le Palais de la Découverte n’aurait jamais été menacé », résume Tania Louis. Selon elle, par peur de se voir couper davantage de financements, de nombreuses structures de culture scientifique ne préfèrent pas témoigner publiquement de leur situation, parfois très instable.
« Ubérisation de la culture scientifique »
Terence, cofondateur d’Exaltia, un collectif de vulgarisateurs scientifiques, et vice-président du Café des sciences, décrit une situation particulièrement instable pour les acteurs indépendants : « On avait prévu un concert au Palais de la découverte le jour de la Fête de la musique. Pour nous, c’était l’occasion de faire le pont entre le milieu culturel et la culture scientifique, donc c’est une grosse déception. » Cette situation n’est pas isolée : « Les indépendants et les structures culturelles qui galèrent sont invisibilisés, et il y a beaucoup de personnes précaires. »
On a appris l’annulation à peu près en même temps que le grand public. Terence
Pour Exaltia, le partenariat avec le Palais de la découverte représente plusieurs milliers d’euros de devis, dont une partie seulement sera payée. « On a appris l’annulation à peu près en même temps que le grand public, détaille Terence. Mais ça faisait déjà un mois que les indications étaient en chaud-froid par rapport à la communication autour du festival Premières ondes de cet été, auquel on devait participer. » Ce festival devait avoir lieu tout le long du mois de juin, avant d’être finalement entièrement annulé au début de ce mois.
Selon Tania Louis, cette précarisation de la culture scientifique prend la forme d’une véritable « ubérisation » du secteur : « Les structures standards de culture scientifique ont de moins en moins de postes permanents et font donc appel à des prestataires indépendants. »
En réponse, certains acteurs du secteur explorent de nouveaux modèles économiques. Terence explique ainsi que, face à ces difficultés, son collectif a choisi de « passer du statut de freelance chacun dans notre coin, à un statut collectif de coopérative », afin notamment de « combattre la précarité ».
Si les coupes budgétaires s’inscrivent dans une logique politique globale de réduction des dépenses culturelles, la situation du Palais de la découverte met en lumière les problématiques structurelles du secteur de la culture scientifique. Alors que les attaques contre les sciences se multiplient – en particulier envers les sciences sociales, mais aussi celles de l’environnement –, il paraît urgent de pérenniser ces quelques lieux publics de transmission de savoirs scientifiques fiables et accessibles à tous·tes.
mise en ligne le 27 juin 2025
Réchauffement climatique : la marche arrière promue par Donald Trump contamine l’Europe
Antoine Portoles sur www.humanite.fr
L’année 2025 est synonyme de « backlash » pour la préservation de la planète, avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Cette tentation de la marche arrière, présente en Europe depuis plusieurs années, risque de s’amplifier sous l’effet des armes et du business.
Le backlash. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis, quand, dans les années 1990, la journaliste et essayiste Susan Faludi décrivait les vents contraires dont étaient victimes les mouvements féministes. Voilà qu’il fait florès depuis plusieurs mois, cette fois-ci au sein des mouvements écologistes. Que ce soit contre les femmes, les minorités ou les droits des travailleurs, droite et extrême droite versent, comme toujours, dans l’escalade réactionnaire. Leur nouvelle proie : la transition écologique.
Alors que l’urgence climatique devrait au contraire appeler à accélérer les efforts, ils sont parvenus à instiller dans l’opinion publique l’idée que nous serions allés trop loin pour sauver l’habitabilité de la planète et qu’il faudrait donc faire marche arrière. Ce discours fallacieux a été catalysé par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en janvier. Cinq mois après le début de son second mandat, le leader nationaliste a déconstruit méthodiquement la politique climatique états-unienne : coupes budgétaires draconiennes et licenciements parmi la communauté savante, retrait derechef de l’Accord de Paris de 2015 et des négociations multilatérales sur le climat, mais surtout relance du charbon et boom des forages pétrogaziers. Dernière trouvaille de l’administration trumpiste : l’ouverture à l’exploitation de 23 millions d’hectares de forêts encore intactes et protégées depuis un demi-siècle.
En sus de leurs impacts dévastateurs sur les émissions de gaz à effet de serre – les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial derrière la Chine –, ces décisions s’assoient sur la science et galvanisent les climatosceptiques. Sur ce point, « la radicalité de Trump est difficilement entendable en Europe », estime Théodore Tallent, doctorant au Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Mais il craint que « les discours anti-science » finissent à terme par se propager.
« Cela fait cinq ou six ans déjà que l’extrême droite européenne fait petit à petit sa mue anti-climat, car ça marche d’un point de vue électoral, et cela, Trump l’a compris avant eux », considère Emiliano Grossman, chercheur et professeur associé à Sciences Po. Les droites dites « modérées » s’engouffrent à leur manière dans la brèche, en relativisant l’urgence climatique. En réalité, « si Trump a accéléré la délégitimation des discours écolo, ce phénomène est apparu il y a déjà environ deux ans avec la montée des discours sur la simplification administrative et sur la dérégulation dans le bloc central européen », rappelle Théodore Tallent.
Arrivée à la tête de la Commission européenne en 2019, Ursula von der Leyen avait, dans la lignée de l’Accord de Paris 2015 et des manifestations sur le climat, promu un plan européen de décarbonation certes imparfait, mais ambitieux. Le « pacte vert », comme on l’appelle, était alors soutenu y compris dans les rangs du Parti populaire européen (PPE), dont la présidente est issue. Réélue pour un second mandat l’an dernier, elle a, depuis, tourné casaque. L’UE a retardé d’un an une réglementation destinée à éradiquer la déforestation sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. Les constructeurs automobiles ont obtenu deux années de plus pour respecter les objectifs de pollution. Les ONG environnementales sont menacées de voir leurs financements gelés. Et cette semaine, une loi anti-greenwashing a carrément été enterrée, sous la pression de la droite et de l’extrême droite.
Le pacte vert saboté
L’heure est à la dérégulation tous azimuts, au nom de la sacro-sainte compétitivité. Le pacte vert reposait essentiellement sur deux directives : la CSRD, sur le reporting de durabilité ESG (standards environnementaux, sociaux et de gouvernance) et la C3SD, sur le devoir de vigilance des entreprises. La Commission européenne avait prévu de reporter leur application d’un an, soit à partir de 2028. Mais lundi, le Conseil européen est allé encore plus loin. Les Vingt-Sept sont parvenus à fixer les grandes lignes de la directive Omnibus, censée réduire la portée des deux précitées.
S’agissant de la C3SD, les seuils des sociétés concernées ont été relevés à 5 000 salariés (contre 1 000 auparavant) et à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires net (450 au départ). La vigilance sera cantonnée aux seuls fournisseurs directs et, surtout, la responsabilité civile de l’entité ne pourra plus être mise en cause. Même sabotage pour la CSRD, circonscrit aux entreprises de plus de 1 000 salariés générant 450 millions d’euros de chiffre d’affaires ; 85 % des sociétés sortent ainsi de son champ d’application.
L’UE a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, avec une baisse des émissions de CO2 de 55 % en 2030 par rapport à 1990, et de 90 % dès 2040. Alors que se tient ce jeudi le sommet des chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles, Emmanuel Macron veut mettre le sujet sur la table… Au risque de semer la zizanie. « On garde l’objectif (de 2050), mais on est pragmatique sur les trajectoires », a rapporté un proche du président de la République au Monde.
Tandis que plusieurs États membres – tels que la Hongrie de Viktor Orbán, biberonnée à la doctrine anti-climat de Trump – s’en remettent à la COP30 de Belém (Brésil) en novembre, d’autres, comme l’Espagne ou le Danemark veulent garder le cap ambitieux de 2040. Un objectif que la France accueille avec réserve, soucieuse de préserver son mix énergétique. Côté allemand, la coalition menée par le chancelier Friedrich Merz, récemment élu, plaide, comme la France, pour une décarbonation accompagnée de flexibilité.
Derrière l’enjeu de la compétitivité se cache surtout celui de la défense européenne, propulsé par la guerre en Ukraine. Là aussi, Trump mène la danse : lors du sommet de l’Otan qui s’est déroulé les 24 et 25 juin à La Haye, le président états-unien a réussi à soumettre les membres européens de l’Alliance Atlantique à une hausse historique de leurs dépenses militaires à hauteur de 5 % de leur PIB. « L’écologie est traitée en silo. Dès lors qu’elle est concurrencée par les questions de réarmement, elle passe à la trappe », constate Théodore Tallent. Mais celui qui est également chercheur affilié au centre de recherches de l’Université de Cambridge soutient une tout autre approche : « Il faut être l’idiot utile de Trump et de Poutine pour ne pas comprendre que la transition écologique nous rend justement indépendants d’eux. »
mise en ligne le 27 juin 2025
Avec « Comment le fascisme
gagne la France »,
le sociologue Ugo Palheta veut « réveiller les consciences »
Diego Chauvet sur www.humanite.fr
Sociologue spécialiste des extrêmes droites, Ugo Palheta analyse dans son dernier ouvrage l’accélération du processus de « fascisation » en France. Il appelle à un sursaut et à un débat stratégique au sein de la gauche.
Le sociologue spécialiste des extrêmes droites vient de publier un nouveau livre. Comment le fascisme gagne la France est une version largement remaniée et augmentée d’un premier opus, la Possibilité du fascisme, paru en 2018. Ugo Palheta y note une progression des thèses racistes et xénophobes, tout en réfutant l’inéluctabilité d’une victoire prochaine du Rassemblement national. À condition de « renouer avec l’antifascisme ».
Qu’est-ce qui a changé depuis « la Possibilité du fascisme » paru en 2018 pour justifier cette nouvelle édition ?
Ugo Palheta : Le changement tient surtout à l’amplification de dynamiques que j’avais identifiées à l’époque, et pour commencer la progression électorale du Rassemblement national (RN). En 2018, on croyait encore que le RN avait atteint un plafond de verre. Après le débat raté de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2017 et les mauvais scores du parti aux législatives qui avaient suivi, beaucoup pensaient que l’extrême droite était durablement affaiblie. En réalité, elle a depuis poursuivi une dynamique de renforcement. Aujourd’hui, elle constitue le seul bloc en expansion dans un paysage politique tripolaire, aux côtés du pôle néolibéral-autoritaire (Macronie-LR) et du pôle de gauche. Autre amplification majeure : le durcissement autoritaire de l’État.
Cela avait commencé sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais cela a pris une ampleur inédite avec Emmanuel Macron : répression brutale des mobilisations (gilets jaunes, quartiers populaires, Sainte-Soline…), surarmement de la police, interdictions croissantes de manifester, marginalisation du Parlement… Ce basculement s’accompagne de la banalisation et de la radicalisation du racisme d’en haut. Non seulement les politiques anti-immigrés ont été considérablement durcies par les droites au pouvoir, mais les partis et médias dominants n’ont cessé de construire l’islam et les musulmans comme ennemi de l’intérieur. Les deux meurtres récents visant explicitement des musulmans nous rappellent une fois de plus que ce racisme tue.
Pourquoi le discours sécuritaire et xénophobe de la droite et du centre ne siphonne-t-il pas l’électorat de l’extrême droite ?
Ugo Palheta : En fait, ces stratégies ne neutralisent pas l’extrême droite. Au contraire, elles banalisent ses idées et les rendent hégémoniques. Prenons 2007 : Nicolas Sarkozy a capté une partie de l’électorat du Front national, mais ça n’a été que provisoire. En reprenant les thèmes de l’extrême droite, les partis traditionnels déplacent le centre du débat public vers ses obsessions : immigration, islam, insécurité. Être hégémonique pour une force politique, c’est, notamment, parvenir à imposer les termes du débat, donc que les autres forces débattent ou légifèrent à partir de ce qui fait « problème » pour vous. Ainsi, quand la droite ou le centre gauche reprennent les obsessions de l’extrême droite, ils contribuent à bâtir les conditions de son hégémonie. À court terme, ils peuvent grappiller des points aux élections mais, à moyen et long terme, c’est l’extrême droite qui rafle la mise.
Vous notez également une part de responsabilité de la gauche. Quelle est-elle ?
Ugo Palheta : Le premier problème, c’est que la gauche dite de gouvernement a elle-même mené des politiques destructrices socialement : austérité sous François Mitterrand (la « rigueur »), privatisations massives sous Lionel Jospin, politique de l’offre sous François Hollande. Ces choix ont généré précarité, insécurité sociale, concurrence généralisée. Mais, si cette insécurité sociale a pu favoriser l’extrême droite, c’est que les politiques néolibérales, de droite comme de gauche, se sont accompagnées de discours et de politiques anti-immigrés et plus tard islamophobes. Si bien que les incertitudes et les peurs croissantes (de la précarité, du déclassement, etc.) ont été politisées selon un schéma xénophobe et raciste, orientées vers des boucs émissaires fournis notamment par toute l’histoire coloniale de ce pays : immigrés, musulmans, quartiers populaires.
La gauche n’a pas troqué les immigrés contre la classe ouvrière. Elle a durci son discours et ses politiques d’immigration au moment même où elle abandonnait les travailleurs. Mais il y a eu aussi des reculs idéologiques : outre l’acceptation de l’idée qu’il y aurait « trop d’immigrés », tout le discours historique de gauche autour de l’exploitation et de la lutte des classes a disparu dans ces années au profit d’une rhétorique vaguement « citoyenniste » ou contre l’exclusion, qui ne désignait plus aucun ennemi et épargnait ainsi la bourgeoisie. Or ce vide a été comblé par les récits identitaires de l’extrême droite : la nation menacée, l’islam contre la République, l’étranger comme ennemi intérieur.
Vous évoquez un basculement de l’État social vers un État pénal. En quoi cela relève-t-il d’une fascisation plutôt que d’un simple durcissement sécuritaire ?
Ugo Palheta : On parle souvent de « dérive », mais cela atténue la portée du phénomène. Mon hypothèse, c’est que ce qui se cherche ou se prépare n’est pas juste un État capitaliste démocratique un peu plus répressif, mais un État d’exception : suspension de l’État de droit, dissolution d’organisations, écrasement de toute contestation, etc. En outre, certains groupes – Roms, migrants, musulmans – subissent d’ores et déjà un traitement d’exception. Ce qui commence à la marge finit par s’appliquer à tous, sous la forme d’un État policier.
Cette évolution repose aussi sur une alliance renforcée entre autoritarisme et pouvoir économique. Des secteurs entiers du capital – industries fossiles, sécurité, armement, Big Tech, agrobusiness – parient désormais sur des stratégies autoritaires. Bien sûr, ce durcissement a pour objectif d’imposer la refonte néolibérale des rapports sociaux et de relancer l’accumulation du capital, mais il a aussi des visées banalement électorales : si, dès 2017, Macron a opéré un virage autoritaire et raciste, c’était pour capter l’électorat de droite, élargir sa base sociale et ainsi se maintenir au pouvoir en 2022.
Cette fascisation ne résulte-t-elle pas d’une stratégie réussie de la part du RN ?
Ugo Palheta : Le RN a mené une stratégie bien pensée de respectabilisation (dite « dédiabolisation »), mais certaines conditions ont favorisé leur succès. D’abord, cette stratégie n’aurait jamais fonctionné à ce point sans un haut niveau de complicité politique et médiatique, acceptant l’idée même que le RN d’aujourd’hui n’aurait plus rien à voir avec le FN d’autrefois. En outre, le RN prospère sur un terreau d’instabilité et d’incertitudes produit par des politiques néolibérales, face à une gauche impuissante ou carrément complice là encore. Dans ce contexte, un électorat s’est structuré à partir des années 1980, composé pour l’essentiel de gens qui n’ont jamais été politisés à gauche et qui sont imprégnés profondément par des rhétoriques de droite et d’extrême droite (mêlant refus du prétendu « assistanat » et refus de l’immigration).
Pour revenir au FN-RN, Marine Le Pen a cherché à se démarquer des déclarations antisémites et négationnistes de son père (qu’elle avait toujours acceptées jusque-là), tout en conservant l’essentiel de son idéologie. Elle a aussi habilement ajouté plusieurs notes à sa gamme ethno-nationaliste, par exemple en instrumentalisant la cause des femmes à des fins racistes (les immigrés et les musulmans seraient responsables de la persistance du patriarcat et des violences de genre) ou encore la lutte contre l’antisémitisme, prétendant que les ennemis des juifs seraient aujourd’hui les musulmans et la gauche.
Faut-il considérer la progression de l’extrême droite comme inéluctable ? Peut-on encore infléchir cette dynamique ?
Ugo Palheta : Le récit de l’inéluctabilité est lui-même un facteur de défaite. En juillet 2024, l’ensemble des sondages donnaient le RN largement gagnant. Pourtant, ce n’est pas ce qui s’est passé. Certes, il a progressé, mais c’est la gauche qui a obtenu une majorité relative grâce notamment à une forte mobilisation militante. Cela montre que la mécanique peut être brisée. « Ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu », écrivait Brecht.
Un certain volontarisme est nécessaire, même si l’action en elle-même ne suffit pas : nous avons aussi besoin d’un débat stratégique sérieux pour savoir comment employer nos forces, quelles alliances sont nécessaires pour vaincre et changer la société. Ce livre ne propose donc pas un constat désespéré ou une énième lamentation. Il vise à réveiller les consciences, mais surtout à comprendre comment nous en sommes arrivés là et, à partir de là, à définir une stratégie.
Justement, quel est cet antifascisme avec lequel vous appelez à renouer ?
Ugo Palheta : D’abord, cela suppose de refuser la normalisation du RN, sa banalisation. Employer le terme de fascisme, c’est rompre avec un récit anesthésiant et nommer clairement le danger. On le voit avec Netanyahou, Poutine ou Trump, l’extrême droite, ce ne sont pas que des discours, ce sont des actes : massacres (jusqu’au génocide à Gaza), arrestations et expulsions arbitraires, assassinats ciblés, etc.
Renouer avec l’antifascisme, c’est donc d’abord défendre notre camp social, qui inclut l’antiracisme, le féminisme, l’écologie sociale, toutes les luttes contre les dominations. Cette autodéfense est concrète : face aux agressions d’extrême droite, mais aussi pour protéger les droits fondamentaux des plus vulnérables. Mais l’antifascisme ne peut se limiter à la défense. Il doit redevenir un moteur politique, un point de ralliement. L’été dernier, un front commun a brièvement émergé à partir du ciment que constitue l’antifascisme et il faut prolonger cette dynamique : parce que l’extrême droite s’en prend à tout le monde, il nous faut l’unité des mouvements d’émancipation contre elle.
Le problème, c’est que cela est resté cantonné aux élections. Le Nouveau Front populaire n’a pas donné lieu à des campagnes de terrain durables, faute de volonté commune et de travail collectif. Or la gauche est forte quand elle fait vivre les luttes, toutes les luttes : dans les quartiers, les villages, les universités et bien sûr les lieux de travail.
Il faut enfin livrer une bataille culturelle. Pas seulement démonter les mensonges du RN, mais convaincre qu’une politique alternative est possible. Beaucoup partagent nos idées mais n’y croient plus. Il faut restaurer cette confiance, mais aussi articuler les propositions d’urgence à un horizon positif. Ne pas se contenter de dire non aux politiques néolibérales ou répressives, mais formuler le projet d’une société libérée de l’exploitation, du racisme, du patriarcat. C’est ce que le mouvement ouvrier a longtemps su faire : relier les luttes immédiates à un projet global de transformation.
Comment le fascisme gagne la France, d’Ugo Palheta, la Découverte, 380 pages, 20,90 euros.
mise en ligne le 26 juin 2025
Contrôle d’identité au faciès : la France condamnée pour la première fois par la CEDH
Par Halima Taieb Amara sur https://www.bondyblog.fr/
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, jeudi 26 juin, la France pour un contrôle d’identité discriminatoire, une décision inédite. Elle a donné raison à Karim Touil, un Français contrôlé trois fois en dix jours, estimant que l’État n’avait pas apporté de « justification objective et raisonnable » à ces contrôles.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, jeudi 26 juin, la France pour un contrôle d’identité discriminatoire, une décision inédite. Elle a donné raison à Karim Touil, un Français contrôlé trois fois en dix jours, estimant que l’État n’avait pas apporté de « justification objective et raisonnable » à ces contrôles. Cette condamnation, la première du genre, repose sur une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État devra lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, les cinq autres Français – tous d’origine africaine ou nord-africaine – ont vu leurs recours rejetés. La Cour n’a pas retenu l’existence d’une discrimination dans leurs cas ou un constat de défaillance systémique dans le dispositif français de contrôle d’identité. Ces hommes, originaires de Roubaix, Marseille, Vaulx-en-Velin, Saint-Ouen et Besançon, avaient dénoncé des contrôles au faciès subis entre 2011 et 2012. Après des recours infructueux devant la justice française, ils avaient saisi la CEDH en 2017 et demandaient également que les autorités françaises soient contraintes d’adopter des mesures concrètes pour prévenir les contrôles discriminatoires de ce genre.
Un rapport du Défenseur des droits documente (une nouvelle fois) le caractère systémique des contrôles au faciès
Ce jugement intervient alors que les contrôles d’identité sont en forte augmentation en France. Une enquête du Défenseur des droits publiée mardi révèle qu’en 2024, 26 % des personnes interrogées ont été contrôlées par les forces de l’ordre au cours des cinq dernières années , contre 16 % en 2016. Les jeunes hommes reconnus comme étant arabes, noirs ou maghrébins sont particulièrement ciblés : ils ont quatre fois plus de risques d’être contrôlés, et douze fois plus pour un contrôle « poussé » (fouille, palpation, injonction de quitter les lieux, tutoiement ).
Cette étude analyse les pratiques policières en France et met en lumière les discriminations dans les interactions quotidiennes entre les forces de l’ordre et certains citoyens.
mise en ligne le 26 juin 2025
Montpellier : face aux coupes budgétaires sur le social, le secteur monte sa coordination de luttes
Elian Barascud Publié le 26 juin 2025 à 14:38
Ce jeudi 26 juin, les salariés grévistes de l’association de prévention spécialisée de l’Hérault (APS 34) ont organisé un nouveau rassemblement sur la place de la Comédie pour protester contre des suppressions de postes. D’autres acteurs du secteur, également touchés par des coupes budgétaires, étaient présents. Ils envisagent une assemblée générale collective et des actions communes
Les salariés de l’association de prévention spécialisée de l’Hérault (APS 34) commencent à avoir l’habitude de prendre la rue. Au printemps dernier, ils étaient mobilisés contre de potentielles coupes budgétaires du Département de l’Hérault, qui leur avait finalement promis de maintenir leur budget. Mais début juin, Kléber Mesquida, président du Département de l’Hérault, est revenu sur ses engagements, et 12 postes d’éducateurs sont désormais menacés. Après un premier rassemblement la semaine dernière, ils étaient en grève et ont organisé un nouveau rendez-vous sur la place de la Comédie ce jeudi 26 juin avec d’autres acteurs du social.
“On est en train de connaître une vague de licenciements inédite dans notre secteur”, explique Max Muller, salarié d’APS 34 et militant à la CGT action sociale 34. Car APS 34 n’est pas la seule association concernée. Gérald Verrier, délégué central CGT de l’association ADAGES, précise : “Dans notre association, ce sont 13 postes qui sont menacés d’ici la fin de l’année 2025 pour faute d’endettement, au centre social du quartier Croix d’Argent, à l’espace de vie sociale dans le quartier Sabines et dans le quartier de la Devèze à Béziers.”
“Ce sont 600 familles qu’on accompagne sur de l’apprentissage du français, de l’aide à l’insertion, et 300 jeunes qui viennent faire de l’aide aux devoirs chez nous qui seront impactés”, complète Perrine, salariée du centre social de la Croix-d’Argent. “On est censée être huit salariés, mais actuellement on est que quatre, les contrats précaires ne sont pas renouvelés”, souffle-t-elle.
Solidarité et coordination
“Les salariés d’APS 34 ont la pression, s’ils perdent dans leur grève, personne ne peut gagner”, affirme Philippe, salarié du CHU de Montpellier et militant à la CGT-hôpital, venu en soutien avec un chèque de 150 euros de la part de son syndicat pour alimenter la caisse de grève des éducateurs. Même chose pour la CGT-retraités de Montpellier, qui a donné 400 euros dans la caisse de grève. L’organisation trotskyste Révolution Permanente a quant à elle contribué à hauteur de 1 400 euros.
“Maintenant, il faut passer un cap, c’est tout le secteur qui est concerné, ce n’est pas seulement APS 34, nous sommes en train de monter une coordination pour agir ensemble”, continue Max Muller. Cette coordination a déjà prévu de se réunir en assemblée générale du secteur et d’organiser un prochain rassemblement le 4 juillet à 10 heures devant le Conseil Départemental de l’Hérault.
Pour soutenir les grévistes d’APS 34, voici un lien vers leur caisse de grève : https://www.cotizup.com/soseducs
La prévention spécialisée de l’Hérault menacée : « Nous sommes les seuls à pouvoir atteindre certains jeunes »
Cécile Hautefeuille sur www.medipart.fr
Faute de budget suffisant, l’association de prévention spécialisée du département pourrait licencier une dizaine d’éducateurs et fermer trois antennes. Les salariés dénoncent une catastrophe pour les quartiers populaires et les jeunes suivis. Ils manifestent le 26 juin à Montpellier.
Montpellier (Hérault).– Aller vers les habitantes et habitants des quartiers, c’est leur métier. Leur demander de l’aide, c’est plus inhabituel. Les salarié·es de l’association de prévention spécialisée de l’Hérault (APS 34) se déploient depuis plusieurs jours dans les quartiers prioritaires du département pour alerter sur les coupes budgétaires menaçant leurs emplois.
Selon leurs informations, quinze personnes, dont treize éducatrices et éducateurs spécialisé·es, pourraient être licencié·es à l’automne prochain avec la probable fermeture des services de Frontignan, Sète et Béziers et la suppression de deux postes dans le quartier de La Mosson, à Montpellier. L’annonce est tombée le 10 juin dans un courrier du département, principal financeur de l’association.
« La collectivité nous a menti, déplore Max, éducateur spécialisé à l’APS 34. Nous nous étions fortement mobilisés au printemps contre une possible baisse de subvention de 25 % et le département nous avait promis, les yeux dans les yeux, de maintenir son budget. Finalement, 35 % des effectifs pourraient disparaître, on nous a trahis. »
Sollicité, le département socialiste de l’Hérault dément avoir menti et renvoie la responsabilité à certaines communes qui le laissent assurer, seul, le financement de la prévention spécialisée alors qu’il n’en a pas vocation. « Le département a dès le début d’année été transparent, répond ainsi la collectivité à Mediapart. Dans un contexte contraint budgétairement, le maintien du dispositif dépendrait de la volonté des communes et de leur participation financière. C’est donc en fonction des réponses des communes, que ce budget prévisionnel [...] est par conséquence réadapté. »
Pour la collectivité, « la baisse des effectifs évoquée par l’APS 34 ne serait que la conséquence de cette non-volonté des communes de voir perdurer le dispositif », citant les exemples de Béziers et Sète. Montpellier, en revanche, a fait le choix de « maintenir une participation financière », souligne le département.
Après un premier rassemblement, le 19 juin, devant les bureaux du département, les salarié·es de l’association appellent à une nouvelle journée de grève et à une manifestation, jeudi 26 juin, sur la place de la Comédie à Montpellier. Avec l’espoir d’embarquer le plus de monde possible dans la lutte, en particulier les habitantes et habitants des quartiers. « Si on arrivait à monter un comité pour nous soutenir, ça serait incroyable », espère Max, par ailleurs syndiqué à la CGT Action sociale.
Situations d’errance
Pour mobiliser, les salarié·es de l’APS 34 labourent donc le terrain, quartier par quartier. Vendredi 20 juin, une dizaine d’entre elles et eux se sont installé·es devant la maison pour tous Léo-Lagrange de La Mosson, tracts et pétition posés sur une table de camping ; puis se sont engouffré·es dans les allées du marché pour les distribuer. « C’est une attaque sans précédent contre les quartiers populaires ! », lance l’un d’eux, en glissant un tract à une habitante. « Nos interventions auprès des jeunes vont être impactées », tente une autre, face à deux mères de famille qui écoutent attentivement. « Ça m’intéresse, parce que moi aussi, je travaille avec des enfants », leur répond l’une d’elles.
Les éducatrices et éducateurs spécialisé·es interviennent auprès des 12-25 ans et de leurs familles sur nombre de problématiques : accès aux droits, à la santé, au logement, lutte contre le décrochage scolaire, recherche d’emploi… Des activités de loisirs, sorties, vacances, peuvent aussi leur être proposées.
« Notre terrain, c’est la rue. Nous y sommes toute la journée et sommes les seuls à pouvoir atteindre certains jeunes », explique Laura Palancade, éducatrice spécialisée et salariée depuis deux ans à l’APS 34. Casquette vissée sur la tête, elle tire nerveusement sur sa cigarette électronique. Sa colère est patente. « Je suis sur le secteur centre-ville de Montpellier et j’accompagne principalement des jeunes majeurs en sortie de protection de l’enfance. Des jeunes en situation d’errance, de rue, de mal-logement ; avec des problématiques d’addiction, de prostitution, de santé mentale... », énumère-t-elle. Après un silence, elle reprend : « En fait, nous sommes en bout de chaîne des défaillances de la protection de l’enfance. C’est ça, maintenant, la prévention. »
Kader, 43 ans, habitant « depuis toujours » de La Mosson, se joint à la troupe. Salarié d’une association d’éducation populaire, il vient apporter son soutien au collectif. « Je les vois, sur le terrain. Je vois leur travail, leur engagement », dit-il, en montrant de la tête les éducatrices et éducateurs spécialisé·es. « Ils cassent la barrière entre les habitants de quartier et l’institution. Alors supprimer des postes et des financements, c’est encore plus les abandonner », soupire-t-il.
Kader déplore des décisions budgétaires « qui viennent de tout en haut » et ajoute : « On ne sait même plus d’où elles viennent tellement elles viennent de loin ! Mais elles finissent toujours par cogner le dernier maillon, le maillon faible. »
Dans ce contexte austéritaire, les collectivités renvoient la balle à l’État ou se la jettent entre elles. Dans le cas de l’APS 34, le département de l’Hérault affirme ainsi avoir développé, ces dernières années, « des conventions dans lesquelles les communes participaient à hauteur de 30 % des dépenses de personnel liées à la prévention spécialisée » et dit regretter que certaines « n’[aient] tout simplement pas exprimé le besoin pour cette politique publique majeure dans les quartiers prioritaires ».
De quoi excéder Max, éducateur spécialisé à La Mosson. « Jusqu’ici, le département se substituait à ce désengagement des mairies mais il ne veut plus le faire. De toute façon, qui paye quoi, qui se désengage, ce n’est pas mon souci. Nous, on défend notre profession. On défend le public qu’on accompagne. »
Il y a des gamines de la protection de l’enfance qui fuient, fuguent de foyer en foyer et se prostituent à 10 ans, à 13 ans. Elles n’ont plus aucun lien avec personne à part nous. Max, éducateur spécialisé
Ému, Max raconte les larmes, il y a quelques jours, d’une mère de famille qui venait d’apprendre les probables licenciements d’éducatrices et éducateurs spécialisé·es. « C’est une maman qui vient d’Algérie et a des difficultés à parler français. Elle prend des cours, elle s’acharne, elle essaie de s’en sortir. Dès qu’elle allume la télé, elle entend qu’on la traite de “soumise”, qu’on la critique parce qu’elle ne travaille pas... On est les seules personnes à l’accompagner. Elle m’a dit : “On m’enlève la seule aide que j’ai et après, on va me dire, c’est pas bien, tu restes à la maison, tu ne fais rien…” C’est insupportable ! »
Max dit aussi penser aux jeunes « qui n’ont plus aucun adulte dans leur entourage » et détaille : « Il y a des gamines de la protection de l’enfance qui fuient, fuguent de foyer en foyer et se prostituent à 10 ans, à 13 ans. Elles n’ont plus aucun lien avec personne à part nous. Je pense très fort à elles, je sais à quel point on est le dernier lien pour elles. Et ça, c’est fini… On abandonne ces jeunes qui sont en danger, exposés à un niveau de violence incommensurable et déjà polytraumatisés par leur parcours de vie. »
Dents serrées, Laura Palancade balaie les arguments financiers avancés par les collectivités. « C’est purement idéologique. Il n’y a aucune logique financière, car on ne coûte pas cher. On coûte moins cher qu’une mesure de placement, moins cher qu’une mesure d’investigation éducative, moins cher que des peines carcérales pour mineurs. Le message est clair : dans les quartiers, on préfère envoyer l’armée ou la police et l’accompagnement social, on s’en fout. »
Quand il y a de la casse, ce sont les éducateurs de rue qui viennent sauver tout le monde ! Kader, habitant de La Mosson
Évoquant les récentes attaques au couteau perpétrées par des mineurs, elle raille les pouvoirs publics : « Allez-y, faites-vous plaisir et mettez des portiques de sécurité partout, interdisez les téléphones et les réseaux sociaux. Ça ne réglera pas le problème de la précarité des quartiers, de la misère sociale et des gamins qui se sentent exclus ! »
Kader, venu soutenir les éducatrices et éducateurs, est tout aussi en rogne : « L’institution, elle est bien contente de les trouver quand il y a des problèmes ! », lance-t-il, en référence aux révoltes de 2023, après la mort de Nahel tué à Nanterre par un policier. « Dès le premier jour des émeutes à la Paillade [l’autre nom du quartier de La Mosson –ndlr], le maire a convoqué toutes les structures du quartier, y compris les acteurs de terrain – pas que les directeurs ! Quand il y a de la casse, ce sont les éducateurs de rue qui viennent sauver tout le monde ! »
Assis sur un banc, cigarette à la main, Max fixe du regard la maison pour tous du quartier. « Il y a deux semaines jour pour jour , François Bayrou était ici », lance-t-il, pensif. Le premier ministre et une partie du gouvernement sont venus à La Mosson le 7 juin pour le comité interministériel des villes, consacré aux quartiers populaires. « Et il a fait quoi, Bayrou ? Il est venu inaugurer un commissariat ! Tu vis dans des territoires extrêmement précarisés, qui subissent un nombre inimaginable de difficultés et la seule chose qu’ils ont à proposer... c’est un commissariat ! C’est le sécuritaire opposé au préventif. »
Max montre du doigt une tour d’habitation en face, dont le dernier étage est totalement brûlé. « Ça fait deux ans et demi et la famille n’est toujours pas relogée, mais la police, elle, a des locaux tout neufs », lâche-t-il, dépité.
L’attente des licenciements
Les salarié·es de l’APS 34 attendent désormais le « document tarifaire » officiel, qui viendra préciser le nombre de licenciements et les quartiers prioritaires concernés par les suppressions de poste. Auprès de Mediapart, le département assure qu’« un dialogue a été entamé [...] avec la gouvernance de l’association afin d’étudier les solutions possibles pour limiter l’impact de ce non-soutien financier de certaines communes », et dit avoir proposé « de permettre à des éducateurs dont la mission s’arrêterait d’être intégrés au sein du département sur des postes vacants de travailleurs sociaux ».
La collectivité insiste : « La prévention de la délinquance des jeunes est un sujet majeur pour nos territoires et l’avenir de la jeunesse, le département tient à réaffirmer son engagement aux côtés des acteurs sociaux de la protection de l’enfance. »
Max, lui, est persuadé qu’il fera partie des personnes licenciées : « Je suis le numéro un sur la liste selon les critères d’âge et d’ancienneté. Je n’ai pas d’enfant, je ne suis pas diplômé, je n’ai pas le permis. » Laura Palancade abonde : « Ceux dont les licenciements coûteront moins cher vont partir et j’en serai. Les autres partiront l’année prochaine parce que les budgets ne seront pas maintenus, c’est certain. » Et conclut, en baissant la tête : « La prévention spécialisée est morte. Ce mouvement social, on devrait le faire avec des cercueils, parce qu’on est en train d’enterrer la prévention. »
mise en ligne le 25 juin 2025
Il était une fois…
Gaza avant le 7 octobre
Eva Sauphie sur https://orientxxi.info/
Le nouveau film des frères Nasser, Once Upon a Time in Gaza, nous plonge dans le quotidien de trois Gazaouis en 2007, au moment du blocus de la bande de Gaza imposé par Israël. Le long-métrage, en salles ce mercredi 25 juin, a été présenté à Cannes peu de temps avant la mort de la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée par un missile israélien et qui était au cœur du film Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, lui aussi présenté au festival.
Once upon a time in Gaza
réalisé par Tarzan Nasser et Arab Nasser
avec Nader Abd Alhay, Majd Eid et Ramzi Maqdisi
sortie le 25 juin 2025
durée 1h27
Le chant des oiseaux et le son des vagues habillent le générique d’ouverture. Puis une voix familière se fait entendre, celle de Donald Trump. « Le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. On a l’opportunité d’en faire quelque chose de phénoménal. »
C’est avec cette énième sortie du président étatsunien qui annonçait, en février 2025, vouloir transformer l’enclave palestinienne en station balnéaire que commence le film des frères Nasser. Leur troisième long-métrage Once Upon a Time in Gaza (« Il était une fois à Gaza ») a été tourné bien avant cette déclaration. Mais Arab et Tarzan Nasser1 en ont ajouté des bribes en toute fin de montage pour rendre compte de l’absurdité et du mépris jusqu’au-boutiste dont témoigne Trump à l’égard des Palestiniens. Et du silence de la « communauté internationale ». Arab Nasser, que nous rencontrons à quelques heures de l’avant-première parisienne, fustige :
Après plus d’un an de souffrance, d’humiliation et d’enfermement, Trump est arrivé au moment le plus douloureux pour les Palestiniens, celui du génocide, pour nous dire de quitter notre terre, et nous suggérer une relocalisation en Indonésie. C’est le plus grand cri de racisme et de violence jamais perpétré à l’encontre des Palestiniens. On en entend des absurdités depuis des années, mais je crois que Trump est le plus créatif.
Derrière le sarcasme du cinéaste se cache l’épuisement. Épuisement devant l’immobilisme généralisé face à la situation des Gazaouis — près de 56 000 personnes tuées par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre 2023, sans compter les corps toujours ensevelis sous les décombres. Mais l’histoire que dépeignent les jumeaux gazaouis, qui prennent toujours Gaza comme cadre pour leurs films, n’est pas celle du 7 octobre, même si elle permet d’en comprendre l’avènement. Once Upon a Time in Gaza brosse avant tout le portrait d’une population qui ne compte pas capituler.
Une prison à ciel ouvert… avant la peine de mort
Nous sommes en 2007, au moment de la prise de pouvoir du Hamas et du blocus de la bande de Gaza imposé par Israël. Yahya est un étudiant un peu paumé et Oussama est dealer. Ensemble, ils se lancent dans un trafic de médicaments en falsifiant des ordonnances. Du bricolage, en somme, pour vivre et survivre dans cette bande de terre où s’achève la construction par Israël d’un mur de 60 km, qui finit de mettre les Gazaouis dans un état d’enfermement physique et psychologique. Aux côtés du duo, un troisième personnage : Abou Sami. Ce policier corrompu exerce son petit pouvoir en intimidant Oussama, jusqu’à commettre l’irréparable. Quant à Yahya, il se voit recruté par le gouvernement pour jouer le héros martyr d’un film d’action.
J’ai choisi cette date plus ou moins officielle, car elle correspond au moment où les Israéliens ont déclaré Gaza comme zone ennemie. Ce mur n’est que le miroir d’un apartheid violent. À partir de 2007, deux millions de personnes, deux millions de rêves, deux millions d’idées ont été officiellement mis dans une prison à ciel ouvert. C’est comme si on avait dit aux Gazaouis d’attendre leur jugement avant la peine de mort. Et voilà, maintenant : la peine de mort.
C’est aussi en réponse à l’amnésie générale que le duo a choisi cette année-là : « On a l’impression que les gens ont oublié ce qu’il se passait à Gaza avant le 7 octobre, qu’il y avait un siège israélien. » « Il était une fois à Gaza » n’est pas un titre en forme de conte. Il a été choisi pour rappeler que, fut un temps, il y avait des gens qui essayaient de s’en sortir sur le territoire.
Les trois protagonistes, écrits à l’image du western spaghetti Le Bon, la brute et le truand (Sergio Leone, 1966), n’ont rien d’héroïque. Ils sont tantôt du côté du bien et de la bonté, tantôt du côté du mal et de la brutalité. Non par choix personnel, mais bien parce que le contexte de l’occupation les y oblige. « Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je t’ai suivi dans un monde qui n’est pas le mien », lance Yahya à son camarade. « Tu crois que c’est le mien ? », rétorque Oussama. Cet échange-clé du film illustre la situation dans laquelle est plongé le trio. Tout comme le reste de la population, les personnages du film essaient tant bien que mal de poursuivre le cours de leur existence.
Montrer l’avant 7 octobre 2023
Tourné en Jordanie, ce film de méta-cinéma, où s’imbriquent l’histoire du tournage d’un film de propagande et des incursions de journaux télévisés, retranscrit la vie quotidienne d’une population dont l’humanité a été niée. Il tente d’en capter la normalité malgré les bombardements filmés en toile de fond. Les frères Nasser se sont toutefois interrogés sur le bien-fondé de leur récit.
L’écriture du scénario débute en 2015, un an après la guerre de 2014. Parallèlement, le duo planche sur la réalisation de Gaza mon amour, sorti en 2021. Quand survient le 7 octobre 2023, ils interrompent l’écriture de Once Upon a Time pendant cinq mois. Arab rembobine :
Revenir à la fiction était trop difficile face aux images réelles de corps lacérés et de meurtres qu’on recevait chaque jour. On s’est demandé, avec mon frère, ce qu’on pouvait bien raconter face à cette réalité-là. Puis on a réalisé qu’il fallait continuer à écrire pour montrer cette période d’avant le 7 octobre, pour montrer la vie de ces prisonniers, comment ils vivaient et comment ils luttaient aussi.
Cette lutte se traduit aussi dans les petites choses, comme dans cette volonté de construire du lien. Si Gaza mon amour racontait une histoire d’amour sous les bombes, Once upon a time in Gaza décrit une histoire d’amitié. « Quand il y a des coupures d’électricité, qu’il n’y a plus rien à faire, on va chez un pote. La conversation nous maintient en vie. Pour moi, c’est un luxe de pouvoir être avec un ami et que l’échange soit préservé », raconte le cinéaste qui a quitté Gaza, en 2012 pour la Jordanie.
Depuis juin 2017, Arab et Tarzan Nasser ont le statut de réfugiés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Une grande partie de leur famille est encore à Gaza. Elle a refusé de se déplacer vers le sud de la bande, et vit toujours dans le nord, qui souffre le plus de la famine imposée par Israël. Seuls leurs frères Amer, coscénariste du film, et Abboud, graphiste sur le projet, sont sur le sol français. Amer et Abboud ont bénéficié, après le 7 octobre, d’une bourse délivrée par le dispositif Pause dédié à l’accueil d’urgence de chercheurs et d’artistes en exil. Ce programme, créé en 2017 au sein du Collège de France, financé par deux ministères français et soutenu par le comité Ma’an for Gaza artists — lancé par les chercheuses françaises Marion Slitine, compagne de Arab, et Charlotte Schwarzinger —, permet d’obtenir un visa talent. Aujourd’hui, 12 des 59 lauréats palestiniens sélectionnés sont toujours bloqués à Gaza. En mai 2025, une tribune dans Le Monde intitulée « Lauréats de Pause, un programme français d’accueil, des chercheurs et artistes palestiniens sont toujours bloqués à Gaza », signée notamment de l’historien Patrick Boucheron et du sociologue Didier Fassin, dénonçait le fait que « le gouvernement français […] ne mette pas tout en œuvre » pour l’accueil des lauréats du programme, après la mort de l’un d’entre eux — Ahmed Shamia, architecte de 42 ans — grièvement blessé quelques jours auparavant dans un bombardement israélien. « Le processus passe par le consulat, et c’est très long », tient à souligner Arab.
« Un misérabilisme mal venu »
Avant de rejoindre Paris avec son frère Tarzan pour l’avant-première de Once Upon a Time in Gaza, Arab Nasser a d’abord présenté le film au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard. Pour le cinéaste, si l’Académie du festival a été contrainte de parler de Gaza, c’est uniquement en raison de la sélection du film Put Your Soul on Your Hand and Walk (« Mettez votre âme sur votre main et marchez ») de Sepideh Farsi consacré à la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna. Un mois avant le festival, le 16 avril 2025, celle que l’on surnommait Fatem a été tuée avec sa famille par un missile israélien ayant frappé sa maison. Pour Arab Nasser, Cannes a en réalité invisibilisé Gaza :
Pour d’autres causes, il y a eu des dénonciations, des discours, mais quand ça touche les Palestiniens il y a une sorte d’omerta. Et ça ne concerne pas seulement Cannes. Les prises de parole sont faibles et témoignent d’une empathie et d’un misérabilisme souvent mal venus.
Le discours bien timide de Juliette Binoche, présidente de la 78e édition du festival, en est un parfait exemple : rendre hommage à Fatima Hassouna, tout en évitant soigneusement de mentionner la responsabilité israélienne.
Une conférence en l’honneur de la photojournaliste a bien été organisée à l’initiative de Sepideh Farsi, en présence de plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières. Mais là encore, le bât a blessé. Alors qu’elle devait se tenir au prestigieux Hôtel Majestic, où le cortège de stars internationales a coutume de loger et de défiler, l’événement a finalement eu lieu au Pavillon Palestine. Un rétropédalage qui n’a rien d’étonnant pour le réalisateur gazaoui. Il signera, aux côtés de plus de 300 personnalités du monde du cinéma, la tribune intitulée « À Cannes, l’horreur de Gaza ne doit pas être silenciée », publiée sur le site de Libération le 12 mai, à la veille du lancement du festival. Le réalisateur s’interroge :
Je ne sais pas ce qu’attend le monde pour réagir. Nous n’avons pas besoin de soutien par pitié. Je voudrais que les gens nous soutiennent parce qu’ils croient en notre cause et en la justice. Comment peut-on rester silencieux alors qu’on est témoin d’images d’enfants démembrés tous les jours ? Les populations se mobilisent, mais quand est-ce que ceux qui ont les décisions en main vont réagir ?
S’il ne peut se substituer aux décideurs, Arab Nasser espère que le cinéma a au moins encore un impact sur les consciences.
mise en ligne le 25 juin 2025
« Union des droites » :
Éric Ciotti, l'atout du RN pour séduire
les milieux patronaux
Florent LE DU sur www.humanite.fr
Un an après son alliance avec le Rassemblement national, le Niçois et son parti, l’UDR, sont devenus un atout essentiel pour Marine Le Pen et Jordan Bardella pour attirer l’électorat de droite et séduire les milieux patronaux.
Plus qu’une intégration, c’est une assimilation. À l’extrême droite, Éric Ciotti est chez lui. Quelques semaines après la parution de son livre, Je ne regrette rien, chez Fayard, propriété de Vincent Bolloré, dans lequel il revient sur son alliance avec le Rassemblement national lors des dernières législatives, le fondateur de l’Union des droites pour la République (UDR) a sorti la brosse à reluire pour Marine Le Pen à l’occasion de la niche parlementaire de son groupe, jeudi 26 juin.
Les textes que les députés ciottistes présenteront à l’Assemblée nationale suivent les obsessions de l’extrême droite : dénoncer les accords avec l’Algérie, faire payer des « frais d’incarcération » aux prisonniers, mettre en place une politique nataliste et des peines planchers… Une en particulier retient l’attention : celle « supprimant la possibilité d’assortir la peine complémentaire d’inéligibilité d’une exécution provisoire ». Avec l’objectif, donc, de sauver la tête de la patronne, qui en a écopé le 31 mars dernier, la rendant inéligible pour 2027, en attendant l’appel.
Le RN sort de l’isolement
Une sorte d’allégeance d’Éric Ciotti envers son nouveau camp. Depuis sa rupture rocambolesque avec Les Républicains, le député entretient avec Marine Le Pen et Jordan Bardella une relation chaleureuse dans laquelle chacun se retrouve. L’ex-président de LR a sauvé son poste de député et vise la mairie de Nice. Quant au RN, il possède désormais une autre force politique à son service, pour relayer ses propres idées et poursuivre sa normalisation.
« Stratégiquement, cette alliance est utile au RN, analyse Bruno Cautrès, politologue au Cevipof. Les enquêtes d’opinion montrent que l’image du parti ne cesse de s’améliorer mais il reste perçu comme isolé. Or, cela lui pose problème dans son objectif d’être vu comme un parti de gouvernement. » Alors qu’il y a cinq ans le RN était le seul véritable parti d’extrême droite en France, avec lequel Les Républicains prenaient encore ses distances, il a depuis été rejoint dans cet espace par Reconquête et l’UDR, tout en restant hégémonique.
Le repli identitaire à la sauce ultralibérale
Cette journée d’initiative parlementaire est ainsi l’occasion pour les troupes de Marine Le Pen de sortir un peu plus d’un isolement devenu très relatif. L’UDR pourrait y faire adopter des propositions de loi, ce que le RN a toujours échoué jusqu’ici. « Ce serait un vrai précédent contre ce cordon sanitaire scandaleux », s’enthousiasme le ciottiste Charles Alloncle dans l’Opinion.
Les macronistes, qui ont consigne de ne pas voter les textes lepénistes lors des niches, ont consacré plusieurs réunions, ces derniers jours, à cette question. Ils semblent prêts à franchir le pas. En commission, trois propositions de loi ont été adoptées. Ce jeudi en séance publique, si l’opération de sauvetage judiciaire de Marine Le Pen n’a a priori aucune chance d’aboutir, la majorité du « socle commun » serait favorable au texte interdisant aux personnes visées par une obligation de quitter le territoire (OQTF) de se marier en France.
Il s’agirait d’une énième dérive extrême droitière du camp présidentiel. Et d’une victoire par ricochet du RN dans son objectif d’apparaître comme « prêts à gouverner ». Une quête qui obsède le parti depuis 2022, ce qui l’a poussé à entamer une grande opération séduction des milieux d’affaires. Dans ce contexte, la prise de guerre ciottiste est un gage.
Le patronat prêt à basculer ?
Fascinés par le président argentin Javier Milei, le Niçois et son parti cherchent à copier son cocktail de repli identitaire et d’ultralibéralisme. L’UDR plaide pour la retraite à 65 ans, la fin des 35 heures, les accords de libre-échange, une coupe de 220 milliards d’euros dans les dépenses publiques et de 250 000 postes de fonctionnaires, ou encore l’instauration d’un taux unique pour l’impôt sur le revenu, entre 5 et 15 %. Un paradis pour le Medef, dont l’ancien président Pierre Gattaz était en avril « l’invité d’honneur » d’une soirée de présentation du programme fiscal du parti d’extrême droite.
« Le ralliement d’Éric Ciotti est, pour nous, un très bon signal, confie un industriel français, habitué des rencontres d’Ethic, organisation patronale dirigée par Sophie de Menthon qui auditionne régulièrement des personnalités politiques. Depuis plusieurs mois, le RN va dans le bon sens pour rassurer le milieu. Nous n’y sommes pas encore, son programme reste emprunt de stigmates socialistes (sic) mais l’influence de Ciotti est séduisante. Si Le Pen annonçait qu’elle le nommerait à Bercy, ça changerait beaucoup de choses. »
Les dirigeants du RN le savent. Ce n’est pas un hasard si, en juin 2024, en pleine campagne des législatives, Jordan Bardella s’est rendu à l’audition du Medef avec un « invité surprise » : Éric Ciotti. « Beaucoup de patrons se disent prêts à franchir le pas si Marine Le Pen fédère une union des droites autour d’elle, ajoute notre interlocuteur. Ça en prend le chemin. » L’ancien président de LR barricadé dans ses locaux fermés à double tour rêve désormais de crever le plafond de verre du RN.
mise en ligne le 24 juin 2025
Accès à l’eau potable en Outre-Mer : dix associations dénoncent une « discrimination environnementale territoriale »
Jessica Stephan sur www.humanite.fr
Boire, se laver, manger… Autant de gestes du quotidien qu’une partie des citoyens français des Outre-Mer ont des difficultés à réaliser, en raison des problèmes d’infrastructure, des contaminations ou des tarifs de l’eau. Les associations dénoncent une « discrimination environnementale territoriale »
En matière d’eau potable, l’égalité territoriale est loin d’être respectée. Trois millions de personnes en France subissent des difficultés pour y accéder, rappelle un rapport de plusieurs ONG, rendu public ce lundi 23 juin. Intitulé « Soif de justice », il dénonce les inégalités d’accès à l’eau dans les Outre-Mer et tire la sonnette d’alarme sur les conséquences en termes sanitaires ainsi que pour les droits fondamentaux.
Dix associations, locales et nationales, sont à l’origine de cette alerte, déterminées à dénoncer une « discrimination environnementale territoriale » : L’ASSAUPAMAR (Martinique), le Collectif des luttes sociales et environnementales, Guyane Nature Environnement, Kimbé Rèd F.W.I. (Antilles), Lyannaj pou dépolyé Matinik, Mayotte a soif, Mayotte Nature Environnement, Notre Affaire à Tous, Sillages (La Réunion), et l’association VIVRE (Guadeloupe). Selon elles, la situation ne pourra pas être résolue tant qu’elle ne sera pas pleinement reconnue en tant que discrimination.
Plusieurs causes pour une même difficulté
Leur rapport sera donc transmis au rapporteur spécial des Nations Unies sur l’accès à l’eau potable pour « donner un éclairage international sur cette discrimination territoriale structurelle, et pousser la France à se prononcer et à avancer sur ces questions », indique Emma Feyeux, responsable de projet au sein de Notre Affaire à Tous.
Difficultés techniques ou d’infrastructures engendrant des coupures d’eau régulières, pollutions, tarification très élevée… Plusieurs causes sont pointées pour une même difficulté : l’accès à l’eau potable, pourtant reconnu comme un droit fondamental par le droit international et européen.
« Une des causes profondes de ces situations relève de la discrimination systémique entre les territoires ultramarins et l’Hexagone », dénonce Sabrina Cajoly, fondatrice de Kimbé Rèd FWI. Pour preuve, explique-t-elle, les « territoires français des Outre-mer sont exclus d’un traité des droits de l’homme, la Charte sociale européenne, qui porte sur tous les droits économiques et sociaux, y compris l’accès à l’eau. »
« En Guadeloupe, il y a eu du chlordécone dans l’eau du robinet »
En cause également, selon les ONG, un manque de mobilisation au niveau national et de compréhension de ces problématiques, mais également une dilution des compétences : « En matière d’accès à l’eau potable, il reste très difficile d’agir en responsabilité de manière globale du fait du nœud de compétences » estime Emma Feyeux. L’État renvoie aux collectivités, qui sont compétentes en la matière mais manquent de moyens. Et de nombreux acteurs interviennent : « Il reste difficile de remonter la chaîne des responsabilités », poursuit-elle.
Alors que les impacts sont multiples : sur le droit à la dignité humaine, la santé, la vie privée… Et les conséquences très concrètes, rappelle Sabrina Cajoly, sur la base de travaux de l’Unicef : « En Guadeloupe, les enfants perdent plus d’un mois de cours par an en moyenne du seul fait des coupures d’eau et de pollution de l’eau à l’école. » Les conséquences sont également sanitaires, comme dans le cas des contaminations au chlordécone, un pesticide utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993 et aux effets nocifs sur la santé pourtant connus.
« En Guadeloupe, il y a eu effectivement du chlordécone dans l’eau du robinet », explique Régis Huyet, militant au sein de Lyannaj pou dépolyé Matinik. Or, les politiques publiques sont à tout le moins insuffisantes. Le Plan Chlordécone IV, fustige-t-il, « affiche clairement qu’il ne cherche pas à faire une dépollution. Le but est de faire en sorte que les Antillais apprennent à vivre avec le chlordécone. »
« Un véritable sous-investissement chronique dans les territoires de l’outre-mer »
Pour s’attaquer à cette inégalité, le rapport insiste sur la nécessité d’un changement de paradigme, vers une justice environnementale, d’autant que ces difficultés seront encore accentuées par le changement climatique. Et demande des moyens, qui sont aujourd’hui largement insuffisants rappelle Sabrina Cajoly : « En Guadeloupe, pour l’accès à l’eau potable, le budget annoncé est de 320 millions d’euros sur quatre ans. Il est présenté comme colossal, alors qu’une enquête parlementaire évalue à 1,5 à 2 milliards le budget nécessaire pour remédier à la question de l’eau potable seulement en Guadeloupe. »
Quant à la pollution au chlordécone, la situation est « pire », souligne-t-elle. « Le budget total, pour Guadeloupe et Martinique, donc plus de 750 000 personnes, est de 130 millions sur cinq ans, et concerne tous les domaines : tant l’impact environnemental que la pollution de l’eau, de la santé, l’indemnisation des personnes. »
Un scandale qui ne date pas d’hier, analyse Sabrina Cajoly : « Il y a un véritable sous-investissement chronique dans les différents territoires de l’outre-mer, historique mais qui est toujours d’actualité. » Ce nouveau rapport vient le rappeler, pour inciter les pouvoirs publics à agir à la hauteur de la situation.
mise en ligne le 24 juin 2025
Malgré sa diabolisation,
La France Insoumise maintient
sa stratégie du conflit
Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Les cadres du mouvement jugent illusoire l’idée qu’en changeant de stratégie sur la forme, leur disqualification médiatico-politique cesserait. Face à l’intensification des attaques et des accusations d’antisémitisme, ils s’adaptent pour ne pas donner d’« accroches ».
« Il faut essayer de comprendre le phénomène dans une dynamique politique. » Pour Manuel Bompard, la diabolisation de La France insoumise (LFI) est une évidence qui nécessite désormais de prendre de la hauteur. C’est pour le coordinateur national du mouvement une forme de « harcèlement permanent », un « deux poids et deux mesures » médiatique, politique et institutionnel qui vise à abattre le premier parti de gauche de France en s’affranchissant de la raison et des faits. On ne peut donc en faire qu’une lecture politique, sous l’angle de la fusion des droites et de la bollorisation des médias.
Cette analyse est en partie partagée au-delà des rangs insoumis. Même Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) qui défend désormais une candidature commune de la gauche hors LFI à la présidentielle, s’est inscrit en faux contre ce phénomène, qui n’est plus seulement l’apanage de la droite et de l’extrême droite. Il l’a dit à la tribune du congrès du PS à Nancy (Meurthe-et-Moselle) le 15 juin : « Je ne répondrai pas aux injonctions de la droite et de l’extrême droite qui rêvent de blanchir leurs convergences coupables en diabolisant la gauche radicale ! »
Les causes de cette répudiation peuvent être considérées comme lointaines. Dès qu’il s’est émancipé du PS, Jean-Luc Mélenchon a théorisé sa relation conflictuelle aux médias en anticipant, selon sa propre vision politique, la guerre à outrance immédiate que lui livrerait le capital s’il arrivait au pouvoir. Ce parti pris s’est traduit par de multiples outrances, du « petite cervelle » lancé à un étudiant en journalisme en 2010, aux journalistes de « Quotidien » interdits de couvrir ses meetings en 2019 – il reprochait à l’émission les images filmées lors de la perquisition au siège de son parti en 2018 –, en passant par de régulières attaques ad hominem contre des journalistes de presse écrite sur son blog.
La médiatisation du fondateur de LFI ne pouvait donc qu’être un terrain d’affrontement durable. Dès 2013, le chercheur en histoire visuelle André Gunthert consacrait d’ailleurs un article à la « généalogie de la diabolisation visuelle » de Jean-Luc Mélenchon.
Depuis, le triple candidat à la présidentielle a parfois mis le populisme de gauche en mode mineur, facilitant l’union des gauches en 2022 et une accalmie médiatique, comme l’analysait le politiste Arthur Borriello. Pôle émergent à gauche au début des années 2010, LFI a été propulsée au premier plan politique, ce qui aurait pu produire un changement d’optique. « Si la stratégie du “bruit et de la fureur” permet de marquer des points idéologiquement, elle peut aussi donner des munitions à nos adversaires et rabougrir notre propre base », prévenait le député Hendrik Davi, avant d’être purgé de LFI.
Une puissante mécanique de délégitimation
Mais la rupture avec le Nouveau Front populaire (NFP), dont le Parti socialiste (PS) est rendu seul responsable en raison de son abstention sur la motion de censure début 2025, a remis la stratégie du conflit au goût du jour. Et ce retour coïncide avec une période nouvelle de la diabolisation de LFI commencée après le 7-Octobre. La création d’une commission d’enquête parlementaire « contre LFI » obtenue le 18 juin par le patron des député·es Droite républicaine (DR) Laurent Wauquiez, sur ses supposés liens avec « l’idéologie islamiste », en est le symptôme le plus criant.
Mais déjà lors de l’hommage à Robert Badinter en février 2024, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, arrivé tôt, était apparu seul, les bras croisés, tel un symbole de l’ostracisation du mouvement – et il y en a eu d’autres –, tandis qu’Éric Ciotti, futur allié de Marine Le Pen, serrait des mains à tout-va.
Le débat sémantique assumé par la direction de LFI sur le caractère « terroriste » des attaques du Hamas et les fautes de Jean-Luc Mélenchon sur l’antisémitisme n’y sont pas pour rien. Mais la nature des attaques déversées depuis sur l’ensemble du mouvement – parfois à grand renfort de fausses informations et qui se sont traduites par la dégradation du domicile de Jean-Luc Mélenchon et des demandes de déchéance de nationalité contre l’eurodéputée Rima Hassan –, l’ont fait basculer dans une dimension quasi orwellienne.
Le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon, qui a frôlé les 22 % de suffrages exprimés à la dernière présidentielle, est ainsi érigé en repoussoir politique et moral. Et sa mise au ban dépasse largement les seuls médias d’extrême droite. De la base au sommet, des militant·es et des responsables de LFI, qui subissent les conséquences de la diabolisation, s’interrogent donc sur la manière d’y résister. Ne faudrait-il pas chercher à désarmer l’animosité ?
« Il y a une maccarthysation du débat public. On est revenus à une période de criminalisation de la parole contestatrice, et ça va bien au-delà des rangs de LFI », préfère considérer Manuel Bompard, pensant notamment au sort réservé à l’éditorialiste Jean-Michel Aphatie.
Le chercheur Johan Faerber, auteur de Militer. Verbe sale de l’époque (Autrement, 2024), qui étudie finement la fabrique du « réprouvé » en politique, partage en partie cette analyse : « LFI est assimilée au parti de l’étranger, une fable d’extrême droite qui procède depuis le XIXe siècle avec les mêmes mécanismes de délégitimation, et qui bénéficie aujourd’hui d’une puissance économique avec un réel pouvoir – notamment celle de Pierre-Édouard Stérin [un milliardaire ultraconservateur qui rêve de porter l’extrême droite au pouvoir – ndlr]. LFI est prise dans les mailles du filet d’un récit antimilitant, anti-opposition », résume-t-il.
Il n’y a pas d’alternance tranquille. Danièle Obono, députée LFI
Mais ce diagnostic devrait, aux yeux du chercheur, pousser les Insoumis à réagir : « Cela ressemble à une submersion. LFI est privée de son propre récit, elle ne peut plus rien énoncer, et ne peut que dénoncer. C’est très difficile à rétablir car pour faire des propositions, il faut être audible, or plus personne ne veut ni ne peut les écouter. »
Les cadres de LFI interrogé·es insistent pourtant d’abord sur la « dynamique politique » qui les place dans cette situation. « La diabolisation, la détestation de La France insoumise, est le ferment de la recomposition politique en cours, c’est-à-dire du rapprochement de la droite et de l’extrême droite », estime Manuel Bompard. Élu président du parti Les Républicains (LR), Bruno Retailleau a bien déclaré : « Nos seuls adversaires, c’est la gauche de Mélenchon », plaçant de manière subliminale le RN au rang de potentiel allié.
« On ne peut pas faire cette analyse sur la diabolisation sans penser en termes de radicalisation du bloc bourgeois, qui est prêt à s’allier avec les fascistes », explique aussi la députée LFI Danièle Obono. « Nous sommes pris pour cibles par les aspirants au pouvoir d’extrême droite parce qu’on représente l’organisation de gauche qui peut prétendre au pouvoir. Il n’y a pas d’alternance tranquille », ajoute-t-elle, rappelant que Léon Blum comme le Parti communiste français (PCF) ont fait l’objet des mêmes stigmatisations en leur temps.
Le boomerang de la conflictualité
Cette analyse, si elle s’appuie sur une droitisation réelle des élites médiatiques et politiques, fait abstraction des provocations des cadres du mouvement ces dernières années, qui ont permis à leurs adversaires de faire le vide autour de LFI. Le mouvement en avait tiré les conséquences après les législatives de 2024 en modifiant l’attitude du groupe à l’Assemblée nationale, englué dans les polémiques à répétition.
C’est sur ce point de clivage, entre autres, que François Ruffin a fini par rompre avec LFI, comme Clémentine Autain et leurs camarades de L’Après.
Dans une longue émission d’« Au Poste » le 30 mai 2024, Manuel Bompard revendiquait une « stratégie du coup de pied dans la porte » en matière de communication médiatique et de diffusion des idées. « Vous tapez un bon coup de pied dans la porte et après vous pouvez rentrer, vous pouvez développer vos arguments de manière tranquille », disait-il.
Réinterrogé à ce sujet par Mediapart quelques mois plus tard, le député nuançait : « Ce n’est pas la même chose de s’emparer de sujets qui fâchent en assumant de casser des unanimismes, et de passer son temps à répondre à des polémiques inventées de toutes pièces. Je vois bien qu’il y a des tentatives de diversion du système, et qu’il vaut donc mieux bien choisir ses angles de conflictualité. »
La stratégie de la première force de gauche en 2025 n’est pas si éloignée de celle des origines, quand au Parti de gauche en 2013 Danielle Simonnet théorisait : « Le conflit crée de la conscience. »
Si cette stratégie est malgré tout maintenue, c’est parce que les Insoumis sont convaincus que la conflictualité leur permet d’atteindre un électorat éloigné de la politique – le fameux « quatrième bloc », celui des abstentionnistes, comme l’analysait Jean-Luc Mélenchon au sortir du premier tour de la présidentielle de 2022. Un électorat auquel il faut s’adresser longtemps avant l’élection afin qu’il se mobilise le cas échéant, et permette à la gauche d’accéder au second tour.
« Pour ça, il faut rompre un peu avec le ronron médiatique et produire une conflictualité forte, qui peut temporairement faire douter des gens qui aspirent à une proposition politique plus consensuelle. Mais la question se pose à la fin, pas au milieu du chemin », estime Manuel Bompard. « Est-ce qu’il y a des gens qui sont influencés par ces campagnes de dénigrement médiatique et se disent que nous sommes allés trop loin ? Ça peut arriver, évidemment. La question, c’est de savoir si c’est durable. Or je pense que personne, dans l’espace politique qu’on aspire à rassembler, ne pense sincèrement que La France insoumise est un mouvement qui promeut l’antisémitisme », poursuit-il.
Preuve que les conséquences de la diabolisation des Insoumis sont désormais prises très au sérieux par l’état-major du parti, l’Assemblée représentative du mouvement, organisée le week-end du 21 et 22 juin à Paris, a donné lieu à une kyrielle de nouvelles mesures internes pour parer au problème.
Considérant que « la riposte face aux attaques est devenue indispensable », LFI a décidé de se structurer sur ce point. Outre la mise en place d’une plateforme internet dédiée où les militant·es et les cadres pourront trouver des arguments de « désintox », le mouvement promet de développer des « dispositifs pour assurer la sécurité des militants et leur accompagnement juridique » dans un contexte de « fascisation » de la société.
De nouvelles équipes de service d’ordre seront ainsi mises en place dans plusieurs départements et des formations seront entreprises « afin de pouvoir partout mener la bataille politique et faire face aux intimidations et aux menaces ». Enfin, afin d’éviter les « procédures bâillons », LFI annonce qu’elle mettra à disposition « une équipe nationale de juristes qui pourra accompagner et conseiller celles et ceux qui pourraient être visés par des poursuites judiciaires, ou qui voudraient faire des recours contre tel ou tel abus ou manquement administratif ».
Pauline Graulle
La stratégie de la première force de gauche en 2025 n’est ainsi pas si éloignée de celle des origines, quand au Parti de gauche (PG) en 2013 Danielle Simonnet, alors proche de Mélenchon, théorisait : « Le conflit crée de la conscience. » Or, si LFI a depuis progressé à l’intérieur de la gauche, elle n’y est pas hégémonique et n’a pas endigué la progression du RN. Plusieurs député·es sortant·es LFI ont perdu face au RN ou à l’extrême droite ciottiste en 2024 : Caroline Fiat, Pascale Martin, Léo Walter, Charlotte Leduc, Martine Étienne, Sébastien Rome, Catherine Couturier, Michel Sala ou encore Florian Chauche.
Il y a donc des moments où le doute s’immisce, et des erreurs qui amènent à une relative introspection. L’affaire du visuel aux codes antisémites de Cyril Hanouna, retiré en catastrophe des réseaux sociaux du mouvement, a fortement secoué ses cadres et ses militant·es. Interrogé sur la manière de répliquer aux accusations d’antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon avait dans un premier temps répondu sèchement – « On ne peut rien contre ça. Bien faire notre travail et laisser braire. C’est une offensive politique » –, avant de hurler sur le journaliste qui le questionnait. Mais la virulence des attaques qui ont suivi et les interpellations en interne de militantes et militants juifs heurtés par le visuel n’ont pas été neutres.
Le député Aymeric Caron avait diffusé le message suivant dans la boucle du groupe LFI à l’Assemblée : « Merci de tenir compte du fait que chaque membre du groupe est impacté, une fois de plus, par ces communications catastrophiques, qui se multiplient. » « Ce visuel n’aurait jamais dû exister », confiait, sous couvert de l’anonymat, un autre député, ajoutant sur le ton du regret : « On sait qu’on est dans un environnement hostile, mais il y a un état d’esprit spontanéiste. C’est presque un système. »
Les leçons d’une erreur
Depuis, les Insoumis assurent avoir tiré des leçons, même si le cadre médiatique dominant est jugé trop hostile pour pouvoir les exposer. « Sur ce sujet-là comme sur d’autres, on a été bousculés car des personnes concernées nous ont dit que notre positionnement n’allait pas. C’est un mensonge de dire qu’on ne veut rien faire dessus », relate Danièle Obono, qui a assuré ces dernières années une formation interne sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et qui répète que cet épisode était « une erreur », « un manque de vigilance ».
« On est un mouvement qui a dix ans à peine, avec ses forces et ses limites. Il faut faire avancer des gens avec des niveaux de formation différents, travailler nos angles morts pour que ça ne serve pas à créer des accroches. On a commencé ce travail et on va le continuer », assure la députée, qui distingue le « débat critique » légitime de l’« offensive politique » malhonnête. S’ils dénoncent d’un côté l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme à des fins de criminalisation des mobilisations pour la Palestine ou d’affaiblissement de LFI, les Insoumis reconnaissent tout de même un besoin de s’améliorer, dont les autres partis de gauche ne sont pas non plus exempts.
« Le racisme, l’antisémitisme, le sexisme sont des phénomènes qui existent dans la société de manière générale. Aucun corps social ne peut considérer qu’il en est, par principe, immunisé, affirme ainsi Manuel Bompard. Toutes les formations politiques ont un travail à faire sur ces oppressions. Mais moi, je le mène en dehors des caméras et des interviews. Le cadre médiatique est trop gangrené par les instrumentalisations pour pouvoir avoir une discussion sereine sur le sujet. »
Pris en étau entre la nuance et le temps long nécessaires à certains débats aussi complexes que cruciaux d’un côté et, de l’autre, la conflictualité érigée en stratégie dans un cadre médiatique qui ne fonctionne qu’à l’indignation, LFI cherche un difficile équilibre.
Mais, sur le fond, elle considère sa diabolisation inévitable en raison de ses positions, et alerte donc le reste de la gauche : « Le problème des gens qui nous attaquent, ce n’est pas La France insoumise, c’est le programme de rupture qu’on porte. Si, à un moment, ils ont l’impression qu’ils sont débarrassés de La France insoumise, ils s’attaqueront aux autres, prévient Manuel Bompard. C’est une constance de l’histoire. »
mise en ligne le 23 juin 2025
Face
aux nouveaux fascismes,
construire la digue
Edwy Plenel sur https://blogs.mediapart.fr/
L’association unitaire Visa (Vigilance et initiatives syndicales antifascistes) publie chez Syllepse un remarquable manuel internationaliste de résistance aux nouveaux fascismes que j’ai volontiers accepté de préfacer.
Créée en 1996, Visa est une association intersyndicale qui regroupe plus de 300 structures syndicales. Si la CGT, Solidaires et la FSU y prédominent, on y retrouve aussi le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ainsi que des syndicats de la CFDT, de la CNT, de la CNT-SO, de FO, de l’UNSA et de l’Union pirate. Nouveaux fascismes, ripostes syndicales qui vient de paraître chez Syllepse synthétise et actualise le travail de réflexion et d’information de ce réseau unitaire face à la menace d’extrême droite.
Sa grande originalité, outre évidemment sa documentation du cas français, est sa dimension internationale à l’heure où cette menace est devenue globale, sous ses divers avatars. Grâce aux solidarités syndicales, Visa offre ainsi un inventaire par pays quasi exhaustif, dans cet ordre : Italie, Hongrie, Finlande, Pays-Bas, Pologne, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Bélarus, Russie, Ukraine, Iran, Inde, Argentine, Brésil, Israël/Palestine, Syrie, États-Unis. J’ai volontiers accepté la demande de Visa de soutenir ce livre par une préface, que je republie dans ce billet.
Son propos rejoint celui d’autres initiatives d’esprit unitaire et internationaliste, semblables au travail constant de Visa. Ainsi, le jour où j’écrivais à Lisbonne cette préface intitulée « Construire la digue », le député écologiste Pouria Amirshahi lançait à Paris « La Digue », reprenant la même image avec la même démarche : fédérer pour résister. Toutes les précisions sont à retrouver ici. Sous l’intitulé « Ni Trump ni Poutine, construire la digue », Pouria Amirshahi et d’autres parlementaires (notamment Elsa Faucillon, Tristan Lahais et Chloé Ridel) présenteront leurs premières réalisations au Festival des idées de La Charité-sur-Loire, vendredi 4 juillet en soirée, lors d’un débat animé par Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent.
Construire la digue
Ne nous racontons pas d’histoire : l’époque n’est pas réjouissante tant les ombres menacent.
Le week-end qui a précédé l’écriture de cette préface, une victoire de l’extrême droite a été évitée in extremis à l’élection présidentielle en Roumanie – mais elle a progressé en suffrages –, tandis que la droite extrême est arrivée en deuxième position au premier tour de l’élection présidentielle en Pologne – elle risque de bénéficier au second du renfort des voix d’extrême droite –, alors que l’extrême droite supplantait une gauche en déclin aux élections législatives au Portugal – au point de devenir la première force d’opposition à la coalition conservatrice au pouvoir.
Ces trois résultats électoraux surviennent dans un paysage géopolitique non seulement européen mais mondial où, sous divers atours selon les contextes nationaux, une extrême droite xénophobe et raciste, autoritaire et populiste, cynique et violente, impose son agenda idéologique. Cette radicalisation des classes dominantes, pour défendre leurs privilèges indus et perpétuer les injustices qui les garantissent, enfante une fuite en avant guerrière dont l’agression russe contre l’Ukraine et la destruction israélienne de la Palestine sont les dramatiques illustrations, ouvrant la voie à une sauvagerie générale où des civilisations prétendument supérieures nourrissent leurs propres barbaries, jusqu’aux crimes contre l’humanité tout entière.
Solution de rechange d’un capitalisme du désastre qui refuse toute limite à son avidité destructrice, cette extrême droite mondialisée a évidemment le visage de Donald Trump qui, redevenu président des États-Unis, s’attaque à tous les principes démocratiques, aussi imparfaits et inaccomplis soient-ils, proclamés à la face du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la conscience des catastrophes produites par le règne de l’argent, la loi du plus fort et le désir de puissance. Le trumpisme et tous ses avatars, dont les versions françaises fédèrent désormais tout le camp conservateur jusqu’au centre-droit, s’attaquent aux libertés et droits fondamentaux en arguant de leur seule légitimité électorale qui l’emporterait sur tout autre pouvoir ou contre-pouvoir – l’État de droit, l’indépendance de la justice, le respect du syndicalisme, la liberté de la presse, l’auto-organisation populaire, le pouvoir du Parlement, etc.
C’est ici qu’intervient l’apport décisif de ce livre issu du travail collectif de Visa, ce réseau de « Vigilance et initiatives syndicales antifascistes ». Refusant l’abattement et la résignation que peut générer la lucidité sur l’ampleur et l’urgence du péril, il documente le véritable chemin de résistance, le plus sûr, le plus solide, le plus durable. Les exemples étrangers cités précédemment nous le rappellent : surtout en France où l’élection présidentielle réduit la volonté de tous au choix d’un seul, on ne peut plus se contenter de faire barrage par nos votes, pour empêcher le pire, au risque de laisser advenir des pouvoirs qui lui font la courte échelle comme ce fut le cas, depuis les scrutins de 2017 et de 2022, avec Emmanuel Macron. Non, plutôt que d’être réduits régulièrement à faire barrage, ce manuel de résistance nous indique comment construire la digue.
C’est une digue sociale, unitaire et internationaliste. Sociale, car tout syndicaliste le sait : c’est dans les luttes, au plus près du concret et du quotidien, des lieux où l’on vit, habite et travaille, que se construisent des résistances progressistes qui mobilisent et rassemblent au-delà des premiers convaincus. Unitaire, car tout antifasciste l’a appris : c’est grâce aux divisions fratricides des tenants de l’émancipation, aux querelles des forces partisanes qui en font la diversité, donc la richesse, que l’extrême droite réussit à s’imposer, en pariant sur la démobilisation et la démoralisation. Internationaliste enfin, car toute l’histoire des luttes l’enseigne : c’est par une conscience aigüe des causes communes de l’égalité qui unissent les peuples, leurs espérances de justice et de dignité, que peut se construire une résistance sans frontières, sans nations propriétaires et sans « campismes » borgnes, aux dominations des pouvoirs économiques et étatiques.
Cet internationalisme est sans doute l’apport le plus original de ce livre, sans équivalent dans le débat politique tant, à gauche, s’est longtemps égaré ce fil originel de la cause ouvrière et du mouvement social. Ici, on apprend des autres, des ailleurs et des lointains. « Agis en ton lieu et pense avec le monde » : cette recommandation d’Édouard Glissant convient bien à la démarche de Visa alors que l’émergence de nouveaux fascismes accompagne la violence ravageuse de pouvoirs oligarchiques et mafieux. Poète du Tout-Monde et penseur de la Relation, ce Martiniquais fut lui-même de tous les combats des émancipations, aussi bien contre l’aliénation coloniale que contre la prédation capitaliste. Si je convoque ici cette lucidité, c’est parce qu’elle me semble résumer l’esprit même du syndicalisme qui unit, dans sa pluralité, ce réseau antifasciste unitaire.
Ainsi entendu, le syndicalisme est une école de solidarité et d’humilité, où l’auto-organisation est indissociable d’une autodidaxie. L’espérance d’égalité, de justice et de dignité, n’y est pas une doctrine assénée d’en haut par des clercs qui en seraient les gardiens, voire les propriétaires au nom d’une prétendue juste ligne. Non, elle se construit toujours par en bas et par l’expérience, durant ces moments précieux où l’on se retrouve autour de causes partagées, dans un heureux déplacement où l’on s’échappe des immobilités et des fixités, des fatalités du destin et des assignations à résidence.
À rebours de la politique professionnelle et élective, où l’engagement risque trop souvent de devenir un métier carriériste et une ambition personnelle, le syndicalisme originel s’est ainsi affirmé comme une philosophie concrète de l’action, ancrée dans le vécu quotidien des premiers concernés. Nul hasard d’ailleurs si, à sa source première, l’on trouve une tradition aujourd’hui trop mésestimée, libertaire et anti-autoritaire, qui se méfiait instinctivement des avant-gardes autoproclamées qui prétendent savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui.
C’est ce que propose Visa face à l’extrême droite : construire la digue avec la société, dans la société, pour la société. Même si le vote est évidemment l’un des moyens de l’empêcher d’arriver au pouvoir, il serait irresponsable de s’en contenter, de ne parier que sur lui, de n’avoir que cet objectif en tête. Même une heureuse surprise électorale ne mettra pas fin, tel un coup de baguette magique, à son emprise idéologique sur le débat public, dans un engrenage ravageur qui ruine tout monde commun avec pour premières cibles les discriminé·es, les racisé·es, les minorités, les femmes…
Aussi bien à l’intérieur d’une même nation qu’à l’échelle du monde entier, la cause des opprimés, exploités et dominés, est forcément sans frontières. Tout repli identitaire – nationaliste, xénophobe, sexiste, masculiniste, etc. – est une concession faite aux ennemis de l’égalité des droits, de la justice sociale et de l’émancipation collective. Car c’est bien cela que l’extrême droite, unie sur l’essentiel quelles que soient ses chapelles, entend combattre : l’égalité des droits, cette proclamation qui est au point de départ de tous les droits conquis, inventés, défendus, imaginés, que ce soit hier, aujourd’hui ou demain. Droits politiques, droits sociaux, droit des femmes, droit des peuples, droit international, droit de la nature, etc. : contre ces tenants de l’inégalité naturelle qui sont nos adversaires de toujours, en tout temps et sous toute latitude, il s’agit de défendre cette égalité radicale, sans distinction d’origine, de naissance, de culture, de croyance, d’apparence, de sexe, de genre.
« Là où croit le péril croît aussi ce qui sauve » : empruntée au poète Hölderlin, cette formule convient bien au travail de Visa, aussi nécessaire que salutaire. Il n’y a jamais de fatalité. Tout dépend de nous, de nos lucidités et de nos responsabilités. En ce sens, toutes et tous, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes.
Lisbonne, le 22 mai 2025
Nouveaux fascismes - Ripostes syndicales
Éditions Syllepse Collection : « Mauvais Temps »
Coordinateur : Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (Visa)
204 p - 12 €
mise en ligne le 23 juin 2025
Guerre Israël-Iran :
le rêve américain
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Derrière ses fausses hésitations et tergiversations, Donald Trump a un objectif bien précis en aidant Tel-Aviv à mater Téhéran : imposer au monde sa force et son autorité.
L’intervention américaine à la suite de l’attaque israélienne contre l’Iran donne à comprendre les enjeux du conflit : il s’agit en premier lieu de mettre le monde sous domination américaine. Contredisant ses propos de la veille, Donald Trump a saisi l‘occasion offerte par le coup de force de Benyamin Netanyahou.
Le président étatsunien s’était résolu à revenir à la table des négociations quittée en 2018. Un cycle de 60 jours venait de s’achever et un nouveau rendez-vous était pris entre Iraniens et Américains. Israël l’a bloqué en attaquant l’Iran. Donald Trump exige alors la reddition totale de l’Iran puis ordonne, trois jours plus tard, de bombarder les sites nucléaires. Depuis sa réélection, Donald Trump paraît conduire une politique erratique. Elle est en fait une stratégie : détruire toute confiance dans la parole et rendre improbable un monde qui se parle au travers d’une diplomatie internationale. Celui qui ne peut être vu comme le fou qu’il joue à être (madman theory) terrorise et impose sa loi. Le monde vit désormais sous cette menace. La politique de la négociation laisse la place à celle de la puissance ; les mercenaires se substituent aux diplomates. Cela ouvre une période de grands dangers, d’imprévisibilité totale.
Cette stratégie est déployée tous azimuts à l’échelle internationale – menace d’annexion des pays voisins, menace sur les droits de douane, attaque militaire. Donald Trump entend restaurer la domination américaine sur le monde et secondairement celle des pays occidentaux – ils ne seront admis dans le club que s’ils sont serviles et dociles. Dans cette volonté de domination par la force, les questions militaires sont cardinales. C’est le sens de l’intervention américaine : démontrer la suprématie militaire et empêcher l’Iran d’avoir l’arme nucléaire. Non par refus de la prolifération nucléaire mais par volonté qu’elle reste dans les mains des puissances et des Occidentaux. Qui prétendra qu’Israël est moins inquiétant que l’Iran ? Que l’arme de destruction massive est rassurante dans les mains de la Russie et des États-Unis ?
Pour restaurer la puissance et imposer sa loi, attaquer l’Iran est une aubaine. Il ne s’agit pas d’un petit pays rebelle. L’Iran pèse par la profondeur de son histoire et de sa culture, l’étendue de son territoire, son nombre d’habitants. Le faire tomber sera un symbole fort. Mais ce ne sera pas forcément si difficile. Son crédit moral et politique est nul. L’Iran n’a cessé de menacer de destruction totale Israël. Ce régime est honni par son peuple ; détesté par l’opinion publique mondiale ; en rivalité avec les pays arabes sunnites en particulier l’Arabie saoudite. Face à la guerre que lui mène Israël avec l’appui des États-Unis, il n’engrange que peu de soutien.
Au-delà du symbole, faire plier l’Iran est un objectif important. Tout d’abord pour Benyamin Netanyahou. Le choix de bombarder des lieux du pouvoir politique, des hôpitaux et des civils ne laisse aucun doute sur les objectifs du gouvernement israélien. La question de la bombe n’est pas l’objectif fondamental. Depuis longtemps, le but poursuivi par le pouvoir de Tel-Aviv est de reconfigurer le Moyen-Orient, de construire le grand Israël dans une région délibérément plongée dans le chaos.
Ensuite, pour Donald Trump. C’est une menace adressée aux pays du « Sud global ». Depuis 2024, l’Iran fait partie des Brics+, ce groupe de dix pays du Sud1 qui entend se coordonner et faire contrepoint au G7. Ces impudents prétendent casser la domination américaine et contourner le dollar dans les changes internationaux. Parmi eux, ils sont nombreux à ne pas accepter le « deux poids deux mesures » qui affecte les relations internationales, jusque dans le régime de sanctions et les procès de la cour pénale internationale. Loin de constituer un groupe homogène, les Brics+ représentent néanmoins une contestation puissante de l’hégémonie étasunienne. Donald Trump veut l’enrayer.
Il a d’ailleurs été élu pour renforcer la suprématie américaine. Les chemins sont parfois sinueux, mais le but est clair et établi. C’est l’enjeu ultime de la confrontation qui s’annonce avec la Chine sur tous les terrains. Mais la Chine, comme les autres pays des Brics+, ne passent pas le cap de la condamnation de principe de la guerre contre l’Iran. Aucun n’entend sacrifier ses objectifs propres pour défendre un régime si faible et si exécrable. Les jours du régime iranien sont peut-être comptés. Pas ceux de la confrontation voulue par Donald Trump et l’extrême droite internationale.
L’immense danger impose de réagir avec clairvoyance. Qui peut croire que c’est par la violence et le mensonge que nous allons éviter le pire ? Nous sommes devant un ballet de somnambules qui se rassurent en se disant que la raison empêchera in extremis la marche vers la folie. Or il n’y a pas de raison triomphante si les raisonnables sont tenus au bord du chemin ou choisissent d’y rester.
Les forces de paix peinent à se faire entendre. Elles sont dispersées, dépourvues de projets, sidérées par la détermination des bellicistes, des cyniques, des fascistes et des proto-fascistes. Il faut pourtant faire émerger un autre possible que celui du choc des puissances, des rapports des forces et du mensonge. Pour l’heure, les femmes, la vie, les libertés sont sous les bombes.
mise en ligne le 22 juin 2025
10 employés pour s’occuper
de 103 résidents : à l’Ehpad de Nemours, les employés obtiennent
enfin des embauches
Florent LE DU sur www.humanite.fr
À l’Ehpad du Pays de Nemours (Seine-et-Marne), les agents et la CGT ont réussi à arracher la création de 24 postes, nécessaires à la prise en charge des résidents.
Une victoire sociale et sanitaire. En quelques semaines, les agents de l’Ehpad du Pays de Nemours, en Seine-et-Marne, et la CGT ont réussi à arracher la création de 24 postes, nécessaires à la prise en charge des résidents. Une première grève a été entamée le 16 mai, pour protester contre le sous-effectif qui dégradait leurs conditions de travail.
Vingt postes ont alors été budgétés par la direction de l’établissement public. Mais sans être pourvus, maintenant ainsi la même situation : « L’après-midi, l’Ehpad ne comptait que 5 aides-soignant·es, 3 agent·es des services hospitaliers et 2 infirmier·ères diplomé·es d’État intérimaires pour s’occuper de 103 résident·es », indique la CGT.
Une nouvelle négociation a alors abouti sur l’embauche immédiate de 24 agents (13 aides-soignants dont 2 de nuit, 7 agents des services hospitaliers et 4 infirmiers diplômés d’État). « Les agent·es de l’Ehpad Pays de Nemours se disent satisfait·es de cette victoire, mais tou·tes restent vigilant·es », précise la CGT dans un communiqué du 19 juin.
mise en ligne le 22 juin 2025
« Israël aura la sécurité lorsqu’il aura respecté les droits des Palestiniens »
Rachida El Azzouzi dur wwwmediazpart.fr
La juriste Monique Chemillier-Gendreau fustige l’absence de volonté politique des pays occidentaux et arabes de stopper Benyamin Nétanyahou dans sa spirale mortelle. Selon elle, Israël poursuit un objectif depuis sa création : rendre impossible un État palestinien.
Grande spécialiste du droit international et de la théorie de l’État, la juriste française Monique Chemillier-Gendreau plaide régulièrement devant les juridictions internationales, à l’instar de la Cour internationale de justice (CIJ) de l’ONU à La Haye (Pays-Bas), où plusieurs procédures concernant Israël et la Palestine sont ouvertes.
En mai 2025, elle est intervenue au nom de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), la voix du monde musulman, en défense de l’Unrwa, l’agence onusienne pour les réfugié·es de Palestine, à laquelle Israël interdit d’opérer dans les Territoires palestiniens occupés.
En février 2024, elle a plaidé, toujours pour l’OCI, dans l’affaire de l’occupation de la Palestine qui a abouti à une décision historique de la CIJ le 19 juillet 2024 : Israël doit cesser toute activité de colonisation en territoire palestinien et restituer à ses habitant·es leurs terres et biens confisqués depuis 1967.
Dans un entretien à Mediapart, Monique Chemillier-Gendreau revient sur son ouvrage récemment paru Rendre impossible un État palestinien. L’objectif d’Israël depuis sa création (Éditions Textuel, 2025), dans lequel elle démonte de manière implacable soixante-quinze ans de faux-semblants israéliens.
Elle voit dans l’impunité dont bénéficie le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou « la profonde complicité de l’Occident colonial » et appelle « à ne pas céder au découragement », à continuer à défendre le droit. « Une fois affirmé, il rentre dans les rapports de force et finit par les faire basculer, assure-t-elle. C’est ce qui s’est passé pour certaines guerres ou pour les luttes de libération nationale », au Vietnam, en Algérie ou encore au Portugal.
Quant à la sécurité d’Israël, elle passe par le respect des droits des Palestiniens, défend Monique Chemillier-Gendreau : « C’est en leur faisant comprendre cela que nous protégerons les Israéliens contre eux-mêmes. »
Mediapart : Comment expliquez-vous qu’après plus de vingt mois de guerre génocidaire à Gaza, Benyamin Nétanyahou bénéficie toujours d’une impunité au point d’attaquer l’Iran et de déstabiliser encore un peu plus la région ?
Monique Chemillier-Gendreau : Nous voyons bien avec les déclarations du président français Emmanuel Macron relatives à la guerre d’agression ouverte par Israël contre l’Iran, dépourvues de condamnation, que les pays occidentaux ne sont pas prêts à arrêter Israël. C’est la profonde complicité de l’Occident colonial qui se joue là.
Ces pays restent imbibés d’idéologie coloniale et de nostalgie de l’époque coloniale. C’est aux opinions publiques de tenter d’inverser cette tendance. Malheureusement, l’idéologie qui anime les dirigeants est partagée par une partie de ces opinions publiques.
Cela pose la question du traitement de la complicité des alliés d’Israël et des manquements à leurs obligations internationales. À quoi sert le droit s’il n’est pas respecté ?
Monique Chemillier-Gendreau : Le droit a des effets différés. Il est important qu’il soit dit car une fois affirmé, il entre dans les rapports de force et finit par les faire basculer. C’est ce qui s’est passé pour certaines guerres ou pour les luttes de libération nationale.
Les rapports de force n’étaient pas en faveur des Vietnamiens dans la guerre que leur ont menée les USA. Comme ils n’étaient pas en faveur de l’Algérie lorsque la France a décidé de s’opposer aux indépendantistes algériens par la force. Ils n’étaient pas en faveur des colonisés du Portugal lorsque ce pays s’est obstiné, par des guerres coloniales meurtrières, à empêcher l’accession à l’indépendance de ce qu’il considérait comme « ses provinces d’outre-mer ».
Et pourtant, tous ces dominés ont gagné. Ni la supériorité militaire, ni les moyens financiers, ni les alliés des États dominateurs ici cités ne leur ont permis de triompher. C’est que le droit s’était immiscé dans l’affaire. Et que chez le plus fort lui-même, la perception du droit, c’est-à-dire la conviction peu à peu intégrée que l’action menée l’était sur des bases illégales, l’a conduit à la défaite.
Ce qui protège les humains, ce sont les droits proclamés et universellement respectés.
La détermination des peuples en lutte a été essentielle. Mais le fait que, du côté de l’oppresseur, l’opinion publique a basculé n’a pas été négligeable. La guerre du Vietnam a été gagnée par les Vietnamiens mais avec l’appui des intellectuels du monde entier dans le Tribunal Russell et des étudiants américains qui menaient la bataille – et à quel prix ! – dans les campus américains. Ils le faisaient avec la conviction que cette guerre était une guerre illégale.
Il en a été de même pour les guerres coloniales de la France ou du Portugal. Les rebelles sous oppression coloniale n’auraient pas gagné de la même manière si les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes et à lutter contre le colonialisme par tous les moyens n’avaient pas été proclamés aux Nations unies.
Voilà pourquoi nous ne devons pas céder au découragement et continuer à proclamer ce qui est conforme au droit et ce qui ne l’est pas. L’effet différé viendra.
Vous aviez conclu votre plaidoirie en février 2024 dans l’affaire de l’occupation de la Palestine devant la Cour internationale de justice en appelant à « sauver les Israéliens contre eux-mêmes ». Qu’entendez-vous par là ?
Monique Chemillier-Gendreau : Nous voyons bien avec cette guerre déclarée contre l’Iran que le gouvernement d’Israël est engagé dans une spirale mortelle, enivré qu’il est par sa réelle supériorité militaire et technologique. La population israélienne est prise dans ce délire.
Cette population a été à juste titre traumatisée par les attentats du 7-Octobre. Mais elle n’avait pas les moyens de replacer ces attentats dans leur contexte car Israël, État non démocratique, est basé non seulement sur la ségrégation raciale et l’apartheid, mais aussi sur une information volontairement biaisée et historiquement fausse.
Et il y a eu aussi un choc idéologique pour cette population qui est le suivant : toute l’idéologie sioniste était basée sur deux idées fausses : celle qu’il y avait au Proche-Orient une terre disponible pour accueillir les juifs qui décidaient après deux mille ans de diaspora de se regrouper dans un territoire ; et celle selon laquelle les risques de persécution auxquels ils avaient été exposés pendant des siècles cesseraient avec leur regroupement sur une terre leur appartenant en propre et qu’ils seraient ainsi protégés.
Israël s’est employé […] à ce qu’à aucun moment, les éléments de base d’un État [palestinien] ne soient rendus possibles.
Ces deux idées ont volé en éclats. En dépit de l’accélération que la politique d’Israël donne à sa volonté de chasser les Palestiniens, de les expulser, de les parquer, ils sont toujours là et les autres pays refusent toute solution de les accueillir. Donc, non, cette terre n’est pas libre. Elle est occupée par un peuple qui y détient des droits et qui n’y renoncera pas.
Quant à l’idée qu’un coin de terre à eux protégerait les juifs contre les persécutions et massacres dont ils ont été si souvent victimes dans leur histoire, elle est aussi totalement fausse, et les massacres du 7-Octobre l’ont démontré.
En dépit de sa supériorité militaire, technologique et en renseignement, Israël a été surpris en état de faiblesse. La leçon est rude. Il faudra encore du temps pour que les Israéliens comprennent que ce n’est pas un coin de terre qui protège.
Ce qui protège les humains, ce sont les droits proclamés et universellement respectés. Israël veut sa sécurité ? Qu’à cela ne tienne. Il l’aura lorsqu’il aura respecté les droits des Palestiniens. C’est en leur faisant comprendre cela que nous protégerons les Israéliens contre eux-mêmes. Ils doivent sortir de leur narcissisme et apprendre la réciprocité. C’est cette valeur qui leur manque cruellement et qui les rend aveugles.
À l’aune du génocide à Gaza, de l’accélération de la colonisation en Cisjordanie occupée mais aussi à Jérusalem-Est depuis octobre 2023, un État palestinien est-il encore possible ?
Monique Chemillier-Gendreau : Mon travail a consisté à montrer comment, depuis la création d’Israël en 1948 et même depuis l’émergence du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle, les tenants de ce mouvement n’ont jamais envisagé la possibilité d’un État palestinien aux côtés de l’État juif dont ils voulaient la création.
Les cartes publiées par le mouvement sioniste en témoignent : elles montrent que les intentions vont bien au-delà de ce qui sera après la Première Guerre mondiale la Palestine mandataire. Elles sont en effet la preuve de prétentions qui englobent une partie de l’Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban.
Ces prétentions ont été mises en sourdine pendant longtemps, Israël sachant que les Nations unies à l’époque de leur création, et alors qu’elles représentaient la défense de principes juridiques forts, n’admettraient pas de telles prétentions. Mais le climat international a changé et s’est beaucoup dégradé.
Les Nations unies et notamment son Conseil de sécurité, organe décisionnel en charge du maintien de la paix, n’ont plus d’autorité, étant condamnés à l’inaction devant les conflits en cours, comme cela est démontré par l’usage du veto américain lorsqu’il est question de la Palestine ou du veto russe lorsqu’il est question de l’Ukraine.
Israël s’était pourtant engagé solennellement, lors de son admission aux Nations unies, à respecter la Charte et toutes les résolutions de cette organisation…
Monique Chemillier-Gendreau : À peine cette promesse a-t-elle été faite qu’elle a été reniée. Il faut se souvenir qu’en 1949, immédiatement après que les Juifs de Palestine eurent proclamé leur État en s’appuyant sur la résolution 181 de l’Assemblée générale qui recommandait un plan de partage en deux États, Israël a remis en cause le territoire qui lui était alloué par la communauté internationale et a conquis par la force, à l’occasion de la guerre israélo-arabe de 1948-49, un tiers du territoire qui revenait à un État arabe selon la recommandation de partage.
Il a fait alors de Jérusalem-Ouest – qui ne lui était pas dévolue par le plan de l’ONU – sa capitale. Puis, à l’occasion de la guerre des Six-Jours, Israël a occupé le reste de toute la Palestine. Mais l’occupation militaire était présentée comme une situation transitoire en attente de la paix.
Lorsque celle-ci a été entrevue avec la reconnaissance d’Israël par la Palestine au moment de sa proclamation comme État en 1988 et surtout avec le processus d’Oslo à partir de 1993, Israël a pipé les négociations en feignant de négocier la création d’un État palestinien, tout en entravant les négociations à toutes les étapes par son obstination à refuser toute avancée sur les points essentiels : le retour des réfugiés, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de la Palestine, l’arrêt de la colonisation et le retrait des colons déjà implantés illégalement.
La solution est dans des sanctions coordonnées et bien ciblées contre Israël.
Le processus d’Oslo, qui promettait d’aller vers un État de Palestine, n’était-il qu’une illusion ?
Monique Chemillier-Gendreau : C’est ce que je démontre dans ce travail. Israël s’est employé très minutieusement et systématiquement à ce qu’à aucun moment, les éléments de base d’un État ne soient rendus possibles au profit des Palestiniens. Leur territoire a été spolié par les conquêtes de 1948, puis mité par la colonisation d’abord rampante, ensuite forcenée ; leur population est interdite de se regrouper ; l’Autorité palestinienne reconnue par les accords d’Oslo est une administration sans aucun pouvoir d’État et enfin Jérusalem leur est refusée comme capitale.
Il faut noter aussi que, dans toutes les négociations, il a été admis comme allant de soi que la Palestine en devenir serait un État « démilitarisé ». Cette concession centrale à la volonté israélienne de demeurer en position de force est emblématique du fait que le dossier n’est pas traité sur la base du principe – central dans la Charte des Nations unies – de l’égalité de droit des peuples.
Pourquoi la communauté internationale s’acharne-t-elle alors à parler de quelque chose qui est rendu impossible par Israël ?
Monique Chemillier-Gendreau : Mais tout simplement parce que cela relève du droit. Le droit des Palestiniens à disposer d’eux-mêmes selon les principes cardinaux des Nations unies. La communauté internationale doit encore faire semblant d’être du côté du droit.
Les pays occidentaux alliés d’Israël doivent se livrer à ce faux-semblant car la grande masse des pays du Sud, issus de luttes de libération nationale, n’est pas prête à immoler ses principes. Donc on est dans la communication, on fait comme si on voulait encore la réalisation de la solution à deux États…
Alors, est-ce qu’un État palestinien est encore possible ? La réponse serait oui, s’il y avait de la part des pays influents une volonté politique. Il faudrait que cette volonté politique engendre des mécanismes de sanctions dirigées de manière efficace contre Israël.
Les pays occidentaux peuvent priver Israël d’armes, ou de composants de matériel militaire. Ils peuvent rompre les relations de coopération économique. Les pays arabes peuvent utiliser l’arme du pétrole. Ces différentes mesures seraient de nature à faire plier Israël. Mais il n’y a de volonté politique ni des uns ni des autres.
Quelle est la solution si celle à deux États est rendue impossible par Israël ?
Monique Chemillier-Gendreau : La solution est donc dans des sanctions coordonnées et bien ciblées contre Israël. Car, pour l’instant, les Palestiniens, dont nous devons respecter le droit à disposer d’eux-mêmes, ne se sont pas prononcés pour une autre solution, celle-ci étant celle d’un État binational.
Il est vrai que la représentation politique des Palestiniens est divisée et défaillante. Cela va nécessairement changer, mais pas avant que ne s’arrête la guerre génocidaire menée contre Gaza.
mise en ligne le 21 juin 2025
« Qu’est-ce que vous venez foutre
ici ? » :
des inspecteurs du
travail agressés
à la Foire du trône
Hayet Kechit sur www.humanite.fr
Insultes racistes, homophobes et sexistes, carnets arrachés, intimidations… Le 11 juin, des inspecteurs du travail en mission sur un chantier de la foire du trône à Paris ont violemment été pris à partie par une cinquantaine de forains, qui les ont forcés à quitter les lieux sous la menace. Des plaintes pour agressions, délit d’outrage et d’obstacle ont été déposées. La CGT exige de la ministre du Travail un soutien public et des mesures de protection dignes de ce nom pour les agents victimes de cette embuscade.
Les inspecteurs du travail s’attendent rarement à voir les patrons leur dérouler le tapis rouge sur un chantier. Ils étaient cependant loin d’imaginer le déferlement de violences qui allait s’abattre ce 11 juin sur une dizaine d’entre eux, lors d’un contrôle inopiné à la Foire du trône, à Paris, décrit par la CGT dans un communiqué publié il y a deux jours.
Venus vérifier à titre préventif les opérations de démontage de la fête foraine – qui a remballé ses attractions après une saison en berne et des taux de fréquentation en chute – le inspecteurs, accompagnés de quelques agents de police et de l’Urssaf, mènent dans un premier temps leur procédure sans anicroche.
Ils constatent cependant rapidement que leurs suspicions étaient fondées face au spectacle « de travailleurs évoluant sur des manèges à plus de 10 mètres de hauteur, sans protection collective ni individuelle », alors que les chutes de hauteur sont la principale cause des accidents du travail mortels en France. Ils notent également « plusieurs autres situations de danger grave et imminent », raconte Nazli Nozarian de la CGT Travail emploi formation professionnelle (USNTEFP).
« Vous êtes des suceurs de bites d’Arabes ! »
Le cheminement dans le chantier et les constats suivent leur cours quand les contrôleurs, carnet de notes en main, se trouvent soudain encerclés par une cinquantaine de forains particulièrement vindicatifs. « Déjà que ça a été la merde cette année, qu’est-ce que vous venez foutre ici ? Vous êtes venus nous enculer pendant qu’on travaille ! Venez pas nous casser les couilles ! » auraient-ils commencé tout en filmant les agents avec leur Smartphone, selon le récit de Nazli Nozarian. Suit alors une flopée de propos dégradants, d’insultes sexistes, misogynes et à caractère sexuel, visant particulièrement l’une des femmes policières à qui il aurait été dit : « Voilà une pute qui va bien se faire enculer ! »– émaillé d’un florilège d’injures homophobes et racistes.
« Vous n’allez jamais faire des contrôles sur les Noirs et les Arabes de merde dans les cités ! Vous êtes des suceurs de bites d’Arabes ! » auraient poursuivi ces forains, joignant à ces tirades des gestes suggestifs. Arrachant les carnets des mains de deux agents de contrôle, ils les auraient ensuite ostensiblement frottés sur leurs parties génitales. Pour la syndicaliste, au-delà de l’outrage, le préjudice professionnel est énorme : « Ces carnets sont des outils de travail fondamentaux qui contiennent les constats du jour mais aussi ceux des mois précédents. Ce sont des notes confidentielles, qui feront défaut quand il s’agira de mener les procédures à leur terme. »
L’un ne sera pas restitué, l’autre sera rendu vidé de ses pages réduites en morceaux au nez des inspecteurs. La violence monte alors crescendo tandis que les agresseurs passent des injures aux menaces explicites : « Vous dégagez, ça vaut mieux pour vous, sinon ça va vite dégénérer et il y a deux cents personnes qui vont arriver ! », auraient-ils fini par lancer, poussant les agents à mettre fin à leur mission de façon prématurée.
Plaintes déposées
Pourquoi la police n’a-t-elle pas sévi face à ces attaques ? « Les agents n’étaient pas outillés ni en nombre suffisant pour intervenir face à la cinquantaine d’assaillants. Ils ont préféré temporiser en priorisant la sécurité des collègues sur place », répond Nazli Nozarian, selon qui, au final, ce sont les agresseurs « qui ont gagné puisque le contrôle n’a pas pu avoir lieu. » Contactés par l’Humanité pour recueillir leur version des faits, les organisateurs de la Foire du trône n’ont pas répondu à nos sollicitations.
Une série de plaintes a été déposée dans la foulée au commissariat par les victimes, d’après Nazli Nozarian. Elle détaille « un triple préjudice » : le choc engendré par les agressions verbales et physiques, le délit d’obstacle puisque le contrôle n’a pas pu avoir lieu et enfin le délit d’outrage. Leur ministre de tutelle, Catherine Vautrin s’est pour sa part fendue d’un mail de soutien aux agents concernés, leur confiant son espoir que ces « agressions inadmissibles n’auront pas de conséquence sur leur état de santé ».
Elle affirme par ailleurs qu’elle sera « particulièrement attentive aux actions qui seront engagées en vue d’obtenir une réponse, notamment judiciaire, qui soit à la mesure de la gravité de ces faits » et promet de « convoquer les représentants de l’organisation de la Foire du trône pour leur indiquer très fermement que de tels comportements sont absolument inadmissibles ». Une réaction bien timorée, selon la CGT, au vu de la violence de l’événement, alors même que la ministre du Travail et de l’Emploi « n’hésite pas, quand il s’agit de soutenir les employeurs, d’inonder les réseaux sociaux de ses interventions. »
Une remise en cause des normes
Pour la syndicaliste, le minimum serait de proposer la protection fonctionnelle à ses collègues et reconnaître ce qui s’est passé comme un accident de service. Elle pointe également la responsabilité de Catherine Vautrin, qui par ses prises de position aurait ouvert les vannes à cette violence débridée régulièrement vécue par les agents de contrôle sur le terrain.
« Nous constatons qu’il y a une remise en cause de plus en plus violente des normes, présentées comme trop lourdes et faites pour enquiquiner les employeurs. Ce discours qui mine la légitimité de nos contrôles est régulièrement alimenté par le gouvernement lui-même, à commencer par Catherine Vautrin », déplore Nazli Nozarian, encore échaudée par les récentes sorties de la ministre, lors de la polémique soulevée par la fronde des boulangers contre la fermeture de leurs commerces le 1er mai. « Affirmer, comme elle l’a fait, qu’elle comprenait leur colère était complètement irresponsable. C’était non seulement un appel au travail illégal, mais aussi une mise en danger directe des agents de contrôle », analyse la représentante syndicale.
Mort au travail : un lycéen meurt
durant son stage d’observation
dans un magasin Gifi
Clémentine Eveno sur www.humanite.fr
Alors qu’il effectuait un stage d’observation, un lycéen de seconde dans un établissement de Saint-Lô (Manche) est mort, mercredi 18 juin, des suites d’un « accident » survenu la veille.
Alors que dans l’indifférence quasi-générale, les travailleurs continuent de périr, un lycéen de seconde dans un établissement de Saint-Lô (Manche) est mort, mercredi 18 juin, des suites d’un « accident » survenu la veille alors qu’il effectuait son stage d’observation chez Gifi, a indiqué le parquet de Coutances.
C’est alors que le gérant de l’enseigne à Saint-Lô manipulait une palette, selon l’antenne locale ICI, que la marchandise aurait basculé sur le jeune stagiaire. La victime de 16 ans aurait été projetée en arrière, et sa tête aurait violemment heurté le bord d’un trottoir, selon cette même source.
L’enquête d’abord ouverte pour blessure involontaire se poursuit pour des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail. Elle doit « déterminer les circonstances exactes, vérifier le respect de la législation du travail et de la sécurité des travailleurs », a déclaré le parquet de Coutances à l’Agence France-Presse.
« Les jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers sans y être préparés »
« Un élève ne devrait pas mourir en stage. La justice déterminera les éventuelles responsabilités », a déclaré, dans la foulée, le Sgen-CFDT Normandie. Le syndicat a également indiqué s’interroger « sur la mise en place précipitée de ces stages en Seconde générale, et sur le sens pédagogique dans le parcours de formation de l’élève », rapporte le quotidien local Ouest-France.
Une situation également dénoncée par la CGT Educ’action : « Avec l’explosion des périodes de stage en entreprise, les jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers sans y être préparés », dénonce le syndicat, qui demande de « revoir les obligations liées à ces périodes de stage, de les repenser pour mieux les encadrer et assurer la sécurité des jeunes en entreprise ». L’organisation syndicale demande ainsi la suppression des stages en entreprise dès la 3e et « des séquences d’observation en seconde qui ne représentent pas d’intérêt », ainsi que « l’interdiction de l’apprentissage avant 18 ans ».
En réponse, le ministère du Travail a rappelé qu’ « il n’est pas acceptable que des jeunes qui commencent leur vie professionnelle trouvent la mort sur leur lieu de travail », raison pour laquelle « la ministre Astrid Panosyan-Bouvet a demandé d’instruire un renforcement des mesures destinées à prévenir ces accidents graves et mortels qui seront présentées aux partenaires sociaux ».
Pourtant, cet épisode dramatique est loin d’être le premier. Selon l’INRS (Institut national de recherche et sécurité), la fréquence des accidents du travail, pour les jeunes de moins de 25 ans, s’élevait à 10 % par an en 2018. Soit un bilan 2,5 fois supérieur aux accidents de l’ensemble des salariés (environ 4 %). En 2023, 38 jeunes sont décédés sur leur lieu de travail, ils étaient 43 en 2022.
Parmi les nombreux cas, près de trois ans plus tôt en 2022, un jeune de 14 ans est mort après que le mur d’un bâtiment s’est effondré sur le chantier de démolition, dans le vignoble au sud-est de Nantes, où il effectuait son stage de 3e. L’auteur du documentaire « Travail à mort », Joseph Gordillo, rappelait l’importance de mettre en exergue le fait que les morts au travail n’étaient pas des faits divers, mais des faits de société. Et pour cause : « Quand l’État estime qu’il s’agit d’un fait de société, il met en œuvre des actions concrètes »
mise en ligne le 21 juin 2025
VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS EN ZONES DE CONFLIT EN HAUSSE DE 25 % : LA PALESTINE EN PREMIÈRE LIGNE SELON L'ONU
Théo Bourrieau sur www.humanite.fr
Les violences contre les enfants en zones de conflit ont atteint des niveaux « sans précédent » en 2024, dénonce le rapport annuel de l’ONU publié jeudi 19 juin. Avec 41 370 « graves violations », le triste record de 2023 a été battu.
L’ONU a « vérifié » 41 370 graves violations contre des enfants en 2024, dont 36 221 commises en 2024 et 5 149 commises précédemment mais confirmées en 2024, soit le nombre le plus élevé depuis la mise en place de cet outil de surveillance il y a près de 30 ans. Ce triste record bat celui déjà enregistré en 2023, qui lui-même représentait une hausse de 21 % par rapport à l’année précédente.
Selon le rapport, consulté par l’agence de presse Anadolu en 2024, 4 676 enfants ont été tués, 7 291 ont été blessés, 7 402 ont été recrutés dans des groupes armés, 7 906 se sont vu refuser l’accès à l’aide humanitaire, 3 018 ont été détenus en raison de liens avec des groupes armés et 4 573 ont été enlevés. « En 2024, la violence contre les enfants lors des conflits armés a atteint des niveaux sans précédent, avec une hausse sidérante de 25 % des violations graves par rapport à 2023 », regrette le rapport du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.
L’armée israélienne sur la « liste de la honte »
Chaque année, l’ONU répertorie dans ce rapport les violations des droits des enfants (moins de 18 ans) dans une vingtaine de zones de conflit dans le monde et dresse en annexe la « liste de la honte » des responsables de ces violations qui incluent enfants tués et mutilés, recrutements, enlèvements, refus d’accès humanitaire ou violences sexuelles, rappelle l’Agence France-Presse (AFP).
Israël et la Palestine ont particulièrement intéressé les auteurs. L’ONU a de nouveau inclus les forces armées et de sécurité israéliennes au nombre des « parties qui commettent des violations graves à l’encontre des enfants dans les situations de conflit armé », à l’instar de la branche armée du Hamas, révèle un rapport.
La Palestine occupe la première place de ce triste classement, avec plus de 8 500 violations graves, en très grande majorité attribuées aux forces israéliennes, dont plus de 4 800 dans la bande de Gaza et près de 3 700 en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-est. Le rapport note également que l’armée israélienne a entravé l’accès des enfants à l’aide humanitaire. L’ONU met aussi en cause les opérations d’Israël au Liban, où plus de 500 enfants ont été tués ou blessés par l’armée israélienne l’an dernier.
Antonio Guterres a déclaré qu’il était « consterné par l’intensité des graves violations commises à l’encontre des enfants » dans les territoires palestiniens occupés et en Israël. « Je suis profondément préoccupé par l’augmentation significative des violations graves dans la bande de Gaza, et je suis profondément alarmé par l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-est », a continué le secrétaire général de l’ONU. « Si vous êtes bouleversés par les chiffres concernant Gaza pour cette année, attendez l’année prochaine, car il y a de fortes chances qu’il y ait de moins en moins de personnes pour surveiller les violations », a averti un haut fonctionnaire de l’organisation, rapporte Anadolu.
Après les Territoires palestiniens, la République démocratique du Congo (plus de 4 000 violations graves), la Somalie (plus de 2 500), le Nigeria (près de 2 500) et Haïti (plus de 2 200) ont enregistré le plus de violences contre les enfants en 2024.
mise en ligne le 20 juin 2025
“Mesquida menteur” :
rassemblement contre
les suppressions de postes dans le social
sur https://lepoing.net/
Ce jeudi 19 juin une centaine de personne s’est rassemblée devant le conseil départemental de l’Hérault pour protester contre les suppressions de postes d’éducateur-trices de l’Association de Prévention Spécialisée de l’Hérault (APS 34).
“On est là ! On est là! Même si Mesquida veut pas nous on est là, pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur” : des casseroles et des slogans retentissaient devant le Conseil Départemental de l’Hérault ce jeudi 19 juin au matin.
Les salarié-es d’APS 34 en grève et des soutiens de la lutte y protestaient contre les coupes budgétaires du département de l’Hérault. “Le 10 juin on a appris qu’ils allaient quand même licencier et faire pire que ce qu’ils avaient prévu il y à trois mois puisqu’ils s’apprêtent à baisser le budget de 40%, ce qui entrainera le licenciement de plus d’un tiers des effectifs, et les fermetures de service de Frontignan, Sète, Béziers et potentiellement celui de Lunel en plus du petit cadeau de Monsieur Delafosse qui coupe 2 postes sur la Paillade. Ce qui se joue c’est quasiment la fin de la prévention spécialisée de l’Hérault, après qu’on nous ait menti droit dans les yeux” explique Max Muller, salarié d’APS 34 et militant à la CGT. En effet, le 25 mars dernier les élu-es du département avaient assuré que les financements resteraient constants.
“Les premières personnes qui se retrouvent touchées effectivement c’est nous les éducateurs”, continue Max. “Mais ce sont surtout les habitant-es des quartiers populaires qu’on accompagne par milliers partout dans le pays qui vont se retrouver dans la merde, c’est eux qui seront attaqués en premier lieu, c’est pas juste une question d’emploi”.
L’association fournit une aide précieuse aux personnes en difficulté. Une mère de famille habitante de la Paillade témoigne : “Ça fait 13 ans que j’habite à Paillade, j’ai 3 enfants et j’avais beaucoup de difficultés concernant les papiers, la recherche d’un travail, les inscriptions. Les salarié-es d’APS 34 étaient très présent-es pour m’aider dans les démarches, ils donnent aussi des cours de soutien aux enfants, ils m’ont aidé pour les procédures. Ils vont nous manquer si ils sont pas là” “C’est un soutien tellement important”, ajoute une autre habitante. “Ils sont tout le temps là à nous aider, pour sortir les enfants de la rue, aider les parents et les enfants incompris”.
Les coupes budgétaires représentent un problème bien plus large qui menace différents secteurs. “Il y a des centres sociaux qui sont en train de fermer, les camarades de l’association Adages sont en grève, comme les assistantes familiales, ou les chauffeurs poids lourds qui livrent de repas pour les cantines. Notre réponse doit être une lutte collective à l’échelle départementale ou même nationale pour pas juste se faire découper les uns après les autres” ajoute Max Muller.
Présent au rassemblement de soutien à Anasse Kazib organisé le mardi 17 juin à Montpellier, celui-ci appelle à une “lutte commune contre le gouvernement qui fait le choix de la répression au lieu de faire celui de la protection”, et dont les “coupes budgétaires financent les politiques de réarmement. On est pas dupes, ils ont besoin d’argent pour les avions et les bombes c’est pour ça qu’on est licencié-es.”
Un prochain rassemblement est prévu jeudi 26 juin sur la Place de la Comédie à midi.
mise en ligne le 20 juin 2025
Dix ans
de SOS Méditerranée :
« On sauve des vies,
un point c’est tout »
Nadège Dubessay sur https://www.humanite.fr/
En une décennie, elle a porté secours à plus de 42 000 personnes. Ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, l’ONG SOS Méditerranée fête ses 10 ans. Financée à 91% par des dons privés, l'organisation continue jour après jour de sauver des vies, malgré des obstacles toujours plus nombreux.
C’était une affaire qui roule. Suffisamment pour faire vivre son épouse et ses deux enfants. Grâce à un oncle, Neerav (le prénom a été changé) a pu ouvrir un café au Bangladesh. L’oncle en question, d’un parti d’opposition, est retrouvé mort, poignardé. Le café de Neerav est brûlé. Menacé de mort à son tour, le jeune homme de 32 ans n’a pas d’autre issue que la fuite. Elle passe par la Libye, où il est enlevé et torturé. Parce qu’il n’avait pas d’argent à donner à ses bourreaux, il sera embarqué de force sur un bateau en bois surchargé, enfermé dans la cale où l’air est saturé de vapeur et de carburant. « Nous ne pouvions plus respirer. J’ai vomi 32 fois. Un garçon à côté de moi a eu les jambes brûlées par le carburant du bateau qui s’était mélangé à l’eau de mer. Sa peau se détachait. » Neerav perd connaissance. « Quand on m’a sorti de la cale, j’étais si faible que je ne pouvais pas marcher. Mais j’ai compris que nous allions être secourus. Je n’arrivais pas à y croire », raconte-t-il encore. Le 6 novembre 2024, il sera sauvé ainsi que 139 autres personnes par l’Ocean Viking, le navire humanitaire de l’association SOS Méditerranée. À bord, chacun compte. Il faut vite donner les premiers secours, distribuer la nourriture. Et prendre le temps d’écouter. Des récits singuliers. Tous bouleversants. Comme celui de Neerav.
Six bébés sont nés à bord et 641 enfants avaient moins de 5 ans
Ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, SOS Méditerranée célèbre son 10e anniversaire. Une décennie d’engagement citoyen pour sauver des vies en mer. D’abord grâce au navire l’Aquarius (2016-2018), puis l’Ocean Viking (2019 à aujourd’hui). Les chiffres, implacables, en disent long. Depuis 2016, 42 381personnes de 44 nationalités différentes, dont 14 % de femmes et 24 % de moins de 18 ans, ont été secourues. Six bébés sont nés à bord et 641 enfants avaient moins de 5 ans. Mais la Méditerranée reste la route migratoire la plus mortelle, avec 32 000 décès recensés depuis 2014.
Jamais Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée et cofondatrice du projet, n’aurait imaginé une mobilisation si durable. L’histoire débute en 2014, année qui marque la fin de l’opération humanitaro-militaire « Mare Nostrum », qui avait permis de secourir pendant un an plus de 150 000 personnes en Méditerranée centrale. Une opération lancée après un naufrage au large de l’île italienne de Lampedusa, où au moins 368 personnes sont mortes. La plupart avaient fui l’Érythrée. L’émotion citoyenne était alors immense.
Sophie Beau habite Marseille. L’humanitaire, elle baigne dedans depuis toujours. « Un drame gravissime se déroulait sous nos yeux, aux portes de l’Europe. » Il fallait agir. Mais comment ? Sa rencontre avec Klaus Vogel, un Allemand de la marine marchande, sera déterminante. Face à la défaillance des États européens, ils montent cette idée folle de sauver des gens en Méditerranée. Après tout, selon le droit maritime international et le droit humanitaire, il s’agit bien d’un devoir impératif, non ? Ils sont une poignée de bénévoles à y croire. À peine se comptent-ils sur les dix doigts de la main. « On s’est dit : « Si on arrive à sauver une vie, ça sera bien » », sourit aujourd’hui Sophie Beau.
« On était clivants »
Les demandes de subventions, elle sait faire. Mais quelle ne fut pas sa stupeur de voir les portes des soutiens habituels se refermer les unes après les autres. Partout, le même refrain : « On ne pourra pas vous financer. » « Il y avait plusieurs raisons, dont une certainement politique. On était clivants, selon beaucoup. Et dans le financement des actions humanitaires, aucune enveloppe n’est consacrée à la mer Méditerranée. »
Qu’à cela ne tienne. Sophie Beau passera par le crowdfunding – le financement participatif – via la plateforme Ulule. « En six semaines, on a levé 275 000 euros. Du jamais-vu pour un projet de solidarité. » De son côté, Klaus Vogel dégote l’Aquarius, un navire capable d’accueillir des centaines de personnes et d’affronter la mer par tous les temps. Un an après la création de l’association, le bateau se lance dans les eaux méditerranéennes avec à son bord une équipe de professionnels : médecins, infirmiers, sage-femme… En deux ans et demi, plus de 29 000 personnes seront secourues.
Aujourd’hui, l’association, financée à 91 % par des dons privés dont 49 % de particuliers, compte plus de 900 bénévoles répartis dans 23 antennes et surmonte vaille que vaille les obstacles – nombreux – à sa mission première : « Sauver des vies en mer, un point c’est tout. La situation s’est largement détériorée », soupire Sophie Beau. En 2018, avec l’arrivée de Matteo Salvini au gouvernement, l’Italie transfère ses responsabilités à la Libye – où tous les exilés passés par-là décrivent un enfer – pour la coordination des secours sur cette zone de la Méditerranée dans les eaux internationales. Les conséquences s’avèrent dramatiques. Plus aucun navire civil n’est informé d’un cas de détresse par les autorités libyennes, qui s’acharnent à empêcher les sauvetages. « On se retrouve à l’aveugle, avec nos jumelles, à scruter la mer », raconte l’humanitaire.
« Il y a cette volonté, palpable, de nous criminaliser »
Pire, depuis l’accession au pouvoir de Giorgia Meloni en Italie, le décret Piantedosi appliqué dès janvier 2023 interdit de mener plusieurs sauvetages d’affilée. Au risque que le navire soit confisqué, amende en prime. À cela s’ajoutent des autorités italiennes désignant un port toujours plus loin pour débarquer les personnes. « Il y a cette volonté, palpable, de nous criminaliser et de nous empêcher de mener nos opérations en mer. Avec des conséquences tragiques pour tous ceux que nous ne pouvons plus secourir », tempête Soazic Dupuy, directrice des opérations. « L’équipage est confronté à ce dilemme : débarquer toujours plus au nord, sans dévier notre route, même si nous avons connaissance d’un autre cas de détresse. Sinon, on est détenus et on perd vingt jours d’opération. » Sans compter les coûts additionnels en fioul : « 300 000 euros depuis le début de l’année », détaille Soazic Dupuy.
À terre, c’est notamment l’extrême droite qui cible SOS Méditerranée. Intimidations, agressions, harcèlement sur les réseaux sociaux, voire procès, via de soi-disant contribuables qui lancent des recours contre les subventions des collectivités territoriales (9 % des fonds de l’association). Ils dénoncent un « financement du grand remplacement » et accusent l’ONG de complicité des trafiquants d’êtres humains. « Le RN opère une vraie guérilla judiciaire, assure Sophie Beau. Mais avec notre approche butée et légaliste, nous avons obtenu une décision de jurisprudence du Conseil d’État en 2024 et nous n’avons plus eu de nouvelles attaques. »
« Nous avons développé une expertise sur le sauvetage sécurisé en mer »
Il faut avoir les épaules solides dans ces conditions pour ne pas baisser les armes, comme beaucoup d’autres navires humanitaires l’ont fait. « Nous avons appris de nos erreurs et, en dix ans, nous avons développé une expertise sur le sauvetage sécurisé en mer que nous pouvons transmettre à d’autres », se félicite Soazic Dupuy.
SOS Méditerranée, c’est aussi le soutien indéfectible de donateurs, de bénévoles toujours plus nombreux, plus jeunes. Et ici, le mot famille n’est pas galvaudé. Son président, François Thomas, parle de « véritable parenthèse d’humanité ». Ce marin de formation s’est dit incroyablement bluffé par « le professionnalisme des équipes, qui se remettent sans cesse en question et sauvent des vies dans des conditions très périlleuses ».
Sophie Beau puise ses forces dans cette multitude d’actions solidaires qui permettent à l’association de collecter les 24 000 euros nécessaires chaque jour pour une opération en mer. Elle œuvre afin que les mers et les océans soient enfin reconnus comme un espace humanitaire et sanctuarisés. Soazic Dupuy parlerait des heures durant de « cette force incroyable, cette résilience » des rescapés. Personne ici n’est dupe. Le changement climatique, les conflits généreront toujours plus de flux migratoires. Combien de morts en mer faudra-t-il encore pour que les États ouvrent les yeux ?
mise en ligne le 19 juin 2025
Ça a eu lieu !
Catherine Tricot sur www.regards.fr
Il y a un an le président dissolvait l’Assemblée nationale. Retour sur ce moment qui rassembla la gauche.
Ce fut un choc, un traumatisme national, souvent vécu intimement : on se souvent de l’endroit où l’on se trouvait lorsqu’Emmanuel Macron est apparu sur les écrans ce 9 juin 2024 vers 21 heures. Au soir de l’élection européenne où l’extrême droite française venait de rassembler plus de 31% des suffrages et les macronistes moins de 15%, le président de notre Ve République annonçait sa décision : l’Assemblée nationale est dissoute.
Dans la ville où je vis, Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, ce fut un vent d’angoisse. Comment Macron pouvait-il nous faire ça !? Lui semblait s’amuser : il voulait « balancer une grenade dégoupillée dans les jambes des partis. Maintenant on va voir comment ils s’en sortent ». Nous, on voyait déjà le RN à Matignon et tout le monde anticipait la poussée des haines racistes, les expulsions, les agressions homophobes, les attaques « contre les wokistes et les gauchistes ». Ce fut cette épouvantable anticipation qui a poussé des centaines de milliers d’entre nous à exiger l’union de tous les partis de gauche. Les militants politiques n’étaient pas les plus présents dans ces premiers moments, marqués par les divisions. Glucksmann pavoisait avec un peu plus de 13% ; Mélenchon était ravi que LFI frôle les 10%, les écologistes respiraient d’avoir franchi la barre fatidique des 5% ; les communistes n’avaient toujours pas la clef pour sortir de leur marginalité… La gauche politique qui rassemblait autour de 30% était à ses affaires.
Mais, dès cette nuit-là, devant les sièges des partis, sur les réseaux, par tous les moyens (pétitions, note de blogs, appels…), la gauche profonde se mobilisait. La proposition fut d’abord formulée par François Ruffin : il fallait un « nouveau front populaire », avec les partis, les assos, les syndicats… tout le monde pour barrer la route au RN. Un programme, partout des candidats communs sous la bannière NFP malgré quelque dissidences et de méchantes purges. Au final, hausse spectaculaire de la participation et à la surprise générale, le NFP arrive en tête. Les partis de gauche s’enferment alors à huis clos pour trouver un nom qui fasse consensus pour Matignon. Que ces 10 jours furent longs et pathétiques. Et ce fut l’inconnue et inattendue Lucie Castets ! Fantastique ! Nous avons donc de la ressource humaine.
La suite, on la connait. Elle commence par cette incroyable fête concoctée par Thomas Jolly et sa bande. Sur la Seine, aux yeux du monde et pour ouvrir les Jeux olympiques, c’est notre France qui s’avance. Belle, inattendue, dangereuse et créative. On est heureux. Comme le dit l’historien Patrick Boucheron, qui était de l’aventure aux côtés de Thomas Jolly, à propos de tous ces moments : « Ça a eu lieu ». Et c’est là l’essentiel.
L’acharnement à éteindre ce feu n’a pas été vain. Macron a procrastiné pendant 3 mois pour éviter que la gauche ne vienne défaire « sa belle et grande politique de l’offre ». Barnier fut nommé. Rien ne fut demandé aux millions d’entre nous qui ont voté NFP. Les partis de gauche se sont un peu plus entredéchirés. Comme si Bardella avait gagné, Retailleau a pu dire et faire ses dingueries et le premier ministre Bayrou parler sans honte de submersion migratoire. Gaza se meurt et il se passe si peu. On promet désormais la retraite à 66 ans. Et Macron recommence à se parer des vertus de l’écologie. La tristesse est revenue. Glucksmann et Mélenchon se préparent, loin de nous, de nos peurs et de nos espoirs.
Mais nous savons que ça a eu lieu.
mise en ligne le 19 juin 2025
Entre galaxie Bolloré, com' à gogo et nouveaux titres, comment la presse d’extrême droite prend d’assaut le débat public
Florent LE DU sur www.humanite.fr
Hier marginalisés, les journaux identitaires gagnent en visibilité dans les kiosques et sur les plateaux télé. Deux ans après la reprise du « JDD » par Bolloré, l’Humanité Magazine a enquêté sur une presse qui a trouvé dans le nouvel écosystème médiatique un tremplin pour se hisser aux avant-postes de la bataille culturelle.
Le racisme en 4 par 3. À la sortie d’une bouche de métro, la une du « Journal du dimanche » du 8 juin et son sous-entendu xénophobe – « Violences : que faire face aux « barbares » ? » – est placardée sur le dos d’un kiosque. Un mois plus tôt, c’est le dessin de la couverture de « La Furia », un bourreau à la hache ensanglantée accompagné du titre « Justice. C’était mieux avant » qui prenait cette place. En avril, c’était celle de « Frontières », avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qualifiée de « parti de l’étranger », reprenant les mots de l’antisémite Charles Maurras.
Le « JDNews », « Omerta », « l’Incorrect » ou « Causeur » s’arrachent aussi ces encarts publicitaires. La presse d’extrême droite ne se cache plus. Elle part à l’assaut du débat public. « On en a de plus en plus de cet acabit, déplore Adel, marchand de journaux de la porte de la Chapelle, Paris 18e. Ils achètent l’emplacement auprès de la maison mère, MediaKiosk, qui est obligée d’accepter tant que l’affiche n’est pas illégale. »
Adel n’a la main que sur la mise en rayon des magazines, qu’il est obligé de proposer à ses clients tant qu’ils sont des « titres de presse d’information politique et générale » – un label que l’historique revue antisémite « Rivarol » a perdu en 2022.
« Notre manager n’a pas de consignes mais, disons, des recommandations… »
Le « JDD » a rejoint la case « extrême droite » il y a tout juste deux ans, avec la prise de contrôle du titre par Vincent Bolloré, propulsant à la tête de la rédaction l’ancien de « Valeurs actuelles » (« VA ») Geoffroy Lejeune, pour imposer sa ligne identitaire. Idem avec leur nouvel hebdomadaire lancé en septembre 2024, le « JDNews », et son directeur de la rédaction Louis de Ragenel. Un autre ex de « VA », magazine qui, depuis, s’est rapproché du Rassemblement national et a polissé son propos outrancier. À leurs côtés, on trouve les nouveaux venus, « Frontières » (qui a succédé à « Livre noir » site web créé en 2021 puis relancé en trimestriel papier en 2023), « Omerta » (2022), le magazine satirique « La Furia » (2022), mais des plus anciens comme « l’Incorrect » (2017) ou « Causeur » (2007).
Il faut fouiller pour les trouver dans l’étal d’Adel. Tout le contraire de celui de Pierre1, vendeur dans une boutique Relay, propriété du groupe Lagardère et donc de Bolloré. « Les titres comme « Frontières », « Omerta », le « JDD », sont clairement mis en avant, explique le trentenaire, contredisant la version officielle de son employeur. D’abord parce qu’ils achètent plus que les autres certains espaces payants, près des caisses par exemple. Et dans les autres espaces, ça n’a rien d’un fait du hasard. Notre manager n’a pas de consignes mais, disons, des recommandations… »
Il est quasiment devenu impossible de ne pas être exposé à cette presse qui diffuse ses obsessions : immigration, islam, insécurité et haine de la gauche. « C’est peut-être la partie la plus efficace de la bataille culturelle : imposer dans l’espace public les images et les discours chers à leur idéologie », constate l’historien des médias Alexis Lévrier.
Cette abondance de titres a automatiquement fait augmenter le lectorat de cette presse extrémiste. Frontières revendique ainsi « plus de 28 000 exemplaires par numéro » contre 15 000 du temps de « Livre Noir ». Le « JDD » n’a pas retrouvé les chiffres de l’avant-Bolloré (entre 120 000 et 140 000 exemplaires) mais, en glissant un contenu d’extrême droite dans un support inchangé (hormis la disparition des pages Enquête…), il expose sa ligne à 107 000 lecteurs (décembre 2024). Quant à « Valeurs actuelles », la concurrence les a nettement fait reculer depuis quatre ans, passant de 114 000 exemplaires par numéro en 2021 à 72 848 au premier trimestre 2025.
Être vu semble d’ailleurs plus important qu’être lu
Cela reste conséquent : il y a dix ans, les tirages cumulés de « Rivarol », « Minute » (disparu en 2020), « Présent » (disparu en 2022), « Éléments » (toujours en vente), « Valeurs actuelles » ou « Causeur » ne dépassaient pas les 100 000 exemplaires. Jadis marginalisée, cette presse qui n’assume pas l’étiquette « extrême droite » – comme le RN – s’est normalisée.
Elle s’est aussi diversifiée pour toucher des publics variés : « La Furia » joue la carte de l’humour, « l’Incorrect » possède des pages « lifestyle », « Valeurs actuelles » et « Frontières » multiplient les formats vidéo… « Les nouveaux s’inspirent beaucoup des réseaux sociaux et des codes télévisuels avec peu de faits mais beaucoup de mise en scène », constate le sociologue Samuel Bouron, auteur de « Politiser la haine » (La Dispute, 2025).
Être vu semble d’ailleurs plus important qu’être lu. Pour imposer leur agenda dans l’espace public, l’affichage publicitaire est une arme, tout comme l’exposition sur les plateaux de télévision. Erik Tegnér (« Frontières »), Geoffroy Lejeune (« JDD »), Tugdual Denis (« Valeurs actuelles »), Juliette Briens (« l’Incorrect »), Elisabeth Lévy (« Causeur ») – pour ne citer qu’eux –, ont leur rond de serviette sur CNews mais parfois au-delà, comme sur BFMTV, Sud Radio ou RMC… « Ces titres servent de rampes de lancement à un bataillon de penseurs identitaires qui vont avoir la parole dans d’autres médias, explique Samuel Bouron. C’est un élément déterminant de la bataille de l’extrême droite qui consiste à imposer l’idée que tout problème dans la société est lié au triptyque immigration-islam-insécurité. »
Avec le « JDD », Relay, Europe 1 et CNews, Vincent Bolloré s’est construit un écosystème, avec des titres préexistants perçus comme sérieux, qu’il ouvre aux autres médias, leur offrant une légitimation et une notoriété qu’ils n’auraient jamais pu atteindre sans cette bienveillance.
La presse d’extrême droite devient mainstream
Une boucle tellement puissante qu’elle finit par contaminer au-delà de la sphère d’extrême droite en imposant leurs thèmes dans le débat public. Exemple éclatant, pendant les législatives de 2024, Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFMTV, dépassé par CNews dans l’audimat, a sommé ses programmateurs d’inviter davantage « d’éditorialistes droite et droite + ». « Ils réussissent à diffuser leurs infos, même tronquées ou fausses, s’inquiète Alexis Lévrier. Et surtout à imposer de fausses évidences auprès du grand public, par exemple en érigeant comme faits de civilisation tout fait divers impliquant une victime blanche. »
Un journalisme charognard qui ne s’embarrasse pas toujours de la déontologie et de la rigueur nécessaire. En février dernier, le reporter de « Frontières » Jordan Florentin, en recherche permanente de coups médiatiques, s’est empressé d’exhumer avec délectation les tweets « anti-RN » et « d’extrême gauche » de la sœur d’une jeune victime de 11 ans, Louise : « Sa petite sœur vient d’être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. » Une mise en danger de la famille d’une victime couplée d’une fausse information, puisque le profil du meurtrier était tout autre.
Ces affaires ne les ont pourtant pas discrédités, pas plus que les condamnations de « Valeurs actuelles » pour incitation à la haine ou « Causeur » et « l’Incorrect » pour diffamations. Dans le « JDD », semaine après semaine, les ministres en poste se succèdent pour faire leurs annonces sur l’air du « il faut parler à tous les Français ». La presse d’extrême droite devient mainstream, tout en dénonçant en chœur le « système » sans jamais remettre en cause le système économique.
Et pour cause : la plupart des magazines d’extrême droite sont financés, au moins partiellement, par de riches mécènes aux positions libérales affirmées. Vincent Bolloré au « JDD » ; la famille Safa, milliardaire actionnaire de « Valeurs actuelles » ; l’héritier et ex-candidat Reconquête Laurent Meeschaert à « l’Incorrect » ; l’homme d’affaires Charles d’Anjou qui a imprimé sa patte pro-Russe et identitaire dans « Omerta » ; le financier Charles Gave qui en 2023 a renfloué « Causeur », dont le principal actionnaire est Gérald Penciolelli, ancien propriétaire de « Minute »…
En octobre 2012, Yves de Kerdrel est nommé directeur de la rédaction de « Valeurs actuelles », alors classé comme hebdomadaire de droite conservatrice. Il entreprend aussitôt une étude de marché afin de mesurer quel lectorat il est susceptible d’attirer en changeant sa ligne. Le profil type qui en ressort « est un Français bourgeois, rural (…) contre le politiquement correct et contre le parisianisme ». Il en conclut qu’une radicalisation de son titre attirerait de nouveaux lecteurs. Ce qui fonctionne : six mois après, « Valeurs actuelles » augmentait son audience de 50 %.
Où sont les annonceurs ?
Reste qu’aujourd’hui, il ne fait pas gagner d’argent à ses actionnaires. D’autant que l’hebdomadaire, comme les autres titres d’extrême droite, est confronté à un boycott des grands annonceurs. C’est le constat réalisé par le collectif des Sleeping Giants, qui scrute les publicités diffusées par les médias d’extrême droite et alerte les marques qui s’y trouvent : « Dans « Valeurs actuelles », il n’y a absolument aucune marque « connue ». Pour le « JDD », quasiment tous les grands noms sont partis avec l’arrivée de Geoffroy Lejeune », détaille Rachel, porte-parole. Économiquement, il reste donc coûteux en termes d’image de s’afficher dans ces pages. Pour combien de temps ?
En attendant, des marques « identitaires » remplissent les encarts. Comme Terre de France, boutique en ligne proposant des produits aussi variés que des chaussettes patriotes, des bustes de Jeanne-d’Arc ou des drapeaux royalistes, qui a aussi sponsorisé, le mois dernier, l’émission « l’Heure des Pros » (CNews) de Pascal Praud. Sur Internet, une agence, Helium, joue même les intermédiaires. Elle fournit à des sites d’extrême droite pestiférés, comme Breizh-Info ou le nouveau venu Occidentis, des « annonceurs principalement chrétiens » selon un mail de démarchage débusqué par les Sleeping Giants.
Dans le « JDD », outre la nouvelle chaîne T18 qui s’est offert une page dans le dernier numéro, un annonceur de poids est revenu en force : LVMH. Comme un symbole du rapprochement entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault, le second ayant récemment cédé ses parts du groupe Lagardère au premier. Accompagnés d’autres investisseurs, ils ont racheté fin 2024 l’École supérieure de journalisme de Paris. Nouvel étage de cette fusée visant à imposer l’extrême droite dans le champ médiatique, et au-delà. « Ils sont persuadés que les écoles de journalisme sont « woke », de gauche, ce qui n’est pas le cas, analyse l’historien des médias Alexis Lévrier. En réalité, au nom du pluralisme et de la liberté d’expression, ils veulent dans leurs rédactions des entités interchangeables auxquels on peut imposer une idéologie. »
C’est aussi avec le même argument fallacieux d’une prétendue « emprise de la gauche » sur la presse qu’il conviendrait de combattre que les nouveaux titres d’extrême droite justifient leur existence. Ils cherchent à faire croire qu’ils sont des chemins de la liberté. En les lisant, Desproges aurait toujours la nausée et les mains sales.
mise en ligne le 18 juin 2025
Marqué par les reculs environnementaux,
le projet de loi « simplification » est adopté
Lucie Delaporte sur wwwmediapart.fr
Le projet de loi sur la simplification de la vie économique, qui comporte d’importantes régressions sur le front de l’écologie, a été adopté de justesse mardi 17 juin contre la majorité macroniste qui le jugeait trop éloigné de ses intentions initiales.
« C’est« C’est une victoire culturelle du Rassemblement national contre l’écologie punitive. » Tout sourire, à l’instar de tous les députés de son parti au sortir de l’hémicycle, Pierre Meurin parade.
Le texte sur la simplification de la vie économique, adopté mardi 17 juin au terme d’un parcours chaotique, est incontestablement une victoire pour la droite et l’extrême droite qui ont très largement réécrit le texte initial en le transformant en loi de retour en arrière sur l’écologie.
Suppression des zones à faibles émissions (ZFE), détricotage du « zéro artificialisation nette », recul sur la protection des espèces protégées… Il aura finalement très peu été question de la vie des entreprises dans ce texte bourré de cavaliers législatifs, avec des sujets n’ayant bien souvent rien à voir avec l’économie.
La mine réjouie des députés du Rassemblement national (RN), dont les 120 députés ont voté comme un seul homme pour ce texte, montrait aussi leur satisfaction d’avoir fait capoter le plan des macronistes qui, au dernier moment, avaient annoncé qu’ils voteraient contre un texte pourtant à l’initiative du gouvernement Attal.
À la tribune pour le groupe Ensemble pour la République (EPR), la députée Marie Lebec explique ce revirement. Il faut dire que pour la troisième fois en un mois, les macronistes s’apprêtent à voter contre un texte qu’ils ont eux-mêmes défendu… Elle dénonce donc un projet de loi « disloqué et vidé de sa cohérence, par les circonstances d’alliances contraires », en référence notamment à la suppression des ZFE votée tant sur les bancs de la droite et de l’extrême droite que de La France insoumise. « C’est un texte qui fragilise ce que nous avons construit depuis huit ans » sur l’environnement, assure celle qui a pourtant voté pour la suppression des ZFE. Comprenne qui pourra.
Au moment du vote, le groupe EPR s’est d’ailleurs fracturé puisque près d’un tiers des députés macronistes ont voté avec la droite et l’extrême droite pour le texte ou se sont abstenus. Le MoDem de François Bayrou a voté en faveur de ce texte de grande régression écologique, offrant la victoire sur le fil – 275 voix contre 252 – à l’alliance RN-LR-Horizons.
Espèces protégées en danger
Face à des députés RN surmobilisés, les macronistes ont souvent brillé par leur absence lors de l’examen du projet de loi, pourtant annoncé en grande pompe comme un texte fondamental par Bruno Le Maire.
Déposé il y a plus d’an, le projet de loi, examiné par petits bouts ces derniers mois, a largement été réécrit, se colorant peu à peu de l’air du temps anti-écolo.
« On a bien vu le traumatisme au moment où l’A69 a été jugée illégale par le tribunal administratif de Toulouse. Là, on a eu une pluie d’amendements pour pouvoir bétonner tranquillement, détaille la députée LFI Anne Stambach-Terrenoir. Au final, on est arrivé à un texte d’inspiration trumpiste mené par la droite et l’extrême droite. »
Ce texte a ouvert la voie à toutes les obsessions anti-écolo, antidémocratiques, antisociales du moment. Charles Fournier, député Les Écologistes
L’examen du texte en commission avait ouvert le bal du grand n’importe quoi avec la proposition de supprimer des centaines d’agences et d’organismes tels que l’Ademe, l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Contrôleur général des lieux de privatisation de liberté… Des milliers d’amendements – étrangement jugés recevables – avaient alors été introduits, faisant complètement dérailler le projet de loi initial.
Si les propositions les plus baroques ont été écartées, le texte vient défaire des pans entiers de la loi « climat et résilience », adoptée lors du premier mandat Macron.
Il comporte notamment des reculs importants sur la protection des espèces protégées qui ne doit plus être un frein aux projets d’infrastructures diverses ou à la vie économique. À l’heure de la sixième extinction de masse, il ne faudrait pas gêner les projets autoroutiers et autres constructions de data centers. Ces derniers, comme tout un tas de projets de construction, pourront être qualifiés d’intérêt général majeur, ce qui les exonère d’un certain nombre de règles sur la biodiversité.
Difficile de résumer pour le reste le contenu d’un texte fourre-tout qui se sera préoccupé de l’octroi des licences IV dans les buvettes comme des massifs coralliens. Pointant les coups de canif portés aux études d’impact sur l’exploration minière, le député Les Écologistes Charles Fournier fustige « un texte qui a ouvert la voie à toutes les obsessions anti-écolo, antidémocratiques, antisociales du moment ». « C’est ubuesque et en même temps très grave », affirme-t-il, en expliquant que son groupe va porter des recours au Conseil constitutionnel contre les cavaliers législatifs. « Qu’on m’explique ce que les mesures contre la pollution de l’air ont à voir avec la vie économique », s’agace-t-il, certain que plusieurs pans de la loi tomberont devant cette instance.
Sur les ZFE, les écologistes vont déposer ce jour une proposition de loi pour rétablir le dispositif et l’améliorer, au vu des critiques portées par la gauche sur l’absence d’alternative à la voiture et le caractère excluant de la mesure pour les ménages modestes.
Si la ministre chargée du commerce et des PME, Véronique Louwagie (LR), s’est félicitée d’un texte « fortement attendu par le monde économique », la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle expliqué dans un communiqué agacé que « la santé publique et la lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions ne devraient pas être les variables d’ajustement de calculs politiques à la petite semaine ».
Le texte fera l’objet d’un examen en commission mixte paritaire en septembre.
Derrière la simplification,
une régression sociale et économique
sur https://www.cgt.fr/
Sous couvert de simplification administrative, le projet de loi « simplification de la vie économique » actuellement examinée à l'Assemblée nationale menace le droit du travail, affaiblit les contre-pouvoirs et aggrave la crise écologique. Décryptage CGT
Alors que le gouvernement vante une nouvelle étape de simplification administrative pour les entreprises, le projet de loi actuellement débattu à l’Assemblée nationale cache mal une offensive contre les droits des salarié·es, la démocratie sociale et la protection de l’environnement. Décryptage d’une loi qui fait peser de lourdes menaces sur le monde du travail.
Des attaques en règle contre les droits des salarié·es
Derrière la « simplification », plusieurs mesures contenues dans ce texte s’en prennent directement au droit du travail et au fonctionnement démocratique des instances représentatives du personnel :
-
possibilité de généralisation de la visioconférence pour les réunions du CSE, au détriment de la qualité des échanges en présentiel et du lien collectif, pourtant essentiels à une démocratie d’entreprise vivante ;
-
suppression de l’agrément régional pour les organismes de formation syndicale, ouvrant la voie à une mise en concurrence et à une baisse de la qualité des formations pour les élu·es du personnel ;
-
réduction du délai d’information des salarié·es en cas de cession d’entreprise, de deux mois à un seul. Cela affaiblit la capacité des salarié·es à se mobiliser pour des projets alternatifs de reprise, alors que la désindustrialisation s’accélère ;
-
allègement de nombreuses procédures de déclaration et d’autorisation, avec pour conséquence une remise en cause de garanties en matière de santé, de droits collectifs et d’environnement.
Certain·es député·es de droite ont même tenté d’aller plus loin, avec des amendements – fort heureusement jugés irrecevables – visant à :
-
réduire le nombre de CSE et de défenseur·ses syndicaux·les ;
-
limiter à trois ou six mois le délai de recours devant les prud’hommes pour contester un licenciement ;
-
supprimer l’exigence du consentement du ou de la salarié·e en cas de prêt de main-d’œuvre.
Moins d’instances, moins de démocratie sociale
Autre aspect alarmant du projet : la suppression de 25 comités, commissions et instances consultatives, parmi lesquels :
-
la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
-
l’Observatoire national de la politique de la ville ;
-
le Comité de suivi des mesures liées au Covid-19 ou à la guerre en Ukraine ;
-
et surtout, la Commission du label diversité, un symbole alors que les discriminations au travail explosent.
Même si la mobilisation a permis le maintien de certaines instances clés où siège la CGT (conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, CNDP, Haut-Conseil de l’Assurance maladie…), la vigilance reste de mise. Le texte prévoit :
-
la suppression automatique des instances n’ayant pas « justifié leur utilité » au bout de trois ans ;
-
un principe de « deux suppressions pour une création » pour toute nouvelle instance ministérielle ;
-
Une baisse continue des financements, comme c’est le cas pour l’Ires.
Un recul écologique préoccupant
En matière environnementale, le projet aggrave les dérégulations. en effet, il élargit les projets d’intérêt national majeur aux infrastructures routières et ferroviaires (autoroutes…), qui ne seront plus comptabilisés dans l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols. Une grave remise en cause des engagements climatiques et agricoles.
Plusieurs organismes chargés de l’évaluation environnementale et sanitaire sont supprimés :
-
Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ;
-
Observatoire des espaces naturels et agricoles ;
-
Commission sur les démantèlements nucléaires ;
-
Commission sur la déontologie des alertes environnementales…
Une mobilisation syndicale large et unitaire
Face à cette offensive, sept organisations syndicales nationales (CGT, CFE-CGC, CFTC, FO, FSU, Solidaires, Unsa) ont publié le 7 avril un communiqué intersyndical appelant les parlementaires à rejeter les amendements les plus dangereux.
« Pour réduire les droits sociaux dans l’entreprise, on simplifie le Code du travail. Pour rendre illisible la solidarité à l’œuvre sur la fiche de paye, on la simplifie. Et pour capter toujours plus de richesses créées par les travailleur·ses, on simplifie la vie économique… »
Au nom de la simplification, c’est en réalité une mise en coupe réglée du droit du travail, des contre-pouvoirs démocratiques et de la transition écologique qui est à l’œuvre.
mise en ligne le 18 juin 2025
États-Unis : 5 millions d’Américains dans la rue contre Trump
et ses dérives autoritaires
Stéphane Ortega sur wwwhttps://rapportsdeforce.fr/
Samedi 14 juin, des millions de manifestants ont protesté contre la politique autoritaire de Donald Trump aux États-Unis, une semaine après les arrestations de masse de migrants à Los Angeles et l’envoi de la troupe en Californie.
Deux villes des États-Unis symbolisent à elles seules la force de la mobilisation anti-Trump de ce samedi. À Burlington (Vermont), commune dans laquelle Bernie Sanders a été maire, 16 000 personnes sont descendues dans les rues. Un habitant sur trois. À Charlottesville, commune de Virginie de 43 000 habitants, marquée par une attaque meurtrière de l’extrême droite pendant le premier mandat de Donald Trump, près de 7 000 personnes ont défilé sous la bannière « No Kings ». Cette journée, lancée par une coalition de 200 organisations, a pris comme slogan : pas de monarques en Amérique. Un message clair à Trump, accusé de se comporter comme un roi : celui-ci vient par exemple d’organiser une parade militaire à Washington pour le jour de son anniversaire.
Les chiffres de la participation aux manifestations sont impressionnants partout et retiennent l’attention dans les plus grandes villes américaines. Au moins 70 000 à Seattle, 100 000 à Chicago et San Francisco, 200 000 à Los Angeles comme à New York, 80 000 à Philadelphie, 60 000 à San Diego, 20 000 à Denver (Colorado) comme à Austin (Texas), Portland (Oregon) ou Tampa (Floride) pour n’en citer que quelques-uns.
Après la sidération, la mobilisation
Cette journée marque un tournant. Elle tranche avec les mobilisations modestes de mars dernier, qui dénonçaient les attaques contre la science et les purges numériques des sites gouvernementaux. À l’époque, 2000 personnes s’étaient rassemblées à Washington et quelques milliers d’autres dans une trentaine de villes des États-Unis.
Cette fois-ci, les opposants à la politique autoritaire de Donald Trump revendiquent cinq millions de participants dans 2000 points de manifestations sur l’ensemble du pays. Un décompte participatif, impliquant des journalistes indépendants, estime la participation à cette journée entre 4 et 6 millions d’Américains.
Finies la léthargie et la désespérance des premiers mois face à l’avalanche de mesures du nouveau président. L’opposition a réussi à sortir de sa torpeur. Un premier coup de semonce avait été donné le 5 avril dernier. Ce week-end-là, la journée « Hands Off » réunissait au moins 600 000 manifestants. Plus selon les organisateurs qui s’avançaient jusqu’au chiffre de 5 millions. Mais malgré tout, moins que ce week-end, après comparaison du nombre de manifestants dans plusieurs villes importantes.
Toujours est-il qu’en ce mois de juin l’opposition à Trump n’est plus tétanisée. Durant des mois, la comparaison avec la grande mobilisation de la Women’s March début 2017 servait de référence pour montrer la faiblesse de la résistance. Aujourd’hui, la journée « No Kings » rivalise avec les estimations de 2017 comprises entre 2 et 5 millions d’Américaines et d’Américains dans les rues.
Les arrestations de masse mettent le feu aux poudres aux États-Unis
Une semaine avant les mobilisations « No Kings » pour dénoncer l’autoritarisme de Donald Trump, le président des États-Unis lançait une vaste opération d’arrestations de migrants à Los Angeles. Dès le 6 juin, des agents fédéraux de la police de l’immigration (ICE), masqués et armés, multipliaient les descentes dans les quartiers latinos de Los Angeles et dans des entreprises. Un raid choquant qui a déclenché des manifestations et des actions de désobéissance civile autour des centres de détention en Californie.
L’administration Trump, qui exige à l’ICE 3000 arrestations par jour, n’a pas fait dans la demi-mesure en réponse aux protestations. Elle a envoyé 4000 membres de la Garde nationale et 700 marines contre un mouvement que Donald Trump tente de faire passer pour insurrectionnel.
Loin de reculer, Donald Trump a annoncé après les manifestations monstres de samedi qu’il entendait étendre les arrestations à des villes comme Chicago, New-York ou Seattle. Toutes des villes sous administration démocrate, qu’il désigne comme des ennemis intérieurs des États-Unis. Quitte à mettre le feu aux poudres dans tout le pays.
mise en ligne le 17 juin 2025
Le Planning familial
est en danger
sur www.regards.fr
Baisses et suppressions de subventions, fermetures d’antennes départementales : l’avenir du Planning familial s’assombrit. Le plus grand réseau associatif et militant à offrir des services de santé sexuelle en France alerte sur la baisse de financements des collectivités. Le Planning dénonce une attaque « à l’accès à la contraception, à l’avortement, à la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), à l’éducation à la sexualité, à la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles [menant à] remettre en cause des droits acquis de haute lutte ». Argument massue de ces coupes budgétaires : la dette publique bien sûr. Dans la région Pays de la Loire, la présidente Horizons Christelle Morançais a supprimé la totalité des subventions allouées. À l’heure où les IST explosent et les besoins d’accompagnement augmentent face à la libération de la parole sur les discriminations et les violences, sacrifier le Planning, c’est mettre en danger la population.
Quand l’argent dicte
les droits des femmes
Violaine de Filippis Abate sur www.humanite.fr
Le Planning familial a récemment alerté sur les coupes budgétaires qu’il subit. Dans la Drôme par exemple, sept centres ferment. Cette situation illustre parfaitement comment, sans modifier les lois protectrices, la réduction des moyens rend les droits inapplicables. Prenons l’avortement, droit pour lequel le Planning familial milite activement et accompagne concrètement les femmes. Le manque de moyens financiers limite son action sur le terrain.
En Ardèche, une femme sur deux doit changer de département pour avorter. Sur l’ensemble du territoire, ce taux atteint une femme sur cinq. Le Planning souligne par ailleurs que 89 % des personnes interrogées font état de freins persistants : manque de structures, délais d’attente trop longs et stigmatisation persistante.
La méthode de coupure de budgets révèle une stratégie politique plus large. L’allocation budgétaire constitue un outil de régression des droits des femmes sans passage parlementaire. Cela trouve un écho particulier dans les programmes politiques actuels. Au Rassemblement national, on propose des politiques familiales traditionalistes via des mesures fiscales incitatives. Rien de surprenant puisque dans notre société capitaliste, les objectifs politiques se traduisent nécessairement par des incitations fiscales.
Subventionner la maternité plutôt que l’emploi pousse les femmes à mettre leur carrière entre parenthèses et à dépendre du revenu du conjoint plutôt que de sécuriser leurs propres ressources. Il va également sans dire qu’aucune mesure favorisant l’égalité professionnelle n’est mentionnée dans leurs différents fascicules. Autrement dit, il n’est pas question d’améliorer l’égalité salariale ou de lutter contre les discriminations professionnelles, ni de permettre des dispositifs facilitant l’articulation vie professionnelle-vie personnelle.
Nous assistons ainsi à un phénomène cyclique où l’argent demeure le nerf des attaques aux droits des femmes. Comme à la fin du XXe siècle, le backlash post-MeToo est aussi visible dans les médias des milliardaires conservateurs. Susan Faludi écrivait : « À l’approche des années 1990, Paul Weyrich (fondateur de la nouvelle droite – NDLR) et ses amis ont effectivement l’impression que leurs idées imprègnent la culture dominante. »
Aujourd’hui, ce sentiment de lutte culturelle conservatrice se répète. Et l’ampleur de la mobilisation financière est vertigineuse. Le rapport « la Partie émergée de l’Iceberg » du Forum parlementaire pointe que les versements aux acteurs anti-droits se chiffrent en milliards d’euros. Face à l’offensive budgétaire qui transforme nos droits en mirages, nous devons rester vigilants. Derrière chaque subvention coupée, se dessine le retour d’un ordre patriarcal que ses promoteurs n’osent plus forcément toujours défendre ouvertement, mais qu’ils financent massivement.
mise en ligne le 17 juin 2025
Marche mondiale vers Gaza : depuis Le Caire,
récit du blocage du convoi et de la répression de la mobilisation
Sur https://lundi.am/
Ils étaient des dizaines de milliers d’internationaux à s’être donné rendez-vous pour marcher jusqu’à Gaza depuis l’Egypte en traversant le désert. Mais arrivés au Caire, la mobilisation s’est brutalement faite intercepté et réprimée par le régime Al-Sissi. L’un des marcheurs nous a transmis ce récit des évènements.
13 juin 2025
Après une fouille intense de nos sacs à l’aéroport et le visa obtenu, nous arrivons au Caire sans aucun problème. Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Selon le vol de provenance, le jour et l’heure d’arrivée, beaucoup de nos camarades ont été retenu.es dans des aéroports ou directement expulsé.es par un vol retour. Les maghrébin.es sont spécifiquement pris.es pour cible, passant un interrogatoire quasi systématiquement.
La nuit est courte. Nous recevons un message dans la matinée avec les instructions suivantes : toutes les délégations doivent se retrouver à Ismalaia, en s’y rendant par ses propres moyens en taxi de 2 ou 3 personnes, pour faire pression sur les autorités égyptiennes et tenter d’obtenir une dernière fois le feu vert pour marcher dans le Sinaï.
Sur la route, à peine sortie du Caire, des bouchons à perte de vue. Notre chauffeur nous dit ne jamais avoir vu ça. Cette route est empruntée, mais pas autant. Premier checkpoint : Nous faisons profil bas. Sur le bas côté, des groupes d’occidentaux sont sortis des voitures et semblent ne plus pouvoir avancer. Nous passons sans problème en demandant au chauffeur d’accélérer. On continue la route et de nouveau un énorme bouchon. Nous comprenons que 90% des voitures sont là pour la marche. Ça klaxonne dans tous les sens, l’ambiance devient trépidante. Nous sommes là dans un objectif commun, et c’est beau de nous y voir rassemblés.
Il est 15h. Nous arrivons au 2e check point. Immédiatement, la police encercle la voiture et nous demande les passeports. Nous résistons en leur montrant que nous sommes en règle mais en leur disant qu’on ne lâchera pas notre passeport. En vain. Ils font pression. Nous donnons les passeports. Les agents se baladent avec des piles entières de passeport et rentrent tour à tour dans leurs bureaux. Nous descendons du véhicule, allons à l’encontre des marcheur.euses et nous nous rendons compte de l’étendu du mouvement : de Roumanie, du Chili, de Malaisie, du Canada, du Royaume-Uni, beaucoup d’espagnol.es et énormément de français.es. La délégation française semble être la plus importante. Nous estimons à environ 1000 personnes bloquées à ce checkpoint.
Immédiatement, nous sortons les drapeaux et les slogans. Nous chantons. Nous exprimons notre souhait : Free Palestine ! Nous n’avons plus de passeport, nous sommes stoppé.es sur notre chemin mais nous avons toujours nos voix pour porter haut et fort notre combat.
Nous apprenons que le long de la route, les marcheur.euses ont été arrêté.es sur 4 checkpoint différent. Il commence à faire chaud. Certain.es partent acheter des cartons de bouteilles d’eau pour les distribuer. Nous commençons a perdre patience et exigeons le retour des passeports.
16h : Un agent vient avec une première pile de passeports : agglutiné.es, nous sommes en cercle espérant entendre son nom pour reprendre son passeport. On s’organise comme on peut, par nationalités. La distribution dure des heures, en plein soleil.
19h : Nous sommes une cinquantaine à ne toujours pas avoir notre passeport. Avec une camarade, nous entreprenons une liste des ressortissant.es français.es sans passeport. Nous sommes 8. Nous voulons faire pression auprès de l’ambassade ou du consulat mais tout semble fermé. On va donc continuer à discuter avec les agents.
20h : 2 passeport français ont été retrouvés. Pour les 6 autres, nous sommes toujours dans l’attente. Pareil pour les autres nationalités. Les forces de l’ordre sont arrivées.
Celles et ceux qui ont récupéré.es leur passeport ne sont pas autorisé.es à repartir. Tout le monde se réunit entre délégation. L’idée est de rester camper cette nuit au checkpoint.
22h : ça fait maintenant 2h que nous attendons les 35 passeports manquants. Nous perdons patience. Ils le font exprès. Ils veulent nous ralentir coûte que coûte. La nuit est tombée. Des bus sont arrivés. Nous apprenons qu’au premier checkpoint, les marcheur.euses ont été déportés
dans des bus vers l’aéroport. Pendant que nous sommes toujours en négociation - ça fait 3h qu’on nous dit ’Attendez dans 5 min on vous les rend’ - les délégations sont assises, gardent leur position et commencent à être nassées. La tension commence. Ça s’énerve. Les autorités commencent à faire monter les personnes dans les bus, censés les faire revenir au Caire. De notre côté, nous ne pouvons rien risquer tant que nous n’avons pas notre passeport. Nous voyons la tension monter, les gens emmenés de force dans les bus. Quelques premiers blessés.
23h : tous les passeports on été rendus ! Il faut prendre une décision : rejoindre les autres dans la nasse en solidarité, partir de nous mêmes au Caire pour assurer une présence internationale et éviter l’expulsion à l’aéroport. Les délégations nous conseillent de rentrer au plus vite au Caire, par nous mêmes, et de ne pas inciter la résistance et la violence. Nous sommes un mouvement pacifiste.
14 juin 2025
Beaucoup de militaires dans la ville, les gens se font suivre, interrogés. Certains hôtels dénoncent la présence d’internationaux.ales.
Brève conclusion :
Certes, aujourd’hui les autorités égyptiennes ont en quelque sorte gagné : nous n’avons pas atteint Ismalaia, notre foule a été divisée et nous avons du rebrousser chemin. Mais nous sommes toujours là, déterminé.es à porter notre message coûte que coûte ! Nous faisons du bruit, nous dérangeons, nous perturbons la tranquillité de ces pays complices, et c’est en partie ce que nous voulons ! Alors continuons à résister et à crier haut et fort que nous ne supportons plus ce massacre, il a duré bien trop longtemps. Ne nous divisons pas, suivons notre objectif avec union. Ce serait les laisser gagner une nouvelle fois...
Ce n’est pas un échec. Cette marche contribue à l’éveil international des consciences.
Dans chaque pays, des citoyen.nes organisent des marches en soutien à celle pour Gaza.
Ce témoignage personnel n’est qu’une infime partie de ce qui a été vécu au Caire les vendredi 13 et samedi 14 juin. Nous avons vécu l’un des scénarios les plus favorables.
mise en ligne le 16 juin 2025
Brenda Wanabo-Ipeze, visage de la lutte kanak : « Que la France accepte enfin que notre pays soit libéré »
par Benoît Godin https://basta.media/
Comme six autres responsables indépendantistes kanak, Brenda Wanabo-Ipeze a été emprisonnée dans l’Hexagone dans la foulée des troubles de 2024 en Nouvelle-Calédonie. Libérée mais toujours poursuivie, elle reste déterminée.
« Militante indépendantiste kanak. » Voilà comment Brenda Wanabo-Ipeze se présente. Militante, elle l’est jusque dans ses vêtements. Fin mai, à deux pas du tribunal de Paris où elle a été auditionnée quelques jours auparavant, elle arbore une robe « popinée » de Nouvelle-Calédonie. Une façon de marquer son identité kanak. Brenda Wanabo-Ipeze est l’une des sept responsables indépendantistes kanak transférés et emprisonnés dans l’Hexagone suite à l’explosion de la révolte dans le territoire en mai 2024.
Brenda avait été libérée sous contrôle judiciaire le 10 juillet 2024, avec une autre militante, Frédérique Muliava. Cinq responsables indépendantistes sont quant à eux restés près d’un an en détention. Jusqu’à ce 12 juin : la justice décide de libérer enfin les cinq hommes, dont le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) Christian Tein. Ils n’ont toutefois toujours pas le droit de retourner en Nouvelle-Calédonie.
« C’est une grande étape qui a été franchie, j’espère que cette libération sera de bonne augure pour la suite, réagit Brenda Wanabo-Ipeze. Mais il faut rester mobilisé tant que tout le monde ne peut pas rentrer à la maison, en Kanaky, et que les charges qui pèsent sur nous ne sont pas abandonnées. Nous sommes avant tout des militants indépendantistes kanak : au-delà de notre affaire, on attend que la France accepte enfin que notre pays soit pleinement libéré », ajoute-t-elle.
Accusés d’être des « mafieux »
Brenda Wanabo-Ipeze ne compte pas renoncer. « Dans ma famille, tout le monde milite pour l’indépendance », confie-t-elle. La trentenaire est membre de l’Union calédonienne (UC), le plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie et l’une des composantes majeures du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). Elle est aussi présidente du conseil d’administration de Djiido, la seule radio indépendantiste du territoire. Pas étonnant donc de la retrouver investie dès le début dans la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT). Une structure créée en novembre 2023 par l’UC pour rassembler les opposants au projet du gouvernement français d’élargir le corps électoral aux élections provinciales.
À la CCAT, Brenda Wanabo-Ipeze est en charge de la communication. L’organisation a mené des mois de mobilisation intense – mais « pacifique », assure Brenda – contre la volonté du gouvernement de passer en force sa réforme du corps électoral. Paris a refusé d’entendre. Le 13 mai 2024, quand l’Assemblée nationale s’apprête à adopter la réforme, la Nouvelle-Calédonie s’embrase. La CCAT se retrouve alors accusée au plus haut niveau de l’État. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer d’alors, qualifie même l’organisation de « groupe mafieux » qui « commet des pillages, des meurtres, de la violence ».
« Ça m’écœure, réagit aujourd’hui la militante. Même nous avons été surpris par tout ce qui est arrivé. Le FLNKS n’a jamais fait le choix de la violence, pas plus que l’UC ou la CCAT, parce qu’on est dans “le pari de l’intelligence” [la formule est de Jean-Marie Tjibaou, figure emblématique de l’indépendantisme kanak, ancien président du Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), assassiné en 1989 par un opposant]. C’est comme ça que nos vieux nous ont appris à lutter. Dans le respect des opinions de l’autre. Si je ne suis pas contente après quelqu’un, je ne vais pas brûler son entreprise… »
Quatorze personnes ont été tuées par balle lors du mouvement insurrectionnel qui a duré de mai à septembre 2024. Onze étaient des civils Kanak, tués soit par les forces de l’ordre soit par d’autres civils. Un non-Kanak a été tué alors qu’il attaquait un barrage avec une arme. Deux gendarmes font aussi partie des victimes. On déplore plusieurs milliards d’euros de dégâts matériels. « On n’a pas d’autre pays que Kanaky. C’était regrettable pour nous de le voir dans cette situation-là », soupire Brenda.
La vie de la militante a basculé le 19 juin 2024. « À 6 h 10 du matin, le GIGN a fracassé la baie vitrée de notre domicile dans le quartier de Saint-Michel, au Mont-Dore [à une trentaine de kilomètres de la capitale Nouméa, ndlr]. Ils sont rentrés, m’ont isolée de mon mari et mes deux frères et m’ont annoncé avoir un mandat d’arrêt de la République française à mon encontre. » Les gendarmes perquisitionnent son domicile : « Ils cherchaient des armes, mais il n’y en avait pas. Ils cherchaient également mon passeport, je ne comprenais pas pourquoi… »
« Choquée », Brenda n’est pour autant qu’à moitié surprise : « Dès que le peuple se lève et qu’il y a des débordements, on va chercher des boucs émissaires. Mais les vrais coupables, ce sont ceux qui ont voulu passer en force pour ouvrir le corps électoral ! À un moment donné, l’État français devra assumer ses responsabilités », affirme-t-elle.
Conduite à la caserne Meunier, dans le centre de Nouméa, Brenda est placée en garde à vue. Elle ne le sait pas encore, mais elle n’est pas seule : dix autres responsables de la CCAT sont concernés par ce qui est présenté par le procureur de la République de Nouméa comme un coup de filet contre les « commanditaires présumés » d’émeutes. Parmi eux, Christian Tein, commissaire général de l’ Union calédonienne et figure la plus en vue du mouvement contre le dégel du corps électoral, ou encore Frédérique Muliava, directrice de cabinet du président du Congrès, le parlement local.
La garde à vue des onze activistes va s’étaler sur trois jours, un traitement normalement réservé aux affaires de grand banditisme ou de terrorisme. « Le premier soir, je n’ai pas pu prendre de douche. Cette nuit-là, je l’ai passée menottée sur un lit picot. Je l’ai signalé à mon avocat le lendemain et ça ne s’est plus reproduit, témoigne Brenda. Je pensais alors qu’on allait être relâchés après les interrogatoires. »
Le 22 juin, Brenda et ses camarades sont finalement présentés devant des juges d’instruction qui leur apprennent que toutes et tous sont mis en examen pour des chefs d’accusation extrêmement graves : complicité de meurtre, vol et destruction en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits… Et qu’ils vont être placés en détention provisoire en France dite métropolitaine.
La mère de famille s’effondre : « Je me mets à pleurer, je n’arrivais plus à me retenir. Je pensais à mes enfants. Mon mari attendait dans le hall du tribunal, la juge a demandé à aller le chercher, mais on avait interdiction de se parler. Je n’ai pas pu lui dire que je partais en France, je n’ai pas pu lui dire au revoir. Ta vie se bloque d’un coup. Tu te dis : on est en train de vivre quoi là ? Qu’est-ce qu’il nous fait, l’État français ? »
« Ça a été extrêmement brutal, dit aussi Louise Chauchat, jointe par téléphone. Quand la machine étatique se met en branle comme ici, il n’y a rien à faire, constate cette avocate au barreau de Nouméa, en charge de la défense de trois des inculpés, dont Brenda. Nous, avocats, avons été un simple prétexte aux droits de la défense. Tout était déjà prêt : les avions, le choix des prisons… Je ne pensais pas qu’en 2024 de telles façons de procéder soient encore possibles. »
Parmi les onze inculpés, deux sont laissés libres sous contrôle judiciaire, deux placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nouméa, tandis que les sept autres sont immédiatement conduits à l’aéroport de Nouméa-Magenta : Guillaume Vama, Yewa Waetheane, Dimitri Qenegei, Steeve Unë et Christian Tein – et deux femmes – Frédérique Muliava et Brenda Wanabo-Ipeze. Commence un trajet de plus de vingt heures. D’abord à bord d’un avion militaire jusqu’à l’aéroport international de La Tontouta, puis d’un avion de ligne qui les mène jusqu’en France, via les États-Unis. « On nous a laissé les menottes tout du long, témoigne Brenda. Pour manger, pour aller aux toilettes… »
Une fois sur le sol français, les militants sont séparés et envoyés dans des prisons différentes : Mulhouse, Riom, Bourges, Blois… Arrivée en pleine nuit à l’aéroport militaire de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Brenda est embarquée seule dans un fourgon. Après trois heures de route, elle atteint, le 24 juin vers 6 h 45, le terminus de ce périple forcé, la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d’Or).
Tout comme Frédérique Muliava ou Christian Tein, elle est placée à l’isolement. « Mes seuls contacts étaient avec le personnel pénitentiaire. Je n’avais pas de sous pour cantiner ou joindre ma famille. Appeler au pays, ça coûte cher ! Mes proches, je ne les ai eus au téléphone qu’à ma sortie de prison. » Seul lien avec chez elle, une télé dans sa cellule : « Je suivais tous les midis sur France 3 le journal de l’Outre-mer. J’essayais de jauger quelle était la situation au pays, si les destructions étaient toujours en cours, si c’était encore chaud avec les forces de l’ordre… »
Comme le FLNKS, Brenda dénonce une « déportation ». Un terme qui s’inscrit dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, et pas seulement lorsque celle-ci fut, de 1863 à 1931, une colonie pénitentiaire. « Les déportations, c’est quelque chose qui a beaucoup marqué la Kanaky, indique-t-elle. Étant une enfant d’Ouvéa, j’ai grandi avec la mémoire de la prise d’otages de 1988 [La prise d’otages sur l’île d’Ouvéa, du 22 avril au 5 mai 1988, se termine sur un bain de sang 21 morts, dont dix-neuf militants kanak. Les survivants sont arrêtés et transférés en « métropole », où ils resteront jusqu’à la loi d’amnistie découlant des accords de Matignon, ndlr]. Quand je suis montée dans le Transall militaire à Magenta, je me suis vue à la place de mes papas, mes oncles, mes grands-pères qui étaient dans les mêmes avions. C’est là que tu te dis que l’État, en 40 ans, n’a pas changé. »
Une fois libérée en juillet 2024, Brenda, comme Frédérique Muliava, est placée sous un contrôle judiciaire strict, avec bracelet électronique et interdiction de quitter l’Hexagone. Elle se retrouve bloquée à Montpellier, dans un petit appartement où vit son frère. « J’ai été “assignée à résidence” à 17 000 km de chez moi », résume-t-elle.
Les premières semaines sont difficiles : « J’étais déboussolée après ces semaines de solitude. Et je pensais beaucoup à Bichou [surnom donné à Christian Tein, ndlr] et aux garçons. C’est dur de penser que toi, tu es dehors et que les autres sont toujours derrière les barreaux… J’ai entendu certains dire que c’est parce nous étions mamans. Mais les garçons aussi sont papas. » Brenda est rejointe mi-août par son mari qui, comme d’autres proches, a tout quitté pour venir auprès d’elle. Mais leurs trois enfants, âgés de 3 à 12 ans au moment de l’arrestation de leur mère, sont restés « au pays ». Une « séparation très difficile », dit la mère sobrement. Le couple survit comme il peut, principalement grâce à des caisses de solidarité.
Les sept indépendantistes sont maintenus dans l’Hexagone, mais l’affaire continue pourtant à être instruite à Nouméa, dans un contexte qui leur est peu favorable. « Il y a eu une très forte instrumentalisation politique de ce dossier. Le discours du parquet montrait d’abord un souhait de répondre aux exigences d’une seule partie de la population, celle des anti-indépendantistes », dénonce Louise Chauchat. Il faudra attendre le 28 janvier 2025 et une décision de la Cour de cassation pour que le dépaysement de la procédure, demandé à plusieurs reprises par la défense, soit enfin accepté et que le dossier soit renvoyé à Paris. « Une bonne décision », pour l’avocate : « On reste prudents, mais l’instruction semble avancer dans un sens positif et juridique. Est-ce que les magistrats vont continuer à en faire une affaire politique ? Apparemment non. »
Tous les responsables indépendantistes emprisonnés en juin 2024 restent poursuivis. Et seules Brenda Wanabo-Ipeze et Frédérique Muliava, dont les contrôles judiciaires avaient déjà été allégés ce printemps, sont pour l’heure autorisées à rentrer chez elles. Mais Brenda n’a pas encore pris ses billets : « Ils nous ont emmené ensemble, on repart ensemble ! On est tous dans la même galère, on a tous les mêmes chefs d’inculpation. Et puis, c’est l’État qui nous a conduit ici, ce serait normal qu’il prenne en charge notre retour. » La militante affiche une combativité intacte : « Même si aujourd’hui je vis une situation compliquée avec mes enfants et mon mari, même si pour nous tous c’est dur, on poursuit la lutte. On a ça dans l’âme. »
mise en ligne le 16 juin 2025
Canons, munitions, chars… Pendant le génocide à Gaza, l’Europe et la France fournissent des armes à Israël
Théo Bourrieau sur www.humanite.fr
Plusieurs révélations de médias et d’associations témoignent de la coopération militaire entre l’Union Européenne et notamment de la France, et Israël. Alors qu’au moins 55 000 Palestiniens, dont 16 000 enfants, sont morts sous les armes israéliennes, l’Europe se rend complice d’un génocide.
Les exemples s’enchaînent, les preuves s’accumulent. L’Europe et la France financent, vendent et fournissent des armes à Israël, alors même que la bande de Gaza subit un génocide, que la Cisjordanie est toujours sous l’occupation et la colonisation, et que l’Iran se fait bombarder par l’armée de Benyamin Netanyahou.
Tandis que les dockers de Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, ont bloqué plusieurs tonnes d’équipement militaires à destination du port d’Haïfa, sur la côte nord israélienne, et qu’un rapport de plusieurs ONG confirme que la France livre « un flux ininterrompu » d’armes à Israël depuis octobre 2023, de nouvelles révélations témoignent des échanges militaires entre l’Europe et Israël.
L’Europe finance l’industrie militaire israélienne
Disclose, Investigate Europe et Reporters United démontrent qu’une partie des fonds d’un projet de développement de drones militaires financé par l’Europe et sept gouvernements européens, dont la France, va bénéficier à une entreprise publique d’armement israélienne. Une filiale de l’entreprise Israël Aerospace Industrie, principale firme aéronautique israélienne, va ainsi toucher 14 des 59 millions d’euros d’argent public destiné au programme Actus, consacré à l’armement et à la certification de drones.
Si cette entreprise, Intracom Defense, a pu recevoir cet argent et même être désignée coordinatrice du projet, c’est en raison de sa création et de sa domiciliation en Grèce. Sauf qu’elle a été rachetée au printemps 2023 par Israël Aerospace Industries, qui détient 94 % de son capital et 100 % du pouvoir décisionnaire. L’Europe et les sept États impliqués soutiennent et financent donc un programme militaire qui profite d’abord à l’industrie militaire israélienne. Si l’Hexagone est d’abord concerné par le cofinancement du programme, il est également bénéficiaire des fonds dans la mesure où l’entreprise française Safran a reçu une enveloppe de 10 millions d’euros pour le développement de ses drones.
La France construit de l’équipement pour des chars israéliens
Samedi 7 juin, De Morgen, quotidien belge, et The Ditch, média en ligne irlandais, révélaient également que 3 palettes de « roulements à rouleau conique » étaient en train de transiter par le port d’Anvers en Belgique à destination d’Israël. Ces pièces sont destinées à l’entreprise d’armement israélienne Ashot Ashkelon Industries, « chargée en exclusivité des systèmes de transmission sur les chars israéliens Merkava, qui appuient de façon systématique les offensives terrestres à Gaza », selon Stop Arming Israel France.
Si l’entreprise Timken à l’origine de cet équipement est américaine, l’usine de fabrication est française, située à Colmar (Haut-Rhin). Ces roulements devaient embarquer dans un cargo, à destination du port israélien d’Ashdod, mais, après le retentissement des révélations médiatiques, le départ a été retardé.
L’Europe et la France, complices du génocide à Gaza
Du développement des technologies militaires au financement des programmes de recherche, en passant par la vente et le transport d’équipements de guerre, l’Europe est impliquée dans « toutes les étapes de l’armement israélien », regrette Marc Botenga, eurodéputé Belge spécialiste de ces questions. Il est donc « tout à fait clair » que l’Europe se rend complice du génocide à Gaza, s’insurge le membre du Parti du travail de Belgique (PTB).
« Tous ces exemples rendent très concrète la coopération entre la France et Israël en matière d’armement », affirme de son côté Loïc, de Stop Arming Israel France. « Ces millions d’euros d’armement se traduisent en canons et munitions qui tirent sur les Palestiniens, en roulements de chars qui écrasent les habitants de la bande de Gaza », fustige le militant.
« En janvier 2024, la Cour internationale de Justice a affirmé que tous les États avaient le devoir de faire tout ce qui était possible pour éviter un génocide », rappelle Marc Botenga. « En juillet de la même année, un avis de la même cour déclare illégale l’occupation israélienne », et, surtout, estime que « tous les États sont dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé », continue l’eurodéputé. Au regard de la coopération militaire entre l’Europe et Israël, « il est très clair que l’Union Européenne ne respecte pas les décisions de la Cour Internationale de Justice », regrette le membre du PTB.
Un des leviers principaux pour faire cesser cette coopération militaire entre l’Europe, la France et un État génocidaire : « la pression populaire », estime Marc Botenga. « En tant que députés, nous avons le devoir de participer, d’encourager, de nourrir les mobilisations citoyennes », assure-t-il. À Fos-sur-Mer, « on a vu que l’action citoyenne, celle des travailleurs et travailleuses, peut avoir un impact plus rapide que les décisions judiciaires et politiques », appui également Loïc. « Des ingénieurs qui conçoivent les armes aux ouvriers qui les fabriquent, en passant par la douane ou par les marins, les routiers et les travailleurs de l’aviation qui les transportent, collectivement, on peut agir pour que la chaîne meurtrière s’arrête », assure le militant de Stop Arming Israel France.
mise en ligne le 15 juin 2025
Le COR a tort sur les retraites : abrogeons la réforme Borne !
Par Éric Coquerel sur www.humanite.fr
Éric Coquerel estdéputé LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Pour le gouvernement, le nouveau rapport du comité d’orientation des retraites (COR) tombe à point après la récente adoption à l’assemblée de la résolution abrogeant le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Le rapport conclut en effet à l’impossibilité d’abroger cette réforme. Il préconise même de repousser l’âge légal de départ à la retraite : « Pour équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu’en 2070 via le seul levier de l’âge de départ à la retraite, il serait nécessaire de porter cet âge à 64,3 ans en 2030, 65,9 ans en 2045 et 66,5 ans en 2070 ».
Voilà qui illustre la reprise en main du COR. On se souvient que pendant la mobilisation contre la réforme Borne, son ancien président, Pierre-Louis Bas avait fortement déplu au gouvernement en expliquant, auditionné dans ma commission des finances, que le déficit du régime des retraites était dû non à une augmentation des dépenses mais à un problème de recettes. Son nouveau président remplit donc sa mission au point même, fait inédit dans le COR, qu’il présente une conclusion unilatérale alors même que plusieurs hypothèses ont été produites.
Pourtant, s’il en tire des conclusions qui vont dans le sens du gouvernement, il part du même raisonnement que le COR « ancienne version » : les dépenses de notre système par répartition sont stables soit environ 14 % du PIB. Le COR souligne que « la quasi stabilisation des dépenses de retraite dans le PIB prévue en 2070 par rapport au niveau observé en 2024 ne corrobore donc pas l’idée d’une croissance plus soutenue des dépenses de retraite par rapport à la richesse nationale ». Cette part devrait même baisser à l’avenir pour s’établir à 13,8 % du PIB en 2030 et se situer à 12,8 % en 2070.
Les comparaisons s’arrêtent là. Le rapport du COR se refuse en effet à toute nouvelle solution de recettes.
Le rapport exclut ainsi toutes les pistes de financement émises lors du conclave que ce soit la hausse des cotisations, car pénalisant le « coût du travail » ou la modération des pensions (sous-indexation des pensions), mesure jugée « récessive » car réduisant la demande des ménages. Ce qui pour le coup me semble juste.
Par contre le COR oublie les éléments à charge contre le recul de l’âge de départ à la retraite. Un saute pourtant aux yeux : alors que la réforme de 2023 était censée équilibrer le système de retraite, il devrait finalement être déficitaire de 6,6 milliards d’euros en 2023 (contre -1,7 milliards d’euros prévu en 2024), soit 0,2 % du PIB et pourrait atteindre 1,4 % du PIB en 2070. Repousser l’âge de départ n’a donc rien d’une solution miracle.
Par ailleurs, il faut également comprendre à quoi correspond ce chiffre : la situation des régimes de retraite est hétérogène. Le déficit s’explique surtout par la situation du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers soit les effets d’une politique austéritaire qui impose un gel des effectifs dans la fonction publique, dégradant le rapport cotisants/pensionnés ainsi qu’un gel des rémunérations. Par ailleurs, certaines hypothèses interrogent, notamment sur le solde migratoire net. Pourquoi cette hypothèse très minimaliste de 70 000 personnes par an, alors qu’il était de 190 000 en 2021, de 150 000 en 2024 selon l’INSEE ?
Mais la raison principale qui contredit les effets positifs d’un allongement de l’âge du départ à la retraite sur les déficits, c’est que cela ne sert à rien de forcer les gens à travailler plus longtemps si la part de richesse qu’ils produisent n’est pas suffisante économiquement. Au lieu de travailler plus longtemps, il faudrait donc augmenter la productivité qui a reculé de 3,5 % entre 2019 et 2023 alors qu’elle progressait de + 0,5 à + 0,6 % en moyenne par an entre 2011 et 2019. C’est d’ailleurs pourquoi, les entreprises ne gardent ou n’embauchent pas du coup ce surplus de main-d’œuvre rendu disponible par le recul de l’âge de départ à la retraite. La preuve : 57 % des nouveaux retraités en 2020 étaient sans emploi dans les mois précédant leur départ à la retraite. La productivité ayant depuis baissé et l’âge de départ à la retraite ayant reculé, il y a tous les risques que ce taux augmente encore à l’avenir.
Pour régler cette question, il faut donc actionner d’autres leviers.
Tout d’abord chercher plus de recettes. Pour cela, commençons par arrêter d’assécher les recettes actuelles. Le COR pointe d’ailleurs le désengagement de l’État dans les régimes publics. Dans un récent rapport, la Cour des comptes a aussi chiffré le coût annuel pour la sécurité sociale des exonérations de cotisations non compensées à 5,5 milliards d’euros par an. Arrêtons aussi d’encourager l’auto-entrepreneuriat, bien souvent un salariat déguisé, qui ne rapporte rien à la sécurité sociale. Il en est beaucoup parmi les 716 200 créations d’entreprises sous le régime de microentrepreneur en 2024.
Cessons aussi de décrédibiliser toute nouvelle mesure de recettes. C’est possible à condition d’imposer une répartition plus juste entre les revenus du capital, grand gagnant des années Macron, et ceux du travail. Parmi ces pistes :
– une hausse de seulement 1 point sur les cotisations patronales déplafonnées permet de dégager 13,8 milliards d’euros selon la Cour des comptes ;
– soumettre à cotisation des revenus issus des primes, de l’intéressement et de la participation ramène 2,2 milliards d’euros auquel on peut rajouter 10 milliards si on fait de même vis-à-vis des dividendes et rachats d’action ;
– aligner la fiscalité des produits d’épargne retraite sur celle des salaires rapporte 6,4 milliards d’euros.
Enfin une politique en faveur de l’augmentation des salaires, à commencer par le SMIC et l’égalité salariale homme/femme imposée par la loi, engagerait un cercle vertueux et des rentrées de cotisation massives.
Et puisqu’on agite sans cesse la nécessité de réformes structurelles, alors banco. Lâchons cette politique de l’offre et de la compétitivité productrice d’inégalités et d’impasse économique : relançons l’activité par le redéploiement des services publics afin de répondre aux besoins de la population, par la bifurcation écologique soutenue par des investissements publics enfin à la hauteur et la promotion d’une souveraineté industrielle et agricole appuyée sur un protectionnisme solidaire. De quoi entraîner une création d’emplois stables à même de garantir une vie digne à toutes celles et ceux en âge de travailler tout en permettant aux aînés de profiter de leur retraite sans épuiser leur capital santé.
Ce programme c’était à peu de chose près celui, victorieux, du NFP lors des législatives de juillet 2025. Il commençait par l’abrogation de la réforme de retraites. La PPR du groupe GDR vient de montrer que cette réforme n’a toujours pas de majorité parlementaire et populaire. C’est pourquoi à l’issue du conclave, s’il se confirme que la réforme des retraites n’est pas abrogée, et quoi qu’en dise le rapport du COR, il appartiendra aux partisans de son abrogation de censurer le gouvernement Bayrou.
mise en ligne le 15 juin 2025
« Le miroir américain » de Cole Stangler : « Entre la France et les États-Unis, les dynamiques politiques se ressemblent »
Christophe Deroubaix sur www.humanite.fr
Dans son ouvrage-enquête sur la radicalisation des droites et l’avenir de la gauche, le journaliste franco-états-unien Cole Stangler explore les similitudes entre les deux pays, du vote des classes populaires au rôle du syndicalisme, en passant par l’influence des chaînes de télévision ultradroitières.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a produit deux effets dans le discours public : l’éloignement des États-Unis de la France et de l’Europe, d’une part, et la crainte que la situation outre-Atlantique soit annonciatrice de l’avenir de notre pays, d’autre part. À la croisée de ces deux pistes, mais hors des sentiers battus, un journaliste – franco-américain comme il se doit – a mené l’enquête dans les deux pays.
Vous tendez un « miroir américain » – titre de votre livre – à la France. En quoi ces deux pays sont-ils plus proches qu’il n’y paraît ?
Cole Stangler : Les similitudes remontent à la période de la Révolution française et à la guerre d’indépendance américaine. Ces deux révoltes ont donné naissance à des Républiques inspirées par la philosophie des Lumières. La France et les États-Unis sont également, de longue date, des pays d’immigration, avec des identités nationales modelées par l’arrivée de gens venus d’ailleurs. La grandeur de nos mythes fondateurs nous empêche également parfois de voir les moments sombres de nos histoires respectives de façon limpide.
Enfin, bien qu’ils soient dotés de systèmes politiques très différents, la France comme les États-Unis partagent un point commun très important : à un moment donné, les électeurs sont obligés de choisir entre deux candidats afin d’élire un président détenant des pouvoirs considérables. Dans un climat marqué par un fort sentiment de rejet, voire de dégoût de la politique, cela peut produire des surprises. Un politicien relativement impopulaire peut se retrouver à la Maison-Blanche ou à l’Élysée.
Plus précisément, je pense que les dynamiques politiques se ressemblent dans nos deux pays. Les classes populaires en dehors des grandes métropoles basculent à l’extrême droite. Les électeurs et les élus de la droite « traditionnelle » se radicalisent, en déployant des mots et des expressions longtemps confiés aux marges. Des médias financés par des milliardaires conservateurs transforment le débat. Face à tout cela, la gauche a du mal à proposer une alternative crédible. La France n’est pas les États-Unis et je n’ai aucune intention de prédire l’avenir. En revanche, j’estime que mieux comprendre les bouleversements politiques qui transforment les États-Unis peut nous aider à éclaircir certaines choses en France.
Vous parlez du décrochage des classes populaires du Parti démocrate aux États-Unis et de la gauche en France et de leur penchant pour le vote d’extrême droite. Pourtant, les comportements électoraux diffèrent parmi les mêmes groupes sociaux en fonction des « origines ». Un ouvrier blanc aura plus tendance à voter républicain et un ouvrier noir démocrate. Votre présentation n’est-elle pas trop uniforme ?
Cole Stangler : Évidemment, les classes populaires blanches (ce que les Américains appellent la « white working class ») votent beaucoup plus à droite que les classes populaires racisées. Ces dernières votent majoritairement démocrate. Soyons clairs : le racisme joue un rôle structurant dans la société américaine et Donald Trump en tire des bénéfices depuis le début de sa carrière politique. Il s’appuie aussi sur d’autres formes de discrimination, notamment le sexisme et la xénophobie. Pour certains de ses électeurs, et notamment les hommes blancs, c’est justement la parole désinhibée du candidat qui plaît.
Toujours est-il que les républicains séduisent de plus en plus les classes populaires dans leur ensemble, y compris les minorités. Selon les sondages à la sortie des urnes en 2024, presque la moitié des électeurs latinos ont voté Trump, dont une majorité d’hommes latinos. Si on ne parle que de la « white working class », on risque d’avoir une vision incomplète de la transformation politique en cours.
De manière plus générale, je pense qu’il faut essayer de comprendre pourquoi des catégories de la population qui votaient historiquement à gauche ne le font plus. C’est la raison pour laquelle je consacre autant d’attention à la « Rust Belt », cette vaste zone des États-Unis frappée par la désindustrialisation, où il y a peu de perspectives économiques et où de nombreux résidents gardent le souvenir d’un passé plus prospère. Dans des territoires de ce type, les électeurs sont davantage susceptibles d’adhérer à des discours désignant des boucs émissaires. Pour le Parti républicain comme pour le Rassemblement national, la source du malheur, c’est l’immigré, et plus précisément l’immigré sans papiers. Malheureusement, ces discours fonctionnent très bien.
Vous consacrez un chapitre à Fox News et CNews, où le miroir renvoie deux images identiques, la chaîne française semblant avoir copié la chaîne créée dans les années 1990 par Rupert Murdoch. En quoi ces deux chaînes sont-elles devenues des instruments politiques au service de l’extrême droite ? On pourrait penser qu’elles ne convainquent que ceux qui les regardent et qui sont déjà des convaincus.
Cole Stangler : Ces deux chaînes ont été conçues par leurs fondateurs comme des outils de combat politique. Elles cultivent des liens étroits avec des partis de droite et d’extrême droite et elles donnent la priorité à leurs sujets de prédilection : l’immigration, l’insécurité, l’identité nationale, la place de la religion dans la société, le « wokisme »…
Souvent, l’analyse s’arrête là. Mais, à mon avis, il faut aussi prendre en compte le style populiste de ces deux chaînes. Comme l’a montré le chercheur Reece Peck dans « Fox Populism : Branding Conservatism as Working Class », les chroniqueurs de Fox News se positionnent régulièrement du côté de leurs téléspectateurs (« nous » les « Américains ordinaires »), tout en critiquant des médias plus prestigieux comme le « New York Times » ou CNN, qu’ils assimilent aux « élites ». CNews joue le même jeu. Des chroniqueurs comme Pascal Praud parlent au nom des « Français » et ne cessent de critiquer le travail d’autres médias, avec une véritable obsession pour l’audiovisuel public. Il faut aussi reconnaître que les deux chaînes savent comment amuser la galerie. Fox News et CNews consacrent énormément d’attention aux faits divers.
Pourquoi s’intéresser à ces deux chaînes ? Tout d’abord, le fait qu’elles soient les chaînes d’information les plus regardées aux États-Unis et en France mérite notre attention. Deuxièmement, elles exercent énormément d’influence auprès des élus. Depuis le début des années 2000, Fox News signale aux politiciens républicains les sujets qui méritent leur attention, ainsi que les positions à prendre sur les combats du jour.
Imaginons que vous êtes sénateur et vous ne savez pas comment vous positionner sur un vote budgétaire : il y a de fortes chances que vous alliez regarder l’émission de Sean Hannity avant de prendre votre décision, en sachant très bien que le contrarier comporte des dangers. Si vous ne respectez pas ses consignes, vous risquez d’être traité comme un « Rino » (un « republican in name only », soit un républicain d’apparence) et de subir une primaire contre un concurrent plus radical. Selon une série d’études, Fox News a ainsi contribué à la droitisation des élus républicains.
À ce stade, il n’y a pas d’études équivalentes sur CNews. J’ai pourtant l’impression d’assister à une dynamique similaire quand on voit à quel point la chaîne pèse sur le débat politique en France. Cette influence va bien au-delà des bancs de l’extrême droite. Je pense à ce qu’un ancien député Renaissance m’a dit, en parlant de son propre groupe parlementaire : « Nous sommes complètement à la botte de CNews. »
Que pensez-vous de l’idée qu’en France et outre-Atlantique, il existe deux gauches, l’une radicale et l’autre d’accompagnement ? Aux États-Unis, elles se retrouveraient dans le même parti par la force du système politique et, en France, elles auraient chacune son parti ou ses partis.
Cole Stangler : En effet, le Parti démocrate rassemble des tendances politiques très différentes. Alexandria Ocasio-Cortez l’a dit elle-même dans une interview en 2020 : si elle avait été élue en Europe, elle ne siégerait pas dans le même parti que Joe Biden. Aujourd’hui, le Parti démocrate est dominé par un centre-gauche qui peut tolérer un peu de redistribution, mais pas trop. Un centre-gauche qui dénonce le racisme et d’autres formes de discrimination, mais qui n’a pas très envie de s’attaquer aux racines des maux non plus. Ensuite, il y a une gauche plus à gauche, incarnée par des gens comme « AOC » ou Bernie Sanders.
Comme en France, cette gauche-là doit élargir son électorat si elle veut un jour arriver au pouvoir. Mais elle se confronte à un défi supplémentaire aux États-Unis : l’absence de plafond pour les dons et les dépenses de campagne. Si une candidate a réellement envie de s’attaquer aux inégalités, elle va souvent se retrouver face à un adversaire ayant une meilleure assise financière.
Votre dernier chapitre s’intitule « Retour aux sources ». On y croise une jeune femme qui a contribué à la création d’un syndicat à Starbucks et un docker de Port-de-Bouc, près de Marseille. En quoi le syndicalisme, largement affaibli dans les deux pays par la désindustrialisation, peut-il avoir un avenir et en représenter un pour une alternative progressiste ?
Cole Stangler : Dans un contexte où une partie des classes populaires basculent à l’extrême droite, il est plus indispensable que jamais. En plus de défendre les intérêts les plus immédiats des salariés, les syndicats parviennent à transmettre un certain nombre de valeurs à leurs adhérents : l’utilité de l’action collective, le respect de la différence, la redistribution des richesses… en somme, une vision du monde à l’opposé de celle défendue par les trumpistes. Un élu de gauche peut très bien alerter sur les dangers de l’extrême droite, mais ce message est plus crédible lorsqu’il est porté par quelqu’un qui vous ressemble et vous défend au quotidien.
Nous pouvons passer des heures à débattre de la politique politicienne. Sur quels sujets faudrait-il faire campagne ? Dans quels États ou dans quelles régions ? Ces choix ne sont pas sans importance, mais ils masquent une déconnexion plus profonde entre la gauche et une partie de sa base historique qui ne va pas se régler dans un cycle électoral, que ce soit en France ou aux États-Unis. Retisser ces liens va prendre du temps. Il est dur d’imaginer que le travail se réalisera de manière durable sans un renouveau du syndicalisme.
Le Miroir américain. Enquête sur la radicalisation des droites et l’avenir de la gauche, de Cole Stangler, Éditions les Arènes, 192 pages, 20 euros.
mise en ligne le 14 juin 2025
Les vraies raisons
pour lesquelles Israël déclenche
une guerre contre l’Iran
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
En envoyant son aviation bombarder les sites nucléaires iraniens, Benyamin Netanyahou empêche tout nouvel accord entre Téhéran et Washington et oblige Emmanuel Macron à reporter la conférence prévue à l’Onu sur la Palestine. À New-York, le chef de l’État devait annoncer la reconnaissance de l’État de Palestine par la France. Analyse
Donald Trump et Benyamin Netanyahou ressemblent à ces bonimenteurs de foire, qui grugent tout le monde en laissant penser qu’ils ne sont pas d’accord. Deux bateleurs qui se sont distribués les rôles pour parvenir à leurs fins. Le problème est que dans cette partie de poker menteur, la paix au Moyen-Orient et, plus largement dans le monde, est en jeu.
Depuis dix ans maintenant, les gouvernements israéliens successifs ont fait de l’Iran leur bête noire, la mère de tous les maux. Mais qu’est-ce qui explique qu’aujourd’hui une guerre – le mot n’est pas trop fort – ait été déclenchée ? Des actions au sol s’étaient déjà déroulées dans le passé. Il s’agissait notamment du vol de documents confidentiel Défense mais également de l’assassinat d’un scientifique impliqué dans le dossier nucléaire, par le Mossad. De même, à l’automne dernier, des échanges de tirs de missiles et d’envois de drones avaient bien eu lieu entre les deux pays, séparés de près de 2000 km mais jamais Israël n’avait envoyé ainsi ses avions de chasse frapper plus de 200 cibles contrairement à ce qu’il avait entrepris contre des installations nucléaires irakiennes en 1981 et une autre dans le nord de la Syrie, en 2007.
Jeu de dupes entre Trump et Netanyahou
Cette attaque – toujours en cours – ne doit rien au hasard et s’inscrit dans un plan beaucoup plus élaboré qui vise à transformer l’ensemble de la région en un sanctuaire inscrit dans le cadre des intérêts états-uniens avec, comme gardien Israël. La guerre génocidaire menée à Gaza, après les attaques monstrueuses du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, a ouvert la voie à une annihilation des organisations (Hezbollah au Liban, Hamas en Palestine) et des États (Liban, Syrie) qui s’opposaient peu ou prou à cette mainmise régionale. Restait l’Iran, quoi qu’on puisse penser du régime en place.
C’est là que commence le jeu de dupes de Trump et Netanyahou. Le premier – qui, en 2018 avait retiré la signature des États-Unis de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (dont l’acronyme anglais est JCPoA). À l’époque, lors de son premier mandat, le milliardaire états-unien parlait du « pire accord jamais négocié », qui pourrait déclencher un « holocauste nucléaire ». Il accompagnait son retrait du rétablissement de sanctions contre l’Iran. Pourtant, onze rapports de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) attestaient du respect par l’Iran de ses engagements.
À la surprise générale, cette même administration Trump, de retour aux affaires, a repris le dialogue avec Téhéran. Au début du mois de juin 2025, un possible accord encadrant le programme nucléaire iranien, garantissant que la République islamique ne pourrait se doter de l’arme atomique était évoqué. Quelques jours auparavant, interrogé pour savoir s’il avait dit à Netanyahou de ne pas cibler l’Iran, Trump répondait : « Eh bien, je voudrais être honnête. Oui, je l’ai fait… J’ai dit (à Netanyahou) que ce serait très inapproprié de le faire maintenant, car nous sommes très proches d’une solution. »
Le président des États-Unis ajoutait : « Cela pourrait changer à tout moment. Cela pourrait changer d’un simple coup de fil. Mais pour l’instant, je pense que [l’Iran] souhaite conclure un accord, et si nous y parvenons, cela sauverait beaucoup de vies. » Le 28 mai, le New York Times pensait qu’« au cœur de la tension entre M. Netanyahou et M. Trump se trouvent leurs points de vue divergents sur la meilleure façon d’exploiter un moment de faiblesse iranienne. »
Il s’agissait en réalité d’une entente. Les discussions se sont en effet poursuivies entre les États-Unis et l’Iran, non sans difficultés, et les Iraniens devaient se prononcer sur les dernières propositions états-uniennes avec, comme date butoir le 13 juin. Deux jours auparavant, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait qualifié la proposition américaine de « 100 % contraire » aux intérêts de son pays. Plus que de l’enrichissement il était visiblement question de levée des sanctions.
Netanyahou isolé sur la scène internationale
C’est là qu’entre en scène Netanyahou. S’il n’a pas le feu vert de Washington, il n’a pas non plus reçu une interdiction formelle d’attaquer. Comme dit l’adage, « qui ne dit mot, consent ». Le premier ministre israélien y voit plusieurs avantages alors que depuis plusieurs mois maintenant, notamment depuis sa rupture unilatérale du cessez-le-feu à Gaza, il est isolé sur la scène internationale, son seul soutien réel provenant des États-Unis. N’est-ce pas pour cela que l’aviation israélienne est entrée en action à ce moment précis ?
La question des sanctions a commencé à émerger (deux ministres d’extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, sont directement touchés), celle de la révision de l’accord d’association avec l’Union européenne également. Dans le monde et y compris en Israël même, les manifestations contre la guerre ont pris un nouvel élan, renforcé par les images terribles des Gazaouis tués chaque jour par les bombes et condamnés à la famine.
Et puis, surtout, Benyamin Netanyahou sentait bien qu’une chose impensable jusque-là était en train de se produire. La conférence de l’Onu sur la solution à deux États, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite, allait aboutir à la reconnaissance officielle par Paris de l’État de Palestine et Riyad, malgré les pressions, refusait de normaliser ses relations avec Tel Aviv, campant sur l’idée de 2002 d’une reconnaissance d’Israël par les pays arabes en échange de l’acceptation de l’établissement du nouvel État.
Ces derniers jours, plusieurs diplomates européens avaient signalé à l’Humanité que « tout était possible et qu’il fallait s’attendre à des coups tordus de la part d’Israël » pour empêcher un tel événement. Après Paris près d’une dizaine de pays membre de l’UE suivaient certainement. Or, pour le gouvernement israélien, il n’est pas question d’accepter un État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale. Il fallait donc saborder l’initiative de l’Assemblée générale des Nations unies et la conférence qui devait s’ouvrir le 17 juin prochain. Avec les attaques massives sur l’Iran Netanyahou semble bien être parvenu à ses fins.
Donald Trump maintenant met en demeure l’Iran. Celui-ci « doit conclure un accord avant qu’il ne reste plus rien ». Et le dirigeant états-unien a ajouté : « Je leur ai dit que cela serait bien pire que tout ce qu’ils avaient connu, anticipé ou ce qu’on leur avait dit, que les États-Unis fabriquent les meilleurs équipements militaires et les plus destructeurs que personne d’autre au monde, DE LOIN, et qu’Israël en a beaucoup, et que beaucoup d’autres vont encore arriver — et qu’ils savent comment les utiliser ».
L’Iran « responsable de la déstabilisation » régionale ?
Vendredi après-midi, Emmanuel Macron a annoncé que la conférence à l’ONU qui devait s’ouvrir la semaine prochaine à New York sur la solution à deux États était reportée « pour des raisons logistiques et sécuritaires » mais qu’elle sera organisée « au plus vite », ajoutant : « ce report ne saurait remettre en cause notre détermination à avancer vers la mise en œuvre de la solution des deux États. J’ai dit ma détermination à reconnaître l’État de Palestine, elle est entière et c’est une décision souveraine. » Mais, une fois de plus, et alors qu’on s’attendait à ce qu’il le fasse le 18 juin, cette décision est reportée.
Pour le président de la république, l’Iran porte « une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région ». Mais les discussions en cours entre Téhéran et Washington, aussi difficiles soient-elles, ont été interrompues par Israël. De la même manière, si l’on peut souscrire à l’idée d’un Iran empêché d’avoir l’arme nucléaire, comme l’a répété le chef de l’État, cette préoccupation devrait concerner l’ensemble de la région (voir le monde entier débarrassé des armes nucléaires), ce qui doit inclure Israël, puissance nucléaire non déclarée, non-signataire du traité de non-prolifération et qui, à ce titre, n’accueille jamais aucun inspecteur de l’AIEA sur son sol.
Pendant ce temps, la guerre se poursuit à Gaza et la possibilité d’un nouveau cessez-le-feu semble s’éloigner toujours plus.
Arrêter le nucléaire iranien
avec des bombes :
le pari dangereux de Nétanyahou
Justine Brabant sur www.mediapart.fr
Les frappes israéliennes du 13 juin ont peu de chances de mettre fin au programme nucléaire iranien. Elles risquent en revanche de pousser Téhéran à quitter les cadres de discussions existants et à redoubler d’efforts pour se doter de l’arme atomique sur le long terme.
L’armée israélienne a décrit ses attaques du 13 juin au matin comme une « frappe préventive » visant à empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire en frappant « le cœur » de son programme d’enrichissement d’uranium. L’Iran aurait atteint un point de non-retour justifiant le recours à la force et l’abandon de la voie diplomatique, ont en somme expliqué les autorités israéliennes.
Une partie des États européens ont semblé conforter Tel-Aviv dans cette décision, à l’image d’Emmanuel Macron qui a réaffirmé, quelques heures après le lancement des attaques, « le droit d’Israël à assurer sa sécurité ». Il y a pourtant de nombreuses raisons de penser que ces frappes ne vont pas mettre un terme au programme nucléaire iranien. Et risquent au contraire de le rendre plus difficile à contrôler.
La première raison est matérielle : donner un coup militaire décisif au nucléaire iranien est considéré comme quasi impossible en pratique, étant donné son état d’avancement et la manière dont il est conçu – avec des lieux sensibles enterrés et dispersés à travers le pays.
Les usines d’enrichissement d’uranium de Natanz et de Fordo, considérées comme deux des sites les plus sensibles du programme iranien, se trouvent sous terre. Une autre installation souterraine est en cours de construction à l’intérieur d’une montagne (le Kolang Gaz La) au sud de l’usine de Natanz ; elle devrait servir de lieu de production de centrifugeuses. Le site de Natanz compte aussi des installations non souterraines, dont une usine pilote d’enrichissement entrée en service en 2003.Cent mètres sous terre
La profondeur à laquelle sont enterrées ces usines est tenue secrète, mais les estimations de chercheurs spécialisés vont de huit mètres (pour l’usine de Natanz) à une petite centaine de mètres sous terre (pour l’usine de Fordo et la nouvelle installation sous le Kolang Gaz La). Elles sont probablement recouvertes de plusieurs couches de béton armé, de terre compactée et/ou de roche.
Les atteindre suppose d’utiliser des bombes très spécifiques. Or Israël ne possède officiellement aucun missile capable de percer plus de six mètres de béton en une frappe. Détruire l’usine d’enrichissement d’uranium de Fordo supposerait d’utiliser des bombes que seuls les États-Unis possèdent (les GBU-57/B, des « bombes anti-bunker » de plus de 10 000 kilos) et nécessiterait de parvenir à frapper à plusieurs reprises au même endroit.
C’est ce qu’ont calculé deux chercheurs du think tank britannique Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), dans une note publiée en mars 2025, qui dressait plusieurs scénarios d’attaques israéliennes sur le nucléaire iranien.
Le site de Natanz a été touché en surface mais guère au niveau de ses installations souterraines.
La protection dont bénéficient ces installations, le degré d’avancement de Téhéran, et le fait que le savoir scientifique nécessaire est désormais largement maîtrisé par les Iraniens conduisent la plupart des spécialistes en prolifération nucléaire, dont les chercheurs du RUSI, à penser que la force militaire seule ne saurait mettre un terme au programme iranien.
Les frappes israéliennes, si massives qu’elles aient été, ne semblent pour l’instant pas les démentir. Les premières images satellite prises après les attaques israéliennes intervenues tôt dans la matinée du 13 juin montrent que le site de Natanz a été touché en surface au niveau de son usine pilote et d’une installation électrique – mais guère au niveau de ses installations souterraines.
Le site de Fordo, considéré par les experts comme l’endroit le plus stratégique du programme nucléaire iranien, a lui été visé dans une seconde salve de frappes, le 13 juin en fin de journée. L’étendue des éventuels dégâts est encore inconnue.
Les partisans du recours aux armes face à Téhéran convoquent deux exemples historiques afin d’illustrer l’efficacité supposée de bombardements : les attaques israéliennes contre le réacteur irakien Osirak (en 1981) et contre l’installation syrienne d’Al-Kibar (en 2007). Elles sont réputées avoir mis un coup d’arrêt aux ambitions nucléaires militaires des deux États.
Mais les circonstances ne sont pas comparables, argumentent les chercheurs du RUSI Darya Dolzikova et Justin Bronk. Ils relèvent que « dans les deux cas, les programmes des pays attaqués étaient très concentrés [géographiquement] et n’en étaient qu’à leurs balbutiements, leur développement dépendant largement de l’aide étrangère ». Au contraire de l’Iran de 2025 qui, « après une frappe militaire sur ses sites nucléaires [...], aura non seulement l’expertise locale nécessaire pour reconstruire en rebâtissant des installations plus profondes et plus résistantes, mais y sera davantage incité ».
Détermination décuplée
Des officiels israéliens l’admettent eux-mêmes. Le conseiller à la sécurité nationale israélien Tzachi Hanegbi a ainsi reconnu qu’il était « impossible de détruire le programme nucléaire par la seule force ». L’objectif est en réalité « de faire comprendre aux Iraniens qu’ils devront arrêter le programme nucléaire », avance-t-il.
C’est un pari particulièrement risqué. Sans même parler des risques de précipiter toute la région dans le chaos, le passé a démontré que les attaques sur leur programme nucléaire semblaient surtout démultiplier la détermination des autorités iraniennes à se doter de l’arme atomique. En avril 2021, l’Iran avait répondu à une tentative de sabotage de son usine souterraine de Natanz, en annonçant son intention d’enrichir son uranium à 60 % (contre 20 % jusqu’alors – le seuil permettant l’utilisation à des fins militaires est de 90 %).
Les progrès de l’Iran en matière nucléaire ont largement été « une réponse aux menaces perçues pour sa survie », observe la politiste Doreen Horschig, en poste à l’université de Floride centrale (États-Unis). Elle rappelle l’influence de la crise de Suez de 1956, et des tensions régionales qui en ont découlé, dans la décision de Téhéran de développer son programme nucléaire.
Une attaque israélienne de grande envergure contre les installations nucléaires iraniennes « renforcerait probablement la perception de la menace par Téhéran », « accélérerait sa quête d’un arsenal nucléaire », et pousserait certainement le programme nucléaire iranien « plus loin dans la clandestinité », prédisait Doreen Horschig en 2024, dans un article sobrement intitulé « Pourquoi frapper les installations nucléaires iraniennes est une mauvaise idée ».
Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives des attaques israéliennes, toujours en cours et dont Benyamin Nétanyahou assure qu’elles pourraient durer deux semaines. Mais on sait déjà trois choses.
Premièrement, elles risquent d’anéantir les actuels pourparlers sur le nucléaire entre l’Iran et les États-Unis.
Deuxièmement, elles vont singulièrement compliquer – voire rendre impossible pour un temps – les contrôles de l’AIEA (l’Agence internationale de l’énergie atomique), pour des raisons de sécurité des inspecteurs, mais également parce que Téhéran pourrait déplacer ses stocks d’uranium enrichi et refuser de communiquer leurs nouvelles localisations afin de les protéger de nouvelles frappes israéliennes.
Troisièmement, elles pourraient conduire l’Iran à se retirer du traité de non prolifération (TNP), considéré comme un pilier essentiel de la sécurité mondiale et auquel Israël a d’ailleurs toujours refusé d’adhérer. En tentant de mettre fin définitivement à la menace nucléaire iranienne, qu’il juge « existentielle », le gouvernement israélien pourrait avoir contribué à la rendre hors de contrôle.
mise en ligne le 14 juin 2025
Guerre à Gaza :
l’ONU vote pour
un cessez-le-feu immédiat
sur https://lareleveetlapeste.fr/
A une majorité écrasante, les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont voté en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. Alors qu’un convoi de solidarité venant du monde entier exige la fin du génocide, le texte demande le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza et un accès sans entrave de l’aide humanitaire.
149 ont voté pour, 19 se sont abstenus, tandis que les Etats-Unis, Israël et dix autres pays ont voté contre. Ce jeudi, l’Assemblée générale des Nations unies exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza. Le texte demande également la libération des otages détenus par le Hamas et le retour des prisonniers palestiniens détenus par Israël.
La résolution a été adoptée sous une salve d’applaudissements. Elle « condamne fermement le recours à la famine comme méthode de guerre, le refus illégal d’accès à l’aide humanitaire et le fait de priver les civils des produits indispensables à leur survie, notamment en entravant délibérément l’acheminement des secours et l’accès à l’aide ».
Depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 400 travailleurs humanitaires et 1300 professionnels de santé ont été tués.
Récemment, le ministre de la défense Katz a publiquement déclaré « Habitants de Gaza, ceci est un dernier avertissement (…). Rendez les otages et jetez dehors le Hamas. Sinon, ce sera la destruction et la dévastation totale ». La résolution de l’ONU fait écho aux mobilisations de soutien qui essaiment dans le monde entier pour sauver les gazaouis du génocide programmé par l’Etat israélien.
Le convoi “Al Soumoud” – “Résilience”, en arabe – est parti le 9 juin 2025 de Tunis pour rejoindre la bande de Gaza par voie terrestre en traversant la Libye et l’Égypte. Il est composé d’environ 300 véhicules et d’un millier de participants. Malgré des dizaines d’interpellations de militants de diverses nationalités venus en Égypte pour protester, « la marche internationale continue (…) des milliers de participants sont déjà arrivés en Égypte, prêts à pour partir à El-Arich demain et continuer à pied vers Rafah » ont indiqué les organisateurs.
Après leur libération par Israël, l’eurodéputée Rima Hassan et l’écureuil Reva Viard, qui se trouvaient à bord du voilier humanitaire « Madleen », ont ainsi été accueillis par des milliers de sympathisants hier. Trois membres de l’équipage sont encore détenus en Israël et devraient bientôt être libérés à leur tour.
« J’ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir » et « il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus », a déclaré l’élue.
Leur opération politique et humanitaire, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a contribué à renforcer la mobilisation internationale pour la cause palestinienne. Une mise en lumière salvatrice alors que les journalistes n’ont pas le droit d’entrer dans la bande de Gaza.
La presse palestinienne a ainsi salué l’expédition du Madleen – baptisé du prénom de Madleen Kullab, la seule femme vivant du métier de la pêche à Gaza. D’après la psychologue Samah Jabr, « Après vingt mois d’un siège étouffant et génocidaire, le ‘Madleen’ est apparu comme un acte de résistance morale, un cri retentissant face à la cruauté mondiale ».
A Gaza, l’Etat israélien a été reconnu responsable de financer le gang criminel de Yasser Abou Chabab, un trafiquant de drogue palestinien notoire, contre leur ennemi commun du Hamas. Ses milices opèrent à l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Reste maintenant à voir ce que va advenir de ce vote des Nations Unies. Si elles ne sont pas contraignantes, les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU ont normalement un poids politique important dans les conflits.
La caravane « Assoumoud » :
quand la rue maghrébine trace la route vers la conscience palestinienne
Khaled Chebli sur www.humanite.fr
Khaled Chebli est chercheur universitaire en droit constitutionnel et affaires parlementaires, membre du Laboratoire de recherche en droit, urbanisme et environnement Faculté de droit, université Badji-Mokhtar, Annaba.
Ce soulèvement populaire transcende les frontières, brise le silence des régimes et rallume la flamme de la cause palestinienne dans l’imaginaire collectif.
Alors que les discours officiels s’enlisent dans l’ambiguïté ou le silence, une dynamique inédite s’élève du cœur du Maghreb : la caravane « Assoumoud ». Ni folklorique ni diplomatique, ce convoi d’hommes et de femmes libres, traversant les frontières avec des vivres, des médicaments – et surtout une volonté farouche – redonne à la solidarité arabe sa voix la plus authentique. Direction Gaza, mais au fond, c’est vers notre propre conscience collective qu’elle trace sa route.
À l’heure où les défaites assiègent l’imaginaire collectif, où la conscience arabe suffoque sous un double blocus — celui de la géographie et celui de la volonté — une initiative surgit du tréfonds des peuples pour redéfinir la dignité, raviver la mémoire, et donner aux grandes causes une voix neuve. Une voix qui ne s’épuise ni dans les communiqués de dénonciation calibrés, ni dans le silence bureaucratique des États. Cette voix, c’est celle de la Caravane de la Résilience — un geste souverain, populaire, qui traverse le Maghreb pour atteindre symboliquement le cœur battant de la Palestine. Elle ne franchit pas seulement des frontières terrestres, mais transgresse l’indifférence, le déni et la trahison feutrée de la normalisation.
Plus de 2 000 volontaires et militants, des dizaines de véhicules, cinq pays maghrébins, des médicaments, des denrées alimentaires… et surtout : des convictions. Rien de tout cela n’a été initié par des États,mais bien par la volonté des libres. La caravane s’est mise en marche en dépit des obstacles logistiques, des attentes interminables aux frontières, du manque de moyens, et du silence gêné des officiels. Partie d’Algérie et de Tunisie, elle a pu rejoindre la Libye grâce à une décision courageuse du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, au moment où d’autres gouvernements hésitaient — voire entravaient le passage.
Ce convoi n’est pas un simple cortège humanitaire. Il est un message en mouvement, un poème de solidarité écrit avec la sueur des bénévoles, les larmes des mères de martyrs, et les cris des peuples du Grand Maghreb. Un message clair, limpide, direct : Gaza, tu n’es pas seule.
La Caravane de la Résilience ne quémande aucune approbation, ne cherche ni accueil officiel ni couverture médiatique convenue. Elle avance portée par l’esprit de celles et ceux qui croient que la solidarité n’est pas une posture saisonnière, et que la cause palestinienne n’est ni un élan charitable, ni une diplomatie d’apparat, mais un engagement historique, moral et civilisationnel. Ce n’est ni folklore ni performance : c’est un acte de résistance contre l’amnésie politique, une tentative de préservation de la mémoire, une sauvegarde du sens profond d’être arabe à l’ère du renoncement généralisé.
Elle interpelle les régimes de front : pourquoi les peuples bougent-ils quand les États se taisent ? Pourquoi les bénévoles prennent-ils l’initiative quand les gouvernements se replient ou pactisent avec l’oppresseur ?
La caravane met à nu les contradictions du paysage arabe officiel : des régimes qui refusent le passage au nom d’une souveraineté nationale galvaudée, ou bloquent les frontières sous prétexte de « sécurité », alorsmême que la véritable sécurité est piétinée chaque fois qu’un enfant est tué à Gaza, qu’une école est pulvérisée, qu’un rêve est enseveli sous les décombres.
Mais la caravane adresse aussi un message à ceux qui ont normalisé, à ceux qui ont gardé le silence, à ceux qui se retranchent derrière une neutralité hypocrite face à un génocide. Elle leur dit : il existe encore une nation debout, des peuples insoumis, des âmes indomptées.
Certains cherchent à réduire la portée de cette caravane à un symbole vide ou un geste marginal. Pourtant, c’est justement dans sa symbolique que réside sa puissance. Parce qu’elle vient du peuple, de la rue, de la conscience vive. Chaque véhicule est un manifeste roulant, chaque boîte de médicaments un acte d’accusation contre les marchands de causes, chaque kilomètre parcouru vers la frontière un défi lancé au fatalisme et à la lâcheté.
Du poste frontalier de Ras Jedir à Zaouia, Misrata, Syrte, Benghazi, Tobrouk, jusqu’au point crucial de Salloum, la caravane avance. Elle attendra, comme ont attendu les fidèles dans l’histoire. Elle affrontera des entraves ici, des pressions là-bas. Mais elle n’abandonnera pas. Car Gaza attend. Car le moment n’est pas aux discours, mais à l’action.
Quant à la position égyptienne, elle sera scrutée par l’Histoire : choisira-t-elle d’écouter la voix des peuples ou de persister dans la logique du siège aux côtés du régime sioniste ? Quelle que soit la réponse, la caravane a déjà remporté sa victoire morale : celle de forcer chacun à se regarder dans le miroir, de replacer les peuples au centre du mouvement, et non à la périphérie de la passivité.
Le régime israélien craint ces initiatives. Non pas parce qu’elles le menacent militairement, mais parce qu’elles le minent symboliquement. Elles rappellent qu’il existe encore un souffle arabe, une dignité rebelle. Elles rappellent que si le siège dure, la volonté humaine, elle, peut durer davantage.
La Caravane de la Résilience n’est pas un aboutissement, mais un commencement. Une étincelle dans la nuit du renoncement. Une démonstration concrète de ce que peuvent accomplir les peuples lorsqu’ils décident de se lever. Elle est un pont entre un Maghreb debout et un Orient meurtri. Une jonction entre les luttes anticoloniales du XXIᵉ siècle et ceux qui continuent de croire que la Palestine n’est pas l’affaire d’un autre, mais notre boussole morale et existentielle.
Dans cette caravane, le Mauritanien côtoie le Tunisien, l’Algérien marche avec le Libyen, le Maghrébin embrasse le Palestinien. Non sous l’égide d’une Ligue arabe atone, mais sous la bannière d’une nation résistante, sous un soleil qui ne se couche pas sur la dignité, à l’ombre d’un olivier qui brûle sans céder — car ses racines sont trop profondes pour être arrachées.
Conclusion : N’ayez pas peur d’être traités d’irréfléchis : l’Histoire n’a jamais retenu les prudents. N’attendez pas des visas d’humiliation : la dignité ne s’accorde pas, elle se conquiert. Et si les points de passage sont fermés, souvenez-vous : il existe toujours une route qu’ouvrent les pas de ceux qui avancent.
« Ils rentraient avec des matraques » :
un cheminot CGT arrêté par l’armée égyptienne avant de rejoindre la « Marche mondiale vers Gaza »
Marius Joly sur www.humanite.fr
Alors qu’il tentait de rejoindre la « Marche mondiale vers Gaza », Samy Charifi Alaoui, secrétaire général CGT des Cheminots de Paris-Est, a été arrêté par les autorités égyptiennes. Le militant syndical dénonce une détention inhumaine et des violences physiques.
Quatorze heures de détention, privation de nourriture et violences physiques. Voilà comment s’est terminé le séjour égyptien de Samy Charifi Alaoui, secrétaire général CGT des Cheminots de Paris-Est, expulsé manu militari du Caire ce jeudi 12 juin après avoir passé la nuit dans un centre de rétention. Le militant syndical était sur place pour participer à la « Marche mondiale vers Gaza », une initiative qui devait rassembler 6 000 activistes venus du monde entier pour parcourir 50 kilomètres à pied vers l’enclave palestinienne.
Engagé pour la défense du peuple palestinien depuis plus de vingt ans et membre de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), Samy Charifi Alaoui n’a pas hésité longtemps à rejoindre le projet. « J’en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, je me suis renseigné et quand j’ai vu qu’il s’agissait d’une marche pacifique pour transporter de l’aide humanitaire, ma décision était prise. » Le pilier de la CGT Cheminot tente de mobiliser d’autres personnes autour de lui et prend la responsabilité de représenter son secteur jusqu’aux portes de Gaza.
Depuis plusieurs semaines, les militants s’agrègent et s’organisent sur les réseaux sociaux. Dans des groupes privés, la logistique du voyage se met en place au fil des messages : obtention de visas, réservations d’hôtels, listes de matériels à emporter… rien n’est laissé au hasard. Une véritable entraide se met en place chez les quelque 500 volontaires français. « Les gens étaient très motivés, il y avait aussi beaucoup de questions, de craintes parfois. Ça a été l’occasion de créer des liens forts », raconte Samy Charifi Alaoui.
Conditions insalubres
Pour le cheminot, le programme est bien ficelé. L’arrivée est prévue le 11 juin dans la soirée, à peine plus d’un jour avant le grand départ. Le 13 juin au matin, des bus sont affrétés pour couvrir les 450 kilomètres séparant Le Caire de la ville d’El-Ariche dans le Sinaï, point de départ de la marche d’environ 50 kilomètres vers le poste-frontière de Rafah. Sauf que rien ne va se passer comme prévu.
À peine sorti de l’avion reliant Paris à la capitale égyptienne, Samy Charifi Alaoui est rapidement stoppé par les forces de l’ordre. « Dès le premier contrôle, on me demande ce que je viens faire là et d’où est ce que je viens. Quand je finis par évoquer mes origines marocaines, on me met sur le côté instantanément. » Arrivés au même moment sur le territoire égyptien, de très nombreux « marcheurs » subissent rapidement le même sort. « Les autorités avaient déjà arrêté des camarades dans leurs hôtels, ils étaient vigilants. À l’aéroport, on était nombreux à avoir des sacs de couchage, ça a pu leur mettre la puce à l’oreille. » S’ensuit alors une longue nuit d’interrogatoires et de détention.
Baladé de salles en salles dans l’aéroport du Caire, le militant syndical réécoute en boucle les mêmes questions sur ses motivations, ses origines, son hôtel… Après plus d’une heure d’attente, il voit son téléphone portable et son passeport confisqués avant d’être dirigé vers un centre de rétention, enfermé avec de nombreux activistes. « On nous a entassés à 100 dans une pièce immonde. Il y avait seulement six lits, des toilettes insalubres, les conditions étaient assez inhumaines. »
Retenus durant toute la nuit, les militants sont même alertés sur les repas payants, proposés par les militaires égyptiens. « On nous avait prévenus qu’ils pouvaient mettre des choses dangereuses dedans, raconte le syndicaliste. Un peu plus tard, on a appris que quelqu’un avait reçu une assiette avec des clous. » L’eau aussi doit être commandée et payée. Temps d’attente : environ deux heures.
« Je ne lâcherai pas le combat »
Mais la maltraitance ne s’arrête pas là. À intervalles réguliers, des militaires font irruption dans la cellule, avec des méthodes plutôt musclées. « Ils rentraient en criant avec des matraques pour embarquer des militants, sans donner aucune explication, se rappelle Samy Charifi Alaoui. On est resté soudés. On mettait en place des chaînes humaines pour que personne ne soit exfiltré. » Il faut attendre la matinée pour que la situation se calme. Un par un, les militants sont appelés et escortés par une rangée de militaires pour être renvoyés dans leurs pays. Aux alentours de 11 heures, c’est au tour de Samy Charifi Alaoui, qui repart moins d’une journée après avoir quitté Paris.
Frustré, le militant ne compte pas s’arrêter là. « Ça n’a absolument pas affecté ma détermination. Ce n’est pas la première fois que je me rends dans la région et ce ne sera pas la dernière. Si un autre projet se lance, j’en ferai partie. Je ne lâcherai pas le combat. » Pour le militant syndical, la mobilisation pour les Gazaouis reste primordiale, y compris chez les syndicats. « Le syndicalisme dépasse largement la question du militantisme dans le travail. Il se doit d’être présent dès qu’on bafoue les droits des gens, de manière internationale. »
Ciblée de toute part, la « Marche mondiale vers Gaza » est aujourd’hui à l’arrêt. Ce vendredi 13 juin, plusieurs rassemblements ont été stoppés par les autorités égyptiennes au Caire et dans ses environs, alors que le convoi « Soumoud », réunissant des participants tunisiens, algériens, marocains et mauritaniens, a été arrêté en Libye, avant même d’atteindre l’Égypte. Quelques jours après le détournement de la Flottille de la Liberté, une autre initiative de soutien au peuple gazaoui subit la répression. Les militants espèrent encore obtenir une autorisation officielle, malgré les multiples arrestations.
mise en ligne le 13 juin 2025
« Je ne veux pas fuir, je n’ai rien fait de mal » : l’Irlande du Nord fracturée par une semaine d’émeutes racistes
Tom Demars-Granja sur www.humanite.fr
L'Irlande du Nord est le théâtre d'émeutes racistes depuis lundi 9 juin, suite à l'arrestation de deux jeunes hommes d'origine roumaine, dans le cadre d'une enquête pour tentative de viol. Les épisodes de violence sont tels que les autorités nord-irlandaises ont dû évacuer des ressortissants étrangers cachés chez eux depuis plusieurs jours.
Les ressortissants étrangers sont contraints de se cacher dans des greniers ou des penderies. Des maisons sont incendiées, les fenêtres brisées. Dans l’espoir d’être épargnés, certains foyers ont placardé des affiches jaunes où sont inscrits « Des locaux vivent ici », « Des Philippins vivent ici », ou encore « Foyer britannique ». Les rares personnes qui ne sont pas cloîtrées chez elles rasent les murs, où sont inscrits des messages tels que « Dehors les violeurs Roms ». Depuis lundi 9 juin, l’Irlande du Nord est mise à feu et à sang par la multiplication d’émeutes racistes.
Les vagues de violences, qui visent des communautés racisées, s’enchaînent jour après jour, poussant des citoyens à fuir le pays. Les autorités nord-irlandaises ont ainsi annoncé avoir évacué des ressortissants étrangers cachés chez eux, alors « qu’ils n’avaient rien faits de mal », a rapporté le commissaire nord-irlandais, Jon Boutcher. « Ce ne sont pas des criminels, a-t-il rappelé, à destination des émeutiers. Nous allons vous arrêter, nous allons vous poursuivre en justice. » Quinze suspects ont déjà été arrêtés, dont trois jeunes hommes – deux sont mineurs – qui ont été mis en examen pour leur rôle dans ces violences, jeudi 12 juin.
Des cocktails Molotov et des feux d’artifice
L’oppression raciste en cours en Irlande du Nord s’est déchaînée depuis l’inculpation, lundi, de deux adolescents pour la tentative de viol d’une jeune fille. Si la police n’a pas communiqué sur l’origine des deux jeunes, plusieurs médias britanniques n’ont pas hésité à révéler que les deux inculpés se sont exprimés par l’intermédiaire d’un interprète roumain lors de leur comparution au tribunal.
Jusqu’ici, les violences se sont surtout concentrées à Ballymena, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Belfast, où vit une importante population immigrée d’Europe de l’Est. Mercredi soir, des individus s’en sont notamment pris aux autorités et aux habitations, avec des cocktails Molotov, des feux d’artifice et autres projectiles, ainsi qu’une hachette, selon la police, qui a eu recours à un canon à eau pour disperser la foule. Un centre de loisirs, où des familles déplacées par les émeutes à Ballymena avaient été logées temporairement, a été incendié à Larne, à une trentaine de kilomètres de là, sans qu’aucun blessé soit à déplorer.
Des émeutes racistes ont aussi eu lieu dans les rues de Portadown, au sud-ouest de Belfast, où des centaines de manifestants se sont rassemblées sous des mots d’ordre anti-immigrés. « Les gens nous regardent de travers, ils me disent : “Fuck les Roumains, rentrez chez vous bâtards” », témoigne Maria (le prénom a été modifié), vendeuse d’origine roumaine, auprès de l’Agence France-Presse (AFP). « Ce n’est pas à propos de cette fille, c’est une histoire de racisme », juge Maria, qui dort chez des amis avec son mari depuis lundi soir.
Certains habitants de Clonavon Road « sont déjà rentrés » dans leurs pays d’origine, ajoute celle dont le mari a amené dans la précipitation plusieurs familles à l’aéroport. « Mais je ne veux pas fuir, je n’ai rien fait de mal », s’émeut-elle. Un porte-parole du premier ministre britannique, Keir Starmer, a condamné cette nouvelle flambée de violences, dénonçant des scènes « scandaleuses ». Le ministre chargé de l’Irlande du Nord, Hilary Benn, s’est quant à lui dit « choqué » par les dégâts engendrés, à l’issue d’une visite à Ballymena, jeudi matin.
Au-delà de ces deux localités, des incidents ont eu lieu mercredi soir à Carrickfergus et Newtownabbey, non loin de Belfast, ainsi qu’à Coleraine, dans le nord de la province britannique, où le trafic des trains et des bus a dû être interrompu. Des rassemblements ont eu lieu à Belfast, mais se sont déroulés « majoritairement dans le calme », selon la police. Jon Boutcher a appelé à des « peines de prison ferme importantes » pour les personnes qui seront condamnées pour avoir participé à ces émeutes. « Nous devons envoyer un message très clair », a-t-il insisté.
« La plupart des personnes impliquées dans les émeutes – dont beaucoup d’adolescents – sont issues d’une communauté ouvrière loyaliste » – attachée au maintien dans le Royaume-Uni et à majorité protestante -, estime Alex Kane, éditorialiste pour le média Irish News. Cette population, autrefois dominante, s’est, selon lui, sentie « délaissée » lors du processus de paix qui a mis fin à trente ans de conflit avec les partisans de l’unification irlandaise, en majorité catholiques. Or, la défense de leur identité britannique s’est notamment basée… sur leur haine des immigrés.
mise en ligne le 13 juin 2025
Agression israélienne contre l’Iran :
nouveau risque
pour la sécurité mondiale
Rob Grams | sur https://frustrationmagazine.fr
Lorsque l’Iran, en avril 2024, avait riposté à des attaques et assassinats d’Israël, nos médias avaient titré “attaque de l’Iran”. Cette nuit, Israël a agressé unilatéralement l’Iran, bombardant sa capitale, tuant femmes, enfants, scientifiques, des responsables politiques et militaires iraniens… Le prétexte ? Les avancées du programme nucléaire iranien qui pourraient déboucher sur la constitution d’un arsenal atomique iranien. Ces mêmes médias reprennent désormais les éléments de langage de la propagande israélienne et parlent de “frappe préventive” : il n’y a donc rien à attendre d’eux pour s’informer. Que s’est-il passé réellement ?
Agression ou “frappe préventive” ?
Cette nuit,
Israël a lancé, avec 200 avions de combat, une agression unilatérale contre l’Iran, ce qui constitue une “déclaration de guerre”. Différents lieux ont été ciblés en pleine capitale, à Téhéran. Mais
aussi un important site nucléaire près de Natanz. Des chefs et des commandants des Gardiens de la révolution, des chefs d’Etat-major et des hauts-conseillers ont été assassinés, de même que des
experts et scientifiques nucléaires. Comme toujours avec Israël, la majorité des victimes se trouvent être des femmes et des enfants : on dénombrait ce matin 35 femmes et enfants iraniens
tués.
Israël ne compte pas en rester là puisque le Premier ministre israélien, le sanguinaire Benjamin Netanyahu, sous mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité, affirme que cette guerre durera “autant de jours que nécessaire”. Le ministre israélien de la Défense est allé dans le même sens en déclarant que l’Iran “paiera un prix de plus en plus
lourd”.
Comme toujours avec Israël, la majorité des victimes se trouvent être des femmes et des enfants : on dénombrait ce matin 35 femmes et enfants iraniens tués.
Pourtant la plupart des médias occidentaux ont repris les éléments de langage propagandistes de l’agresseur en parlant de “frappe préventive” – ce qui ne veut strictement rien dire. Il en est ainsi du Figaro, de France 24, de BFMTV, de CNN…
Cette lecture complètement partisane du conflit est une insulte à l’intelligence des lectrices et lecteurs. Si cette nuit l’Iran avait frappé Jérusalem et Tel Aviv en prétextant prévenir une attaque israélienne ou détruire les armes atomiques israéliennes, les médias reprendraient-ils les éléments de langage du régime iranien ? Parleraient-ils de “frappe préventive” ? Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, au prétexte de volontés bellicistes de l’Otan, aurait-on imaginé voir des titres comme “La Russie a procédé à une “incursion préventive” contre l’Ukraine” ?
Le monde condamne, la France fait le paillasson
Cette attaque unilatérale contre l’Iran s’est faite au détriment de tous les efforts diplomatiques. Il semblerait que même Donald Trump ait été pris de cours puisque celui-ci exhortait Israël à ne pas attaquer. Il déclarait hier rester «engagé à régler de manière diplomatique la question du nucléaire iranien».
« Les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quels que soient le contexte ou les circonstances”. Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
Le Japon a fermement condamné les frappes israéliennes, dénonçant “une escalade”. Le chef de la diplomatie japonaise, Takeshi Iwaya, a ainsi déclaré qu’il “est extrêmement regrettable que des mesures militaires aient été prises alors que les efforts diplomatiques sont en cours ». Plus timoré mais quand même clair, le Premier ministre britannique Keir Starmer a jugé ces frappes “préoccupantes” et appelé à “revenir à la diplomatie”. La Chine s’est dite “très préoccupée” et a dénoncé la violation de la souveraineté iranienne. Le Qatar a lui aussi “fermement condamné et dénoncé l’attaque israélienne contre l’Iran”. L’Arabie Saoudite a exprimé “sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes” qui constituent “une violation manifeste des lois et normes internationales.”
Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a lui rappelé que “les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quels que soient le contexte ou les circonstances” puisque cela est d’une dangerosité inouïe.
Israël lance une attaque unilatérale d’une ampleur inédite contre une nation souveraine, au beau milieu de négociations diplomatiques, et notre diplomatie trouve le moyen de parler de “droit à se défendre contre toute attaque”. C’est le sens même des mots qui est détruit.
Au milieu de ces condamnations, un pays a fait entendre un autre son de cloche : la France, qui continue par ailleurs de livrer des armes à Israël en continu, et qui s’est illustrée par un communiqué de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dont le niveau de servilité satisfaite laisse pantois : “nous réaffirmons le droit d’Israël à se défendre contre toute attaque”. Israël lance une attaque unilatérale d’une ampleur inédite contre une nation souveraine, au beau milieu de négociations diplomatiques, et notre diplomatie trouve le moyen de parler de “droit à se défendre contre toute attaque”. C’est le sens même des mots qui est détruit.
La dénucléarisation, c’est pour les autres ?
Il est plutôt légitime de s’opposer à la prolifération des armes atomiques. Chaque nouveau pays doté accroît le risque d’une guerre mondiale atomique dont on peine à imaginer les conséquences pour l’humanité entière. Toutefois, les Etats-Unis restent le seul pays à l’avoir jamais utilisé, et à deux reprises, contre des civils, créant un précédent et commettant par là un crime contre l’humanité. De la même manière, si on peut s’inquiéter qu’un régime théocratique et autoritaire comme l’Iran, aux discours parfois bellicistes, soit lui aussi doté de l’arme atomique, quid d’Israël qui attaque sans cesse les pays frontaliers, annexe des territoires et commet un génocide contre la population de Gaza ? Est-on sûrs qu’Israël et les Etats-Unis sont vraiment légitimes à décider de qui a droit à l’arme atomique ? L’Iran est-elle vraiment plus agressive que ces deux nations impérialistes ? Les Etats-Unis sont un des pays les plus agressifs et brutaux de l’histoire de l’humanité : depuis sa création, fondée sur un génocide, cette nation a été en guerre pendant 218 ans, soit 90% de son temps d’existence.
Chaque nouveau pays doté accroît le risque d’une guerre mondiale atomique dont on peine à imaginer les conséquences pour l’humanité entière. Toutefois, les Etats-Unis restent le seul pays à l’avoir jamais utilisé, et à deux reprises, contre des civils, créant un précédent et commettant par là un crime contre l’humanité.
Il faut aussi rappeler que l’agression américaine contre l’Irak s’était aussi faite au prétexte du développement “d’armes de destruction massive”. Il s’était finalement avéré que les documents de preuve présentés étaient des faux pour justifier l’invasion. Ici le cas est différent puisque l’Iran reconnaît avoir un programme nucléaire, mais on voit qu’il s’agit d’un prétexte récurrent pour justifier les agressions occidentales.
En toute logique, l’Iran explique que c’est précisément les menaces et les attaques sans cesse répétées d’Israël contre son territoire qui font partie des éléments justifiant sa volonté d’accéder aux armes atomiques.
Selon le traité de 1968 sur la non-prolifération nucléaire (TNP), seuls les Etats dotés de l’arme nucléaire avant le 1er janvier 1967 peuvent légalement la posséder, c’est-à-dire la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Sauf que dans les faits, c’est bien Israël qui viole ce traité depuis fort longtemps
Selon le traité de 1968 sur la non-prolifération nucléaire (TNP), seuls les Etats dotés de l’arme nucléaire avant le 1er janvier 1967 peuvent légalement la posséder, c’est-à-dire la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Sauf que dans les faits, c’est bien Israël qui viole ce traité depuis fort longtemps, ce qui est de notoriété publique, sans qu’aucun pays ne trouve justifiable des attaques “préventives” contre ses sites nucléaires. Israël refuse systématiquement le contrôle de ses sites nucléaires par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). D’après le magazine britannique Jane’s Defence Weekly, Israël produirait entre 10 et 15 bombes nucléaires chaque année et disposerait de 80 à 300 ogives nucléaires pouvant être lancées par missiles balistiques, sous-marins et avions.
L’Iran a le droit de se défendre
Comme on le voit le fameux “droit de se défendre” matraqué pour justifier le génocide des palestiniens après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, dont on avait bien noté qu’il ne s’appliquait jamais aux palestiniens, semble ne pas s’appliquer non plus à l’Iran. Pourtant, selon le droit international, le “droit de se défendre” ne s’applique pas seulement aux Etats génocidaires.
« Les frappes d’Israël contre l’Iran constituent un recours à la force interdit par l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, une attaque armée au sens de l’article 51 donnant à l’Iran un droit à la légitime défense, et vraisemblablement un crime international d’agression de la part des dirigeants israéliens. » Professeur Ben Saul, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, et professeur de droit international à l’Université de Sydney
L’Iran a ainsi déclaré qu’il avait le “droit légal et légitime” de répondre aux attaques meurtrières d’Israël, ce qui, sur le plan du droit international (mais aussi de la morale) est exact. Comme le confirmait le professeur Ben Saul, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, et professeur de droit international à l’Université de Sydney : « Les frappes d’Israël contre l’Iran constituent un recours à la force interdit par l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, une attaque armée au sens de l’article 51 donnant à l’Iran un droit à la légitime défense, et vraisemblablement un crime international d’agression de la part des dirigeants israéliens. »
Des agressions multiples d’Israël contre l’Iran
Le 1er avril 2024, Israël avait bombardé le consulat d’Iran en Syrie tuant seize personnes dont plusieurs haut responsables iraniens. “Tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur ont été tués ou blessés” avait déclaré le ministère de la défense syrien. Cette attaque illégale n’était par ailleurs pas la première mais le cinquième raid israélien à viser la Syrie en huit jours afin d’assassiner des responsables iraniens.
L’Iran, présentée systématiquement comme une puissance agressive alors que c’est elle qui est attaquée, avait été dans une logique de désescalade, se contentant d’une riposte essentiellement symbolique contre des sites militaires. “Si Israël ne répond pas, nous serons quittes” avait déclaré l’Iran (quand bien même l’attaque israélienne contre l’Iran avait fait plus d’une dizaine de morts là où l’attaque iranienne contre Israël n’en a fait aucune). Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, partageait cette analyse : “L’Iran ne pouvait pas ne pas réagir. Mais Il y a une retenue et pas de volonté d’escalade du côté de l’Iran qui n’y a aucun intérêt, pour Israël c’est différent ». Selon Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam), cité par Le Monde, « les Iraniens ont informé par leurs canaux les Américains, qui avaient des informations précises sur la riposte (…) Les Iraniens ont observé une grande transparence dans leur réponse. Ils ont veillé à ce que les Américains et les Israéliens soient assez préparés pour contrer ces frappes ». L’Iran avait d’ailleurs demandé aux occidentaux d’ “apprécier sa retenue” face à l’attaque d’Israël plutôt que de l’accuser, rappelant qu’elle ne voulait pas l’escalade mais qu’elle répondrait aux menaces et aux agressions.
Le 1er avril 2024, Israël avait bombardé le consulat d’Iran en Syrie tuant seize personnes dont plusieurs haut responsables iraniens.
Les tensions entre Israël et l’Iran datent de longtemps. Israël s’opposant absolument au programme nucléaire iranien.
Le “camp du bien” vs “le camp du mal” : une lecture stupide des relations internationales
Les Etats-Unis et Israël, tout comme le reste du camp occidental, portent une lecture du monde qui se diviserait entre le bien (“le monde libre”) et le mal. Malgré ces discours moralisants, ce n’est pas la défense de la démocratie ou du bien qui intéressent les puissances occidentales. Celles-ci, comme les autres, s’intéressent à la défense des intérêts de leur classe capitaliste. Israël fait partie de la zone d’influence occidentale au Moyen-Orient, raison du soutien des Etats-Unis et d’une grande partie des pays européens. Israël joue de ce soutien pour faire avancer son propre agenda (la colonisation, l’affaiblissement de ses ennemis dans la région etc.).
Refuser de soutenir Israël qui attaque l’Iran n’a rien à voir avec soutenir le régime iranien, ses nombreuses violations des droits démocratiques ou ses attaques brutales contre les femmes. Il ne s’agit pas d’une guerre de modèles, ou d’une guerre idéologique. S’opposer aux attaques d’Israël c’est être attaché au droit international.
Contrairement à ce que certaines et certains essayent de faire croire, refuser de soutenir Israël qui attaque l’Iran n’a donc rien à voir avec soutenir le régime iranien, ses nombreuses violations des droits démocratiques ou ses attaques brutales contre les femmes. Il ne s’agit pas d’une guerre de modèles, ou d’une guerre idéologique. S’opposer aux attaques d’Israël c’est être attaché au droit international. Ce droit est censé garantir la souveraineté des Etats, c’est-à-dire l’idée que ce n’est pas à des puissances étrangères de décider à la place d’une population de l’avenir d’un pays. C’est aussi s’opposer à un ordre mondial où les puissances occidentales continuent de se partager le monde pour leurs intérêts. En plus d’être d’une extrême injustice, cet ordre mondial fait peser des risques gravissimes sur la sécurité de tous les peuples avec la possibilité de déclenchement d’une troisième guerre mondiale, à une époque où les grandes puissances sont dotées de l’arme atomique.
Les enjeux des relations internationales ne peuvent pas être caricaturés par une bataille entre le bien et le mal que chaque camp serait convaincu d’incarner. Jusque-là soutenu dans sa folie guerrière par le camp occidental, Israël tente, après avoir massacré impunément des dizaines de milliers de civils palestiniens, de régionaliser sa guerre, voire de la mondialiser. Elle est une puissance extrêmement agressive, qui viole à répétition toutes les normes les plus élémentaires du droit international. Une fois de plus, la France qui soutient l’action israélienne et livre des armes à l’agresseur, se trouve impliquée militairement dans un conflit sans que ses citoyens n’aient été consultés.
Jusque-là soutenu dans sa folie guerrière par le camp occidental, Israël tente, après avoir massacré impunément des dizaines de milliers de civils palestiniens, de régionaliser sa guerre, voire de la mondialiser.
Le seul moyen d’assurer la paix est de continuer à faire pression sur les gouvernements des pays occidentaux pour que ceux-ci cessent leur soutien aveugle à un Etat qui commet un génocide sur une population colonisée et menace toute la stabilité de la région et le contraignent au respect du droit international.
mise en ligne le 12 juin 2025
Ce que nous dit le débat sur la taxe Zucman
par Pablo Pillaud-Vivien sur www.regards.fr
Taxer les riches, c’est un début, mais leur richesse dépasse largement la profondeur de leurs comptes bancaires.
Ce jeudi, le Sénat examine une proposition de loi initiée par les députés écologistes Éva Sas et Clémentine Autain, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman. Elle propose d’instaurer une taxation minimale de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Une mesure soutenue au-delà des rangs de la gauche : lors du vote en commission des finances, les députés LFI, PS, écologistes et même certains députés LR et centristes ont voté pour. Seuls les macronistes et le Rassemblement national s’y sont opposés. Pas forcément pour les mêmes raisons.
La France a déjà connu une société de rentiers. C’était celle du début du 20ème siècle qui a bien failli en mourir d’asphyxie. On se souvient que lorsqu’Emmanuel Macron a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il n’a pas tout supprimé. Il a laissé en place l’imposition sur les biens immobiliers. Pour l’homme qui trouve agréable d’imaginer des jeunes milliardaires, il faut favoriser l’esprit start-up, pas l’investissement dans la pierre. Tout à ses références sur la France éternelle, le RN n’a pas cette approche. Le bien immobilier symbole de transmission est une valeur. Il mélange pêle-mêle le « ça-m’suffit » et le beau château, à Montretout ou ailleurs.
La proposition Zucman s’attaque à tous les patrimoines. Sa visée est redistributive. Elle lève le voile sur une société où les très riches s’enrichissent par le simple effet mécanique de leur capital, pendant que les autres rament. Selon Forbes, en France, 53 milliardaires détiennent à eux seuls plus de 600 milliards d’euros. Il s’agit ici d’un déséquilibre structurel que cette taxe écornerait à peine. Son intérêt est autre : elle force le débat sur la montée exponentielle des inégalités de patrimoine et elle rapporterait des rentrées fiscales que la minorité gouvernementale peine à imaginer ailleurs que venant des poches du plus grand nombre.
Car, soyons en certains, taxer les très riches à hauteur de 2% ne suffira pas à renverser l’aggravation des écarts de richesse. Même légèrement amputée, leur richesse continuera de croître plus vite que celle du reste de la population. Ils n’ont pas seulement beaucoup d’argent : ils possèdent des actifs, des entreprises, des parts dans des fonds, des leviers de pouvoir économique.
On commence à parler des très riches. Il faudra aussi parler des entreprises qu’ils détiennent. Car c’est le plus souvent là que tout commence. Arnault, Niel, Pinault et compagnie, comme beaucoup des plus riches de France, tirent leurs richesses de leurs entreprises. Le capital productif, celui qui fait tourner l’économie, est de plus en plus concentré dans les mains de quelques-uns. Il n’existe aujourd’hui aucun consensus politique, même à gauche, pour exiger une répartition du pouvoir économique dans les entreprises. On n’ose même plus poser la question de leur propriété.
Tant qu’on ne regardera pas en face les rapports de propriété dans l’économie, tant qu’on n’ouvrira pas le débat sur la démocratisation des entreprises, tant qu’on ne sortira pas de l’idéologie de l’actionnaire-roi, nous resterons à la surface des choses. Parce qu’on ne peut pas parler sérieusement d’égalité sans parler de pouvoir – et le pouvoir, aujourd’hui, c’est là qu’il se loge.
mise en ligne le 12 juin 2025
Le monde bouge pour Gaza
Patrick Le Hyaric sur www.humanite.fr
Un mouvement mondial pour libérer Gaza et la Palestine est en marche. Il prend différentes formes. Sa pluralité lui donne une force considérable.
Le voilier Madleen avec Rima Hassan et Greta Thunberg aura réussi à montrer l’inacceptable, à déchirer le silence. Les actions des Dockers CGT de Fos suivie de celles des ports de Gênes puis d’Anvers et d’autres, ont révélé à des millions d’Européens que nos pays livrent bien des armes au gouvernement d’extrême droite israélien. Du même mouvement, elles auront montré en actes la voie vers la suspension des traités de libre-échange et de coopération. Les vétérans pour la paix (Vétérans for Peace) et une coalition de 45 organisations, religieuses et humanitaires se relaient devant la mission des États-Unis auprès de l’ONU en se nourrissant avec moins de 205 calories par jour, comme les habitants de Gaza. Autant d’actes, autant de manifestations, autant d’adresses de résistance. Autant de rappels au droit international. Autant de cailloux lancés dans la machinerie de l’anéantissement organisé.
Le mouvement de solidarité contre l’acte de piraterie envers le Madleen constitue une relance d’un mouvement où les jeunes sont majoritaires. Dans toutes les villes européennes, le mouvement populaire se conjugue avec Gaza. Les organisations syndicales françaises prennent désormais leur part avec un appel commun de solidarité. Et la journée de mobilisation du 21 juin devant le salon de l’aéronautique du Bourget se transforme en journée anti-guerre et contre l’exposition des armements israéliens, ceux-là mêmes qui tuent les enfants de Gaza et détruisent maisons et fermes en Cisjordanie.
Voici que s’élance une marche mondiale pour lever le blocus. De villes européennes, d’Alger, de Tunis, de Rabat, du Caire et de bien d’autres endroits, se forment des cortèges en direction de Gaza.
Comme au moment des combats contre l’apartheid en Afrique du Sud ou ceux pour la libération du Vietnam, le mouvement mondial pour faire cesser le génocide des Gazaouis et l’effacement du peuple palestinien est en marche. Les institutions européennes, le pouvoir macroniste, la conférence internationale de l’ONU qui s’ouvre dans quelques heures ne pourront pas l’ignorer.
Le silence se brise. L’inacceptable s’expose au grand jour. Le récit des dominants s’écroule sous le poids de l’indicible, des morts, des destructions, des volontés d’anéantir tout un peuple. Quand une armée déploie cinq navires pour arraisonner un frêle voilier désarmé avec douze militants de la paix à bord, il est difficile de conclure à un signe de force. En agissant comme un État terroriste dans les eaux internationales, le pouvoir israélien bafoue le droit international tout en revendiquant le viol de celui-ci en maintenant le blocus de Gaza. Rappelons que le blocus ne date pas du 7 octobre 2023, mais du mois… de juin 2007.
Comme tous les bateaux lancés dans le cadre de « la flottille de la liberté », s’il n’a pas atteint Gaza, le Madleen a fait plus. Il a alerté sur la tentative d’effacement de l’enclave palestinienne des cartes du monde. Il n’a pas pu distribuer les vivres qu’y avaient entassés les habitants de Catane. Il a fait plus. Il a déployé une sonore interpellation modifiant les emplois du temps dans les chancelleries tout en jetant de nouveaux ponts solidaires avec le peuple palestinien qui y trouve force et réconfort.
Un voilier, des dockers européens, des manifestations larges et jeunes, des appels syndicaux, des actions pour la justice et la Paix à Tel-Aviv comme à New-York, trois journées contre la présence des engins de mort israéliens et d’autres au salon du Bourget, des rondes et des marches sur Gaza, c’est une autre vision du monde qui se dessine, un monde à construire ensemble, un monde commun.
Gaza est devenue un nom propre qui circule de lèvres en lèvres, de pancartes en banderoles, de conférences en rassemblements et en marches. Gaza devient bien plus qu’un territoire assiégé. Elle devient le symbole de la construction méthodique des dominants occidentaux assoiffés de positions géostratégiques, de ressources, de territoires quand les peuples du Sud global refusent obstinément d’être humiliés, dépossédés, piétinés, interdits d’avenir. Avec elles et eux faisons la jonction pour une humaine mondialité.
De partout, les peuples, les mondes du travail et de la création, les jeunes hurlent contre les prédateurs qui préemptent ressources, territoires et forces de travail des enfants, des femmes, des hommes pour faire enfler leurs dividendes et alimenter les paradis fiscaux.
Gaza est l’un des laboratoires, point de basculement dans l’inhumain, intégré à la stratégie de l’Occident colonialiste et capitaliste avec ses appareils diplomatiques, médiatiques, militaires au service de l’économie de la violence.
Gaza porte la révélation des manœuvres des pouvoirs occidentaux qui ont détruit dans le monde arabe les forces syndicales et progressistes au profit d’un intégrisme islamiste. Ils ont fait de même en Palestine : construits et financé le Hamas pour affaiblir et empêcher Yasser Arafat. L’inhumanité des dirigeants israéliens envers les otages de leur pays, les laisse de marbre. Ils entretiennent ce prétexte pour bombarder toujours sans faire effort pour les libérer vivant. C’est le peuple Israélien qu’ils malmènent et trompent. Mieux encore. Pour combattre l’islamisme militaire du Hamas, ils créent de toutes pièces et financent de nouvelles milices islamistes proches de Daech. Le cynisme criminel pour maintenir l’ordre existant est leur marque de fabrique.
Le mouvement de solidarité internationale en cours vient déchirer le voile de cette continuité politique, de cet ordre politique qu’appellent de leurs vœux les nationalistes et les extrêmes droites.
Le mouvement mondial en marche pour la justice et le droit est une très bonne nouvelle. Il est gros du monde commun qui se cherche. Nous en sommes.
mise en ligne le 11 juin 2025
Les jeunes tuent :
ce monde ne va pas
Catherine Tricot sur www.regards.fr
Après la mort d’une assistante d’éducation dans un établissement scolaire de Nogent, quelques semaine après l’assassinat d’une adolescente à Nantes, l’inquiétude s’étend. Qu’est-ce qu’il se passe dans notre jeunesse ?
On parle beaucoup d’une forte dégradation de leur santé mentale. Des chiffres affolants sont donnés : un jeune sur quatre serait en souffrance. Ceux qui passent à l’acte, meurtre ou suicide, sont l’expression ultime d’une douleur si profonde, si partagée.
Parmi les responsables politiques, les plus décidés à apporter des réponses immédiates prônent la mise en place de portiques, de vidéo surveillance, d’interdiction de vente de couteaux. Chacun sait bien que ce sont des solutions impossibles économiquement, inefficaces et en trompe-l’œil. Emmanuel Macron, toujours si économe de moyens, proposent l’interdiction des réseaux sociaux. Cet autre monde irréel n’existera pas. Les jeunes se parlent, s’informent et se distraient massivement sur leur portable.
Les défenseurs des enfants et de l’école tirent la sonnette d’alarme sur l’absolue pauvreté des moyens de prévention et de soin dans le domaine mental, en particulier à l’école et en pédopsychiatrie : un médecin scolaire pour 13 000 élèves.
Il faudra aussi, un jour, se demander ce qui provoque un tel malaise, d’une telle ampleur, si soudainement.
La souffrance de la jeunesse dit à quel point notre monde est anxiogène, si dénué de sens et d’avenir.
Ce monde ne leur va pas. Donc il ne va pas.
Drame de Nogent :
plongée dans le quotidien d’une assistante d’éducation (AED)
Pierre Joigneaux sur https://fakirpresse.info/
Après le drame de Nogent, une assistante d’éducation (AED) de 31 ans tuée par un élève ce mardi, j’ai de suite pensé à Charlotte : assistante d’éducation, le même âge, le même département. J’avais rencontré Charlotte il y a deux mois de ça, et elle tirait déjà la sonnette d’alarme…
Parce que dans les couloirs, dans la cour, aux toilettes, à l’infirmerie, à l’entrée, à la sortie, en perm’, dès que les élèves quittent la salle de classe, les assistants d’éducation (AED) sont là, au four et au moulin. Des journées de fou. Une présence essentielle pour nos gosses, mais un métier ultra précaire. Et surtout abandonnés par l’institution, par l’Etat.
Jusqu’au drame de Nogent, donc.
La réponse de ce gouvernement ? Le Premier ministre dénonce la « menace des armes blanches, devenue critique ». Comme si la « menace » venait de nulle part. La ministre de l’éducation parle de la mise en place de « fouilles », appelle une « réponse globale » mêlant santé mentale des jeunes avec un « protocole de repérage ».
Mais qui va « fouiller » ? Quels personnels, quand il en manque partout, quand les profs, déjà, ne sont pas remplacés ?
Et « repérage » des problèmes psychologiques par qui ? Par les infirmières scolaires ? La France en compte une pour… 1558 élèves !
Par les psys de l’Education nationale ? Qui vont aussi prendre en charge la santé mentale, peut-être ? La France compte une seule psy pour… 1500 élèves !
Pour repérer et soigner, encore faudrait-il des professionnels de santé dans les établissements scolaires, non ? Mais qu’ont fait Elisabeth Borne comme ministre de l’Education, et son gouvernement, pour améliorer les choses, dans ce domaine ?
Qu’ont fait Elisabeth Borne comme Première ministre, et son gouvernement, pour améliorer les choses, dans le quotidien des élèves et des personnels ?
Qu’a fait François Bayrou, qui pleure dans son costume de Premier ministre, mais pointait déjà comme ministre de l’Education il y a plus de trente ans ?
Comme si leur responsabilité n’était pas engagée, directement engagée…
Loin des coups de com’ du gouvernement, on vous plonge dans le quotidien d’une assistance d’éducation, celui de Charlotte (lire le début en accès libre ci-dessous).
« Bonjour Fakir.
Je vous écris pour vous faire part de mon expérience pour le moins très précaire. Je suis AED, soit assistante d’éducation dans un collège public de la Marne. Vous n’êtes pas sans savoir que ce contrat est déjà précaire à la base. Fin février, j’ai été victime d’un accident qui, aujourd’hui, m’empêche de marcher et implique une longue rééducation. Je ne marcherai pas avant des mois. Aujourd’hui, la sanction tombe : demi salaire, direct… » Clément, mon collègue à la com’, nous avait signalé ce témoignage reçu sur Facebook. Je me l’étais noté, dans un coin de mon cahier. Je l’avais ajouté à la pile immense des sujets d’articles potentiels, alors qu’on est sous l’eau, à la rédaction. Mais pendant que quand Louisa, aide à domicile à Aurec-sur-Loire, me racontait les métiers invisibles dont on ne parle jamais, je me rappelais de Charlotte…
Je me frotte les yeux, et je relis son message avant de la contacter. « Vous n’êtes pas sans savoir que ce contrat est déjà précaire à la base… » Pour être honnête, les assistants d’éducation, ça m’évoque des lointains souvenirs du collège, mais guère plus. Charlotte, du coup, sans plus attendre, entre dans le vif : « On ne me propose même pas la possibilité de survivre dignement, et pourtant, je suis sous contrat, engagée avec l’Éducation Nationale… »
Une honte, mais une honte légale.
Je rembobine : Charlotte est assistante d’éducation dans un collège public dans la Marne. Elle a eu un grave accident, le 24 février dernier. « Je me suis explosé la jambe. » Elle est tombée, elle s’est pété le ligament du genou droit. Elle ne peut plus marcher, déclare un arrêt à l’Éducation nationale, prévient sa CPE, le jour même. Résultat ? Quatre jours plus tard, elle reçoit un demi-salaire : 600 euros. Comment c’est possible ?
mise en ligne le 11 juin 2025
Flottille vers Gaza :
indignation sélective et cynisme d’État
Pierre Jacquemain sur www.politis.fr
Alors que le Madleen a été intercepté par Israël, les commentateurs préfèrent railler cette initiative humanitaire. Malgré le génocide. Malgré les dizaines de milliers de morts. Quand est-ce que le cynisme s’arrêtera ?
Il y a des silences plus assourdissants qu’une meute qui se déchaîne. En France, ces derniers jours, un étrange concert s’est formé : celui d’un unanimisme politique et médiatique qui s’applique non pas à défendre la justice ou la vérité, à s’indigner d’un génocide en cours ou à dénoncer les fossoyeurs du droit international, mais à condamner ceux qui, sur mer ou sur terre, osent encore se dresser au nom de la solidarité. Au nom de l’humanité.
La flottille humanitaire en route vers Gaza – composée de civils, de médecins, de parlementaires européens, de journalistes, de syndicalistes et de militants des droits humains – a été qualifiée, avec une inquiétante synchronisation, de « provocation » par nombre de voix officielles. Sur les plateaux télé, les mots se répètent, interchangeables, comme dictés par un même logiciel de langage – parfois même venu d’Israël. Un chroniqueur vedette sur LCI raille des « touristes de la cause palestinienne ». Un ministre de la République, tout en nuance, évoque une opération « instrumentalisée par le Hamas ». D’autres ironisent autour de « la flottille s’amuse » à l’instar de l’édition de cette semaine de Franc Tireur. 60 000 morts à Gaza valent bien une franche déconnade. Qu’est-ce qu’on se marre.
L’inversion morale est totale : ceux qui veulent apporter des médicaments, du pain, des couches et du lait, de l’espoir à une population sous siège sont traités comme des criminels. Et pendant ce temps, dans une indifférence presque complète – quand ça n’est pas pour s’en amuser –, une députée européenne, Rima Hassan, de même qu’un journaliste, Yanis Mhamdi de Blast, sont arrêtés et retenus par Israël – le seul pays démocratique de la région nous assène-t-on – pour avoir embarqué dans cette même flottille. Où sont les éditoriaux des grands journaux ? Les offusqueurs professionnels de plateau pour s’en indigner ?
Ceux qui veulent apporter des médicaments, du pain, des couches et du lait, de l’espoir à une population sous siège sont traités comme des criminels.
Dans le même temps, en France, l’émotion est mobilisée pour des faits divers, certes tragiques, mais qui déclenchent aussitôt l’activation complète de la machinerie compassionnelle : une minute de silence ici, des chaînes d’information en édition spéciale là, des hommages à l’Assemblée. Pourquoi pas. Comment expliquer alors que dans ce même pays, une enseignante soit sanctionnée pour avoir respecté la demande de ses élèves d’observer une minute de silence pour les 16 000 enfants tués à Gaza ? 16 000 enfants. Pas une tribune. Ou plutôt si, une seule. Pas un discours officiel en revanche. L’indignation sélective devient l’autre nom du cynisme.
Savoir être du bon côté de l’histoire
Et pourtant. Quelque chose gronde. Face à la chape de plomb, des brèches s’ouvrent. Partout en France, dans plus de 120 villes, des centaines de rassemblements ont eu lieu ces derniers jours pour soutenir la flottille, pour dénoncer l’inhumanité des massacres quotidiens à Gaza – et en Cisjordanie –, pour dire que la solidarité n’est ni un crime ni une provocation.
Quelque chose gronde. Face à la chape de plomb, des brèches s’ouvrent.
Dans ces foules se retrouvent des soignants, des enseignants, des étudiants, des mères de famille, des croyants et des athées. Et au-delà de nos frontières, une autre image vient balayer le tableau figé des postures diplomatiques : cette marche qui s’élancera dès demain depuis Le Caire jusqu’au poste frontière de Rafah, menée par des centaines de citoyennes et citoyens venus de plus de 40 pays, qui avancent ensemble, parfois à pied, pour tenter de briser le mur du silence et de l’abandon. Ce ne sont pas des provocateurs. Ce sont des vivants, des solidaires, des humains. Il est des moments de l’histoire où il faut savoir être du bon côté. Plus que jamais, ceux-là y sont.
Gaza : 31 Palestiniens tués et 200 blessés
par l’armée israélienne
près d’un centre d’aide humanitaire
Julie Debray-Wendeling sur www.humanite.fr
Ce mercredi 11 juin, des tirs israéliens ont fait une trentaine de morts et 200 blessés près d’un centre d’aide humanitaire, annonce la Défense civile de de Gaza.
La Défense civile de Gaza a indiqué que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur des Palestiniens se rendant à un centre humanitaire américain ce mercredi 11 juin, faisant 31 morts et 200 blessés, a rapporté son porte-parole, Mahmoud Bassal à l’Agence France Presse (AFP). Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas réagi.
La nuit dernière, des milliers de Gazaouis rassemblés dans l’espoir d’atteindre le centre de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) ont été la cible de tirs israéliens « à plusieurs reprises », a affirmé le porte-parole. Puis vers 5 h 30, « ils ont intensifié leurs tirs et en même temps il y avait des tirs nourris de drones visant les civils », a-t-il poursuivi.
Épisodes meurtriers à répétition
Si la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), créée de toutes pièces en février dernier par Israël et les États-Unis, assure distribuer des colis repas aux habitants gazaouis touchés par la famine, elle semble en réalité avoir la mainmise sur l’aide humanitaire. L’ONU, régulièrement prise pour cible par le gouvernement de Netanyahou, refuse de travailler avec l’organisation, en raison de différentes préoccupations concernant ses procédés et son instrumentalisation.
Depuis leur très récente ouverture, les épisodes meurtriers à proximité des centres d’aide GHF sont récurrents. La Défense civile a ajouté qu’un événement similaire s’était produit lundi 9 juin : 10 personnes ont alors été tuées et plus de 30 autres blessées par des tirs israéliens, alors qu’elles tentaient, là encore, d’accéder à des centres de distribution d’aide gérés par la Fondation Humanitaire de Gaza.
Une indignation internationale
De leur côté, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, ont annoncé mardi des sanctions contre deux ministres israéliens accusés d’« incitation à la violence » contre le peuple palestinien. Ces deux figures de l’extrême droite israélienne, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, « ont incité à une violence extrémiste et de graves violations des droits humains des Palestiniens » en Cisjordanie, ont dénoncé les ministres des Affaires étrangères de ces cinq pays dans un communiqué commun. Ces ministres ne sont désormais plus autorisés à se rendre dans ces dits pays et leurs avoirs éventuels sont gelés au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.
Dans la foulée, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, s’est indigné de la situation humanitaire, « catastrophique » à Gaza, dénonçant les pratiques du gouvernement de Benyamin Netanyahou, ne respectant pas le droit international humanitaire. « Des membres du gouvernement israélien justifient le fait qu’une population affamée, qui a déjà tout perdu, soit en plus privée d’accès à la nourriture, à l’eau et aux médicaments ». Les États-Unis ont quant à eux « condamné » ces sanctions mardi 10 juin, les jugeant « extrêmement peu utiles » et estimant que les cinq états devraient davantage se concentrer sur le Hamas.
mise en ligne le 9 juin 2025
La flottille pour Gaza arrêtée : Israël accusé de violer le droit international, Paris se tait
Cécile Hautefeuille sur www.mediapart.fr
Les douze personnes arrêtées dans la nuit de dimanche à bord du bateau « Madleen » ont été convoyées vers Israël. Des ONG et une partie de la gauche française dénoncent cette action menée dans les eaux internationales. Des milliers de manifestants se sont rassemblés en France lundi soir
Des milliers de personnes se sont rassemblées dans toutes les grandes villes de France, lundi 9 juin à partir de 18 heures, pour protester contre la prise de contrôle par l’armée israélienne du bateau humanitaire Madleen qui faisait route vers Gaza. La réaction du gouvernement français est jugée beaucoup trop timide, voire « complice ».
Escorté par deux navires de la marine israélienne, le bateau abritant douze militant·es, dont six Français·es, est entré dans le port d’Ashdod lundi à la nuit tombée, vers 20 h 45, heure locale (19 h 45 à Paris). « À leur arrivée, des dispositions seront prises pour leur retour dans leurs pays d’origine respectifs », avait indiqué en milieu d’après-midi le ministère israélien des affaires étrangères, qualifiant ce navire de la Flottille de la liberté de « yacht selfie transportant Greta Thunberg et les autres soi-disant célébrités ».
De nationalité française, allemande, brésilienne, turque, suédoise, espagnole et néerlandaise, les douze militant·es avaient embarqué à bord du Madleen le 1er juin en Italie pour « briser le blocus israélien » à Gaza. L’activiste suédoise Greta Thunberg, l’eurodéputée La France insoumise (LFI) Rima Hassan ou encore le journaliste français de Blast Yanis Mhamdi se trouvaient à bord du navire battant pavillon britannique.
Israël affirme avoir « dérouté » le bateau au milieu de la nuit de dimanche à lundi. L’organisation Freedom Flotilla Coalition (Coalition de la Flottille de la liberté) parle d’un équipage « kidnappé » par une armée qui a « arraisonné » le navire.
À Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Nice, de gros rassemblements ont eu lieu lundi soir à l’appel de la gauche, pour protester contre l’interception du bateau et dire leur inquiétude pour ses occupant·es.
Présent place de la République à Paris dans une foule dépassant sans doute les 10 000 personnes, aux côtés d’autres représentants des partis de gauche, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a assuré « craindre le pire » pour les militant·es à bord. La dirigeante des Écologistes Marine Tondelier avait auparavant appelé à « une mobilisation populaire internationale » pour « amener les États à s’engager pour leur protection et leur libération ».
À la mi-journée, l’Élysée avait simplement fait savoir qu’Emmanuel Macron avait « demandé de permettre, dans les plus brefs délais, le retour en France » des Français·es. Le ministre des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a souhaité que la France puisse exercer une « protection consulaire à leur égard » et leur rendre visite « en vue de s’assurer de leur situation » à leur arrivée sur le territoire israélien .
Sur le réseau social X, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé une « arrestation illégale » et demandé à l’ensemble de la communauté internationale de la condamner. Il s’est adressé en particulier à l’exécutif : « Rima Hassan, députée française, va être détenue en prison après l’acte de piraterie de ses agresseurs cette nuit. Le gouvernement et le président ne prennent pas la mesure du danger. Ont-ils peur de Nétanyahou ? C’est insupportable », a-t-il posté.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré, lui aussi sur X : « L’équipage a atteint son but. Il doit maintenant faire l’objet d’un soutien des États européens. Le silence des gouvernements serait une faute. »
Nombre de voix, dont celles de la Ligue des droits de l’homme et d’Amnesty International, ont également dénoncé ce lundi une violation du droit international, et l’absence d’autorité légale d’Israël à agir de la sorte. Interrogé par BFMTV, Benjamin Fiorini, secrétaire général de l’Association des juristes pour le respect du droit international, était formel : « Cette arrestation ne peut pas être légale », car « Israël n’a aucune souveraineté » dans les eaux où le navire a été intercepté.
Chaque port de la Méditerranée devrait envoyer des bateaux chargés d’aide, de solidarité et d’humanité à Gaza. Et ils devraient naviguer ensemble. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les Territoires palestiniens
Le gouvernement israélien manie de son côté l’ironie, considérant que « le spectacle est terminé », ainsi que l’a posté sur le réseau social X le ministère des affaires étrangères au milieu de la nuit. Une vidéo montrant que nourriture et eau avaient été distribuées aux militantes et militants a été publiée, avec une photo de Greta Thunberg, ainsi légendée : « Greta Thunberg est actuellement en route pour Israël, saine et sauve et de bonne humeur. »
Au même moment, le ministre israélien de la défense a exigé de l’armée israélienne qu’elle montre aux passagères et passagers du Madleen la vidéo des atrocités commises le 7 octobre 2023 par le Hamas. « Il est juste que Greta l’antisémite et ses amis partisans du Hamas voient précisément quelle est l’organisation terroriste qu’ils sont venus soutenir, pour laquelle ils agissent, et quels crimes atroces elle a commis contre des femmes, des personnes âgées et des enfants – et contre qui Israël se bat pour sa défense », a-t-il posté sur X. 1 200 personnes, dont 815 civils, ont été assassinées lors de cette attaque organisée par le Hamas sur le sol israélien.
Plus de 54 772 Palestinien·nes, majoritairement des civils, ont été tué·es dans la guerre menée par Israël et à Gaza, « 100 % de la population » est « menacée de famine », avertit de son côté l’ONU. Dans un communiqué publié samedi 7 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte également sur « l’effondrement du système de santé », car « il n’y a déjà plus aucun hôpital en service dans le nord » du territoire.
Un nouveau convoi en route
Depuis l’arrestation des militantes et militants du Madleen, de nouveaux appels à venir en aide aux Gazaoui·es sont lancés. « Chaque port de la Méditerranée devrait envoyer des bateaux chargés d'aide, de solidarité et d’humanité à Gaza. Et ils devraient naviguer ensemble – unis, ils seraient inarrêtables », exhorte sur X Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les Territoires palestiniens. Selon elle, « briser le siège est un devoir légal pour les États et un impératif moral pour nous toutes et tous ».
Et c’est justement pour « briser le blocus » qu’un convoi de plusieurs centaines de personnes a quitté la Tunisie lundi 9 juin dans des autocars, avec l’intention de rejoindre la bande de Gaza, en passant par la Libye et l’Égypte. Selon le porte-parole de ce convoi, cité par le quotidien Le Monde, il ne s’agit pas d’apporter de l’aide humanitaire dans « l’endroit le plus affamé au monde » mais de poser « un acte symbolique ».
Dès l’aube, le compte « Freedom Flotilla Coalition » a publié sur les réseaux X et Bluesky des vidéos, en anglais, des militantes et militants présent·es à bord du Madleen appelant, chacune et chacun, leur gouvernement à réagir. « Si vous voyez cette vidéo, c’est que nous avons été interceptés par les forces israéliennes […] et que nous sommes peut-être dans une situation très difficile, alors je demande à nos soutiens, à nos familles […] de faire pression sur le gouvernement français pour que nous soyons libérés et, bien sûr, que ce génocide cesse. »
Parmi les réactions internationales, la Turquie a dénoncé une « attaque odieuse » de la part du gouvernement du premier ministre israélien, jugeant qu’« une fois de plus qu’Israël agit comme un État terroriste ». L’Iran condamne de son côté un « acte de piraterie ».
Alors que l’équipage du Madleen devait arriver en Israël, des manifestantes et manifestants s’étaient rassemblé·es près du port d’Ashdod pour demander la libération de Gaza
et la fin du silence international.
Montpellier :
2 000 personnes manifestent en soutien
à la flottille de la liberté
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Après un premier rassemblement ce dimanche 8 juin, ce sont 2 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montpellier ce lundi 9 juin, en soutien de la flottille pour la liberté en approche de Gaza, avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, la militante écologiste Greta Thunberg et une dizaine d’humanitaires, arrêtés par l’état d’Israël
Dans la nuit de dimanche à lundi, Madleen, le bateau de la flottille de la liberté, chargé de briser symboliquement le blocus ciblant la bande de Gaza en apportant des vivres, a été stoppé en mer par l’armée israélienne. Avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, la militante écologiste Greta Thunberg, et une dizaine d’humanitaires. À Montpellier, ce sont entre 1 500 et 2 000 personnes qui ont manifesté pour les soutenir ce lundi soir.
“C’est une piraterie d’État, une violation du droit maritime et du droit humanitaire”, tonne Manu, militant de BDS (boycott désinvestissements sanction, association non-violente de soutien à la Palestine), ce lundi 9 juin sur la place de la Comédie, devant environ 1 500 personnes. “Macron n’a toujours pas exigé l’eut libération, il est complice”, ajoute le militant.
Nathalie Oziol, députée LFI de l’Hérault. Appelle quant à elle l’État français à “condamner fermement ces agressions et à faire respecter le droit international”. Côté montpelliérain, elle demande à Michael Delafosse, maire “socialiste” de Montpellier, de suspendre le jumelage de la commune avec la ville israélienne de Tibériade, comme le demande une partie de l’opposition municipale.
Le maire de Montpellier avait déjà dû reculer sur la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible de l’État d’Israël“, célébrée chaque année en présence des barons socialistes locaux, au mépris du droit international, qui prévoit un partage de la ville sainte. Sous pression de son aile gauche et du mouvement de soutien à la Palestine, il avait déclaré en avril dernier que cette journée ne se tiendrait plus dans un lieu public, comme c’était le cas avant, au domaine de Grammont.
Domaine de Grammont que les militants investiront les militants de BDS le 22 prochain à l’occasion d’un pique-nique accompagné d’animations politiques pour célébrer “la journée d’Al-Qods” (nom arabe de Jérusalem).
mise en ligne le 9 juin 2025
Manifestations contre
l'ICE : en déployant
la garde nationale
en Californie, Donald Trump tente un double
coup de force
Christophe Deroubaix sur www.humanite.fr
En ordonnant le déploiement de la garde nationale en Californie, le président nationaliste tente de mettre au pas le principal État démocrate et de faire taire les dissensions internes à la coalition républicaine.
Il intervient surtout dans un moment politique où l’hôte de la Maison Blanche se trouve affaibli notamment par la tonitruante dissension avec Elon Musk. Pour prévisible qu’il fut, ce clash des oligarques n’en ébrèche pas moins la coalition républicaine, constituée de différents courants aux visions parfois contradictoires. Le multimilliardaire s’était ainsi opposé à la guerre commerciale et au creusement du déficit tout en réclamant, en vain, l’ouverture des robinets migratoires pour les plus qualifiés.
En assumant la guéguerre avec le plus important financeur de sa campagne et en créant un précédent dans le principal État démocrate sur la question de l’immigration, Donald Trump a choisi la ligne de Steve Bannon, son ancien conseiller ouvertement en contact avec toutes les extrêmes droites du monde : ouvertement nativiste et autoritaire.
À Los Angeles, le
courage
d’affronter la police
En outre, les militants anti-police diffusent activement leurs conseils et tactiques : filmer la police, se masquer pour éviter d’être filmé par la police et identifié par les logiciels de reconnaissance faciale, s’armer de gants, de lunettes et de parapluies en guise de boucliers, désactiver les fonctions de localisation sur son téléphone, ou le laisser à la maison, inscrire le numéro d’un avocat sur son bras ou sa cuisse, utiliser du lait pour calmer la douleur des gaz lacrymogènes et fabriquer des petites bombonnes de récupération de ces gaz grâce à du bicarbonate de soude et de l’eau…
Le gouverneur de Californie a désapprouvé l’envoi de la garde nationale. La dernière fois qu’un président américain avait déployé l’armée pour réprimer des manifestations civiles, c’était en 1992, lors des soulèvements de Watts, après l’acquittement des policiers ayant tabassé Rodney King.
La nécessité d’abolir l’institution policière est flagrante. Mais les démocrates font preuve, une fois encore, de leur incohérence, ou plutôt, de leur attachement au statu quo et aux structures de la répression. La maire de Los Angeles par exemple, Karen Bass, s’est dite « furieuse » des « tactiques qui sèment la terreur et affectent la sécurité dans (sa) ville ». Pourtant, le même jour, elle a adopté le budget municipal accordant 240 nouveaux recrutements au LAPD, dont le budget annuel dépasse déjà les 2 milliards de dollars.
mise en ligne le 7 juin 2025
Parcoursup : la machine,
cimetière des vocations
Cyril Pocréaux sur https://fakirpresse.info/
Ce lundi, c’est le top départ de Parcoursup, cette grande loterie où une machine décide si nos jeunes qui veulent étudier auront, ou non, une chance de réaliser leurs rêves. Spoiler : souvent, c’est « non »…
« L’intelligence artificielle va disrupter tous les modèles économiques, et je veux que nous en fassions partie. Je
veux que nous ayons des champions de l’intelligence artificielle ici en France, et attirer les champions du monde entier. » C’est
Emmanuel Macron, disrupteur en chef, qui lançait ça, l’œil brillant, lors d’un des précédents sommets « French Tech ». Et de vanter, l’œil brillant, son modèle de société qui
« digitalise » les services publics, met des tablettes dans les écoles, oriente les élèves avec les algorithmes de Parcoursup…
Sans même se poser la question sans même qu’elle ne l’effleure : des « champions » pour faire quoi ?
La technique, soit, mais au service de quelle humanité ? Au service de quel projet ? La question n’est jamais posée : car la technique, en elle-même, c’est leur « proooooooojet ».
Et tant pis pour les jeunes qui, non sélectionnés par les algorithmes de Parcoursup – eux-mêmes désormais faussés par ceux qui exploitent « l’intelligence » artificielle pour se faire une place au soleil des classements – tant pis donc pour les jeunes qui, écartés par la machine, sont renvoyés au néant, à eux de se démerder seuls, parce qu’une machine l’a décidé. L’an passé, sur 850 000 candidats à une place pour poursuivre des études supérieures, 85 000 n’avaient pas reçu de proposition. En 2022 : 22 % des bacheliers n’avaient pas trouvé de place. Beaucoup racontent leur détresse sur les réseaux sociaux.
Débrouillez-vous.
Ceux dont les parents ont les moyens pourront toujours alimenter le business des écoles privées.
Quant aux autres…
Quand la machine brise des rêves
C’est un immense, un terrible gâchis.
Un cimetière des vocations, comme on vous le racontait déjà dans notre dernier bouquin, celui de Damien Maudet, Un député aux Urgences.
Car c’est l’un des paradoxes de cette start-up nation dont rêve Macron : ses algorithmes ruinent les rêves, ceux des aspirants infirmiers, entre autres. « La sélection, où il n’y a plus d’entretien, n’est pas adaptée », se désole Rémi Salomon, président de la CME, la conférence médicale d’établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). En bref : depuis 2019, le concours d’entrée en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) a été supprimé pour laisser place à l’algorithme de Parcoursup, dont personne ne comprend bien le fonctionnement.
Étonnamment, depuis l’entrée en vigueur de ce système, le nombre de demandes d’entrées en IFSI a littéralement explosé (mais pas le nombre de places disponibles) : de 180 000 demandes en 2017, à 680 000 en 2021. Problème, tout aussi étonnant : le nombre d’abandons en cours de cursus a lui aussi augmenté, en flèche. En 2023, la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) pointait un doublement du taux d’abandon en études de soins infirmiers, passant de 10 % pour la promotion 2011 à 22 % pour celle de 2020.
D’après Michèle Appelshaeuser, présidente du Comité des instituts de formations du paramédical, « le concours donnait au moins aux étudiants le temps de maturer un projet et de réfléchir au métier d’infirmier ». Comprenez : aujourd’hui, les étudiants cochent dans leurs vœux un IFSI comme ça, un peu par défaut. Puis sont sélectionnés par la machine, mais se rendent vite compte qu’ils ne sont pas intéressés, et arrêtent. Effet pervers : à l’inverse, des milliers de lycéens motivés sont refoulés d’entrée de jeu par l’algorithme. Et il n’existe aucun concours pour retenter sa chance, quand bien même c’est là le métier de vos rêves. Un rapport sénatorial souhaite remettre en cause ce système, qui génère un « taux d’abandon en cours d’études particulièrement important. »
Mais puisque l’algorithme le dit, on continue à massacrer des vocations.
Et donc, en cascade, à supprimer des lits à l’hôpital.
Merveilleuse start-up nation…
mise en ligne le 7 juin 2025
“Si je continue plus longtemps j’y resterai”, Anthony, ouvrier du BTP
https://frustrationmagazine.fr/
Le secteur du BTP (Bâtiments et Travaux Publics) est celui où se produit le plus d’accidents du travail mortel. Rien qu’en 2023, 149 travailleurs du BTP sont morts à cause de leur travail. Le 13 mai dernier, trois maçons mourraient sur un chantier à la suite de l’effondrement d’un mur. Les petites entreprises, les plus nombreuses dans le BTP, secteur où la sous-traitance est le modèle économique dominant, sont particulièrement concernées par les problèmes de sécurité qui mènent à ces accidents. C’est ce que nous a raconté Anthony, 21 ans, qui est déjà très conscient des risques qui affectent son quotidien. Après avoir visionné certaines de nos vidéos où l’on parle de la souffrance au travail, il nous a contactés et nous avons discuté.
Je travaille dans le bâtiment, en couverture (la construction des toits), et les conditions sont pitoyables. Dans l’Oise, les entreprises font constamment la course entre elles, les chantiers sont éloignés les uns des autres et c’est notre sécurité qui en pâtit car on doit aller de plus en plus vite. Concrètement, les échafaudages sensés nous protéger sont dangereux à installer : on est à 6 à 8 mètres au-dessus du vide avec une console de 5kg dans une main et le marteau dans l’autre, le tout sans sécurité car on perdrait du temps … Et presque tout le monde a banalisé tout ça. Il y a même des gens qui se mettent en danger sans raison, tout ça pour paraître courageux, fort, et rendre fière les supérieurs, montrer que l’on peut compter sur eux pour faire de l’argent. C’est une constante compétition mais il faut que tout ça s’arrête : je travaille 39h par semaine plus la route et les pauses de 30 minutes pour manger, j’ai 21 ans et je suis crevé. J’ai l’impression que si je continue plus longtemps j’y resterai, mentalement ou physiquement, ou bien les deux…
Concrètement, les échafaudages sensés nous protéger sont dangereux à installer : on est à 6 à 8 mètres au-dessus du vide avec une console de 5kg dans une main et le marteau dans l’autre, le tout sans sécurité car on perdrait du temps … Et presque tout le monde a banalisé tout ça. Il y a même des gens qui se mettent en danger sans raison, tout ça pour paraître courageux, fort, et rendre fière les supérieurs, montrer que l’on peut compter sur eux pour faire de l’argent.
Des fois, je me demande pourquoi on ne manifeste pas avec mes collègues. Mais en fait c’est simple les gens on besoin d’argent, et quand dans le bâtiment on veut manifester, on ne nous écoute pas et en plus on perd de l’argent donc autant la fermer. D’ailleurs je trouve qu’on parle très peu du secteur du bâtiment, alors que je vois et vis chaque jour des mises en danger énormes notamment à cause de la crise actuelle : il y a très peu de chantiers donc on prend tout et vu que les gens n’ont pas assez d’argent il prennent l’entreprise la moins chère. Mais la moins chère, c’est celle qui n’échafaude pas correctement, qui va vite et qui met encore plus en danger ses travailleurs…
Parfois j’essaye d’en discuter avec mes collègues mais pour eux c’est normal et surtout on dirait qu’ils ont peur de perdre leur boulot donc ils acceptent n’importe quoi. Mon collègue, un ancien, a des problèmes de santé et donc parfois il est prêt à refuser de travailler sur un chantier risqué… Mais il finit toujours par accepter ce que demande le patronat. Deux autres collègues, lorsqu’ils sont malades, courent quand même bosser. J’ai l’impression que c’est juste moi qui suis pas assez fou ou alors trop sensé pour ce système, car j’aurais beau changer de boîte c’est partout pareil dans ce secteur.
Je m’entends bien avec mes collègues sur le plan humain, mais niveau travail pas vraiment, ils sont complètement dans le “travailler plus pour gagner plus”, alors que je vois bien que ça ne marche pas. C’est une petite entreprise, on est souvent en équipe de deux et les ouvriers se respectent entre eux, mais depuis des années le contexte économique fait que les petites entreprises qui sont sous-traitantes pour des groupes de construction et font du pavillon neuf sont tellement en concurrence que le moins cher décroche le chantier à chaque fois et c’est nous, travailleurs, qui en pâtissons. Et surtout notre sécurité.
On parle très peu du secteur du bâtiment, alors que je vois et vis chaque jour des mises en danger énormes notamment à cause de la crise actuelle : il y a très peu de chantiers donc on prend tout et vu que les gens n’ont pas assez d’argent il prennent l’entreprise la moins chère. Mais la moins chère, c’est celle qui n’échafaude pas correctement, qui va vite et qui met encore plus en danger ses travailleurs…
Je n’ai jamais parlé à des syndicalistes, notamment parce que j’avais cette idée ancrée en moi du “c’est le boulot qui est comme ça” et que j’aime juste pas mon boulot. Alors qu’en fait c’est faux, ce n’est pas mon boulot que j’aime pas c’est danger inutile, les risques pour gagner plus au boulot et un système qui menace la sécurité des travailleurs.
Concrètement, on travaille sur des pavillons, parfois à 6 mètres de haut, échafaudé sur console qu’on installe depuis une échelle, ce qui est pourtant une pratique interdite. On ne doit pas travailler depuis une échelle, surtout pas pour une manipulation qui nécessite l’utilisation des deux mains, mais on le fait TOUS ! J’ai l’impression parfois qu’on déteste la sécurité, on accepte de faire dangereux pour faire vite. C’est une vraie culture de travail, cette banalisation des risques. Dans le bâtiment demande à n’importe qui ce qu’il pense de l’inspection du travail ils vont te dire qu’il ne servent à rien, qu’il nous cassent les pieds, alors qu’ils sont là pour nous protéger.
Mes patrons sont clairement des bourges pour le coup, mais humainement ça va, disons que peu importe le patron : dans le secteur du pavillon neuf, il y a toujours des manquements à la sécurité et quand j’en parle autour des moi a d’autre couvreur je me rends compte c’est généralement partout pareil. Ce système est horrible et je ne trouve pas comment en sortir.
On manque de matériel de qualité : Outillage, visseuse meuleuse, tronçonneuse, échafaudage propre, on manque d’échafaudage correct, d’un monte charge : il n’y en a un pour deux équipes et dans un très mauvais état. Nos EPI (équipement personnel de sécurité) c’est des gants, des chaussures de sécurité, bleu de travail, casque et lunettes, on les a et on est autorisé à en prendre chez le fournisseur sans demander, à ce niveau là c’est cool, mais c’est aussi le minimum syndical donc c’est normal.
Mes patrons sont clairement des bourges pour le coup, mais humainement ça va, disons que peu importe le patron : dans le secteur du pavillon neuf, il y a toujours des manquements à la sécurité et quand j’en parle autour des moi a d’autre couvreur je me rends compte c’est généralement partout pareil, dans l’Oise en tout cas.
Ce système est horrible et je ne trouve pas comment en sortir
mise en ligne le 6 juin 2025
Gardanne,
Chapelle-Darblay :
le deux poids, deux mesures
de la réindustrialisation
Thomas Coutrot sur www.politis.fr
Une subvention de 800 millions d’euros accordée pour relancer une centrale biomasse à la réussite douteuse. Et cinq ans d’attente pour un prêt de 27 millions d’euros visant à redémarrer une usine de recyclage de papier. Comment expliquer cette différence de traitement ?
En novembre 2024, l’État a annoncé une subvention de 800 millions d’euros pour la relance de la centrale biomasse de Gardanne. Ce soutien massif contraste étrangement avec son refus, toujours persistant à ce jour, d’accorder un simple prêt de 27 millions d’euros via la Banque publique d’investissement (BPI) pour la relance de la papeterie Chapelle-Darblay à Grand-Couronne (Seine-Maritime), fermée depuis cinq ans.
La centrale biomasse de Gardanne est pourtant dénoncée par les associations environnementales comme un désastre écologique : elle brûle 450 000 tonnes de bois par an, dont un tiers importé, avec un rendement énergétique inférieur à 30 %. Autrement dit, deux arbres brûlés sur trois ne font qu’émettre du CO2 sans produire d’électricité. Elle émet des particules fines sur le territoire avoisinant et pousse à un extractivisme forestier, comme le dénoncent de nombreuses associations locales. Une enquête publique se déroule en ce moment auprès de 324 communes touchées, et pourrait renforcer la mobilisation citoyenne.
En revanche, l’impact écologique positif de la relance de Chapelle-Darblay ne fait pas débat. L’usine pourrait recycler 480 000 tonnes de papiers usagés pour produire du carton et stopperait l’aberration écologique actuelle : depuis cinq ans, le contenu des poubelles jaunes de l’Ouest de la France est envoyé par camions en Allemagne et en Italie pour y être recyclé.
Dans les deux cas, la CGT locale et nationale s’est mobilisée pour défendre l’emploi et l’environnement. La CGT de Gardanne a élaboré, en lien avec des ONG, un projet industriel réduisant fortement l’usage de la biomasse et prévoyant le développement de la production de biogaz. La CGT de Chapelle-Darblay a travaillé avec Greenpeace pour présenter une argumentation irréfutable sur les bénéfices environnementaux de la relance de la papeterie.
L’État s’est fortement engagé pour Gardanne, mais n’a pas conditionné son soutien à la mise en œuvre du projet alternatif porté par la CGT. Les emplois pourraient être sauvés mais pas l’environnement. Comment expliquer ce deux poids deux mesures ? L’actionnaire de Gardanne est EPH, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a fait fortune en rachetant des centrales à charbon en fin de vie. Il dispose d’un fort poids politique, notamment via son groupe de presse. Il a fermé la centrale à charbon de Gardanne en 2021 au profit de celle à biomasse, conformément aux promesses du candidat Macron en 2017. Élu président, celui-ci veille à assurer la survie de la nouvelle centrale, même si son bilan écologique est à peine moins désastreux.
La Chapelle-Darblay dispose manifestement de moins d’amis dans les hautes sphères gouvernementales.
À la Chapelle-Darblay, l’actionnaire est le groupe canadien Fibre Excellence, soutenu par les collectivités locales, qui ont même réquisitionné le foncier pour empêcher la vente de l’usine par son précédent actionnaire. Mais le projet dispose manifestement de moins d’amis dans les hautes sphères gouvernementales. Lassé d’attendre, Fibre Excellence a lancé un ultimatum à l’État, soutenu par les syndicalistes CGT (1). Souhaitons qu’ils soient enfin entendus.
mise en ligne le 6 juin 2025
Terrorisme
d’extrême droite :
cette menace qui inquiète (enfin) le renseignement
Bruno Rieth, Florent LE DU ,Anthony Cortes et Elisabeth Fleury sur www.humanite.fr
L’attentat de Puget-sur-Argens (Var) rappelle la réalité de la violence identitaire. Un danger identifié par les services de renseignements. Comment s’est passée cette montée en puissance de l’ultradroite ? Et pourquoi les gouvernements successifs y sont si longtemps restés sourds ? Explications.
C’est un peu après 22 heures, ce samedi 31 mai, à Puget-sur-Argens (Var), que Christophe B., âgé de 53 ans, démarre son périple meurtrier. À bord de sa Nissan Navara, il emporte deux armes de poing semi-automatiques, deux armes d’épaule, quatre chargeurs garnis de munitions, et plus de 1 000 munitions. Quelques minutes plus tard, il croise un premier voisin, de nationalité tunisienne : Hichem Miraoui.
Sans sortir de son véhicule, il le tue en faisant feu à plusieurs reprises. Il reprend sa route et à 22 h 26, crible la baie vitrée d’un logement de la résidence. Alertés par les détonations, deux des occupants sortent et essuient les tirs de Christophe B. L’un des deux, Kurde né en Turquie, est blessé à la main. Le tireur est interpellé le lendemain, à 5 h 10. Un meurtre raciste ? Pas seulement. Un « attentat terroriste », selon le Parquet national antiterroriste (Pnat) qui s’est saisi de l’affaire. C’est la première fois, depuis sa création en 2019, que le Pnat ouvre une enquête pour un attentat d’extrême droite.
Terroristes solitaires
Depuis 2017, 20 dossiers ont été ouverts, mais jusqu’ici uniquement pour des actes préparatoires. Cet attentat, inédit, concrétise tristement les inquiétudes des services de renseignements français depuis plusieurs années. L’ultradroite compterait entre 2 000 et 3 000 individus, dont 1 300 sont fichés S, selon une source proche des renseignements.
« L’ultradroite suit la même évolution que les mouvements terroristes islamistes. Ces dernières années, de nombreux groupes ont été démantelés. Le risque, c’est qu’on se retrouve avec de plus en plus d’individus isolés qui passent à l’acte », indique notre interlocuteur. Les exemples de terroristes solitaires ne manquent pas en Europe et aux États-Unis. Cette menace éclate au grand jour avec l’attentat perpétré en 2011 par le néonazi Anders Breivik en Norvège.
Le premier d’une longue liste : la fusillade de l’église à Charleston (États-Unis) en 2015, Munich (Allemagne) en 2016, Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 2019, Hanau (Allemagne) en 2020… La France a aussi connu des attaques similaires sans pour autant être qualifiées de terroristes. Comme la fusillade de la rue d’Enghien, fin décembre 2022, qui avait visé des militants kurdes, faisant trois morts et quatre blessés.
Un rééquilibrage des missions du renseignement
En tant que premier procureur de la République antiterroriste de 2019 à 2024, Jean-François Ricard a été à l’origine de cette décision. S’il confie à l’Humanité avoir immédiatement placé la menace de l’ultradroite parmi ses plus grandes inquiétudes, la jugeant « capable de tuerie de masse », il affirme ne rien regretter, brandissant la « doctrine » du Pnat qu’il a participé à élaborer. « Il peut y avoir des dossiers d’actions idéologiques violentes qui ne peuvent être qualifiées de terroristes, se justifie-t-il. La fusillade de la rue de Enghien est un cas typique où nous sommes dans l’épaisseur du trait. Les faits peuvent laisser penser qu’il s’agit d’un acte terroriste, mais la personnalité perturbée de l’auteur le contredit. »
Et de poursuivre : « Pour que le Pnat se saisisse, il faut remplir une batterie de critères. Une proximité avec une organisation terroriste, une certaine gravité des faits, et avoir réfléchi son acte en conscience. » Une analyse qui semble avoir légèrement évolué depuis. Interrogée au sujet de ces affaires qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisine du Pnat, une source judiciaire souffle : « Il ne faut pas regarder des affaires qui datent de quelques années avec les yeux de 2025. »
Dès sa prise de poste, Jean-François Ricard alerte le pouvoir politique sur l’ampleur de la menace identitaire en s’appuyant sur les « éléments de terrain » des renseignements. Non sans difficulté dans un premier temps. « On m’a suspecté d’être un magistrat qui protégeait l’ultragauche », se souvient-il. « Jusqu’en 2018, tout était centré sur la lutte contre la menace islamiste ou presque et cela se justifiait, précise un agent de la DGSI. Ensuite, on entendait en permanence parler de « l’ultragauche », alors que pour nous le danger c’était l’ultradroite, nous l’avons fait savoir. »
Résultat : leurs alertes ont finalement conduit à un « rééquilibrage » encore en cours dans l’appréhension des différentes menaces terroristes. « À partir de 2020, on nous a demandé de nous remettre sur l’ultradroite et de faire remonter à la DGSI les profils qui pourraient virer terroristes », confirme un ex-agent du renseignement territorial (RT).
En poste à l’époque à Beauvau (2018-2020), Christophe Castaner, interrogé par nos soins, ne tient pas à rebondir sur ces alertes. « Je crois que cette conscience était partagée », évacue-t-il. L’ex-ministre précise cependant avoir demandé à ses services de porter « une attention particulière sur la mouvance radicalisée d’extrême droite », notamment en « prenant en compte ce qu’il se passait en Allemagne, où l’essentiel des attentats terroristes était le fait de radicalisés d’extrême droite ». Pour preuve, l’ancien ministre souligne que, sous ses ordres, huit groupes d’ultradroite ont été dissous en 2019.
Une sphère identitaire en ébullition
Comment expliquer cette prise de conscience tardive ? « À partir de 2017, les alertes se sont répétées, avance un autre agent. Jusqu’au moment où nous avons mis au jour l’affaire des Barjols, là on s’est dit que ça devenait sérieux. » À l’époque, ce groupe clandestin est suspecté de préparer des assassinats de musulmans ou d’Emmanuel Macron.
Dans le même temps, les personnes surveillées de longue date et gravitant autour des réminiscences du GUD, des Zouaves, des mouvements néoskinheads (en particulier composé d’anciens du Bastion social, dissous en 2019), affichent une activité renforcée, parfois en lien avec des mouvances étrangères, en particulier allemandes, polonaises ou britanniques, nous rapporte-t-on.
Tout un monde que l’on retrouve bien souvent, selon les agents interrogés, dans les « espaces VIP » des meetings RN ou Reconquête. « À cela s’ajoute le travail constaté des ingérences russes pour faire monter les thèmes identitaires, de lutte civilisationnelle, et les discours racistes, pour accroître le nombre de fâchés », analyse un membre des renseignements.
Cette montée en puissance de l’ultradroite est favorisée par les réseaux sociaux et messageries cryptées type Telegram ou Discord. C’est le cas des Barjols, d’abord nés sur Facebook, ou des membres du « projet Waffenkraft », groupe de néonazis qui avait projeté des attentats contre « les juifs, les musulmans » et des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou l’artiste Médine. Entrés en contact via Discord, ils y ont monté leur projet, avant de se rencontrer physiquement pour un « week-end d’entraînement » en forêt.
Ces réseaux permettent aussi de diffuser cette idéologie raciste, potentiellement violente, alimentant les fameux « loups solitaires », plus difficiles à identifier pour les services de renseignements. « Ces fils de discussion, où se disent les pires horreurs, banalisent à la fois le racisme et les appels à la violence, observe le sociologue Samuel Bouron, auteur de Politiser la haine (la Dispute, 2025). Ils peuvent accélérer les passages à l’acte en ce sens qu’ils endoctrinent, donnent des idées et légitiment des individus enclins à basculer dans la violence en leur montrant qu’ils ne sont pas seuls. » Sur ces groupes publics, n’importe qui peut accéder à des messages tels que cette photo d’un fusil à pompe, légendée : « Remigration ou mise en terre ? » et publiée deux jours après l’attentat de Puget-sur-Argens.
Les discours politiques pointés du doigt
À ce stade de l’enquête, rien n’indique que Christophe B., qui a reconnu avoir tué Hichem Miraoui, fréquentait ces groupes. Son manifeste sous forme de vidéos démontre en revanche l’influence de la libération de la parole raciste, dans les sphères médiatiques et politiques.
« Il y a un sujet sur le discours politique actuel et l’imaginaire qu’il déploie, notamment chez Retailleau et Darmanin, situé entre la matrice identitaire et le propos de bistrot, relève un agent. À la fin ça donne quoi ? Des mecs qui se disent qu’ils peuvent bien tuer des Arabes. »
Un bruit de fond xénophobe qui inquiète les services de renseignements et la justice. Pierre Couttenier, procureur de Draguignan (Var), non loin de Puget-sur-Argens, note une hausse du nombre d’injures à caractère raciste mais témoigne de son impuissance : « Malgré l’affichage politique, rien n’est fait contre le bas du spectre, l’injure raciste, qui n’aboutit jamais à des condamnations. » Le gouvernement doit agir à la racine de la haine raciste. Aujourd’hui, cela revient à exiger du pyromane qu’il éteigne l’incendie.
mise en ligne le 5 juin 2025
Victoire éclatante pour les grévistes de l’hôpital psychiatrique d’Auch
Cécile Rousseau sur www.humanite.fr
Après 23 jours de mobilisation, les grévistes de l’hôpital psychiatrique d’Auch ont arraché, ce 3 juin, une grande partie de leurs revendications.
Le 3 juin, au terme de vingt-trois jours de grève, les blouses blanches du centre hospitalier spécialisé psychiatrique d’Auch (Gers) ont arraché une grande partie de leurs revendications. Le projet de gel de dix lits cet été, faute de personnel, qui avait mis le feu aux poudres, a ainsi été balayé. L’agence régionale de santé s’est aussi engagée à faire le maximum pour trouver des psychiatres dans les structures alentour pour assurer les dix jours de pénurie de garde estivale. Sept psychologues vont également être stagiairisés (en vue de titularisation) alors qu’ils étaient en CDD.
Au total, une trentaine de recrutements ou de redéploiements sont prévus. Pour obtenir cette victoire, des dizaines de soignants se sont succédé pour tenir le piquet 24 heures sur 24 devant l’entrée. Avec une banderole : « 2025, année de la santé mentale, ça commence quand ? »
Certains, comme Annabelle Skowronek, infirmière et élue CGT au CSE, ont enchaîné les nuits dans le camping-car ou la tente. « On est super-satisfaits du résultat mais on a dû déployer une énergie folle juste pour se faire entendre et avoir la garantie de conditions de travail à peu près normales ! » précise la syndicaliste.
mise en ligne le 5 juin 2025
Les dockers de Fos refusent de charger de l’équipement militaire fabriqué en France à destination d’Israël
Théo Bourrieau sur www.humanite.fr
Un cargo israélien fait escale, jeudi 5 juin, près de Marseille, et doit embarquer en secret 14 tonnes de pièces détachées pour mitrailleuses. Fabriqué par la société française Eurolinks, ce matériel militaire est destiné à l’entreprise d’armement Israel Military Industries, révèlent Disclose et le média irlandais The Ditch.
Alors qu’un navire de la Flottille de la liberté est en route pour tenter de percer le blocus de la bande Gaza, chargé d’aide humanitaire, un tout autre type de cargaison risque de bientôt emprunter la même route. Selon une enquête de Disclose et de The Ditch, un cargo israélien va faire escale, jeudi 5 juin, à Fos-sur-Mer, près de Marseille.
Le Contship Era doit embarquer en secret 14 tonnes de pièces détachées pour fusils-mitrailleurs, fabriqué par la société française Eurolinks et destiné à l’entreprise d’armement Israel Military Industries. Jeudi 5 juin, un nouveau volet de l’enquête révèle qu’une autre cargaison doit embarquer dans ce même bateau, composée de pièces détachées produites par la société Aubert et Duval servant à équiper des canons.
Alors qu’Emmanuel Macron promet des sanctions contre Israël, la France, dans le même temps, continue de vendre des armes au gouvernement de Benyamin Netanyahou, responsable du génocide à Gaza. Le ministère des armées français a répondu que « La France ne fournit pas d’armes à Israël ». Cependant, Israël reste un « partenaire », répond le ministère : « On ne va pas se priver ni de sa technologie ni de ses compétences ».
Du matériel utilisé dans le « massacre de la farine » ?
D’après les informations du média d’investigation en ligne et du média irlandais, le navire de commerce doit embarquer 19 palettes contenant des « maillons », des pièces détachées utilisées pour relier entre elles des cartouches d’armes automatiques. L’arrivée du cargo est prévue jeudi 5 juin à 6 heures, son départ, destination le port d’Haïfa, au nord d’Israël, le même jour aux alentours de 23 heures, écrivent les journalistes, dont Ariane Lavrilleux.
L’entreprise à l’origine de la commande est une filiale d’Elbit Systems, l’un des principaux industriels de l’armement israélien, se présente comme « le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense » et fourni l’armée israélienne en munitions, précise les Disclose et The Ditch. D’après eux, il s’agit de la troisième livraison de ce type entre Fos-sur-Mer et Haïfa depuis le début de l’année : la première fois le 3 avril pour une cargaison de 20 tonnes de marchandises, la deuxième le 22 mai. Parmi les maillons livrés, au moins un million est compatible avec le Negev 5, fusils automatiques utilisés dans la bande de Gaza et employé par l’armée israélienne dans le « massacre de la farine », le 29 février 2024 où plus de 100 Palestiniens sont morts.
« Les dockers ne le chargeront pas »
Pour rappel, en mars dernier, une enquête de Marsactu et de Disclose révélait que la France aurait autorisé, fin octobre 2023, la livraison à Israël d’au moins 100 000 pièces du même genre et de la même entreprise susceptibles d’être utilisés contre des civils à Gaza. En octobre 2024, un rapport gouvernemental, dont le contenu a fuité sur Mediapart, confirme que la France a vendu pour 30 millions d’euros d’armes à Israël en 2023.
Toujours selon une enquête de Disclose, une autre entreprise d’armement française, Thales, aurait vendu à l’industrie de l’armement israélien pour 2 millions d’euros de systèmes d’aide au pilotage pour des drones armés, ce que la firme française dément auprès de l’Humanité. Thalès affirme « s’assurer de l’identité des utilisateurs finaux de ces systèmes dans les pays tiers concernés ».
« L’Espagne, elle, annule ses contrats d’armement avec Israël… », rappelle la députée communiste des Hauts-de-Seine Elsa Faucillon. « Les dockers français, fidèles à leur histoire, ne laisseront pas passer cette complicité avec le massacre du peuple palestinien », espère de son côté le député apparenté au groupe Écologiste François Ruffin. Dans le même temps, le Syndicat Général CGT des Ouvriers Dockers et des Personnels Portuaires du golfe de Fos explique avoir trouvé le conteneur chargé de matériel mortel et l’avoir mis de côté.
« Les dockers ne le chargeront pas », affirme le communiqué, ne voulant pas « participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ». « Pour la paix, pour l’arrêt des guerres dans le monde, pour une société débarrassée de l’exploitation capitaliste » termine gravement le syndicat. « Partout dans le monde, la lutte s’organise contre le génocide à Gaza ! », félicite Manuel Bompard, député insoumis de Marseille.
mise en ligne le 4 juin 2025
Espagne: vers une régularisation de près de 500 000 personnes en situation irrégulière
sur https://www.rfi.fr/
C’est officieux, mais c’est certain : le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez se prépare à faire voter une immense régularisation de près de 500 000 migrants en situation irrégulière en Espagne, et ce, alors que bien d’autres pays européens ne pensent qu’à expulser. Le parti au pouvoir reprend ainsi le flambeau d’une initiative législative parlementaire qui a recueilli 800 000 signatures. L’opposition de droite est vent debout.
70 000 étrangers vont bientôt bénéficier d’un permis de séjour et d’un permis de travail en Espagne, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau. C’est la volonté de l’exécutif socialiste pour qui le pays a besoin de main d’œuvre pour son économie au beau fixe, qui connaît une croissance de 2% et avec un taux de chômage qui ne cesse de baisser, grâce principalement au tourisme et aux exportations de services.
On ne connait pas encore les conditions requises, mais il s’agit réellement de légaliser près d’un demi-million d’étrangers sans papiers dans un pays touché par le vieillissement démographique, et avec un taux de natalité parmi les plus bas d’Europe.
Ces régularisations devraient bénéficier à plusieurs secteurs économiques en tension, comme ceux de la construction, de l'agriculture, de l’hôtellerie ou de la restauration. Les étrangers y représentent déjà jusqu’à la moitié des effectifs.
Une initiative populaire reprise par les socialistes au pouvoir
Cela fait un an que cette initiative populaire, citoyenne, est bloquée au Parlement. Elle vient d’être reprise par les socialistes au pouvoir. Pourquoi ? Pour remédier au fait que, depuis l’approbation d’un nouveau règlement sur les étrangers en novembre dernier, de très nombreuses personnes se retrouvent dans l’illégalité, essentiellement les parents étrangers de résidents établis en Espagne et surtout des demandeurs déboutés du droit d’asile.
À droite, la principale formation, le Parti populaire, s’y oppose, mais comme le gouvernement de gauche détient la majorité à la Chambre basse, cela ne devrait pas empêcher cette régularisation massive.
Ces dernières années, l’immigration s’est imposée comme l’un des principaux sujets de débat dans la société espagnole.
"La préfecture est saturée, le tribunal administratif sous l’eau" : la galère d’étrangers pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour à Montpellier
Guy Trubuil sur https://www.midilibre.fr/
Système de dématérialisation pour le renouvellement des titres de séjour, dossiers refusés pour des motifs techniques, absence de contacts directs, délais intenables. Certains demandeurs d’un renouvellement de leur titre de séjour se retrouvent parfois dans des situations très délicates.
"C’est très difficile pour moi, jamais je n’ai connu une telle situation, je tombe des nues." À 61 ans, après cinquante ans passés en France en toute légalité, Yves (1) est aujourd’hui sans titre de séjour. Originaire du Cameroun, il a entamé les démarches de renouvellement de sa carte pour une durée de 10 ans à la fin de l’année dernière, dans les délais impartis, à savoir quatre mois avant l’échéance. "Il s’agissait de ma quatrième demande, les deux fois précédentes, on m’envoyait même des formulaires de demande de naturalisation. Mais cette fois-ci, rien ne s’est passé."
Rupture de droits
Et sa carte de séjour a expiré. Considéré en situation irrégulière, Yves a été radié de France Travail où il était inscrit… Pas de papiers, pas d’indemnités. Comme lui, de nombreux demandeurs d’un renouvellement de titre se retrouvent aujourd’hui désemparés, sans possibilité de travailler ou de voyager et sans recours sinon celui de faire appel à un avocat.
Une voie empruntée par Ludmila (1), une Ukrainienne placée devant l’impossibilité de se rendre en Allemagne pour assister aux obsèques de son père. Après avoir saisi le tribunal administratif sa demande d’une carte pluriannuelle a finalement été acceptée par la préfecture, quelques jours… avant l’audience. Une situation qui n’est pas isolée.
"Il y a tellement de dysfonctionnement que la préfecture n’arrive plus à traiter les dossiers. La préfecture est saturée, le tribunal administratif est sous l’eau mais c’est dramatique pour ces personnes. Certaines n’ont plus de ressources. On se retrouve devant des situations iniques, de rupture de droits" observe Me Julie Moulin. "Parfois, la préfecture octroie des récépissés provisoires, d’un mois, trois mois, renouvelés et ensuite c’est le silence radio de l’administration" ajoute la juriste.
"Même nous qui connaissons les procédures on ne sait jamais sur quel site on doit faire la démarche. Et dans le cadre des démarches simplifiées, la préfecture propose parfois des rendez-vous après l’échéance du titre", relève Thierry Lerch, bénévole à la Cimade. "Moi ce qui m’inquiète c’est le renouvellement des titres de 10 ans pour les personnes âgées" ajoute Alain.
La domiciliation auprès du CCAS remise en cause
Les associations qui interviennent auprès des personnes sans papiers viennent d’écrire à la préfecture pour s’émouvoir d’un changement intervenu dans l’examen des demandes. "Depuis quelques semaines, il est indiqué sur le site qu’en cas de domiciliation de la personne au CCAS, le dossier ne sera pas recevable. On pense que c’est discriminatoire" précise Camille Couturier, chargée de coordination à la Cimade. "Cela va laisser sur le carreau beaucoup de personnes, celles qui vivent dans les bidonvilles, celles qui sont hébergées par le 115" poursuivent la responsable et Thierry Lerch un bénévole.
Pas un justificatif suffisant
La domiciliation permet aux demandeurs de disposer d’une adresse postale, nécessaire pour entreprendre certaines démarches. La Cimade rappelle que les demandes de domiciliation sont elles-mêmes instruites par le Centre communal d’action sociale de Montpellier avant d’être acceptées.
Pour la préfecture, cependant, "la déclaration de domiciliation auprès d’un CCAS ne peut justifier, à elle seule, d’un domicile effectif dans le département." Ses services rappellent la liste des justificatifs acceptés, les factures (eau, gaz…) un bail de location de moins de six mois la taxe d’habitation, une attestation de l’hébergeant… "Ainsi la situation des étrangers domiciliés effectivement par une association sera naturellement prise en compte" précisent-ils en ajoutant qu’une "attention particulière reste portée aux usagers en situation de grande précarité qui n’auraient pas d’autres possibilités de prouver leur résidence sur le territoire".
Explosion du contentieux
Car la démarche passe depuis plusieurs mois par l’Administration numérique des étrangers de France, l’Anef. "C’est une plateforme numérique mais à la moindre difficulté, si un document n’est pas lisible par exemple, cela clôture le dossier. Cela ne fonctionne pas bien. Ce système limite les personnes dans la possibilité de présenter leur situation globale" reprend Me Moulin.
"Pour les personnes qui demandent un titre de séjour car ils ont un emploi on arrive à traiter le problème en amont, avec la préfecture. Mais la principale difficulté c’est pour les femmes isolées avec enfants. Elles obtiennent des récépissés mais parfois en décalage. Il y a des trous pendant lesquels elles ne peuvent pas, par exemple, avoir accès à la CAF" ajoute sa collègue Me Sophie Mazas.
Une "phase transitoire" indique la préfecture
Contactés, les services de la préfecture confirment que la dématérialisation des démarches est actuellement dans "une phase transitoire" entre l’ancien et le nouvel outil qui "induit une augmentation de la charge de travail des services" mais défendent "une réforme nécessaire sur le moyen terme".
Les problèmes rencontrés avec l’Anef, mais aussi la contestation des obligations à quitter le territoire (OQTF) et le durcissement de la politique nationale dans l’octroi des autorisations de séjour, ont eu pour conséquences de faire exploser le contentieux dit des étrangers au tribunal administratif. La juridiction confirme "l’augmentation de 41,3 % de ce contentieux depuis le début de l’année 2025".
Chez les personnes résidant en France depuis des années, le malaise est palpable. "C’est très difficile pour moi. Heureusement que mon amie m’a aidé dans mes démarches. Ce que je regrette c’est qu’on n’a pas d’interlocuteur, seulement des réponses automatiques" déplore Yves. La préfecture rappelle, de son côté que les usagers peuvent télécharger sur l’Anef, une "attestation de prolongation d’instruction". "Ce document prolonge les droits de l’ancien titre de séjour" assure-t-elle.
(1) Prénoms d’emprunt.
mise en ligne le 4 juin 2025
Le Rapport sur les inégalités en France vient de paraitre. Avant-propos, par Louis Maurin
Louis Maurin sur https://www.inegalites.fr/
Le « Rapport sur les inégalités en France » vient de paraitre. À quoi bon dresser un état des lieux factuel et nuancé, quand le débat médiatique ne semble se nourrir que d’exagérations, voire de démagogie ? Dans l’avant-propos de l’ouvrage, Louis Maurin vous présente cette nouvelle publication.
Doit-on continuer à produire un rapport sur les inégalités en France ? La question se pose à l’heure où notre système d’information semble avoir perdu la raison. À droite comme à gauche, la démagogie paraît triompher de tout. Pour susciter l’excitation médiatique, il faut produire du drame, jouer sur les peurs, montrer du doigt tel ou tel bouc émissaire de la France d’en bas le plus souvent, parfois d’en haut.
« Contre les inégalités, l’information est une arme », martelons-nous depuis des années. Que faire de ce slogan si l’information perd son sens, noyée dans le brouhaha médiatique ? Chacun s’enferme dans sa bulle et se conforte dans ses convictions. Il peut sembler bien naïf de croire en la valeur de nos graphiques, tableaux et explications. À notre souci de débattre sérieusement à partir d’opinions différentes. L’heure ne semble plus être à tenter de convaincre ceux qui pensent différemment mais à les soumettre par la violence des arguments.
La réponse est simple : le camp des dominants n’attend qu’une chose, que nous baissions les bras. À force, par exemple, d’intérioriser que l’opinion publique serait devenue raciste, « pauvrophobe » ou « anti-impôts », les défenseurs de l’égalité ont trop souvent battu en retraite. Une forme moderne de « servitude volontaire », pour reprendre l’expression d’Étienne de La Boétie, ce philosophe du XVIe siècle [1].
Contre la marée de la désinformation, nous ne lâcherons rien. Massivement, les Français rejettent les inégalités et plébiscitent la solidarité. De 2002 à 2023, la part de celles et ceux qui pensent qu’il y a des races supérieures à d’autres a été divisée par deux, de 14 % à 7 %. Celle des personnes « tout à fait d’accord » avec l’opinion selon laquelle « il y a trop d’immigrés » a baissé de 28 % à 14 % entre 2016 et 2024. 12 % de la population seulement estime qu’on en fait trop pour les plus démunis.
Pourtant, notre pays bafoue sa devise. Avant impôts et redistribution, la France est l’un des pays les plus inégalitaires parmi les pays riches, juste après les États-Unis et le Royaume‑Uni. Ce n’est que grâce à de puissants mécanismes de solidarité qu’après redistribution, il termine tout juste en milieu de peloton.
Notre modèle social est très loin d’être l’un des plus mauvais du monde : il vaut bien mieux se faire soigner ou étudier en France qu’ailleurs. Il est surtout un modèle d’hypocrisie. Nous ne cessons de prôner l’égalité, pour les autres. Ce décalage entre les discours répétés des pouvoirs publics sur le sujet et le quotidien de la population nourrit des tensions, plus encore que le niveau des inégalités. Il alimente un profond rejet non pas de la politique mais des politiques en place et fait progresser le Rassemblement National.
La plus belle illustration de cette hypocrisie est l’école. Les enfants de diplômés partent avec plusieurs longueurs d’avance. Tout le monde le sait, depuis des décennies. « Les cadors, on les retrouve toujours aux belles places, nickel », chantait Alain Souchon il y a bientôt quarante ans. Aujourd’hui, l’élite scolaire, que constituent les écoles normales supérieures par exemple, recrute toujours plus de deux tiers de ses effectifs parmi les enfants de cadres supérieurs.
En haut de la hiérarchie sociale, tout le monde s’en moque. Depuis les années 1980, aucun gouvernement n’a entrepris de politique d’envergure de démocratisation de l’école. Cette inaction répond à la pression des lobbys des diplômés, en particulier des représentants des lycées d’élite, des classes préparatoires et des grandes écoles. À la sortie du système scolaire, le déclassement à l’embauche, la précarité, la dureté des conditions de travail et bien d’autres éléments minent la vie des exécutants. Cette situation est ressentie d’autant plus violemment que notre pays est l’un des plus riches au monde, que cette richesse est de plus en plus visible, et que ces dernières années ont été marquées par des politiques publiques qui ont nourri les revenus des plus aisés.
On peut continuer à ignorer les alertes que lance l’Observatoire des inégalités depuis plus de 20 ans au fil de ses publications, comme bien d’autres à l’instar de la Fondation pour le logement des défavorisés dans son rapport annuel sur l’état du mal-logement, ou du Secours Catholique au sujet de la pauvreté. Tous documentent l’ouverture lente de la fracture sociale. Dans ce cas, il ne faut pas se plaindre des conséquences politiques de cette surdité. Le prix à payer de la gourmandise des classes aisées et diplômées est le délitement du tissu social et, à terme, un « déchirement du pacte républicain », selon l’expression de l’ancien président de la République Jacques Chirac (discours du 17 décembre 2003). Faute d’actions, c’est exactement ce qui se passe. Une partie des classes dirigeantes, malgré ses cris d’orfraies devant l’arrivée possible de l’extrême droite au pouvoir, semble ne pas s’en inquiéter : il faut dire qu’elles en seraient les premières bénéficiaires.
De la lutte contre le racisme à celle contre l’échec scolaire, de l’aide aux plus démunis à l’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les forces de combat contre les inégalités sont d’une tout autre puissance que le militantisme xénophobe et autoritaire. Des millions de bénévoles y sont engagés tous les jours. L’urgence aujourd’hui est de mettre en place les moyens d’un rassemblement très large autour de valeurs communes au lieu de s’entredéchirer et de pointer du doigt des boucs émissaires. La vocation de notre rapport est de servir de base de discussion solide, pour défendre des politiques publiques de justice sociale.
[1] Voir Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie, édition établie par Anne Dalsuet et Myriam Marrache-Gourand, Folio, éd. Gallimard, avril 2025.
|
Commander ou télécharger l’ouvrage complet |
|---|
|
Rapport sur les inégalités en France, édition 2025.
|
Les enseignements du « Rapport sur les inégalités, édition 2025 »
Tous les deux ans, l’Observatoire des inégalités publie un panorama complet des disparités qui fracturent notre société. Revenus, éducation, travail, modes de vie, territoires : l’ouvrage analyse méthodiquement les écarts en s’appuyant sur les données les plus récentes. Anne Brunner en repère des faits saillants et les évolutions récentes.
Le constat n’est pas nouveau : les catégories populaires, composées d’ouvriers, d’employés, de personnes peu diplômées et souvent peu qualifiées, subissent les exigences de flexibilité d’une société prospère, confortable pour une large classe favorisée. La fracture passe par les conditions de travail notamment. 35 % des salariés connaissent au moins trois critères de pénibilité physique à leur poste, une proportion qui n’a pas baissé en quinze ans. Cela concerne dix fois plus les ouvriers que les cadres. L’injustice est d’autant plus grande que notre pays est aussi l’un des plus inégalitaires dans le domaine de l’éducation. Année après année, les tests de niveaux scolaires montrent à quel point l’école française profite beaucoup plus aux enfants de parents diplômés qu’à ceux de milieux populaires.
Au final, le milieu social des parents est le facteur qui a la plus grande répercussion sur les revenus perçus à l’âge adulte, bien plus encore que le sexe, le fait d’avoir grandi dans un quartier défavorisé ou d’avoir des parents immigrés. Bien sûr, tous ces facteurs peuvent se cumuler. Bien sûr aussi, le déterminisme n’a rien de systématique, bien des exceptions confirment la règle. Mais ce chiffrage montre le poids de la reproduction des inégalités d’une génération à l’autre, de façon incontestable. À ce constat s’ajoutent des phénomènes nouveaux. Les résultats des derniers travaux de la recherche doivent servir d’électrochoc : les filles ont de moins bons résultats en mathématiques que les garçons dès l’école primaire. Et l’université ne se démocratise plus. Deux signaux qui alertent sur l’urgence à repenser l’école et ses objectifs.
Le rapport que nous venons de publier apporte aussi de bonnes nouvelles, souvent passées sous les radars des médias qui ne s’attardent guère sur le sort des plus modestes. Soulignons par exemple cette amélioration : le taux de chômage dans les quartiers prioritaires a diminué de 25 % en 2014 à 18,3 % en 2022, soit une baisse de 6,7 points, tandis qu’il a reculé de 2,6 points dans les autres quartiers (de 10,1 % à 7,5 %). Cela signifie que l’écart tend à se réduire entre les territoires les plus défavorisés et le reste de la France. L’évolution est d’autant plus importante à noter que ces quartiers sont ceux de l’habitat social qui accueille les populations les plus démunies et voit souvent déménager ceux qui s’insèrent le mieux dans l’emploi. Les lieux les plus en difficulté ne sont pas éternellement destinés à le rester.
Et demain ?
Nos données les plus récentes sur les niveaux de vie et l’éducation portent sur l’année 2022. Celles sur l’emploi, le plus souvent sur 2023. Depuis, l’inflation a persisté encore quelques mois, le chômage semble repartir à la hausse et l’économie mondiale est secouée par la brutalité et l’imprévisibilité du président des États-Unis. Les événements des derniers mois ont-ils fait évoluer ces indicateurs et dans quel sens ? Il faudra attendre la prochaine édition de ce rapport pour en mesurer les effets. Partageons tout de même quelques éléments qui doivent à la fois éviter de tomber dans l’exagération et alerter.
Malgré le ralentissement économique, les augmentations de salaires se sont poursuivies au cours des deux dernières années, en léger retard par rapport à la hausse des prix. Le revenu par personne a même gagné du pouvoir d’achat (0,3 % sur l’année 2023, puis 1,9 % en 2024 selon l’Insee). Mais cette évolution globale pourrait masquer un accroissement des inégalités, entre ceux qui ont pu négocier une hausse de salaire et les autres, notamment. Cependant, rien n’indique une explosion des écarts.
Le « mal-emploi » continue à miner notre société et à attiser les tensions sociales
Du côté des plus modestes, la baisse du nombre d’allocataires du RSA s’est arrêtée en septembre 2024. Le nombre de personnes qui perçoivent une allocation pour chômeurs en fin de droits augmente, ainsi que celui des allocataires du minimum pour les personnes handicapées. La catégorie qui voit sa situation le plus se dégrader est sans doute celle des plus démunis et des plus mal logés. En grande partie parce que les étrangers en situation irrégulière sont laissés sans ressources et écartés du droit de travailler. En matière d’inégalités au travail, nous faisons face à au moins trois incertitudes : la première porte sur le chômage. Sa remontée récente sera-t-elle durable ? Va-t-elle, à nouveau, entraîner un élargissement des écarts entre les jeunes, les moins diplômés, les immigrés et une large classe de cadres supérieurs et de professions intermédiaires qui bon an, mal an bénéficient d’une bien meilleure stabilité ?
La deuxième incertitude porte sur l’emploi précaire, qui continue à augmenter. La baisse du chômage est due en partie au développement de l’apprentissage pour les jeunes, une politique extrêmement coûteuse et qui atteint aujourd’hui ses limites. Si la précarité augmente lorsque le chômage baisse, alors le « mal-emploi » continue à miner notre société et à attiser les tensions sociales.
Troisième doute : la volonté politique sera-t-elle au rendez-vous d’une lutte ferme contre les discriminations et d’un allégement, ou au moins d’une prise en compte, de la pénibilité du travail des ouvriers et employés ? Les employeurs font peu d’efforts s’ils n’y sont pas contraints par la réglementation.
Ancrée dans le travail et l’école, la fracture sociale traverse nos modes de vie : déplacements, maintien du logement à une température acceptable et, in fine, espérance de vie. À l’avenir, il faudra à la fois réduire les inégalités sociales et les dégradations faites à l’environnement si l’on veut préserver le sort des générations futures. Pour cela, il faut regarder les choses en face et les affronter. On ne pourra se contenter de viser les seuls modes de vie néfastes des ultra-riches. Un effort collectif doit être fait, mais il n’est possible que s’il est largement expliqué et tient compte des besoins des plus défavorisés.
mise en ligne le 3 juin 2025
Racisme :
le silence complice de Retailleau
Pierre Jacquemain sur www.politis.fr
Alors que les crimes et délits racistes de l’extrême droite sont parmi les premières menaces qui pèsent sur la France, le ministre de l’Intérieur préfère regarder ailleurs, quitte à mettre en péril la République.
Dans la nuit du 30 mai, des membres du groupuscule du Bloc montpelliérain ont fait irruption dans un bar associatif de la ville d’Alès, dans le Gard, agressant plusieurs personnes et semant la terreur. Un acte d’une rare violence et qui, comme les événements récents en attestent – depuis le crime raciste qui a coûté la vie à Djamel Bendjaballah le 31 août 2024 au meurtre à caractère raciste du 1er juin à Puget-sur-Argens, dans le Var, en passant par le meurtre islamophobe d’Aboubakar Cissé le 25 avril dernier –, n’est pas isolé.
Bruno Retailleau semble avoir une vision sélective des menaces en cours.
Ces actes s’inscrivent dans une recrudescence alarmante des agressions et des crimes haineux, frappant des personnes racisées, des militants antifascistes, des journalistes, des élus ou de simples citoyens engagés contre l’extrême droite. Une violence souvent banalisée, qui est pourtant le symptôme d’une radicalisation qui s’installe durablement dans le paysage politique français à mesure que l’extrême droite s’institutionnalise. Elle n’est donc pas le fait de groupuscules isolés, mais d’un mouvement structuré qui bénéficie d’une forme de tolérance, voire de bienveillance institutionnelle et médiatique.
À ce titre, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, semble avoir une vision sélective des menaces en cours. Son trop long silence face à l’agression d’Alès – il était pourtant interpellé par de nombreux responsables politiques – est révélateur de ses indignations à géométrie variable. Alors qu’il appelle à une « extrême vigilance » face à la menace terroriste et insiste sur la protection de certains lieux de culte, il semble délibérément écarter la menace de l’extrême droite. Cette partialité dans la condamnation des actes de violence met à mal la confiance des citoyens dans nos institutions et alimente un sentiment d’impunité de l’extrême droite.
Une instrumentalisation des faits
Il est toujours plus prompt à dénoncer « l’islam » ou les jeunes des quartiers populaires qu’à condamner les milices d’extrême droite qui défilent en toute impunité. Beaucoup plus prompt, encore, à dénoncer l’antisémitisme en pointant du doigt les musulmans ou la gauche radicale, qualifiant l’antisémitisme d’extrême droite de « résiduel ». Une affirmation pourtant contredite par de nombreux rapports sur le sujet, à commencer par ceux, récents, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui a documenté la hausse significative des actes antisémites et racistes perpétrés par des groupes d’extrême droite.
Cette instrumentalisation des faits est
d’autant plus choquante qu’elle s’accompagne d’une politique de répression systématique des mouvements sociaux, qu’il s’agisse des syndicats ou des associations de défense des droits humains. Les
militants antifascistes sont régulièrement ciblés, fichés, interpellés,
tandis que les agresseurs d’extrême droite semblent bénéficier d’une plus grande clémence. Une situation qui s’inscrit dans un contexte international où l’extrême droite connaît une ascension
préoccupante : de l’Italie à la Hongrie en passant plus récemment par la Pologne, de l’Argentine aux États-Unis – pays qui connaissent une hausse vertigineuse des violences racistes –, les
régimes autoritaires et les discours de haine se propagent à grande vitesse.
Nier le fait que l’extrême droite est la première menace qui pèse en France, c’est abandonner la République.
En France, ces actes racistes, antisémites, islamophobes, xénophobes ou antireligieux – y compris dans les écoles – ont tous augmenté. Dans le même temps, le taux de plainte est resté très faible. La preuve que nos institutions ne sont pas à la hauteur des drames qui s’intensifient. Qu’elles ne protègent pas. Ni ne rendent justice. Que le ministre de l’Intérieur, par son silence complice, est le patron d’un parti qui n’a plus de républicain que le nom. Parce que nier le fait que l’extrême droite est la première menace qui pèse en France, c’est abandonner la République.
mise en ligne le 3 juin 2025
Plus de 30 Palestiniens tués par Israël près d’un centre d’aide humanitaire à Gaza : l'ONU exige « une enquête internationale indépendante »
Bruno Odent sur www.humanite.fr
Lundi 2 juin, des civils palestiniens rassemblés près d’un centre de distribution de nourriture dans le sud de la bande de Gaza ont été la cible de tirs. Bilan : plus d’une trentaine de morts et 180 blessés. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterrez, exige une enquête internationale.
Des tirs israéliens ont visé plusieurs centaines de civils rassemblés à l’aube du 2 juin dans le sud de la bande de Gaza près d’un centre de distribution d’aide alimentaire. Le bilan ne cesse de s’alourdir et s’élève désormais à plus de 30 morts et à quelque 180 blessés. Face à ces nouvelles atrocités, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réagi en appelant à « une enquête internationale indépendante » et en exigeant que les auteurs de ces crimes soient « tenus pour responsable ».
Les distributions d’aides sont entre les mains exclusives, depuis plus d’une semaine, d’une obscure organisation israélienne soutenue par Washington. Baptisée Fondation Humanitaire de Gaza (GHF), celle-ci prétend avoir distribué plusieurs millions de repas aux habitants menacés par la famine. Mais son déploiement a été le plus souvent marqué par des scènes chaotiques et l’enregistrement, déjà, de tirs israéliens sur des civils à proximité des lieux où ces vivres sont délivrés.
Des gens couverts de sang
« La distribution de l’aide est devenue un piège mortel », a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Unrwa (Office de secours des Nations unies aux réfugiés palestiniens). Pour toute réponse, Tel-Aviv s’est une nouvelle fois contentée d’insulter les dirigeants de l’ONU, estimant que leur demande d’enquête constituait une « honte », car la preuve d’une collusion avec le mouvement islamiste palestinien du Hamas.
Cependant une source militaire israélienne a contribué à jeter elle-même le doute sur le crédit qu’il convient d’accorder à ce discours officiel. Elle reconnaît des tirs dits de sommation vers des individus sortis de la foule et qui se seraient faits menaçants « à l’encontre des soldats ».
L’AFP a pu recueillir plusieurs témoignages de personnes qui se trouvaient sur la zone. Il était « 5 heures ou 5 h 30, avant le lever du jour » lorsque les tirs ont éclaté près du rond-point Al-Alam, où une foule s’était rassemblée avant de se rendre au centre de GHF, situé à environ un kilomètre de là. « Bien sûr, c’est l’armée israélienne qui a tiré à balles réelles. La peur et le chaos régnaient », relève un premier témoin qui demande à conserver l’anonymat. Un autre, Mohammed Abou Deqqa, 35 ans, raconte : « Au début, nous avons pensé qu’il s’agissait de tirs d’avertissement. Mais j’ai commencé à voir des gens allongés au sol, couverts de sang. »
Les lieux mêmes de distribution de nourriture obéissent, selon plusieurs médias israéliens, à une plus vaste stratégie d’évacuation des populations gazaouis. Tous sont situés dans le sud, ce qui oblige les populations à quitter le nord de l’enclave avant d’être poussées à un départ définitif.
Gaza : la distribution d’aide humanitaire tourne au massacre
Gwenaelle Lenoir sur www.mediapart.fr
Le nouveau système de distribution voulu par Israël et les États-Unis tue ceux qu’il est censé sauver. Plus de 72 personnes ont été tuées et des centaines blessées depuis une semaine par des tirs de l’armée israélienne alors qu’elles attendaient les colis alimentaires.
La Fondation humanitaire pour Gaza (Gaza Humanitarian Foundation, GHF) est plus douée pour la réalité alternative et la propagande que pour la distribution de l’aide alimentaire à des gens affamés. « L’aide a de nouveau été distribuée aujourd’hui sans incident », se satisfait-elle dans Times of Israel dimanche 1er juin. Ajoutant : « Les informations faisant état de blessés et de morts sont totalement fausses et inventées de toutes pièces. »
De son côté, et en appui des dires de GHF – ou inversement –, l’armée israélienne a nié avoir tiré. Comme d’habitude lors de ce genre de circonstances, tirs sur des civils ou secouristes désarmés avec un nombre de victimes important, elle a assuré qu’une « enquête est en cours ».
Sauf qu’au même moment, des dizaines de témoignages indiquent que les personnes qui se pressaient devant deux centres de distribution ouverts par GHF, l’un à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et l’autre près du checkpoint de Netzarim, qui sépare le nord et le sud de l’enclave, ont essuyé des tirs de drones, de chars et de soldats israéliens.
Certains sont rapportés par l’ONG Médecins sans frontières présente dans l’hôpital Nasser de Khan Younès. Les équipes médicales ne réussissent pas à faire face à l’afflux de blessés. Celui-ci est insoutenable dans l’état de pénurie absolue dans lequel se trouve l’établissement à cause du blocus quasiment hermétique mis en place par les autorités israéliennes depuis le 2 mars. « Les banques de sang étant presque vides, le personnel médical a dû lui-même donné du sang », écrit l’ONG.
« Contrairement à ce que j’ai vu auparavant, où la plupart des patients étaient des femmes et des enfants, aujourd’hui il y avait surtout des hommes. […] Ils avaient des blessures par balle au niveau des membres et leurs vêtements étaient imbibés de sang », explique Nour Alsaqa, responsable de la communication chez MSF dans le même texte.
Ce sont les hommes, principalement, qui se rendent dans les centres de distribution ouverts par GHF la semaine dernière, en espérant rapporter un colis de nourriture.
Mourir pour un sac de farine
Car c’est bien, une nouvelle fois, et contrairement à ce qu’affirme GHF, en allant chercher de quoi manger que ces personnes ont été tuées ou blessées.
« La GHF a annoncé sur sa page Facebook, qu’elle vient d’ouvrir, qu’elle allait “bientôt” distribuer de l’aide dans deux centres, à Rafah et à Netzarim, explique depuis Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza à Mediapart Eyad Amawi, membre du Comité de secours de Gaza. Vous savez, les gens ont faim, ici, leurs enfants meurent de faim. Ils n’ont pas la patience d’attendre l’heure exacte, ils n’en peuvent plus. Alors ils y sont allés par milliers pour espérer récupérer quelque chose, dès l’aube. »
La Fondation humanitaire pour Gaza avait vanté, avec l’ouverture de centres de distribution gardés par des mercenaires de la société états-unienne SRS, un tout nouveau système d’aide, une organisation au millimètre, avec enregistrement des bénéficiaires et détection faciale, pour que pas un sac de farine ne tombe entre les mains du Hamas. Le détournement de l’aide, jamais prouvé, était en effet la justification israélienne pour abattre le système traditionnel mis en place par l’ONU et les grandes ONG internationales, relayées sur le terrain par une myriade d’ONG nationales.
Les gens se battaient pour cinq palettes de nourriture. On nous a dit d’en prendre, puis on nous a tiré dessus de tous les côtés. Ça, ce n’est pas de l’aide. C’est un piège. Mansour Sami Abdi, rescapé
Le résultat est inversement proportionnel aux efforts de communication déployés par les promoteurs de cette nouvelle organisation. « Ce ne sont pas des centres de distribution d’aide, ce sont des sortes de bases militaires ! Ils ne répondent à aucun des critères professionnels de l’humanitaire, assure à Mediapart Amjad al-Chawa, directeur de la plateforme des ONG palestiniennes, depuis la ville de Gaza. Il n’y a aucune organisation mise en place, aucune base de données, rien du tout. Quand on fait de l’humanitaire, on va au plus près des gens qui ont besoin d’aide, on ne les fait pas marcher des heures et des heures pour atteindre un lieu qui n’est ni sûr ni organisé, alors qu’ils ont faim ! Vous savez, il faut deux heures et demie de marche, quand on est à Khan Younès, pour arriver à leur centre à Rafah, là où ils ont tiré sur les gens affamés qui n’en peuvent plus d’entendre leurs enfants pleurer de faim. »
« Quand on arrive au camp, il y a très peu d’aide à distribuer, et aucune organisation, alors les gens poussent, et les plus costauds se servent, reprend Eyad Amawi. J’ai un voisin, un jeune homme, il a réussi à prendre plusieurs cartons. »
Le chaos domine et sans doute, de la part des mercenaires de SRS et de l’armée israélienne, la peur de voir les centres submergés par la foule, comme c’est arrivé le premier jour des opérations de GHF.
Sans parler de la déshumanisation affolante des personnes affamées, littéralement traitées comme du bétail, comme lorsqu’un drone survole la foule qui se presse devant un centre de distribution il y a trois jours pour annoncer : « Nous invitons nos concitoyens à rester à l’écart du site. Il n’y aura pas de distribution d’aide aujourd’hui. Veuillez respecter les règles pour votre sécurité. » L’humiliation ajoutée à la faim.
« À Rafah, quand les gens sont arrivés devant le centre, l’armée israélienne, qui est positionnée juste derrière les entrepôts de GHF, a envoyé des drones quadricoptères tirer dans la foule, complète Eyad Amawi. À Netzarim, les soldats israéliens sont aussi juste à côté du centre, ils ont fait feu avec leurs fusils et les chars. »
La défense civile de Gaza a fait état de 31 morts et de 170 blessés à Rafah, un mort et plus d’une douzaine de blessés à Netzarim.
« Les gens se battaient pour cinq palettes de nourriture. On nous a dit d’en prendre, puis on nous a tiré dessus de tous les côtés. J’ai couru 200 mètres avant de me rendre compte que j’étais blessé. Ça, ce n’est pas de l’aide. C’est un piège. Qu’est-ce qu’on est censés faire : chercher de la nourriture pour nos enfants et mourir ? », témoigne auprès de MSF un rescapé de la fusillade, Mansour Sami Abdi, père de quatre enfants.
Un autre, Mohamed Daghmeh, raconte, toujours à MSF : « J’ai reçu une balle à 3 h 10 du matin. Comme nous étions pris au piège, j’ai saigné en continu jusqu’à 5 heures. Il y avait beaucoup d’autres hommes avec moi. L’un d’entre eux a essayé de me sortir de là. Il a reçu une balle dans la tête et est mort sur ma poitrine. Nous n’étions là que pour de la nourriture, juste pour survivre, comme tout le monde. »
Ils ont détruit le système humanitaire que nous avons mis des années à construire, les ONG internationales et nationales, pour arriver à ce chaos-là. Amjad al-Chawa, directeur de la plateforme des ONG palestiniennes
Les mêmes scènes de foule et de tirs se sont répétées le 2 juin à Rafah. Au moins trois personnes ont été tuées. « Ça ne peut que se reproduire encore et encore si ces conditions sont maintenues, affirme Amjad al-Chawa. Les gens sont sous pression, ils s’attroupent dès l’aube, que voulez-vous qu’il se passe ? C’est un chaos voulu, organisé. Ils ont détruit le système humanitaire que nous avons mis des années à construire, les ONG internationales et nationales, pour arriver à ce chaos-là. »
Dans la bande de Gaza, le chaos est partout, tout le temps. L’autorité politique et l’armée israélienne ont annoncé renforcer encore l’opération « Chariots de Gédéon » lancée le 16 mai. Même objectif affiché depuis vingt mois : anéantir le Hamas.
Sur le terrain, ce sont des familles entières, des immeubles, des quartiers, des tentes de réfugié·es, qui sont anéantis. Rien que lundi 2 juin, des images terrifiantes parcourent les réseaux sociaux.
Le porte-parole de la défense civile avec une dépouille d’enfant dans les bras après le bombardement de la maison de la famille al-Bursh à Jabalia, 14 morts et 20 personnes coincées sous les décombres. Les regards horrifiés et hagards de douleur des blessés transportés à dos d’homme après le bombardement d’abris à Al-Mawassi, la zone vers laquelle l’armée essaie de pousser les habitant·es de l’enclave. La liste des dix villages et quartiers totalement ou partiellement rasés à Rafah et Khan Younès en trois semaines. L’annonce de la destruction du seul établissement médical pour les dialyses dans le nord de la bande de Gaza. Celle de l’attaque de l’enceinte de l’hôpital européen par les forces israéliennes.
Le chaos et la mort règnent, et l’espoir disparaît à peine survenu. La dernière proposition émise par Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Donald Trump, à savoir la libération de dix captifs israéliens vivants retenus dans la bande de Gaza par le Hamas et d’un certain nombre de dépouilles, contre deux mois de cessez-le-feu, avait reçu l’aval des autorités israéliennes en fin de semaine dernière. Le mouvement islamiste palestinien, dans sa réponse donnée samedi dernier, avait également accepté, ajoutant comme condition la fin de la guerre. « Inacceptable », a déclaré l’envoyé états-unien, reflétant une fois de plus la position israélienne.
Depuis, il est dit haut et fort que les négociations se poursuivent. En attendant, les Gazaoui·es meurent, de faim, par manque de soins, sous les tirs et les bombardements.
Selon le ministère de la santé de Gaza, 54 470 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7-Octobre et 124 693 blessées. 14 000 sont considérées disparues, sous les décombres.
j
mise en ligne le 2 juin 2025
Suspension des allocations
pendant 1 à 4 mois : voici
les nouvelles sanctions ciblant les chômeurs
Hayet Kechit sur www.humanite.fr
Six mois après l’entrée en vigueur de la loi pour le plein emploi, son volet sanctions, condamné unanimement par les associations et les syndicats, a été formalisé dans un décret publié le 31 mai au Journal officiel. Il prévoit la suspension d’au moins 30 % de l’allocation des demandeurs d’emploi, dont les bénéficiaires du RSA, pour une durée allant jusqu’à quatre mois.
Ce n’était qu’une question de temps. Six mois après l’entrée en vigueur de la loi pour le plein emploi sur l’ensemble du territoire, son volet « sanctions » a finalement été formalisé ce samedi 31 mai, à travers un décret publié au Journal officiel. Les demandeurs d’emploi n’échapperont donc pas à ce qui est considéré comme la disposition la plus délétère de cette réforme.
Cette loi impose depuis janvier dernier une inscription d’office dans les fichiers de France Travail à l’ensemble des 1,2 million d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA), mais aussi aux 1,1 million de 16-25 ans suivis par les missions locales, ainsi qu’aux 220 000 personnes en situation de handicap qu’épaule Cap emploi. Tous sont tenus de se plier à 15 heures d’activité hebdomadaire, via un contrat d’engagement, sous peine de représailles, détaillées dans ce décret.
Il permet de dissiper quelque peu le flou entretenu autour de ce nouveau régime de sanctions que l’exécutif nomme pudiquement « dispositif de suspension-remobilisation ». Concrètement, ne pas respecter « le contrat d’engagement », en se soustrayant notamment aux quinze heures d’activité hebdomadaire, coûtera aux demandeurs d’emploi « la suspension d’au moins 30 % » de leur allocation pour une durée d’un à deux mois, qui pourra s’étendre jusqu’à quatre mois, en cas « de manquements répétés », indique le décret.
Mesure infantilisante et stigmatisante
Il s’agirait là « d’une nouvelle logique de sanctions proportionnées, graduelles, non-automatiques et réversibles », assure, dans un communiqué, le ministère du Travail, selon qui ce décret préserverait « les garanties essentielles aux droits des personnes », notamment « les bénéficiaires du RSA ayant à leur charge une famille » pour qui serait prévu « un plafonnement à 50 % de la part de leur revenu pouvant être suspendue ou supprimée ».
Si pour la ministre du Travail Catherine Vautrin, l’introduction de ce nouveau régime de sanctions serait incontournable dans l’objectif de « favoriser une remobilisation pour un retour rapide à l’emploi », les associations, les syndicats, et la Défenseure des droits, ne l’entendent pas ainsi et continuent de dénoncer unanimement une mesure infantilisante et stigmatisante, en rupture avec les principes fondamentaux au cœur du système français de protection sociale.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) l’a pour sa part réaffirmé dans une déclaration rendue publique, le 19 décembre 2024, où elle s’insurgeait contre une mesure jugée « attentatoire aux droits humains ». À savoir : le droit à des « moyens convenables d’existence » prévu dans le préambule de la Constitution de 1946 et le droit à « une insertion sociale et professionnelle librement choisie » inclus dans la charte sociale européenne. L’institution pointe en outre « une relégation inacceptable des droits humains derrière les priorités économiques dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales ».
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), instance placée auprès du Premier ministre et composée des principaux acteurs institutionnels et associatifs impliqués sur ces sujets, a aussi donné de la voix, en mai, critiquant vertement ce nouveau régime de sanctions, susceptible à ses yeux « d’impacter durement les parcours des allocataires du RSA et d’accentuer les inégalités de traitement ».
mise en ligne le 2 juin 2025
Gauche : la cata de 2027,
ça commence maintenant
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
La présidentielle est dans deux ans. La gauche prend le risque d’une division et d’une énième défaite. La débâcle se joue dès aujourd’hui.
La semaine dernière fut catastrophique. L’Assemblée nationale a défait des acquis vieux de plusieurs années, en faveur de la biodiversité et de la qualité de l’air. Des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles sont réintroduits, l’imperméabilisation des sols est tolérée, les ZFE sont remisées. Dans le même temps, le gouvernement obtenait un jugement qui autorise la reprise du chantier de l’autoroute A69. Tout ceci a été fait sous l’impulsion de la droite et de l’extrême droite en opposant les intérêts des agriculteurs, des catégories populaires, des populations d’un territoire à celui de l’environnement. La gauche et les écologistes ont été dans l’incapacité de faire face, se payant même le luxe de se diviser sur le vote des ZFE.
On a déjà déploré, ici, cette logique de lutte systématique qui marginalise la gauche, la rend inaudible et inefficace. Quelle misère quand s’annonce le pire quant à la protection sociale et son financement. C’est toujours cette recherche de la différenciation qui a mis toute la gauche, depuis de longs mois, dans l’incapacité d’organiser des rendez-vous puissants pour soutenir les Palestiniens et contrer le génocide perpétré par le gouvernement israélien.
Le jeu de massacre qui s’installe à gauche pèsera en 2027. Il prépare l’élimination du second tour et assure l’élection d’un président d’extrême droite, de droite extrême ou de droite radicalisée. Mais inutile d’attendre 2027 pour en subir les conséquences. Le refus de convergences pour mieux justifier les candidatures adversaires s’est payé cash cette semaine. En 2026, cela se traduira sans nul doute par la multiplication des listes concurrentes aux municipales.
La mécanique qui peut aboutir à la destruction de la gauche est lancée à plein régime. C’est tout à fait irresponsable et délétère. Ce jeu de massacre programmé doit à tout prix s’arrêter.
Les différences à gauche sont connues et sont structurelles. On ne peut les éluder. On a su vivre avec à de nombreuses reprises dans l’histoire. Hier encore. La gravité des défis impose que l’on trouve une façon de gérer ces désaccords.
Une logique de concurrence à mort jusqu’en 2027 nous laminera tous. Quand bien même il resterait, comme dans les Monty Python, un valeureux combattant sans bras et sans jambe.
Il a été proposé par François Ruffin, par des maires de toutes sensibilités, de s’engager dans une grande consultation de toute la gauche pour départager les logiques qui existent. De fait, c’est ce qui s’est passé en 2017 et en 2022. C’est Jean-Luc Mélenchon qui a remporté cette compétition entre les gauches et les écologistes. Sur la base de ses succès électoraux, Jean-Luc Mélenchon proposa une alliance qui reposait sur les grandes lignes de son programme : ce fut la Nupes puis le NFP. On ne peut pas recommencer cette procédure, classique à gauche, de départage au premier tour de l’élection. Dans un moment de fragilité, les conséquences sont trop destructrices. Il faut anticiper et éviter à tout prix que s’éternise le climat actuel.
Le soutien apporté par Boris Vallaud à Olivier Faure permet d’imaginer un PS ouvert au rassemblement de la gauche. Il ne peut se concevoir dans un périmètre qui exclut sa principale force : les insoumis. Les désaccords ne sont certes pas aux marges. Oui, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann n’ont pas le même projet. Peuvent-ils se passer l’un de l’autre pour gagner et gouverner ? Peuvent-ils prendre la responsabilité au nom de leurs certitudes de nous affaiblir tous ? Il n’y a de rassemblement possible qu’au terme d’une procédure sincère et ouverte qui permet d’exposer les projets et d’acter les différences, d’avancer vers des compromis. Ceux qui, par principe, refuseraient de participer à ce qui est tellement attendu par les électeurs de gauche porteraient le poids politique et historique.
mise en ligne le 1er juin 2025
Entre Israël et les États-Unis, un jeu de dupes pour continuer la guerre à Gaza
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Washington et Tel-Aviv, conscients de la réprobation qui s’exprime partout sur la planète, y compris au sein de leurs propres sociétés, manœuvrent pour rejeter sur les Palestiniens la responsabilité de la poursuite de l’entreprise génocidaire. In fine, ils entendent empêcher la création d’un État de Palestine.
Plus l’indignation mondiale monte et s’exprime face au génocide en cours dans la bande de Gaza, plus l’administration états-unienne et le gouvernement israélien brouillent les pistes. Une trêve entre le 19 janvier et le 17 mars avait permis de sortir de Gaza 33 Israéliens – dont 8 morts – en échange de la libération de près de 1 800 prisonniers palestiniens.
Sur 251 otages, 57 restent détenus à Gaza, dont au moins 34 sont décédés selon les autorités israéliennes. Mais, le 18 mars, Benyamin Netanyahou a décidé unilatéralement de rompre ce cessez-le-feu en vigueur depuis deux mois. Les bombardements n’ont pas cessé depuis et l’aide humanitaire a été utilisée comme une arme contre les Palestiniens.
Des négociations qui virent au jeu de dupes
Paradoxalement, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas n’ont jamais cessé. Pour Washington et Tel-Aviv, il convient de faire croire à l’opinion publique internationale que si la guerre se poursuit c’est à cause de l’intransigeance de l’organisation islamiste palestinienne. L’envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, n’a soumis une proposition au Hamas qu’après l’accord d’Israël.
Américains et Israéliens se mettent d’accord, concoctent un plan à partir de leurs propres buts politiques puis mettent les Palestiniens sous pression pour qu’ils acceptent. Donald Trump assurait, vendredi, qu’un accord sur un cessez-le-feu à Gaza était « tout proche ». Le même jour, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait sommé le Hamas d’accepter la proposition américaine sous peine d’« être anéanti ».
La réponse du mouvement était « positive », selon une source citée par l’AFP, mais le Hamas insiste sur « la garantie d’un cessez-le-feu permanent et d’un retrait total d’Israël » de la bande de Gaza. Une réponse « complètement inacceptable » pour Steve Witkoff, qui ajoutait que « cela ne fait que nous faire revenir en arrière ».
Fort de ce bouclier états-unien, Netanyahou poursuit le massacre. Un massacre humain et politique. Ce dimanche 1er juin, les soldats israéliens ont ouvert le feu sur des Palestiniens rassemblés sur des sites de distribution d’aide gérés par le Gaza Humanitarian Foundation (créé par Israël et soutenu par les États-Unis) dans le sud et le centre de Gaza, tuant au moins 31 personnes.
Si le premier ministre israélien ne veut pas envisager la fin de la guerre, c’est aussi parce qu’elle marquerait la possibilité d’un nouveau processus pour la création réelle d’un État de Palestine. Une délégation de pays arabes qui devait discuter de cette question (à l’ordre du jour de la conférence de l’ONU coprésidée par la France et l’Arabie saoudite le 17 juin) a été empêchée de se rendre à Ramallah samedi.
« Un tel État deviendrait sans aucun doute un État terroriste au cœur du territoire d’Israël », a expliqué un officiel israélien. Quant à l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, échaudé par les déclarations d’Emmanuel Macron sur une possible reconnaissance d’un État de Palestine, il a lancé : « Si la France est vraiment déterminée à voir un État palestinien, j’ai une suggestion à lui faire : tailler un morceau de la Côte d’Azur. »
mise en ligne le 1er juin 2025
Effort
Le billet de Maurice Ulrich sur www.humanite.fr
Dans son éditorial, le directeur de la Tribune dimanche, Bruno Jeudy, croit opportun de paraphraser Sartre et sa formule « L’enfer c’est les autres » avec la formule « L’effort c’est les autres » à propos des 45 milliards que chercherait « désespérément » François Bayrou pour boucler le budget.
Ainsi, écrit-il, « la gauche ne rêve que d’augmenter les impôts des riches ». « Je suis si intelligent, écrivait Oscar Wilde, que parfois je ne comprends pas un seul mot de ce que je dis. » On se demande si Bruno Jeudy comprend toujours ce qu’il écrit. Car qui peut payer plus, si ce n’est ceux qui ont plus d’argent ? Ceux qui n’en ont pas ?
En 2024 le cumul des 500 premières fortunes de France dont celle de Rodolphe Saadé, propriétaire de la Tribune dimanche, dans le classement de tête était de 1 228 milliards d’euros, en augmentation de 5 % sur l’année précédente – soit plus de 60 milliards. La taxe Zucman de 0,2 % sur les ultrariches a été votée à l’Assemblée nationale. On attend qu’elle arrive au Sénat… Allons Bruno Jeudy, un petit effort pour mieux se comprendre.