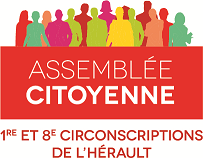mai 2025
mise en ligne le 31 mai 2025
Extrême droite : des néonazis font le coup de force contre le Prolé d’Alès
sur www.humanite.fr
Des néonazis du Block montpelliérain ont violemment frappé des clients et des militants communistes réunis ce vendredi dans ce lieu emblématique d’Alès, alors qu’ils étaient réunis pour fêter la feria de l’Ascension.
L’extrême droite a fait de nouvelles victimes. Une douzaine de néonazis du Block montpelliérain ont violemment fait irruption le vendredi 30 mai dans le bar du Prolé d’Alès, pendant la feria de l’Ascension, « assénant de coups et de gaz lacrymogènes la foule en fête et les militants communistes et leurs ami.e.s », dénonce Giovanni Di Francesco, le secrétaire de section du PCF de cette ville du Gard. Une vingtaine de personnes qui se trouvait dans ce lieu emblématique de luttes, de fête et de culture d’Alès, ont été blessées et secourues par la Croix Rouge et le SAMU dont un militant cheminot PCF hospitalisé en urgence.
Rassemblement républicain
« Devant la gravité de ces faits, au moment où partout en France l’extrême droite trouve banalisation médiatique mais aussi complaisance du Pouvoir et porosité de la droite tant nationalement que localement, lui donnant ainsi des ailes, nous condamnons vivement et appelons à réagir fermement » ajoute le responsable communiste. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux victimes ont porté plainte ce samedi matin, l’une d’entre elles, gravement blessée, a dû poser 5 jours d’ITT, rapporte France Bleu. Giovanni Di Francesco a affirmé vouloir saisir le« Procureur de la République » ; il appelle à un rassemblement républicain ce lundi 2 juin, à 18 heures, devant la sous-préfecture pour dénoncer « cette montée fasciste de plus en plus décomplexée ».
« Je demande au maire et au sous-préfet de veiller scrupuleusement à empêcher ces individus, connus et reconnaissables, d’exercer leur bestialité dans la ville ce jour de fête, poursuit Giovanni Di Franceso. Jamais au grand jamais nous laisserons sous silence se repaître les descendants de ceux qui avaient plongé la France et le monde dans leurs heures les plus sombres, ceux qui visent à opposer les humains entre eux pour mieux les dominer, les annihiler, les déshumaniser. Nous leur opposons fraternité, luttes émancipatrices et culture, solidarité et justice sociale, paix. »
L’élu du PRG de Nîmes demande la dissolution du Block montpelliérain qui constitue est un « danger pour la République ».
mise en ligne le 31 mai 2025
Béziers : l’Association France-Palestine Solidarité se mobilise contre le salon du Bourget
sur https://lepoing.net/
Des militants biterrois de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) organisent dans le cadre d’une coalition de 200 organisations une semaine de mobilisation du 2 au 8 juin pour dénoncer la venue d’entreprises israéliennes d’armement au salon aéronautique du Bourget, qui se tiendra du 16 au 22 juin
“Dans moins d’un mois, le salon aéronautique du Bourget va se tenir du 16 au 22 juin. À ce jour, au moins neuf entreprises israéliennes d’armement dont Elbit Systems, IAI ou Rafaël figurent toujours sur la liste des exposants invités. Ces entreprises qui sèment la mort à Gaza et dans toute la Palestine vont pouvoir continuer tranquillement leur business, ici, en France, à l’invitation du président de la République”, écrivent les militants biterrois de l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS dans un communiqué).
Du 2 au 8 juin, une coalition de 200 organisations (dont l’AFPS fait partie) organise une semaine nationale d’action “pour demander aux préfets et sous-préfet de transmettre au président de la République l’exigence citoyenne qu’il n’y ait aucune présence israélienne au salon du Bourget.” A Béziers, un rassemblement devant la sous-préfecture sera organisé le 3 juin à 12h15, où des portraits d’enfants, de civils, de journalistes, de médecins et d’artistes assassinés par l’armée Israélienne seront brandis.
Une manière de rappeler que la guerre contre la population palestinienne a déjà occasionné la mort de plus de 52 000 personnes. “Dans ce contexte, alors que le 18 septembre 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a voté à une écrasante majorité d’État, dont la France, une résolution enjoignant les États d’interdire toute exportation d’armes ou de matériel connexe en direction d’Israël, comment accepter que la France invite des entreprises israéliennes d’armement qui sèment la mort et le chaos à Gaza à venir faire des affaires, en France, au salon du Bourget ?“, demandent les militants dans la lettre qui sera remise au sous-préfet.
Le collectif Palestine biterrois appelle à une seconde manifestation, samedi 7 juin à 18h30 Rond Point Gagarine (devant l’entrée du parking du Polygone – face au tribunal).
mise en ligne le 30 mai 2025
Après 7 ans de fiasco,
les députés enterrent les ZFE
Par Alexandre-Reza Kokabi sur https://reporterre.net/
Du Rassemblement national pro-voitures à LFI, qui pointe le manque d’alternatives pour les plus précaires, les ZFE ont cristallisé les colères. Leur suppression illustre l’échec d’une écologie déconnectée des réalités sociales.
C’est un vote au goût de renoncement. Mercredi 28 mai, les députés ont adopté un article du projet de loi sur la simplification de la vie économique qui prévoit la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Portée par le député d’extrême droite Pierre Meurin (RN), la mesure a été adoptée par 98 voix contre 51, scellant une alliance hétéroclite allant du Rassemblement national à La France insoumise (LFI), en passant par Les Républicains et quelques élus de la majorité. Le gouvernement, qui tentait de sauver les meubles en restreignant l’obligation a ux seules métropoles de Paris et Lyon, a échoué.
Créées en 2018, les ZFE visaient à améliorer la qualité de l’air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Déjà mises en place dans une dizaine de villes (Nice, Rouen, Paris...) elles devaient pleinement entrer en vigueur en 2025. À peine amorcé, ce chantier est aujourd’hui mis à l’arrêt. Un recul net par rapport aux ambitions affichées par Elisabeth Borne, qui voyait dans ces zones un dispositif « irréversible ».
Un fiasco programmé
Ce revirement spectaculaire sanctionne un long enlisement. Imaginées comme un levier structurant de transition écologique, les ZFE ont souffert d’un double défaut originel : un pilotage centralisé, déconnecté des réalités locales, et une mise en œuvre sans véritable accompagnement. « On a mis la charrue avant les bœufs en disant aux gens de ne plus prendre leur voiture, sans proposer d’alternatives », résumait le député LFI Sylvain Carrière, en avril, dans Reporterre. La prime à la conversion s’est effritée, les transports publics en dehors des grandes métropoles sont restés sous-financés, le leasing social a fait long feu. Le gouvernement, sous pression, avait bien promis de réserver au moins 10 % des 50 000 véhicules électriques accessibles pour 100 euros par mois aux habitants concernés par des ZFE. Pas de quoi changer la donne : à l’écologie incantatoire a succédé le vide opérationnel.
Sur le terrain, le rejet s’est peu à peu cristallisé. En 2023, seuls 51 % soutiennent les ZFE, selon l’institut CSA, en baisse de 6 points par rapport à 2022. L’extrême droite s’est engouffrée dans la brèche, dénonçant une « écologie punitive » et une mesure « séparatiste ». Le RN a imposé un récit efficace : celui d’un pouvoir déconnecté, qui culpabiliserait les classes populaires pour leur dépendance à la voiture. À gauche, LFI a dénoncé l’hypocrisie d’une politique environnementale qui ne s’accompagne pas d’investissements suffisants dans les alternatives.
Les ZFE, des « zones de forte exclusion » ?
C’est dans les territoires les plus fragiles que le rejet a été le plus profond. En Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, 3 voitures sur 4 étaient menacées d’interdiction. À La Courneuve, ce chiffre grimpait même à 80 %. « Les ménages précaires motorisés sont plus fréquemment détenteurs de véhicules anciens », expliquait à Reporterre Daphné Chamard-Teirlinck, du Secours catholique. Et les aides, souvent complexes ou insuffisantes, n’ont pas permis de répondre à l’ampleur du défi.
À Pavillons-sous-Bois, Chloé, infirmière en addictologie et mère célibataire, continuait de rouler dans sa Peugeot Crit’Air 5 : « Avant de changer de voiture, il faut remplir le frigo, payer le loyer, les factures. » À Drancy, Oumayma, étudiante de 24 ans, évoquait un choix de survie : « Dans nos quartiers, la voiture est un moyen de sortir du piège. Elle nous permet d’aller aux entretiens, au médecin, de faire les courses quand les transports nous lâchent. » Pour beaucoup, la ZFE a surtout été perçue comme une « zone de forte exclusion », où les injonctions écologiques viennent heurter de plein fouet la précarité.
Le résultat, c’est une colère sourde, teintée de résignation. « Je gruge tant que je peux », confiait Chloé. À Montreuil, Guénolé, régisseur dans l’événementiel, ironisait : « Une voiture électrique, je la branche où dans ma cité ? Je suis censé tirer une rallonge depuis ma fenêtre ? » Le sentiment d’injustice a nourri un rejet de la mesure, attisé par le manque d’information, les cafouillages réglementaires et l’abandon progressif de l’État. « Il a tout remis dans les mains des collectivités sans leur donner les moyens », déplorait encore Daphné Chamard-Teirlinck.
La pollution de l’air tue
Et pourtant, les premiers effets des ZFE étaient tangibles. À Lyon comme à Paris, la concentration de dioxyde d’azote a chuté d’un tiers. « Ce sont des avancées concrètes pour la santé publique », rappelait le Secours catholique dans une note de positionnement, que Reporterre a pu consulter. Chaque année, la pollution de l’air provoque 40 000 morts prématurées en France, selon Santé publique France. Et ce principalement dans les zones où vivent les populations les plus défavorisées. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a déploré une « décision regrettable », contraire au « droit de vivre en bonne santé ».
Selon Le Monde, la suppression des zones à faibles émissions autoriserait la remise en circulation de 2,7 millions de véhicules parmi les plus polluants dans les grandes agglomérations.
À ce coût sanitaire s’ajoute un risque juridique. La France a déjà été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour dépassement des seuils de pollution. En février dernier, elle a de nouveau été mise en demeure par la Commission européenne. Supprimer les ZFE, c’est s’exposer à de potentielles sanctions financières.
« On va droit dans le mur du réchauffement climatique en klaxonnant »
Le vote de l’Assemblée doit encore être confirmé en commission mixte paritaire. Mais l’élan politique semble brisé. Le gouvernement a tenté, lors des derniers débats, de sauver les ZFE a minima, en limitant leur obligation à Paris et Lyon. En vain. « Reprise des travaux de l’A69, suppression des ZFE, on va droit dans le mur du réchauffement climatique en klaxonnant », a réagi sur le réseau social Bluesky le professeur de droit public Serge Slama.
Reste à savoir ce que deviendront les ZFE déjà mises en place dans les métropoles les plus avancées, comme Paris, Lyon, Grenoble ou Montpellier. À défaut d’une impulsion nationale, certains élus espèrent maintenir localement le dispositif, en le réinventant : en misant sur les aides ciblées et un meilleur maillage des transports publics. Mais sans cadre clair, la lutte contre la pollution risque de dépendre, une fois encore, de la géographie politique.
mise en ligne le 30 mai 2025
Les recettes du patronat pour détricoter
la Sécurité sociale
Hélène May sur www.humanite.fr
Tandis que le déficit du système de protection sociale s’accroît, une nouvelle offensive des organisations patronales remet en question son financement hérité de l’après-guerre, basé sur les cotisations salariales et patronales.
Le patronat a repris son bâton de pèlerin. Depuis l’ouverture du « conclave » sur les retraites, ses organisations rivalisent de propositions pour faire face au déficit de la Sécurité sociale, dont le montant a été évalué le 26 mai, par la Cour des comptes, à 15,3 milliards d’euros en 2024 (4,8 milliards de plus que prévu), et qui devrait atteindre 22,1 milliards d’euros cette année.
Objectif affiché, et repris mi-mai presque mot pour mot par le président Macron : « réduire le coût du travail ». En d’autres termes, profiter de ces difficultés financières apparentes et organisées – une partie des recettes (CSG et CRDS) sont détournées pour rembourser la « dette Covid » – pour provoquer un big bang des recettes de la Sécu au profit des employeurs, en diminuant à nouveau significativement les cotisations patronales, progressivement rognées depuis le début des années 1990.
Pour ce faire, les chefs d’entreprise militent d’abord activement pour une baisse des dépenses. Mais ils proposent aussi d’autres sources de financement, dont le point commun est d’affaiblir notre système de solidarité. Une fuite en avant alors que même la Cour des comptes rappelle dans son dernier rapport sur la Sécurité sociale que son déficit s’explique aussi par « le montant des allégements généraux de cotisations patronales, qui ont pour objet de réduire le coût du travail ». Un montant qui « a presque quadruplé entre 2014 et 2024, pour atteindre 77 milliards d’euros ». Qu’à cela ne tienne. Les patrons ont toute une panoplie de recettes à proposer pour ne plus payer.
La TVA dite « sociale »
Portée de longue date par le Medef, c’est la mesure qui semble avoir la préférence de l’exécutif. Après Emmanuel Macron, qui l’avait évoqué à demi-mot, c’est le premier ministre, François Bayrou, qui, à son tour, le 27 mai, a suggéré que « les partenaires sociaux puissent s’emparer de cette question ». Cette mesure, qui consiste à compenser une baisse de cotisations par une hausse de l’impôt prélevé sur les produits consommés, avait pourtant mauvaise presse. Son évocation en 2007 par Jean-Louis Borloo, alors ministre de Nicolas Sarkozy, entre les deux tours des législatives, avait été jugée en partie responsable d’avoir brisé la vague bleue qui s’annonçait à l’Assemblée. Ce qui n’a pas empêché l’idée de ressortir régulièrement dans le débat public tel un serpent de mer.
Ses défenseurs arguent aujourd’hui que ce transfert vers la consommation permettrait aux entreprises de regagner en compétitivité. Cela permettrait « aux travailleurs de gagner plus d’argent, aux entreprises de pouvoir embaucher plus », a ainsi promis Amir Reza-Tofighi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Pas si sûr, répondent syndicats et économistes, qui rappellent que cette politique de l’offre a un effet limité sur l’emploi et le plus souvent à court terme, comme on l’observe aujourd’hui avec le retour en force des plans « sociaux ». « Il y a eu beaucoup de baisses de cotisations ces dernières années, jamais les salariés ne l’ont récupéré en augmentation du salaire net », a aussi taclé Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.
Le plus injuste des impôts
Gauche et syndicats soulignent qu’une hausse de la TVA reviendrait à transférer le poids des recettes sur le consommateur via une hausse des prix. Soit « une baisse massive de pouvoir d’achat pour les salariés », résume Sophie Binet.
D’autant plus inacceptable que la TVA est le plus injuste des impôts puisqu’elle pèse sur tous de la même façon, sans prendre en compte les revenus. Même le patron de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le dit : « Ça crée des problèmes d’équité, d’inégalités importantes, parce que la proportion à consommer, c’est-à-dire la part que chacun consomme de son revenu, est plus forte chez ceux qui ont moins. »
L’U2P (Union des entreprises de proximité) est sensible à l’objection et tente d’y répondre par des taux de TVA différenciés. « Une hausse modérée de quelques points de la TVA pourrait être l’occasion de faire passer davantage de produits de première nécessité et du quotidien aux taux réduit ou très réduit, pour que les ménages les moins aisés soient également gagnants », suggère-t-elle.
Reste que le plus grand problème est l’incertitude qu’un tel transfert des cotisations vers la TVA fait peser sur le financement de la Sécu. Car la TVA, contrairement à la CSG, n’est pas fléchée vers la Sécurité sociale. Il serait donc aisé pour l’État de décider de l’allouer à d’autres dépenses. « Si, demain, la gestion passe totalement dans les mains de l’État, on tomberait dans le pot commun de l’impôt. On serait tributaires de décisions comptables, budgétaires, et de la couleur politique des gouvernements et du Parlement », explique Karim Bakhta, dirigeant de la fédération CGT des organismes sociaux.
Moitié impôts, moitié cotisations
C’est une autre marotte du patronat pour réduire le montant des cotisations : couper la protection sociale en deux. « La logique voudrait que (les) prestations universelles ne reposent plus sur les revenus du travail et soient financées par un impôt à assiette large, tandis que les prestations contributives continueraient à être financées par les cotisations sociales assises sur les revenus professionnels, ce qui permettrait de clarifier le lien entre payeurs et bénéficiaires de cette couverture sociale », explique Patrick Martin, président du Medef, dans la revue du Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale.
La logique n’est pas nouvelle et avait par exemple été défendue en 2024 par les économistes Antoine Bozio et Étienne Wasmer, critiquant les exonérations de cotisations patronales comme « des trappes à bas salaires ». Cette idée pourrait très bien s’articuler avec la proposition de TVA sociale. Pour la CGT, cette distinction entre contributivité et non contributivité fragilise l’édifice fondé en 1945.
« C’est avant toute chose un choix politique : celui de remettre en cause la Sécurité sociale et de renforcer l’étatisation de la protection sociale, sous couvert d’une distinction entre assurance et solidarité, distinction qui n’a pas lieu d’être pour la CGT, qui revendique une Sécurité sociale intégrale, fondée sur les principes de solidarité de classe, fonctionnant comme une assurance sociale, financée par les revenus du travail et défendant la réponse aux besoins des assurés sociaux », estime l’organisation dans un récent « Mémo Sécu », « Contributivité ou comment détruire la Sécurité sociale ».
Faire payer les retraités
C’est la troisième piste développée par le patronat. « Le taux abattu de CSG pour les retraités, c’est 11,5 milliards d’euros de moins par an pour le budget de l’État. Quant à l’abattement pour frais professionnels, c’est une niche de 4,5 milliards. Alors je ne suis pas en train de dire qu’il faut que les retraités payent tout, évidemment non, mais il peut y avoir une répartition de l’effort », avait estimé dès janvier Patrick Martin. L’option avait été immédiatement relayée par la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, puis par le ministre de l’Économie, Éric Lombard, avant d’être écartée en mai par François Bayrou, conscient du poids électoral de cette catégorie de la population.
Il n’empêche, l’idée circule toujours, alimentée par un constat. Le niveau de vie médian des retraités est, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 2,1 % plus élevé que celui des autres catégories. Même si cela s’explique par l’absence d’enfant à charge et par le fait que les retraités sont plus nombreux à être propriétaires de leur logement (70 % contre 53,7 % dans le reste de la population), cette comparaison alimente le constat du travail qui ne paie plus. « Une anomalie », selon Amir Reza-Tofighi, qui déplorait en avril qu’« à chaque fois qu’on demande des efforts, on ne les demande pas aux retraités, pour des raisons électorales ».
En avril, la Cour des comptes évoquait de son côté la fin de l’indexation des pensions sur l’inflation, estimant que ce système « n’apparaît pas le plus adapté pour assurer un équilibre durable du système des retraites » et qu’une « indexation sur les salaires favoriserait une meilleure équité intergénérationnelle ». Reprise en partie par l’U2P, qui propose un arrêt de l’indexation pendant trois à cinq ans, la mesure est très inégalitaire, puisqu’elle touche tous les pensionnés de la même façon. Moins coûteuse politiquement, la fin de l’abattement de 10 % pour les retraités recueille un plus large soutien. Le Medef comme la CPME et l’U2P y sont favorables.
« Cette suppression de l’abattement fiscal ne toucherait pas les plus modestes, qui sont généralement moins nombreux à être imposables », écrivait Pierre Madec, économiste à l’OFCE. Mais les retraités moyens seraient aussi affectés, et cela se traduirait par une hausse de leur niveau d’imposition. Pour 500 000 d’entre eux, cela voudrait même dire passer de non imposables à imposables. S’ajoute, rappelle la CGT, le fait que « l’augmentation du revenu fiscal de référence aurait des conséquences sur le taux de CSG appliqué, et remettrait en cause l’accès à certaines aides et allocations ou au logement social soumis à conditions de ressources ».
Taxer le patrimoine
S’en prendre au patrimoine pour équilibrer les comptes n’est pas une recette habituelle du patronat. Pourtant, l’U2P en fait un levier d’action et propose d’augmenter le niveau de taxation sur la rente financière et immobilière, pour qu’il cesse d’être inférieur à celui du travail.
Dans le même registre, elle suggère d’augmenter l’impôt sur les gros héritages – supérieurs à 500 000 euros –, estimant que, « quand le poids des fortunes héritées est tel et que nos choix collectifs aggravent le problème en taxant le travail plus que l’héritage, il faut inévitablement corriger la situation en réduisant les prélèvements sur le travail et en remontant un peu ceux qui sont appliqués aux héritages les plus volumineux ».
Ignorées par les organisations du moyen (CPME) et grand patronat (Medef), mais aussi par la droite et le centre, ces pistes prennent pourtant en compte la réalité d’un pays où les inégalités de patrimoine sont bien supérieures aux inégalités de revenus et n’ont cessé de croître (en 2024, 10 % des Français détenaient 50 % du patrimoine total), au point qu’on puisse parler de nouveau d’une « société d’héritiers ». Elles s’inscrivent par ailleurs dans la mobilisation en cours au niveau mondial pour une taxation effective des plus riches.
mise en ligne le 29 mai 2025
Soutenir Gaza
depuis la France :
« On se sentait complètement démunis »
par Malo Janin sur https://basta.media
Après onze semaines de blocus total d’Israël, quelques camions d’approvisionnement sont enfin entrés à Gaza. Face à l’horreur, des personnes tentent d’aider la population gazaouie depuis la France, malgré les nombreux obstacles.
« On se sentait complètement démunis. Puis on s’est dit : pourquoi ne pas faire quelque chose qu’on maîtrise » Benjamin Giraud est boulanger dans le Rhône. Il ne s’est jamais rendu à Gaza. Mais depuis un mois, sa compagne Teepam et lui ont décidé d’utiliser leur farine et leur savoir-faire pour venir en aide à la population de l’enclave palestinienne, victime depuis plus d’un an et demi de bombardements israéliens qui ont dévasté son territoire, et tué des dizaines de milliers de personnes.
Les week-ends, le couple de boulangers vend au marché une quinzaine de « pains pour Gaza ». Leur prix est fixé à 2,50 euros sur lesquels deux euros sont destinés à la population palestinienne. Les boulangers ont fait leur premier virement d’une cinquantaine d’euros au collectif local d’Urgence Palestine, qui se charge ensuite de redistribuer comme il peut l’argent aux Gazaouis. « Ce sont des petites sommes, mais elles peuvent permettre d’aider une femme enceinte, un enfant », dit Benjamin.
Teepam et Benjamin sont horrifiés par les « frappes sur des écoles » et les images de mort qui envahissent les médias et nos réseaux sociaux. « On ne pouvait plus rester sans rien faire, disent-ils. Ce qui me choque le plus, c’est la non-réaction des États et de l’Europe face aux atrocités commises », déplore le boulanger.
« Maintenir une cohésion sociale »
Pour aider la population de Gaza, des collectifs tels qu’Urgence Palestine (que le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau veut dissoudre) encouragent les dons à de petites structures locales. « Privilégier les dons aux associations ou collectifs locaux contribue à maintenir une cohésion sociale et évite de creuser encore plus les inégalités, à la différence des dons individuels », dit l’un des militants d’Urgence Palestine.
Certaines personnes souhaiteraient envoyer directement de l’argent à des individus plutôt qu’à des organisations, mais le collectif pointe les difficultés rencontrées par ces démarches. « Faire de la communication autour de cagnottes individuelles expose ces personnes à la répression de l’armée israélienne. Tout se fait donc par le bouche-à-oreille », explique le porte-parole d’Urgence Palestine.
Le projet humanitaire Enfan de Palestine, créée en avril 2023, fabrique des t-shirts et autres vêtements et reverse les profits à des collectifs palestiniens. 80 000 euros ont ainsi été envoyés au collectif Sa7ten. D’autres organisations, telles que l’Association France Palestine solidarité (AFPS), soutiennent des initiatives locales depuis le territoire français.
Depuis 2001, l’AFPS tisse des relations avec des structures à Gaza et en Cisjordanie. Fourniture de vêtements, tentes, colis alimentaires…« On fait en fonction des besoins que nos partenaires palestiniens sur place nous font remonter », explique Véronique Hollebecque, trésorière de l’AFPS. En 2024, plus de 200 000 euros ont été envoyés à une vingtaine de projets à Gaza via l’appel au don SOS Palestine.
Lors de son dernier voyage à Gaza, en 2022, Véronique s’était rapprochée d’un collectif pourvoyant des couches pour bébés. « Finalement, le projet s’est transformé, pour aller vers l’équipement d’une pompe à eau pour un puits. Les besoins changent plus rapidement et sont plus difficiles à cibler sur la bande de Gaza qu’en Cisjordanie », détaille la trésorière. La prise de contact avec de nouveaux partenaires locaux est aussi devenue impossible depuis le 7 octobre 2023, puisque l’entrée sur le territoire de Gaza est interdite aux militants de l’AFPS.
Les transferts d’argent vers Gaza sont également difficiles. « C’est bien d’avoir des donateurs, mais il encore faut que l’argent puisse parvenir sur le territoire palestinien », note Véronique. De nombreuses banques refusent de faire les transferts à des banques palestiniennes, ce qui a conduit l’association à recourir à une plateforme en ligne de transferts internationaux. Une fois sur place, les partenaires règlent leurs fournisseurs par voie électronique le plus souvent possible : l’argent peut être retiré dans certains endroits, mais les commissions sont de plus en plus importantes, rapporte la trésorière de l’association.
Bombardements incessants, blocus de l’aide humanitaire, répression de la part des autorités israéliennes… Les entraves matérielles aux collectifs locaux sont nombreuses. « Nous soutenons une association qui fait de l’accompagnement scolaire à Khan Younès, mais elle ne peut plus accéder à ses locaux depuis le début de l’offensive israélienne d’il y a deux semaines, et a dû délocaliser ses actions en dehors du camp », déplore Véronique. Après l’offensive sur Jénine, en Cisjordanie, les locaux Maison chaleureuse, un autre collectif de soutien aux enfants, financé à 50 % par l’AFPS, ont été totalement détruits.
« Ces initiatives sont absolument nécessaires pour aider les Palestiniens, et doivent être complémentaires d’ONG qui fournissent une majorité de l’aide humanitaire, de l’éducation et des soins », appuie Lubnah Shomali, une responsable de Badil, un centre palestinien pour les droits des réfugiés. La Palestinienne est venue de Bethléem à Paris le week-end dernier pour plaider la cause des réfugiés lors d’une Conférence pour la protection du peuple palestinien.
L’ONG Médecins sans frontières (MSF) embauche toujours du personnel médical et non-médical sur place. « Nous travaillons dans les hôpitaux du ministère de la Santé et dans des hôpitaux de campagne, structures qui évoluent au gré des destructions et déplacements de populations », explique Alice Gotheron, attachée de presse de MSF. Afin de fournir des soins de chirurgie, de psychothérapie, pédiatriques et traumatologiques, l’ONG se finance sur les dons faits au Fonds d’urgence régional Gaza. « Les besoins sont bien supérieurs et nous sommes contraints de puiser dans le fonds d’urgence international de MSF », ajoute Aurélie Dumont, directrice de la collecte de fonds.
Les routes qui permettent l’acheminement sur la bande de Gaza sont largement impraticables, semées de checkpoints, de foules et de débris. Certains camions du Programme alimentaire mondial ont été pillés. « Personne ne devrait être surpris ou choqué de voir des scènes où une aide précieuse est pillée, le peuple de Gaza est affamé depuis plus de onze semaines », a écrit sur le réseau social X Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa).
<<
mise en ligne le 29 mai 2025
Politis a trouvé
de l’argent magique !
Pierre Jequier-Zalc sur www.politis.fr
À l’aide de nombreux travaux d’économistes, Politis recense cinq mesures qui permettraient de trouver plus de 50 milliards d’euros par an. Davantage que le montant recherché par François Bayrou. Un bonus exceptionnel – pour seulement un an – rapporterait 100 milliards d’euros additionnels.
Le gouvernement de François Bayrou est tellement désemparé face à la nécessité de trouver 40 milliards d’euros supplémentaires pour le prochain budget qu’on ne serait même plus étonné qu’une cagnotte en ligne soit ouverte par les équipes du premier ministre. Comment ne pas les comprendre ?
Enfermés dans une politique de l’offre dogmatique, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont baissé les recettes fiscales, quoi qu’il en coûte. Et ils ne veulent surtout pas faire machine arrière. À ce niveau-là, et même si bon nombre de ministres aiment se poser en apôtres de la laïcité, tout indique que c’est bien la croyance en une religion néolibérale décomplexée (et surtout sa pratique) qui nous a conduits au bord d’une crise de la dette majeure. Dans leur logiciel, il ne reste donc qu’une seule solution : baisser, encore, les dépenses sociales, après trois réformes brutales de l’assurance-chômage et la hausse de l’âge légal de départ à la retraite.
Politis compile ci-dessous quelques idées simples et efficaces pour résoudre l’équation à laquelle les gouvernements successifs, depuis 2017, ne veulent pas répondre. Alors que plus de 9 millions de Français sont en situation de pauvreté, et que ce nombre est en hausse, nous estimons extrêmement périlleux et irresponsable de tailler plus encore dans les dépenses sociales. Pour faciliter la vie de François Bayrou, nous lui proposons ici de quoi faire entrer plus de 50 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an dans les caisses de l’État.
Des propositions chiffrées et sourcées par des économistes reconnus et spécialistes qui, selon toute vraisemblance, ne mettraient en péril ni les emplois ni la santé économique du pays – rappelons, à ce titre, que notre croissance est atone depuis plusieurs années. En revanche, certaines reviennent sur des politiques publiques mises en place depuis 2017 et ayant conduit à aggraver la situation économique de la France.
1 – Appliquer la taxe « Zucman » : 20 milliards d’euros
C’est la mesure la plus médiatisée, notamment du fait du vote par les parlementaires, en février, d’une proposition de loi du groupe Écologiste et Social reprenant le principe de cette taxe pensé par Gabriel Zucman, éminent spécialiste de la fiscalité des plus riches. L’idée est simple et part d’un constat mis au jour par une note de l’Institut des politiques publiques dont Politis vous parlait déjà en 2023 : l’impôt sur le revenu devient régressif pour les plus riches de notre société. Ainsi, les 0,0002 % plus grandes fortunes du pays ne paient que 26 % d’impôt sur leur revenu, contre 50 % pour les 10 % les plus aisés.
En parallèle, le patrimoine des grandes fortunes a explosé ces dernières années, notamment parmi les plus riches des plus riches. Comment expliquer, dans un pays dont la devise contient le mot « égalité », que les plus fortunés payent proportionnellement moins d’impôts que les autres ? Gabriel Zucman propose donc de remédier à cette injustice en instaurant une taxe sur le patrimoine – et non sur le revenu ! – pour les ultra-riches. Cela ne concerne que les foyers fiscaux détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine – soit une infime partie de la population. Un impôt à hauteur de 2 % du patrimoine de ces immenses fortunes permettrait, selon le chercheur, de faire entrer environ 20 milliards d’euros par an dans les caisses publiques.
L’argument ultime des néolibéraux – « si on les taxe, les riches vont partir » – relève du préjugé.
Surtout, cela n’appauvrirait pas ces foyers : en effet, le rendement de leur capital – c’est-à-dire ce que leur fortune leur rapporte en plus chaque année – est de près de 7 % par an en moyenne sur les quarante dernières années, net de l’inflation. Inutile de souligner que les salaires n’ont pas connu une telle hausse. Enfin, l’argument ultime des néolibéraux – « si on les taxe, les riches vont partir » – relève du préjugé et a été maintes fois contesté (lire ci-dessous).
ZOOM : L’exil des riches, peur infondée et facilement résoluble
Si un impôt sur le patrimoine des plus riches est mis en place, ceux-ci auraient le loisir de quitter le territoire pour y échapper : cet argument est répété inlassablement par ceux qui refusent la création de cette taxe. Il suffirait pourtant, afin d’empêcher ce contournement fiscal, de mettre en place un « bouclier anti-exil ». « L’idée est simple : si une personne a vécu longtemps en France, y est devenue immensément riche, et déménage dans un paradis fiscal, alors la France devrait – et pourrait facilement – continuer à taxer cette personne après son départ », explique, sur Instagram, Gabriel Zucman. Loin d’être saugrenue, cette idée est déjà mise en pratique par les États-Unis, par exemple.
2 – Réformer l’héritage et les droits de succession : 19 milliards d’euros
C’est certainement la manne de richesses la plus importante dans laquelle l’État pourrait puiser : les héritages. Dans les quinze prochaines années, 9 000 milliards d’euros de patrimoines détenus par les Français les plus âgés seront transmis à leurs héritiers. Un chiffre énorme, qui témoigne d’une réalité de mieux en mieux documentée ces dernières années. La France du XXIe siècle redevient une société d’héritiers, comme au XIXe siècle. Aujourd’hui, la fortune héritée représente 60 % du patrimoine national, contre 35 % seulement au début des années 1970.
Le flux successoral représente chaque année environ 400 milliards d’euros de patrimoine transmis. Fondation Jean-Jaurès
Étudié par de nombreux économistes, le principe de la succession reste pourtant profondément injuste et très inégalement réparti au sein d’une population où le patrimoine est de plus en plus concentré dans les mains d’une petite minorité – les 10 % les plus riches en détiennent plus de la moitié. « Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail », souligne une étude du Conseil d’analyse économique (CAE), un collège d’économistes qui conseille le premier ministre.
Malgré cela, les successions restent très faiblement taxées. « Le flux successoral représente chaque année environ 400 milliards d’euros de patrimoine transmis, et la fiscalisation de ces donations et successions rapporte autour de 20 milliards d’euros à la collectivité (soit environ 5 % du total des transmissions) », rappelle ainsi une note de la Fondation Jean-Jaurès.
La faiblesse de ce pourcentage est notamment due à l’existence de nombreuses niches fiscales : pacte Dutreil (exonération de la transmission des biens professionnels), assurance-vie, etc. Autant de dispositifs qui permettent à bon nombre de successions d’éviter l’imposition. « Le système de taxation français […] est […] mité par des dispositifs d’exonération ou d’exemption dont les justifications économiques sont faibles », explique les économistes du CAE.
Au vu de ce constat, s’attaquer à une réforme d’ampleur des droits de succession s’apparente à une nécessité démocratique pour rétablir de l’égalité et de l’équité. Ce serait surtout une aubaine pour renflouer efficacement les caisses publiques. Les économistes du CAE ont fait des simulations : ils estiment qu’une réforme ambitieuse, qui s’attaquerait frontalement aux dispositifs qui mitent les droits de succession aujourd’hui, rapporterait 19 milliards d’euros par an à l’État. Une telle réforme n’augmenterait nullement les droits de succession des petits patrimoines, argument régulièrement utilisé par le pouvoir pour ne pas s’attaquer à ce sujet.
3 – Légaliser le cannabis : 2,8 milliards d’euros
Le chiffre pourrait paraître énorme. Pourtant, il est vraisemblablement sous-estimé car fondé sur des estimations très approximatives – et sans doute inférieures à la réalité – de la consommation actuelle de cannabis. Pour donner un ordre d’idée, les recettes fiscales sur la vente de cigarettes étaient de près de 13 milliards d’euros en 2024.
C’est, une nouvelle fois, une note du Conseil d’analyse économique, rattaché à Matignon – qu’on ne peut donc que difficilement qualifier de bolchevique –, qui aboutit à cette estimation : légaliser le cannabis permettrait à l’État d’engranger 2,8 milliards de recettes supplémentaires. Cette somme prend en compte l’ensemble des taxes qui encadreraient la vente du cannabis. En revanche, elle n’intègre pas d’éventuelles nouvelles recettes issues d’un changement des politiques publiques.
En effet, si le cannabis est légalisé, plus besoin de mener des politiques répressives – spécialité hexagonale sur ce sujet. « Même si on fait abstraction des nouvelles recettes fiscales, les politiques de légalisation et de dépénalisation ont un effet positif sur les finances publiques dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices. La plupart des études trouvent que les gains en termes de coûts de répression et de justice liés aux usagers sont plus élevés que les coûts d’encadrement du marché et que l’augmentation hypothétique des coûts de santé », écrivent les auteurs de la note.
Outre l’aspect purement financier, la légalisation du cannabis – sujet auquel Politis a consacré un dossier complet en février – permettrait de mieux encadrer et de réduire les risques liés à la consommation de cette substance.
4 – Revoir les politiques sur l’apprentissage : 10 milliards d’euros
« Apprentissage : quatre dispositifs pour reprendre le contrôle » : le titre de l’étude de l’économiste Bruno Coquet pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ne fait pas dans le subjectif. Les dépenses publiques liées à l’élargissement massif du dispositif de l’apprentissage sont hors de contrôle. Désormais près de 25 milliards d’euros par an. Un coût faramineux dont la quasi unique justification est le souhait d’Emmanuel Macron de pouvoir présenter un bilan d’un million de nouveaux apprentis par an – et, ainsi, de jouer artificiellement – sur le taux de chômage des jeunes. Un objectif d’ores et déjà presque atteint. Mais à quel prix ?
En 2023, un apprenti générait en moyenne plus de 26 000 euros par an de dépenses publiques. B. Coquet
Si Emmanuel Macron s’est attaqué dès 2018 au sujet de l’apprentissage, le tournant majeur date d’après le premier confinement, en 2020. Dans le but de relancer à tout-va l’économie, le président de la République et son gouvernement instaurent une « aide exceptionnelle » pour les entreprises concernant l’apprentissage. Une aide qui va « bien au-delà de toutes les bonnes pratiques en matière d’emplois aidés », pour l’économiste de l’OFCE. En effet, celle-ci élargit massivement le dispositif, notamment pour les étudiants en études supérieures, alors qu’auparavant il ciblait les formations de niveau bac ou inférieur. Pour une entreprise, le coût d’embauche d’un étudiant en apprentissage devient infime. Il « a été réduit d’environ 90 % pour les apprentis du supérieur », note Bruno Coquet.
Autant d’aides qui aboutissent à une situation « incontrôlée » selon l’économiste : « En 2023, un apprenti générait en moyenne plus de 26 000 euros par an de dépenses publiques, soit environ deux fois le coût moyen d’un étudiant du supérieur suivant une voie classique. » « Du point de vue de l’insertion en emploi des apprentis, l’efficience du dispositif est très faible », nuance l’économiste. Ainsi, il propose de revenir à la formule de 2018, concentrée sur les apprentis qui en ont le plus besoin pour s’insérer sur le marché du travail. Cela permettrait à l’État d’économiser 10 milliards d’euros par an, aujourd’hui versés sans contrôle ni distinction aux entreprises, sans autre objectif qu’un chiffre, certes mirobolant, mais qui n’est ni efficient ni intéressant économiquement.
5 – Baisser les exonérations de cotisations sur les bas salaires : 3 milliards
C’est une mesure qui a failli être votée lors du dernier budget. Mais les macronistes, fidèles à leur mantra « ne pas augmenter le coût du travail » et soucieux de ne pas fâcher le patronat, ont finalement réussi à la vider de son sens.
De quoi parle-t-on ? Aujourd’hui, le Smic et les très bas salaires (jusqu’à 1,6 Smic) bénéficient d’exonérations de cotisations patronales. Ce qui peut créer ce qu’on appelle une « trappe à bas salaires » : les entreprises n’ont aucun intérêt à augmenter les bas salaires car cela leur coûte doublement, à la fois par la hausse du salaire et par le surplus de cotisations dont elles étaient exonérées avant l’augmentation. Le phénomène a été, ces derniers mois, de plus en plus mis en avant du fait d’une « Smicardisation » de la société.
Début 2023, 17,3 % des salariés français étaient payés au Smic, un niveau inédit en trente ans. La raison : avec l’inflation, le Smic a continué d’augmenter, rattrapant les bas salaires, qui, eux, ont stagné. Or, avec le système actuel d’allègements de cotisations pour les salaires autour du Smic, il n’existe aucune incitation – au contraire même – à augmenter les bas salaires.
Fin 2024, deux économistes proches du gouvernement, Antoine Bozio et Étienne Wasmer, ont rendu un volumineux rapport sur cette question. Et leur conclusion, même si elle reste policée, est claire : « En termes de politiques d’exonérations de cotisations sociales, une inflexion est nécessaire. » D’autant plus nécessaire que le coût de ces exonérations, entre 70 et 80 milliards d’euros par an, est très important. Infléchir légèrement la politique actuelle sur les très bas salaires – comme l’a, un moment, envisagé le gouvernement – pourrait ainsi rapporter, a minima, 3 milliards d’euros supplémentaires par an.
Bonus : taxer la hausse des richesses des ultra-riches : une mesure exceptionnelle à 100 milliards
« En France, les 500 plus grandes fortunes ont progressé de 1 000 milliards d’euros depuis 2010, passant de 200 à 1 200 milliards. » Dans une note de son blog sur Le Monde, Thomas Piketty, l’économiste des inégalités et auteur du Capital au XXIe siècle, pose ce constat particulièrement éloquent. Et propose une mesure sur cette augmentation faramineuse. « Il suffirait d’une taxe exceptionnelle de 10 % sur cet enrichissement de 1 000 milliards pour rapporter 100 milliards, c’est-à-dire autant que la totalité des coupes budgétaires envisagées par le gouvernement pour les trois prochaines années. »
Rien dans la Constitution n’interdit n’imposer une taxe exceptionnelle sur l’enrichissement des milliardaires. T. Piketty
La proposition, au vu du contexte économique et politique, paraît assez peu crédible. Pourtant, aucun argument ne permet de la balayer d’un revers de main. Les milliardaires partiraient-ils ? Avec la création d’un bouclier contre l’exil fiscal, ils ne pourraient pas. Une mesure anticonstitutionnelle ? « Rien dans la Constitution n’interdit n’imposer une taxe exceptionnelle sur l’enrichissement des milliardaires, et plus généralement d’imposer le patrimoine, qui est un indicateur pertinent pour évaluer la capacité contributive des citoyens, au moins autant que le revenu », réfute Thomas Piketty. « Que certains juges constitutionnels ignorent tout cela et tentent parfois d’utiliser leur fonction pour imposer leurs préférences partisanes ne change rien à l’affaire : il s’agit d’un débat politique et non juridique. »
Un débat politique qu’il est de plus en plus urgent d’avoir pour éviter les cures austéritaires à répétition promises par le gouvernement, et pour, enfin, réinvestir dans nos services publics et dans la transition climatique.
mise en ligne le 28 mai 2025
CHU de Montpellier :
la direction annonce 850 000 euros par an pour les urgences, les syndicats crient victoire
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Dans un communiqué du 28 mai, la CGT et Force Ouvrière du CHU de Montpellier reviennent sur leur mobilisation qui dure depuis février dernier et annoncent que la direction de l’hôpital a pris des mesures pour renforcer le service des urgences
La lutte a fini par payer. En janvier dernier, la CGT du CHU de Montpellier avait réalisé un signalement pour danger grave et imminent à la direction de l’hôpital face aux manques de moyens dont souffrait le personnel et à la hausse de fréquentation des urgences. Devant le manque de réaction de la direction, les syndicats avaient déposés un préavis de grève illimitée le 5 février dernier.
Dans un communiqué du 28 mai, la CGT et Force Ouvrière crient victoire après quatre mois de lutte : “A l’issue de nombreux échanges entre la direction, les organisations syndicales et les personnels qui se sont particulièrement impliqués, nous mesurons enfin les nombreuses avancées qui vont permettre d’améliorer significativement les conditions de travail des personnels paramédicaux et les prises en charge sécurisées des patients, dans l’attente des travaux de rénovation avancés à l’horizon 2027. Le renforcement du service des urgences représentera 850 000 € d’investissement annuel.”
De nouvelles orientations ont également été définies afin de mieux accompagner les patients et de réduire le délai de prise en charge. De nouveau postes d’infirmiers et d’aides soignants vont être créés d’ici cet été. “Les personnels paramédicaux du service des urgences adultes de Lapeyronie peuvent savourer leur victoire et mesurer le chemin parcouru depuis l’hiver dernier”, écrivent les syndicats.
mise en ligne le 28 mai 2025
Au tribunal de Nanterre, des militants pro-palestiniens contre Thalès
Par Marie-Mene Mekaoui sur https://www.bondyblog.fr/
Sept militants pro-palestiniens sont poursuivis par l’entreprise française d’armement, pour avoir réalisé des tags sur les murs extérieurs de son site. Les faits ne sont pas contestés par les prévenus mais justifiés en raison du contexte de la guerre à Gaza.
L’émotion est palpable dans la 18e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Les sept prévenus défilent, chacun leur tour, devant la présidente, Nour Abboudi, pour leur déclaration spontanée. « Désolée, je suis un peu stressée », prévient Romane M., 31 ans. Elle n’arrive pas à contenir ses émotions et pleure. « J’ai participé à toutes les formes légales d’activisme mais je suis restée impuissante », justifie-t-elle.
Ils sont sept militants pro-palestiniens à comparaître libre, ce 27 mai. L’entreprise française d’armement, Thalès, les poursuit pour « dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin commise en réunion ». Les faits se sont déroulés le 1er février 2024, à l’aube. Il est 5 heures du matin quand Tarek I., Corinne L., Romane M., Chadi R., Clara S. et Nordine Z., se rendent devant le siège de l’entreprise, à Gennevilliers.
Ils s’arment de peinture à bombe rouge et taguent sur les murs extérieurs du groupe d’armement français. Ils inscrivent “Free Palestine”, “Thalès complice génocide”, “Stop arming Israel PA”. Des bouteilles en verre remplies de clous sont aussi jetées sur la chaussée en référence aux « bombes qu’Israël lance sur Gaza et auxquelles Thalès contribue », explique Mohamed Geite, un des avocats de la défense. Les sept militants ont été interpellés par la police à quelques mètres des faits.
Des actions de désobéissance civile
Quatre femmes et trois hommes sont assis face à face sur le banc des prévenus. Ils sont enseignants-chercheurs, artistes, chefs d’entreprise, étudiants ou encore infirmiers. Rien ne semble les lier si ce n’est la cause palestinienne. Ils font partie du collectif Palestine Action, dont l’objectif est de réaliser des actions coups de point pour perturber les marchands d’armes qui commerceraient avec Israël.
Les tags avaient donc pour but de « dénoncer les actions de Thalès », explique à la barre Chadi M., mannequin et ancien salarié de la Croix rouge. Ils accusent l’entreprise de vendre des composants d’armes à Israël qui seraient utilisés dans la guerre à Gaza, qui a débuté au lendemain du 7 octobre.
Les sept prévenus, qui ont un casier judiciaire vierge, assument les faits qui leur sont reprochés. Leur défense repose sur le contexte géopolitique dans lequel ils ont été réalisés : celui du génocide à Gaza, dénoncés par plusieurs organisations internanionales.
« Ce n’est pas de la peinture au mur qui devrait scandaliser mais les crimes à Gaza »
La présidente, Nour Abboudi, les laisse discourir mais rappelle en préambule : « Ce qui vous est reproché n’est pas ce qui est inscrit, mais le fait d’avoir fait ces tags. » Mais les prévenus ne dévient pas. « Ce n’est pas de la peinture au mur qui devrait scandaliser mais les crimes à Gaza », dénonce à la barre Tarek I., chef d’entreprise dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Il est tiré à quatre épingles dans un costume beige.
La défense appelle trois témoins à la barre. Le premier, Rony Brauman, ancien président de MSF, avance d’un pas assuré. Il rappelle qu’Israël a largué « 100 milles tonnes de bombes » sur la bande de Gaza. L’action de désobéissance civile non violente qu’ont organisé les prévenus « n’est pas inédite » explique l’homme aux cheveux gris avant de faire une analogie avec les actions menées par la société civile durant l’Apartheid sud africain.
Thalès a des partenariats historiques avec Israël, un État impliqué dans des crimes de guerre
Le deuxième témoin entre dans la salle d’audience. C’est Tony Fortin, chargé d’études à l’Observatoire des armements. Il s’excuse par avance si sa prise de parole est longue.
« Thalès a des partenariats historiques avec Israël, un État impliqué dans des crimes de guerre », assure-t-il. Dans les domaines du satellite, de la sécurité informatique ou du drône, il explique les liens commerciaux qu’entretient l’entreprise d’armement, dont 25 % des parts appartiennent à l’Etat français, avec Israël, accusé de violer le droit international. Or, « quand il y a un risque que les armements utilisés violent le droit international, il faut stopper les ventes », souligne le spécialiste.
« Sans ce type de mobilisation, il est compliqué d’être informé sur l’exportation des armes »
Interrogé par la seconde avocate de la défense, Clara Gandin, sur l’intérêt d’un acte de désobéissance civile comme celui des prévenus, Tony Fortin estime que « l’action menée participe à faire émerger un débat ». Et d’ajouter que « sans ce type de mobilisation, il est compliqué d’être informé sur l’exportation des armes ».
L’huissier invite le troisième témoin à entrer dans la salle. C’est Sarra Griga, rédactrice en chef du média en ligne Orient XXI. En introduction, elle rappelle la décision du 26 janvier 2024, de la Cour internationale de justice, demandant à Israël d’empêcher d’éventuels actes de « génocide » et de « prendre des mesures immédiates » pour permettre la fourniture « de l’aide humanitaire à la population civile de Gaza ».
« La responsabilité du génocide va au-delà de celle des États. Les entreprises qui ont vendu des armes peuvent être poursuivies », explique la journaliste, calepin entre les mains. Elle paraphrase les mots de Johann Soufi, ancien chef du bureau des réfugiés palestiniens des Nations Unis. Pour la journaliste, l’action des militants est donc légitime. « Il est audible que des citoyens sentent le devoir d’intervenir contre le génocide par tous les moyens qu’ils disposent », défend-elle.
Le droit et la morale
Tout au long des interventions, ni la présidente, ni l’avocate générale ou l’avocate des parties civiles n’ont posé de question.
Place aux conclusions. L’avocate qui représente Thalès, Hélène Chesné, débute. « Les éléments du dossier montrent que des dégradations ont été commises et elles ne sont pas contestées par les personnes qui comparaissent. » Elle recadre ensuite le débat. La question est de savoir si la liberté d’expression empêche la culpabilité pénale des prévenus. « L’émotion légitime n’autorise pas n’importe quelle forme d’action », plaide l’avocate qui admet que les faits reprochés « sont minimes ».
Même si l’impuissance « est frustrante », Hélène Chesné soutient que « Thalès n’a rien à se reprocher d’un point de vue légal ». Dans la salle, l’indignation se fait ressentir. La rédactrice en chef, Sarra Griga, hoche la tête de droite à gauche en signe de contestation et lâche un soupir : « c’est faux ».
Quant à l’avocate générale, Amélie Montaillet, elle considère, elle aussi, qu’il faut seulement regarder les dégradations qui ont été « causées et qui constituent une infraction ». Ce n’est pas non plus au tribunal de juger de la légitimité de la mobilisation. « Nous sommes dans une enceinte démocratique, mais pas politique », a-t-elle conclu, en réfutant les arguments d’état de fraternité et de nécessité portés par la défense.
Une action « d’intérêt public »
Clara Gandin est la première avocate de la défense à conclure. L’avocate se lance dans une longue tirade qui retrace les manquements d’Israël au droit international et du rôle de Thalès dans ce contexte. « Sans les hautes technologies fournies par Thalès, les drônes israéliens n’existent pas », dénonce-t-elle. L’action de désobéissance civile perpétrée par les prévenus est donc « d’intérêt public » et « justifie la relaxe » des prévenus.
Pour Maître Geite, « l’objectif était de porter un message et non un préjudice à l’entreprise ». L’avocat note que Thalès n’a pas porté plainte pour diffamation et rappelle que la Cour de cassation a déjà relaxé des prévenus poursuivis pour des faits plus graves comme des blocages d’autoroutes.
Les parties civiles requiert plus de 11 500 euros en réparation d’un préjudice matériel, 3 500 euros en préjudice moral et 4 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public requiert quant à lui 500 euros d’amendes par prévenu avec un sursis allant de 100 à 300 euros pour certains d’entre eux.
Avant d’annoncer que les délibérés se dérouleront le 1er juillet à 9h, la présidente donne une dernière fois la parole aux prévenus. Après un silence, Corinne L. décide de la prendre. « J’espère que justice sera faite pour les Palestiniens et les Palestiniennes. »
mise en ligne le 27 mai 2025
Locataires et militants
se mobilisent contre les expulsions locatives à Paris
Maud Mathias sur www.humanite.fr
L’association Droit au logement appelait jeudi 22 mai à une mobilisation, devant la mairie du XXe arrondissement, pour protester contre les expulsions locatives. Ils dénoncent des pratiques frauduleuses et demandent une application stricte des lois protégeant les locataires.
« Je paye mon loyer, je fais tout dans les règles. Mais le juge ordonne mon expulsion. » Sourire désabusé aux lèvres, Nadia témoigne de l’injustice qui risque de lui coûter son logement. Elle se fond parmi la trentaine de manifestants, campés devant la mairie du XXe arrondissement pour protester contre les expulsions locatives, ce jeudi 22 mai, à l’appel de l’association Droit au logement (DAL). Alors que la trêve hivernale s’est achevée il y a près de deux mois, les expulsions se multiplient à Paris. Et ce sans que des solutions de relogement soient proposées aux locataires mis à la porte, qui risquent de se retrouver à la rue. En 2024, plus de 24 000 locataires ont été expulsés, d’après la Chambre des commissaires de justice – contre 3 500 en 1983. En cause : l’insuffisance de logements sociaux, la hausse des loyers et une politique de l’État qui soutient le logement cher et la spéculation.
Aucun relogement proposé
Nadia, la cinquantaine, vivait depuis 2018 avec son compagnon, dont le seul nom figurait sur le bail. À la suite de son décès en 2024, Nadia demande le transfert du bail, qui lui est refusé. « Ils m’ont dit qu’ils n’avaient aucune preuve que j’avais bien vécu toutes ces années dans l’appartement », raconte-t-elle avec amertume. Sous le choc du décès de l’homme qui partageait sa vie, Nadia a perdu son travail ; la peur de devoir quitter son logement l’a précipitée dans une spirale d’angoisse infernale. « J’ai perdu pied », souffle-t-elle. Assignée au tribunal administratif depuis décembre dernier, le jugement vient de tomber : on l’expulse. Elle a déposé un recours, sans grand espoir.
Également présente parmi les manifestants, Maria, 35 ans, est venue en lieu et place de sa mère, menacée d’expulsion. La retraitée de 66 ans loue depuis plus de dix ans un appartement à un particulier, dont elle a toujours payé le loyer en temps et en heure. Problème : le logement est insalubre. Fissures, humidité, moisissures sur chaque mur : les conditions de vie y sont insupportables. La locataire fait remonter ses difficultés au syndicat de copropriété, sans que rien ne change… jusqu’à ce que la propriétaire décide de l’expulser « pour fuir le problème », dénonce Maria. Malgré un droit au logement opposable (Dalo) positif, qui devrait donc lui garantir l’accès à un logement social, aucune solution de relogement ne lui a été proposée. Ses affaires sont déjà entreposées dans un box, dans la crainte de se retrouver à la rue incessamment.
« Le paradis de la fraude »
Si les plus démunis sont les premières victimes de la crise aiguë du logement, celle-ci profite à une minorité de gros propriétaires, avec l’encouragement du gouvernement. « On propose des allégements fiscaux pour les dons intrafamiliaux, pour aider les enfants de riches à acheter des biens pour le louer et vivre de la rente. C’est le cadeau que vient de faire le gouvernement dans son budget 2025, qui peut monter jusqu’à plus de 50 000 euros », explique Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL. Les logements chers rapportent gros : une recette qui s’élève à 92 milliards d’euros en 2023, tirée des ventes, de la TVA et de la taxe foncière, contre seulement 42 milliards d’euros de dépenses pour les logements sociaux et les aides.
Les rapports locatifs, c’est le paradis de la fraude. L’idéal d’un bailleur, c’est de gagner de l’argent sur l’exploitation. Mais avec la crise, payer le loyer devient difficile pour beaucoup Résultat, de plus en plus de gens sont jetés à la rue », soupire le porte-parole de l’association. Des lois conquises à la suite de mobilisations sociales ces trente dernières années, notamment la loi Dalo de 2007 qui prévoit le relogement des personnes jugées prioritaires, ne sont pas systématiquement appliquées. Le DAL dénonce également des « congés frauduleux » : « On peut délivrer un congé au locataire sans qu’il ait le temps de se retourner contre le bailleur. Alors souvent, le locataire qui attaque son bailleur parce que son logement n’est pas décent ou ne respecte pas l’encadrement des loyers, reçoit un congé », déplore Jean-Baptiste Eyraud.
Pour lutter contre les pratiques malhonnêtes et résorber la crise du logement, Droit au logement demande la création d’une autorité de contrôle qui soit en capacité de sanctionner les pratiques abusives. Une délégation de militants et d’habitants expulsables a été reçue par le cabinet du maire du XXe arrondissement, Eric Pliez (DVG), pour obtenir la suspension des expulsions. Sans grand succès : la mairie n’a pris aucun engagement quant au relogement des quatre familles dont la situation était examinée, qui risquent donc de se retrouver sans domicile.
mise enligne le 27 mai 2025
400 plans de suppression d’emplois : Macron, clown de la réindustrialisation
Pierre Jequier-Zalc sur www.politis.fr
La CGT vient de publier une carte actualisée des plans de suppression d’emploi. Depuis septembre 2023, près de 90 000 emplois directs sont menacés ou supprimés. Un chiffre qu’Emmanuel Macron ignore. Pire, lui et ses gouvernements refusent toute intervention politique pour endiguer cette saignée sociale.
Dans le flot de l’actualité, l’information est passée à la trappe. Pourtant, elle a de quoi étonner, a minima. Auditionné par la commission d’enquête parlementaire sur les plans de licenciements, le patron d’ArcelorMittal France, Alain Le Grix de la Salle, confie, sous serment, avoir été reçu par Emmanuel Macron en compagnie de M. Mittal, dirigeant mondial du groupe, mi-mars. Soit, un mois avant l’annonce du vaste plan de suppression de 636 postes. De quoi discuter sérieusement d’un tel sujet ? D’envisager des moyens de sauver ces emplois ? Ni l’un. Ni l’autre. Selon Alain Le Grix de la Salle, le sujet n’a même pas été abordé.
Qu’écrire face à une telle blague ? « Ahurissant », est peut-être le seul qualificatif adapté à la situation. Pourtant, loin d’être exceptionnel, cet exemple caractérise la politique sur le sujet de l’emploi et de l’industrie de l’autoproclamé apôtre de la réindustrialisation : le néant. Alors que les plans de licenciements s’amoncellent partout dans le pays, touchant notamment plusieurs secteurs industriels, Emmanuel Macron fait la sourde oreille.
Organiser sa propre impuissance
Ce mardi, la CGT a présenté une actualisation de sa carte des plans de suppression de postes. Voilà un an, tout pile, que la deuxième organisation syndicale du pays alerte sur un sujet qui devient de plus en plus brûlant en compilant, méthodiquement, l’ensemble des plans de licenciements dont elle a connaissance.
C’est un gouvernement qui organise sa propre impuissance. S. Binet
En octobre 2024, lors de la dernière présentation de sa carte, la centrale avait recensé 180 plans de suppression de postes entre septembre 2023 et septembre 2024. Six mois plus tard, ce chiffre atteint la barre des 400. « Et il est extrêmement minoré. Nous n’avons pas connaissance de tous les plans dans les petites et moyennes entreprises qui passent en dehors de nos radars », rappelle Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Selon le syndicat, cela concerne 88 501 emplois directs supprimés ou menacés. Avec les emplois « induits », ce chiffre explose et se situe entre 157 000 et 244 000, selon les hypothèses. L’estimation est très importante. Pourtant, elle ne semble que peu préoccuper le gouvernement, bien plus loquace quand il s’agit de taper sur les musulmans ou sur les précaires. C’est d’ailleurs une Sophie Binet particulièrement remontée qui s’est présentée ce mardi devant la presse pour dénoncer « un gouvernement qui organise sa propre impuissance ».
Et comment ne pas la comprendre quand, avec une année de recul depuis ses premières alertes, on ne peut que constater l’inaction du gouvernement. Ou, pire, sa volonté d’aller contre les intérêts des salariés. L’exemple de Vencorex, avec une nationalisation refusée par l’État, puis un projet de coopérative soutenu par à peu près tout le monde – sauf le gouvernement – retoqué par le tribunal de commerce, en représentent très certainement l’allégorie.
Cette impuissance gouvernementale est aussi évidente que la stratégie des multinationales, largement bénéficiaires, abandonnant volontairement des sites plus assez rentables pour leurs actionnaires, pour délocaliser leur production et maximiser leurs dividendes.
Emmanuel Macron impose sa vision du monde : il n’y aurait rien au-dessus de la loi du marché.
De nombreux leviers publics existent pour qu’Emmanuel Macron et François Bayrou mettent un terme à cette saignée sociale. Nationalisation, moratoire sur les licenciements, transparence sur les aides publiques, conditionnalité des aides au maintien de l’emploi… Autant d’outils que le gouvernement pourrait décider d’activer.
Étudier sérieusement la nationalisation
Mais, une fois n’est pas coutume, en organisant son impuissance, Emmanuel Macron impose sa vision du monde : il n’y aurait rien au-dessus de la loi du marché. Et tout interventionnisme de l’État est vu, par essence, comme mauvais. Il s’agirait, pourtant, de sortir d’un dogmatisme inquiétant et de faire preuve de pragmatisme et de « bon sens » : deux valeurs dont les membres de la macronie adorent se draper.
Le bon sens, en effet, c’est de s’interroger sur ce que deviennent les millions – voire les milliards, parfois – d’euros d’aides publiques accordés à des entreprises. Les mêmes qui, ensuite, s’empressent de licencier.
C’est d’étudier sérieusement la nationalisation d’ArcelorMittal, alors que les projets de décarbonation, nécessaires à la poursuite de l’activité française, sont mis entre parenthèses par la multinationale.
Maximiser les rentes du capital n’est pas une politique industrielle sérieuse.
C’est d’écouter les acteurs locaux, syndicats, élus, salariés et même, parfois, patronat, qui proposent des projets de reprise cohérents, comme à La Chapelle Darblay. C’est de travailler au niveau national comme européen pour protéger les salariés français du dumping social et écologique – et non vouloir écarter la directive européenne sur le devoir de vigilance, une réglementation a minima pour faire respecter les droits humains aux multinationales.
Car, disons-le clairement : la politique de l’offre, visant à réduire le coût du travail et à maximiser les rentes du capital n’est pas une politique industrielle sérieuse. Ce n’est pas un principe dogmatique, mais le bilan de huit ans de macronisme.
Méditerranée : les sept jours à la dérive d’un bateau de migrants abandonné
Cécile Debarge sur www.mediapart.fr
En mars 2024, un canot pneumatique transportant environ 80 personnes a dérivé pendant près d’une semaine en Méditerranée centrale. Bien que repéré à plusieurs reprises, personne ne lui a prêté assistance. Seules 24 personnes ont survécu. Mediapart retrace son parcours.
Milan, Catane (Italie).– Lundi 26 mai, les magistrats du tribunal de Crotone, en Calabre, entament l’avant-dernière journée d’audiences préliminaires pour décider si oui ou non deux gardes-côtes italiens et quatre militaires de la Guardia di Finanza doivent être jugés pour le naufrage du Summer Love, au large de Cutro, qui a causé la mort de 94 personnes en février 2023.
Dans l’ombre de ce procès, Mediapart a retracé le sort d’une autre embarcation de migrant·es qui, environ un an plus tard, en mars 2024, a dérivé en Méditerranée centrale pendant près d’une semaine, alors qu’elle avait été repérée par Frontex.
Le 13 mars 2024, il n’est pas encore midi quand l’Ocean Viking, le navire de sauvetage affrété par l’ONG SOS Méditerranée, met le cap sur un bateau en bois qui lui a été signalé. Sur le pont, les sauveteurs scrutent l’horizon. À une quinzaine de kilomètres, un petit point apparaît. À mesure que les trois semi-rigides mis à l’eau approchent, ils distinguent des hommes qui agitent leur tee-shirt depuis un canot pneumatique.
« Les gens sont silencieux et hagards, l’un d’eux avait deux rivières de larmes sous les yeux, sans pour autant crier, ni bouger », décrit Jérôme, le responsable de l’époque de l’équipe SAR (pour « Search and Rescue », recherche et sauvetage). Vingt-cinq personnes se trouvent à bord, des Gambien·nes, des Sénégalais·es et des Malien·nes. Près de la moitié sont des mineur·es isolé·es. Le plus jeune a 12 ans. Deux personnes sont inanimées, étendues sur les planches de bois clouées à la va-vite au fond du canot. L’une d’elles décède peu après.
Aide refusée
Au moment du sauvetage, le bateau se trouve à 120 kilomètres au nord des côtes de Zaouïa, en Libye, d’où il est parti une semaine plus tôt. Pourtant, le canot a été repéré à plusieurs reprises. « Chaque jour, pendant trois jours, un hélicoptère s’est approché de nous, puis a fait demi-tour et est reparti. Nous avons également vu des drones la nuit », témoigne un survivant interrogé par l’ONG Alarm Phone.
Ses propos sont confirmés par deux survivants interrogés par Mediapart. Ils mentionnent également la présence de bateaux de pêche ou de navires marchands, dont certains se sont arrêtés à proximité du canot avant de repartir. « On leur faisait signe de nous aider, nous donner à manger ou à boire, beaucoup sont morts à force de boire de l’eau de mer, témoigne Moudu, un rescapé sénégalais de 21 ans. Tous les jours, on voyait des bateaux et des hélicoptères mais personne ne nous sauvait. »
Après un premier départ raté vers 1 heure du matin, le canot pneumatique met le cap sur l’Italie dans la nuit du 7 mars. Selon les témoignages des survivants, entre 75 et 85 personnes se trouvent à bord. À mesure que l’embarcation s’enfonce dans la nuit, elle se fait malmener par des vagues de plus en plus hautes. Au loin, les lumières de la plateforme pétrolière de Bouri constellent l’obscurité. « Le moteur s’est gâté, se souvient Moudu, on a continué à avancer, sans moteur. »
L’essence se répand dans le fond du bateau et se mélange à l’eau qui menace de faire sombrer l’embarcation. Les bidons devenus inutiles sont vidés et découpés pour écoper. Certains se lèvent et veulent sauter à l’eau, pensant trouver un salut. Ils en sont empêchés. Ce sont les premières hallucinations à bord. Selon les témoignages des survivants, ce moment correspond à celui où l’embarcation est repérée pour la première fois par Frontex.
L’hélico de Frontex
Un Eagle-1, l’hélicoptère de surveillance aérienne utilisé par Frontex, a repéré l’embarcation le 8 mars à 20 h 49, temps universel. Elle se trouve alors dans la zone de recherche et sauvetage libyenne. Un avion quitte la zone dix-sept minutes plus tard après avoir émis un « Mayday Relay » aux centres de coordination de sauvetage italien, maltais et libyen. Selon la procédure, ils doivent prendre le relais pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage. Pourtant, pendant près de quarante heures, il ne se passe rien.
À bord, l’eau arrive jusqu’aux genoux. « On suivait le mouvement des vagues, raconte Moudu. On avait une corde pour essayer de diriger le bateau mais ça n’a pas marché. » Le téléphone GPS ne fonctionne plus. La faim tenaille les estomacs. L’enfant de 2 ans accompagné de sa mère n’a plus la force de pleurer ou de crier depuis longtemps. Les passagers lui donnent la dernière bouteille d’eau pour qu’il n’ait pas à boire l’eau de mer. Il mourra peu après.
Au petit matin du troisième jour, l’oncle de l’un des passagers parvient à contacter l’ONG Alarm Phone pour leur signaler l’embarcation en détresse. Les coordonnées qu’il fournit sont à treize kilomètres environ de ceux identifiés par l’Eagle-1. L’embarcation a déjà dérivé. Une demi-heure plus tard, l’ONG informe les centres de recherche et sauvetage italiens, maltais et libyens. Deux hélicoptères de Frontex reviennent sur la zone mais ne retrouvent pas le bateau.
« La Méditerranée centrale équivaut à la taille de la France ou de l’Espagne, explique le porte-parole de Frontex, Chris Borowski. Y chercher un canot pneumatique est extrêmement difficile, nous avons opéré quatre vols supplémentaires en plus du premier pour retrouver ce bateau, en vain. »
Les centres de coordination de sauvetage libyen, italien et maltais, eux, ne réagissent pas. Aucun d’entre eux n’a donné suite à nos demandes d’entretien.
Responsabilité libyenne
Le Bureau des droits fondamentaux de Frontex, chargé de contrôler le respect par Frontex de ses obligations en matière de droits humains au regard des législations européennes et internationales, a établi les responsabilités qui ont mené à cette tragédie dans un rapport que Mediapart a pu consulter : « Les autorités libyennes avaient l’obligation de coordonner et prendre la responsabilité d’un sauvetage de ce bateau de migrants, car il n’est jamais sorti de la zone de recherche et de sauvetage libyenne et les autorités libyennes ont été informées au moins quatre fois du bateau en détresse. »
Quarante heures après que Frontex eut repéré l’embarcation et près de trente heures après le signalement de l’ONG Alarm Phone, le centre de coordination et de sauvetage italien émet finalement une alerte Inmarsat « au nom des gardes-côtes libyens ». Interrogés par le Bureau des droits fondamentaux de Frontex pour justifier ces quarante heures de délai pour donner l’alerte, les gardes-côtes italiens n’ont pas répondu.
Si tu dormais, même trois ou quatre heures, au réveil tu devenais fou. Et si tu devenais fou, tu mourais. Ali, survivant
Une fois l’alerte Inmarsat émise, aucune opération de sauvetage n’est lancée. Le bateau se voit attribuer le numéro de SAR Case 225. Ses coordonnées sont toujours celles du premier repérage par l’Eagle-1 de Frontex. L’embarcation, elle, dérive toujours.
Le sauvetage final aura lieu à vingt-sept kilomètres du lieu signalé par les autorités italiennes. Autant dire que sans mise à jour de la position du bateau au fil de sa dérive, il était presque impossible pour les navires des ONG patrouillant dans la zone de trouver le bateau. Par deux fois, le 9 et le 11 mars, le navire de sauvetage en mer Life Support a tenté de retrouver le canot pneumatique, sans succès.
À bord, c’est l’hécatombe. « Les gens parlaient dans le vide comme s’ils appelaient leur famille pour qu’elle vienne les secourir », se souvient Moudu. Certains pensent acheter des cigarettes et sautent dans l’eau, de désespoir. En quelques secondes, leur corps disparaît entre les vagues. La nuit, la situation empire. « Si tu dormais, même trois ou quatre heures, au réveil, tu devenais fou, se souvient Ali. Et si tu devenais fou, tu mourais. » Lui-même se souvient des arbres qu’il croyait voir au loin, des heures passées à convaincre l’un de ses amis à bord de l’accompagner au supermarché pour rentrer chez eux. Frontex organise deux autres survols de la zone le 10 et le 11 mars, sans succès.
Un bateau laissé à la dérive
Le cinquième jour, le canot a perdu au moins la moitié de ses passagers et passagères. « Le plus difficile a été de jeter les corps en mer, raconte Moudu. Personne ne voulait le faire mais il a fallu pour leur dignité, pour ne pas que les corps se décomposent au fond du bateau. » Dans ces moments, des prières rompent le silence. « C’était le minimum pour quelqu’un mort devant nous sans que l’on ne puisse rien faire, c’était comme les jeter dans les bras de Dieu », témoigne-t-il.
La frontière entre la vie et la mort est si ténue pour certains passagers que les autres attendent plusieurs heures, voire une journée entière, que le corps soit inerte, avant de s’en séparer. Ceux qui ont encore la force de bouger sont désignés d’office pour vérifier la rigidité des mains, les pupilles. Quand le bateau de sauvetage de SOS Méditerranée les sauve, plus aucun des rescapés n’a la force de se lever ni de marcher.
Pour l’ONG Alarm Phone, il s’agit d’un cas de bateau « left to die », c’est-à-dire sciemment laissé à la dérive. Dans son rapport, le Bureau des droits fondamentaux de Frontex incrimine aussi le manque de communication entre les différents centres nationaux censés coordonner les opérations de recherche et de sauvetage. « Nous avons repéré le bateau, lancé un appel Mayday, alerté les centres de sauvetage de la zone, retrace le porte-parole de Frontex. C’est ce que nous devons faire mais nous n’avons aucun pouvoir pour coordonner les opérations de sauvetage. »
Sur son téléphone, Moudu fait défiler les échanges avec les autres survivants, leurs prières constantes pour les morts : « Ceux qui se sont perdus en mer étaient chargés d’une mission : apporter de l’espoir à leur famille. » Epaulé par une association sicilienne, lui cherche depuis des mois à savoir où a été enterré son ami Abdou, qui voyageait avec lui, mort peu après son transfert à l’hôpital. Il veut se recueillir sur sa tombe et montrer à ses parents où leur fils repose désormais.
mise en ligne le 26 mai 2025
Loi Duplomb
à l'Assemblée nationale :
la dérégulation à tout-va
Clara Gazel sur www.humanite.fr
Examiné à partir de ce lundi à l’Assemblée nationale, le texte porté par deux sénateurs de droite promet de « lever les contraintes » pesant sur les paysans. Cher à la FNSEA, il multiplie les saillies contre les normes environnementales et regorge de mesures contre-productives, comme la ré-autorisation de néonicotinoïdes.
Les porteurs du texte pensent se poser en sauveurs du monde paysan. Débattue ce lundi à l’Assemblée nationale, après son adoption au Sénat, la proposition de loi (PPL) Duplomb – du nom de l’un de ses coauteurs – ambitionne de « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Un titre prometteur bien loin de faire l’unanimité dans la profession et qui soulève de vives contestations des associations environnementales.
En cause, des mesures controversées, parmi lesquelles la réintroduction de néonicotinoïdes et l’assouplissement des normes environnementales pour l’élevage intensif. Autant de mesures chères à la FNSEA qui seront examinées jusqu’au 31 mai et qui font l’objet de plus de 3 500 amendements. Sauf si par un tour de passe-passe législatif, les députés favorables au texte défendent une motion de rejet du texte. En effet, si une majorité de députés la vote, le texte sera immédiatement considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale, donc sans examen dans l’Hémicycle. Il ferait ensuite l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP). Mais en partant de la version du Sénat. « L’unique but de cette manœuvre est de faire passer en force, sans débat démocratique en séance, les dispositions ignobles de cette proposition de loi », a réagi l’association de défense de l’environnement Générations futures dans un communiqué.
Une loi « terriblement rétrograde »
Si les défenseurs de cette PPL brandissent l’argument de l’intérêt général, elle ne satisfait pas l’ensemble du monde paysan. « Elle ne répond en rien aux vrais enjeux comme l’accès à la terre, les revenus ou l’installation, fustige Astrid Bouchedor, chargée de plaidoyer chez Terre de liens. À la place on a plus de pesticides, moins de contrôle et plus de concentration des terres. »
Fanny Métrat, porte-parole de la Confédération paysanne, dénonce une loi « terriblement rétrograde » qui ne répond pas aux causes structurelles de la crise agricole – les mêmes qui avaient déclenché la vague de contestation de l’hiver 2024. « On nous impose un faux narratif selon lequel les normes environnementales seraient responsables de nos souffrances. »
Pire : pour Mathieu Courgeau, coprésident du collectif Nourrir, organisme agricole et citoyen qui œuvre à la refonte du système agricole, la loi détourne l’agriculture de l’indispensable transition écologique. « Elle ne propose rien pour adapter notre modèle aux dérèglements climatiques, qui sont pourtant la deuxième préoccupation des agriculteurs après le revenu. »
Les pesticides érigés en totem
Parmi les mesures les plus décriées, l’article 2 autorise, pour trois ans, des dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes, autorisés ailleurs en Europe. « C’est un choix purement politique, qui n’a rien de scientifique. Les risques pour la santé humaine et la biodiversité sont bien documentés dans la littérature académique », rappelle Yoann Coulmont, chargé de mission plaidoyer chez Générations futures.
Pour Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, « il faut en finir avec le ”pas d’interdiction sans solution”, chiffon rouge agité pour les filières noisette et betterave, qui ont des alternatives et dont la majorité des récoltes est exportée ».
Autre point sensible : la suppression de la séparation entre vente et conseil des pesticides. Un danger clair pour Générations futures, qui rappelle que les vendeurs ont « des intérêts économiques évidents ». Quant à la volonté de soumettre l’Anses – qui délivre les autorisations pour les pesticides – à un comité d’orientation agricole, écartée en commission à l’Assemblée, elle pourrait revenir par voie réglementaire. « C’est une stratégie de diversion de la ministre Genevard », tance Yoann Coulmont.
Encourager les méga-fermes
La PPL prévoit d’abaisser les seuils déclenchant une étude environnementale pour les projets d’élevage intensif. « Pour les volailles, le seuil passerait de 40 000 à 85 000. En dessous, plus d’étude systématique », explique Sandy Olivar Calvo, de Greenpeace. Un soutien affiché à l’élevage intensif et un « appel d’air pour la concentration des fermes », selon Stéphane Galais, de la Confédération paysanne. À qui profiterait cette mesure ? « À une infime minorité car moins de 2 % des exploitations sont au-dessus de ces seuils », répond Sandy Olivar Calvo.
Prévue dans le texte sénatorial, la mesure facilitant la construction de mégabassines a été retoquée en commission. Mais le gouvernement prévoit déjà de la réintroduire par amendement, sous pression de la FNSEA, qui dénonce un texte « détricoté ».
Pressions de la FNSEA sur les élus
Le syndicat, qui soutient ce texte « vital », agite la menace de nouvelles actions ce lundi, aux côtés des Jeunes agriculteurs. Pour faire pression, certains membres n’ont pas hésité à harceler de messages des députés ou à dégrader des permanences dans les Hautes-Pyrénées, l’Hérault ou le Cher. « Contrairement aux pratiques mafieuses des dirigeants de la FNSEA, on va soutenir les élus opposés à la loi en déposant des fleurs, symbole de biodiversité, devant les permanences », réagit Thomas Gibert, porte-parole de la Confédération paysanne.
Le syndicat fustige le « forcing de la FNSEA », qui a conduit à l’adoption de la procédure accélérée pour cette PPL, « loin de faire l’unanimité chez les députés du bloc central ». Autant dire qu’elle a du plomb dans l’aile, suscitant même des divergences entre ministères : début mai, la ministre de la Transition écologique qualifiait la réintroduction d’un néonicotinoïde de « fausse solution », quand sa collègue de l’Agriculture saluait un texte « équilibré ». Rappelons qu’Annie Genevard vient des rangs LR, comme Laurent Duplomb, coauteur de la loi et ancien élu de… la FNSEA.
Comme si les reculs environnementaux ne suffisaient pas, Annie Genevard a annoncé le 20 mai une coupe drastique de 15 millions d’euros dans le budget alloué à l’Agence bio, chargée de structurer la filière. Un « signal délétère », dénoncent professionnels et associations. « On veut sortir du marasme dans lequel on est, lance Fanny Métrat. On n’en peut plus de ces discours qui nous montent les uns contre les autres et nous isolent des citoyens. » Des citoyens qui, en grande majorité, rejettent cette loi, rappelle Sandy Olivar Calvo : « Les députés doivent se souvenir qu’ils n’ont pas été élus par la FNSEA, mais par des citoyens très inquiets des dangers qu’elle porte. »
Agriculteurs, ils disent
non à la loi Duplomb
Par Fanny Marlier sur https://reporterre.net/
Aides fléchées pour les élevages industriels, pesticides à gogo... La loi Duplomb ne bénéficiera qu’à une poignée de gros agriculteurs, insistent les paysans interrogés par Reporterre.
Supposé « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », ce texte pourrait bel et bien accélérer la fin de la profession. C’est le sombre constat dressé par nombre d’agriculteurs qui espèrent arriver à instaurer un rapport de force en amont de l’examen de la loi Duplomb, qui débute lundi 26 mai à l’Assemblée nationale. Les partisans du texte vont déposer aujourd’hui une motion de rejet pour contourner les amendements déposés par les écologistes et insoumis. Si cette motion est votée, l’examen de la loi passera directement en commission mixte paritaire (CMP), réunissant qu’un petit nombre de députés et sénateurs pour travailler sur la version du Sénat.
Dans le détail, le texte écocidaire pourrait réintroduire des pesticides dangereux, encourager l’épandage par drones, favoriser la construction de mégabassines, détruire les zones humides, ou encore, affaiblir l’indépendance de l’Anses, l’agence nationale chargée d’évaluer et d’autoriser la mise sur le marché des pesticides.
« Cette proposition de loi ne répond pas aux attentes du monde agricole fustige Thomas Guibert, porte-parole du syndicat agricole la Confédération paysanne. Ce texte ne bénéficiera qu’à une poignée de très gros agriculteurs, toujours les mêmes, c’est-à-dire ceux notamment ceux qui dirigent la FNSEA. »
En sous-texte, le syndicaliste souligne combien cette loi découle des demandes de la FNSEA, le syndicat qui défend une agriculture productiviste intensive avide de produits phytosanitaires. Derrière ce texte, le sénateur Les Républicains (LR), Laurent Duplomb, est d’ailleurs lui-même un ancien élu de la FNSEA. À l’opposé, la loi constituerait une menace pour l’agriculture paysanne, « celle qui relocalise, respecte les sols et tente de préserver les ressources en eau », souligne la Confédération paysanne.
Au-delà des effets pour la santé et la biodiversité, parmi les dispositifs qui inquiètent les agriculteurs, il y a aussi celui facilitant l’essor des élevages industriels. Selon le niveau de danger qu’elles représentent pour la santé et l’environnement, certaines catégories d’installations, appelées les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont soumises à une réglementation particulière nécessitant une demande d’autorisation préalable. On y trouve des industries, des usines, mais aussi de grands élevages.
Mégapoulaillers industriels
La loi Duplomb vise à élever les seuils de ces élevages soumis à autorisation, en passant par exemple d’un élevage de 40 000 volailles à 85 000 volailles. En 2024, près de 19 000 sites étaient soumis à ce régime d’autorisation, soit moins de 5 % des exploitations agricoles françaises.
« La mesure concerne très peu d’exploitations mais elle pourrait avoir des conséquences environnementales majeures, notamment en termes de pollution de l’eau, pointe Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace. Sans compter que l’accélération des élevages industriels se fait toujours au détriment d’autres exploitations, plus petites, et entraîne généralement leur chute. »
Le nombre d’agriculteurs et de fermes en France ne cesse, en effet, de baisser. À tel point qu’en dix ans, entre 2010 et 2020, la France a perdu 101 000 exploitations agricoles. En cause, le coût des installations, les faibles rémunérations, les conséquences du changement climatique, la difficulté à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
« L’accélération des élevages industriels se fait au détriment des petites exploitations »
Les grandes exploitations, autour de 136 hectares, sont les seules à avoir vu leur nombre augmenter. Les exploitations ne cessent de s’agrandir et de se spécialiser. Sur la décennie, la taille moyenne des exploitations est passée de 55 hectares en 2010 à 69 hectares en 2020.
Plus de pesticides, moins de contrôle
« La loi Duplomb propose uniquement d’utiliser davantage de pesticides, d’alléger les contrôles, et de faciliter les concentrations », résume Astrid Bouchedor, responsable de plaidoyer de Terre de Liens.
Avec quelles conséquences ? Thomas Guibert, de la Confédération paysanne, donne un exemple d’un effet domino délétère. La réintroduction de certains pesticides va nuire aux abeilles et donc nuire aux apiculteurs... qui doivent déjà faire face à « des importations cassant les prix ». Sans parler des baisses de rendement dues à une pollinisation des fruits et légumes en baisse.
Surtout, la loi Duplomb ne répond pas aux demandes issues du monde agricole, martèlent ces agriculteurs. Un sondage Ifop, du Collectif Nourrir réalisé en février 2024 auprès de 600 agriculteurs indiquait qu’à peine 4 % des répondants sont préoccupés par les restrictions sur les pesticides.
Détricotage des mesures favorables à l’environnement
Au total, 52 % citaient le contexte économique comme source de préoccupation majeure, en particulier l’augmentation des coûts (18 %), l’instabilité des marchés (16 %), et des prix de vente insuffisants (12 %). Autre point important : 60 % des agriculteurs interrogés disaient vouloir se tourner vers l’agroécologie et la bio.
En guise de besoins urgents, Astrid Bouchedor, de Terres de liens cite pêle-mêle : la création d’une grande loi foncière facilitant l’accès à la terre, ainsi que la réorientation des aides, comme celles de la PAC, davantage fléchées vers des fermes agroécologiques « à tailles humaines ».
Pour l’heure, le gouvernement ne semble pas prêt d’y répondre favorablement. Mardi 20 mai, l’Agence bio chargée du développement de la promotion des produits bio a appris la suppression des 5 millions d’euros à son budget dédié aux campagnes de communication, ainsi que la réduction de 10 millions d’euros de la dotation de son fonds Avenir bio, destiné à soutenir des projets de développement de filières biologiques.
Quoi qu’il en soit, la loi Duplomb s’inscrit dans la lignée des politiques de détricotage des mesures favorables à la protection de l’environnement et à la santé des citoyens à l’œuvre depuis plusieurs mois. « Il est incompréhensible de voir aujourd’hui les députés débattre d’un texte qui met en péril notre capacité à produire demain et à assurer un environnement et une alimentation saine pour tout le monde », insiste Mathieu Courgeau, éleveur et coprésident du Collectif Nourrir.
Et de conclure : « Alors que les agriculteurs et les citoyens appellent de leurs vœux à une transition de notre système agricole et alimentaire, cette loi est à contre-courant de l’histoire, des réalités scientifiques et des attentes de la société. »
Derrière la loi Duplomb,
le lobby antisciences
Vanina Delmas sur www.politis.fr
La proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » est examinée à partir d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Elle nie la protection essentielle du vivant et les expertises scientifiques.
Le 5 mai, plus de 1 200 médecins, chercheurs et scientifiques ont signé une lettre ouverte adressée aux ministres de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Environnement, à propos des menaces pour la santé, l’environnement et l’expertise scientifique que fait peser la proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Portée par le sénateur Les Républicains (LR) de la Haute-Loire, Laurent Duplomb, elle a été largement adoptée en janvier en première lecture par le Sénat.
Elle est présentée par la droite et une partie du gouvernement comme un complément de la loi d’orientation agricole et une réponse à la colère du monde agricole. Ou plutôt d’une partie du monde agricole : la minorité qui déclare les normes environnementales comme la source de tous leurs problèmes. Parmi ses huit articles, la « PPL Duplomb » en compte plusieurs qui nient totalement les dizaines d’expertises scientifiques réalisées ces dernières années.
Risque de retour des néonicotinoïdes ?
L’article 2 fait courir le risque d’une réautorisation de certaines substances néonicotinoïdes, des pesticides « tueurs d’abeilles » interdits en France depuis 2018 comme l’acétamipride, le sulfoxaflor et le flupyradifurone. L’ONG Générations futures (GF) a décidé de « remettre les faits et la science au cœur des débats » afin de lutter contre la désinformation et les contre-vérités notamment sur l’acétamipride, autorisé ailleurs en Europe et présenté comme moins toxique que les autres. GF pointe les multiples défaillances des évaluations au niveau européen, que ce soit sur sa persistance dans l’environnement que sa toxicité pour les abeilles et la santé humaine.
« Nous avons identifié au moins 23 nouvelles études universitaires parues ces deux dernières années, apportant de nouvelles preuves de la toxicité significative de cette substance sur les abeilles, précise Pauline Cervan, toxicologue. De plus, l’évaluation réglementaire a été particulièrement lacunaire : les risques chroniques n’ont pas été correctement évalués, les effets sur les abeilles solitaires et les bourdons n’ont pas du tout été évalués, tout comme les effets sublétaux qui troublent les comportements, les capacités de reproduction des populations et conduisent à leur disparition. »
Un syndicat agricole industriel et certains élus utilisent ce sujet de l’acétamipride pour mettre un pied dans la porte. P. Grandcolas
Concernant les impacts sur la santé humaine, l’ONG signale l’existence de plusieurs études dans la littérature académique indiquant un effet neurotoxique pour le développement, qui ont été globalement ignorées par les agences européennes d’évaluation des risques. Générations futures et Pesticide Action Network (PAN) Europe vont un cran plus loin en appelant à interdire totalement l’acétamipride pour tous les usages en Europe, agricoles et biocides.
Pour Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie et Environnement au CNRS, l’adoption de cette loi serait un recul catastrophique sur le plan écologique alors que « la France était pionnière sur l’interdiction des néonicotinoïdes ». « Même s’il faut argumenter sur leur dangerosité, et les problèmes liés aux filières qui poussent pour leur retour – la betterave et la noisette – je pense qu’il y a un enjeu plus fort derrière : un syndicat agricole industriel et certains élus utilisent ce sujet de l’acétamipride pour mettre un pied dans la porte et enclencher le début d’une déréglementation plus générale », analyse le chercheur.
Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste et président de l’association Alerte des médecins sur les pesticides juge cette proposition de loi « hors-sol » : « Une expertise collective de l’INRAE de 2022 montre que tous les milieux sont contaminés par ces substances (air, sol, eau, flore, ) et que tous les niveaux d’organisations biologiques, du ver de terre aux mammifères sont impactés. Or, si vous perdez 70 % de la biomasse des insectes, combien d’années faut-il pour que cela impacte l’agriculture ? Pas beaucoup. Comment peuvent-ils en faire abstraction ? »
Côté santé humaine, plusieurs expertises de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) – en 2013 et 2021 – démontrent clairement les liens entre pesticides et pathologies graves chez les agriculteurs et les enfants exposés aux pesticides : cancers du sang, de la prostate, maladie de Parkinson, troubles du développement neuropsychologique et moteur de l’enfant, troubles cognitifs et anxio-dépressifs de l’adulte…
Dans son cabinet de médecin généraliste à Limoges, Pierre-Michel Périnaud constate de plus en plus de troubles de la fertilité, de cancers, de maladies métaboliques, des troubles du neurodéveloppement chez les enfants… Des maladies multifactorielles qui devraient faire l’objet d’études approfondies de la part des agences d’homologation des produits, comme par exemple l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Nous pensons que non seulement les agences doivent être maintenues dans leurs rôles mais faire encore mieux. P-M. Périnaud
« Face à des défis comme l’effondrement de la biodiversité, ou l’allongement de la liste des maladies touchant les professionnels exposés aux pesticides, la contamination générale de la population, les agences ont un rôle important à jouer ! Nous pensons que non seulement elles doivent être maintenues dans leurs rôles mais faire encore mieux, et s’ouvrir à des questions scientifiques comme celle de l’effet cocktail », explique-t-il.
Une vision des choses à l’opposé de l’esprit de la PPL Duplomb. Dans sa première version, elle tentait de « mettre sous tutelle » l’Anses, chargée depuis 2014 de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Une lourde responsabilité qui incombait auparavant au ministère de l’Agriculture. L’article 2 remettait donc en cause l’indépendance scientifique de l’Anses et visait à modifier profondément ses modalités de fonctionnement. L’idée était que le gouvernement lui soumette des dossiers à examiner en priorité, à partir de l’avis d’un « Conseil d’orientation pour la protection des cultures », notamment composé de représentants du monde agricole et des industries agrochimiques.
Ces produits peuvent avoir des effets sur le long terme, des effets cocktails avec d’autres produits, leur dégradation peut être toxique. P. Grandcolas
Lors d’une audition devant la commission des Affaires économiques, le directeur général de l’Anses, Benoît Vallet, avait affirmé sa volonté de démissionner si la loi était adoptée en l’état. Cet article a finalement été écarté par les députés de la commission des affaires économiques. Mais, selon le média Contexte, un décret du gouvernement pourrait quand même interagir sur la « hiérarchisation des demandes d’autorisation en fonction des risques de maladies pesant sur les récoltes d’une filière. »
Pierre-Michel Périnaud reste très vigilant sur ce point et attend des garanties en séance plénière sur l’indépendance de cet outil précieux de sécurité sanitaire. « Depuis environ un an et demi, les gouvernements ont un certain nombre d’agences dans le collimateur : l’Ademe, l’OFB, l’Agence bio et l’Anses. Lorsque l’Anses a interdit le métolachlore en 2023, c’était une victoire pour nous, mais l’agence européenne le recommandait depuis 20 ans. Cette décision a été vigoureusement contestée par le ministre de l’Agriculture de l’époque, Marc Fesneau. Ça préfigurait le projet de loi Duplomb ! »
Philippe Grandcolas déplore la méconnaissance de la société sur les données scientifiques et sur la notion de risque lié aux pollutions. « La plupart des interlocuteurs (politiques, agriculteurs, entreprises, citoyens…) ont une représentation erronée de la toxicité. Ils ne la perçoivent que comme une exposition simpliste, à un instant T. Ils ne comprennent pas que ces produits peuvent avoir des effets sur le long terme, des effets cocktails avec d’autres produits, que leur dégradation peut être toxique, qu’ils peuvent se concentrer dans les réseaux alimentaires de la biodiversité, et s’accrocher aux graisses afin de rester dans le corps humain… » Après des cours sur le changement climatique, peut-être que les scientifiques devraient organiser des séances de rattrapages en sciences de la vie et de la terre pour les députés.
Pesticides :
comment la loi Duplomb menace notre santé
Par Émilie Massemin sur https://reporterre.net/
Une proposition de loi vise à réduire l’indépendance de l’Anses, l’agence qui autorise la mise sur le marché de produits contenant des pesticides, « au mépris des exigences sanitaires », dénoncent des scientifiques.
« Agriculteurs, riverains, citoyens ne veulent plus servir de cobayes. » Dans une lettre ouverte adressée lundi 5 mai aux ministres de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de la Transition écologique, 1 279 médecins, chercheurs et scientifiques alertent sur la menace pour la santé publique que représente la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Portée par le sénateur (Les Républicains) de la Haute-Loire Laurent Duplomb, elle prévoit entre autres la réautorisation de certains néonicotinoïdes, les fameux pesticides « tueurs d’abeilles ».
Surtout, elle corsète plus étroitement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), l’établissement public qui évalue les risques sanitaires et délivre les autorisations de mise sur le marché des pesticides. Adoptée par le Sénat le 27 janvier, cette proposition de loi est examinée en commission du développement durable à l’Assemblée nationale les 6 et 7 mai.
« Faire primer les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales »
Depuis 2015, l’Anses délivre, refuse et retire les autorisations de mise sur le marché des produits contenant des pesticides. Mais la proposition de loi prévoit qu’elle soit tenue d’informer ses ministères de tutelle — Santé, Agriculture, Travail et Environnement — avant de délivrer ses avis et recommandations.
Elle crée aussi un Conseil d’orientation pour la protection des cultures, qui doit indiquer à l’agence les pesticides sur lesquels ses décisions sont attendues en priorité, en fonction des difficultés rencontrées par les filières. Cette nouvelle instance serait majoritairement composée de représentants des filières agricoles, de l’industrie des pesticides et des instituts techniques, selon un projet de décret consulté par Le Monde.
« Trumpisation de nos institutions »
« Ce conseil pourrait essayer de faire primer les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales, comme c’est le cas actuellement avec la demande de réautorisation des néonicotinoïdes au nom de la crise de la betterave ou de la noisette », s’alarme Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste et président de l’association Alerte des médecins sur les pesticides. « Cette priorisation va s’imposer à l’Anses au mépris des exigences sanitaires. C’est une véritable trumpisation de nos institutions, effrayante dans sa rapidité et la violence de ses mesures », renchérit l’historienne des sciences et vice-présidente d’Alerte pesticides Haute-Gironde Sylvie Nony, elle aussi signataire.
Ce n’est pas la première fois qu’une partie de la classe politique cherche à brider l’Anses. En mars 2023, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau (MoDem) avait demandé à l’agence sanitaire de revenir sur l’interdiction du S-métolachlore, un herbicide très utilisé dans la culture du maïs, du tournesol et du soja et responsable d’une contamination quasi-généralisée des nappes phréatiques. En novembre, c’est sa successeuse, Annie Genevard (Les Républicains), qui avait elle-même annoncé la création du Conseil d’orientation pour la protection des cultures.
« Cela pourrait fragiliser le système de sécurité sanitaire dans son ensemble »
Contactée par Reporterre, l’Anses n’a pas souhaité s’exprimer. Mais, le 10 avril, son comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts s’était ému du fait qu’un conseil d’orientation pourrait « remettre en cause le fonctionnement actuel et les garanties de transparence sur les avis et d’indépendance des décisions » de l’agence. Fin mars, le directeur de l’Anses, Benoît Vallet, avait annoncé son intention de démissionner si la proposition de loi Duplomb était adoptée.
« Cette réforme pose un problème déontologique, car les industriels pourraient influencer les décisions. Cela pourrait fragiliser le système de sécurité sanitaire dans son ensemble », avait-il alerté en février pendant le Salon de l’agriculture, rappelant que « les agences sanitaires ont justement été créées pour séparer les intérêts économiques et sanitaires ».
La contamination de l’environnement est généralisée
L’Anses est attaquée alors que les preuves s’accumulent sur la dangerosité des pesticides. Publié en 2021, le rapport de synthèse Pesticides et effets sur la santé de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale confirme la « présomption forte » d’un lien entre exposition aux pesticides et lymphomes non hodgkiniens, myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique chez les agriculteurs.
Un lien est également observé entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central, ainsi que des troubles du développement neuropsychologique et moteur.
Ces conséquences sanitaires sont d’autant plus préoccupantes que la contamination de l’environnement aux pesticides est généralisée. D’après une enquête du Monde, les pesticides et leurs sous-produits sont présents et quantifiés dans 97 % des stations de contrôle de la qualité de l’eau, et dépassent les normes dans près de 20 % d’entre elles.
Plutôt que d’affaiblir l’agence sanitaire, les signataires de la lettre ouverte préconisent le renforcement de l’évaluation des risques liés aux pesticides. « En juin 2023, l’État français a été condamné pour des failles dans les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, notamment parce qu’il ne tenait pas compte des données scientifiques les plus fiables et des résultats de la recherche les plus récents », rappelle à Reporterre Florence Volaire, chercheuse en écologie à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et signataire de la lettre.
Le texte des scientifiques formule ainsi plusieurs recommandations : mettre en œuvre une « véritable médecine préventive » et un suivi effectif de la santé au travail pour l’ensemble des travailleurs agricoles, y compris précaires ; rendre automatique la communication en temps réel des pesticides épandus à l’échelle de la parcelle vers une base de données accessible aux chercheurs ; prendre en compte les études réalisées par des universitaires indépendants, en complément des évaluations fournies par les industriels ; étudier la toxicité chronique et l’effet cocktail des formulations avant leur autorisation de mise sur le marché, « une obligation introduite par le règlement 1107/2009 de l’Union européenne, que la France ne respecte toujours pas », souligne Sylvie Nony.
mise en ligne le 25 mai 2025
Gaza : à quand une grande mobilisation en France ?
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Au sommet des États et dans les rues, le monde sort peu à peu du silence face au déchaînement de bombes qui accable les Palestiniens. Mais en France, la gauche peine à organiser un rassemblement.r
Face à la famine qui gagne, à l’intensification des bombardements et aux toujours plus nombreux morts palestiniens, les réactions internationales commencent timidement à se faire entendre. Parmi les dirigeants les plus actifs, on trouve le gouvernement irlandais, qui s’était associé à la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, accusant l’Etat hébreu de « génocide » à Gaza.
Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol affirmait ce week-end dans une allocution au sommet de la Ligue arabe qu’il faut « intensifier notre pression sur Israël pour arrêter le massacre à Gaza, notamment par les voies que nous offre le droit international ». Il précisait que l’Espagne allait présenter un projet de résolution à l’ONU pour que la Cour Internationale de Justice « se prononce sur le respect par Israël de ses obligations internationales » et une autre pour qu’Israël mette « fin au blocus humanitaire imposé à Gaza » et garantisse « un accès complet et sans restrictions à l’aide humanitaire » dans le territoire palestinien.
Les premiers ministres anglais et canadien ainsi que le président français prévenaient hier qu’ils ne resteraient pas « les bras croisés face aux actions scandaleuses ». Avec 19 autres chefs d’État et de gouvernement, ils exigent une « reprise complète de l’aide de Gaza, immédiatement ». Benyamin Netanyahou leur a répondu ce lundi même : « Nous prendrons le contrôle de tout le territoire de Gaza » et, dans un cynisme atroce, il a affirmé qu’il ne fallait pas laisser mourir de faim les Gazaouis pour « des raisons pratiques et pour des raisons diplomatiques ».
Les opinions publiques, les foules manifestantes aussi se font entendre. Ce week-end, ils étaient près d’un demi-million dans les rues de Londres ; 100 000 manifestants vêtus de rouge à La Haye, aux Pays-Bas pour appeler le gouvernement néerlandais à condamner Israël. Le week-end précédent, 50 000 personnes défilaient dans les rues de Madrid, comme dans une centaine d’autres villes d’Espagne. Les manifestants scandaient : « Ce n’est pas la guerre, c’est un génocide ! », « Boycottez Israël ! ». Il y a un mois, ils étaient 15 000 à Milan. En mars, Lisbonne connaissait des manifestations massives. Les Américains sont sous la coupe de la terreur Trump et n’ont pour le moment pas trouvé le chemin pour renouer avec les protestations qui ont tant irrité les Républicains. Dans le monde arabe aussi, les opinions publiques pèsent sur les dirigeants. On se souvient que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane confiait à des législateurs américains au sujet de l’accord de normalisation avec Israël : « Si je signe, mon peuple me tue ».
Et en France ?
Ça bouge un peu sur le plan diplomatique. Emmanuel Macron a redit en avril que l’hypothèse de la reconnaissance d’un État palestinien par la France est sur la table. Décidée par l’Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron co-présidera avec l’Arabie saoudite en juin une « conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États », à New York.
Et dans la rue ? Tous les samedis à Paris et dans quelques villes se tiennent des rassemblements de soutien, souvent trop clairsemés. Le collectif Urgence Palestine, constitué il y a moins d’un an et aujourd’hui menacé de dissolution par le gouvernement, a rassemblé les plus militants sans parvenir à élargir au-delà. L’insuffisance de la mobilisation est comme un paradoxe dans ce pays historiquement favorable à la cause palestinienne.
De fait, seuls 17% des Français – selon le dernier sondage qui remonte à juin 2024 – s’opposent à la création d’un État palestinien. Malgré l’écœurement face au génocide en cours bien au-delà des cercles militants, aucune grande manifestation à l’horizon. Les logiques répressives mise en place par l’exécutif pèsent. Il y a bien une question spécifique à la France. Dans un paysage où les associations de solidarité avec la Palestine sont faibles, c’est traditionnellement la gauche politique – le PCF, les Verts, LFI – qui conduit les mobilisations. La fracturation de la gauche, là aussi, produit ses effets.
La France insoumise s’est mise aux avant-postes du combat dans une gestion cohérente avec sa stratégie de différenciation par rapport au reste de la gauche. Son choix de propulser Rima Hassan comme figure politique en est l’expression et a produit ses effets. La juriste franco-palestinienne s’interroge, comme beaucoup d‘intellectuels, sur la solution à deux États. Elle s’est fait connaitre en défendant la solution d’un état binational : « From the river to the sea ». Une proposition légitime, souvent avancée au sein de la gauche, israélienne, palestinienne et internationale. Mais elle n’est pas admise par tout le monde, loin de là. Le passage d’intellectuelle à porte-parole puis figure de proue de la campagne des européennes a produit un brouillage, un clivage politique là où la gauche était rassemblée sur la revendication de deux États et d’une reconnaissance par la France de la Palestine. Aucune manifestation unitaire n’a dès lors été possible. Le poison d’une assimilation du soutien aux palestiniens à un combat d’antisémites a fait le reste : la rue a été désertée.
Est-ce que cela excuse les autres forces de la gauche ? En aucune façon. Si la cause palestinienne est devenue un identifiant LFI, c’est aussi parce que le reste de la gauche – de toute la gauche – n’a pris aucune initiative de masse.
Cela étant dit, il faut maintenant tourner la page de cette division. Et appeler à manifester contre le génocide, pour la solution à deux États, pour l’aide humanitaire, maintenant… Une telle initiative, en coordination avec les autres mouvements européens, serait une idée formidable. Et vite, s’il vous plaît.
mise en ligne le 25 mai 2025
À Gaza, un génocide
qui ne dit pas son nom
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Après dix-neuf mois de bombardements, de destructions, d’une famine qui s’installe, la question de la qualification des actes commis par l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne fait de moins en moins de place au doute. La nature de l’offensive contre la population civile et les déclarations du gouvernement qui l’accompagnent étayent l’accusation de génocide tel que défini par les Nations unies en 1948.
Depuis bientôt dix-huit ans, les Gazaouis meurent à petit feu. De guerres (2008, 2012, 2014, 2021, 2023) en blocus inhumain, ils risquent de n’être plus que des morts-vivants sur leur propre terre. Pour ceux qui auront survécu.
Selon l’Unicef, 52 928 personnes ont été tuées, 119 846 blessées depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023. 15 613 enfants ont perdu la vie et 34 173 sont blessés. 11 200 Palestiniens seraient portés disparus, dont beaucoup probablement sous les décombres.
La bande de Gaza – l’une des zones les plus densément peuplées de la planète – ressemble à un champ de ruines. Au 1er décembre 2024, près de 69 % des bâtiments de ce territoire avaient été détruits ou endommagés, selon les images satellites analysées par le Centre satellitaire des Nations unies (Unosat). Au 31 décembre, seuls 18 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnaient partiellement, selon l’OMS, avec une capacité totale de 1 800 lits. L’Unicef affirme que 95 % des établissements scolaires de Gaza sont endommagés ou détruits. Depuis le 7 octobre 2023, des centaines d’écoles ont été directement frappées et 19 universités ont subi de graves dommages.
La CIJ rappelle les obligations des États
Après dix-neuf mois de bombardements israéliens constants qui se poursuivent aujourd’hui, un Gazaoui sur cinq pourrait se retrouver en situation de famine, avertissent les experts en insécurité alimentaire. Les prix des produits de première nécessité ont flambé. Selon les organisations humanitaires à Gaza dont les informations sont reprises par l’ONU, le nombre de repas chauds servis par les cuisines communautaires encore en activité a chuté de 70 % entre le 7 et le 12 mai.
Comment faut-il nommer ce qui se passe dans la bande de Gaza ? « Les actions d’Israël visent à infliger aux Palestiniens des conditions de vie de plus en plus incompatibles avec la poursuite de leur existence à Gaza en tant que groupe », a averti Volker Türk, à la tête du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Le mot « génocide » est de plus en plus prononcé. Notamment depuis que, le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour « génocide » à Gaza auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), le tribunal de l’ONU chargé de régler les différends entre États. Pretoria invoquait « ses droits et obligations » afin de prévenir le génocide.
La définition de l’ONU est précise. Contrairement à l’idée généralement répandue, un génocide ne se traduit pas forcément par l’extermination totale d’un peuple. Selon la convention, le génocide englobe un certain nombre d’actes commis dans l’intention de détruire, intégralement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Elle prévoit aussi et surtout que des États puissent saisir la justice pour empêcher un crime de génocide de se produire.
Elle fait obligation aux États parties de la convention de prendre des mesures pour prévenir et réprimer le crime de génocide. « Cette obligation, ainsi que l’interdiction de commettre un génocide, sont considérées comme des normes du droit international coutumier et s’imposent donc à tous les États, qu’ils fassent ou non partie des 153 pays – dont Israël fait partie – à avoir ratifié la convention », souligne le Centre régional d’information de l’ONU pour l’Europe occidentale.
Dans sa présentation devant la CIJ, l’avocat sud-africain Tembeka Ngcukaitobi dénonçait la « rhétorique génocidaire » d’Israël, dont les officiels appellent les Palestiniens des « animaux humains ». La plaidoirie de l’Afrique du Sud rappelait également le contexte de destruction des infrastructures civiles, de déplacement forcé de populations, d’arrestation de dizaines d’hommes dénudés et transportés dans un lieu inconnu et d’accès limité à l’aide humanitaire d’urgence, poussant les populations à la famine. Dix-neuf mois plus tard, ces actions perpétrées contre les populations et le territoire se sont aggravées. Pourtant, le conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères a évoqué la « tragique souffrance des civils dans cette guerre, comme dans toutes les guerres », mais a parlé des attaques du 7 octobre lancées par le Hamas contre des civils palestiniens comme d’un acte génocidaire.
Des « actes génocidaires »
Dans les attendus de son verdict rendu le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) notait : « À la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l’espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l’article III de la convention sur le génocide et le droit de l’Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable. »
Elle citait également des interventions du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et du commissaire général de l‘organisme des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, qui ont « maintes fois appelé l’attention sur le risque d’une nouvelle dégradation des conditions dans la bande de Gaza ». La CIJ soulignait par ailleurs : « La Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore avant qu’elle rende son arrêt définitif. » C’était il y a dix-sept mois.
C’est pourquoi la Cour internationale de justice estimait « qu’il y a urgence, en ce sens qu’il
existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits qu’elle a jugés plausibles, avant qu’elle ne rende sa décision
définitive », sur la qualification de génocide. Elle prononçait six avis conservatoires, dont la demande faite à Israël
de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d’actes » génocidaires.
C’est sans doute la plus importante mais son application relève de la responsabilité des États, qui peuvent prendre des mesures coercitives. Cela n’est pas le
cas.
« Rendre la bande de Gaza inhabitable »
Professeur à l’université Brown de Providence (Rhode Island), éminent historien de la Shoah et des génocides du XXe siècle, Omer Bartov écrivait le 10 novembre 2023, dans le New York Times, qu’il n’existait aucune preuve qu’un génocide soit en cours à Gaza, « même s’il est très probable que des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité, soient commis ». Mais, en octobre 2024, son avis a changé, comme il l’indique à l’Humanité : « Lorsque je me suis rendu en Israël, j’étais convaincu qu’au moins depuis l’attaque de l’armée israélienne sur Rafah le 6 mai 2024, il était désormais indéniable qu’Israël se livrait à des crimes de guerre systématiques, à des crimes contre l’humanité et à des actes génocidaires. »
Pour l’historien, qui possède par ailleurs la double nationalité israélienne et états-unienne, cela démontre « non seulement un mépris total des normes humanitaires, mais aussi que l’objectif ultime de toute cette entreprise, depuis le début, était de rendre la bande de Gaza inhabitable et d’affaiblir sa population à un point tel qu’elle soit condamnée à disparaître ou à chercher par tous les moyens à fuir le territoire ». Omer Bartov remarque que « la rhétorique des dirigeants israéliens depuis le 7 octobre se traduit désormais dans la réalité – à savoir, comme le dit la convention des Nations unies de 1948 sur le génocide, qu’Israël agissait avec ”l’intention de détruire, en tout ou en partie”, la population palestinienne de Gaza ”en tant que telle, en tuant, en causant des dommages graves ou en infligeant des conditions d’existence destinées à entraîner la destruction du groupe” ».
En mars 2024, la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, avait conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’Israël avait commis des actes de génocide à Gaza. Les dénis israéliens qui en appellent à la Shoah comme garantie de leur impossibilité d’agir de la sorte sont réfutés par Omer Bartov.
« Subir un génocide n’empêche pas de le perpétrer sur autrui. Mais Israël estime que l’Holocauste lui donne le droit à la violence contre autrui et interdit à la communauté internationale d’avoir son mot à dire. » Et les accusations d’antisémitisme servent également à geler toute action internationale. « C’est une manipulation cynique de la propagande israélienne. Il y a de l’antisémitisme, et il faut le combattre. Mais tous ceux qui critiquent Israël ne sont pas des antisémites (…). Quand un citoyen français voit le massacre d’enfants et crie : ”Arrêtez ça !” il crie à son gouvernement de faire quelque chose. Qu’est-ce que cela a à voir avec l’antisémitisme ? » dénonçait, en octobre, le journaliste israélien Gideon Levy dans un entretien à l’Humanité.
La qualification est une obligation juridique
Faut-il attendre que la justice internationale termine son enquête sur la qualification de génocide ? Si celui-ci est avéré, les dirigeants israéliens pourraient être déférés devant des tribunaux ad hoc mais pour la population palestinienne, ce sera trop tard. Interrogé sur TF1, le 13 mai, le président français s’est dit « bouleversé » par la crise humanitaire à Gaza. Mais il a refusé d’utiliser le terme de génocide sans réfuter la possibilité d’une telle qualification. « Ce n’est pas à un responsable politique d’employer ce terme. C’est aux historiens, le temps venu. »
Le temps venu, vraiment ? « Contrairement à ce qu’a affirmé le président, la qualification de génocide n’est ni un travail d’historien, ni le monopole des juges. C’est une obligation juridique qui engage l’ensemble des acteurs politiques, diplomatiques, universitaires et de la société civile », explique Johann Soufi, avocat et procureur international, auprès de l’Humanité. « C’est le sens même de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, comme l’a pointé à plusieurs reprises la CIJ. Celle-ci a rappelé que les États doivent agir dès qu’ils ont connaissance d’un risque sérieux, sans attendre qu’une juridiction se prononce. L’objectif est d’éviter l’irréparable », avance-t-il.
Emmanuel Macron aurait pu lire le rapport publié le 5 décembre par Amnesty International. « Nous avons passé énormément de temps à nous pencher sur l’intention génocidaire », précisait Agnès Callamard, secrétaire générale de l’ONG. « Les actes génocidaires ont été démontrés. Mais ce qui fait la spécificité d’un génocide, c’est l’intention », expliquait-elle. Au terme de toutes ces enquêtes, après avoir constaté les comportements répétés d’Israël malgré les avertissements, s’est dégagée une vision générale. « Avec tous ces éléments, nous n’avons pu trouver qu’une conclusion raisonnable, à savoir qu’”en plus de” ou ”afin de” parvenir à un objectif militaire, Israël avait l’intention de commettre un génocide. »
Un éventail d’actions
L’éventail d’intervention à disposition des dirigeants mondiaux est large, il va de l’embargo total sur les livraisons d’armes ou des composants nécessaires à leur fabrication aux sanctions économiques contre le pays et ses dirigeants. Malheureusement, la France est loin d’être en pointe sur le sujet.
L’Espagne, l’Irlande et la Belgique ont rejoint l’Afrique du Sud dans son procès contre Israël. Les deux premiers ont même reconnu l’État de Palestine. Une décision qu’Emmanuel Macron pourrait prendre lors de la conférence internationale sur la Palestine qui sera coprésidée par la France et l’Arabie saoudite à l’ONU, le 17 juin.
La Convention adoptée par l’ONU contre le crime de génocide
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté à l’unanimité en décembre 1948 une convention qui confirme le génocide comme un crime contre l’un des droits de l’homme le plus élémentaire. Elle détaille « l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » :
« a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle (…) ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
« Le génocide et la complicité de génocide » sont ainsi passibles de la justice internationale.
« Quand la prévention échoue, vient effectivement le temps de la répression. Les tribunaux nationaux ou internationaux jugent alors les responsabilités des personnes physiques ou morales impliquées dans ces crimes, que ce soit comme auteur direct, comme complice ou comme supérieur hiérarchique, note Johann Soufi. Mais pour les victimes, c’est déjà trop tard. C’est pourquoi le devoir de nommer le crime précède l’obligation de juger et de punir ceux qui l’ont commis ou l’ont facilité. »
Avec son association Juristes pour le respect du droit international (Jurdi), il a d’ailleurs adressé deux courriers, le 12 mai, à la présidente de la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne pour « manquement » à leur « obligation d’agir face au risque avéré de génocide à Gaza ».
Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés : « Les Palestiniens sont pris pour cible en tant que peuple »
Pierre Barbancey sdur www.humanite.fr
Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, explique en quoi la guerre à Gaza est génocidaire et estime qu’il est de la responsabilité des dirigeants politiques de suivre les recommandations de la Cour internationale de justice, qui pointe « les risques de génocide », pour le prévenir avant qu’il ne soit trop tard.
Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a participé, à Cannes, à une conférence de presse organisée par la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, dont le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, présenté au festival du film, est consacré à Fatima Hassouna, photojournaliste gazaouie âgée de 25 ans tuée par un missile israélien le 16 avril, alors qu’elle venait d’apprendre que le documentaire avait été sélectionné dans la section Acid.
Depuis la plainte de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, de quelle façon la question du génocide à Gaza se pose-t-elle ?
Francesca Alabanese (Rapporteur spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés) : C’est une question qui se pose de façon accablante, parce que les preuves de ce génocide sont partout. Je ne suis d’ailleurs pas la seule à me demander ce qu’il faudrait qu’Israël fasse de plus pour que les États réagissent et prennent leurs responsabilités. Pire même, beaucoup d’États sont en train de soutenir activement ce qu’Israël est en train de faire, politiquement, économiquement et militairement.
Le dernier volet de mes recherches porte sur les intérêts privés et les flux financiers. Si la Palestine était une scène de crime, il y aurait les empreintes d’une industrie plurisectorielle qui a profité du génocide des Palestiniens. C’est ça la réalité. Alors comment on s’y oppose, entre l’indignation d’une partie de la population et l’indifférence de l’autre, sans parler de la complicité des pouvoirs ?
Quels sont les éléments qui amènent à penser qu’il y a un génocide d’abord, de quelle manière cela va être nommé génocide, et par qui ?
Francesca Alabanese : Moi, quand je parle de génocide, je le fais dans un contexte avec des catégories très spécifiques qui sont celles du droit international. Ce qui constitue un génocide est déterminé par l’article 2 de la convention sur le génocide de 1948. Il stipule que des actes qui sont en tant que tels criminels comme la tuerie, l’infliction de souffrances graves au corps ou psychologiques, la création de conditions de vie calculées pour mener à la destruction ou encore l’entrave aux naissances, le transfert des enfants sont des actes constitutifs de génocide quand ils sont commis avec l’intention de détruire un groupe en tant que tel.
Le groupe en tant que tel, on le repère facilement dans ce cas, puisque, à Gaza, tous les Palestiniens ont été ciblés, même les enfants. Nous l’avons dit dès le début. Maintenant, cela dure depuis un an et demi, nous n’en sommes plus au début.
Et s’il ne s’agissait pas d’un crime intentionnel, on aurait dû voir les traces d’une marche arrière de la part d’Israël. On aurait pu également assister à des tentatives d’enquêtes judiciaires ou des prises de position de membres du gouvernement s’opposant aux méthodes, mots ou propos féroces de quelques-uns, voire à une opposition du Parlement. Rien de cela. C’est l’ensemble de l’apparatus institutionnel qui est animé par cet esprit d’élimination des Palestiniens.
Le but n’est pas de tous les tuer mais cela n’est pas nécessaire à la constitution d’un génocide. Le but, c’est de les chasser de leur terre, de ce qui reste de leur terre. Et s’ils ne partent pas, on les tue. Parce que finalement, le génocide, c’est la destruction physique d’un peuple. Et ce n’est pas seulement le peuple comme ensemble d’individus, c’est le peuple comme esprit de peuple, vie du peuple. Il y a l’élément collectif qui, là, est ciblé, frappé au cœur. Si ce n’est pas un génocide, c’est quoi ?
Emmanuel Macron a récemment déclaré que ce n’était pas aux responsables politiques d’utiliser ce terme-là. Alors, qui doit utiliser ce terme de génocide ?
Francesca Alabanese : Un responsable politique, s’il se définit éthiquement, est quelqu’un qui doit suivre les normes juridiques. Nous vivons dans un système avec des normes. Ce n’est pas au responsable politique d’élaborer un jugement. En revanche, dès que la Cour internationale de justice reconnaît le risque de génocide, c’est à lui de s’activer pour prendre toutes les mesures nécessaires, pour ne pas soutenir et pour empêcher au maximum, pour utiliser sa propre influence, afin de mettre fin à ce qui semble être ou ce qui risque d’être un génocide.
Cela signifie : pas de transfert d’armes ou d’achat d’armes et, si le risque persiste, des mesures économiques, des sanctions. Rien de tout cela n’a été fait, par la France ou par d’autres pays. Et maintenant, ils parlent de la solution à deux États. Trente-trois ans après (les accords d’Oslo – NDLR). Est-ce vraiment la priorité alors que 60 000 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 18 000 enfants, et alors que Gaza a été réduite en poussière ?
Même si les actes de tuerie, de torture qu’on inflige aux Palestiniens jour après jour cessent, même si on arrête de les affamer, il y aura besoin de faire marcher la justice envers les architectes, ceux-là qui ont commis ce génocide. C’est ainsi que doit penser un homme politique.
Liez-vous ce qui se passe à Gaza en ce moment et ce qui se passe en Cisjordanie ?
Francesca Alabanese : Oui, bien sûr. Il y a une attaque globale contre les Palestiniens, avec des vitesses et des intensités différentes. Dans le nord de la Cisjordanie, à Tulkarem, Tubas, Naplouse et Jénine, il y a quand même eu une violence qui ressemble à celle de Gaza.
Mais Israël ne peut pas se permettre de bombarder en jetant l’équivalent de six bombes nucléaires sur la Cisjordanie, simplement parce qu’il y a 800 000 colons, ce qui n’est pas le cas à Gaza. C’est pour cela qu’Israël utilise un peu des stratégies différentes d’annihilation de la Palestine, de la vie des Palestiniens.
La Cour internationale dit qu’il y a un risque de génocide, elle parle de six mesures qu’il faudrait prendre, et Israël n’écoute pas. Le droit international peut-il permettre d’arrêter tout ça ?
Francesca Alabanese : En matière internationale comme au niveau national, le droit ne prend pas effet s’il n’y a pas application. Ce n’est pas le droit qui est en train de faillir, c’est la politique, qui se positionne à l’opposé de là où elle devrait être. Elle ne respecte pas les mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale, pas plus que les décisions de la Cour de justice internationale, qui a déclaré l’occupation illégale. On doit mettre fin à celle-ci, et tout le monde continue d’interagir avec Israël comme si ce pays était souverain à Gaza et en Cisjordanie.
Le monde entier est de plus en plus horrifié de ce qui se passe et se demande comment agir.
Francesca Alabanese : Non, ce n’est pas le monde entier. Même ici (à Cannes – NDLR), regardez autour de vous. Je suis là pour Fatima (Hassouna – NDLR) et pour Sepideh (Farsi – NDLR) ; sinon, ce n’est vraiment pas l’endroit où je voudrais être en ce moment. On parle aujourd’hui de Fatima Hassouna parce qu’elle est morte. Lorsqu’elle était vivante, son travail n’était pas accepté. On est dans un monde schizophrénique où il y a, oui, des principes, l’indignation de quelques-uns, mais l’indifférence de la plupart et la complicité d’autres.
C’est un moment au potentiel révolutionnaire, toutefois je ne vois pas le feu de l’indignation qui fait changer les choses une fois pour toutes. Je le vois parmi les jeunes, mais regardons ce qui se passe : les pouvoirs frappent ceux qu’ils accusent de terrorisme, ceux qui s’indignent et chantent contre le génocide. C’est l’évolution d’un système illibéral qui s’est camouflé en tant que démocratie libérale un peu partout en Occident mais qui ne l’est pas.
Soutenez-vous l’idée de l’envoi d’un convoi diplomatique humanitaire à Gaza ?
Francesca Alabanese : Cela fait trois ans que je dis que nous devons envoyer une force de protection en Palestine. Là, il y a un convoi qui est demandé par 700 organisations palestiniennes et d’autres. Il faut le soutenir. C’est essentiel qu’on ait le soutien du corps diplomatique.
mise en lignele 24 mai 2025
Gaza.
Une mémoire contre l’oubli
Jean Michel Morel sur https://orientxxi.info/
Dans Pour l’honneur de Gaza, le réalisateur palestinien Iyad Alasttal livre un témoignage poignant sur la vie dans l’enclave depuis le 7 octobre 2023, mettant en lumière celles et ceux qui luttent pour survivre malgré l’horreur et l’indifférence du monde.
« Le fait de ne rien entendre est lié à la mort, pas au calme de la fin de la guerre. » Cette phrase est l’une de celles que l’on peut entendre dans le film de Iyad Alasttal, journaliste et cinéaste palestinien, réfugié en France. Elle résume douloureusement la réalité d’une situation que plus personne ne peut hésiter à qualifier de génocide. Pour qu’un génocide soit en cours, il n’est nullement nécessaire que toute une population risque de disparaître. L’intention d’en exterminer le plus grand nombre suffit. Et à Gaza, entre les bombardements des équipements publics, des lieux de culte, des immeubles et de leurs habitants, l’interdiction de laisser entrer l’aide alimentaire et médicale, les coupures d’eau et d’électricité, l’objectif est bien de provoquer l’agonie d’un peuple.
Iyad Alasttal témoigne de cette tragédie qui dure depuis 595 jours. Mais il témoigne aussi de l’intense volonté des Palestiniens de continuer à vivre et de leur préoccupation permanente de ne pas laisser les enfants survivants (au moins 17 000 d’entre eux sont morts) s’abandonner au désespoir alors que d’aucuns n’ont plus ni parents ni famille et que leur existence présente ne ressemble en rien à celle d’avant.
La
bande annonce de « Pour l’honneur de Gaza » d’Iyad
Alasttal est visible sur :
https://youtu.be/sdwRZ21CK_w
Né en 1987 à Khan Younès, dans le sud de Gaza, Iyad Alasttal a suivi des études de cinéma à l’université de Corte, en Corse. Diplômé en 2013, il revient dans l’enclave où, en 2015, il commence à produire et tourner de courts documentaires sur la vie quotidienne de ses habitants. Certaines de ces Gaza Stories diffusées sur YouTube seront primées.
Il quitte la Palestine pour la France en février 2024 et entreprend bientôt la réalisation de Pour l’honneur de Gaza, travaillant avec des collaborateurs restés au pays, mettant au point le scénario, choisissant les personnages et montant les rushes. Le film a été terminé en 2024, ce qui explique qu’on y voit moins de bâtiments détruits qu’aujourd’hui et que le paysage n’est pas encore totalement réduit à un immense champ de ruines.
« Infecté par une maladie qui s’appelle l’espoir. »
L’ambition de Iyad Alasttal n’est pas de montrer les pilonnages incessants de l’aviation, le déploiement des soldats et les fusillades qui s’en suivent, ni la progression dans les rues défoncées des Merkava, les fameux chars israéliens qui n’hésitent pas à démolir les maisons et à écraser les gens.
C’est à travers les portraits de gens qui n’ambitionnent que de continuer à vivre en dépit de la violence qu’on déverse sur eux que le cinéaste témoigne de sa grande empathie pour ce peuple qu’il déclare « infecté par une maladie qui s’appelle l’espoir. »
Une « infection » — que l’on pourrait rebaptiser « courage » — dont fait preuve ce marionnettiste qui, castelet1 sur le dos, se déplace de tente en tente, déclenchant les rires du jeune public. Ou ce dentiste pour enfants qui essaie, avec les moyens du bord, de sauvegarder leur dentition mise à mal par les conditions d’hygiène et de nourriture qu’on leur inflige. Mais être dentiste ne suffit pas : il faut aussi s’improviser thérapeute et organiser des jeux afin de faire oublier pour un moment l’inhumanité à laquelle la soldatesque israélienne, ivre de vengeance, s’emploie à condamner les nouvelles générations gazaouies.
« Parfois, je me demande ce qui nous arrive »
L’expression du courage, c’est aussi cette petite fille, imposante de calme et de dignité, qui se déclare abandonnée, ayant compris que les droits humains dont se gargarisent les pays occidentaux ne s’appliquent pas aux Palestiniens.
Des considérations d’adulte qui lui viennent de son expérience traumatisante et injuste, mais aussi de parents qui lui ont appris qu’en principe il y a des conventions internationales et qu’on ne peut pas traiter « la population palestinienne de Gaza comme un groupe sous-humain ne méritant pas le respect de ses droits fondamentaux ni de sa dignité », ainsi que l’a dénoncé Amnesty International2.
Depuis octobre 2023, au vu des amoncellements de décombres et du nombre de morts — plus de 53 000 à ce jour —, c’est pourtant ce traitement insupportable qui a été infligé aux Gazaouis. Désemparée, une femme journaliste résume cette situation avec une sorte d’incrédulité : « Parfois, je me demande ce qui nous arrive. Où sommes-nous ? Et qu’est-ce que nous faisons ici ? Ce qui nous arrive est incompréhensible et terrible. » — avant d’ajouter qu’elle préférerait ne pas avoir d’enfants pour qu’ils ne soient pas confrontés à une telle abomination.
« Mourir sur sa terre est mieux que l’exode »
La caméra de Iyad Alasttal nous invite à suivre le musicien Ahmad Abu Amsha qui ne lâche pas sa guitare et, suivi d’une cohorte d’enfants, s’installe sur une dune pour évoquer le camp de tentes précaires qu’est devenu son pays.
mise en ligne le 24 mai 2025
« Nos alliés se trompent » : à gauche, des voix s’opposent à l’aide à mourir
Caroline Coq-Chodorge sur www.mediapart.fr
Sara Piazza est psychologue en soins palliatifs et coautrice d’un livre qui prend à partie la gauche, dont elle se réclame. À ses yeux, en soutenant l’aide à mourir, la gauche renonce à agir sur les inégalités des conditions de vie et d’accès aux soins qui créent du « mal mourir ».
L’Assemblée nationale a adopté, mardi 20 mai, les quatre premiers articles du projet de loi sur l’aide à mourir avec les voix presque unanimes de la gauche dans toutes ses composantes. Mais dans le camp progressiste, il existe aussi des voix qui s’opposent farouchement à cette légalisation.
La psychologue Sara Piazza est l’une d’elles. Elle exerce en unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Avec Isabelle Marin, médecin de soins palliatifs dans le même hôpital, elle a publié en 2023 le livre Euthanasie : un progrès social ?.
À cette question, elles répondent fermement par la négative. Et elles dénoncent les partis de gauche qui tous, à l’exception du Parti communiste, se sont engagés à légaliser l’aide à mourir dans leur programme pour la présidentielle de 2022.
Leurs mots sont tranchants : à leurs yeux, l’aide à mourir est « le faux nez d’un ultralibéralisme mortifère qui permettrait de résoudre des problèmes économiques et mettrait en œuvre une fin de vie rapide et pas chère pour les plus fragiles ». Explications de Sara Piazza.
Mediapart : À l’Assemblée, la très grande majorité des députés de gauche défend la légalisation d’une aide à mourir, comme un nouveau droit, une « liberté ultime », celle des malades en fin de vie confrontés à des souffrances réfractaires. Vous êtes au contraire farouchement opposée à cette légalisation, au nom de valeurs de gauche. Comment vivez-vous cette position minoritaire ?
Sara Piazza : C’est difficile. C’est véritablement un enjeu de vie et de mort, une question politique cruciale, et on pense que nos alliés se trompent. Cela rend même virulent, à la mesure de l’enjeu et de notre incompréhension. Le logiciel de la gauche, il me semble, c’est de prendre en compte les conditions socioéconomiques de vie des personnes, les inégalités en matière d’éducation, de justice, et de santé notamment. Être de gauche, c’est rappeler que nous ne sommes pas tous égaux pour exercer notre liberté. C’est la base, quand même.
Mais, d’une part, on entend la prise de parole de collectifs de gauche contre l’euthanasie, à partir de positions marxistes, matérialistes et intersectionnelles, et notamment de collectifs antivalidistes, dans le paysage [lire cette tribune sur le Club de Mediapart – ndlr]. Et d’autre part, on voit de plus en plus de députés de gauche qui commencent à douter sérieusement, en privé, mais aussi quelques-uns qui ont le courage de le dire publiquement.
Cette légalisation de l’aide à mourir bénéfice pourtant d’une très large majorité à l’Assemblée, une convention citoyenne s’est clairement exprimée en sa faveur, et l’opinion publique y est largement favorable. Cela ne vous fait-il pas douter ?
Sara Piazza : J’ai du mal avec la manière dont, systématiquement, on nous dit : « les Français pensent que… » Quand on regarde les sondages de façon fine, en réalité les gens ne savent pas de quoi on parle. Beaucoup de gens continuent de parler, dont certains députés, de la situation de Vincent Lambert. Or précisément, la loi Claeys-Leonetti de 2016 était faite en partie pour répondre à ce genre de situation, en permettant d’arrêter les traitements et de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Aujourd’hui, la loi permet d’arrêter le maintien en vie artificiel d’une personne inconsciente ou dans des états de conscience minimale s’il n’y a pas de perspective de récupération.
La douleur est une construction complexe. Quand on est seul, mal accompagné, qu’on n’a pas les soins qu’il faut, on a mal.
Le principal problème aujourd’hui est que cette loi est mal connue et mal appliquée. Et qu’il y a un dévoiement de l’usage des mots et des représentations. On entend encore dans les discours qu’on meurt de faim et de soif. On peut critiquer la sédation profonde et continue jusqu’au décès, c’est-à-dire en toute fin de vie mettre une personne dans un coma artificiel et arrêter tout ce qui la maintient en vie, dont la nutrition et l’hydratation artificielles. Mais dire qu’on meurt de faim et de soif, c’est une contre-vérité. C’est donner à penser qu’il y a de la souffrance. Or les gens sont profondément endormis, comme lors d’une anesthésie générale.
Des proches de malades et des soignants témoignent de leur traumatisme face à des agonies qui peuvent durer des heures, voire des jours, dans le cadre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. N’est-ce pas un problème ?
Sara Piazza : C’est difficile d’accompagner des personnes en fin de vie. L’euthanasie serait-elle moins difficile à vivre ? On peut aujourd’hui soulager une personne qui veut arrêter sa ventilation, son alimentation ou son hydratation artificielle. Le problème est que la loi actuelle est mal appliquée, parce qu’il n’y a pas assez de moyens, parce que les médecins et les soignants ne sont pas assez formés aux soins palliatifs, aux questions d’éthique.
C’est difficile d’annoncer à un malade droit dans les yeux qu’il a un cancer. Il faut travailler avec les médecins et les soignants pour les soutenir dans ces pratiques dures, les aider aussi à se taire et à écouter ce que pensent et veulent leurs patients. C’est ce qu’on essaie de faire tous les jours. C’est difficile de dire à un patient où il en est de sa maladie, ce qu’on peut lui proposer, être au clair et compréhensible sur les conséquences possibles d’une opération, d’un traitement. Le patient peut dire jusqu’où il peut supporter que la médecine intervienne.
Vous questionnez aussi la pratique d’une aide à mourir dans l’état actuel du système de santé : le manque de personnel, les déserts médicaux. Pour vous, des malades demandent-ils à mourir faute de soins ?
Sara Piazza : On ne peut pas faire comme si les personnes malades étaient dans une bulle. Si des gens ont aujourd’hui envie de mourir, cela ne tombe pas du ciel. Les conditions de vie, matérielles et symboliques, comptent. Quels sont les revenus, la possibilité d’avoir une aide à la maison, un médecin traitant, un accompagnement soutenu à l’hôpital ou en ville ? Quel est l’entourage ? A-t-on des amis, des proches qui viennent nous voir ? Il faut entendre par exemple les collectifs antivalidistes qui décrivent le combat pour tenter de vivre « dignement » comme on dit, tous les jours. On ne cesse de nous décrire les conditions de vie désastreuses dans certains Ehpad. Les conditions de vie des personnes qui tombent malades comptent.
La proposition de loi fixe un cadre : l’aide à mourir ne serait accessible qu’aux personnes ayant une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » et dont la souffrance physique ou psychologique est « réfractaire aux traitements ». N’est-il pas suffisamment restrictif ?
Sara Piazza : Une affection grave et incurable, c’est très large. Quant à la question de la souffrance, là aussi, on considère qu’elle serait, dans la maladie grave, isolée du reste. Il y a plusieurs composantes de la douleur, tout le temps. Dont une part psychique et même sociale.
Prenons l’exemple d’une vieille dame isolée, qui a une affection grave et incurable, qui vit au 6e étage, et dont l’ascenseur ne marche pas : est-ce qu’elle ne vit pas dans certaines conditions qui expliquent aussi son rapport à sa maladie et à sa souffrance ? La douleur est une construction complexe. Quand on est seul, mal accompagné, quand on n’a pas les soins qu’il faut, on a mal.
L’euthanasie laisse espérer qu’on puisse regagner le contrôle sur ce qui nous échappe. Je crois que c’est une illusion.
La Haute Autorité de santé s’est prononcée, après avoir auditionné de nombreux experts, sur la question du pronostic vital engagé à moyen terme. Et ils ont conclu que cela n’était pas possible. On peut éventuellement prédire la mort de quelqu’un à quelques heures ou quelques jours.
Le terme de « phase avancée » est finalement retenu. La Haute Autorité de santé en a donné cette définition : « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie », reprise par les députés. La personne malade qui demande l’aide à mourir devra encore obtenir l’accord d’un médecin qui doit s’assurer, « si la personne le souhaite », qu’elle ait « accès de manière effective » aux soins palliatifs. Ce médecin doit obtenir l’accord d’un autre médecin et d’un soignant qui accompagne le malade. Ces garde-fous ne sont-ils pas suffisants ?
Sara Piazza : Vous me parlez d’un système de soins qui n’est pas celui dans lequel je travaille. À Saint-Denis, il n’y a pas de consultation antidouleur. Dans vingt et un départements, il n’y a pas d’unité de soins palliatifs qui sont les lieux spécifiques pour la prise en charge notamment des patients avec des douleurs réfractaires. 50 % des patients n’ont pas accès aux soins palliatifs. Comment on assure cet accès ? Avec une baguette magique ? Avec quelles ressources ? Avec quel personnel ?
Je ne sais pas dans quelle réalité on imagine les choses. Pour moi, ces patients qui auraient accès à tous les traitements pour soulager leurs douleurs sont virtuels. Ou alors ils habitent à Paris et ont les bons contacts. Et encore, le délitement du système de soins touche même les personnes les plus aisées maintenant.
Dans votre livre, vous reconnaissez que les soins palliatifs peuvent accompagner correctement les patients en phase terminale « la plupart du temps ». L’aide à mourir ne pourrait-elle pas répondre aux exceptions ?
Sara Piazza : Pour moi, on ne fait pas de loi pour une exception. La loi comporte une dimension normative qui renvoie un message, d’une part, et ne peut jamais répondre à toutes les situations, d’autre part. Les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté sont légitimes, mais je crois qu’il faut que la société continue de dire qu’elle ne peut pas y répondre.
Pour la très grande majorité des soignants de soins palliatifs qui accompagnent les personnes en fin de vie, la loi actuelle est suffisante. On a déjà un arsenal législatif qui interdit l’obstination déraisonnable. Depuis 2002, les patients ont le droit de refuser n’importe quel traitement, même s’ils les maintiennent en vie. Il faut surtout développer notre réflexion face à ce que permet la médecine en termes de traitements invasifs.
En Belgique, la plupart des demandes d’euthanasie ne vont pas au bout : les personnes finissent par mourir sans y avoir recours. Mais c’est un soulagement pour les malades de savoir qu’ils peuvent demander une euthanasie si leur situation devenait insupportable. Qu’en pensez-vous ?
Sara Piazza : Cela ne m’étonne pas, l’euthanasie laisse espérer qu’on puisse regagner le contrôle sur ce qui nous échappe. Mais je crois que c’est une illusion et je trouve que ce n’est pas une raison pour légaliser. Je pense qu’on peut proposer un autre modèle où les personnes malades et dépendantes seront mieux accompagnées. Et où on s’assure qu’on fera tout pour qu’elles n’aient pas mal.
Je pense que des médecins, représentant la société, ne doivent pas symboliquement dire « d’accord » à une personne qui demande à mourir. Peut-être qu’elle pense être un trop grand poids pour ses enfants par exemple ? En l’état actuel du projet de loi, le médecin a quinze jours pour répondre à une demande d’aide à mourir. Si sa réponse est positive, le malade a un délai de réflexion de deux jours de réflexion. Pour se faire ligaturer les trompes, c’est un mois...
Quand on est malade, qu’on sait qu’à un moment donné on va mourir, on peut être angoissé. On a peur d’avoir mal, de devenir dépendant. Je sais que c’est un discours qui est difficilement audible, mais l’angoisse, la souffrance, la détresse font partie de l’expérience humaine, il n’est pas question pour moi de mettre fin à cette expérience, mais bien de proposer sans relâche des solutions pour apaiser.
« Non, l’euthanasie
n’est pas une avancée sociale ! »
sur https://www.politis.fr/
Plusieurs organisations et des personnalités interpellent la gauche favorable à la proposition de loi sur l’aide à mourir en pointant les dérives antivalidistes du texte, dans un système de santé plus que dégradé.
Dans les milieux de gauche, pourtant attachés à l’émancipation, à la solidarité et à la justice sociale, les voix critiques de l’euthanasie restent marginalisées, ignorées, voire disqualifiées. Depuis plusieurs années, ces voix s’élèvent, celles de personnes malades, handicapées, âgées, soignantes, citoyennes, qui méritent d’être écoutées sans être renvoyées aux silences et autres sous-entendus nauséabonds.
Notre indignation est pourtant tenace et notre colère intacte. La mal-nommée « aide active à mourir » s’adresse, dans les faits, à celles et ceux que notre société considère comme inutiles, indésirables ou trop coûteux. Elle est un symptôme à combattre et ce combat ne peut se confondre avec les discours de la droite réactionnaire et néofasciste, des Églises traditionnalistes et de leurs tendances abusives. Elle repose sur des représentations validistes et âgistes qui rendent la mort volontaire de certains acceptable.
Faut-il rappeler à la gauche que l’accès aux soins est en voie d’effondrement ?
Nous sommes contre « l’aide active à mourir », à savoir l’euthanasie et le suicide assisté, en particulier dans la société française actuelle.
Faut-il rappeler à la gauche que l’accès aux soins est en voie d’effondrement, dans tous les domaines : soins palliatifs, psychiatrie, pédiatrie, oncologie, entre autres ? Que le renoncement aux soins s’amplifie partout sur le territoire ? Faut-il rappeler à la gauche le contexte politique national et international et la montée de l’extrême droite, la dégradation des conditions de vies d’un nombre de plus en plus grand de personnes, le repli de notre société, de plus en plus fermée et réactionnaire ?
Faut-il se souvenir que le droit à la santé et aux soins est l’un des droits fondamentaux et qu’il ne peut se réduire à un droit à obtenir la mort médicalement assistée ? Faut-il encourager le nihilisme thérapeutique sans prendre en compte l’extension systématique des indications de l’euthanasie dans tous les pays qui l’ont légiférée ?
Nous devons lutter contre les logiques prédatrices et utilitaristes qui ont contaminé l’ensemble des lieux d’accompagnements et de soins.
Soutenir la mort médicalement prescrite et/ou administrée, supposément « digne », sans s’opposer à l’actuelle indignité voire l’inaccès des soins, c’est répondre à la souffrance en supprimant celui qui souffre plutôt qu’en repensant les modalités de vies qui l’amènent à souffrir. C’est renoncer à l’exigence éthique de prendre le temps de saisir l’ensemble de la problématique. Une problématique au croisement de l’individuel et du collectif, du politique et du technique, du soin et du pouvoir.
C’est également prendre tout à l’envers : proposer la mort à l’individu plutôt que repenser le soin et l’accompagnement au niveau politique et collectif. Nous avons besoin d’une reconstruction de services publics dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, dans tous les territoires.
Nous devons lutter contre les logiques prédatrices et utilitaristes qui ont contaminé l’ensemble des lieux d’accompagnements et de soins. En finir avec la tarification à l’activité, valoriser la prévention et les soins sur les seuls diagnostics et évaluations. Créer des lieux où les soignants retrouveront leur mission première : soigner, et où les patients pourront user de leur droit à se soigner. Faut-il rappeler que l’État nous doit les services publics ?
Nous soutenons sans condition les droits des femmes, l’IVG, la contraception, l’auto-détermination des personnes et leurs émancipations.
Nous soutenons sans conditions que toute vie vaut la peine d’être vécue selon ses propres normes et que ce n’est ni aux soignants ni aux gouvernants de décider, de trier, quelles sont les vies qui valent, quelles sont celles qui ne valent pas.
Peut-on émanciper une société sans transformer les racines même du mal ?
Dans le domaine de l’euthanasie, nous sommes pour un esprit des lois – une réflexion politique sur ce que signifie, dans une société fracturée, l’institutionnalisation d’une mort médicalement prescrite ou administrée – et non pour un droit positif qui, comme partout ailleurs où il existe, s’applique d’abord aux personnes considérées comme inutiles car non-productives.
Peut-on émanciper une société sans transformer les racines même du mal : les profondes inégalités d’accès aux soins et à l’accompagnement, l’injustice sociale et fiscale ? Penser que l’euthanasie est une avancée sociale, c’est confondre exclusion et émancipation. La gauche ne peut s’y résoudre.
-
Mathieu Bellahsen, psychiatre
-
André Bitton, président du CRPA et ancien président du Groupe information asile – Collectif Lutte et Handicap pour l’Egalité et l’Emancipation
-
Isabelle Hartvig, résidente d’Ehpad et militante
-
Geneviève Hénault, psychiatre
-
Odile Maurin, pour le collectif Handi Social
-
Sara Piazza, psychologue, pour le collectif JABS
-
Laetitia Rebord, Les Dévalideuses
-
Elisa Rojas, avocate et militante
mise en ligne le 23 mai 2025
Yasmine Tellal, travailleuse agricole
en lutte contre l’exploitation
Hélène Servel sur www.humanite.fr
Cette Marocaine d’abord émigrée en Espagne a connu le calvaire du travail détaché sans contrat de travail dans les champs du sud de la France : salaire en dessous du Smic, violences, harcèlement sexuel. Son ancien employeur s’est déclaré en faillite pour échapper aux poursuites judiciaires. Le procès en appel s’ouvre ce jeudi 22 mai au tribunal d’Avignon.
À peine passé la porte de chez elle, trois chats se glissent entre les jambes de Yasmine Tellal et la béquille sur laquelle elle s’appuie pour marcher. « Ils me changent la vie : après tout ce que j’ai vécu, ils me comprennent et ils me donnent beaucoup de tendresse. »
Arrivée du Maroc en Espagne à 14 ans, cette petite femme apprêtée, cheveux blonds au carré, travaille d’abord dans le prêt-à-porter à Barcelone, puis aux îles Canaries, où elle est responsable d’un magasin. Les affaires marchent bien jusqu’à ce que la crise économique frappe le pays de plein fouet à partir de 2008.
En 2011, un ami lui parle de Laboral Terra, une entreprise d’intérim basée à Murcie qui recrute des femmes pour aller travailler dans les champs du sud de la France. L’entreprise s’appuie sur une directive européenne de 1996 sur le travail détaché qui permet à des travailleurs et travailleuses communautaires ou ayant un titre de séjour dans un pays de l’UE d’aller travailler dans un autre État membre.
Par WhatsApp, on promet à Yasmine qu’elle sera transportée, logée et nourrie et qu’elle percevra un salaire plus élevé qu’en Espagne. C’est décidé : avec une amie, elles décident de rejoindre la France « pour un an, pas plus, histoire de se refaire un peu d’argent ».
Chantage et harcèlement sexuels
Arrivées le soir du 31 décembre 2011 à la gare routière d’Avignon, elles déchantent vite : contrairement à ce qu’on leur avait dit, personne n’est là pour les accueillir et elles attendront plus d’une semaine avant que les responsables de Laboral Terra leur donnent un signe de vie.
Rien ne se passe comme prévu : elles commencent à travailler dans des exploitations agricoles françaises sans contrat de travail, le salaire est en dessous du Smic, les heures ne sont pas toutes comptées… Commencent alors sept années de calvaire dans les champs autour d’Avignon. Les conditions de travail y sont terribles, le harcèlement et le chantage sexuels, systématiques. Repousser les propositions devient de plus en plus compliqué et risqué.
« Un jour, Ahmed, un des responsables de Laboral Terra, m’a ramenée en voiture et puis il s’est arrêté d’un coup au bord de la route et a commencé à m’embrasser de force, à me toucher les seins, à me mettre la main sur son sexe. Je lui ai hurlé d’arrêter, de me ramener chez moi. Il m’a dit : ”Si tu couches avec moi quand je te le demande, je te donnerai 300 euros par mois.” J’ai refusé net et il a fini par me ramener à la maison. J’étais sous le choc. »
En réponse à ses refus, elle est mise à pied et les violences physiques se multiplient jusqu’à la goutte qui fait déborder le vase : un jour, dans les toilettes de l’entreprise, une des travailleuses lui frappe violemment la tête contre le mur et elle perd connaissance. « Elle avait été envoyée par les responsables pour me mettre la pression. Là, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer et avec quatre autres personnes, deux femmes et deux hommes, on est allés taper à la porte de la CGT, dont on avait trouvé le numéro sur Internet. »
Lanceuse d’alerte
Tous les cinq portent plainte en 2017, d’abord au conseil de prud’hommes d’Arles, puis au tribunal pénal à Avignon, notamment sur le volet harcèlement sexuel. Depuis le début des procédures, elle est la seule qui témoigne à visage découvert malgré les nombreuses violences physiques et psychologiques, menaces de mort et pressions qu’elle a subies après ses dénonciations.
Les cinq plaignants croisent la route du Codetras, le Collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangers de l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône, qui les soutient dans leurs procès. Dès le début des procédures, Laboral Terra s’est déclarée en faillite pour échapper aux poursuites.
Ce jeudi 22 mai se tient leur procès au pénal en appel au tribunal d’Avignon. À cette occasion, Yasmine Tellal entend bien rappeler à la juge qu’aucune des personnes plaignantes n’a été entendue, et encore moins sur les questions de harcèlement sexuel. Après sept années de procédures judiciaires interminables et épuisantes, Yasmine Tellal a une santé très fragile.
Mais malgré son état physique, elle a toujours la même détermination dans le regard. Avec son chat Xena – « comme la guerrière » – sur les genoux, elle compte aller au bout de sa démarche. « De toute façon, j’ai déjà perdu ma santé et ma vie : maintenant je veux mettre mes dernières forces pour gagner cette bataille. »
« L’impunité totale » des entreprises qui exploitent les saisonniers agricoles
par Sophie Chapelle sur https://basta.media/
100 000 euros. C’est le montant que doivent les gérants de Laboral Terra, une société d’intérim espagnole, à quatre travailleurs détachés en France. Pour éviter de payer, ils font durer les procédures judiciaires. Reportage au tribunal de Nîmes.
Le banc des prévenus est désespérément vide dans la salle d’audience de la cour d’appel de Nîmes jeudi 22 mai. Yasmine Tellal, elle, est bien présente, aux côtés de son avocate et de ses nombreux soutiens. Ancienne employée de Laboral Terra, une entreprise de travail temporaire espagnole proposant de la main d’œuvre aux entreprises et exploitations agricoles françaises, Yasmine a brisé le silence en 2020 en décidant de saisir la justice. « On était traités comme des animaux », nous avait-elle confié dans cet article de 2020, évoquant les journées de travail de neuf heures, sans pause, où il fallait manger en cachette, les heures supplémentaires jamais payées, et les agressions sexuelles.
En première instance, les deux gérants de l’entreprise, Diego Carda Roca et Sonia Ferrandez Fullera, ont été condamnés à verser à Yasmine et trois autres anciens travailleurs détachés, près de 100 000 euros d’indemnités, au titre des préjudices économique, financier et moral – soit 25 000 euros chacun. Les gérants ont fait appel de cette décision. Ce qui explique la tenue d’une nouvelle audience à Nîmes.
Des prévenus partis en Espagne
Yasmine a fait la route depuis la région de Toulouse où elle vit désormais. Malgré la sclérose en plaques qui l’épuise et l’oblige à se tenir appuyée sur une béquille, elle voulait être là. Les violences subies en tant que femme, le harcèlement, le chantage et les agressions sexuelles ont disparu des charges retenues contre les responsables dans le procès pénal, comme dans les autres précédemment gagnés aux prud’hommes. Yasmine espère pouvoir lors de cette audience en appel rappeler ce que la justice omet de juger.
Mais face au tribunal, nulle trace des représentants de Laboral Terra ni de leur avocat. « Ils sont partis en Espagne, dit simplement la juge qui se tourne vers Yasmine. Des personnes ont été condamnées à vous verser des dommages et intérêts en première instance. Ils ont fait appel mais ne sont pas là. C’est sur ces éléments que la Cour statuera », précise la juge.
Yasmine s’avance vers la barre et tente de dire quelques mots, la juge écourte. Le tribunal annonce une décision le 19 juin avant de passer à l’affaire suivante. L’absence de Laboral Terra laisse supposer que le jugement en première instance où Laboral Terra avait été condamné à de lourdes peines, va être confirmé. Mais au moment où Yasmine sort de la salle d’audience, c’est la colère et la sidération qui marquent son visage.
« Je suis venue pour des miettes »
« Ils ne sont pas venus car ils n’ont pas envie d’être confrontés à une nouvelle condamnation », lâche l’avocate, à la sortie du tribunal. Ce que confirme Yasmine : « Les gérants ont fait appel pour gagner du temps. » La stratégie est bien rodée. À chaque condamnation judiciaire, d’abord aux prud’hommes puis au pénal, Laboral Terra a fait appel. Cela a permis à la société de se déclarer en liquidation judiciaire pour être insolvable sur le plan économique afin de ne pas payer les indemnités.
Le couple de gérants, qui a écopé de cinq ans de prison dont deux ferme en juin 2022 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour « travail dissimulé », n’a pas été incarcéré. Les autorités savent que les deux se trouvent en Espagne. Yasmine soupçonne les gérants de « liquider ce qu’ils ont et de chercher à disparaître ». « Nous on reste en galère. Je suis venue de très loin ici pour des miettes », souligne-t-elle. C’est normalement la caisse de garantie de salaires qui doit prendre le relais pour les indemnités mais la procédure traine. Le cabinet d’avocats de Yasmine envisage un projet de requête auprès de la Civi, Commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Mais le sentiment d’injustice prédomine.
« C’est l’impunité totale, dénonce Béatrice Mesini, chercheuse et membre du Collectif de défense des travailleuses et travailleurs étrangers dans l’agriculture (Codetras). Ce système de détachement des travailleurs facilite la dilution des responsabilités entre les entreprises prestataires et les entreprises utilisatrices. Sur le plan des responsabilités, il n’y a plus personne. C’est le flou ! On ne retrouve pas les fonds. »
Depuis le début de l’affaire, Yasmine Tellal a subi de nombreuses pressions et menaces. « J’ai le sentiment que l’État nous a abandonnés, dit-elle, après huit années de procédures épuisantes. C’est pourtant l’État lui-même qui nous avait demandé de porter plainte. » Pour aider la cheffe de brigade de la police aux frontières à monter un dossier d’instruction, Yasmine a indiqué à la police où se trouvaient les entreprises, les plaques d’immatriculation, l’adresse des gérants à Avignon... « Je me suis déplacée, j’ai fait les photos, j’ai réuni les infos pendant un an et demi, j’ai transmis tous ces éléments et j’ai tout payé de ma poche », énumère-t-elle.
La juge d’instruction a de son côté auditionné la Mutualité sociale agricole (MSA), mais n’a jamais contacté Yasmine ni ses collègues. « L’État a retenu seulement les conclusions de la MSA et a écarté les victimes, dénonce-t-elle. C’est un journaliste qui m’a alertée en juin 2021 pour me dire que l’affaire était passée au tribunal et que Laboral Terra avait été condamné à verser 3,8 millions d’euros à la MSA. Ni nous, ni notre avocat n’avions reçu de convocation. »
À l’extérieur du tribunal, les soutiens sont venus, nombreux. « Ce soutien c’est une façon d’éviter la ’’silenciation’’ : ça permet aux victimes de parler », note Béatrice Mesini, alors qu’aucune investigation sur les faits de harcèlement et d’agressions sexuelles n’a été conduite jusqu’ici. « Grâce à vous, je suis encore debout depuis toutes ces années pour me battre contre cette exploitation, cette traite d’êtres humains, ces agressions sexuelles, dit Yasmine, au micro. S’il faut aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, j’irai. »
Sans les travailleurs migrants, la France serait incapable de produire des fruits et légumes
par Nolwenn Weiler sur https://basta.media/
Les travailleurs migrants sont cruciaux dans le secteur agricole en France pour pallier le manque de main d’œuvre. Ils sont pourtant quotidiennement maltraités, aussi bien dans des exploitations que par les politiques publiques mises en œuvre.
Cher·es parlementaires et politiques qui votez des lois ou publiez des circulaires racistes : qui récolte vos fruits et légumes ? En France – premier producteur agricole européen – les bras manquent pour cueillir et ramasser les fraises, melons, tomates, haricots et autres courgettes que nous mettons, jour après jour, dans nos assiettes. Et sans les saisonnières et saisonniers étrangers, il serait impossible de fournir les stocks dont nous avons besoin pour nous nourrir.
Combien sont-iels ? Difficile à dire, tant les irrégularités et cachotteries caractérisent le secteur. En mars 2020, alors que les frontières étaient fermées à cause du confinement, la FNSEA évoquait 200 000 travailleurs manquants. Seule certitude : la proportion de ces saisonniers, dont les contrats durent entre trois et six mois maximum, ne cesse d’augmenter. La plupart d’entre eux sont marocains, tunisiens et polonais, mais aussi roumains ou latino-américains. Ils sont devenus incontournables dans le Sud-est mais aussi dans le Lot-et-Garonne et en Bretagne.
Partout, leurs conditions de travail sont intolérables. Parlons par exemple de Java, qui s’épuise plus de dix heures par jour, six jours par semaine, pour un salaire incertain, qui n’égale parfois que cinq euros de l’heure après 20 ans d’ancienneté. Ou de Yasmina, qui a enchaîné les contrats dans l’emballage de fruits et légumes, puis dans les serres de fraises avec des journées de 15 heures sans pause et sans toilettes. Regardons du côté de Driss, Boojma, Khalid et leurs collègues, sommés de trimer aux champs sans être payés après avoir acheté leur « droit » de travailler pour 12 000 euros !
Ils et elles évoquent aussi les conditions de vie insalubres, la promiscuité, les douches qui ne fonctionnent pas, la faim, la soif, et les violences sexistes et sexuelles. Le tout dans une insultante impunité, puisque moins de 10 % des exploitations agricoles sont inspectées, et encore moins condamnées.
Depuis quelques années, sous l’impulsion notamment du Codetras, Collectif de défense des travailleuses et travailleurs étrangers dans l’agriculture, certains de ces scandales sont arrivés dans les tribunaux. Avec quelques résultats : depuis 2021, plusieurs sociétés de travail temporaire et leurs dirigeants ont été condamnées pour violation des règles européennes du travail détaché mais aussi pour travail dissimulé, marchandage et conditions d’hébergement indignes.
Des affaires sont encore en cours, dont celle de Yasmina, que basta! avait racontée en 2020, et qui repassera au tribunal le 22 mai prochain.
mise en ligne le 23 mai 2025
Les grands patrons goûtent peu les commissions d’enquête parlementaires
Mathias Thépot sur www.mediapart.fr
Les sommités du monde économique se plaignent de devoir répondre aux convocations des parlementaires dans le cadre des commissions d’enquête qui se multiplient. Preuve qu’ils font peu de cas des institutions démocratiques.
« Ils« Ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. » Invité dans l’émission de Pascal Praud sur CNews, l’homme d’affaires d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin a justifié avec dédain son refus de répondre favorablement le 20 mai à sa convocation par les député·es de la commission d’enquête sur « l’organisation des élections en France », alors qu’il en avait pourtant l’obligation légale.
La représentation nationale souhaitait entendre le milliardaire exilé fiscalement en Belgique sur son projet Périclès, acronyme de « patriotes enracinés résistants identitaires chrétiens libéraux européens souverainistes », et qui vise à structurer une grande alliance entre l’extrême droite et la droite libérale-conservatrice en France.
Mais Pierre-Édouard Stérin n’a visiblement que faire des institutions de la République, multipliant les excuses pour ne pas se rendre au palais Bourbon.
C’en était trop pour le président macroniste de la commission d’enquête Thomas Cazenave qui a lancé contre Pierre-Edouard Stérin une procédure de signalement au procureur de la République pour refus de se présenter devant une commission d’enquête parlementaire.
Si le parquet donnait suite, la peine encourue par le milliardaire serait de 7 500 euros d’amende et deux ans de prison, comme écrit dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 définissant les prérogatives d’une commission d’enquête parlementaire.
Hélas, l’exemple du tycoon d’extrême droite n’est pas isolé. On a ainsi récemment vu le haut fonctionnaire Alexis Kohler, plus proche collaborateur d’Emmanuel Macron à l’Élysée entre 2017 et avril 2025, snober les commissions d’enquête au Sénat sur le scandale Nestlé des eaux en bouteille et à l’Assemblée nationale sur le dérapage des comptes publics.
Deux dossiers dans lesquels il est soupçonné d’être personnellement intervenu pour rendre des arbitrages décisifs. Alexis Kohler ne sera du reste pas inquiété par la justice : le parquet a d’ores et déjà signifié qu’il ne serait pas poursuivi dans l’affaire du dérapage des comptes publics au nom de la « séparation des pouvoirs » . Comprendre : il était un trop proche collaborateur du président de la République Emmanuel Macron – qui est constitutionnellement intouchable – pour être auditionné.
Multiplication des commissions d’enquête
Au-delà de ces deux exemples, on voit que la défiance va croissant envers les parlementaires français qui n’hésitent plus – à l’instar de ce que font depuis des années leurs homologues états-uniens – à confronter les grands patrons, les ministres et autres hauts fonctionnaires, jusqu’ici peu habitués à devoir répondre de leurs actes sous serment, c’est-à-dire avec le risque de poursuite judiciaire en cas de mensonge.
Ainsi, les commissions d’enquête visant à faire la lumière sur des scandales impliquant un intérêt public se multiplient. En plus des commissions déjà citées, citons celles sur l’affaire Bétharram, qui a longuement auditionné le premier ministre François Bayrou, sur les violences commises dans le secteur du cinéma, sur la distribution des aides publiques aux grands groupes, sur le risque de désindustrialisation, ou encore sur la hausse des plans de licenciement.
Les résultats des deux dernières élections législatives en 2022 et en 2024 ne sont pas pour rien dans cette évolution. Ils ont rendu de plus en plus éparse la composition de l’Assemblée nationale où chaque groupe d’opposition ou minoritaire a le droit de lancer une commission d’enquête par an.
La preuve en chiffres : 8 commissions d’enquête ont déjà été lancées lors de l’actuelle législature démarrée l’été dernier, 19 avaient été bouclées entre 2022 et 2024, contre seulement 25 lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. L’accélération est nette.
Le Sénat a emboîté le pas de l’Assemblée, avec cinq commissions d’enquête en cours, douze bouclées depuis le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, soit autant que lors du premier. Et c’est compter sans les missions d’information dont l’une, celle concernant l’affaire Benalla, avait fait grand bruit.
Certes, la multiplication des commissions d’enquête parlementaires peut parfois donner le sentiment d’une spectacularisation de l’action politique, où la forme primerait sur le fond avec des auditions parfois préparées à la va-vite, et où des député·es chercheraient plus à créer du buzz pour poster sur leurs réseaux sociaux un échange saillant.
Un état de fait renforcé par le contexte institutionnel instable qui rend actuellement plus difficile pour les parlementaires de lancer d’un travail de fond sur le plus long terme. « Il faut que l’on finisse nos auditions rapidement car si Macron dissout l’Assemblée nationale en juillet, nos travaux seront caducs... », confie un député. En outre, il est très incertain que les rapports de ces commissions aboutiront sur une évolution de la loi.
Des patrons sur la défensive
Cela étant dit, il ne fait aucun doute que ces commissions d’enquête constituent une respiration démocratique. Ne serait-ce que sur les sujets économiques, où elles confrontent des puissants décideurs habituellement intouchables – car bardés de communicants et d’avocats qui maîtrisent chacun de leurs mots.
Face à la représentation nationale, les patrons se retrouvent sans filtre, contraints de dire la vérité – rare pour eux – et donc dans une position plus vulnérable. Ce qui les agace ostensiblement.
On a notamment pu le constater lors de l’audition du propriétaire de l’armateur CMA CGM Rodolphe Saadé, le 13 mai 2025, par les sénateurs de la commission d’enquête sur les aides publiques distribuées aux grandes entreprises.
Les sénateurs lui ont demandé de justifier l’avantage fiscal mirobolant dont bénéficie son groupe, et qui a coûté au fisc près de 3 milliards par an en moyenne entre 2022 et 2025. « Ne pensez-vous pas qu’il soit temps de passer à autre chose ? », a répondu l’intéressé, lassé des relances.
Plus parlante encore, l’audition par cette même commission le 21 mai du propriétaire du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault. Frustré de se retrouver dans une situation qu’il estimait en sa défaveur, l’homme le plus riche de France est sorti du sujet de l’audition et s’en est pris au rapporteur communiste de la commission, Fabien Gay, par ailleurs directeur du journal L’Humanité, dont un article publié le même jour n’avait pas plu au milliardaire.
« Alors que j’ai juré de dire la vérité devant vous, j’ai été un peu choqué aujourd’hui de voir que le rapporteur de [cette] commission a, dans son journal, trouvé opportun de dire en première page que le secteur d’activité que je représente – le luxe – sabrait l’emploi, alors que c’est précisément le contraire. J’aimerais bien que l’on soit tous logés dans cette commission à la même enseigne, et que l’on doive tous dire la vérité », a-t-il martelé, questionnant le sénateur : « Pourquoi votre journal a titré sur quelque chose qui est faux ? »
En réponse, Fabien Gay a cité deux articles des Échos, dont Bernard Arnault est le propriétaire, l’un décrivant les élus des commissions d’enquête parlementaires comme « jouant parfois aux enquêteurs, voire aux inquisiteurs », et l’autre résumant ainsi leur but : « On n’est certes pas revenu au tribunal révolutionnaire de Robespierre, qui coupa trop de têtes. Mais nous sommes sur une mauvaise pente de démagogie politique. » Preuve si l’on suit son raisonnement que le milliardaire ne pensait pas du bien de la commission d’enquête.
Fabien Gay a par ailleurs sous-entendu que Bernard Arnault avait tenté, lui aussi, de se soustraire à l’audition : « On a eu beaucoup de mal à ce que vous veniez […]. Si vous souhaitez la transparence totale, nous pouvons rendre l’ensemble de nos échanges » publics, et « je ne suis pas sûr que ce serait à votre avantage », lui a-t-il dit, sans réaction du milliardaire.
Les patrons savent du reste qu’ils courent un risque réel en cas de mensonge éhonté : le Sénat vient notamment de saisir le procureur de la République pour « faux témoignage » contre le directeur industriel de Nestlé Waters, Ronan Le Fanic, qui a assuré sous serment qu’aucun événement notable n’avait été constaté sur le site de production de Vergèze, situé dans le Gard, alors que des lots d’eaux contaminées avaient été retenus, selon des révélations de la presse.
Autre précédent qui a marqué le monde des affaires parisien : la procédure engagée contre l’ancien directeur associé de McKinsey en France Karim Tadjeddine qui avait dit sous serment que le groupe auquel il appartenait « payait bien l’impôt sur les sociétés en France », ce qui était faux. S’il a ensuite été épargné par les poursuites judiciaires, il a tout de même démissionné de son poste.
Ainsi, une forme de panique est en train d’émerger dans le monde des affaires parisien. Au point que dans une tribune dans Le Figaro, deux avocats du cabinet August Debouzy, Nicolas Baverez et Vincent Brenot, ont accusé le Parlement d’être devenu « une zone de non-droit », où des parlementaires « couverts par leur immunité, peuvent convoquer, interroger, dénoncer, accuser sans aucune limite » les pauvres patrons « tenus de comparaître et de répondre aux questions écrites et orales, sous peine de sanction pénale ». Horreur !
La Lettre a depuis révélé que ce même cabinet August Debouzy proposait désormais des formations clés en mains pour les patrons du CAC 40 stressés à l’idée de dire la vérité, rien que la vérité, face aux parlementaires. Car ce serait trop leur demander.
Lèse-majesté
L'éditorial de Sébastien Crépel sur www.humanite.fr
C’était un spectacle rare. L’un des milliardaires les plus riches du monde (à touche-touche avec les Américains Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Bill Gates), le Français Bernard Arnault a été durant quelques heures, mercredi, un citoyen ordinaire. Un homme sans plus ni moins de droits qu’un autre, à égalité avec tous les patrons appelés à s’expliquer devant les sénateurs sur l’utilisation des fonds publics par les groupes qu’ils dirigent. Quelle indignité ! Quel crime de lèse-majesté ! Il n’y avait qu’à percevoir l’amertume du seigneur du CAC 40 pour mesurer sa réprobation.
En quelques semaines, tout le gotha de l’industrie et des affaires a été auditionné par la commission d’enquête sur les aides publiques aux entreprises (dont le rapporteur, Fabien Gay, est sénateur et directeur de l’Humanité). Entamés dans l’indifférence de la plupart des médias, ses travaux ont gagné en publicité, alimentés par l’embarras ou la mauvaise foi de ceux-là mêmes qui estimaient n’avoir pas de comptes à rendre de leur gestion.
Les principaux arguments rabâchés devant ou au-dehors de la commission tiennent en un syllogisme. Primo, il est impropre de parler d’aides publiques, puisque l’État rend aux entreprises une partie de l’argent qu’il leur prélève. Secundo, les parlementaires n’ont pas pour fonction de contrôler l’action des entreprises privées. Tertio, il en découle que ces convocations et l’objet de la commission frisent l’abus de pouvoir.
Depuis un quart de siècle et la loi Hue de 2001 sur le contrôle des fonds publics accordés aux entreprises – l’une des premières lois abrogées au retour de la droite aux affaires en 2002 –, le monde et le capitalisme se sont profondément transformés, mais non les rapports sociaux fondés sur l’inviolabilité de la propriété du capital.
À l’heure où 200 à 250 milliards d’euros par an d’argent public – personne, même à Bercy, n’a idée du montant exact – sont alloués aux employeurs dont certains licencient avec cet argent, et tandis que les finances publiques s’enfoncent inexorablement dans le rouge, la démocratie s’arrête toujours à la porte des conseils d’administration. La mauvaise humeur de l’empereur du luxe, spécialiste de l’évasion fiscale et ami de Trump, n’a fait que souligner cet archaïsme, à l’origine de tant de gâchis humain, social, financier et environnemental.
Contrairement à ce qu’affirme Bernard Arnault, LVMH supprime bien des emplois
Khedidja Zerouali sur www.mediapart.fr
Mercredi, Bernard Arnault était entendu par la commission d’enquête sénatoriale sur les aides aux entreprises. D’entrée, une passe d’armes a eu lieu entre le rapporteur communiste et le grand patron au sujet des suppressions d’emplois prévues par le groupe dans le secteur des vins et spiritueux.
Bernard Arnault, après s’être fait longuement désirer, a choisi de commencer son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques par la bagarre. Et pour le patron de LVMH, mercredi 21 mai 2025, l’adversaire était tout trouvé : Fabien Gay, sénateur communiste, rapporteur de la commission, mais aussi directeur de la rédaction du journal L’Humanité.
« J’ai été un peu choqué de voir que le rapporteur de votre commission, alors que moi j’ai juré de dire la vérité, a, dans son journal, trouvé opportun, en première page, de dire que le secteur d’activité que je représente – le luxe – sabrait l’emploi, alors que c’est précisément le contraire », a démarré le patron du premier groupe de luxe au monde.
C’est que la veille, L’Humanité avait dédié sa une et un article à l’annonce faite par LVMH, fin avril, de supprimer 1 200 emplois dans la branche vins et spiritueux du groupe, qui en compte quelque 9 400. Cela représente, au niveau mondial, une suppression de 12 % des effectifs de la branche.
« J’aimerais qu’on soit tous logés dans cette commission à la même enseigne, a repris le milliardaire, devant les sénateurs qui tentaient de recentrer le débat. On doit dire la vérité. Donc monsieur le rapporteur, si vous le permettez, je vais poser une question : pourquoi votre journal a titré avec quelque chose qui est faux ? »
Les taxes américaines comme prétexte
Sans tout de suite répondre sur la véracité des informations publiées par L’Humanité, mais aussi par La Lettre dès le 1er mai, Fabien Gay a rappelé que bien que directeur de la rédaction, il ne tenait pas « la plume » des journalistes du quotidien. Et de s’étonner des manières inquisitrices de Bernard Arnault, qui en plus d’avoir fait languir la commission, s’est permis d’appeler son président, un sénateur Les Républicains (LR), pour se plaindre de l’article en question.
Plus tard lors de l’audition qui a duré deux heures, le sénateur communiste est revenu à la charge, en demandant à Bernard Arnault pourquoi un groupe qui se porte bien, qui distribue aux actionnaires 52 % de ses bénéfices en 2024 et rachète toujours plus d’actions est prêt à supprimer autant d’emplois.
« Comprenez-vous, monsieur Arnault, que cela puisse heurter, questionner, qu’un groupe comme le vôtre fait le choix de se séparer de 1 200 salariés plutôt que de faire le choix de baisser la redistribution des dividendes aux actionnaires ? »
C’est un choix assumé : préserver la rentabilité pour les marchés financiers, même si cela implique de supprimer des centaines d’emplois. Communiqué de la CGT
Et Bernard Arnault de répondre à côté, précisant que les 1 200 sont « des cadres » et qu’« il ne s’agit pas de les licencier, il s’agit de mettre en place un plan pour ne pas renouveler les départs volontaires ou les départs à la retraite ». En bref, pour lui, il est « tout à fait exagéré de parler de suppressions d’emplois ». Pourtant, c’est tout à fait de ça qu’il s’agit.
Pour le patron, ces départs qu’il qualifie de « naturels » se justifient par les menaces chinoises et américaines concernant l’augmentation des droits de douane pour les alcools, et notamment pour le cognac. Contacté par Mediapart, Jean-Jacques Guiony, le PDG de Moët Hennessy, branche de LVMH, développe : « Les taxes douanières ne sont pas encore en vigueur, elles sont de l’ordre de la menace pour le moment. Mais quand il y a des incertitudes pareilles, c’est forcément mauvais pour l’activité. En termes de volume et en termes de valeurs, nous avons reculé. Nous sommes revenus aux chiffres de 2019, donc on revient aussi à la masse salariale de 2019. »
Pour la CGT du champagne, qui s’est exprimée par un communiqué, les économies auraient pu être faites ailleurs : « Aucun prélèvement n’est envisagé sur la fortune colossale de Bernard Arnault, ni sur les marges des autres divisions du groupe. C’est un choix assumé : préserver la rentabilité pour les marchés financiers, même si cela implique de supprimer des centaines d’emplois. »
1 200 postes en moins
Avant que le sujet soit discuté au Sénat, les salarié·es ont été prévenu·es, et d’une drôle de manière.
Le 30 avril, à 11 h 08, à la veille de la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses, les patrons de la filière vins et spiritueux du groupe ont envoyé une vidéo à leurs salarié·es. On y voit Alexandre Arnault, fils du grand patron et directeur délégué de Moët Hennessy, et Jean-Jacques Guiony discourir en anglais dans une vidéo titrée « Nos dirigeants partagent leur vision stratégique pour Moët Hennessy ».
Au bout d’un quart d’heure de vidéo, les deux hommes d’affaires annoncent la couleur : la masse salariale de la filière passera de 9 400 à 8 200 salarié·es. « Donc oui, ils suppriment bien 1 200 postes », souffle, auprès de Mediapart, Alexandre Rigaud, délégué syndical CGT à MHCS, société filiale de Moët Hennessy.
Jean-Jacques Guiony le concède, la forme n’était pas la bonne. « Je communique tous les trois mois. La dernière fois, c'était le 30 avril, juste avant le Ier-Mai. Je les ai déjà prévenus, la prochaine sera fin juillet, qu’ils n’aillent pas me dire que c’est juste avant les vacances d’été, plaisante-t-il. Mais oui, j’entends la critique, elle est fondée. La prochaine fois, on fera différemment et on fera aussi la vidéo en français. »
Pour les salarié·es, de nombreuses questions restent en suspens. Sur les 1 200 postes supprimés, combien le seront en France ? Et en France, quels postes seront supprimés ? Est-ce au siège, dans la vente, à la récolte ? Cela signifie-t-il que le groupe va se séparer des plus petites « maisons » de la branche vins et spiritueux ? Quel impact ces suppressions de postes auront sur les conditions de travail de celles et ceux qui restent ? Dans le même temps, le groupe va-t-il continuer à verser tout autant de dividendes à ses actionnaires ?
Nous avons posé certaines de ces questions au PDG de Moët Hennessy. Pour l’heure, il n’est pas en mesure d’y apporter des réponses. De notre échange, une information est cependant ressortie : ce plan de suppressions de l’emploi ne s’étalera pas dans le temps et se fera en seulement trois ans.
À la question « Et si le contexte international change, que les taxes douanières n’évoluent pas, reviendrez-vous sur votre décision ? », le patron répond : « Peut-être. » « On pourrait, effectivement, revenir sur cette décision si le contexte international évoluait mais, pour être honnête, il y a aussi un aspect structurel. Il y avait un dimensionnement de l’entreprise qui était un peu excessif par rapport à son potentiel de vente à moyen terme. »
Aussi au « Parisien », chez Givenchy et MHD
Pour obtenir des réponses à toutes ses questions, la CGT compte déposer un droit d’alerte économique et social d’ici quelques jours. « Malheureusement, on n’a pas de CSE au niveau de la branche, explique Philippe Cothenet, délégué syndical Moët et secrétaire général adjoint de l’intersyndicale CGT du champagne. Donc, chacun dans le CSE de son entreprise, on va faire remonter ces questions. »
En attendant, les salarié·es devront se contenter des réponses lapidaires de Bernard Arnault en commission d’enquête. Le PDG, présenté par les libéraux comme héros de l’emploi à la française, alors même que le groupe s’est forgé autour de la destruction de Boussac Saint-Frères, délocalise déjà depuis des années et ne compte plus que 18 % de ses salarié·es dans l’hexagone, balaye : « Est-ce qu’on est obligé de garder un nombre d’emplois constant ? Compte tenu du fait que le groupe gagne de l’argent, progresse, on a la responsabilité de ne pas faire de licenciements, mais on ne peut pas être obligé de garder, quand la conjoncture est difficile, le même nombre d’emplois. Ça n’a pas de sens. »
D’ailleurs, le patron aimerait bien dire quelques mots de cette logique qui, selon lui, prévaudrait dans l’administration publique, mais, là encore, ce n’est pas le sujet de cette audition.
D’autres chiffres auraient, eux, gagné à se faire une petite place lors de cette audition qui avait, aussi, pour sujet l’emploi. LVMH n’est pas seulement en train de supprimer 1 200 emplois dans sa branche vins et spiritueux, il en a déjà supprimé plusieurs dizaines ailleurs.
L’an dernier, la filière distribution de Moët Hennessy (MHD), avait déjà ouvert un plan de départs volontaires après le divorce entre LVMH et les Britanniques de Diageo. Quelque 80 salarié·es ont pris le plan et quitté les effectifs. « Ce plan est terminé, ces 80 départs ne sont pas comptabilisés dans les 1 200 annoncés en fin avril », précise Jean-Jacques Guiony.
Dans le reste du groupe de luxe, d’autres salariés ont été poussés vers la sortie. Jamais par des licenciements secs, cela donnerait une mauvaise image. Ainsi, au Parisien, quelque 40 salarié·es ont été remercié·es par le biais d’un plan de départs volontaires, comme nous l’avions raconté en mars.
Dans le secteur de l’habillement, Givenchy aussi pousse vers la sortie des dizaines de salarié·es par un autre dispositif permettant de contourner le peu populaire PSE, la rupture conventionnelle collective. Selon les salarié·es interrogé·es, elle devrait concerner 80 à 100 salarié·es. La première vague de ruptures conventionnelles a déjà eu lieu, à la fin du premier trimestre 2025. Une seconde devrait avoir lieu d’ici peu. Interrogés sur ce plan de départs, LVMH ne nous a pas répondu.
mise en ligne le 22 mai 2025
Entrisme des Frères musulmans : le rapport qui exagère, effraye et clive
Roger Martelli sur www.regards.fr
Le rapport sur l’entrisme des Frères musulmans en France, présenté en conseil de défense est une œuvre commandée et exploitée pour des calculs politiques. Quand intégrismes religieux et intégrismes laïques se nourrissent l’un l’autre.
Étonnant document que celui qui vient d’être rendu public et qui concerne les Frères musulmans, dont l’action est présentée comme « une menace pour la cohésion nationale ». Ce rapport, dont la publication coïncide avec l’affirmation « républicaine » de Bruno Retailleau, a été discuté lors d’un « conseil de défense ». Certaines décisions seront « communiquées », tandis que d’autres, « classifiées », relèveront du si commode « secret Défense ».
La méthode Retailleau
Secret Défense, conseil de défense : une fois de plus, l’esprit est à la guerre, cette fois contre un « entrisme » qui va trouver son champ d’application lors des élections municipales de l’an prochain. À lire le rapport, nous devrions nous convaincre que nous sommes devant une entreprise visant potentiellement au renversement de l’ordre républicain et que seule une voie d’extrême fermeté nous mettra à l’abri du malheur. D’où vient donc la menace ? D’une conjonction des fondamentalismes religieux ? D’une organisation terroriste de déstabilisation avérée et illégale des institutions ? D’un réseau complotiste exacerbant les peurs pour préparer un recours à la dictature ? Rien de tout cela. Ni terroristes, ni salafistes pro-saoudiens : la cible est une organisation connue, fondée sur l’islamisme politique, structurée en réseaux, appuyée sur un « écosystème » d’organisations et cherchant une implantation locale à l’occasion des prochaines élections municipales.
On peut n’avoir aucune sympathie pour l’islamisme en général et pour les Frères musulmans en particulier. On peut n’aimer ni leur organisation hiérarchisée, ni leur idéologie, ni leurs discours à géométrie variable, ni leur prosélytisme communautaire. Mais de là à en faire la Grande Peur du moment, alors que la démocratie vacille et que la paix est en miettes ! Il ne faut pas être angélique, nous dit-on. 7 % des lieux de culte musulmans rassemblant chaque semaine 91 000 fidèles (sur un peu plus de 5 millions de musulmans estimés), 21 établissements scolaires potentiellement rattachés, 127 associations sportives rassemblant 65 000 adhérents (sur 16,5 millions de licenciés)… Cela vaut-il le recours à la guerre totale et à l’arme atomique ?
Le rapport mêle, sans hiérarchie aucune, le classique rapport de police, la dénonciation publique d’institutions et d’individus présumés dangereux, les jugements de valeurs péremptoires, les mises en garde solennelles et les préconisations d’action publique. Il tranche sur des questions complexes, l’organisation des cultes, la pertinence de la notion d’islamophobie, le rapport de l’islam à la politique.
Il se réclame de la République et de la laïcité. Mais de quelle République parle-t-on : celle qui stigmatise ou celle qui rassemble ? Quelle laïcité : celle qui attise les conflits ou celle qui apaise ? Le rapport se veut rassurant pour une nation inquiète. Mais en focalisant les peurs sur une fraction de l’islam, il risque de déboucher sur une seule issue : l’angoisse, le refus de l’autre, le ressentiment. Autant dire : au triomphe de l’extrême-droite. Que Bruno Retailleau ait envie de chasser sur les terres du RN ou se prépare à la grande union sacrée de toutes les droites relève de son choix. Mais qu’on ne mêle pas l’idée républicaine et le pari laïque de Briand et de Jaurès à cette infâmie.
L’enjeu des municipales
Par le biais de « l’écosystème » constitué par leurs associations et à défaut de pouvoir s’emparer de l’État, les Frères musulmans chercheraient en attendant à s’emparer du pouvoir municipal. Voilà donc les 35 000 communes de France promues au rang de nouveau front des luttes. Que les Frères déploient une stratégie patiente d’implantation locale, surtout dans les zones fortement marquées par l’immigration, n’a rien ni de bien nouveau ni de surprenant. Mais ce sont les lieux par excellence où pourrait se poser la question fondamentale : si les associations « fréristes » ont de l’impact est-ce seulement par le machiavélisme de leur comportement ? Ne répondent-ils pas à des attentes, négatives (le refus des discriminations) ou positives (la demande de sens de vie) ?
En se détournant de ce questionnement, on risque de se précipiter vers les solutions courtes et se diriger vers le pire au lieu de le conjurer. La voie de la répression administrative ? Elle peut grandir ceux qu’elle frappe. L’isolement politique ? Il peut exacerbe le sentiment de rejet et d’exclusion chez ceux qui sont tentés par ce choix. En fait, la polarisation sur le local et sur le danger « frériste » ou « salafiste » finit par fixer le débat sur le double danger de la « séparation » et de la « subversion ». Comme l’invocation de « l’arc républicain » ou de la « convergence laïque », elle pousse à l’alliance sans limite de tous les adversaires de l’islamisme, de droite comme de gauche.
Mais est-ce vraiment là le fond souhaitable des controverses municipales ? Ce qui perturbe la capacité à vivre ensemble pacifiquement, est-ce l’altérité menaçante ou la spirale des inégalités, des discriminations, du poids des spéculations immobilières, des logiques comptables, des financements insuffisants, de la citoyenneté imparfaite et des démocraties à repenser ? En déplaçant l’enjeu du débat, on déplace l’axe des alliances et, en focalisant tout sur les dangers de l’islamisme, on met au centre des solutions la force la plus déterminée dans la dénonciation de « l’Autre » par excellence, l’immigré, l’étranger, le musulman. À l’image du ministre de l’Intérieur – toujours au cœur du dispositif quand il s’agit de traiter de religion ou d’immigration –, certains peuvent vouloir jouer de qui sera le meilleur recours. À ce jeu, hélas, le RN est la tête de file.
Islamophobie : danger
Les islamistes crient volontiers à l’islamophobie ; c’est donc que l’islamophobie n’existe pas, suggèrent les auteurs du rapport. Comme si, au XXe siècle, l’anticommunisme avait été un mythe puisque que les communistes ne cessaient de le dénoncer… Il en est de l’islamophobie comme de l’antisémitisme : il relève d’une longue histoire. Mais l’histoire récente lui a donné de l’épaisseur, parce que la France a été une puissance coloniale, parce que l’immigration d’installation pérenne a augmenté la visibilité et le poids de l’islam et parce que la théorie du « choc des civilisations » nous a habitués à la conviction que l’islam était la principale menace pour un Occident en déclin démographique.
L’islamophobie n’a pas pris la place des autres grandes manifestations du refus de l’altérité, en particulier de celle de l’antisémitisme. Mais son poids s’est accru au fil des décennies. Le sémiologue et essayiste Tzvetan Todorov a usé d’une belle formule pour décrire son ressort fondamental : « Tous les êtres humains agissent pour une variété de raisons : politiques, sociales, économiques, psychologiques, physiologiques même ; seuls les musulmans seraient toujours et seulement mus par leur appartenance religieuse (…) Eux obéissent en tout à leur essence immuable et mystérieuse de musulmans ». Que le retour d’un radicalisme religieux s’observe sous toutes les formes, dans toutes les cultures et toutes les religions, cela semble sans importance : le danger est celui de l’islam. Ce qui compte, c’est que l’islam, par nature quasi exclusive, subordonne le politique au religieux et prône la lutte contre tout ce qui n’est pas musulman.
« Ce n’est pas en attisant l’incertitude et le ressentiment, chez les non-musulmans comme chez les musulmans, que l’on mettra la France à l’abri des angoisses, des haines et des replis »
Mais comment ne pas voir que l’attrait des fondamentalismes, quels qu’ils soient, n’est pas d’abord dans l’habileté, la violence ou les dissimulations des forces qui les promeuvent ? Leurs succès sont pour une part l’envers des discriminations qui frappent des segments entiers de la population et, pour une autre part, ils sont l’indice d’un vide de sens et de valeurs que l’État et les « corps intermédiaires » – et parmi eux les partis – ne sont plus capables d’offrir. Ils sont une manière, pervertie mais attractive, d’affirmer une dignité refusée.
Il est dès lors des manières d’affirmer l’idée républicaine et le principe de laïcité qui finissent par les desservir de façon absolue. De même que la liberté se meurt quand les libertés concrètes sont mises en cause en son nom, de même la laïcité se recroqueville quand elle devient instrument de distinction et de discrimination et non d’émancipation. Les Frères musulmans, explique le rapport, ont utilisé la norme vestimentaire pour affirmer la vivacité de l’islam. Mais ce n’est pas par l’interdiction et l’imposition d’une norme censément acceptable par la majorité, que l’on contrera l’identification de la foi et du vêtement qui l’énonce, pour ceux en tout cas qui se sentent exclus de cette majorité.
Alors que le cours du temps, pour l’instant, se traduit globalement par un recul général de la croyance, les crispations identitaires produisent une poussée tout aussi générale des intégrismes. Ironie de l’histoire : intégrismes religieux et intégrismes laïques peuvent alors se nourrir l’un l’autre. On agite le spectre de l’islamisation et, ce faisant, on étend l’emprise d’un clergé conservateur, quand ce n’est pas celui de fanatiques capables du pire au nom d’une foi dévoyée.
Une laïcité d’émancipation
L’affirmation laïque, en France, a été portée par le triomphe électoral des républicains, après 1880. Il serait dramatique qu’elle devienne, par la volonté des sommets de l’État, une manière de masquer le parti pris antimusulman. La loi de 1905 n’était pas une loi antireligieuse, mais l’affirmation d’une double libération. Elle libérait l’État de l’ingérence de l’Église, alors farouchement attachée au principe de catholicité, et elle libérait en même temps les Églises de la tutelle exercée par l’État, même « concordataire ».
La laïcité de 1905 n’était pas davantage une laïcité d’exclusion. Ce n’est d’ailleurs pas la laïcité anticléricale des radicaux qui a coloré la grande loi de cette année-là, mais la démarche ouverte des socialistes Aristide Briand et Jean Jaurès. Pour ces deux-là, l’essentiel n’était pas de proscrire les signes religieux de l’espace public, ni les soutanes, ni les processions, mais de garantir la séparation des deux institutions de l’État et de l’Église. C’était débarrasser l’espace public de polémiques du temps passé, qui empêchaient de mettre en lumière les dossiers bien plus brûlants d’une souveraineté vraiment populaire et d’une République sociale attentive aux droits. La même préoccupation devrait l’emporter aujourd’hui encore. La démocratie serait perdante si l’on en venait à l’idée que la question laïque se substitue à toutes les autres et les surplombe, à un moment où il s’avère de plus en plus que la société est un tout, pour lequel il vaut mieux éviter d’ériger un enjeu à une rang supérieur à celui de tous les autres.
La laïcité telle que l’histoire l’a promue en 1905 n’a donc pas besoin d’être « ouverte », comme on le demande parfois : elle l’est par fondation. Mais elle ne doit en aucun cas revenir à la situation antérieure – ni à un gallicanisme déguisé (celui du contrôle d’’un clergé « nationalisé », que continuent d’ambitionner les Républicains), ni à un anticléricalisme hors d’âge. L’ennemi n’est pas la religion, mais l’aliénation, d’où qu’elle vienne. L’émancipation peut certes prendre la forme d’une émancipation individuelle du fait religieux ; elle ne peut prendre celle d’un combat étatique contre les religions, a fortiori contre une religion en particulier, et encore moins contre une religion qui se trouve aujourd’hui être davantage celle de dominés que celle de dominants.
« Les peuples n’aiment pas les missionnaires armés », s’exclamait Robespierre en 1792, contre l’avis de ceux qui pensaient que la guerre contre les monarchies allait étendre l’influence de la révolution. On peut aujourd’hui se convaincre que la sécularisation des sociétés est une avancée majeure de la liberté de conscience ; penser qu’elle progressera par le recours à une laïcité imposée par la loi est pourtant un contresens. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? On sait les ravages justifiés par cette formule facile.
Legrand écrivain franco-libanais Amin Maalouf rappelle avec justesse que la ville musulmane que fut Cordoue était un havre d’ouverture au Xe siècle, pour devenir un lieu d’intolérance deux siècles plus tard. Maalouf nous donne la clé du mystère : entre les deux dates, l’Espagne musulmane est passée de la certitude à l’incertitude et donc d’une religion sereine à une religion inquiète. Ce n’est pas en attisant l’incertitude et le ressentiment, chez les non-musulmans comme chez les musulmans, que l’on mettra la France à l’abri des angoisses, des haines et des replis, sur les petites communautés (celles des minorités) ou sur les grandes (celles des majorités, a fortiori si elles craignent de ne plus l’être…). Nous n’avons pas à épurer notre société de ses miasmes, mais à promouvoir un projet qui mobiliser au mieux ses forces vives et qui rassure au maximum ceux que leur fragilité voue à l’inquiétude du déclin. C’est d’une sérénité reconquise que la France a besoin et pas d’un nouvel esprit de guerre civile.
En bref, il y a tout à craindre qu’un rapport, au total mal ficelé, ne serve qu’à conduire l’exécutif dans une spirale de ces peurs et de ces refus qui étouffent la République au lieu de la refonder.
mise en ligne le 22 mai 2025
Face aux extrêmes droites,
le sursaut civique en Europe
ne remplacera pas
une réponse sociale
Fabien Escalona sur www.mediapart.fr
Le soulagement après la défaite de George Simion en Roumanie ne doit pas égarer. Si des forces compatibles avec Trump et Poutine ont été contenues lors de plusieurs scrutins récents, leur menace est intacte et aucune alternative solide n’est au pouvoir.
La vague brune paraît tellement irrésistible que son endiguement provisoire fait presque figure de bonne nouvelle. En Roumanie, une catastrophe politique et géostratégique a été évitée dimanche 18 mai, avec la défaite du candidat de l’Alliance pour l’unité des Roumains (AUR, extrême droite). George Simion, nationaliste, réactionnaire et hostile à l’aide l’Ukraine, risquait de priver l’Union européenne et l’Alliance atlantique d’un partenaire fiable sur leur « flanc Est », vis-à-vis du régime russe et des réseaux trumpistes.
Désormais, beaucoup espèrent un renversement de situation similaire en Pologne. Le parti Droit et justice (PiS), qui détient la présidence, cherche à sauvegarder l’héritage de sa « révolution conservatrice ». Le duel entre son candidat et celui du camp libéral, le maire de Varsovie, va certainement polariser la société de manière intense. Dans ce pays comme en Roumanie, la défaite de la droite la plus dure est une condition nécessaire à l’avancement de la cause des femmes, des minorités, de la société civile et de l’état de droit en général.
Il est logique que toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ces causes aient ressenti un certain soulagement face aux nouvelles venues de Bucarest. Mais cela ne devrait pas conduire à un défaut de lucidité, voire à un enthousiasme mal placé dont bien des observateurs et des responsables politiques ont fait preuve depuis dimanche.
Un peu benoîtement, l’hebdomadaire allemand Die Zeit s’est ainsi félicité que les Roumain·es aient choisi « la maison Europe » et se soient donné une « chance de consolider [leur] démocratie » en votant pour Nicușor Dan, le maire anticorruption de la capitale. De manière tout aussi révélatrice, l’eurodéputée française Nathalie Loiseau a félicité « le peuple roumain [pour avoir] résisté aux mensonges et aux manipulations dont il a été bombardé », comme si l’attraction de l’extrême droite se résumait à un malentendu attribuable aux ingérences russes.
Dans le même esprit rassuriste, le Nouvel Obs s’interrogeait récemment sur un possible « contre-effet Trump », aux États-Unis comme dans le reste du monde. Peu de temps avant, le New York Times notait que les guerres commerciales et l’autoritarisme de Trump avaient desservi les candidats conservateurs associés à ce dernier, en Australie et au Canada. Sans nier ces dynamiques de campagne, on peut relativiser l’évolution concrète du rapport de forces, et insister sur les tendances encore plus sombres en Europe.
Halte à la pensée magique
Au Canada, le successeur libéral de Justin Trudeau a surtout asséché les autres forces progressistes et conservé l’essentiel de son propre électorat. Cela n’a pas empêché son rival, issu de l’aile radicale du parti conservateur, d’augmenter le score de sa formation par rapport aux dernières élections. L’écart entre les deux grands partis dépasse à peine les deux points de part des suffrages, ce qui est aussi le cas en Australie. Ce n’est que par l’effet des modes de scrutin que les écarts en sièges sont plus significatifs.
En Roumanie, le surcroît de mobilisation contre Simion ne l’a pas empêché de progresser entre les deux tours. Dans le contexte d’une participation en hausse de 10 points, il a récolté 1,5 million de voix de plus que le 4 mai. En Pologne, il faut ajouter au score du PiS, moins impressionnant qu’en 2020, l’envolée de formations extrémistes à sa droite. Et au Portugal, celles et ceux qui pensaient que Chega avait atteint son plafond de verre en 2024 en sont pour leurs frais : André Ventura et son trumpisme lusophone, inexistants il y a six ans, ont failli ravir la deuxième place du scrutin au parti socialiste.
Surtout, les problèmes de fond ne sont pas près d’être réglés. Les forces censées contenir les droites compatibles avec Trump, voire Poutine, ne sont équipées ni des intentions politiques ni des propositions programmatiques propres à agir sur les causes d’attraction de ces dernières.
Les trois scrutins européens sont parlants : la géographie électorale de ces droites est corrélée à celle du déclin économique et de la précarité sociale. Les trois pays concernés, dans leur ensemble, occupent d’ailleurs une position subalterne dans l’espace capitaliste européen. Ils font partie des États les plus vulnérables et dépendants de cet espace. Or, ni le nouveau président roumain, ni le challenger polonais du PiS, ni le premier ministre portugais reconduit au pouvoir ne promeuvent une économie politique alternative à cette configuration.
Il faudrait développer une conception élargie et « sociale » de l’État de droit, au-delà de la défense indispensable des libertés fondamentales.
Au contraire : le maire de Bucarest a beau être un indépendant identifié par ses combats anticorruption, il s’inscrit complètement dans le paradigme néolibéral qui a accentué les fractures sociales et territoriales de la Roumanie. Au Portugal, les deux partis alternant au pouvoir – les seuls qui surnagent face à l’ascension météoritique de Chega – ont coconstruit le modèle touristique qui enferme le pays dans un développement subordonné, en décalage avec les besoins de la population. Et en Pologne, les libéraux qui entendent éviter un destin « à la hongroise » avaient été éjectés du pouvoir, en 2015, par un PiS qui apparaissait mieux-disant sur les enjeux de redistribution et de justice sociale.
Cela ne veut pas dire que les droites extrêmes ou radicales ont des solutions pertinentes aux problèmes socioéconomiques de fond. Il faut par ailleurs admettre que – comme en France – leur force propulsive réside dans des attitudes xénophobes et autoritaires bien réelles, ancrées dans l’histoire longue des sociétés.
Mais on ne peut pas comprendre le succès de leur politique du ressentiment sans la mettre en rapport avec des conditions matérielles d’existence, le sentiment d’un « monde fini » où seuls les plus impitoyables surnageront, et l’absence d’organisations de masse cultivant une vision du monde égalitaire et solidaire.
À cet égard, il faut certes prendre au sérieux les ingérences de puissances étrangères dans les processus électoraux, mais ne jamais oublier que leur puissance de déstabilisation est indexée sur la faible confiance des populations envers leurs institutions et leurs élites dirigeantes, et sur leur disponibilité à des discours démagogiques qui tirent parti de cette situation. Un algorithme biaisé et des faux comptes TikTok ne peuvent suffire en eux-mêmes à diriger des millions de votes sur des candidatures xénophobes, complotistes et complaisantes avec les impérialismes.
Achevons en soulignant que l’État de droit, au nom duquel les citoyen·nes sont appelé·es à « faire barrage », doit être défendu avec rigueur et cohérence. Ce n’est pas ce qui s’est passé dans le cas roumain, avec une accumulation d’amateurisme et d’opacité ayant abouti à l’annulation de la présidentielle de décembre 2024, en plein entre-deux-tours. De quoi donner du grain à moudre à une rhétorique centrée sur l’élection volée, et des idées à George Simion qui invoque désormais des ingérences imaginaires, notamment de la France, pour demander une nouvelle annulation.
Peut-être faut-il surtout développer une conception élargie de l’État de droit, au-delà de la défense indispensable des libertés fondamentales et de la sécurité juridique. Une tradition existe en la matière. Sous la République de Weimar, des juristes comme Hermann Heller (1891-1933) ont parlé d’« État de droit social », avec l’idée qu’une « organisation juste des rapports socioéconomiques » prolongeait le combat pour la liberté et l’égalité « dans l’ordre du travail et des biens ». C’est cette organisation juste qui permet l’effectivité des droits et consolide l’attachement du corps civique à un modèle politique pluraliste.
Des libéraux sincères, soucieux et soucieuses des garanties constitutionnelles prémunissant contre le gouvernement tyrannique promu par les trumpistes au-delà de leurs frontières, devraient le comprendre et subordonner leurs préférences économiques à cette priorité. Il le faudrait, en tout cas, pour que le temps gagné face à l’extrême ne soit pas un temps gâché.
mise en ligne le 21 mai 2025
« C'est un petit peu comme si on leur offrait des funérailles » :
à Paris, une cérémonie pour rendre hommage aux 855 sans-abris morts en 2024
Tristan Gayet sur www.humanite.fr
855 sans-abri sont morts en France en 2024. Ce mardi 20 mai, le collectif Les morts de la rue a organisé au Parc de Belleville à Paris une cérémonie pour leur rendre hommage.
623 en 2022, 611 en 2023, et 855 l’année dernière. Les chiffres des morts à la rue ne cessent d’augmenter. Pour lutter contre l’invisibilisation de ce scandale, le collectif Les morts de la rue a rendu hommage, ce mardi 20 mai, à toutes les personnes décédées « sans chez-soi » en France l’année dernière.
Sur les murs de l’amphithéâtre du Parc de Belleville, des affiches rappellent que « vivre à la rue tue » et que « chacun.e était quelqu’un.e ». C’est pourquoi le nom de chaque personne morte à la rue a été lue à voix haute lors de l’initiative.
186 nouveaux décès en 2025
Le collectif a invité des élus et des personnalités politiques pour cette cérémonie de lecture des noms, afin de « les sensibiliser, les mettre face aux faits afin qu’ils prennent conscience ». Mardi soir, c’est surtout la gauche qui était représentée, notamment avec le sénateur communiste Ian Brossat, la députée LFI Sophia Chikirou ou Rémi Féraud, sénateur socialiste. Plusieurs conseillers municipaux de la ville de Paris étaient aussi présent.
Pour Bruno Hoguet, membre du collectif qui a vécu à la rue pendant plusieurs mois, cet aspect est primordial : « j’ai réussi à m’en sortir en me débrouillant, mais c’est aussi grâce à l’aide des petits politiques qui nous entourent. Ils agissent pour nous aider. »
La cérémonie s’est terminée par un hommage. Tous les spectateurs sont alors invités à déposer une rose auprès du nom d’un « sans chez-soi » décédé. En même temps résonne un enregistrement de la lecture des noms, accompagné, quand c’est possible, d’un parcours de vie.
« C’est un petit peu comme si on leur offrait des funérailles », témoigne Arnaud, présent à l’événement pour la deuxième fois. La procession est longue. Dans l’émotion, chacun espère ne pas avoir à déposer de fleurs l’année prochaine. Mais 186 sans-abri sont déjà décédés cette année. Sans oublier les morts qui n’ont même pas été recensés.
350 000 personnes à la rue
Car beaucoup de sans-abri meurent encore dans l’indifférence générale et ne sont jamais identifiés. « Nous ne pouvons garder que les cas vérifiables », ajoute Bérangère Grisoni, présidente des Morts de la rue. « On travaille sur la base de signalements citoyens, de la police ou des pompiers, d’une veille média et grâce à l’aide de la DIHAL, pour Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ».
La bénévole dénonce une inaction des politiques. « Aujourd’hui, on a des lois qu’on n’applique pas. C’est un devoir de l’État que les politiques sur le logement soient les chantiers prioritaires ». Et ce, alors qu’en France le sans-abrisme explose. En douze ans, il a augmenté de plus de 145 % d’après la Fondation pour le logement des défavorisés, soit 350 000 personnes à la rue.
Pour la France, septième puissance économique mondiale, ces chiffres sont accablants. Dans l’Union européenne, l’hexagone détient le triste record du plus haut taux de sans-abrisme. Peu après sa première investiture, Emmanuel Macron avait pourtant annoncé qu’il ne voulait « plus de femmes et d’hommes dans la rue », et ce « d’ici la fin de l’année » 2017. Huit ans après, la situation s’est aggravée…
<<
mise en ligne le 21 mai 2025
Netanyahou tue, la France tergiverse
Denis Sieffert sur www.politis.fr
La France dénonce beaucoup, mais la tragédie de Gaza n’attend pas. Le temps des indignations est révolu, celui des actes et des sanctions est arrivé. Sinon, notre faillite morale sera bientôt regardée comme une véritable complicité.
Interrogé sur le massacre commis par l’armée israélienne à Gaza, Emmanuel Macron s’est écrié : « C’est une honte. » On ne saurait mieux dire. Mais ce sentiment, n’importe lequel de nos concitoyens peut le partager. On attend évidemment autre chose de la part du président de la République. Des actes et des sanctions. Or, tel un Matamore qui ne ferait rire personne, Macron n’en finit pas de « dénoncer les actions scandaleuses d’Israël », comme dans ce communiqué publié le 20 mai avec le Canada et le Royaume-Uni. Il « prépare » pour le 22 juin une conférence coorganisée avec l’Arabie saoudite, et confirme une « prochaine » reconnaissance, d’ailleurs toute symbolique, de l’État de Palestine. Il faut s’en féliciter. A-t-on seulement idée de la situation à Gaza dans un mois ?
Netanyahou se rit de notre couardise.
On est frappé par le rapport que notre président entretient avec une histoire tragique qui s’accomplit au présent. La France ne fera évidemment pas la guerre à Israël, mais pendant que l’armée israélienne tue en moyenne cent civils par jour, et utilise la faim comme arme de guerre, les relations entre Tel-Aviv et l’Union européenne sont toujours régies par le fameux accord d’association mis en œuvre en 2000, dont l’article 2 proclame l’obligation des parties à « respecter les droits humains » et « les principes démocratiques ». Pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait référence, mardi sur France Inter, à ce document pour évoquer « une potentielle suspension », tout en avouant que l’initiative venait des Pays-Bas.
On se demande ce que coûtera en vies humaines ce « potentiel ». Netanyahou se rit de notre couardise. Il laisse entrer, « pour des raisons diplomatiques », dit-il cyniquement, cinq camions de vivres « pour les bébés », quand il en faudrait quatre cents. Ce qui supposerait un cessez-le-feu immédiat, l’arrêt des ventes d’armes, et des sanctions économiques. Mais il faudrait déjà que la France n’ait pas peur des mots. Pas question par exemple pour Macron de parler de « génocide ». « Les historiens trancheront », a-t-il dit. Comme si l’enquête d’Amnesty International et les conclusions de Francesca Albanese, la rapporteuse des Nations unies pour les territoires palestiniens, n’existaient pas, preuves à l’appui. « L’histoire » ? C’est dire, là encore, le sentiment d’urgence qui étreint le président de la République.
Macron n’est pas seul à avoir peur des mots qui pourraient fâcher Netanyahou. Un politologue de la Fondation Jean-Jaurès juge que le mot serait « contre-productif », et qu’il « crisperait ». Qui ? Les dirigeants israéliens probablement, dont il faudrait ménager la susceptibilité. Tant de précautions après 53 000 morts, et alors que l’armée israélienne entreprend de raser Gaza, et que nous parviennent des images de survivants aux corps décharnés, laissent pantois. Bien sûr, il y a eu le 7-Octobre, mais il y a longtemps que nous ne sommes plus dans les représailles, mais dans la vengeance, et plus encore dans la réalisation d’un projet politique d’extrême droite que résume aujourd’hui l’alternative expulsion ou extermination.
L’histoire européenne, décidément, n’en finit pas de repasser les plats les plus détestables.
L’heure n’est plus au constat, ni à la « honte ». La France, sans doute, n’est pas inactive. Mais notre pays se comporte comme s’il n’avait d’autre planche de salut que Donald Trump. S’en remettre pour faire pression sur Netanyahou au fantasque président américain, qui dit tout et son contraire, est la garantie de l’échec. C’est aussi un terrible aveu de dépendance au moment même où l’Europe prétend s’émanciper de l’ogre américain. Il est bien possible que Trump obtienne l’entrée de quelques camions de survie dans l’enclave palestinienne, mais on ne devrait pas oublier que, sur le fond, Trump et l’extrême droite israélienne sont d’accord pour expulser les Gazaouis de leur territoire. Les uns le veulent par idéologie, l’autre par mercantilisme immobilier.
L’extrême droite israélienne aurait même trouvé dans le désert libyen une terre d’accueil… Sordide. Comment peut-on s’en remettre à pareille engeance ? L’histoire européenne, décidément, n’en finit pas de repasser les plats les plus détestables. On a longtemps pleuré l’inaction des démocraties pendant la guerre d’Espagne, en 1936. Puis, l’Europe libérale s’est couverte de cendres après les génocides rwandais et de Srebrenica, en 1994 et 1995. Toujours trop tard. On regardera bientôt notre faillite morale à Gaza comme une véritable complicité. Et on pourra alors commémorer. Regrets éternels.
Guerre à Gaza : en sortant enfin du silence, les Occidentaux prêts à vraiment aborder un virage ?
L'éditorial de Marion d'Allard sur www.humanite.fr
Assurément, le ton change. En paraphant un communiqué commun pour exiger la fin de l’offensive israélienne sur Gaza et l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne, en dénonçant « le niveau de souffrance humaine intolérable » et en condamnant « le langage odieux utilisé récemment par des membres du gouvernement israélien et la menace agitée d’un déplacement forcé des civils », Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney sont sortis, enfin, de leur silence coupable.
Au moins dans les mots. Face aux atrocités perpétrées par l’armée de Netanyahou, les chancelleries occidentales, en écho à la force des mobilisations populaires – y compris Israéliennes –, auraient-elles pris le virage de la lucidité ?
Le régime de Tel-Aviv est plus isolé que jamais. Benyamin Netanyahou le sait. Et l’abjecte surenchère militaire à laquelle il se livre fait tout autant figure de planche de salut politique que de matrice stratégique pour parvenir à son ultime but : annexer Gaza, déporter les Palestiniens qui y vivent et poursuivre la colonisation en Cisjordanie, en Syrie et au Liban. Dans une invariable rhétorique de l’absurde, le premier ministre israélien s’obstine à taxer ceux qui s’opposent à ses visées génocidaires d’antisémitisme et de soutien au Hamas.
Certes, dans la bouche et sous la plume de chefs d’États et de gouvernement européens et nord-américains, les termes sont forts et inédits. Résolus même, lorsque Paris, Londres et Ottawa se disent, à l’unisson, « déterminés à reconnaître un État palestinien ». Mais derrière les grandes déclarations, l’heure doit être aux sanctions, indispensables pour mettre fin, instamment, aux massacres de masse ordonnés par un criminel de guerre sous mandat d’arrêt international.
L’union européenne, par la voix sa cheffe de la diplomatie Kaja Kallas, a annoncé ce mardi 20 mai un réexamen de son accord d’association avec Israël. Il était temps et Bruxelles ne doit pas s’arrêter là. Il est urgent de décréter un embargo total sur les ventes et les exportations d’armes et d’œuvrer, par tous les moyens, pour que le droit international soit respecté et Benyamin Netanyahou arrêté. La prise de conscience ne suffit pas. Elle n’est qu’une première marche. Il faut désormais gravir toutes les autres.
Soutien à Israël : l’Union européenne prend ses distances face à l’entreprise génocidaire à Gaza
Tom Demars-Granja sur www.humanite.fr
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a annoncé, mardi 20 mai, que l’Union européenne allait réexaminer son accord d’association avec Israël. Alors que la pluie de bombes redouble d’intensité sur la bande de Gaza, les alliés d’Israël commencent à revoir leur position et poussent pour un cessez-le-feu.
Ce revirement partiel arrive alors que près de 54 000 Gazaouis ont été, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, tués par l’armée israélienne. « 14 000 bébés mourront dans les prochaines 48 heures, si nous ne pouvons pas les atteindre », alertait Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires des Nations unies, lors d’un entretien accordé à la BBC, mardi 20 mai.
Lundi, seuls cinq camions remplis de nourriture pour bébés ont été autorisés à entrer. D’une population victime d’une entreprise génocidaire à l’annexion de la bande de Gaza, le gouvernement dirigé par le premier ministre Benyamin Netanyahou se retrouve, depuis lundi 19 mai, ouvertement remis en cause par plusieurs États alliés.
Ce que signifie le réexamen de l’article 2
Annonce d’importance, déjà : l’officialisation par l’Union européenne (UE) du réexamen de son accord d’association avec Israël. « Il existe une forte majorité en faveur du réexamen de l’article 2 (sur le respect des droits humains – NDLR) de notre accord d’association avec Israël, a fait savoir la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles, mardi 20 mai. Nous allons donc nous lancer dans cet exercice. »
Un changement de cap qui symbolise une rupture qui s’amorce entre les soutiens de cette révision – la France, la Belgique, le Portugal, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Slovénie, la Suède, les Pays-Bas – et les partisans du statu quo – l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, Chypre, la Grèce, la Lituanie, la Hongrie, la Lettonie. L’ex-premier ministre Dominique de Villepin estime même, comme il l’a affirmé au micro de Franceinfo mardi 20 mai, que les Vingt-sept pourraient aller plus loin en décrétant « un embargo sur les livraisons d’armes » et en appelant en son nom à déférer le chef de l’État israélien et son gouvernement « devant la Cour pénale internationale ».
Le Royaume-Uni a de son côté annoncé la suspension de ses négociations commerciales avec Tel-Aviv, tandis que la Suède demande que l’UE sanctionne « certains ministres israéliens ». Des prises de position saluées par la gauche. Pour l’eurodéputée Manon Aubry, « les lignes bougent enfin contre l’impunité de Netanyahou », tandis qu’Israël intensifie son offensive pour prendre le contrôle de l’enclave palestinienne rasée par de longs mois de bombardements. « Enfin, des sanctions sont prises contre l’État d’Israël, appuie sa collègue, Rima Hassan. Il est déjà trop tard, mais il était temps. »
Toujours au Parlement européen, cinquante députés ont questionné la Commission sur la façon dont elle comptait agir face à la répression menée par Tel-Aviv contre les organisations non gouvernementales (ONG) israéliennes. Un projet de loi qui impose une taxe de 80 % sur les financements publics étrangers destinés à ces structures issues de la société civile a, de fait, été entériné. « Ce projet de loi entraînera de facto la fermeture de nombreuses ONG israéliennes de défense des droits humains ainsi que d’organisations humanitaires qui mènent des activités vitales dans le pays, compris dans les territoires palestiniens occupés, telles que B’Tselem et Breaking the silence », fustigent les signataires dans un communiqué publié mardi 20 mai. Un an et demi après l’enclenchement d’un massacre causant plusieurs milliers de morts, le soutien inconditionnel à Israël commence à s’effriter.
mise en ligne le 20 mai 2025
Pierre-Édouard Stérin, saint patron de l’extrême droite française #34.
Le plan Périclès sur le gril à l’Assemblée : pourquoi Pierre-Édouard Stérin choisit encore et encore la chaise
vide
Thomas Lemahieu sur www.humanite.fr
Cet article fait partie de la série « Pierre-Édouard Stérin, saint patron de l’extrême droite française » (34 épisodes)
Jamais deux sans trois : convoqué ce mardi 20 mai à l’Assemblée, le milliardaire catholique identitaire ne s’est pas présenté devant la commission d’enquête sur l’organisation des élections en France. Sur CNews, il se permet même de narguer les députés en les traitant de « marioles » et d'« imbéciles ». Mais derrière les « menaces » invoquées pour se soustraire à cette audition, le concepteur du plan Périclès entend criminaliser l’opposition croissante à ses menées politiques.
Avant, Pierre-Édouard Stérin était riche et puissant. Maintenant, il est célèbre, aussi. Même mieux que ça, après la révélation à son grand dam, l’été dernier, de son plan visant à assurer une triple victoire – idéologique, politique et électorale – aux droites extrêmes : Stérin est identifié. Son dessein est connu. Son nom circule dans les gazettes, et au-delà. Son visage apparaît sur des affiches, des cartons ou même des banderoles, tantôt avec Vincent Bolloré ou Elon Musk, tantôt seul.
Les dizaines d’entités qu’il finance directement via Périclès, son « family office » Otium Capital et son philanthropique Fonds du bien commun, mais également la Nuit du bien commun qu’il a cofondée en 2017… Ses activités se trouvent sous surveillance citoyenne, bien au-delà de la commission d’enquête sur l’organisation des élections en France, qui devait l’entendre ce mardi 20 mai, et à laquelle le milliardaire catholique a une nouvelle fois fait faux bond, invoquant toujours les « menaces de mort » à son encontre.
Valeurs actuelles fait son service après-vente
La veille, l’entrepreneur et exilé fiscal avait réclamé, comme la semaine dernière, une audition en visioconférence sous ce prétexte ubuesque du « danger » qu’il courrait au Palais Bourbon… Et ce alors même que sa présence est annoncée en grande pompe à un événement traditionaliste, mi-juin, dans les quartiers chics de Paris, en présence de l’abbé Matthieu Raffray, de Gabrielle Cluzel, plume de Boulevard Voltaire, ou du maire d’Orange apparenté Reconquête !.
Mais Pierre-Édouard Stérin a des soutiens. Au coude-à-coude avec le Figaro et le JDD, Valeurs actuelles se distingue par son outrance dans le service après-vente du milliardaire. Pour justifier la défection, le média cite ainsi longuement une source anonyme présentée comme « l’équipe de Périclès » : « L’ultra-gauche appelle quotidiennement à sa décapitation. En province, des manifestations avec des propos particulièrement violents, appelant notamment à sa décapitation, se tiennent en marge des Nuits du Bien Commun. Il y a un mois, le rapt d’un multimillionnaire a été déjoué en Belgique. Hier, la fille d’un leader de la cryptomonnaie, a manqué d’être enlevée à Paris et il y a quelques semaines, le cofondateur de Ledger était kidnappé. »
Pour Stérin, les députés veulent « faire les marioles »
Ce mardi 20 mai, au moment même de sa convocation, Pierre-Édouard Stérin se répand, en visio, dans l’émission de Pascal Praud sur CNews. « J’habite en Belgique, crâne le milliardaire depuis son exil fiscal. Je ne me rends en France que trois jours tous les deux mois et je n’ai pas envie de me déplacer pour répondre à des questions auxquelles mon associé a déjà répondu… » Avant d’ajouter : « La deuxième raison qui est plus importante, c’est que j’ai reçu des dizaines de menaces de mort émanant des amis des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. Il y a un risque de sécurité avéré, j’ai contacté le ministère de l’Intérieur qui m’a confirmé qu’effectivement, ces menaces étaient sérieuses et imminentes. Après, je ne suis pas le seul à en recevoir, mais comme elles sont sérieuses et imminentes, je n’ai pas envie de venir à Paris pour répondre à ces questions. » Aiguillonné par Pascal Praud, Stérin ne voit « aucune raison donnée » par les parlementaires à leur refus de l’entendre en visioconférence. « Ce que je comprends, c’est qu’ils ont envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont des politiques, ils ont besoin de n’importe quel prétexte pour que leurs noms soient mis en avant… Ils m’attendent aujourd’hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant des caméras… »
Sans revenir sur le renvoi totalement hors sujet aux tentatives d’enlèvements crapuleux de figures des cryptomonnaies, Me Louis Cailliez avait, pour le compte de Pierre-Édouard Stérin, annoncé lundi 19 mai, en fin de soirée, le dépôt d’une plainte pénale visant une « vague de menaces de mort et d’exhortation au meurtre » qui aurait « déferlé contre lui, sur Internet et sur la voie publique, à la suite de la médiatisation de son audition par une commission d’enquête parlementaire ». L’amalgame est établi. Allègrement.
À Tours, le 6 mai – à la même date que l’audition d’Arnaud Rérolle, le bras droit de Stérin pour Périclès, à l’Assemblée nationale -, une manifestation unitaire contre la Nuit du bien commun a rassemblé près de 400 personnes, soit plus que les participants à l’intérieur de l’Opéra. Avec des dons en baisse très nette par rapport à l’an dernier, les résultats ont été très médiocres de l’aveu des organisateurs du gala de charité. « Vous êtes moitié moins que l’année dernière à cause des manifestants », se lamente l’un d’eux dans la presse locale.
Le lendemain, les mêmes changent d’angle d’attaque en dénonçant des « menaces de mort » contre « l’un de leurs bénévoles ». « On en a décapité pour moins que ça », cinglerait un des messages relevés par leurs soins. Dans son communiqué annonçant la plainte, l’avocat de Pierre-Édouard Stérin, lui-même engagé au sein du collectif Justitia soutenu par Périclès, se concentre, lui, sur une affiche « Stérin décapitation » placardée à Tours comme « un exemple révélateur de l’ampleur et de la gravité du phénomène ».
L’apparition de la Section carrément anti-Stérin (Scas)
C’est donc à partir d’un ou deux slogans, certes, de très mauvais goût mais manifestement isolés, que Pierre-Édouard Stérin construit aujourd’hui son récit visant à lui permettre d’esquiver les questions des parlementaires et de devoir y répondre sous serment puis, par la même occasion, à criminaliser les mobilisations sociales et citoyennes contre ses menées politiques… Un grossier jeu de bonneteau, qui ne doit pas faire oublier que pour le milliardaire, les déconvenues se multiplient.
Dans le paysage, un nouvel acteur est apparu fin mars 2025 sous le nom de Section carrément anti-Stérin (Scas). Avec l’objectif revendiqué de contrecarrer le milliardaire et son plan Périclès en visant ses galas de charité dans tout le pays. « La galaxie du bien commun et Périclès sont, quoi qu’en dise Stérin, fondamentalement liés et s’entre-nourrissent », dénonce le groupe. Ajoutant mi-avril : « Dans toutes les villes où une Nuit du bien commun doit avoir lieu, des personnes, des organisations se rencontrent, s’adressent aux associations, diffusent de l’information et se mobilisent. » Après Tours et alors que plusieurs rendez-vous sont programmés début juin à Nantes et à Rouen, une manifestation était organisée lundi 19 mai à Lyon, avec le soutien des Soulèvements de la Terre, du PCF, de LFI, de Solidaires et d’autres. Elle s’est déroulée sans heurts.
Mais ça n’est pas tout : en Sologne, non loin de Salbris, une petite manifestation s’est aussi tenue, fin avril, devant l’internat de l’Académie Saint-Louis qui, incubé au sein du Fonds du bien commun, doit en cas d’autorisation préfectorale ouvrir ses portes à ses premières classes réservées aux garçons en septembre prochain. Même cause, même effet : samedi 24 mai prochain, à Étang-sur-Arroux (Saône-et-Loire), un « pique-nique citoyen » est prévu contre l’ouverture d’une école privée hors contrat du réseau Excellence Ruralités, financé à la fois par le Fonds du bien commun et la Nuit du bien commun.
Dans l’Allier, à Moulins, Yannick Monnet, député PCF et élu municipal d’opposition, alerte depuis des semaines sur une fresque historique mise en scène par l’association Murmures de la Cité, dont l’un des sponsors est le Fonds du bien commun. « Dans une conclusion empreinte de lumière et d’espoir, la France est dépeinte comme un pays éternel, guidé par la Providence, qui survit aux tourments, se réinvente et se projette dans un avenir toujours plus lumineux, porté par l’énergie et la volonté de son peuple », expliquent, par exemple, ses animateurs pour décrire le clou de leur spectacle.
Bolloré et Stérin « polluent le débat par leur puissance économique »
Des tas d’autres épisodes sont significatifs, comme la mise en échec par les personnels du groupe Bayard de l’arrivée d’Alban du Rostu, son ex-aide de camp au Fonds du bien commun, comme directeur de la stratégie. Quelques semaines plus tard, Dominique Greiner, représentant des assomptionnistes actionnaires du groupe, s’était livré à une forme inédite de critique à l’occasion d’un entretien à la Revue des médias de l’INA. « L’argent corrompt. L’Église catholique se retrouve aujourd’hui en difficulté pour se positionner, notamment face à Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. Ils polluent le débat par leur puissance économique et financière et promeuvent une forme du catholicisme. Qui n’est que ça : une forme du catholicisme. Très étroite, par ailleurs. Ils ont arrosé tous les mouvements de l’Église, qui aujourd’hui ne peuvent plus se passer de leurs fonds. »
Mais avant même la découverte du plan Périclès, la majorité de gauche à Marseille avait, dès février 2024, refusé d’accueillir dans les locaux municipaux de l’Opéra la Nuit du Bien commun après la publication d’une première enquête sur la philanthropie de Pierre-Édouard Stérin dans l’Humanité magazine. « À la lecture de l’article, la Ville de Marseille a découvert le parcours de M. Stérin, avait indiqué alors une porte-parole de l’équipe municipale. On ne peut plus faire avec des gens qui ont des valeurs ultra-conservatrices et antidémocratiques. La Ville retire son soutien de façon évidente et claire. » L’été dernier, en Belgique, la principale fondation du pays (Fondation du Roi Baudouin) avait, elle, suspendu son partenariat avec l’événement après nos révélations sur Périclès.
Une tribune des maires de gauche contre cette « vision rétrograde de la société »
Ces derniers jours, de Nathalie Appéré (Rennes) à Arnaud Deslandes (Lille) en passant par Grégory Doucet (Lyon), Johanna Rolland (Nantes) et Pierre Hurmic (Bordeaux), les maires socialistes et écologistes de huit grandes villes où se déroulent des soirées de la Nuit du bien commun ont fait paraître dans le Monde une tribune collective assez nette. « Sous couvert de philanthropie, c’est une vision rétrograde de la société qui s’installe insidieusement dans nos territoires, décryptent-ils. Une vision qui oppose la morale aux droits, la charité à la justice sociale, la hiérarchie à l’égalité. (…) Il s’agit d’alerter nos concitoyens sur le projet politique sous-jacent, et de refuser d’être les complices passifs de cette opération d’influence. »
Aides directes ou indirectes aux partis des droites extrêmes, formation des candidats, constitution de baromètres pour fabriquer l’opinion publique, harcèlement judiciaire de ses adversaires, etc. Tout le monde voit aujourd’hui Stérin faire avec son plan Périclès. Effet Streisand oblige, en voulant échapper à la publicité, le milliardaire élargit encore et toujours le spectre de celles et ceux qui s’opposent à ses ambitions et à son monde…
Le raout du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure
À Biarritz, après que Thibault de Montbrial, un des bénéficiaires des mannes de Périclès, a pu organiser un raout de son Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure (CRSI) dans le stade de l’équipe de rugby – dont Otium Capital est devenu l’actionnaire de référence en 2024 -, les supporters dans les tribunes dénoncent ce qu’ils désignent comme un « Stérin miné ». Et malgré la menace d’une éviction pure et simple orchestrée par leur actionnaire, et en dépit de la rétrogradation de l’équipe en Nationale annoncée ce lundi, les dirigeants du club, avec, au premier rang, Shaun Hegarty qui a vu son ami Federico Aramburu, ex-international argentin, tomber sous les balles de militants de l’extrême droite radicale en mars 2022, cherchent des investisseurs moins encombrants.
mise en ligne le 20 mai 2025
Les « Fossoyeurs » sévissent toujours
dans les Ehpad : l'exemple par la Villa d’Avril
Par Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris sur www.humanite.fr
Une nouvelle recrue, candidate aux élections des instances représentatives du personnel, doit parer plusieurs tentatives de licenciement. Son tort ? Avoir dénoncé les mauvaises conditions de travail dans son Ehpad, maltraitantes pour les résidents..
Été 2024. Saint-Avold, en Moselle. Dans une maison de retraite médicalisée de 76 lits nommée Villa d’avril (groupe Colisée, 4e acteur du secteur), Mme L., aide-soignante et récemment candidate aux élections professionnelles, est sur le point d’être licenciée.
Son tort ? Avoir dénoncé, à moult reprises, les conditions de travail qui lui sont imposées ainsi qu’à ses collègues, lesquelles (ce sont majoritairement des femmes) évoluent dans un contexte de sous-effectif chronique, au point que la santé et la dignité des résidents s’en trouvent atteintes. Depuis juillet, Mme L. ne mâche plus ses mots : « Ce matin, j’ai repris mon poste (…) et j’ai remarqué qu’aucun résident n’a été changé la nuit. (Ils) sont donc souillés de la tête aux pieds, frigorifiés. Cette négligence m’oblige à faire double travail (…). Il est compliqué pour moi de continuer à travailler dans de telles conditions. »
Plutôt que de se préoccuper de ce constat alarmant, et huit jours seulement après sa candidature, l’employeur la convoque à un entretien en vue d’un licenciement. « Je suis d’accord que, la seule solution, (…) c’est de retirer le noyau contagieux », écrivait alors la directrice de l’Ehpad à sa responsable régionale. Mme L., licenciée le 3 septembre, ne peut donc pas participer aux élections, prévues pour le 24. Conscient de l’avoir virée sans respect de son statut protecteur (non seulement pour les élus du personnel, mais aussi les candidats aux élections), l’établissement consent à réintégrer la salariée, mais trois jours après les élections, le 27 septembre…
Contre toute attente, le 2 octobre, rebelote : Mme L. est convoquée à un nouvel entretien préalable. Par décision du 18 décembre, l’inspection du travail, saisie de la demande de licenciement, s’y oppose, considérant qu’aucun des reproches faits à la salariée n’était établi. Ouf !
Mais l’Ehpad refuse alors de la réintégrer, au prétexte (inopérant) qu’un recours est porté contre la décision de l’inspection. Elle saisit le conseil de prud’hommes en janvier. L’employeur change alors son fusil d’épaule : il réintègre la salariée pour la muter aussitôt dans un autre établissement, à Giraumont, près de Metz, à plus de 80 kilomètres de son domicile, alors qu’aucune clause de mobilité ne figure à son contrat.
Stop, ou encore ? Placée en arrêt maladie depuis le 7 février, Mme L. fait de nouveau l’objet d’une procédure de licenciement le 4 mars, juste après l’expiration de sa période de protection, cette fois pour « absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise »…
Finalement, les juges prud’homaux viendront clore cette vaste farce et annuler ce triple licenciement1, en retenant que le comportement de l’employeur caractérise un « trouble manifestement illicite » justifiant la réintégration de Mme L. au sein de la Villa d’avril.
-
Décision : conseil de prud’hommes de Forbach, 28 avril 2025, RG n° R 24-05838. Avocate plaidante : Romane Bartoli, du barreau de Paris. ↩︎
mise en ligne le 19 mai 2025
Choose France :
en termes d'attractivité est un échec,
la preuve par les chiffres
Cyprien Boganda sur www.humanite.fr
Lundi 19 mai, 200 patrons de multinationales sont attendus à Versailles pour le sommet Choose France, où le chef de l’État doit vanter les mérites de sa politique économique… Pour tenter d'en masquer les échecs. En vain. Démonstration.
Emmanuel Macron doit se livrer ce lundi 19 mai à l’un de ses exercices favoris : l’autocélébration. Tel un monarque en son palais, le chef de l’État reçoit sous les ors du château de Versailles 200 patrons de multinationales dans le cadre du sommet Choose France, un raout somptuaire mis en place dès 2018 pour mettre en scène sa capacité à séduire les dirigeants d’entreprises étrangères.
Au programme, sont attendues des annonces en matière d’investissements dans l’Hexagone, pour un montant qui devrait avoisiner les 20 milliards d’euros, ainsi qu’un bilan (forcément) mirifique de la politique macroniste. En 2024, les investissements avaient été salués par les cris de joie de Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie : « Ce grand succès historique est dû à une seule chose : notre politique économique mise en place depuis sept ans avec Emmanuel Macron. (…) La réindustrialisation de la France est en marche ! »
Un net essoufflement de « l’effet » Macron
Le triomphalisme sera probablement de mise ce lundi. « Nous sommes depuis six ans le pays le plus attractif d’Europe », fanfaronnait déjà Emmanuel Macron face à Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur TFI, le 13 mai. Pourtant, les dernières données concernant l’attractivité tricolore invitent à la retenue plus qu’à l’autosatisfaction.
Le baromètre du cabinet EY, qui fait le point régulièrement sur les investissements étrangers, annonce un net essoufflement de « l’effet » Macron : le nombre de projets d’implantation et d’extension de sites existants en France a plongé de 14 % en 2024. Première raison invoquée par 200 patrons internationaux interrogés par EY : le climat politique en France, source d’une « instabilité » budgétaire inédite. Une instabilité créée par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, décrétée par un certain Emmanuel Macron.
La France détient certes la « palme » européenne avec 1 025 projets d’investissements étrangers (contre 853 au Royaume-Uni et 608 en Espagne), mais la moisson en termes d’emplois est de plus en plus maigrichonne : seuls 30 postes en moyenne ont été créés par chacun de ces projets d’investissements en 2024, contre 125 en Espagne et 48 en Allemagne. Au total, 29 000 emplois devaient être créés par le biais des investissements étrangers en 2024, soit une baisse de près de 30 % par rapport à 2023 et de 35 % par rapport à 2021.
Les chiffres sont encore plus cruels lorsqu’on tient compte (ce que l’exécutif ne fait quasiment jamais) des postes détruits dans le même temps par les multinationales. L’enquête d’EY montre par exemple que l’année dernière, elles ont créé 12 304 postes dans l’industrie manufacturière (en baisse de 40 % par rapport à l’année précédente), mais qu’elles en ont supprimé 8 312 (en hausse de 66 %) par le biais de restructurations et de fermetures de sites.
Soit un solde de seulement 3 992 créations nettes. Dans certains secteurs, le bilan devient carrément négatif : dans la chimie, par exemple, 480 emplois ont été créés, pour 1 420 destructions ! Dans l’automobile, deux fois plus de postes ont été supprimés (2 029) que créés (1 133).
Un pari à la fois périlleux et ruineux
Il n’y a rien de surprenant à ce que ce soient ces deux secteurs qui trinquent le plus : les derniers mois ont vu de nombreuses multinationales sabrer dans leurs effectifs, comme le belge Solvay (68 suppressions de postes dans le Gard) ou l’allemand WeylChem (plus de 100 suppressions dans l’Oise). Mais les mauvaises nouvelles frappent plus généralement l’ensemble de l’industrie.
Plus du quart des destructions d’emplois prévues par des PSE en 2024 (environ 77 000) concernaient l’industrie manufacturière. Par ailleurs, le solde net de créations d’emplois dans l’industrie est resté positif en 2024, mais il a chuté de plus de 60 % par rapport à l’année dernière, à 31 223 emplois, selon le cabinet Trendeo. « Cela résulte d’un double mouvement de montée des suppressions d’emplois (+ 77 %) et de baisse des créations (− 18 %) », précise le cabinet.
Le processus de « réindustrialisation » tant vanté par Emmanuel Macron est bel et bien enrayé, et les efforts de com déployés dans le cadre de Choose France ne suffiront pas à remonter la pente : en appeler aux multinationales pour réindustrialiser le pays est un pari à la fois périlleux et ruineux.
Périlleux, parce qu’on sait très bien que les multinationales ferment des sites plus vite qu’elles en ouvrent : quand elles sentent le vent tourner, elles ne tardent jamais à baisser le rideau. « On a affaire à des entreprises très mobiles, moins attachées au territoire et qui, en cas de problème, n’hésiteront pas à fermer leur site français pour se relocaliser ailleurs », prévenait déjà l’économiste Vincent Vicard, en 2022.
Transformer la France en eldorado du grand capital
En ce moment, de nombreux groupes regardent les États-Unis avec des yeux de Chimène, à l’image du laboratoire Sanofi, qui a récemment annoncé son intention d’y investir la bagatelle de 20 milliards de dollars. EY confirme que les investissements étrangers ont grimpé d’environ 20 % dans le pays dirigé par Donald Trump l’an passé, en partie du fait de la politique « probusiness » menée par son prédécesseur, Joe Biden, à grands coups d’investissement public et d’exonérations fiscales.
Tout miser sur les multinationales est donc un pari hasardeux, mais également ruineux car les politiques d’attractivité mises en place par Emmanuel Macron pour transformer la France en eldorado pour le grand capital ont un coût exorbitant. Un coût social, avec l’affaiblissement du droit du travail dans le cadre des ordonnances de 2017 (facilitation des licenciements économiques, plafonnement des indemnités prud’homales, etc.), mais également économique : baisse de l’impôt sur les sociétés (11 milliards d’euros par an), des impôts de production (au moins 10 milliards), etc.
Et le pire, c’est que les patrons de multinationales n’ont même pas la reconnaissance du ventre. Interrogés par EY, ils considèrent que la « simplification » et la « réduction » de la fiscalité française sont toujours des « priorités absolues » pour attirer d’avantage d’investissements dans les mois à venir. Entendre Emmanuel Macron, sur TF1, annoncer sa volonté d’alléger la fiscalité pesant sur le travail ne leur a sans doute pas déplu.
mise en ligne le 19 mai 2025
À l’Assemblée, la réintroduction des néonicotinoïdes revient
par la petite porte
Amélie Poinssot sur www.mediapart.fr
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a achevé vendredi 16 mai l’examen de la proposition de loi « Duplomb ». Elle a réintroduit la plupart des reculs écologiques qui avaient été retirés en commission développement durable.
Deux salles, deux ambiances. Examinée cette semaine par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, la proposition de loi « Duplomb » – du nom du sénateur Les Républicains (LR) qui l’a initiée – a retrouvé une bonne partie des reculs écologiques qu’elle contenait à l’origine. Un vote qui vient contrebalancer celui de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, les 6 et 7 mai, où plusieurs élu·es, allant de la gauche à la droite, avaient retoqué la plupart des dispositions critiques.
Cette fois-ci, LR et les macronistes d’Ensemble pour la République (EPR) – à l’exception de la présidente de la commission développement durable Sandrine Le Feur, venue soutenir ses amendements auprès de ses collègues des affaires économiques – ont voté d’une même voix pour rétablir les textes les plus critiques, se rapprochant des positions du Rassemblement national (RN), qui tient une ligne claire depuis le début des discussions en faveur des pesticides, de l’élevage intensif et des mégabassines.
Seul le MoDem est apparu divisé, les uns votant avec la gauche et le groupe écologiste pour maintenir les avancées de la semaine dernière, les autres s’alignant sur le reste de la Macronie, la droite et l’extrême droite en faveur d’une agriculture productiviste le moins limitée possible par la nécessité de préserver biodiversité et santé de la population.
Principale disposition au cœur du texte, la possibilité d’un retour des néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d’abeilles, est ainsi revenue en force. Inscrite à l’article 2 de la proposition de loi, elle permettrait par décret, « à titre exceptionnel », « de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ». Ces produits toxiques, interdits en France depuis 2018, avaient bénéficié d’une dérogation jusqu’au début de 2023.
Le RN pro-pesticides
Au cours des débats qui se sont achevés vendredi 16 mai, le rapporteur de la loi Julien Dive (LR), élu de l’Aisne, l’un des départements les plus gros producteurs de betteraves, a fermement soutenu la réintroduction de l’insecticide. Pour l’encadrer, il a simplement porté un amendement qui limite cette autorisation à trois ans, tout en donnant un « avis favorable » à un amendement du RN qui rendait cette durée renouvelable. Ce dernier amendement, toutefois, n’a pas emporté la majorité. Le RN a même tenté, sans y parvenir, de faire entériner le retour de l’ensemble des néonicotinoïdes, y compris ceux interdits par l’Union européenne.
Pour les élu·es favorables à ce type d’insecticide dit systémique – il se diffuse dans toutes les parties de la plante, y compris le pollen et le nectar –, la cause est entendue : il s’agit simplement de réintroduire l’acétamipride pour traiter les noisetiers. Il s’agit de l’une des trois molécules encore autorisées sur le sol européen. « Ce sera juste pour une durée précise, pour une molécule précise, et à certaines conditions », a plaidé Julien Dive à plusieurs reprises. « Quand bien même on ne le ferait que pour la noisette, ça vaut le coup de le faire », a assuré de son côté Jean-Luc Fugit, député macroniste du Rhône.
Pour sauver la filière noisette ou la filière betterave, on accepte de siffler la mort de la filière apicole. Pierrick Courbon, député PS de la Loire et apiculteur
Le texte, cependant, ne précise à aucun endroit que seule cette molécule est concernée, et que seule la filière de la noisette pourrait en bénéficier. Autrement dit, c’est une porte grande ouverte pour le retour de substances dont la toxicité n’est plus à démontrer.
Au cours des débats, les député·es pro-pesticides ont avancé la nécessité de faire le poids face aux concurrents de la France sur la noisette, Italie et Turquie en tête. « 65 % de la production de noisette de mon département est partie à la poubelle », fait valoir Hélène Laporte, députée RN du Lot-et-Garonne, auprès de Mediapart.
Élue dans le fief du syndicat de la Coordination rurale, qui s’oppose violemment aux mesures environnementales, elle rappelle que le retour de l’acétamipride est porté depuis longtemps par son parti : c’était déjà l’objet, il y a deux ans, d’une proposition de loi de son collègue, Timothée Houssin. Et l’extrême droite n’entend pas se cantonner à la noisette. « Il y a la fraise aussi… »
Les chiffres brandis pendant les débats pour défendre le retour de la molécule toxique sont le plus souvent fantaisistes. La réalité, c’est que malgré les attaques de la « puce diabolique », contre laquelle l’acétamipride est parfaitement efficace, les rendements des noisetiers français restent nettement supérieurs à ceux de l’Italie et de la Turquie, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
La gauche de la commission n’est pas dupe et dénonce le tour de passe-passe : privilégier les intérêts d’une filière au détriment du principe de précaution et de la préservation des insectes, voilà qui est curieux, relèvent les uns et les autres au cours de la discussion. « Pour sauver la filière noisette ou la filière betterave, on accepte de siffler la mort de la filière apicole », regrette le socialiste élu de la Loire Pierrick Courbon, lui-même apiculteur. « En vingt ans, le miel a perdu deux tiers de sa production. »
L’élue des Deux-Sèvres Delphine Batho (Générations Écologie) avance les dernières données scientifiques : « L’acétamipride se retrouve dans le liquide céphalorachidien d’enfants atteints de cancers, il franchit la barrière placentaire, se transmet dans le lait maternel, il y a une suspicion importante de son impact sur les troubles du développement… »
Quant à la députée d’Ille-et-Vilaine Mathilde Hignet (La France insoumise), elle refuse « d’être complice d’un système qui bousille les vies des agriculteurs » et profite du débat pour rendre hommage à Christian, cet agriculteur breton atteint de leucémie, « qui nous a quittés le 10 avril dernier ».
RN et FNSEA
Si l’ensemble de la gauche tient, avec constance, une ligne d’opposition aux pesticides et dénonce un texte qui n’améliore en rien les conditions de vie dans le monde agricole, elle échoue à faire passer la plupart de ses amendements.
Parmi les rares dispositions progressistes adoptées, signalons cependant celle portée par le député gersois David Taupiac (groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, Liot), voté avec la gauche et en dépit d’un « avis défavorable » du rapporteur : les exploitants agricoles subissant des pertes en cas d’interdiction d’un produit phytosanitaire devront être indemnisés.
L’autre sujet clé du texte, le processus d’autorisation des pesticides par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses), se voit quant à lui largement amendé, faisant apparaître l’indépendance de l’expertise scientifique comme une ligne rouge pour la Macronie. Dans le texte adopté en janvier par le Sénat, la tutelle du ministère de l’agriculture était renforcée et l’Anses se voyait dotée d’un « conseil d’orientation pour la protection des cultures » dans lequel pouvait être intégrés, par voie de décret, des représentants des firmes de l’agrochimie.
La commission développement durable avait rejeté l’ensemble de ces dispositions ; celle des affaires économiques les a corrigées. Il n’y a plus de « conseil d’orientation », mais un « comité des solutions » où les firmes ne pourront pas siéger, mais être auditionnées.
Une majorité a également voté pour des facilitations concernant les bâtiments d’élevage, notamment par la voie de deux amendements déposés par le RN explicitement travaillés « en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles [FNSEA] ».
La commission affaires économiques n’a pas pu revenir, en revanche, sur un point important sur lequel la commission développement durable avait été saisie « au fond » et qu’elle avait rejeté : la simplification de la construction de mégabassines.
La discussion sur le stockage d’eau devrait toutefois revenir en séance plénière, à partir du 26 mai. C’est en tout cas ce qu’ont promis, du côté des macronistes, Jean-Luc Fugit, et pour LR, l’élu de Haute-Loire Jean-Pierre Vigier : ils prévoient de déposer des amendements en ce sens. Le backlash écologique est loin d’être terminé.
mise en ligne le 18 mai 2025
Montpellier : de la Paillade à la Comédie pour demander la fin du génocide
sur https://lepoing.net/
Ils étaient un millier à manifester depuis le quartier populaire de la Paillade jusqu’à la place de la Comédie ce samedi 17 mai pour commémorer les 77 ans du début de la Nakba et demander la fin du génocide en Palestine
Juché sur un camion stationné devant les halles de la Paillade, Manu, militant de la campagne BDS-Urgence Palestine Montpellier, harangue la foule : “Cela fait longtemps que BDS est présent à la Paillade, et on sait que ce quartier est mobilisé en faveur du peuple palestinien.”
Et en ce 17 mai, la manifestation prend un contexte tout particulier : il y a 77 ans, le 15 mai, commençait la Nakba (“catastrophe” en arabe), où en 1948, démarrait le début de l’expulsion des Palestiniens de leurs terres et du nettoyage ethnique : entre 700 000 et 750 000 palestiniens — sur les 900 000 qui vivaient dans les territoires qui seront sous contrôle israélien à l’issue du conflit de 1948, ont fui ou ont été chassés de leurs terres.
“C’est une réalité toujours en cours”, rappelle une intervenante au micro. “Ce n’est pas seulement les expulsions, c’est aussi la famine, le manque d’eau, l’absence d’électricité, le blocus humanitaire.” À ce propos, six personnalités (Étienne Balibar, Sophie Bessis, Rony Brauman, Mona Chollet, Annie Ernaux et Edgar Morin) ont récemment lancé un appel au gouvernement Français pour demander à Israël “l’ouverture des points de passage afin que l’aide humanitaire soit distribuée par des organisations internationales, selon les normes du droit international”. Cet appel, relayé par l’Union Juive Française pour la Paix, vise à être signé par le plus grand nombre (lien pour signer en cliquant ici).
Le cortège, fourni d’un millier de personnes, a défilé de la Paillade à la Comédie en distribuant notamment aux passants des flyers appelant à signer la pétition contre la dissolution d’Urgence Palestine.
Le 21 mai à Montpellier, la Carmagnole (10 rue La Palissade) organise à 19 heures la présentation du livre « Gaza Mort Vie Espoir » avec deux de ses auteurs, Brigitte Challande et Pierre Stambul. Ce livre compile des récits de résistance quotidienne à Gaza depuis le 7 octobre, dont certains sont lisibles sur l’Agora du Poing.
mise en ligne le 18 mai 2025
Déserts médicaux :
« Il faut créer
un service public de
santé
territoriale et de proximité »
Scarlett Bain sur www.humanite.fr
Pour Eric May, médecin généraliste et directeur du Centre Municipal de Santé de Malakoff, les deux propositions de lois qui viennent d’être adoptées pour lutter contre les déserts médicaux ne répondent pas aux besoins réels des populations et du maillage du territoire.
Pour lutter contre les déserts médicaux, deux lois ont été votées en première lecture à quelques jours d’intervalles. La première, la loi Garot, défendue par la gauche, adoptée le 7 mai à l’Assemblée nationale, porte le principe de régulation de médecins. La seconde, dite loi Mouiller présentée par la droite, votée le 13 mai au Sénat, défend la notion d’encadrement. Cette dernière est soutenue par le gouvernement, qui a déclenché son examen en lecture accélérée. Membre de l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé (USMCS), Eric May propose une autre voie pour garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Quelle est votre position par rapport à la proposition de loi du sénateur Les Républicains Philippe Mouiller ?
Eric May : Ce projet de loi porte la notion d’encadrement et non pas de régulation de l’installation des médecins. Elle ne répond pas aux enjeux et nous amènerait droit dans le mur. Les propositions qu’elle comporte reprennent des éléments du plan d’action élaborée à la hâte par François Bayrou et y ajoutent du flou. Le nombre d’interventions d’un médecin qui s’installerait dans une zone surdotée et qui devrait compenser par une présence chronique dans une zone sous-dotée n’est plus renseigné.
Le premier ministre l’avait fixée à deux jours, ce qui ne répondait déjà en rien aux besoins réels mais au moins une indication était donnée. Cependant, dans tous les scénarios, une présence hachée ne peut répondre ni à la qualité ni à la continuité des soins. Ce projet de loi porte la notion d’organiser la « solidarité » des médecins. Moi, j’appelle cela de la charité. Ce n’est pas ce dont la population a besoin.
Soutenez-vous davantage la proposition de loi transpartisane portée par le député socialiste Guillaume Garot ?
Eric May : La régulation de l’installation des médecins est un passage nécessaire. Il faut arrêter de rester arc bouté sur le principe de la liberté de l’installation dont nous allons fêter les cent ans l’année prochaine. Cette charte des médecins libéraux est datée et a montré les limites de son efficacité, aggravée notamment par le numerus clausus. Au moment où justement les ressources sont rares, la question de leur bonne répartition se pose logiquement et pour une raison simple : l’égalité d’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire.
Mais cette régulation doit aller de pair avec l’organisation des soins de premiers recours sans quoi on continuera de créer des déserts médicaux. En cela dans les deux propositions de loi, il reste un impensé : l’avenir du secteur 2. Ces médecins, le plus souvent spécialisés, pratiquent des dépassements d’honoraire. Ils sont aussi mal répartis sur le territoire : des zones se retrouvent surdotées en secteur 2 et sous-dotées en secteur 1. En réalité, il est question d’un choix de société : celui de développer un réel service public de la santé.
En tant que directeur du Centre Municipal de Santé de Malakoff, vous défendez le maillage du territoire par une offre de soin publique. Selon vous, la simple régulation ne peut être suffisante ?
Eric May : Non, elle est une étape. La solution doit passer par la création de centres de santé public, qui sont des structures pluriprofessionnelles avec obligation de pratiquer le tiers payant et de respecter les tarifs opposables. Il faut que les politiques publiques investissent dans la création d’un service public de santé de proximité pour mailler l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas de s’opposer à la médecine libérale mais de venir compléter ou palier les besoins de la population qui se trouve dans une situation d’urgence.
Le coût de leur création et de leur maintien est un choix. Sans remettre en cause le droit des professionnels de santé à un exercice libéral, il faut dans chaque territoire un centre de santé public en lien avec un hôpital public et des services publics de santé préventive tels que la santé scolaire ou la PMI… Soigner, éduquer, garantir l’accès aux services de santé de qualité : ce sont là les missions de la République. La santé ne peut plus dépendre des choix individuels d’installation ou d’exercice de professionnels de santé. Elle doit faire l’objet d’une organisation fondée sur l’intérêt général, au service de tous, lisible et garantie sur tout le territoire. De par mon expérience, je sais que ce modèle de travail en équipe dans des centres pluridisciplinaires et équipés en conséquence peut séduire de nombreux médecins.
mise en ligne le 17 mai 2025
« La direction de la Poste veut museler les syndicats » : cinq postiers de Sud PTT devant le tribunal pour des faits datant d’une grève de… 2014
Hayet Kechit sur www.humanite.fr
Mis en cause pour « violation de domicile » et « violences », après deux tentatives d’occupation du siège du groupe postal, lors d’une grève en 2014, cinq syndicalistes sont convoqués au tribunal correctionnel de Paris, le 12 juin. Ils nient les accusations, dénonçant une tentative d’intimidation de leur direction, qui peut leur valoir une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.
Deux intrusions au sein de son siège national, dans le cadre d’un mouvement social. Voilà ce que la direction de la Poste appelle une « violation de domicile », qui vaut, onze années après les faits reprochés, une comparution devant la justice à quatre postiers et une postière, militants de Sud-PTT dans les Hauts-de-Seine, convoqués le 12 juin prochain au tribunal correctionnel de Paris. Ils sont par ailleurs accusés de faits de « violences » qui auraient été commis, à cette même occasion, à l’encontre de la responsable de la sûreté de l’époque. Ce que nient de façon constante les mis en cause.
À un mois de cette convocation judiciaire, les militants ont organisé ce jeudi 15 mai une conférence de presse, à laquelle s’est notamment joint le député Éric Coquerel (LFI), pour rendre public un appel de soutien aux grévistes mis en cause, signé par plusieurs personnalités du monde syndical et politique, dont le sénateur et directeur de l’Humanité Fabien Gay.
Le but de cette action : apporter une réponse collective face « un acharnement, dans l’air du temps, destiné à museler toute contestation syndicale et sociale contre l’idéologie dominante ». Ce que Sud estime être une « instrumentalisation de la justice » serait ainsi l’arme ultime dégainée par la direction de la Poste pour porter le coup de grâce à un syndicat pugnace, devenu au fil de grèves victorieuses (en 2010 et 2014 notamment) « un caillou dans la chaussure »– selon les termes d’Eric Coquerel – dans son entreprise de restructuration et de réduction des coûts, menée au détriment des conditions de travail des agents et de ses missions de service public.
« Cinq ans d’emprisonnement, c’est pas rien ! »
Autour des deux stands dressés face au siège du groupe, à Paris (XVe), tracts, DVD retraçant les luttes victorieuses du syndicat, dossiers de presse détaillés circulent parmi le public accueilli en ce frais matin de mai. « Rien n’est laissé au hasard. Vous avez sorti l’artillerie lourde ! » tente-t-on de plaisanter auprès de Gaël Quirante, le chef de file de Sud Poste 92, qui compte parmi l’un des cinq syndicalistes mis en cause. « On va dire que 5 ans d’emprisonnement, ce n’est quand même pas rien ! » grince du tac au tac le représentant syndical, qui vu « l’air du temps », n’a pas le cœur à la légèreté et prend l’affaire très au sérieux. C’est en effet la peine encourue par les cinq militants, à laquelle pourrait s’ajouter une amende de 75 000 euros, si la version de la Poste emportait la conviction du tribunal pour ces faits remontant à février 2014.
À cette époque, un bras de fer – qui durera 170 jours, entre janvier et juillet 2014 – est engagé déjà depuis un mois entre la direction du groupe postal et Sud PTT 92. Des factrices et facteurs de Rueil-Malmaison, la Garenne-Colombes, et Gennevilliers sont alors grève pour exiger l’embauche en CDI de leurs collègues intérimaires et contre les restructurations. Face à l’enlisement du conflit, une délégation se rend alors à deux reprises, les 13 et 20 février 2014, au siège de leur groupe, rue de Vaugirard, à Paris (XVe), ainsi que dans des locaux de la direction départementale, en tentant d’y pénétrer malgré l’opposition de la responsable sécurité de la Poste.
À l’issue de ces confrontations, cette dernière portera plainte aux côtés de sept vigiles et du groupe lui-même pour « violences », « dégradations » et « violation de domicile », malgré les dénégations constantes des cinq postiers. « Je connais Gaël et les syndicalistes des Hauts-de-Seine depuis longtemps et il n’est pas imaginable qu’il y ait eu un seul acte de violences », se porte garant Eric Coquerel, qui révèle avoir tenté, en vain, de plaider la cause des syndicalistes auprès du PDG de la Poste, Philippe Wahl, croisé dans le cadre de ses missions de président de la commission des Finances à l‘Assemblée nationale. L’élu, selon qui « cette procédure judiciaire fait partie d’un plan concerté pour faire un exemple » affirme également « avoir été le témoin depuis 2015 de l’acharnement de la Poste vis-à-vis de Sud PTT 92, qui paie le fait d’empêcher la normalisation des plans de restructuration ».
Diversion à l’action militante
Un acharnement dont témoigneraient, selon Gaël Quirante, les motifs jugés invraisemblables de cette plainte. « » Violation de domicile « : c’est tout de même une façon originale de présenter les choses s’agissant d’une action somme toute très banale dans les luttes syndicales », raille Gaël Quirante, qui ne s’en dit pas moins inquiet face au signal adressé aux militants qui se risqueraient désormais à investir les locaux de leur entreprise pour exiger d’être reçus par leurs dirigeants. Derrière cette affaire, le syndicaliste, comme Eric Coquerel, voit une diversion à l’action militante et une nouvelle escalade dans le projet de museler un syndicat particulièrement offensif dans sa lutte pied à pied contre la précarisation, la fermeture de guichets, la suppression de tournées et leur lot de dégâts sur les conditions de travail, générés par le projet de restructuration mené à marche forcée par le groupe postal.
Gaël Quirante a par ailleurs saisi l’occasion de cette riposte pour dévoiler un document interne assez édifiant lié à la réorganisation du centre d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), sur lequel le syndicat a mis la main et que l’Humanité a pu consulter. « Il classe les agents dans un échiquier selon leur niveau de proximité avec le projet de restructuration, dans deux catégories : antagonistes ou conciliants », détaille le syndicaliste, selon qui des mesures de rétorsion seraient même envisagées à l’encontre de ceux que la direction nomme les « irréconciliants ».
Classement des salariés réfractaires
Au-delà de cet étrange fichage, le syndicaliste s’estime également, à travers l’action judiciaire qui débutera le 12 juin, une cible privilégiée de la direction. Cette dernière ne se résoudrait en effet pas à voir le postier garder son mandat syndical, lui ouvrant le droit d’intervenir dans les centres postaux, malgré son licenciement acté en 2018 (pour lequel ce dernier a lancé un recours devant la Cour européenne des droits de l‘homme). Un licenciement autorisé par la ministre du Travail de l’époque, Murielle Pénicaud, alors même que l’Inspection du Travail avait qualifié la procédure de discriminatoire et qu’une fronde s’était levée parmi ses collègues, à la faveur d’une autre grève spectaculaire de quinze mois.
Contactée par l’Humanité sur l’ensemble de cette affaire, la direction de la Poste n’a pour le moment pas donné suite à nos sollicitations, ni sur la procédure en justice des cinq prévenus, ni sur cette affaire de fichage à Issy-les-Moulineaux.
mise en ligne le 17 mai 2025
Gaza : Monsieur le président, votre honte
Edwy Plenel sur www.mediapart.fr
« C’est une honte », s’est contenté de dire, le 13 mai sur TF1, Emmanuel Macron à propos de ce que fait Israël à Gaza et qu’il s’est refusé à qualifier. La véritable honte, c’est de s’en tenir à ces mots et de ne rien faire pour empêcher le génocide en cours. Au moins cent Palestiniens auraient encore perdu la vie dans des frappes vendredi.
« Une sinistre entreprise » : le 13 mai, Tom Fletcher, secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires, commençait ainsi son exposé devant le Conseil de sécurité. Oui, une sinistre entreprise, insistait-il, que d’informer « à nouveau » la communauté internationale sur « l’atrocité du XXIe siècle dont nous sommes les témoins quotidiens à Gaza ».
Que dirons-nous aux générations futures ? a-t-il d’emblée lancé aux diplomates réunis à New York. Que « nous avons fait tout ce que nous pouvions » ? Des « mots vides de sens », cinglait-il, tant c’est l’inverse qui est vrai. L’état des lieux – des ruines, plutôt – qu’il a dressé mérite d’être longuement cité, ne serait-ce que pour l’histoire car, précisait-il, c’est « ce que nous voyons » et que, pourtant, le monde laisse faire, dans un mélange de complicité, d’indifférence et d’impuissance.
« Israël impose délibérément et sans honte des conditions inhumaines aux civils dans le territoire palestinien occupé. Depuis plus de dix semaines, rien n’est entré à Gaza – ni nourriture, ni médicaments, ni eau, ni tentes. Des centaines de milliers de Palestiniens ont, une fois de plus, été déplacés de force et confinés dans des espaces de plus en plus restreints, puisque 70 % du territoire de Gaza se trouve soit dans des zones militarisées par Israël, soit sous le coup d’ordonnances de déplacement. »
« Chacun des 2,1 millions de Palestiniens de la bande de Gaza est confronté au risque de famine. Un sur cinq risque de mourir de faim. Malgré le fait que vous ayez financé la nourriture qui pourrait les sauver. Les quelques hôpitaux qui ont survécu aux bombardements sont débordés. Les médecins qui ont survécu aux attaques de drones et de snipers ne peuvent pas faire face aux traumatismes et à la propagation des maladies.
« Aujourd’hui encore, l’hôpital européen de Gaza à Khan Younès a été bombardé une nouvelle fois, faisant encore plus de victimes civiles. Pour avoir visité ce qui reste du système médical de Gaza, je peux vous dire que la mort à cette échelle a un son et une odeur qui ne vous quittent pas. Comme l’a décrit un employé de l’hôpital, “les enfants crient lorsque nous enlevons le tissu brûlé de leur peau...” Et pourtant, on nous dit que “nous avons fait tout ce que nous pouvions”. […] »
Les alarmes de l’ONU
« Il n’y a pas que Gaza. La violence effroyable augmente également en Cisjordanie, où la situation est la pire que l’on ait connue depuis des décennies. L’utilisation d’armes lourdes, de méthodes de guerre militaires, d’une force excessive, de déplacements forcés, de démolitions et de restrictions de mouvement. Expansion continue et illégale des colonies. Des communautés entières détruites, des camps de réfugiés dépeuplés.
« Les colonies s’étendent et la violence des colons se poursuit à un niveau alarmant, parfois avec le soutien des forces israéliennes. Récemment, des colons ont enlevé une jeune fille de 13 ans et son frère de 3 ans. Ils ont été retrouvés attachés à un arbre. Devons-nous également leur dire que “nous avons fait tout ce que nous pouvions” ? »
Le lendemain de cet exposé, complété par celui d’Angélica Jácome, directrice de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) – « le risque de famine est imminent », a-t-elle averti –, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) diffusait son bulletin hebdomadaire sur la situation à Gaza.
Chaque mercredi, il actualise le décompte du massacre : entre le 7 et le 14 mai 2025, à midi, 275 Palestinien·nes tué·es et 949 blessé·es ; entre le 7 octobre 2023 et le 14 mai 2025, au moins 52 928 Palestinien·nes tué·es et 119 846 blessé·es ; chiffres qui incluent les 2 799 personnes tuées et 7 805 blessées depuis le 18 mars 2025, date de la rupture du cessez-le-feu par Israël.
Deux jours plus tard, le 16 mai 2025, une autre agence des Nations unies, l’Unicef, dédiée à la protection de l’enfance, signalait « la mort d’au moins 45 enfants dans la bande de Gaza au cours des deux derniers jours » : « Depuis dix-neuf mois, Gaza est un cimetière pour les enfants et plus aucun endroit n’est sûr. Du nord au sud, ils sont tués ou blessés dans les hôpitaux, dans les écoles transformées en abris, dans des tentes de fortune ou dans les bras mêmes de leurs parents. Au cours des deux derniers mois seulement, dans l’ensemble de la bande de Gaza, plus de 950 enfants auraient été tués par des frappes. »
Ces chiffres, dans leur sécheresse, ne disent pas tout du désastre, cette destruction non seulement de vies humaines mais de l’existence même d’un peuple, de ses maisons, de ses lieux, de sa terre, de sa culture, bref de son monde.
Ils n’en épuisent même pas le décompte macabre : le 20 juillet 2024, une étude de la revue médicale The Lancet évaluait déjà les morts à 8 % de la population gazaouie, en ne se contentant pas de dénombrer les personnes tuées directement mais en incluant aussi une évaluation des décès provoqués par le blocus, la famine et les maladies.
Emmanuel Macron lors de l’émission « Les défis de la France » sur TF1, le 13 mai 2025. © Photo Sébastien Calvet / Mediapart
Certes, le siège total que subit, depuis le 2 mars 2025, la bande de Gaza, ce petit territoire surpeuplé (365 kilomètres carrés pour 2,1 millions d’habitant·es), réveille quelques lucidités tardives. Mais, pour l’heure, il n’a rien changé à l’inaction du monde.
Interrogé sur TF1 au soir du 13 mai, le jour même de l’exposé devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Emmanuel Macron s’est refusé à évoquer un « génocide » durant les six pauvres minutes consacrées à la guerre de Gaza d’une interminable émission de plus de trois heures. L’affaire des seuls historiens, a-t-il asséné. En somme, quand tout sera fini, quand le crime aura été accompli, quand les vivant·es ne seront plus là pour en témoigner. Parce que nous n’aurons rien fait pour les sauver.
Au même moment, à New York, Tom Fletcher répondait par avance au président de la République française : « Vous disposez donc de ces informations. Aujourd’hui, la Cour internationale de justice (CIJ) examine la question de savoir si un génocide est en cours à Gaza. Elle examinera les témoignages que nous avons partagés. Mais il sera trop tard. Reconnaissant l’urgence, la CIJ a indiqué des mesures provisoires claires qui doivent être mises en œuvre maintenant, mais elles ne l’ont pas été. […] Alors, pour ceux qui ont été tués et ceux dont les voix sont réduites au silence : de quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin maintenant ? Agirez-vous – de manière décisive – pour prévenir les génocides et garantir le respect du droit humanitaire international ? Ou direz-vous plutôt que “nous avons fait tout ce que nous pouvions” ? »
La honte, c’est de ne rien faire pour arrêter un génocide, sauver un peuple, sanctionner des dirigeants criminels, défendre le droit international
La question du génocide ne fait plus guère débat parmi les juristes et les humanitaires. Elle a été documentée par Amnesty International le 5 décembre 2024, par Médecins sans frontières le 18 décembre 2024, par Human Rights Watch le 19 décembre 2024, après l’avoir été, dès le 24 mars 2024, par Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. Ce mot, qui qualifie et incrimine, décrit une volonté d’annihilation d’une partie du peuple palestinien. De destruction, d’effacement, de disparition.
C’est un processus indissociable de toute entreprise coloniale, d’appropriation d’un territoire et d’expropriation d’un peuple. Cette même semaine, les 14 et 15 mai, les Palestiniens commémoraient leur Nakba, la première « catastrophe », celle de 1948, qui, en vérité, ne s’est jamais interrompue – elle dure depuis soixante-dix-sept ans. « Un futuricide en Palestine », résume Stéphanie Latte Abdallah dans l’ouvrage collectif qu’elle a codirigé, Gaza, une guerre coloniale (Sindbad-Actes Sud) : « Depuis le 7 octobre 2023, les Gazaoui·es et les Palestinien·nes ont le sentiment de vivre une nouvelle Nakba, en raison d’une guerre génocidaire qui vise directement les civils et tout ce qui permet d’envisager un avenir à Gaza. »
« Actuellement en fuite » : sur la page du site de la Cour pénale internationale (CPI) qui lui est dédiée, tel est le statut du premier responsable de ces crimes, sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré le 21 novembre 2024. Il se nomme Benyamin Nétanyahou, premier ministre au moment des faits, « suspecté d’être responsable des crimes de guerre consistant à affamer délibérément des civils comme méthode de guerre et à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile ; et des crimes contre l’humanité de meurtres, de persécutions et d’autres actes inhumains, du 8 octobre 2023 au moins jusqu’au 20 mai 2024 au moins ».
En avril, la fuite de ce suspect de haut vol – qui fuit aussi la justice de son propre pays où il est poursuivi pour corruption – l’a amené sans aucun tracas en Europe, hôte de la Hongrie de Viktor Orbán le 3 avril, puis aux États-Unis le 7 avril, reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. D’un continent à l’autre, il a même pu traverser sans encombre l’espace aérien français.
Depuis la nouvelle guerre d’Israël à Gaza alors même qu’une autre guerre se poursuit en Europe, celle de la Russie contre l’Ukraine, on ne compte plus les preuves de ce « double standard » occidental qui ruine le droit international.
Tandis que l’Europe, avec la France en première ligne, discute de nouvelles sanctions et rétorsions contre la Russie de Vladimir Poutine, rien n’est fait contre l’État d’Israël de Benyamin Nétanyahou. Diplomatiques, militaires, commerciales : la panoplie de mesures est pourtant vaste, et la liste des pays qui en font déjà l’objet est fournie – pas moins de vingt-huit, si l’on s’en tient aux seules sanctions économiques et financières.
Lors de son entretien télévisé du 13 mai, Emmanuel Macron n’a même pas mentionné la reconnaissance de l’État de Palestine, une initiative un temps évoquée qui, pourtant, resterait de l’ordre du symbole.
« C’est une honte », s’est contenté de dire le président français à propos de ce que fait Israël à Gaza. Non, la honte, c’est de ne rien faire pour arrêter un génocide, sauver un peuple, sanctionner des dirigeants criminels, défendre le droit international.
Une honte dont Emmanuel Macron et ses semblables devront rendre compte devant l’histoire, ainsi que le prophétisait, ce même 13 mai 2025, Tom Fletcher devant le Conseil de sécurité : « Pour ceux qui ne survivront pas à ce que nous craignons de voir arriver – au vu et au su de tous –, ce n’est pas une consolation de savoir que les générations futures nous demanderont des comptes dans cette enceinte. Mais elles le feront. Et si nous n’avons pas sérieusement fait “tout ce que nous pouvions”, nous devrions craindre ce jugement. »
mise en ligne le 16 mai 2025
Guerre en Ukraine :
à Istanbul, Kiev et Moscou organisent un désordre autour des pourparlers
Vadim Kamenka sur www.humanite.fr
Après trois ans, les premières négociations directes entre l’Ukraine et la Russie vont débuter en Turquie après de multiples contorsions diplomatiques. Cette réunion qui va enfin débuter vendredi 16 mai dans la matinée témoigne d'une faible volonté pour des pourparlers entre les deux protagonistes. En attendant la guerre se poursuit.
En cette quatrième année de guerre en Ukraine, Kiev et Moscou vont finalement débuter des négociations à Istanbul, ce vendredi matin. Cette réunion initialement bilatérale se tiendra sous différents formats notamment entre la « Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie » a détaillé une source au ministère turc des Affaires étrangères qui jouera le rôle de médiateur.
Le choix de la Turquie comme lieu de rencontre par le président russe est déjà un signal diplomatique. Depuis le début de la guerre, Ankara a servi d’intermédiaire entre les deux administrations, en livrant des armes à l’Ukraine notamment des drones et en refusant d’appliquer des sanctions contre Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait obtenu la signature de « l’initiative céréalière de la mer Noire » avec la Russie, l’Ukraine et les Nations unies en juillet 2022.
Des positions trop antagonistes
De fortes tensions ont émaillé les modalités d’une telle réunion. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky qui a fait le déplacement à Ankara, jeudi pour rencontrer son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a critiqué la délégation russe, la qualifiant de « pure façade ». Cette dernière est composée du conseiller présidentiel, Vladimir Medinski, accompagné par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine et le vice-ministre de la Défense Alexandre Fomine.
Quelques instants plus tard, Moscou a répliqué. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a qualifié de « clown » le dirigeant ukrainien, jetant un doute sur l’issue de ces discussions. Petit rappel, Vladimir Medinski a fait partie des négociateurs ayant abouti à un accord entre l’Ukraine et la Russie en mars 2022. Les deux délégations de l’époque avaient réussi à lever un certain nombre d’obstacles afin de permettre la signature d’un projet de cessez-le-feu par les deux présidents. Sous pression britannique notamment, Volodymyr Zelensky s’était retiré de l’accord final.
« Nous sommes qu’aux prémices des négociations. Les positions sont encore extrêmement antagonistes entre les deux administrations. Pour la délégation russe, Vladimir Medinski qui a porté le projet d’accord au printemps 2022, réclame que ce texte soit le point de départ. Une chose inenvisageable pour Kiev surtout que Moscou souhaite que les nouvelles conquêtes territoriales soient intégrées », estime l’ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Gliniasty.
Au final, le président ukrainien a dépêché une délégation ukrainienne qui « aura un mandat pour un cessez-le-feu » et sera dirigée par le ministre de la Défense, Roustem Oumerov. Ces revirements confirment qu’avant le début de ces pourparlers, les deux protagonistes n’ont pas voulu reconnaître les difficultés d’une telle rencontre et la mise en place d’un processus de paix. Dans une forme de bras de fer diplomatique, chacun a tenté de rejeter l’échec sur l’autre.
« Les deux puissances ne souhaitent pas réellement négocier pour deux raisons différentes. Le président russe veut poursuivre la guerre tout en négociant afin de continuer à engranger des gains sur le terrain. Le président Zelensky ne peut pas signer une paix aujourd’hui. La population ukrainienne ne lui pardonnerait pas, d’avoir subi trois années de guerre, des milliers de morts, des destructions, pour finalement acter la perte de territoires », note Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.
Trump prêt à se rendre en Turquie
Pour les États-Unis, le conseiller spécial Steve Witkoff et le secrétaire d’État Marco Rubio sont également en Turquie. Ce dernier qui doit rencontrer son homologue ukrainien, Andriy Sybiga a estimé, jeudi : « Je ne pense pas que nous ayons de grandes attentes quant à ce qui se passera demain ». Même position du président Donald Trump qui a soutenu l’initiative russe de négociation directe. Le milliardaire a jugé qu’il pourrait se rendre également « vendredi » sur place en cas de progrès dans les discussions. Avant d’affirmer : « Rien ne se passera (…) tant que (Poutine) et moi ne serons pas ensemble. »
« L’Europe juge de son côté que l’Ukraine doit négocier en position de force et que c’est à Kiev d’accepter des pourparlers, juge Jean de Gliniasty. Elle laisse aux États-Unis, à l’Ukraine et à la Russie le processus diplomatique. Après, un dialogue peut débuter alors que le conflit perdure. Cela s’avère être le cas, dans la majorité des guerres. Seulement, Moscou refuse un cessez-le-feu pour maintenir ses objectifs militaires tout en tentant de normaliser ses relations avec Washington. Une stratégie qui s’avère risquée. »
En attendant, les choses bougent sur le front. À son tour CNN, citant deux officiels états-uniens, confirme que la Russie rassemblerait des forces pour une prochaine offensive ce printemps, « destinée à s’emparer d’une plus grande partie du territoire ukrainien ». De son côté, Vladimir Poutine a limogé le commandant des forces terrestres de l’armée russe, Oleg Salioukov avant de le nommer secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe. C’est un important organe consultatif qui se réunit régulièrement autour du président.
mise en ligne le 16 mai 2025
La Kanaky, une Haïti
des temps modernes ?
Loïc Le Clerc sur www.regards.fr
Un an après les révoltes en Nouvelle Calédonie, la crise s’installe. En jeu : la capacité à sortir d’un rapport colonial, ici comme ailleurs. L’histoire nous enseigne les conséquences d’un entêtement buté et absurde.
Le 7 avril 1803, Toussaint Louverture mourrait au Fort de Joux, dans le Doubs. Cela faisait sept mois que le héros de Saint-Domingue (l’actuelle Haïti) croupissait dans cette geôle de la République. Son tort ? Avoir mené la révolte des esclaves, avoir été tant révolutionnaire au point de faire des mots de liberté, égalité et fraternité des actes. Saint-Domingue n’abolissait pas seulement l’esclavage, elle s’affranchissait des Empires, notamment français, pour devenir la première République noire du monde. Toussaint Louverture avait porté la République mais il avait défié la France. La « perle des Antilles » finira par obtenir son indépendance, mais la sanction de la France sera immense : 200 ans plus tard, les Haïtiens payent encore ce lourd tribut, une dette colossale pour compenser le manque à gagner esclavagiste et colonialiste. Haïti est un enfer, gangrenée par la corruption, la violence et la misère.
La France n’apprend-elle rien de ses erreurs ? La question se pose à l’heure où la crise s’installe profondément en Nouvelle-Calédonie.
Voilà bientôt un an que Christian Tein, l’un des leaders du mouvement indépendantiste kanak, et six autres personnes sont enfermés à l’autre bout du monde, au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin). Ils sont traités comme de dangereux criminels insurrectionnels alors que tous les témoignages rendent compte de leur pacifisme et de leur ouverture au dialogue. Ils sont accusés par le gouvernement d’avoir fomenté les « émeutes » de mai 2024 – émeutes « gérées » par la France à grands renforts militaires, ayant causé la mort de onze Kanaks.
Les raisons de la colère commencent à s’accumuler à Nouméa. Il y a ces référendums sur l’indépendance dont le processus dure depuis 1988. Il y a cette idée des macronistes de réformer le code électoral, l’année dernière, pour donner plus de poids aux électeurs blancs – farouchement contre l’indépendance. Le camp dit loyaliste se radicalise, au point qu’aujourd’hui, la situation politique devient absurde : Manuel Valls, ministre des outre-mer, a désormais plus de facilité à discuter avec les indépendantistes, les loyalistes étant arc-boutés sur leur position de dominants. Emmanuel Macron leur vient en renfort : « La France serait moins grande et moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. »
L’affaire est coloniale. La droite et l’extrême droite ne s’y trompent pas. Ils ne comptent pas perdre une nouvelle fois la guerre d’Algérie… Mais nous ne sommes plus au XXe siècle ! L’île est exsangue économiquement (et nécessite d’importants financements pour reconstruire), encore traumatisée par la violence de l’année 2024.
Le gouvernement ne saurait ignorer un peuple qui demande le respect et le choix. Pour trouver le chemin de la démocratie, il faudra trouver autre chose que l’interdiction des manifestations et la suspension des réseaux sociaux. Si la démocratie c’est aussi permettre à chacun de se projeter dans l’avenir, il est décisif que les projets soient sur la table et que la définition du corps électoral soit consensuelle. La République française doit se réinventer, élargir ses conceptions qui ne tiennent pas compte de l’historie, des cultures, des réalités géographiques et politiques. Et même géostratégiques. Sinon, la crise perdurera ad nauseam.
En 1998, une inscription a été faite au Panthéon, en hommage à Toussaint Louverture. En faudra-t-il une pour les Kanaks, dans 200 ans ?
mise en ligne le 15 mai 2025
« Nous, livreurs sans papiers, sommes
pris en étau entre
les contrôles de police
et les demandes de rentabilité d’UberEats et Deliveroo »
Par Jérémie Rochas , Arto Victorri sur https://www.streetpress.com/sujet/
Les livreurs sans papiers de Lille dénoncent le harcèlement de la police, qui multiplierait les contrôles d’identité et les interpellations. Les forçats de la livraison se sont regroupés en collectif et demandent leur régularisation.
« Faites attention rue de Béthune, là où les livreurs se regroupent. Ils sont nombreux, il y a la PAF [police aux frontières], la municipale, la nationale avec leurs voitures. Ils viennent d’arrêter quelqu’un. » En mars dernier, l’alerte est envoyée en urgence sur les téléphones de quelque 120 livreurs lillois réunis en collectif. Chaque semaine, des dizaines de messages vocaux sont diffusés pour prévenir des contrôles policiers qui ciblent les coursiers sans papiers de la métropole, contraints au mouvement permanent. Les membres du groupe se partagent aussi des contacts d’avocats, des informations sur les projets de loi dans leur secteur, des appels à la grève ou au soutien de collègues blessés pendant des livraisons. Les restaurateurs irrespectueux avec les coursiers sont aussi signalés. Le réseau d’entraide s’active parfois même au-delà des frontières, avec des cagnottes créées pour aider financièrement les livreurs expulsés vers leur pays d’origine.
« En 2022, la situation est devenue insupportable », raconte Abdoulaye (1), l’un des porte-paroles du collectif de livreurs sans papiers de Lille. « On voyait nos collègues se faire arrêter les uns après les autres à mesure que les plateformes baissaient les prix de livraison. On a décidé de réagir. » D’abord, l’idée émerge de se mobiliser pour soutenir les livreurs interpellés et placés en centre de rétention administrative (CRA), première étape avant une possible expulsion du territoire. Très vite, l’information circule « de bouche à oreille » et des dizaines de nouvelles recrues des plateformes viennent grossir les rangs du collectif, appuyé par les associations d’aide aux personnes exilées et des syndicats. Ils organisent leur première manifestation en janvier 2023 et revendiquent depuis sans relâche la fin des contrôles policiers et la régularisation des travailleurs indépendants.
Des contrôles incessants
Au cours de ses cinq années de livraison, l’ancien gendarme guinéen a vu des dizaines de collègues abandonner leur poste, accablés par la précarité et l’omniprésence policière : « La plupart d’entre nous travaillent sans congé toute la semaine pour à peine 1.000 euros par mois. On peut parfois rester 11 heures ou 12 heures d’affilée dehors, lorsqu’il y a peu de commandes. Tout ça avec la peur au ventre. »
Tous les livreurs sans papiers interrogés partagent cette angoisse d’être arrêté durant leurs heures de travail. La psychose les suit même parfois jusqu’aux portes des clients : « Un soir, une voiture de police est arrivée en trombe au moment où je remettais une commande. Le client était choqué et s’est interposé, mais ils n’ont rien voulu savoir », raconte Salif (1), un autre livreur sans papier du collectif. « J’avais mon récépissé à jour [le document prouvant l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à la préfecture]. Alors ils n’ont pas eu d’autre choix que de me laisser partir. Je les ai recroisés cinq minutes plus tard en train de contrôler un autre livreur. »
Avant de poser ses bagages dans le Nord de la France, l’ancien demandeur d’asile a roulé sa bosse à Nantes et à Bordeaux. Si les conditions de travail y étaient tout aussi difficiles, il raconte n’avoir jamais connu le même degré de répression policière : « Je ne connais pas un seul livreur sans papiers à Lille qui n’a pas fini un jour au commissariat. D’ailleurs, la plupart de mes collègues sont partis travailler à Paris. »
Ben (1) a lui décidé de quitter la France en juillet 2024, à la suite d’un énième contrôle d’identité. Ce jour-là, il est presque minuit quand le livreur de 25 ans rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est à quelques mètres de sa porte d’immeuble quand une voiture de la brigade anti-criminalité (BAC) commence à le suivre et lui ordonne de s’arrêter. Le Guinéen fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et sait qu’il risque l’expulsion vers son pays d’origine en cas d’interpellation. Alors il fait mine de ne pas avoir entendu et pédale de toutes ses forces, priant pour qu’ils renoncent à le poursuivre. Mais la patrouille le prend en chasse et appelle des renforts. Après de longues minutes de course-poursuite dans les rues du quartier de Wazemmes, Ben met le pied-à-terre, épuisé. Il est aussitôt cerné par plusieurs véhicules et menotté sur-le-champ. Il n’a rien oublié du sentiment d’humiliation : « Les passants s’arrêtaient pour me regarder. J’ai eu tellement honte, j’avais l’impression d’être un criminel. »
Après l’avoir fouillé et contrôlé son identité, les policiers décident de le laisser repartir. Un agent de la BAC se serait alors approché pour lui lancer : « La prochaine fois, si tu ne t’arrêtes pas quand je te le demande, je te nique ta mère. » Ben prend la décision le soir même de plier bagages vers un autre pays d’Europe.
Échapper aux contrôles
En avril 2023, Ben a déjà passé une nuit en cellule après un contrôle au cours d’une livraison. Si la mobilisation du collectif de livreurs sans papiers avait permis sa libération, la peur de la police ne l’a plus jamais quitté et a directement impacté son chiffre d’affaires. « Je savais que la police contrôlait les livreurs le matin, alors je ne sortais pas de chez moi avant 12 heures », explique le jeune livreur. « Mais il était souvent trop tard : toutes les commandes étaient déjà prises. » Il prend aussi l’habitude de contourner les carrefours et les grands boulevards, quitte à rallonger la durée de ses shifts : « À chaque fois que je voyais les modèles de voitures de la BAC, j’avais la boule au ventre, des sueurs froides, je perdais toute orientation. C’était devenu insupportable à vivre. »
Pour Emmanuelle Jourdan-Chartier, présidente de la section lilloise de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), ces contrôles incessants que subissent les coursiers sans papiers participent à « une stratégie de harcèlement policier de populations ciblées et discriminées ». L’association vient justement de lancer une campagne nationale pour recueillir le ressenti des victimes de contrôles au faciès et demander leur interdiction. En 2023, le Conseil d’État avait reconnu leur caractère discriminatoire mais s’était jugé incompétent pour y mettre fin.
Interrogé, le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) conteste l’existence d’un ciblage de ces travailleurs sans papiers : « Il n’y a aucune attention particulière portée à ces livreurs en l’absence de motif à contrôle. »
Amendes et confiscation de vélos
Les coursiers sont également sujets aux amendes distribuées sur plusieurs artères principales du centre-ville, désormais interdites à la circulation à vélo. Ils sont aussi régulièrement ciblés par la brigade routière départementale qui procède à la mise en fourrière des vélos électriques débridés, utilisés par de nombreux coursiers pour optimiser les trajets et compenser leurs maigres revenus. « On n’a pas le choix, il faut bien manger », soupire Abou (1), qui explique être pris en étau entre les règles de circulation et les demandes des plateformes, qui exigent sans cesse la réduction du temps de course. Lui a récemment échangé son vélo électrique pour un scooter d’occasion. À 48 ans, il rêve de raccrocher la livraison. Mais en attendant l’obtention de sa carte de séjour, il lui faudra continuer de sillonner les rues lilloises en esquivant « les visiteurs », comme sont surnommés les policiers par les membres du collectif.
En octobre 2023, Abou a été arrêté aux abords de la station de métro Porte des Postes – considérée comme un véritable guet-apens par les livreurs sans papiers -, avant d’être placé au centre de rétention administrative de Lesquin (59). Il a pu compter sur le soutien de ses collègues de galère pour mobiliser associations et avocats jusqu’à sa remise en liberté, après 63 jours d’enfermement. Mais aussitôt dehors, Abou a ravalé sa peur pour repartir au charbon. Son chiffre d’affaires peine à atteindre le SMIC, sauf qu’il lui faut payer le loyer du logement social qu’il sous-loue à l’un de ses amis, la cantine de ses deux enfants et préparer l’arrivée d’un nouveau-né prévue dans quelques mois.
« On est là pour servir la France, on paie des impôts, mais on se fait sans cesse arrêter, certains se font confisquer leurs vélos quand ils fuient la police », s’époumone Abdoulaye, l’un des porte-paroles du collectif. « Mais nous ne sommes ni des animaux, ni des délinquants. »
Location de comptes
Pour passer sous les radars, Abou loue son compte UberEats ou Deliveroo à un particulier en règle. La location d’un profil peut varier entre 100 et 150 euros par semaine. En 2024, la mairie de Lille estimait que ces « activités non déclarées et les locations de compte » pouvaient concerner la moitié de l’effectif total des livreurs de la ville, soit près de 3.000 personnes.
Une technique qui n’est pas sans risques. « Ces travailleurs sont exploités par d’autres personnes mal intentionnées qui profitent de leur situation précaire », insiste le service com’ de la police nationale. De plus, les plateformes déploient des dispositifs de détection de comptes sous pseudonyme par reconnaissance faciale ou de contrôle de pièces d’identité. En mars 2022, l’État a signé avec les plateformes une charte d’engagement contre la fraude et la sous-traitance irrégulière, provoquant la déconnexion de plusieurs milliers de comptes.
Interrogées par StreetPress sur les conditions de travail de ses livreurs indépendants sans papiers, Deliveroo et UberEats se contentent de réaffirmer leur engagement dans la lutte « contre la sous-traitance irrégulière », soit « la sous-location illicite de comptes ». « Nous collaborons étroitement avec les forces de l’ordre et leur transmettons toutes les informations requises dans le cadre des enquêtes qui peuvent être menées », ajoute même UberEats, première plateforme à avoir instauré le système d’identification en temps réel de ses travailleurs dès 2019. Aucun des mastodontes de la livraison de repas ne prend cependant position sur la question de la régularisation des livreurs sans papiers, portée depuis plusieurs années par des syndicats comme la CGT et l’Union-Indépendants. « Leur modèle économique repose pourtant sur le fait que ces travailleurs soient corvéables à merci et qu’ils n’aient d’autres solutions pour vivre que de travailler pour des miettes par le biais de location de comptes », s’agace Ludovic Rioux, représentant de la CGT Transport.
Bientôt une maison des livreurs ?
Si les livreurs sans papiers avaient pour habitude de se retrouver entre deux courses près des rues commerçantes ou sous le parvis de la gare il y a encore quelques mois, désormais le mot d’ordre est la dispersion. « Les flics ont commencé à faire des descentes et arrêter tous les livreurs qui se réunissaient à l’extérieur », confie Abdoulaye, qui attend désormais les notifications de l’application dans un centre commercial proche du centre-ville. « Maintenant, tout le monde est dans son coin. »
En avril 2024, la ville de Lille a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la création d’un « lieu de répit » pour les salariés de l’aide à domicile et les livreurs indépendants. La mairie souhaite proposer aux travailleurs précaires « un accompagnement socio-médical, un appui administratif ou un atelier de réparation de vélo ». Un espoir pour les livreurs sans papiers sous pression policière constante dans l’espace public.
Ce modèle de maison des livreurs, déjà en place à Bordeaux ou Paris, leur permettrait enfin de se rassembler et de s’organiser en sécurité. « Les conditions de travail ne cessent de se dégrader, d’autant plus pour les livreurs sans papiers », insiste Anthony*, livreur et représentant syndical à l’antenne locale de l’Union-Indépendants. « Les plateformes ont réussi à installer une forme d’individualisation, nous devons essayer d’en sortir. »
Contactés, la mairie de Lille et la préfecture du Nord n’ont pas répondu à nos sollicitations.
(1) Les prénoms des livreurs ont été changés.
Texto de Jérémie Rochas et photos d’Arto Victorri.
mise en ligne le 15 mai 2025
RSA :
pourquoi Laurent Wauquiez
raconte (encore)
n’importe quoi
Ludovic Simbille sur https://rapportsdeforce.fr/
Candidat à l’élection de la présidence de Les Républicains, Laurent Wauquiez a déclaré vouloir limiter le RSA à deux ans et généraliser des heures de travail obligatoire en contrepartie. A rebours de la réalité, cette surenchère droitière intervient alors que la loi plein emploi prévoit dès le 1er juin de suspendre le RSA en cas de non respect des 15 heures d’activités imposées. Et que le Conseil national de lutte contre la pauvreté demande un moratoire.
« C’est à propos du RSA ? Faut aller bosser gratuitement dans les bagnes à saint Pierre et Miquelon ? ». Agathe n’était pas au courant de la dernière déclaration de Laurent Wauquiez sur les titulaires du Revenu de solidarité active avant qu’on ne lui demande son avis. « Mais de manière générale, j’ai juste hâte qu’il arrête de parler », s’exaspère cette auto-entrepreneuse bretonne au Rsa.
En campagne pour la présidence du parti Les Républicains (LR) ne cesse de faire des propositions chocs, reprises par la presse, pour se démarquer davantage vers la droite de son concurrent, Bruno Retailleau. Après avoir invité à rassembler les personnes sous OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, le député de Haute-Loire a proposé de sortir du « Rsa à vie » qui coûte 12 milliards d’euros. Ce revenu « doit être une aide temporaire quand on a eu un accident de la vie. Il faut le limiter à deux ans pour les Français qui sont aptes au travail ». Car, « le vrai social, c’est le travail », croit savoir ce fils d’industriels pour qui « il est temps d’arrêter l’assistanat dans notre pays »…
30 à 100 % du RSA suspendu
Comme Agathe, on se serait bien passé de commenter les élucubrations de cette figure de la droite, si elle ne faisait pas des émules, impactant la vie des plus démunis. Dans l’Allier, le département veut également limiter la durée de versement de l’indemnité à 36 mois. Une pétition a même été lancée en faveur « d’une vraie réforme qui favorise le travail ». Tous les départements de droite ont refusé d’appliquer la revalorisation légale de la prestation à 1,7% prévue au 1er avril. Motif ? « On dévalorise le travail », explique le président du Conseil départemental d’Ardèche. « On n’en peut plus : c’est trop ! », s’emportait celui de la Marne.
Ce discours antisocial n’est pas nouveau. Déjà en 2011, le même L. Wauquiez, à qui l’on peut reconnaître une certaine constance, déposait une loi imposant des missions aux destinataires d’aides sociales afin d’éradiquer ce « cancer de l’assistanat ». Presque quinze ans plus tard, ses volontés ont été exaucées par la loi dite du plein emploi. Entrée en vigueur en janvier 2025, cette réforme contraint l’ensemble des éloignés de l’emploi à s’inscrire à France Travail, l’organisme qui remplace Pole Emploi. Et chaque signataire d’un contrat d’engagement réciproque (CER) s’engage à effectuer 15 heures d’activité hebdomadaires pour espérer toucher ses 646, 52 euros… Sous peine de voir cette somme suspendue ou de se voir radié. Attendus pour le 1er juin, les décrets ne sont toujours pas publiés. Mais le journal Le Monde a révélé que 30 à 100 % de l’indemnité pourra être suspendue pendant quatre mois en cas de manquements aux engagements.
Dans un avis du 07 mai dernier, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) alerte sur ce principe de « suspension-mobilisation », prévu par ce nouveau RSA. Cet organisme officiel propose plutôt « d’introduire un premier niveau de sanction qui serait une convocation pour un rappel aux obligations » des allocataires et d’allonger le délai de recours à trente jours, au lieu de dix actuellement. Il signale « le risque de ruptures d’égalité devant le droit ».
Tout comme les syndicats, associations et mutuelles réunis dans Le Pacte du Pouvoir de Vivre, le CNLE demande don un moratoire sur ce régime de sanctions, contraire à la constitution de 1946. Son article 11 prévoit « le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Ce signalement institutionnel s’ajoute à la déclaration de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de décembre dernier dénonçant une « atteinte aux droits humains ». Du côté syndical, la Cfdt et l’UNSA vantent l’accompagnement plutôt que le contrôle quand la Cgt réclame l’abrogation de cette loi dont les contours demeurent flous.
Pas de lien entre sanction et retour à l’emploi
Généralisée en 2025, cette réforme du RSA a d’abord été testée dans 49 territoires, sans qu’un réel bilan n’ait été mené par les pouvoirs publics. Les premiers retours n’ont pour l’instant rien donné de concluant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son « efficacité » demeure mitigée, comme l’a documenté l’économiste Michel Abhervé à partir des données publiques « une indication que l’obligation et la sanction non seulement n’améliorent pas les résultats, mais au contraire que leur absence améliore ceux-ci ». L’étude de la Dress faisant état d’une hausse d’un nombre d’allocataires du RSA en 2024 vient également étayer cette idée. Idem pour les chiffres du chômage fournis par France Travail. « Ce qui est sûr c’est que s’il y avait eu dans leurs données, une preuve d’un lien entre sanction ou contrôle et retour à l’emploi, ils ne se seraient pas privés de la publier, or il n’y a rien là-dessus », remarque une fine connaisseuse de l’opérateur.
Mettre la pression sur les précaires ne fait que marginaliser les publics les plus vulnérables. A commencer par les mères isolées, représentant près de 30 % des bénéficiaires. Le risque « de non-recours aux droits et la pauvreté » dont s’inquiète le CNLE existe déjà. Le taux de renoncement au RSA a augmenté de 10, 8 % dans les territoires pilotes, révélait un rapport au vitriol de plusieurs associations. Dans le Nord, tout ou partie tout ou partie du RSA est suspendue en cas d’absence à un rendez-vous, depuis octobre. Résultat, nombre de bénéficiaires décrochent d’eux-même par peur de l’institution ou sont radiés. De quoi afficher un nombre important de sorties du RSA pour les départements, sans qu’on sache s’il s’agit ou non d’un retour à l’emploi. « À quoi sert d’avoir moins d’allocataires si la pauvreté augmente », rétorquait un élu d’opposition du Finistère auprès de Rapports de Force.
L’emploi précaire, un retour à la dignité ?
Si contrôler et punir les sans-emploi ne permet pas d’améliorer leur sort, rien ne montre non plus que le « vrai social » soit nécessairement le travail, comme l’avance L. Wauquiez. Le CNLE, encore lui, vient de révéler qu’en France le taux de pauvreté avait sensiblement augmenté ces dernières années alors que dans le même temps le taux de chômage diminuait. La faute, notamment aux emplois précaires… Celles et ceux qui dégotent un boulot ne sortent toujours pas la tête de l’eau. Dans sa dernière étude, la Dares donne un panorama peu reluisant de la situation professionnelle des détenteur de l’allocation au trois lettres. Seuls 10% de l’ensemble des Rsa-istes étaient en emploi, dont 4, 5 % en CDI et 2,3 % en CDD de plus de 6 mois. Et le nouvel « accompagnement rénové » n’y change pas grand-chose. En juin 2024, seuls 16 % des participants aux expérimentations avaient un emploi durable, loin des 50 % affichés en son temps par le premier ministre Gabriel Attal pour vanter la réforme.
Sortir du minima social pour un boulot de courte durée n’aide pas à s’extirper de la précarité. Pire, cela « crée des interruptions de revenus du fait des délais de traitement de dossiers », nous expliquait un professionnel de l’accompagnement. D’autant que « l’obligation de résultat conduit à les orienter vers les boulots difficiles dont personne ne veut », se désespérait Olivier Treneul, de Sud-Solidaires. Ce qui, au passage, n’incite pas vraiment les entreprises à améliorer leurs conditions de travail qui ne sont pourtant pas les dernières responsables des difficultés de recrutements.
D’autant plus que 82 % des personnes au Rsa ont un frein à l’emploi. 28 % sont en mauvaise santé, et disent être restreintes dans leur quotidien. « La conditionnalité des 15 h n’y fera rien si ce n’est aggraver la situation de ces personnes », souligne la CGT. Le candidat à la présidence des LR ne s’en formalise pas : « Près de 40 % des bénéficiaires du RSA ont moins de 35 ans. Qui peut croire qu’ils sont tous dans l’impossibilité de travailler ?, a-t-il lancé avant de s’improviser économiste. Alors qu’il existe 500 000 emplois vacants dans les services à la personne, l’hôtellerie-restauration, l’aide à domicile… » Même à supposer que tous ces freins soient levés, cette logique purement arithmétique se heurte à la dureté du marché du travail. Le besoin conjoncturel de main d’œuvre dans le privé est estimé pour 2025 à 2,4 millions de postes à pourvoir. Soit bien en-dessous des 5,77 millions d’inscrits à France Travail. Et seuls 44% de ces projets de recrutement promettent un CDI. Il n’y aurait de toute façon que des bouts de boulot à décrocher. Peu importe pour les partisans de l’emploi à tout prix : « Le retour au travail, même précaire, est un pas vers la dignité », assume le département du Finistère.
Quitte à miser sur l’employabilité à marche forcée… Les activités obligatoires prévues actuellement dans la loi ne semblent pas à aller assez loin aux yeux de L. Wauquiez qui souhaite « la généralisation de vraies heures de travail en contrepartie » du RSA. Recherche d’emploi, bénévolat, immersion professionnelle, la confusion entretenue par le gouvernement autour de ces 15 heures hebdomadaires n’aide déjà pas à contenir les dérives vers du travail gratuit… qui s’opèrent déjà. L’exemple le plus récurrent reste ces rsa-istes recrutés pour entretenir le cimetière de la commune de Villers-en-Vexin dans l’Eure qui n’a « pas les moyens d’embaucher du personnel ». Initiées dans les pays anglo-saxons, ces politiques de responsabilisation des chômeurs dites du « Workfare » n’ont fait que créer à terme une nouvelle classe de « travailleurs forcés », qu’a étudié la sociologue Maud Simonnet, tirant vers le bas les salaires de l’ensemble du salariat.
« Un boulot de dingue »
De fait, les personnes hors emploi s’adonnent déjà à un « boulot de dingue » dont le Secours Catholique dévoilait l’étendue dans son rapport du même nom. Ce sont ces tâches du quotidien, dont l’utilité sociale est parfois plus prégnante que celles des salariés valorisant du capital, qu’oublient de mentionner Laurent Wauquiez et consorts. Sans parler des agriculteurs, dont nombre d’entre eux, perçoivent le RSA. Après des mois d’interrogation, un accord entre France Travail et la MSA prévoit de les dispenser des fameuses heures imposées. Du moins pour ceux ayant un revenu supérieur à 500 euros.
Ce travail non marchand pourrait se voir reconnaître par une rémunération conséquente non conditionnée. Le CNLE qui déplore une actuelle « aide sociale vitale de l’État ne permettant souvent que de survivre, loin des conditions d’une vie digne », préconise la mise en place d’un revenu plancher. Dans son évaluation des réformes du chômage, publiée en avril 2025, la Dares montre que celles et ceux qui s’en sortent le mieux ont eu droit à un véritable « filet de sécurité ». Et remplacer le RSA par un salaire ? C’est ce que prône, le secrétaire du parti communiste, Fabien Roussel. Cela aurait au moins l’avantage d’ouvrir des droits par le biais de cotisations, maladie ou retraite…
« On ne peut pas continuer à payer des gens à rester chez eux, continue Laurent Wauquiez qui veut « la fusion de toutes les aides sociales en une seule plafonnée à 70 % du Smic ». Car « aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 € brut, aura 2 200 € pour faire vivre sa famille ; tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 € ». Ce qui est totalement faux : on ne gagne pas plus avec les allocations qu’en travaillant.
Agathe a finalement lu son Wauquiez dans le texte. Elle s’en désole : « Je ne sais même pas où commencer. Le montant n’est pas 2300 euros mais 1600 euros. Il oublie aussi de préciser que les personnes qui travaillent touchent aussi des aides » RSA complémentaire, prime activité, allocations familiales. « Par ailleurs parler de gaspillage d’argent public, c’est quand même du gros foutage de gueule vu qu’il invite ses copains à des repas à 100 000 euros avec l’argent de la région », ajoute-t-elle en référence à l’affaire des dîners fastueux sur le dos du contribuable qui implique l’ex-président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes… De ce côté aussi, « Il est temps d’arrêter l’assistanat dans notre pays ».
mise en ligne le 14 mai 2025
« Nous pouvons faire du métal sans Mittal » : devant le siège de la multinationale, les Arcelor exigent la nationalisation des hauts-fourneaux
Léa Darnay sur www.humanite.fr
Les salariés d’ArcelorMittal ont convergé, ce mardi 13 mai, devant le siège social du groupe, à l’appel de la CGT. Les sidérurgistes exigent la nationalisation des sites français. Des propositions de loi émanant de la gauche vont dans ce sens.
Trois semaines après l’annonce d’un plan de suppression de 636 emplois dans l’Hexagone, 400 salariés venus de tous les sites français d’ArcelorMittal ont convergé, ce mardi 13 mai, devant le siège de la multinationale, à Saint-Denis. « Nous pouvons faire du métal sans Mittal », scandent les sidérurgistes au pied de l’immeuble de verre.
Tous veulent éviter la catastrophe. « Si les hauts-fourneaux de Dunkerque et Fos-sur-Mer s’arrêtent, ce sont les 40 autres centres et usines qui tombent, avec un effet en cascade inimaginable sur l’ensemble de l’industrie du territoire, ultradépendante de l’acier », alerte David Blaise, représentant syndical central CGT de la branche centres de services.
Tandis qu’un comité social et économique (CSE) se déroule derrière les vitres teintées pour dessiner les contours du plan social, des cars de travailleurs en colère affluent pour mettre la pression sur la direction française du sidérurgiste en appelant à la nationalisation. Les Florangeois donnent le ton : casques de chantier sur la tête, bleus de travail sur le dos, fumigènes à la main, leurs pétards font trembler le béton. « Ils nous parlent de reclassements, mais il faut mettre les mots : ce sont des licenciements !, dénonce Éric Cholet, gilet rouge sur le dos. C’est une véritable casse sociale et industrielle ! »
« Un désinvestissement organisé »
Sur ce site lorrain, 194 postes seraient supprimés, soit deux tiers des effectifs. « Nous avons déjà vécu l’arrêt des hauts-fourneaux, de la coquerie, de la scierie, se désole le travailleur de Moselle. C’est à cause d’un désinvestissement organisé. » Devant le siège dionysien, les discours des représentants syndicaux des sept sites touchés par le plan social s’enchaînent et se ressemblent. « Montataire (Oise) est un site dimensionné pour produire 1 million de tonnes à l’année, mais ils n’envisagent plus que 600 000 tonnes en 2025. Il n’y a aucun investissement stratégique », regrette Nicolas Vilmin, délégué CGT du site picard.
Industeel, filiale qui vient déjà de perdre 110 postes l’an dernier, trinque à nouveau. « Même si ce ne sont que 20 emplois sur les 1 000 salariés, c’est déjà trop pour un fabricant qui livre le nucléaire, affirme Sébastien Gautheron. Depuis 190 ans, nous fabriquons de l’acier, nous en faisions avant Mittal, nous en ferons après lui », assure l’élu.
« Comment expliquer ce nouveau plan social alors que le groupe, perfusé d’argent public, vient d’annoncer des résultats positifs ? » rétorque Frédéric Sanchez, secrétaire fédéral de la métallurgie CGT. Le géant de la sidérurgie ne s’en cache pas : les 636 postes supprimés en France font partie d’un plan de délocalisation de ses fonctions supports vers l’Inde. « Mittal se désengage de l’Europe. Mais, en même temps, il demande 800 millions d’euros d’aides publiques pour un projet de décarbonisation du site de Dunkerque qu’il ne fera jamais », s’insurge le métallo.
La nationalisation
Pour sortir de ce poker menteur, la CGT revendique la nationalisation. Gaëtan Lecocq, secrétaire général du syndicat CGT Dunkerque, et Reynald Quaegebeur, délégué syndical central CGT AMF, ont travaillé avec les économistes Tristan Auvray et Thomas Dallery à un « plaidoyer pour un pôle public de l’acier ». « On peut prouver par A + B que la nationalisation coûterait moins cher à l’État, autour de 1 milliard d’euros, que ce que l’assurance-chômage devrait verser en indemnisation si Mittal licenciait tout le monde, soit 1,3 milliard d’euros. Alors, si Mittal ne veut pas de nous, qu’il dégage. Nous avons les compétences ! » affirme le Dunkerquois sous les applaudissements.
À Fos-sur-mer, où l’un des deux hauts-fourneaux est déjà à l’arrêt et où 300 postes sont en voie de suppression, « il y a zéro projet de décarbonation », regrette Stéphane Martins De Araujo. Le délégué CGT craint l’annonce d’ici à 2026 de l’arrêt de la phase à chaux, avec la suppression de 900 à 1 000 emplois sur le bassin. « Soit le gouvernement impose l’arrêt des PSE et un réinvestissement pour de l’acier vert. Soit il nationalise en demandant le remboursement de toutes les aides publiques perçues », exige-t-il.
La nationalisation, c’est aussi ce qu’ont porté les nombreux élus de gauche venus soutenir les ArcelorMittal et annoncer le dépôt de propositions de loi en ce sens, concernant le seul site de Dunkerque (PS) ou l’ensemble des activités françaises (PCF au Sénat, insoumis à l’Assemblée). « De notre point de vue, il faudrait verser entre 2 et 8 milliards d’indemnisation à Mittal. Mais si on ne faisait rien, la perte de souveraineté industrielle serait inestimable », souligne Aurélie Trouvé (LFI). « Il est important de montrer que la nationalisation n’est pas un coût, mais un investissement. C’est même la possibilité pour l’État de réinvestir », assure de son côté Fabien Roussel (PCF). « La classe politique se doit d’être courageuse sur le sujet », résume Sophie Binet.
Mais à quoi sert
le ministre de l’industrie ?
Martine Orange sur www.mediapârt.fr
Alors que les plans sociaux et les fermetures de sites industriels s’enchaînent, le risque d’une désindustrialisation irréversible du pays n’est plus à écarter. Pourtant, le ministre de l’industrie Marc Ferracci n’en dit rien, et n’esquisse aucune stratégie pour contrer le désastre possible.
La riposte a fusé en un instant. « Mais à quoi sert le ministre de l’industrie ? », s’est exclamée la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, en réponse à une question sur ArcelorMittal lors de l’émission « Questions politiques », le 27 avril. En quelques mots, la responsable à la veste verte a mis des mots sur un malaise grandissant. De plus en plus d’acteurs économiques et industriels ou d’observateurs se la posent, tant ce ministère semble déserté. Que ce soit sur un dossier particulier ou sur une filière entière, il paraît incapable d’articuler une quelconque stratégie.
Alors que les plans sociaux s’enchaînent dans l’automobile et ses sous-traitants, dans la chimie, dans la sidérurgie et dans bien d’autres secteurs industriels, l’exécutif ne dit rien. Pas un mot. Lors des questions au gouvernement, les ministres du travail et de l’industrie se contentent de botter en touche. Leurs réponses sont convenues, inutilement polémiques parfois, et surtout n’engagent à rien.
« Nous agissons », a ainsi soutenu le ministre de l’industrie, Marc Ferracci, le 29 avril en réponse à une question sur le sort d’ArcelorMittal. Pour quoi faire ? Avec quel objectif ? Pas la moindre précision n’est donnée, si ce n’est lutter contre les surcapacités et le dumping chinois. On se dépêche de passer à autre chose.
L’effacement actuel du ministère de l’industrie répond à un calcul politique, à en croire certains observateurs. Ne pas parler des fermetures de sites, des défaillances d’entreprises revenues à leur plus haut niveau, des suppressions d’emplois par milliers est un moyen d’invisibiliser les drames en cours. Et de désamorcer par avance les conflits sociaux éventuels. C’est surtout une façon de mettre sous le tapis l’échec de la politique de l’offre menée par les gouvernements d’Emmanuel Macron depuis huit ans, dont Marc Ferracci, proche du président, fut l’un des inspirateurs.
Point de non-retour
Mais ces petits calculs politiques peuvent-ils se justifier face au désastre qui se dessine ? Car il ne s’agit pas de simples ajustements conjoncturels ou de restructurations limitées : nous assistons à une destruction de l’industrie d’une ampleur comparable à celle de la fin des années 1970 et du début des années 1990, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ont été parfaitement documentées.
Alors que la France affiche déjà le plus bas taux d’industrialisation en Europe, peut-on se contenter de regarder ces disparitions sans doute irréversibles sans rien dire ? Car ce ne sont pas seulement des activités qui disparaissent, mais aussi des savoir-faire, des brevets, des compétences… tout ce qui forme des écosystèmes permettant à une industrie de se développer.
Dès l’automne, la CGT avait sonné l’alarme sur l’ampleur des plans sociaux annoncés, se demandant si l’industrie n’allait pas atteindre un point de non-retour. Mais cela n’a provoqué aucune réaction au ministère. Aucun plan, aucune mesure d’anticipation ne semble avoir été étudiée.
À chaque nouveau plan social ou fermeture d’usine, le ministre de l’industrie reçoit les dirigeants concernés, les représentants sociaux, parfois les élus des territoires touchés. Il enregistre les doléances et les propositions, selon un ballet parfaitement chorégraphié. Et puis rien.
La seule grande action revendiquée par Marc Ferracci est d’avoir poussé les instances européennes à adopter un « plan acier » contre les ambitions chinoises. Présenté par le très évanescent commissaire européen à l’industrie Stéphane Séjourné, ce plan tient du service minimum. Il ne prévoit ni taxe carbone renforcée aux frontières, ni mesures anti-dumping. Et même les quotas des importations d’acier chinois aux frontières, un temps de 15 %, ont été portés à 30 %.
Désertion stratégique
Penser que la question industrielle puisse se résoudre au seul niveau européen est de toute façon un leurre. Il faut aussi une volonté, une stratégie au niveau du pays, ce que d’autres membres de l’Union européenne (UE) ont bien compris et tentent de mettre en œuvre. Mais en France, hormis les grands-messes, les sommets internationaux et autres Choose France où l’on se gargarise de grands mots et de visions planétaires, rien ni personne – de la base au sommet de l’exécutif – ne permet d’entrevoir les projets, les programmes ou les ambitions que le pouvoir nourrit.
Matignon semble incapable d’exprimer la moindre vision. Bien qu’ayant été pendant trois ans haut-commissaire au plan, poste censé apporter une approche de long terme et dégager des grands enjeux stratégiques, le premier ministre François Bayrou n’a jusqu’à présent donné aucune orientation industrielle ou économique, en dehors de la simplification et de la suppression des normes.
Le ministre de l’industrie reste, lui, fidèle à la feuille de route présidentielle. Alors que le secteur automobile, épine dorsale de l’industrie en Europe, connaît une crise qualifiée de centenaire, aucun plan public depuis l’annonce d’un « airbus de la batterie électrique » – en 2019 – n’a été présenté pour aider ce secteur à se renforcer, à traverser cette crise et à s’adapter à la nécessaire transition écologique.
Le même constat peut être dressé pour tous les autres secteurs. Le ministre n’a rien à dire sur la défense, la chimie, la machine-outil, les transports, la construction. Et l’on ne parle même pas de secteurs considérés désormais comme secondaires par le ministère, comme le textile ou le bois.
Il n’existe pas davantage de projets transversaux, comme l’aide à la robotisation, ou sur la façon d’utiliser de façon raisonnée et adaptée l’intelligence artificielle. Il n’y a pas plus de réaction chez le ministre quand le gouvernement annonce, au nom de la rigueur budgétaire, les baisses de crédit pour la recherche ou la formation, alors que l’industrie de demain aura plus besoin que jamais de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens si elle veut encore exister.
Dans l’intitulé de son portefeuille, Marc Ferracci est aussi ministre chargé de l’énergie. Mais là encore, sur ce sujet essentiel qui est pourtant le soubassement de toute politique industrielle, le ministre de l’industrie ne paraît guère présent. Sa seule préoccupation semble être de permettre à quelques groupes électro-intensifs de mettre la main sur la rente du nucléaire historique d’EDF, quel que soit le prix pour le groupe public ou pour l’ensemble du pays.
L’a-t-on entendu une seule fois sur la nécessité de réformer le marché européen de l’énergie, structurellement dysfonctionnel et manipulé, comme l’a largement documenté le rapport Draghi ? Pour toutes ces questions et pour le reste, il s’en remet à sa collègue ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
En trente ans, les résultats de cette doxa sont là : la France a connu la plus forte désindustrialisation de tous les pays développés.
« Tant que l’industrie et l’énergie resteront à Bercy, il ne se passera rien. C’est l’inspection des finances qui commande », analyse un connaisseur des cercles de pouvoir. Depuis le démantèlement du ministère de l’industrie par le très libéral Alain Madelin à la fin des années 1980, celui-ci est passé sous le contrôle du ministère des finances et a perdu une grande partie de son autonomie et de son expertise. Tous ceux qui ne partageaient pas les vues de Bercy, à commencer par les universitaires, en ont été exclus.
En trente ans, les résultats de cette doxa sont là : la France a connu la plus forte désindustrialisation de tous les pays développés. Mais l’échec patent de cette politique n’a pas amené le ministère à s’interroger : dans un monde de plus en plus fragmenté et bousculé, il prône toujours la mondialisation heureuse, le soutien aux champions mondiaux et les nécessaires délocalisations.
Entourés des mêmes conseils – McKinsey, Roland Berger, Accenture et autres –, les membres du ministère continuent à dispenser les mêmes schémas. Et sont persuadés que les dirigeants des groupes font toujours les meilleurs choix et sont les meilleurs stratèges.
De Carlos Ghosn à Carlos Tavares en passant par Serge Tchuruk , Anne Lauvergeon ou Gérard Mestrallet, les exemples d’erreurs magistrales et de choix fatals abondent. Mais il ne saurait être question de poser la question taboue de la compétence de certains dirigeants. Par nature, ces derniers savent mieux que tous les autres. Et le ministère de l’industrie n’est là que pour les servir, surtout pas pour discuter leurs choix, encore moins pour leur opposer des options inverses.
Un actif comme un autre
Tous les représentants du personnel et les élus locaux rapportent la même expérience quand ils ont eu à côtoyer le ministre de l’industrie, les membres de son cabinet, le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) ou les responsables des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire). Lors d’une fermeture d’usine ou de licenciements massifs, ils ont été écoutés poliment et ont pu présenter leur plan. Mais à la fin, tous ont le sentiment de s’être fait « balader ».
Pour tous ces représentants du ministère, le seul souci tangible est que le plan social en cours ou la fermeture d’un site industriel ne se transforme pas en conflit social majeur, fasse la une des journaux et devienne un sujet politique. Alors, ils font pression pour que les dirigeants paient plus que les sommes dues en cas de licenciement pour acheter la paix sociale. Pour le reste ? Le maintien d’une activité industrielle, la disparition de maillons essentiels, la prise de contrôle de propriétés intellectuelles sous pavillon étranger, ce n’est pas leur problème.
En huit ans, le ministère de l’industrie n’a pas utilisé une seule fois le décret Montebourg de mai 2014, qui permet de bloquer le rachat d’entreprise par des capitaux étrangers non européens quand l’activité est jugée stratégique. Il est vrai que ce décret est considéré comme un chiffon rouge par Emmanuel Macron : il avait été pris pour bloquer le rachat des activités d’Alstom par General Electric, que ce dernier soutenait en sous-main depuis des mois.
Le ministère n’a pas non plus eu recours à la directive européenne sur le contrôle d’activités stratégiques par des capitaux étrangers non européens, préférant regarder filer le Doliprane, Latecoere, Vencorex et tant d’autres, plutôt que de prendre une mesure qui pourrait entacher « l’attractivité de la France ».
Le cas de Pierre-Olivier Chotard illustre à lui seul l’état d’esprit qui règne dans le ministère de l’industrie : secrétaire général du Ciri, il vient de partir pantoufler chez Rothschild – sans passer par la case de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – pour s’occuper des fusions-acquisitions. Pour lui, l’entreprise est un actif comme un autre, à vendre, à acheter, à malaxer dans tous les sens pour en extraire des profits et des commissions. Quitte à la laisser détruire s’il le faut, selon les lois darwiniennes du marché.
Les protégés et les autres
De toute façon, se demandent les soutiens du gouvernement, comment mener une politique industrielle dans une période d’austérité budgétaire ? D’emblée, le gouvernement a exclu de toucher les 200 milliards d’euros distribués sans contrepartie à toutes les entreprises, pour les réorienter de façon plus efficace.
Des budgets ont bien été sanctuarisés ces dernières années pour soutenir le développement de certains projets industriels, notamment sur les nouvelles technologies. Le projet France 2030, piloté par Bruno Bonnell, un autre ami du président, a ainsi hérité d’une enveloppe de 5,4 milliards d’euros à dépenser sur cinq ans pour soutenir l’innovation.
Mais la Cour des comptes est incapable d’évaluer ses dépenses et leur pertinence. « Aucun de ces documents ne fournit encore la vision consolidée et transversale des investissements effectivement réalisés et en cours », écrit l’institution, comme l’a rapporté La Lettre.
Le contre-exemple industriel de l’usine d’aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne
Elle était condamnée, sans sauvetage possible, ainsi que tous ses propriétaires successifs l’ont affirmé : du canadien Alcan après avoir racheté Pechiney, au géant minier Rio Tinto après son OPA sur Alcan. Le cabinet de conseil Roland Berger l’a aussi confirmé, organisant un premier plan de restructuration dès 2011, destiné à mener le site à l’extinction.
Le ministère de l’industrie en était aussi convaincu : il n’y avait plus rien à faire pour sauver l’usine d’aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), contrairement à ce que soutenaient ses salarié·es. Malgré les prix très bas de l’électricité consentis par EDF, l’usine ne pouvait pas être viable au plan international. D’ailleurs, aucun repreneur ne se manifestait.
L’arrivée d’Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif en 2012 a interrompu la spirale fatale. Après une visite sur place, le ministre décide de mobiliser tous les moyens pour sauver le site, contre l’avis de ses équipes. Le groupe familial industriel allemand Trimet se déclare intéressé et, à l’été 2013, conclu un accord pour reprendre l’usine à hauteur de 65 % (EDF apportant les 35 % restants).
Repensée et réorganisée, gérée de façon prudente et classique, « sans dépendre des banques », l’usine est depuis repartie. Malgré la compétition acharnée sur le marché mondial de l’aluminium, malgré les droits de douane imposés sur les exportations vers les États-Unis, la productivité de l’usine est en hausse et ses salarié·es parmi les mieux payés de France.
La même opacité entoure les actions de la Banque publique d’investissement (BPI), créée pour apporter des financements aux projets de création et de développement des entreprises. Certains y ont un accès direct, à l’instar de Mistral AI, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle générative qui a obtenu une centaine de millions d’euros de crédit trois semaines seulement après sa création. D’autres doivent attendre trois mois pour avoir un rendez-vous et beaucoup se voient refuser une aide.
Aucun bilan de ces subventions n’étant disponible. Faut-il comprendre – comme le soupçonnent certains – qu’il y a les protégés et les autres ? Les repreneurs de Vencorex, qui demandaient quatre semaines supplémentaires et une aide de 40 millions pour monter leur projet de reprise en coopérative avec le soutien des collectivités locales et des fonds régionaux, se sont vu opposer un refus net. « Parce que l’État n’est pas assuré de retrouver son argent au bout de cinq ans », a justifié Marc Ferracci.
Au même moment, la Caisse des dépôts, CNP Assurances et la BPI ont volé au secours de la direction de Veolia, menacée par la Caixa à la suite d’un différend sur la filiale d’eau espagnole du groupe – reprise après l’OPA sur Suez. En quelques jours, ces grands institutionnels ont mobilisé environ 1 milliard d’euros pour prendre 5 % du capital de Veolia.
Le groupe est, il est vrai, un dossier prioritaire pour l’Élysée depuis des années. Mais le sauvetage du dirigeant d’un grand groupe est-il vraiment la priorité du moment? Est-ce ce type de mesure que l'exécutif imagine pour reconstruire un outil de production compétitif ?
mise en ligne le 14 mai 2025
Chaque jour compte :
le tic-tac résonne à Gaza
Maud Vergnol sur www.humanite.fr
L’histoire jugera les soutiens au génocide en cours en Gaza. Après les bombardements, les déplacements forcés, les humiliations, le gouvernement d’extrême droite israélien utilise la faim comme arme de guerre, avec une cruauté sans limites, qui laisse peu de doute sur ses intentions. Cette situation terrifiante a beau être rigoureusement documentée par de nombreuses ONG, hier encore par Médecins du monde, les acharnés du soutien inconditionnel à Israël continuent de nier les crimes contre l’humanité en cours à Gaza et en Cisjordanie.
« Je pense qu’il n’y a pas de famine à Gaza, a osé Arno Klarsfeld. S’il y avait une famine, il y aurait des milliers d’enfants dénutris et maigres comme les images de survivants de camps de concentration, ce n’est pas ce que je vois. » Ce sommet d’obscénité n’est malheureusement pas anecdotique. Passons sur la comparaison suggérée avec les camps nazis, dont ceux qui en usent ne semblent pas réaliser le mal qu’ils font à la mémoire de la Shoah.
Mais puisque Arno Klarsfeld et ses amis lepénistes du Rassemblement national font mine de ne pas voir, nous avons choisi de leur montrer la réalité. Dure, insoutenable. Celle d’enfants gazaouis aux joues creusées, la peau sur les os. À quel point faut-il être aveuglé par la haine pour ne pas avoir blêmi depuis le début des bombardements israéliens face aux images de mères palestiniennes tenant leur enfant sans vie dans leurs bras ? À Gaza, rapportait une ONG dans The Guardian en décembre, 96 % des enfants pensent que leur mort est imminente et 49 % souhaitent mourir.
Chaque jour compte. Le tic-tac résonne à Gaza. L’inertie des dirigeants européens en est d’autant plus insupportable. Ici et là, parfois bien tardivement, des voix commencent à s’élever et de plus en plus de personnalités osent enfin dénoncer les crimes du gouvernement Netanyahou. Tant mieux !
Tout ce qui peut contribuer à mettre fin au calvaire des Palestiniens est bon à prendre. Mais il faudra plus que des paroles et des symboles. L’Union européenne n’a encore formulé aucune menace de sanctions, aucune révision de l’accord d’association avec Israël. La lâcheté et les bons sentiments sont inefficaces contre la faim.
En Syrie, Israël harcèle des agriculteurs déjà fragilisés par la sécheresse
Par Pauline Vacher et Charles Cuau sur https://reporterre.net/
Dans le sud de la Syrie, les agriculteurs de la vallée du Yarmouk vivent sous la menace constante des incursions militaires israéliennes. Depuis décembre, ils sont privés d’accès à leurs terres et confrontés à une crise de l’eau.
Kowaya et Al-Qoseyr (vallée du Yarmouk, Syrie), reportage
Depuis les hauteurs du village de Kowaya, Adnan (le prénom a été modifié) observe à distance ses champs de concombres, en contrebas dans la vallée du Yarmouk, aux portes du Golan annexé et de la Jordanie. Trop dangereux pour lui d’y descendre. « Je préfère envoyer mes fils. Ils sont jeunes et pourront courir si les Israéliens débarquent », dit-il avec un regard inquiet tourné vers la Jazira.
Cet ancien poste-frontière syrien a été reconverti en base militaire par les troupes israéliennes quelques jours après la chute du régime de Bachar el-Assad, en décembre 2024. Comme la plupart des habitants de ce village agricole, Adnan vit désormais dans la crainte des incursions de l’armée israélienne.
Le 8 décembre, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a unilatéralement mis fin à « l’accord de désengagement » de 1974 entre Israël et la Syrie, qui instaurait une zone tampon démilitarisée entre les deux pays, séparant le Golan annexé de la Syrie. Les troupes israéliennes ont, au mépris du droit international, pris possession de cette zone, s’avançant également en territoire syrien. Depuis la base de la Jazira, elles mènent régulièrement des incursions dans la vallée du Yarmouk.
« Si les soldats vous trouvent dans vos champs, ils vous emmènent »
Le 25 mars à Kowaya, des bombardements israéliens ont tué au moins six personnes, dont une femme, selon le ministère des Affaires étrangères syrien. Une tentative d’incursion des forces israéliennes dans le village avait alors provoqué des affrontements avec des habitants armés. Face à l’intensité des bombardements, plusieurs familles ont fui vers les villages voisins. À Nawa, le 3 avril, neuf Syriens ont été tués lors d’affrontements avec l’armée israélienne, venue se positionner à proximité du barrage d’Al-Jabaliya.
Le prétexte d’une menace sécuritaire
Cette région rurale, où les familles dépendent quasi exclusivement de l’agriculture, est éminemment stratégique pour Israël. Depuis que ses troupes ont pris possession de la zone tampon, l’État hébreu cherche à l’étendre de facto à l’intérieur du territoire syrien en réalisant des incursions sur quelques kilomètres pour faire fuir les agriculteurs. Officiellement, il s’agit de démilitariser la zone et de désarmer les populations locales. Les habitants répliquent qu’ils ne possèdent que des fusils de chasse destinés à protéger leurs champs des sangliers. Pour les hommes du village, l’objectif du pays voisin est clair : prétexter une menace sécuritaire pour les chasser et occuper leurs terres.
« Si les soldats vous trouvent dans vos champs, ils vous emmènent. Ensuite, vous êtes interrogé pendant un ou deux jours sur la présence d’armes, puis relâché », raconte Enad (le prénom a été modifié), également agriculteur dans le village de Kowaya. Certains agriculteurs arrêtés par l’armée israélienne ont été contraints de signer une déclaration leur interdisant de retourner sur leur exploitation. Les anciens détenus refusent de s’exprimer. Il leur a été explicitement interdit de parler aux journalistes sous peine d’une nouvelle arrestation.
« Ils viennent au moins deux fois par semaine, dit Adnan. C’est impossible de travailler dans ces conditions. » Pour que ses concombres soient vendables, ils doivent avoir la bonne taille, donc être récoltés très régulièrement. Alors, quand vient ce moment, ses fils se précipitent pour couper ce qu’ils peuvent, quitte à laisser des légumes sur place pour les récupérer un autre jour. « Habituellement, on dort sur place pour protéger les champs des sangliers, mais maintenant, c’est trop dangereux », raconte Adnan.
« Depuis qu’Israël occupe la ville, plus une goutte d’eau ne nous parvient »
Aux incursions israéliennes, s’ajoute une pénurie d’eau croissante. Tout le long de la vallée du Yarmouk, l’irrigation dépend de la rivière éponyme, des nappes phréatiques et des barrages. Or, à cause du changement climatique, les pluies se font rares. Le barrage de Saham al-Golan, qui alimente le sud de la région, est désormais quasiment à sec. « Cette année, il n’y a eu aucune pluie. Les barrages ne se sont pas remplis et une grosse partie de mes plants sont morts », se désole Hani Al-Jamaoui, un agriculteur du village d’Al-Qoseyr, un peu plus en amont.
Saham al-Golan dépend en partie du ruissellement du barrage d’Oum Al-Adham, situé dans le Golan et sous contrôle israélien depuis décembre. « Depuis qu’Israël occupe la ville, plus une goutte d’eau ne nous parvient, affirme Anwar Al-Jamaoui, cousin de Hani, qui cultive également des terres. Tous les villages et les exploitations voisines sont asséchés. » Désemparés, Hani et d’autres agriculteurs de la région se sont tournés vers le responsable des ressources en eau du gouvernorat de Deraa, espérant qu’il puisse s’entretenir avec les autorités israéliennes. Ils demandaient la réouverture du barrage d’Oum Al-Adham, comme c’est censé être le cas en période de sécheresse, mais cette requête est restée sans réponse.
Enjeux géopolitiques
Hani possède aussi des champs en contrebas de la vallée du Yarmouk, à la frontière jordanienne. Pour les irriguer, il dépend du barrage d’Al-Wehda, situé à cheval entre les deux pays. Sous le régime de Bachar el-Assad, l’accès à cette zone sensible était strictement contrôlé. Désormais, la situation s’est assouplie, mais le niveau de l’eau a drastiquement baissé. La Jordanie puise davantage que ce que le barrage peut réellement fournir, tandis que la Syrie construit de petits barrages en amont et pompe dans les nappes phréatiques.
Résultat : le niveau du Yarmouk baisse et les tensions montent entre Amman et Damas. Pour Hani, cela se traduit par une irrigation de plus en plus incertaine, qui menace ses récoltes. Par ailleurs, bien que les opérations militaires israéliennes n’aient pas pour but officiel de s’emparer de l’eau du Yarmouk, il est un enjeu stratégique pour l’Etat hébreu, car le fleuve est l’affluent majoritaire du Jourdain, essentiel à son approvisionnement en eau.
« Ici, tout est détruit. Il n’y a plus d’école, plus de services, plus rien »
Certains agriculteurs plus aisés ont installé des pompes pour puiser l’eau des nappes ou du barrage d’Al-Wehda et la faire remonter vers les cultures. Mais une fois les installations en place, il faut encore acheter le carburant nécessaire à leur fonctionnement, dont le prix a explosé. Quelques familles ont opté pour des panneaux solaires, mais il faut souvent se regrouper à deux ou trois pour réunir les fonds nécessaires. « Je n’ai pas les moyens d’un tel investissement, j’arrive déjà à peine à m’en sortir, dit Hani, en montrant la vitre brisée de son salon qu’il ne peut réparer. Ici, tout est détruit. Il n’y a plus d’école, plus de services, plus rien. »
À l’entrée de Kowaya, trois carcasses de char rouillent au bord de la route, vestiges des combats entre l’ancien régime et l’État islamique, qui se sont affrontés ici jusqu’en 2018. « Les chefs locaux ont demandé à Damas de les enlever, mais le gouvernement n’ose pas intervenir à cause d’Israël », regrette Hani. Beaucoup ont le sentiment que le nouveau président par intérim, Ahmed Al-Charaa, privilégie la stabilité régionale à leur existence.
Alors, pour assurer leur sécurité, les hommes et les jeunes du village organisent leurs propres patrouilles. Mais le sentiment d’abandon est palpable. « On a demandé de l’aide aux nouvelles autorités de Damas. On nous a répondu de ne pas provoquer les Israéliens », déplore Enad, amer. Ils se sont aussi tournés vers les postes locaux des Nations unies. En vain.
L’avenir semble bouché. Les incursions israéliennes empêchent l’accès aux terres, l’eau devient rare et les infrastructures sont en ruine. À Kowaya comme dans les villages voisins, certains envisagent de partir. Adnan, lui, n’a pas encore les moyens de fuir, mais il économise et prévoit de vendre son exploitation, « au rabais s’il le faut ».
mise en ligne le 13 mai 2025
L’Europe sacrifie l’Asie centrale pour trouver son énergie « verte »
par Manon Madec sur https://reporterre.net/
L’Union européenne multiplie les investissements visant des minerais et la production d’énergie en Asie centrale. Malgré son discours sur une stratégie « gagnant-gagnant », l’environnement et les populations locales sont menacés.
Almaty (Kazakhstan), correspondance
À l’ouest du Kazakhstan, des bancs de sable remplacent la mer Caspienne, tandis qu’à Karaganda, dans le centre du pays, la neige vire au noir chaque hiver. En Ouzbékistan, le désert de Kyzylkoum grignote les terres autrefois fertiles de la région de Navoï. L’Asie centrale porte les stigmates de décennies d’exploitation pétrolière, gazière et minière. Pour la population, les ressources ne sont pas non plus une bénédiction : depuis les années 1990, leur exploitation est contrôlée par les majors étrangères et les élites locales, qui se partagent les rentes.
Aujourd’hui, ce sont les ressources dites « vertes » qui attirent l’attention sur la région. Lithium, nickel, uranium, terres rares : l’Asie centrale regorge de matières premières critiques, utilisées pour fabriquer des technologies bas carbone. Et ce n’est pas tout : avec son potentiel solaire, éolien et hydraulique, l’Asie centrale est un terrain idéal pour produire de l’hydrogène vert, qualifié ainsi car obtenu par électrolyse de l’eau, un procédé réalisé à partir d’énergies renouvelables et peu émetteur de CO2.
Ces ressources subiront-elles le même sort que les hydrocarbures ? Aujourd’hui, les États de la région les mettent aux enchères, en quête d’investisseurs qui ne se contentent pas de les extraire, mais participent aussi à la montée en gamme de l’industrie locale. Et ça, l’Union européenne (UE) l’a bien compris. À Samarcande (Ouzbékistan), lors du sommet UE-Asie centrale du 4 avril, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis des « partenariats mutuellement bénéfiques », fondés sur la création d’industries locales et d’emplois, ainsi que la production et l’exportation d’énergie verte.
Lithium kazakh et uranium ouzbek
Bénéfiques, ces projets le seront à coup sûr pour l’Europe, dont la demande en matériaux critiques ne fera qu’augmenter, prévient la Commission, alors que l’offre, elle, reste très restreinte. Échanger avec l’Asie centrale réduirait sa dépendance à la Chine, son principal fournisseur. Depuis les accords signés avec le Kazakhstan en 2022 et l’Ouzbékistan en 2024, elle a déjà investi dans le graphite et le cuivre via ses bras financiers, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle ne cache pas son intérêt pour les terres rares. En parallèle, l’Allemagne lorgne le lithium kazakh pour ses batteries. La France, qui importe déjà de l’uranium du Kazakhstan, accélère la production en Ouzbékistan.
Pour alimenter ses industries avec de l’énergie « propre », l’UE compte importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert par an dès 2030, dont 2 millions du Kazakhstan. En 2023, l’entreprise germano-suédoise Svevind a investi dans un gigantesque site de production à Mangystau, près de la mer Caspienne.
Doté de parcs éoliens et solaires, le site produirait, dès 2030, 40 gigawattheure d’électricité, sans compter celle issue de l’électrolyse. « C’est plus que la capacité actuelle de tout le pays, dit Vadim Ni, fondateur de l’ONG Save the Caspian Sea. Mais la totalité servira à produire l’hydrogène exporté vers l’Allemagne. »
« Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale »
De cette énergie verte produite sur son sol, le Kazakhstan ne verra pas la couleur. Pour en bénéficier, il faudrait moderniser un réseau électrique hérité de l’époque soviétique, conçu pour des centrales à charbon et inadapté aux renouvelables. Des investissements considérables qui ne sont pas, pour l’instant, à l’agenda européen.
Le pays, à l’instar de l’Ouzbékistan, aurait pourtant besoin d’accélérer sa transition. L’électricité y est toujours produite au charbon pour l’un, au gaz pour l’autre. En 2024, alors qu’il a les objectifs de réduction des émissions de CO2 les plus ambitieux de la région, le Kazakhstan a investi davantage dans de nouvelles capacités charbon que dans les renouvelables, rapporte le Global Energy Monitor.
Une dépendance aggravée par l’exploitation des matières critiques. Car les usines de transformation des minerais tournent au charbon, explique Dimitry Kalmykov, directeur du musée écologique de Karaganda. « Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale », affirme Vadim Ni.
« Préjudice irréversible à la biodiversité »
Pire encore, « les projets extractifs menacent d’accroître une pollution de l’air déjà critique », s’inquiète Dimitry Kalmykov. Cendres, métaux lourds, ammoniac : plusieurs études, dont une communication scientifique présentée en 2020, établissent un lien direct entre industrie minière et dépassement des seuils toxiques.
Quant au projet hydrogène, Kirill Ossin, fondateur de l’ONG EcoMangystau, prévient qu’il risque de porter un « préjudice irréversible à la biodiversité ». Construit dans la réserve naturelle d’Ustyurt, dans le sud-ouest du Kazakhstan, le parc détruirait l’habitat des gazelles et couperait les corridors empruntés par l’aigle des steppes, le koulan — un âne sauvage — et le léopard de Perse.
Il ne subsiste à l’état sauvage que 1 000 léopards de Perse, dont le milieu naturel est menacé par un projet d’extraction d’hydrogène vert au Kazakhstan. Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0 DE / Marcel Burkhard
S’y ajoute la saumure issue du dessalement de l’eau de mer, nécessaire à l’électrolyse. Plus chaude et plus salée que l’eau d’origine, elle pourrait perturber les écosystèmes marins si elle était rejetée dans la Caspienne. Une étude de faisabilité commandée par le gouvernement allemand, coécrite par Svevind, évoque un traitement « durable » des rejets, sans en préciser les modalités.
Vieux réflexes extractivistes
Les habitants aussi pourraient en faire les frais, car neuf litres d’eau seront pompés pour produire chaque kilo d’hydrogène, dans une région aride où l’accès à l’eau est déjà conflictuel. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : la mer Caspienne a baissé de deux mètres en vingt ans, et pourrait en perdre jusqu’à 14 de plus d’ici à la fin du siècle. C’est la pêche, l’agriculture et la consommation domestique qui sont menacées.
L’étude allemande admet une « situation critique » et reconnaît que l’hydrogène « accentuera la pression sur les ressources en eau ». Anticipant les critiques, l’UE a lancé le plan d’investissement Team Europe pour améliorer la gestion de l’eau. Cependant, signalent certains chercheurs : les financements sont insuffisants et sa mise en œuvre repose sur la bonne volonté des élites locales.
« La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés »
Malgré leurs zones d’ombre, les projets ne sont pas rejetés en bloc par les activistes. Sous conditions, ils admettent qu’ils pourraient profiter à la transition comme aux habitants. « C’est un projet prometteur, attractif, avec des retombées économiques importantes », reconnaît Kirill Ossin à propos de l’hydrogène. Mais tous dénoncent l’approche européenne qui perpétue les vieux réflexes extractivistes, par « peur de passer à côté de ressources dont elle a besoin », dit Mariya Lobacheva, directrice d’Echo, une ONG kazakhe pour la transparence et la participation citoyenne.
Craintes d’une répétition du scénario des années 1990
Vadim Ni regrette que l’UE « s’en remette aux autorités locales, alors même qu’elles ne sont pas toujours compétentes ». En 2021, le Kazakhstan s’est doté d’un Code de l’environnement censé contraindre les entreprises à limiter leur empreinte écologique. Mais, faute de moyens, « le système d’évaluation environnementale stratégique n’est pas appliqué », explique-t-il.
Derrière la vitrine démocratique, Mariya Lobacheva fait un constat amer : « La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés. » La société civile peine donc à jouer un rôle de garde-fou. « Personne ne fait pression sur les investisseurs ou le gouvernement. Les gens ne croient pas à leur capacité à changer les choses », dit Dimitry Kalmykov.
Mariya Lobacheva redoute une répétition du scénario des années 1990, lorsque les contrats signés avec les majors pétrolières ont été conclus sans consultation publique. Même les emplois promis par l’UE ne réveillent pas son enthousiasme : « Il n’y a aucune transparence sur les conditions et les niveaux de qualification des postes réservés aux Kazakhs. »
Pour convaincre l’Asie centrale de ses bonnes intentions, l’UE doit passer à l’acte. En commençant par ouvrir le dialogue avec les habitants, scientifiques et écologistes, « seule façon de garantir des partenariats gagnant-gagnant », affirme Kirill Ossin.
mise en ligne le 13 mai 2025
Jean-François Tamellini, syndicaliste belge : « Derrière la course aux armements, le véritable enjeu est la répartition capital-travail »
sur www.humanite.fr
Sous la houlette de la Commission européenne, les Vingt-Sept ont engagé une course aux armements. Les syndicalistes du continent livrent des clés pour la construction d’une économie de paix. Par Jean-François Tamellini, Secrétaire général de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) wallonne.
(Les intertitres et la mise en gras sont du fait de 100-paroles)
Guerre, racisme et néofascisme pour masquer l’échec du capitalisme ?
Massacres à Gaza, en Ukraine et au Soudan, avènement de l’extrême droite et de la ploutocratie, surenchère agressive et cacophonie médiatique trumpistes, protectionnisme nationaliste, austérité budgétaire et guerre aux pauvres… Une fois de plus, et comme toujours, le capitalisme nous mène droit dans le mur. Et ne nous propose comme seule sortie de crise que la fuite aveugle dans la guerre économique et l’économie de guerre.
La seconde élection de Trump a marqué un tournant. Une véritable guerre culturelle a été engagée par l’internationale réactionnaire. La fenêtre d’Overton s’est transformée en baie vitrée, les cordons sanitaires sont rompus et la droite « classique » poursuit sa mue vers l’extrême droite. La technique utilisée est la montée des nations les unes contre les autres. Patriotisme économique et nationalisme culturel sont imposés comme des références absolues.
L’étranger, l’étrangère, toute personne considérée comme différente est présentée comme un danger. Les luttes pour l’égalité et la justice sociale sont traitées de « wokistes », la nouvelle insulte passe-partout des réactionnaires. Une cacophonie et un confusionnisme savamment entretenus pour dissimuler le véritable enjeu : la répartition capital-travail.
Cette guerre culturelle n’a en effet qu’un objectif : relancer les politiques néolibérales et la course à la maximisation des profits. En s’attaquant à tout ce qui pourrait freiner la captation de parts de marché par les actionnaires privés : services publics, sécurité sociale, syndicats, mutuelles, ONG, associations luttant contre les discriminations… Dans ce contexte troublé et inquiétant, on nous enjoint d’ailleurs de préparer des kits de survie, mais aussi et surtout de repenser notre modèle industriel à l’aune du réarmement.
En Belgique, le ministre de la Défense – un nationaliste flamand flirtant ouvertement avec l’extrême droite – prône la reconversion de l’usine Audi à Forest 1 en une usine d’armement. Une fuite en avant militariste sans projet politique, social ou industriel sérieux, mais qui fait le bonheur – et les clics – des sites d’actualité en continu et de leurs réseaux.
Politique de défense et protectionnisme : oui éventuellement, mais au service de qui ...
Soyons clairs, adopter une stratégie de défense est important. La stabilité et la sécurité sont des conditions de base pour construire ou consolider des démocraties. Une politique industrielle publique de l’armement, régulée et coordonnée au niveau européen, pourrait être déployée, dans une logique semblable à celle qui avait mené à la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca) au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a une énorme différence entre une stratégie de défense visant à favoriser les conditions de paix entre États et une politique va-t-en-guerre visant à enrichir les actionnaires privés d’entreprises d’armement.
Soyons clairs, encore : le protectionnisme, dans le système capitaliste actuel, ne doit pas être un tabou. Encore faut-il qu’il soit pensé dans une optique de progrès social et environnemental. Si elles servent à freiner le shopping fiscal, social et environnemental des multinationales, à relocaliser l’économie, à garantir la souveraineté sur les besoins fondamentaux, et non à asservir d’autres peuples, les taxes ont clairement un rôle à jouer. Mais on est alors à l’opposé du modèle nationaliste de Trump.
Ces quarante dernières années, le démantèlement de l’industrie européenne est allé de pair avec celui des systèmes de sécurité sociale, entraînant une précarisation de l’emploi, des salaires et des conditions de travail. Pour affronter la guerre commerciale et financer le réarmement, les va-t-en-guerre libéraux voudraient aujourd’hui sabrer une fois de plus dans la sécurité sociale et les services publics. Militarisme et austérité, un beau projet d’avenir…
Le devoir de la gauche
Face à cette radicalisation de la droite, la gauche, dans son ensemble et sa diversité, doit reprendre les clefs du débat, réaffirmer ses valeurs et la pertinence de ses analyses. Remettre au premier plan le rapport de force capital-travail, en repensant le modèle sur la base des besoins fondamentaux des populations.
C’est sur cette base qu’avait été créée la Sécurité sociale après guerre, un modèle qui a permis aux corps de se redresser et à l’économie de se développer, grâce au travail de la classe ouvrière, parmi lesquels de nombreux travailleuses et travailleurs migrants. Il nous faut aujourd’hui aller plus loin et travailler à une transformation radicale de l’économie au service du progrès social, de la protection de l’environnement et du renforcement de la démocratie.
La guerre économique et l’économie de guerre ne sont que des impasses mortifères. Il est indispensable de recréer les vraies conditions qui assureront une paix durable au niveau mondial : le rétablissement d’un cordon sanitaire inviolable à l’égard de l’extrême droite et une meilleure répartition des richesses.
En ajoutant l’indispensable dimension environnementale aux conditions qui avaient rendu possible le pacte social d’après guerre, rappelant aux fous de ce monde que le combat pour préserver la planète prime sur leur capitalisme de guerre et leurs guerres commerciales. Revendiquer, militer et lutter pour une meilleure répartition des richesses doit être une priorité pour les forces de gauche. La réduction des inégalités et le progrès social sont les meilleures armes contre l’extrême droite, ses idées et ses logiques guerrières.
mise en ligne le 12 mai 2025
Emploi : le chômage baisse
mais la pauvreté progresse
Marie Toulgoat sur www.huma.fr
Alors que le nombre de privés d’emploi a diminué entre 2015 et 2022, le nombre de personnes en précarité a, lui, augmenté. Les salariés en temps partiel ou en contrat court, ou encore en invalidité, sont en première ligne de cette dégradation.
« Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous. Au moment où je vous parle, on est à 7 % de chômage. » En novembre 2023, Emmanuel Macron, dans une allocution, ravivait sa rengaine du plein-emploi, son objectif de parvenir à 5 % de chômage en 2027, coûte que coûte.
Loin du mythe que s’est construit le président sur les bienfaits de cette ambition, les faits sont têtus, et terribles pour les plus précaires. Selon une étude du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) publiée le 7 mai, la baisse du taux de chômage n’a guère signé le recul de la pauvreté. Au contraire, celle-ci et le sentiment de pauvreté alimenté par les Français ont continué de progresser.
En effet, selon le diaporama dressé par l’institution, alors que le chômage a baissé de 3 points entre 2015 et 2022, passant de 10,3 % à 7,3 %, le taux de pauvreté monétaire, lui, a augmenté. Le nombre de personnes vivant avec moins de 60 % du niveau de vie médian est passé de 14,2 % à 14,4 %.
La part des personnes devant renoncer à au moins cinq dépenses de la vie courante sur une liste de treize (par exemple, pouvoir accéder à internet, pouvoir avoir une activité de loisir régulière, chauffer son logement ou encore pouvoir acheter des vêtements neufs) est passée de 12,1 % à 13,1 %. Le sentiment de pauvreté s’est quant à lui envolé de plus de 6 points, passant de 12,4 % à 18,7 % parmi la population sur la même période.
Des microentrepreneurs et apprentis pauvres
Selon le CNLE, une des raisons est à trouver dans la nature des emplois créés entre 2015 et 2022. Car si le chômage a en effet reflué, les emplois créés n’ont pas tous été de qualité identique.
« De nombreux emplois créés n’ont pas entraîné une sortie de la pauvreté, que ce soit pour les actifs employés sous contrats temporaires et à temps partiel ou pour ceux sous le statut de microentrepreneur, qui sont restés pauvres monétairement dans l’emploi, ou pour les apprentis de l’enseignement supérieur, qui souvent vivaient déjà au-dessus du seuil de pauvreté avant d’être en emploi », notent ainsi les autrices de l’étude. En somme, l’objectif de réduction du nombre de chômeurs s’est fait par la généralisation d’emplois précaires, à temps partiel et mal rémunérés.
Ce sont précisément parmi ces employés précaires que les difficultés économiques et matérielles se font le plus criantes. « Les privations matérielles et sociales se sont considérablement étendues parmi les employés embauchés sur des contrats courts atteignant des taux comparativement élevés (15,5 % en 2015, 18,3 % en 2019 comme en 2021), les intérimaires (de 14,1 % à 23 %) et les chômeurs (de 34 % à 37 %) », détaille le rapport.
Si l’augmentation des difficultés touche les personnes en emploi de piètre qualité, les personnes inactives sont elles aussi à la peine. Ainsi, le taux de pauvreté a augmenté parmi les personnes retraitées, à mesure que la pension moyenne, en euro constant, a diminué de 2015 à 2022. Le taux de pauvreté des personnes ne pouvant travailler pour cause d’invalidité a lui aussi bondi. Il est passé de 26,8 % en 2015 à 36,7 % en 2022.
Une colère accrue chez les allocataires
Cette publication du CNLE apporte ainsi une lumière crue sur la politique de réduction du chômage menée par Emmanuel Macron. Les dernières réformes de l’assurance-chômage ont en effet eu pour principale conséquence de jeter dans la précarité les personnes privées d’emploi.
La réforme entrée en vigueur en 2021, par exemple, visait ainsi à revoir à la baisse le montant de l’allocation, en modifiant le mode de calcul du salaire de référence, sur lequel se base l’indemnisation, pénalisant les personnes dont la carrière a été la plus discontinue.
La même année, le nombre d’heures travaillées nécessaires pour pouvoir ouvrir des droits au chômage a été rehaussé, et la durée d’indemnisation rabotée. En plus d’accentuer la pauvreté des salariés et des personnes inactives, les politiques publiques entreprises par les gouvernements d’Emmanuel Macron – la dernière en date étant la réforme du RSA conditionnant l’octroi du minimum à des heures de travail – alimentent nombre de tensions.
Selon le CNLE, celle-ci est à mettre au compte des « problématiques d’information et d’accès aux droits des usagers, des besoins exprimés non satisfaits et des phénomènes de concurrence entre usagers ».
Ces discordes mènent même parfois au drame. Le 28 janvier 2021, une conseillère de France Travail (ex-Pôle emploi) a même été tuée par un usager à Valence (Drôme). La recrudescence des rendez-vous générée par les réformes de l’assurance-chômage, couplée au sous-effectif de l’administration, avait été pointée du doigt par les syndicats.
mise en ligne le 12 mai 2025
« À ce rythme, on ne va pas vivre vieux ». Dans la Sarthe, le quotidien
d’un désert médical
Caroline Coq-Chodorge sur www.mediapart.fr
Dans l’ouest de la Sarthe, il y a trois fois moins de médecins que dans le reste de la France, et la plupart ont plus de 60 ans. La catastrophe sanitaire est déjà là, et va s’aggraver si rien n’est fait. Habitants et médecins réclament d’urgence une régulation de l’installation des médecins.
La Ferté-Bernard, Tuffé et Vibraye (Sarthe).– « Aberrant », « une honte », « une catastrophe », « la dégringolade », « le délabrement », « l’abandon » : les habitant·es de la Sarthe déroulent le champ lexical de la désolation et de la colère quand on les interroge sur leur accès aux soins. « Je ne veux pas en parler, cela me met trop en colère ! », s’exclame Jacqueline, 86 ans. « Cela me révolte ! On vote, on paie nos impôts comme tout le monde », dit Janine, 94 ans. Aux urgences de La Ferté-Bernard, elle fulmine, dans l’attente d’un scanner. Sa fille Martine, 70 ans, tapote sa jambe pour l’apaiser, en vain.
Janine et Jacqueline sont toutes deux venues de Tuffé, gros village de 1 669 habitant·es situé à vingt minutes de route de La Ferté. Le dernier médecin est parti il y a quatre ans. Ensuite, des doctrices espagnoles recrutées par des agences d’intérim se sont succédé dans la maison de santé construite dans la commune. Toutes sont parties. Depuis un an, il n’y a plus de médecin.
Tous les habitant·es et les médecins croisé·es dans ce coin ouest de la Sarthe réclament une régulation de l’installation des médecins, a minima comme le proposent les député·es qui ont largement adopté, mercredi 7 mai, une proposition de loi limitant les installations en zones surdotées.
Le texte doit encore passer par le Sénat… qui examine, lundi 12 mai, un autre texte qui veut contraindre les médecins qui s’installent en zone surdense à travailler à temps partiel dans un désert médical. De son côté, le gouvernement veut les faire travailler deux jours par mois en zone sous-dense. La pression politique est donc forte sur la médecine de ville.
En attendant, il faut un réseau pour retrouver un médecin traitant dans la Sarthe. « Quand notre médecin espagnole est partie, on a cherché partout, il n’y avait pas de place. On en a retrouvé une à Bonnétable [quinze minutes de voiture – ndlr] grâce à une collègue de travail qui nous a prévenues, explique Martine. Ma mère a trouvé un dentiste à Sillé-le-Guillaume [quarante-sept minutes de route – ndlr] grâce à mon frère, qui est psychologue et qui a demandé au maire. Moi, pour mes dents, je vais à Lorient, chez mes enfants. Et comme je ne parviens pas à trouver un cardiologue, ma médecin généraliste renouvelle les ordonnances. »
Enchaîner les kilomètres pour être soigné
À la « graineterie-fleurs-café » de Tuffé – c’est écrit sur la devanture années 1950 –, Jacqueline boit, en fin de matinée, ses deux portos de la journée, « pas plus », jure-t-elle. « Avant, il y avait trois médecins, une pharmacie, raconte-t-elle. J’ai retrouvé un médecin à Connerré [dix minutes de voiture – ndlr]. Mais il a 65 ans, il m’a prévenue qu’il allait bientôt partir. »
Qu’importe, Jacqueline ne « croit plus aux médecins ». Elle montre ses yeux qui coulent depuis deux mois, en raison d’une infection. Rien n’y a fait : ni son médecin ni les urgences. Son découragement s’étend aussi à la politique. Jacqueline votait à gauche. « Depuis cinq ou six ans, je ne vote plus. Cela ne m’intéresse pas, je n’attends rien d’eux. »
Aux urgences de La Ferté-Bernard, Claire et Daniel Girard, 62 et 68 ans, ont roulé trente minutes depuis Saint-Calais, où le service d’urgences est fermé ce jour-là. Ils accompagnent la sœur de Daniel et son beau-frère, atteint d’une leucémie, qui souffre des lourds effets secondaires de ses traitements.
Daniel est le seul à conduire. Ils n’ont trouvé un médecin traitant qu’à Ceton, à quarante minutes de chez eux. Claire a des problèmes cardiaques et doit aller à Tours, à plus d’une heure de route, pour voir un spécialiste. « À ce rythme, on ne va pas vivre vieux », disent-ils.
Claire a été comptable puis gardienne d’immeuble, Daniel ouvrier agricole. « On a travaillé toute notre vie, on a payé nos impôts. Mais les jeunes médecins ont un boulot en or et ne veulent pas venir dans un coin perdu. Les politiques n’ont aucune volonté, ils s’en foutent des Français. » Leurs opinions politiques ont bougé, de gauche à l’extrême droite : « Cela ne peut pas être pire. Au moins ils seront plus fermes. »
La Ferté-Bernard fête ses 1 000 ans cette année. La ville derès de 9 000 habitant·es est dominée par la massive église Notre-Dame-des-Marais. Les marais en question ont été asséchés par un réseau de canaux qui sillonne la ville. On y trouve les restes d’un château, une porte médiévale, des maisons à colombages. Dans ce recoin de l’est de la Sarthe débute le parc naturel régional du Perche : bocages, forêts vert pimpant troué du blanc des fleurs d’acacias, villages historiques.
Le maire, Didier Reveau, soucieux de donner une bonne image de sa commune, fait la liste de tous ses atouts : un bassin de population de 30 000 habitant·es, le plein emploi dans un « territoire d’industrie », une gare, deux lycées et deux collèges, publics et privés, une crèche, un centre aquatique, « tous les sports possibles », etc.
Une terre de conquête pour le RN
Mails, coups de téléphone, rien n’y fait : impossible d’interroger la déléguée départementale du Rassemblement national (RN), Marie-Caroline Le Pen. Le parti d’extrême droite est pourtant en train de réussir son implantation dans la Sarthe. Aux dernières législatives, il n’est pas parvenu à faire élire de député·es, mais a doublé son nombre de voix. Dans trois circonscriptions, il a perdu d’un cheveu.
Dans la quatrième, Élise Leboucher (La France insoumise, LFI) n’a eu que 225 voix d’avance sur la sœur de Marine Le Pen. « Pour le RN, la Sarthe est la porte d’entrée vers la Bretagne », estime la députée, qui voit sa concurrente RN « et son mari, le député européen Philippe Olivier, tracter sur les marchés ». Leur premier argumentaire politique reste la lutte contre l’immigration.
« Quand on fait du porte-à-porte, les gens nous parlent de leurs problèmes d’accès aux soins. On leur dit que le RN ne propose rien de nouveau sur le sujet. Ils sont surpris », rapporte Élise Leboucher, qui a activement participé au groupe de travail transpartisan sur la régulation de l’installation des médecins. Sur le sujet des déserts médicaux, le Rassemblement national est le seul parti à voter comme un seul homme contre toute régulation de l’installation des médecins.
Tuffé a aussi sa gare, sur la ligne Le Mans-Paris, à deux heures trente de la capitale. Sylvain*, 36 ans, nouvel habitant, travaille quatre jours par semaine dans une grande administration à Paris. Il a gagné en qualité de vie, mais peine comme les autres à trouver un médecin : « J’ai un médecin traitant en Seine-Saint-Denis. Comme moi, plusieurs amis prennent le train pour se soigner dans des centres de santé autour de la gare Montparnasse. Financièrement, il faut se le permettre. »
À ses côtés, Alexandre, 36 ans, n’a pas de médecin traitant. Il a vu une fois « un médecin retraité dans un Médibus », un cabinet médical itinérant payé par la région. Sinon, en cas de maladie, il attend que ça s’aggrave puis se rend aux urgences. Dans ses bras, Tess, 2 ans, s’y est rendue quelques fois. Ses parents racontent : « [On a passé] du temps sur Doctolib, et au téléphone. Certains cabinets médicaux ne décrochent même pas s’ils ne connaissent pas le numéro. On a trouvé un pédiatre sur Le Mans, mais il faut prendre un rendez-vous six mois avant. » Donc elle aussi fréquente les urgences pour une grosse fièvre ou une bronchiolite.
Sylvain et Alexandre se demandent « comment résoudre ça ». « Si j’étais médecin, je ferais comme eux, j’irais au bord de la mer. La seule solution est de les contraindre à s’installer là où il y a de la demande », estime Alexandre. Dans la Sarthe, ils ne seraient pas malheureux, estime Sylvain : « Un médecin qui s’installe ici fait fortune. »
Les mois d’attente et les dépassements d’honoraires
Étienne, Francis et Daniel sont des pompiers volontaires retraités. Au fil des années, ils ont pris en charge des malades pour les convoyer à l’hôpital de La Ferté-Bernard ou du Mans, et ne sont pas spécialement remerciés de leur engagement. Eux aussi ont de grandes difficultés d’accès aux soins.
Étienne va à Angers, à 240 kilomètres, pour voir un dentiste. Francis a « la chance d’avoir un pied-à-terre sur la côte, à Pornic (Loire-Atlantique). Il y a deux à trois mois d’attente pour voir un ophtalmologue ou un dermatologue. Ici c’est un an. » Daniel, lui, se plaint des dépassements d’honoraires : « On n’a pas le choix, on est obligé de les accepter. J’ai payé 400 euros de ma poche pour me faire opérer dans une clinique. »
La doctrice Laure Artru est une rhumatologue retraitée de la Sarthe, aujourd’hui présidente de l’Association de citoyens contre les déserts médicaux. Au cours de sa carrière, elle a vu l’offre de soins se dégrader à grande vitesse dans le département : « En 2020, 50 000 habitants de la Sarthe étaient sans médecin traitant. En 2025, ils sont 100 000 habitants », dans un département qui en compte 566 000.
Les pauvres en santé paient pour les riches en santé ! Laure Artru, présidente de l’Association de citoyens contre les déserts médicaux
Certain·es de ses patient·es se plaignaient de douleurs qui s’expliquaient parfois par un retard de soins. « J’ai vu arriver des patients rouges comme des coqs, avec une grave hypertension non diagnostiquée. » Elle se souvient aussi « d’une jeune femme avec une sclérose en plaques sans médecin traitant ». Ou de cet homme qui avait mal aux épaules et a fini avec « trois pontages coronariens ».
Elle rappelle les chiffres de la mortalité dans les déserts médicaux fournis par l’Association des maires ruraux de France. Selon une étude, « il y a 14 000 décès par an en plus dans les zones rurales que ce qui serait attendu si l’espérance de vie y était identique à celle des villes ».
Vigoureusement, la doctrice plaide pour un encadrement de l’installation des médecins, en donnant l’exemple de sa génération : « Dans les zones surdenses, certains médecins ne voient que 500 patients par an. Pour vivre, ils multiplient les consultations et les examens. Ils font de la surfacturation ! Les pauvres en santé paient pour les riches en santé ! »
Dans les années 1980 et 1990, quand les médecins étaient très nombreux, « [les médecins] s’installait là où il y avait de la place. C’est [s]on cas », confie-t-elle. En Sarthe, la qualité de vie n’est finalement pas si mauvaise : avec son mari Bernard, cardiologue, ils ont acheté un magnifique corps de ferme auquel ils consacrent une belle partie de leur retraite.
Des aides à l’installation tous azimuts
Des dispositifs existent déjà : les médecins qui s’installent dans la quasi-totalité de la Sarthe, classée en zone sous-dense, reçoivent 50 000 euros s’ils travaillent quatre jours par semaine. Ils doivent y exercer pendant cinq ans. S’ils partent, ils doivent rembourser « au prorata de la durée restant à couvrir », détaille l’assurance-maladie.
Et s’ils s’installent dans certaines communes aux alentours de La Ferté-Bernard, classées en zone de revitalisation rurale, ils sont en prime exonérés de tout impôt pendant cinq ans. C’est le cas de Vibraye, à vingt minutes de La Ferté-Bernard, qui n’a jamais attiré un seul médecin.
Dans la file d’attente chez le pharmacien, des patient·es s’inquiètent pour l’un des deux derniers médecins, sexagénaire, de ce gros village. « Il est fatigué, il a des cernes. Il y a un monde dans la salle d’attente ! » Le maire de Vibraye, Dominique Flament, ne sait plus quoi faire. La région déploie un « Médibus », un « cabinet médical itinérant », à Saint-Calais, la ville la plus proche, mais il ne poussera pas jusqu’à Vibraye.
Entre les villes et les villages, la concurrence est rude. Comme à Tuffé, la mairie a fait construire une maison médicale, sans succès. Le maire a médiatisé la situation du village sur TF1. Aujourd’hui, il se tourne vers un cabinet de recrutement, en espérant pouvoir attirer, et fidéliser, un médecin étranger.
« L’accès aux soins est au cœur de notre combat. On fait de gros investissements, sans résultats », se désole-t-il. La grosse pharmacie du village s’est dotée d’une cabine de téléconsultation, « mais c’est du dépannage », estime le maire.
À La Ferté-Bernard, l’ambition est bien plus grande, mais les difficultés identiques. Le Pôle santé Simone-Veil s’appuie sur toutes les innovations possibles pour soulager les médecins et leur permettre de voir plus de patient·es. En 2017, sur dix-sept médecins, « huit sont partis d’un coup à la retraite ». « Avec un autre médecin, on n’a pas eu le cœur d’abandonner la population », explique Didier Landais, l’un des généralistes du pôle, 75 ans.
Ils ont donc monté ce centre de santé, où tous les professionnels sont salariés. « Je ne reviendrai pour rien au monde à l’exercice libéral », affirme-t-il. Le bâtiment a été construit par la commune, qui le met à disposition gratuitement. Le maire de La Ferté-Bernard, Didier Reveau, souligne le faible coût pour le faire tourner. « L’an dernier, il nous a coûté 60 000 euros en fonctionnement, en raison du manque de médecins. S’il y en avait assez, le centre de santé serait à l’équilibre », affirme-t-il.
Au côté des médecins – 3,8 postes à temps plein – travaillent deux et bientôt trois infirmières de pratique avancée (IPA). Elles font des préconsultations, pour faciliter le travail du médecin. « La demande est énorme, explique Didier Landais. On ne peut plus voir les patients trente minutes, comme le faisaient les médecins de famille. » Aujourd’hui, ils voient quinze minutes l’infirmière et quinze minutes le médecin. « Et ils sont heureux, assure Elisa Marais, IPA, parce qu’on prend le temps de revoir leur traitement, de parler de leurs difficultés. » Les IPA assurent aussi un suivi des malades chroniques entre deux consultations médicales.
« Foutu pour foutu, on innove », sourit Elisa Marais. Le centre de santé a inventé l’infirmière boussole, qui trie les patients qui s’adressent en urgence au pôle santé : elle évalue si la demande est prioritaire, ou si elle peut attendre. C’est une première en France, qui est en train de faire ses preuves.
Elisa Marais ne supporte plus d’entendre les arguments des médecins contre la régulation : « Il faut passer avant leurs choix de vie. Mais ils ne savent rien sur nos territoires. On ne serait pas attractifs, disent-ils. Nous, on comprend qu’on ne mérite pas d’être soignés. »
mise en ligne le 11 mai 2025
Gaza : la colère a gagné
le « médecin pour la paix »
Gwenaelle Lenoir sur www.mediapart.fr
Le documentaire « Un médecin pour la paix » veut retracer l’itinéraire édifiant du médecin palestinien Izzeldin Abuelaish, qui prônait la paix malgré l’assassinat par l’armée israélienne de trois de ses filles et de l’une de ses nièces en 2009. Mediapart s’est entretenu avec un homme en colère.
La scène est terrifiante. Elle se déroule sur un plateau de télévision israélien, en direct. Un journaliste, Shlomi Eldar, tient un téléphone portable en main, il a mis le haut-parleur. Des cris de douleur, des hurlements de terreur, des supplications s’en échappent : « Ils ont tué mes filles, mon Dieu, ils ont tué mes filles ! »
Cette voix, toute de désespoir, est celle du docteur Izzeldin Abuelaish, elle vient de Gaza, plus exactement du camp de réfugié·es de Jabaliya.
Shlomi Eldar, visiblement bouleversé, interroge : « Si quelqu’un de l’armée israélienne nous écoute, il faut envoyer des ambulances », et il donne l’adresse du médecin. Puis il ôte son oreillette, disant : « Je ne vais pas raccrocher, je ne peux pas raccrocher, mais je vais quitter le plateau. »
Izzeldin Abuelaish, ce soir-là, a perdu trois filles, Besan, Mayar, Aya, et une nièce, Nour. D’un double tir de char. Intentionnel.
C’était le 16 janvier 2009. Depuis déjà presque trois semaines, l’armée israélienne menait une nouvelle guerre contre Gaza. Pire que les précédentes. Moins horrible que les suivantes.
Cette scène est montrée dans le documentaire de Tal Barda sorti en France le 23 avril 2025, Un médecin pour la paix. La réalisatrice franco-américaine, née et grandie à Jérusalem, a voulu raconter l’histoire du docteur Izzeldin Abuelaish après avoir lu son livre, Je ne haïrai point (éd. J’ai lu, 2012), et l’avoir rencontré.
Le film a été tourné avant octobre 2023. Il est d’ailleurs émouvant de contempler ces vues d’une bande de Gaza encore debout, avec ses immeubles ocre et gris, ses ruelles du camp de réfugié·es de Jabaliya, ses moments de farniente sur la plage, ses saluts entre voisins. Ces scènes ordinaires d’une ville vibrante avant sa destruction totale.
Aujourd’hui, des milliers de pères éplorés
Aujourd’hui, des Izzeldin Abuelaish, il y en a des milliers, à Gaza. Des milliers de pères qui ont vu, sous leurs yeux, leurs filles et leurs garçons assassiné·es. Depuis octobre 2023, 15 613 enfants ont été massacré·es, selon un bilan arrêté le 5 mai 2025 par l’Unicef, et 34 173 blessé·es, dont beaucoup amputé·es à vif, handicapé·es à jamais.
Il y a des milliers de parents endeuillés et brisés.
Mais il n’y a qu’un Izzeldin Abuelaish, tant le destin individuel de cet homme fait exception.
D’abord parce que l’opinion israélienne n’a pas pu échapper, cette fois-là, à la guerre que son gouvernement et son armée menaient à quelques dizaines de kilomètres des plages de Tel-Aviv. La guerre faisait des victimes, innocentes, et les téléspectateurs et téléspectatrices les touchaient du doigt. Elles avaient des prénoms, des photos et des âges. Le père éploré avait un nom, un visage, et un ami israélien, Shlomi Eldar, qui se transformait en porte-voix de ses cris.
Ensuite parce qu’Izzeldin Abuelaish n’était pas un Palestinien parmi d’autres. Le natif du camp de Jabaliya parle hébreu couramment. Gynécologue, il travaille dans un hôpital israélien. Il passe tous les jours le checkpoint d’Erez pour se rendre de sa maison, en bordure de Gaza-ville, où il vit avec ses huit enfants, jusqu’au service d’obstétrique de Tel-Hashomer, près de Tel-Aviv. Spécialisé dans les problèmes d’infertilité, il permet à des femmes, israéliennes et palestiniennes, juives, musulmanes et chrétiennes, d’avoir des enfants. Il a touché ses collègues avec son premier deuil, celui de son épouse, morte en 2007 d’une leucémie.
Bref, en 2009, il est une figure idéale pour incarner une paix en marche, même si celle-ci boite sérieusement depuis plusieurs années.
Après l’assassinat de ses filles et de sa nièce, le docteur Izzedin part à l’autre bout du monde, ou presque, avec ses enfants survivants.
La paix ne sera pas obtenue par la force. La paix est le fruit d’un choix. Izzeldin Abuelaish
Et depuis Toronto, où il vit et exerce désormais, il poursuit une double quête : la paix entre les peuples et la reconnaissance, par l’État d’Israël, de sa responsabilité dans le double tir de char sur son appartement, qui a tué Besan, Mayar, Aya et Nour.
C’est cela que Tal Barda a voulu saisir. Cette volonté de celui qui a été cinq fois nominé pour le prix Nobel de la paix de ne jamais renoncer.
La réalisatrice le saisit presque toujours enthousiaste, même quand les tribunaux israéliens refusent de reconnaître la responsabilité de l’armée israélienne. Même quand il retourne à Gaza, discute avec des cousins, frères, connaissances bien plus sceptiques que lui.
Et aujourd’hui ? Aujourd’hui alors que l’intention génocidaire du gouvernement israélien ne fait plus de doute, alors que si seulement quatre jeunes filles étaient tuées dans une journée, ce jour-là serait considéré comme « calme » ?
« L’urgence est d’arrêter le bain de sang. Il faut mettre fin au génocide. Ensuite, dans le cadre du processus de reconstruction, il sera possible de parler de paix, assure à Mediapart Izzeldin Abuelaish depuis Toronto. Il sera indispensable d’être enfin sérieux à ce sujet, de comprendre que la paix ne sera pas obtenue par la force. La paix est le fruit d’un choix. Ce n’est pas une simple incantation. »
L’homme, s’il demeure persuadé que la paix est la seule voie possible, à condition qu’elle soit juste et assure des droits égaux, ne cache pas qu’il est bouleversé. Même s’il répète, comme il le disait dans le film, avant 2023 et les massacres sans fin : « Si je savais que mes filles et ma nièce étaient le dernier sacrifice sur la voie de la paix entre Palestiniens et Israéliens, je l’accepterais. Mais elles n’ont pas été les dernières. Il y a eu ensuite 2014, 2016, 2018, 2021, et jusqu’à aujourd’hui. Et c’est ce qui me met en colère. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes neveux, mes nièces sont toujours là-bas, massacrés tous les jours », reprend-il.
Que dit le monde, alors que les dirigeants israéliens se comportent comme une mafia de voyous ? Izzeldin Abuelaish
Depuis octobre 2023, le gynécologue a perdu plus de soixante-dix membres de sa famille. Comme des dizaines de milliers de Palestinien·nes de la diaspora, il tremble chaque matin en ouvrant son téléphone portable. « La plupart des gens que vous voyez dans le film avec moi à Gaza ont été tués », s’exclame-t-il.
L’homme que nous voyons par visioconférence n’est pas abattu. Il est en colère. Pas tant contre les Israélien·nes que contre les États occidentaux.
Les premiers, dit-il, « sont déconnectés pour la plupart. Ils restent centrés sur les otages et ne veulent pas voir ce qui se passe à Gaza. C’est aussi à cause de la propagande, qui a déshumanisé les Palestiniens ». À lui aussi, on demande ce qu’il pense du 7-Octobre. « Ils s’imaginent qu’il n’y a rien avant le 7-Octobre. Alors quand on me pose la question, je réponds “quel 7 octobre ? Celui de 1948, de 1949, de 1967 ? Mes filles ont été tuées un 16 janvier. Que pensez-vous du 16 janvier ?” Nous ne pouvons pas voir les choses avec un instantané. Il faut les considérer d’une manière globale. »
Les États occidentaux, eux, portent l’essentiel de la responsabilité et reçoivent le gros de sa colère. Car ils vendent les armes sans lesquelles le génocide ne serait pas possible et apportent un soutien actif ou un silence complice : « Que dit le monde, alors que les dirigeants israéliens se comportent comme une mafia de voyous ? Vous voyez ce qu’ils font en Syrie, ce qu’ils ont fait au Liban, ce qu’ils font ici et là ? Et les colons en Cisjordanie ? Ils se créent leurs propres ennemis. Mais où sont les États occidentaux ? »
Le Dr Izzeldin Abuelaish exige que les criminels rendent des comptes, devant des tribunaux. Tous les criminels. Ceux qui ont agi directement. Ceux qui ont vendu les armes. Ceux qui ont encouragé le génocide. Ceux qui se taisent. Pour que les parents cessent de hurler de douleur.
« Je continuerai à plaider pour la justice, la liberté, l’égalité, la dignité, les droits, la sécurité future des Palestiniens et des Israéliens, parce qu’ils sont interdépendants, liés les uns aux autres. Mais nous avons besoin que le monde nous aide et que, pour une fois, il agisse », martèle le médecin, sa colère emplie d’humanité.
mise en ligne le 11 mai 2025
Interroger les commencements
Maryse Dumas sur www.humanite.fr
Le 8 mai 1945, les armées nazies capitulent. Enfin ! L’Europe commence à panser ses plaies et le monde à s’imaginer en paix. Mais comment en est-on arrivés là ? Comment une telle catastrophe mondiale a-t-elle pu se produire ? Beaucoup a déjà été dit et écrit sur le sujet. Mais notre actualité exige de nous un travail plus approfondi sur la façon dont les nazis ont pu réussir à parvenir au pouvoir en Allemagne en 1933. Dans son essai remarquable titré « les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir ? » (Gallimard), Johann Chapoutot éclaire une partie de la réponse.
Il commence par bousculer nombre d’idées reçues : les nazis ne sont pas arrivés démocratiquement au pouvoir, Hitler n’a pas été élu par les Allemands. D’ailleurs, les nazis étaient en perte de vitesse dans les élections. Ni la crise, ni la gauche ne sont responsables de l’arrivée des nazis au pouvoir. Johann Chapoutot l’affirme. Cette prise de pouvoir résulte « d’un choix, d’un calcul, et d’un pari ». Le choix, c’est celui des élites économiques et patrimoniales. Le calcul, celui d’utiliser les nazis dans l’objectif de faire face au Parti communiste en progression continue ; le pari, celui d’une coalition censée permettre de domestiquer des nazis que l’on croyait inexpérimentés par des politiciens que l’on croyait aguerris.
C’est ce troisième volet qui porte les réflexions les plus neuves et les plus évocatrices. Les lectrices et lecteurs peuvent à juste titre être médusés par l’ampleur des correspondances, qui n’ont rien de fortuit, entre la gouvernance de la République de Weimar de 1933 et celle de la France d’aujourd’hui. L’auteur assume de se livrer à une « enquête qui se veut instruction, dans tous les sens du terme, que l’on pourra aussi lire comme un réquisitoire ».
Dans le long épilogue qui conclut l’ouvrage, l’historien fait part à la fois de sa démarche et des interrogations qu’elle a pour lui-même suscitées dès lors qu’elle l’amenait à constater des rapprochements de plus en plus évidents entre les deux périodes. Il se dit lui-même surpris par leur nombre et leur portée. Il se met à la place du lecteur critique qui trouvera tout cela « trop probant pour être honnête ». Il avoue s’être à lui-même adressé ces mises en garde tout au long de son travail. Contestant, à partir d’une argumentation fouillée, la notion « d’objectivité », il préfère se référer à l’exigence « d’honnêteté qui commande à l’historien d’instruire à charge et à décharge, et lorsqu’il compare, de faire le départ entre les similitudes et la différence des temps ».
Se livrant à une réflexion approfondie et stimulante sur le travail historique, ses méthodes et son apport dans la démocratie, il affirme : « Ce n’est pas parce que l’Histoire ne se répète pas que les êtres qui la font – qui la sont – ne sont pas mus par des forces identiques. » À cet égard, sa comparaison entre la Constitution de la République de Weimar et celle de 1958 en France est édifiante. Mais c’est l’ensemble du livre qui, page après page, démonte des mécanismes, s’intéresse aux forces politiques et économiques mais aussi aux comportements individuels sans en délaisser aucun. Un grand livre qui mérite bien la première place qu’il occupe actuellement dans les ventes d’essais en France. Un livre qui ouvre à de multiples réflexions et débats en particulier avec l’auteur. Ce à quoi vous invite l’Institut CGT d’histoire sociale le 15 mai, à 14 heures à Montreuil, ou par lien numérique. Soyons nombreuses et nombreux !
mise en ligne le 10 mai 2025
La fabrique de la haine
Pauline Londeix sur www.humanite.fr
Le vendredi 25 avril, Aboubakar Cissé, jeune homme malien de 22 ans, a été assassiné dans une mosquée dans le Gard, parce que musulman. L’auteur de ce crime s’est félicité de son acte islamophobe. Un tel crime aurait dû ébranler le pays, être le cri d’alarme qui nous réveille tous. Il aurait dû nous ouvrir les yeux collectivement sur les conséquences de la fabrique de la haine, quotidienne, omniprésente sur les plateaux télé, en marche depuis plusieurs décennies en France, ciblant des populations particulières et en particulier les personnes de confession musulmane.
Au lieu de cela, le ministre de l’Intérieur a attendu deux jours avant de se déplacer à Alès, sans aller jusqu’à se rendre sur les lieux de l’assassinat et refusant de rencontrer la famille de la victime. Une partie des députés de l’Assemblée nationale ont par ailleurs boycotté la minute de silence dédiée au jeune homme, minute de silence que la présidente de l’Assemblée nationale a dans un premier temps refusé de voir se tenir. Finalement celle-ci a eu lieu, sans pour autant que le caractère islamophobe du meurtre ne soit explicité.
Ce terme n’a pas plus été employé dans la majorité des médias français ou par les décideurs politiques. Et cela pose véritablement problème, tant nier le caractère spécifique d’une discrimination, ou tarder à condamner un tel acte ou à rendre hommage à la victime sont autant de violences symboliques pour les communautés touchées. Comme si la vie de cet homme – et celles des autres personnes musulmanes – comptait moins que celle des autres citoyens de ce pays.
La sociologue Kaoutar Harchi l’a analysé en ces termes au micro de France Culture le 30 avril : « C’est un attentat raciste et je crois que le mot n’a pas encore été prononcé : c’est un attentat islamophobe. Il me semble important d’insister sur ce terme-là, pour bien préciser que nous avons affaire à une question qui est d’ordre raciale, et pas à une question qui serait d’ordre confessionnelle ou théologique. (…) La spécificité de l’islamophobie, c’est qu’elle participe à produire une racialisation du religieux. (…) Il y a un principe d’infériorisation qui est immédiatement produit, qui mène par la suite à des pratiques discriminatoires ou à cet abominable meurtre. »
Kaoutar Harchi a ajouté : « C’est intéressant de voir à quel point certaines personnes, certains représentants politiques notamment, s’attachent à refuser, à rejeter, ce terme d’islamophobie. Il faut se mettre à la page. Il faut lire nos collègues sociologues, et voir à quel point ce terme est pleinement solide. Mais bien évidemment il n’est pas question uniquement de considération scientifique ou conceptuelle. Si le terme islamophobie est rejeté et critiqué, c’est aussi parce que politiquement il ne correspond pas à certains agendas politiques et aussi parce qu’on refuse de considérer la dimension raciale qui habite ces actes meurtriers. »
Est-ce donc cela le pays qu’est devenue la France ? Celui où on refuse la diversité et où on invite sur les plateaux télé et radio des personnes qui ciblent sans complexe des populations entières ? Qu’on ne s’y méprenne pas, aujourd’hui sont ciblés les musulmans, mais demain ce seront les autres, tous ceux qui ne sont pas dans la norme, tous ceux qui déplairont, tous ceux qui penseront différemment.
Je pense à toutes les personnes musulmanes dans ce pays, et j’aimerais leur dire qu’elles ne sont pas seules. Le rouleau compresseur médiatique qui s’est mis en place est effroyable, mais il n’est écrit nulle part qu’à la fin la haine l’emportera.
Face à la « banalisation de l’islamophobie », personnalités et associations appellent à un rassemblement d'ampleur à Paris le 11 mai
Tom Demars-Granja sur www.humanite.fr
Une marche est organisée place de la Bastille, dimanche 11 mai, en hommage à Aboubakar Cissé, un jeune homme de confession musulmane tué lors de sa prière dans une mosquée du Gard, le 25 avril dernier. Une centaine de signataires, composée d'intellectuels comme d'organisations politiques, appellent ainsi à « un sursaut » face à la radicalisation de l'islamophobie en France.
L’islamophobie tue. C’est pour prendre à bras-le-corps ce destin funeste, que des organisations politiques, des intellectuels, des artistes ou encore des associations appellent, à travers une tribune publiée lundi 5 mai par l’hebdomadaire Politis, à une marche de grande ampleur, dimanche 11 mai, à partir de 14 heures, place de la Bastille (Paris). Les attaques envers la communauté musulmane ont beau être légion depuis de nombreuses années, il a fallu le meurtre d’Aboubakar Cissé, un jeune homme âgé de 22 ans violemment tué lors de sa prière dans une mosquée du Gard, le 25 avril dernier, pour que le phénomène revienne sur le devant de la scène.
Une centaine de signataires ont ainsi pris position à travers cette tribune, du Comité Adama à la France insoumise (LFI), en passant par le collectif juif décolonial Tsedek !, le parti Révolution permanente ou le collectif Relève féministe, pour les organisations. Côté personnalités, la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, la comédienne et figure du mouvement #MeToo Adèle Haenel, le porte-parole de la Jeune garde Zine-Eddine Messaoudi ou encore le président de la mosquée de Pessac Abdourahmane Ridouane ont apporté leur soutien au texte.
Dénoncer le « déni des représentants politiques »
Toutes et tous le rappellent : « Cette décision, au fond, le tueur ne l’a pas prise tout seul. Cet assassin vit en France, où des membres des gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’alimenter l’islamophobie et des scores à deux chiffres du Rassemblement national. » C’est pourquoi cette marche du 11 mai doit être, selon les organisateurs, « à un sursaut, un réveil », espère Amal Bentounsi, figure de la lutte contre les violences policières parmi les voix à l’initiative de la marche, auprès de l’Agence France-Presse (AFP).
Fondatrice du collectif Urgence notre police assassine, elle dénonce le « déni des représentants politiques » face aux actes de haine à l’encontre de la communauté musulmane. Yassine Benyettou, secrétaire national du collectif RED Jeunes et coorganisateur de la marche, déplore de son côté « une peur constante » qui grandit au sein de la communauté musulmane.
Il estime que la « parole décomplexée » d’une partie de la classe politique alimente un climat antimusulman dans le pays, et « porte atteinte à la sécurité d’une partie de la population française ». Des saillies du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau – qui a annoncé vouloir dissoudre les collectifs Urgence Palestine et la Jeune garde -, au projet politique raciste du Rassemblement national (RN), en passant par l’offensive identitaire menée par le groupe Bolloré (CNews, anciennement C8, Europe 1, etc.), la communauté musulmane est devenue l’une des cibles systématiques des champs médiatique et politique.
Les organisateurs de la marche appellent l’ensemble des forces politiques, religieuses et de la société civile à s’unir pour lutter contre le racisme antimusulman. « Il faut que tout le monde prenne part au combat pour protéger les musulmans de France » face à une « banalisation de l’islamophobie », assure Sofia Tizaoui, secrétaire syndicale de l’Union syndicale lycéenne, également à l’initiative de la mobilisation. « On appelle toute la population française à se rassembler, pas seulement les musulmans », poursuit la lycéenne.
Lors d’une conférence de presse organisée mardi 6 mai, la présidente du groupe insoumis à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a indiqué que les élus et militants de son mouvement seront « évidemment mobilisés » dimanche. « Les absents brilleront par leur absence », lance Amal Bentounsi, dénonçant certains responsables politiques qui « pointent du doigt les musulmans à des fins électoralistes ».
« La marche doit être pour la paix », affirme de son côté Yassine Benyettou. Ce dernier qui aspire à rassembler dimanche « toutes les communautés pour faire bloc ensemble » et défendre les « valeurs humanistes ».
mise en ligne le 10 mai 2025
À front renversé
Maurice Ulrich sur www.humanite.fr
Quatre-vingts ans après la victoire des Alliés et des peuples sur le nazisme et les fascismes, l’histoire semble s’écrire à front renversé. L’image la plus symbolique pourrait en être le salut nazi de l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, considéré à ce moment-là comme le coprésident du pays le plus puissant du monde.
La réalité la plus tragique, la plus douloureuse aussi de ce renversement, ce pourrait être la volonté de Netanyahou et des fascistes qui le soutiennent, à la tête du pays créé après la « solution finale », d’en finir avec Gaza et les Palestiniens qui y vivent encore dans les conditions catastrophiques dont s’insurge une part de l’opinion mondiale, mais qui ne semblent pas troubler nombre des « grands » du monde. Le retournement encore, c’est la Russie où Poutine entend se réclamer cyniquement du rôle majeur de l’URSS dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, au prix de 25 millions de morts, pour justifier l’agression de l’Ukraine.
En France même, les dirigeants du Rassemblement national, continuateurs d’un parti créé par des SS, se prétendent lavés d’un antisémitisme obsessionnel et fondateur, remplacé par la haine des musulmans et des immigrés. La droite se sent pousser des ailes depuis la victoire de Trump et entend discréditer, sous l’étiquette du « wokisme », toutes les opinions progressistes comme ce qui reste de l’héritage du Conseil national de la Résistance, mis à mal par les politiques libérales, de Mitterrand à Macron.
Dans ce monde, les États-Unis semblaient pour beaucoup, même à tort, un pôle de référence de la démocratie et de la modernité. Depuis le retour à la présidence de Trump, ils font peur. Leur rivalité avec la Chine fait planer la menace d’un affrontement dont les conséquences pourraient être incommensurables, alors que le rôle de l’ONU est bafoué aussi bien par les Russes que par les Américains. Un nouveau foyer de tension a repris entre l’Inde et le Pakistan. Le nouveau pape Léon XIV, américain de naissance et qui semble conscient du désordre du monde, en a appelé à la paix. Albert Camus avait dit que plus que refaire le monde, notre tâche était d’empêcher qu’il ne se défasse. Sans doute nous devons mener les deux de front.
mise en ligne le 9 mai 2025
« Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie » de Benoît Trépied :
« Je n’imagine pas cette jeunesse qui s’est insurgée accepter un accord qui mène à autre chose
qu’une accession à la souveraineté »
Benjamin König dsur www.humanite.fr
« Aller chercher Kanaky » : l’expression que reprend l’auteur est celle que la jeunesse indépendantiste kanak a adopté comme mot d’ordre, sur les barrages et ailleurs. Comment faire, alors que l’État français répète les mêmes erreurs et que la société calédonienne paraît fracturée ? Voici tout l’enjeu et l’intérêt de cet ouvrage, véritable somme de la pensée de Benoît Trépied.
Benoît Trépied est anthropologue au CNRS, auteur de « Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie » (Anacharsis, 288 pages, mars 2025)
« Pour la première fois, la République française a reconnu officiellement, dans la Constitution, qu’il y avait un territoire en voie de décolonisation : ce n’est pas un discours militant, mais un point de vue officiel. »
Un an après le début des révoltes qui ont embrasé la Kanaky-Nouvelle-Calédonie (KNC), dont Benoît Trépied est spécialiste, l’anthropologue analyse dans un nouvel ouvrage le bouleversement que constitue cet événement majeur. Son livre permet de mieux en saisir les dynamiques en s’inscrivant dans le double registre du temps long, afin de comprendre la civilisation kanak, et les évolutions de la société calédonienne, marquée par une colonisation de peuplement et une diversité ethnique et culturelle.
Au fond, pourquoi est-il est nécessaire de décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ?
Benoît Trépied : Tout simplement parce que, sinon, les affrontements et la guerre vont reprendre, parce que les Kanak ne renonceront jamais à cette exigence de décolonisation : ils ont cela chevillé au corps, car ça renvoie à un traumatisme d’aliénation coloniale qui s’est transmis de génération en génération. Jean-Marie Tjibaou l’avait dit à son époque : « La paix s’appelle Indépendance Kanak ». Tout l’enjeu est de savoir quel type de décolonisation le pays va suivre. Est-ce qu’il est possible d’inventer une nouvelle forme de décolonisation inclusive, qui permette aux non-Kanak d’avoir une place, et laquelle ? La question est aussi : est-ce que la France va réussir à décoloniser ? Sans décolonisation, il n’y aura pas de paix, et le pays risquera d’exploser encore et encore.
Quelle serait une décolonisation souhaitable pour la France, même si bien sûr les premiers concernés sont les Kanak et les Calédoniens ?
Benoît Trépied : C’est une décolonisation pacifique qui sorte par le haut du contentieux colonial. C’est l’intérêt de la France pour son image dans le monde, car elle a quand même un sacré passif en la matière. Elle peut être à la hauteur de cet enjeu, ce qu’elle n’a jamais montré, même si ce que Michel Rocard avait tracé était prometteur. Mais dans les instants fatidiques du 3e référendum, les vieux démons sont ressortis : c’était un choix politique. Ça veut dire trouver une forme de décolonisation dans la négociation et la discussion, plutôt que dans un contexte de libération violent, qui crée des dommages irrémédiables. Il existe un projet inclusif à la fois avec le peuple kanak et les autres, qui donne une place aux Caldoches, aux Wallisiens, qui reflète ce qu’est le pays aujourd’hui : une mosaïque.
Une partie des Calédoniens, et notamment la droite, ne l’ont pas compris et ne veulent pas l’entendre…
Benoît Trépied : Tout le problème est là : avoir pensé la période des accords comme permettant de rester dans ses façons de vivre, en donnant aux Kanak les provinces Nord et des îles, un drapeau, etc., mais sans changer les règles du jeu. Ça n’est plus possible aujourd’hui et, à certains égards, j’espère que ce qu’il s’est passé dès le 13 mai 2024, dans tout l’aspect dramatique que cela revêt, a permis à certains d’ouvrir les yeux. L’élection d’Emmanuel Tjibaou en est un indice. Ensuite, la question est : est-ce que la décolonisation veut dire l’indépendance ? Si oui, quel type d’indépendance, c’est-à-dire quel recouvrement de pleine souveraineté ? C’est une question ouverte, qui laisse un espace politique pour trouver un point d’accord.
Vous replacez dans votre livre l’histoire récente de la KNC dans un temps long : pourquoi cela vous a-t-il paru nécessaire ?
Benoît Trépied : Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c’est que je crois fondamentalement, parce que c’est mon métier, que les phénomènes politiques contemporains s’inscrivent dans des dynamiques historiques. On ne peut pas comprendre le 13 mai sans comprendre l’histoire coloniale de long terme. Deuxièmement, j’ai voulu réexpliquer que l’histoire de la Calédonie ne commençait pas avec la venue des Français en 1853, ou en 1774 avec James Cook, car cela représente à peine 10 % de l’histoire humaine du pays. Pour comprendre la force de la revendication kanak, l’assise de cette légitimité, il faut comprendre qu’ils sont les héritiers d’une civilisation de trois mille ans. Cela permet de relativiser l’exceptionnalité de la période récente. On a vu avec le 13 mai que les gens continuaient de parler du contentieux colonial, de faire référence aux trois mille ans d’histoire, à l’autochtonie au sens philosophique du terme. C’est une illusion de croire qu’on peut balayer ça d’un revers de main ou à l’aune de formalités juridiques, comme le 3e référendum ou le vote de la majorité à l’Assemblée nationale. Parce qu’en face de ça, on est dans l’histoire longue d’un peuple.
Il y a l’enjeu colonial, mais aussi ces trois mille ans d’histoire : quelle est la dynamique entre cette histoire et la situation actuelle ?
Benoît Trépied : Les Kanak eux-mêmes ont beaucoup valorisé la culture kanak, et ça a été une arme forte de leur engagement politique. Il y a plusieurs façons d’aborder cette culture, mais il s’agit de prendre ces éléments de culture comme des choses dynamiques et qui se transforment. Le monde kanak d’aujourd’hui est à la fois dans des formes d’héritage et de continuité. Il y a une progression de l’idée d’égalité. C’est un monde dynamique, ancré dans des logiques à la fois de groupe familiaux larges, d’échanges, de réciprocité, du clan, des chefferies, avec des enjeux forts autour de la culture de l’igname, du taro, de l’horticulture, des terroirs. En même temps, ce monde a été profondément transformé ; il a créé une unité consciente et politique qui n’existait pas. Il a aussi créé des gens qui habitent en ville, des gens qui ne parlent plus leur langue, mais qui se sentent aussi kanak. Il a renouvelé ce que ça veut dire qu’être kanak.
Le mot lui-même est d’ailleurs récent…
Benoît Trépied : Oui, il est allochtone au départ, réapproprié et retourné. Cette vision dynamique de l’identité kanak était le cœur de la pensée de Jean-Marie Tjibaou, qui reste un phare intellectuel de la lutte kanak, et qui disait que le retour à la tradition est un mythe, et que « Nos pères et nos grand-père ont vécu des réalités que je ne vivrais pas : notre identité est devant nous ». Cela permet d’inclure d’autres gens, c’est une ouverture.
Pour en revenir à des choses plus récentes, pourquoi l’accord de Nouméa a-t-il constitué une avancée, et quelles en sont les limites avec le recul ?
Benoît Trépied : Pour la première fois, la République française a reconnu officiellement, dans la Constitution, qu’il y avait un territoire en voie de décolonisation : ce n’est pas un discours militant, mais un point de vue officiel. Cet accord a tenté d’inventer une solution originale pour répondre à un nœud colonial complexe, lié à la politique de colonisation de peuplement, donc à la minorisation des Kanak, face à la charte des Nations unies, au droit des peuples à disposer d’eux mêmes. La confrontation de ces deux points de vue tendait la situation et l’accord de Nouméa a essayé d’en sortir par le haut, en conjuguant les légitimités. Il y a deux tensions coloniales qui se croisent : le rapport à la France et la place des Kanak au sein de la société calédonienne.
Ce qui s’en approche le plus est l’idée de « nation arc-en-ciel » à la Nelson Mandela. Les limites, c’est que cette politique de la main tendue des Kanak n’a pas été saisie par tout le monde. Et comme les accords étaient aussi un compromis qui reposait sur un partage du pouvoir avec la création des provinces, cela a permis au RPCR, aux loyalistes durs, de se replier et de conserver leur logique colonialiste, sur la province Sud et sur Nouméa en particulier. Au fil des accords, alors même qu’on a vu cette ce fameux destin commun émerger dans certaines zones du Nord, où les Caldoches ont compris qu’il y avait une place pour eux dans le projet des Kanak, au contraire dans le Sud c’est resté très fermé de ce point de vue. Et ce n’est pas un hasard si c’est à Nouméa que ça a pété, avec une logique de ségrégation.
Un an après le 13 mai, avec un peu plus de recul, comment analysez-vous ce qui s’est passé ?
Benoît Trépied : Je pense qu’on manque encore de recul. On ne sait pas vraiment tout ce qui s’est passé, tout ce qui s’est joué, on ne connaît pas les rouages. Il y a cette question pendante des formes d’instrumentalisation de cette violence. Je m’y rends bientôt pour enquêter sur ce sujet. C’est d’abord une révolte politique liée à cette question du dégel du corps électoral et de la volonté de l’État depuis 2021 de s’allier avec les loyalistes et de passer en force, et une méconnaissance de l’importance du sujet. Cela signifiait perpétuer le mécanisme de la colonisation de peuplement. La CCAT a réussi à mobiliser beaucoup de manifestants avant le 13 mai, notamment avec la manifestation à l’Anse Vata, à Nouméa. Et puis il y avait aussi un enjeu social, puisqu’on savait depuis longtemps que, du fait que la décolonisation se soit arrêtée aux portes de Nouméa, ces tensions sociales et ces inégalités en faisait une cocotte-minute prête à exploser. Il suffisait d’une étincelle. L’immense responsabilité de l’État, c’est d’avoir fait fi des avertissements.
Le résultat des législatives de juillet ne traduit-elle pas cette ambivalence, cette tension, avec d’un côté l’élection d’Emmanuel Tjibaou, de l’autre celle de Nicolas Metzdorf, un loyaliste extrémiste ?
Benoît Trépied : Je pense que c’est l’événement le plus important depuis le 13 mai : deux mois après qu’Emmanuel Tjibaou a été élu dans la 2e circonscription, c’est totalement inattendu et ça dit quelque chose de l’attachement des gens au destin commun qu’il incarne, qui a toujours dit qu’il ne voulait pas l’indépendance sans les autres, qui est un homme de dialogue. S’il a remporté cette circonscription ingagnable, c’est parce que les Kanak se sont mobilisés, mais aussi que des non-Kanak ont voté pour lui : tous ceux qui étaient mal à l’aise avec cette montée des périls. Il y avait aussi des jeunes Océaniens sur les barrages ; il existe des formes de solidarité de classe ethno-sociales, car ceux qui sont toujours en bas de l’échelle sont les Kanak et les Océaniens.
De son côté, Nicolas Metzdorf a changé de circonscription, parce qu’il se savait menacé en brousse avec son discours extrême. Il n’a pas du tout remporté haut la main sa circonscription, puisqu’il a été élu avec 3 000 voix d’avance. L’élection d’Emmanuel Tjibaou montre que la compréhension des causes de l’éruption de cette violence a été assez partagée. C’est un indice qu’il y a la possibilité d’un basculement des rapports de force. Le plus frappant est que cette victoire se fait avec un corps électoral dégelé ; ce n’est donc pas un argument décisif pour remporter les élections. Ça prouve que le pays a brûlé pour rien et que si les Kanak se mobilisent, ils sont majoritaires.
mise en ligne le 9 mai 2025
« La France est exposée
au scénario
qui a vu gagner Trump »
Fabien Escalona sur www.mediapart.fr
Avec « Le Miroir américain », le journaliste Cole Stangler met en garde contre les risques d’une dégradation de la démocratie française, non pas identique mais analogue à celle qui frappe de l’autre côté de l’Atlantique. Il appelle la gauche à défendre « des avancées concrètes et rapidement visibles ».
Cole Stranger, journaliste franco-américain et auteur de l’enquête sur la radicalisation des droites françaises et américaines, « Le Miroir américain », aux éditions Les Arènes.
En dépit du caractère hors norme de la grande parade trumpiste, la France est peut-être le pays européen qui a le plus à apprendre des évolutions de la vie politique aux États-Unis. C’est la conviction du journaliste Cole Stangler, qui a publié mercredi 7 mai Le Miroir américain. Enquête sur la radicalisation de la droite et l’avenir de la gauche (éditions Les Arènes).
Lui-même franco-américain, bien placé pour constater les différences qui séparent les deux formations sociales, il souligne aussi les ressemblances qui les rapprochent, et participent des « échos » qu’il a perçus de part et d’autre de l’Atlantique lors de ces dernières années.
« Même si elles n’ont pas réussi à réaliser pleinement leurs promesses, écrit-il, nos deux républiques sont des modèles d’universalisme qui ont inspiré d’innombrables luttes […]. Les États-Unis et la France se sont tous les deux construits sur l’immigration, avec des identités nationales modelées par l’arrivée de personnes venues d’ailleurs et de cultures façonnées par le brassage et la mixité […]. Et ici comme là-bas, la grandeur de nos mythes fondateurs nous empêche parfois de voir les moments sombres de nos histoires respectives. »
Ces mythes et leurs angles morts participent, aujourd’hui, d’une attractivité électorale de démagogues d’extrême droite qui nous serait apparue sidérante il y a quelques années. C’est pour comprendre de manière sensible cette attractivité, et en creux les obstacles rencontrés par la gauche, que Cole Stangler a sillonné les États-Unis en 2024. Son livre est le récit de ses rencontres, rapprochées d’entretiens antérieurs réalisés en France et de travaux académiques qui éclairent son propos.
Mediapart : Votre ouvrage s’ouvre sur les conséquences politiques de la désindustrialisation, aux États-Unis comme en France. Comment les décririez-vous ?
Cole Stangler : Il existe bien sûr de la détresse sociale dans les grandes villes et les campagnes, mais celle qui est vécue dans les zones désindustrialisées est spécifique, dans la mesure où les gens ont connu autre chose, ou du moins leurs parents. Ils vivent non seulement la souffrance sociale, parce qu’il y a moins d’emplois et que ces emplois sont précaires, mais ils savent aussi très bien qu’il y a vingt ou trente ans, l’endroit était plus prospère, offrait d’autres perspectives de vie. On retrouve cela dans la Rust Belt [« ceinture de rouille », surnom de la zone de déclin de l’industrie lourde américaine dans le Nord-Est – ndlr] aux États-Unis, comme dans le nord et l’est de la France.
Politiquement, cette configuration a des conséquences importantes, parce qu’elle favorise chez de nombreuses personnes une forme de nostalgie et de rancœur. Elles reprochent à l’État de les avoir abandonnées, ou d’avoir été complice du processus qui a conduit au déclin économique du territoire. Ce déficit de confiance envers la puissance publique est un fort moteur de décrochage vis-à-vis du monde politique, et donc d’abstention.
Dans beaucoup de ces zones, les classes populaires qui votent le font davantage en faveur de l’extrême droite que de la gauche. Pour le comprendre, il faut regarder le bilan de cette gauche, ainsi que ses choix politiques. Aux États-Unis, la perte d’audience des démocrates dans les milieux populaires ne résulte pas d’une fatalité, mais de la décision consciente de donner la priorité à d’autres électeurs. Et puis c’est bien connu : en contexte économique dégradé, on recherche facilement des boucs émissaires. Le Parti républicain et le Rassemblement national (RN) ont trouvé le leur : l’immigré.
On sent aussi que la politisation à droite de ressentiments et de préjugés est rendue possible par le caractère « impensable » d’une alternative économique et sociale. On le comprend aisément après la présidence de François Hollande en France, mais le bilan de Joe Biden n’était-il pas plus substantiel ?
Cole Stangler : J’ai en effet beaucoup rencontré le sentiment que l’économie était un sujet trop complexe pour être changé politiquement. La gauche de gouvernement, en ralliant les politiques « pro-capital » de l’ère néolibérale, à partir des années 1980, a favorisé ce sentiment. Par conséquent, elle a aussi permis à la conflictualité politique de se déplacer sur d’autres terrains, notamment celui des « guerres culturelles ».
Aux États-Unis, celles-ci se sont typiquement déployées à propos des armes à feu, de la place de la religion dans la société, des droits des homosexuels et des droits à l’avortement. Les offensives contre le « wokisme », qui se sont aussi déclinées en France ces dernières années, s’inscrivent dans cette veine.
Les États-Uniens ont entendu beaucoup de promesses et de grands chiffres, mais dont les effets sont encore impalpables. Et, entre-temps, ils ont subi une inflation violente.
Alors oui, il y a eu du changement sous Biden, avec de l’investissement dans les infrastructures et une tentative de réindustrialisation « verdie ». Le problème, c’est que ces politiques prennent du temps et ne rompent que partiellement avec le legs néolibéral.
C’est ce que je montre à travers le cas d’un bassin sidérurgique en Virginie-Occidentale, qui s’est complètement étiolé, et en face duquel une usine de batteries électriques a été financée grâce aux programmes de l’administration Biden. Or cette usine ne comptera pas autant d’emplois, ils n’ont pas encore tous été créés, et rien ne garantit qu’ils auront la même « qualité » en termes de droits des salariés.
En résumé, les États-Uniens ont entendu beaucoup de promesses et de grands chiffres, mais dont les effets sont encore impalpables. Et, entre-temps, ils ont subi une inflation violente, tandis que les mesures de Biden les plus appréciées du public, après le covid, ont pris fin, au motif qu’elles avaient été pensées comme temporaires.
Revenons au mouvement de radicalisation de la droite, que vous observez de part et d’autre de l’Atlantique. Vous insistez sur les sources anciennes du phénomène, masquées par les figures de droite les plus « traditionnelles » pendant des années.
Cole Stangler : Trump et le trumpisme ne viennent clairement pas de nulle part. On peut citer des prétendants malheureux à la présidentielle, qui ont assemblé des ingrédients encore bien présents aujourd’hui.
Je pense à George Wallace, à la fois très critique de la guerre du Vietnam et défenseur de la ségrégation au tournant des années 1960-70. Je pense aussi à Pat Buchanan, candidat à la primaire républicaine de 1992, durant laquelle il fit campagne contre le multiculturalisme et le libre-échange, tout en mobilisant une base de chrétiens évangéliques autour des guerres culturelles. À la convention du parti, il évoqua une « bataille pour l’âme de l’Amérique » dans un discours perçu comme extrême, mais devenu la norme aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier non plus la présidence de George W. Bush (2000-2008). Déjà à l’époque, il avait contesté le recomptage des voix en Floride, et des militants étaient parvenus à empêcher les opérations par leur pression physique. Lui aussi soutenu par une base religieuse évangélique, il a provoqué des dégâts immenses avec sa « guerre contre le terrorisme » (l’invasion d’un pays souverain, la pratique de la torture en dehors des conventions internationales) et avait souhaité passer une loi radicale contre l’immigration.
Dans le cas français, le RN qui menace d’arriver au pouvoir est dans le paysage depuis cinquante ans. Sa progression s’est également faite grâce à une conjonction de facteurs de longue durée : les préjugés et les discriminations qui circulaient déjà dans la société ; la désindustrialisation, qui a favorisé la bascule des milieux populaires ; et des attentes plus fortes encore envers l’État dans ce pays, qui ont nourri des déceptions à la hauteur. Sans compter la contribution active de la droite classique à faire de l’immigration et de l’identité des enjeux de campagne permanents.
Le parallèle entre le Parti républicain aux États-Unis et le RN en France tient-il jusqu’au bout ? Le RN pâtit encore, même si c’est de moins en moins le cas, d’être issu des marges du système politique.
Cole Stangler : Peut-être, mais nos deux pays ont un système présidentiel dans lequel l’électorat est sommé de choisir entre deux camps, ou du moins entre deux options finales dans le cas de la présidentielle en France. Les effets peuvent être dévastateurs, même quand la société n’est pas majoritairement située à l’extrême droite.
C’est ce qui est intéressant et troublant avec les électeurs de Trump : certains ne sont pas d’accord avec tout et pointent même ses excès, mais ils l’ont choisi plutôt que Kamala Harris. Trump se retrouve à prendre des décisions très radicales mais avec un taux d’approbation historiquement faible pour un président, alors qu’il vient d’être réélu avec plus de voix que son adversaire.
La France est exposée à ce genre de scénario. Dans le livre, je cite une propriétaire de restaurant qui me dit que la gauche est une option impossible pour elle. Le Pen, Bardella… : elle se fiche de l’identité du candidat RN mais sait qu’elle votera pour une candidature clairement « antigauche ».
Les gauches françaises se cherchent encore dans leur attitude vis-à-vis de médias comme CNews. Les progressistes états-uniens, confrontés précocement à des médias de masse porteurs de désinformation et d’idées d’extrême droite, ont-ils des leçons à partager ?
Cole Stangler : Honnêtement, je ne sais pas s’il y a grand-chose à prendre. À ce stade, de plus en plus de journalistes à gauche ont estimé qu’il fallait construire d’autres médias non traditionnels pour combattre des chaînes ultraconservatrices comme Fox News. Il en résulte une fragmentation de l’espace médiatique particulièrement prononcée, avec des podcasts, des lettres d’information sur Substack, des chaînes YouTube…
C’est une évidence absolue que pour gagner, la gauche doit mobiliser de larges pans des milieux populaires par-delà les espaces géographiques, qu’ils soient très urbanisés ou plus ruraux.
Il y a bien eu la tentative de bâtir un Fox News de gauche, avec MSNBC, mais ses dirigeants ne sont pas parvenus à imiter le style populiste qui a fait le succès de la première. Ils ont repris les codes des classes moyennes supérieures dans les grandes villes, qui les cantonnent à un certain public. Cette question du « style » est trop négligée en France pour comprendre l’attrait de ces chaînes. Si on ne fait que répéter qu’elles mentent, on ne parviendra pas à contrer leur succès.
Un débat stratégique s’est esquissé entre François Ruffin, alertant sur la faiblesse de la gauche dans « la France des bourgs », et les Insoumis, théorisant l’existence d’un « quatrième bloc » abstentionniste à mobiliser pour emporter des élections. Là encore non sans échos avec les États-Unis. Quelles conclusions tirez-vous de vos propres recherches et rencontres ?
Cole Stangler : Dans son dernier livre, Jean-Luc Mélenchon écrit que « la conscience politique urbaine est la forme de conscience politique la plus avancée ». Malgré la tonalité radicale du langage, cela me fait penser aux stratégies du Parti démocrate en 2016, lorsque les stratèges expliquaient que chaque voix perdue dans la Rust Belt allait être gagnée en banlieue ou dans les villes.
Pour moi, c’est une évidence absolue que pour gagner, la gauche doit mobiliser de larges pans des milieux populaires par-delà les espaces géographiques, qu’ils soient très urbanisés ou plus ruraux. Pour transcender ces frontières, le discours de Bernie Sanders est resté le même depuis des années : un programme universaliste pour défendre les intérêts du plus grand nombre, en mettant en avant les questions sociales et en affirmant simultanément qu’une attaque contre une personne, que ce soit en raison de ses origines, de son apparence ou de son orientation sexuelle, est une attaque contre tous.
Ce qui me donne espoir, c’est le renouveau du syndicalisme aux États-Unis, même si la tendance est encore modeste. Il est intéressant d’observer les résistances salariales permises par les campagnes de syndicalisation dans le sud des États-Unis, dans les usines installées en raison du coût du travail moins élevé que dans les États du nord avec un passé syndical plus fort. Cela a suscité des réactions très violentes chez les républicains, ce qui montre bien qu’ils le vivent comme une menace.
Un pays davantage syndiqué est un pays dans lequel les classes populaires ont des valeurs plus ancrées à gauche, et il s’agit de développer ce militantisme dans de nouveaux secteurs, comme ceux de la logistique et de la distribution. L’enjeu est semblable en France : j’ai été marqué par ma rencontre avec un jeune syndicaliste qui travaillait chez Amazon au sud de Montélimar, dans une zone commerciale qui a quelque chose de très américain. Il doit braver l’isolement des employés, le turnover, etc.
La réponse stratégique de fond, au-delà du marketing électoral à chaque scrutin, consiste bien à retisser le lien à la base. C’est un travail de longue haleine, peu spectaculaire mais finalement plus important que tel ou tel slogan ou telle ou telle alliance, en tout cas sur le long terme. Les liens de confiance vous rendent en effet plus enclin à écouter des messages progressistes, parce qu’ils sont émis ou relayés par des gens qui vous ressemblent, vous connaissent et vous défendent.
mise en ligne le 8 mai 2025
Au Cachemire indien :
« Ils parlent tous de guerre, mais ils ne savent pas ce qu’elle coûte »
Côme Bastin et Haziq Qadri sur www.mediapart.fr
Depuis la suppression de l’autonomie politique de leur État en 2019, les Cachemiris espéraient au moins vivre en paix. Mais le retour des armes et de la suspicion à leur égard ravivent les traumatismes du passé. « Nous sommes redevenus des cibles », témoigne un habitant.
Bangalore (Inde).– À Tiwari, village situé dans le district d’Uri, l’angoisse monte crescendo. Celle de perdre la paix fragile qui avait prévalu récemment sur la ligne de contrôle, cette zone frontalière disputée entre l’Inde et le Pakistan. « Depuis quelques années, la vie était paisible et on pouvait vivre comme tout le monde. Il n’y avait ni tirs ni bombardements d’un côté ou de l’autre, témoigne Mohammad Haneef, paysan de 38 ans. Mais depuis ce mois-ci, on recommence à vivre dans la peur, personne ne sait ce qui va se passer. L’Inde et le Pakistan doivent s’asseoir ensemble et résoudre leurs différends. »
Son témoignage, comme tous les autres, a été rapporté à Mediapart à distance, les journalistes étrangers étant strictement interdits au Cachemire.
Ce village a souvent été pris entre les feux croisés des deux armées, en conflit sur leur frontière dans le Cachemire depuis la naissance de l’Inde et du Pakistan, lors de la partition, en 1947. Après quatre affrontements majeurs au XXe siècle, les deux pays se sont livrés à d’incessantes escarmouches. Tantôt des accrochages directs à la frontière, tantôt des tirs de missiles ou des bombardements en réponse à des incursions, l’Inde accusant le Pakistan d’héberger et de soutenir des groupes insurgés menant des exactions sur son sol. Selon le South Asia Terrorism Portal, près de 5 000 Cachemiri·es ont été tué·es lors de ces affrontements ces vingt-cinq dernières années.
Un cessez-le-feu sur la ligne de contrôle, conclu en février 2021, avait cependant amené un peu d’espoir, notamment dans la région d’Uri. « Nous sommes sortis des bunkers civils dans lesquels nous nous étions longtemps réfugiés, nous avons commencé à reconstruire nos maisons, c’était comme un rêve devenu réalité », décrit Ghulam Rasool, père de famille de 51 ans, qui vit dans une maison en bois à Tiwari. « Mais depuis l’attaque à Pahalgam, tout a changé pour nous. Nous sommes redevenus des cibles. Tout le pays parle de guerre, mais ils ne savent pas, comme nous, ce qu’elle coûte. »
Le 22 avril, l’Inde a été saisie d’effroi. Dans la région de Pahalgam, les températures clémentes d’avril invitaient les touristes à profiter des vallées verdoyantes du Cachemire. C’est là qu’un groupe baptisé Le Front de résistance (The Resistance Front, TRF) choisit ce jour-là de mener un attentat sanglant. Vingt-six touristes sont abattus froidement par les assaillants, du jamais-vu en Inde depuis les attaques terroristes de Bombay, en 2008. TRF affirme agir pour défendre les droits des locaux face aux « envahisseurs » du reste de l’Inde. Une référence à la suppression de l’autonomie politique du Cachemire en 2019 par Narendra Modī.
L’Inde affirme rapidement que TRF est en réalité une émanation du Lashkar-e-Tayyiba, groupe islamiste armé militant pour le rattachement du Cachemire au Pakistan, accusé d’incursions et d’attaques fréquentes du côté indien de la frontière. L’attentat réactive en quelques jours les tensions entre New Delhi et Islamabad, accusé de tolérer, voire d’encourager l’action de tels groupes insurgés.
Vivre avec la peur
Le Pakistan, comme à son habitude, nie en bloc ces accusations, et l’Inde menace d’une intervention militaire, faute d’excuses et de coopération dans l’enquête sur les attentats. Avant même que les armes ne reprennent, mercredi 7 mai, les Cachemiri·es voient revenir la suspicion et la répression brutale à leur égard.
À Pulwama, au sud du Cachemire, de nombreuses maisons ont été dynamitées par l’armée le 26 avril. Motif : un complice des attentats serait issu de ce village. « L’armée est arrivée à 7 heures du matin et nous a demandé d’évacuer la maison. Nous sommes restés plusieurs heures dans la mosquée et lorsque nous sommes sortis, les maisons étaient en ruine », raconte Abdul Rashid, un habitant de 68 ans.
Ces représailles indiscriminées, à la dynamite ou au bulldozer, sont de plus en plus fréquentes, pour marquer les esprits, bien qu’elles échappent à tout cadre légal. « Si un habitant est impliqué, pourquoi s’en prendre à tous ses voisins ?, demande Abdul Rashid. Pourquoi même s’en prendre à ses parents ? Ce ne sont pas eux qui l’ont poussé à rejoindre ces militants. »
Dans la ferveur nationaliste qui s’empare de l’Inde, où une union sacrée s’est formée autour de la nécessité de punir le Pakistan, la lutte contre les terroristes laisse peu de place aux considérations pour le sort des populations locales. Dans la nuit du 7 mai, l’Inde a finalement mis ses menaces à exécution.
Une opération militaire d’envergure a frappé, principalement par les airs, neuf cibles désignées comme des camps d’entraînement terroristes au Pakistan. Islamabad a juré de répondre à cette « déclaration de guerre » et a fait pleuvoir son artillerie sur la ligne de contrôle. Bilan : au moins vingt-six morts côté pakistanais et douze côté indien.
Pour les locaux, c’est l’enfer. « À 1 heure du matin, nous avons été réveillés dans la terreur par des bruits de roquette assourdissants, témoigne Bilal Ahmad, 35 ans, habitant de la région frontalière de Karnah, au nord du Cachemire. En regardant les réseaux sociaux, nous avons compris que notre armée avait finalement attaqué le Pakistan, qui effectuait des tirs de représailles. »
Terré toute la nuit, Bilal Ahmad constate au petit matin que de nombreuses maisons ont été détruites dans les affrontements. « Mon père est mort en 2003 après un bombardement similaire de la part du Pakistan. Mais ce que j’ai vécu cette nuit-là, moi, je ne l’avais jamais vu de ma vie. Nous savons qu’il va nous falloir vivre à notre tour avec cette peur. »
Des Cachemiri·es fuient déjà les zones frontalières devant la guerre qui se déploie, soit vers des abris souterrains, soit vers des zones plus sûres. Un scénario que les habitant·es de Tiwari, quelques jours avant ce déluge de feu, confiaient redouter plus que tout. « Les écoles vont fermer, on va devoir quitter nos maisons à nouveau et retourner dans les bunkers, vers une vie misérable, pressentait Ghulam Rasool, qui dit avoir honte pour ses enfants. Ils nous en veulent de vivre ici, ils veulent vivre en ville, là où il y a des marchés et des restaurants. »
Pour la plupart de ces habitant·es pauvres et paysans, déménager est néanmoins impossible. « Sommes-nous moins que des êtres humains ? Ne méritons-nous pas, nous aussi, une vie normale ? », demande Mohammad Haneef.
mise en ligne le 8 mai 2025
Nicolas Offenstadt, historien : « Le 8 mai est loin d’avoir une mémoire paisible »
Aurélien Soucheyre sur www.humanite.fr
À l’occasion des 80 ans de la capitulation nazie, l’historien Nicolas Offenstadt, chroniqueur à l’Humanité, revient sur ce que symbolise cette date à travers plusieurs dimensions.
Nicolas Offenstadt, est un
historien français, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université Panthéon-Sorbonne.
Nous avons célébré, ce 8 mai, les 80 ans du 8 mai 1945, jour de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie. Pourquoi cette date, qui signifie la fin des combats en
Europe, et donc la fin de six années de destructions et de souffrances inouïes, est-elle si fortement ancrée dans notre mémoire collective et célébrée chaque
année ?
Nicolas Offenstadt : Elle signifie la fin de la barbarie nazie et de la guerre qu’elle a déclenchée. Dès lors, elle comporte un aspect international immédiat, elle peut concerner toutes les populations qui en ont été victimes, toutes les nations qui ont été touchées par la guerre, même si des dates différentes sont retenues pour la commémoration de la fin de la guerre, même si elle est loin de faire consensus.
Le 8 mai 1945 est-il une date de basculement, de sortie de la barbarie pour aller vers un espoir et une construction humaniste qui s’incarnent aussi bien dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) que dans la charte des Nations unies en cours d’élaboration ?
Nicolas Offenstadt : Attention, l’idéal de sécurité collective pour garantir la paix, fortement, et de réforme sociale gouvernait aussi bien des engagements pris après la Première Guerre mondiale. De nombreux anciens combattants étaient revenus du front en espérant participer à changer le monde.
Mais les alliés, à partir du moment où se dessine la victoire définitive contre l’Allemagne nazie, envisagent tout un ensemble de politiques (démocratisation, dénazification, décartellisation…) vis-à-vis des vaincus pour que les horreurs passées ne puissent pas se reproduire. Les débuts de la guerre froide, la séparation entre deux blocs, vont aussi limiter la portée des espérances.
Quatre-vingts ans après, peut-on dire que l’esprit et l’héritage du CNR et de l’ONU tels que pensés à l’époque sont menacés à force de réformes libérales d’un côté et de violation des résolutions des Nations unies de l’autre, avec même le retour de la guerre sur le continent européen ?
Nicolas Offenstadt : Il est certain que, depuis les années 1980, les avancées, sous de multiples formes, du néolibéralisme ont affaibli, voire détruit tout un ensemble de structures de l’État providence qui s’est mis en place dans différents pays d’Europe, en particulier, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
Mais attention, la construction européenne ne doit pas être lue seulement sous ce prisme. Elle avait pour but de préserver la paix entre les partenaires. À l’intérieur de l’UE, c’est bien le cas, de favoriser démocratie et respect des droits de l’homme. Or, on voit que c’est encore un instrument qui peut faire pression en ce sens, bien sûr, avec un succès inégal selon les enjeux et les contextes, sur des États autoritaires, « illibéraux »
Y a-t-il eu, depuis le 8 mai 1945, des évolutions dans la façon dont ce jour est célébré ?
Nicolas Offenstadt : En fait, le 8 mai est loin d’avoir une mémoire paisible. Les gouvernements et les politiques publiques ont varié selon les projections et les enjeux politiques, que ce soit en URSS, en Allemagne ou en France. Staline, tout au culte de sa propre action, n’en a pas fait un jour férié, ce n’est que plus tard, sous Brejnev, qu’il le devient, avec une valorisation de la « Grande Guerre patriotique ». De Gaulle privilégiait d’autres dates plus centrées sur la France et son action, comme le 18 juin. Il y eut de vifs débats autour de son caractère férié ou pas.
En Allemagne de l’Ouest, il faut attendre, les générations passant, le milieu des années 1980 pour que soit clairement marqué son caractère de jour de « la libération » pour les Allemands. En France également, c’est avec François Mitterrand que le 8 mai devient de manière pérenne une fête légale fériée.
« Parmi la coalition antinazie, même si les rivalités existent, il y a encore en 1945 la volonté de régler collectivement le sort de l’Allemagne. »
En RDA, en revanche, le 8 mai est férié : il inscrit le pays du côté des vainqueurs de l’histoire et célèbre la force du socialisme à travers la victoire de l’URSS, désormais le grand allié. D’ailleurs, aujourd’hui encore, c’est un enjeu politique, la dirigeante de l’extrême droite allemande, Alice Weidel (née en 1979), expliquait en 2023, à rebours du consensus mémoriel, qu’elle n’entendait pas célébrer le 8 mai car c’était une « défaite » de son pays… Et il y a peu, elle levait les yeux au ciel dans une émission de télévision quand on évoquait la commémoration des camps de la mort.
Le 8 mai 1945 est aussi une date qui, avec les massacres de Sétif et l’affaiblissement des empires coloniaux, marque un tournant vers les guerres d’indépendance et la décolonisation…
Nicolas Offenstadt : Absolument. Les luttes anti-impérialistes et anticoloniales, et les victoires qu’elles obtiennent, s’accélèrent après 1945. D’ailleurs, le bloc de l’Est appuyait ces mouvements, en se prévalant d’une autre mondialisation, une « mondialisation rouge » qui se sentait à distance de l’héritage colonial occidental.
C’est enfin une date clé avec deux grands vainqueurs : les États-Unis et l’URSS. Le monde se voit refaçonné. Peut-on dire que la guerre froide à venir démarre le 8 mai 1945 ?
Nicolas Offenstadt : La guerre froide proprement dite démarre en fait un peu plus tard. Parmi la coalition antinazie, même si les rivalités existent, il y a encore en 1945 la volonté de régler collectivement le sort de l’Allemagne. Elle se défait progressivement jusqu’aux ruptures de 1948-1949, notamment avec le blocus de Berlin.
Peut-on considérer que nous sommes en train de sortir de l’ordre mondial issu du 8 mai 1945 ?
Nicolas Offenstadt : L’effondrement du bloc de l’Est, à partir de 1989, pouvait sembler mettre un terme à la guerre froide. Mais on voit que la Russie rejoue et utilise encore la posture d’un bloc opposé à l’Occident, à ses valeurs, ou ses supposées valeurs, certes sur d’autres lignes. Certains groupes de gauche se déterminent encore en partie sur des lignes de guerre froide, d’un anti-impérialisme immobile, assez étonnamment, sans vouloir voir les changements.
Par ailleurs, un des risques majeurs que l’on voit déjà poindre dans un contexte de recul profond de la raison gouvernante, c’est relativisation, la banalisation ou bien la trivialisation de la barbarie nazie, de la Shoah et de toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale qui l’ont accompagnée.
Chacun de ces trois termes correspond à des processus formellement différents, mais ils convergent. En ce sens, oui, ce serait la sortie d’une forme de morale universelle, plus petit dénominateur commun, issue de la Seconde Guerre mondiale.
mise en ligne le 7 mai 2025
80 ans du 8 mai 1945 #5.
Dans la clandestinité,
la Résistance construit
la France d’après
Cet article fait partie de la série 80 ans du 8 mai 1945 (8 épisodes)
Jean Vigreux sur www.humanite.fr
D’abord en ordre dispersé, les forces combattantes s’unifient, puis rédigent le programme du Conseil national de la Résistance pour former le modèle démocratique et social de la Libération.
Jean Vigreux est historien.
Dès juin 1940, la France défaite est abattue. Si le général de Gaulle s’enfuit à Londres pour organiser la future armée auprès des Britanniques, il reste pour la plupart un inconnu. Beaucoup hésitent encore à franchir la Manche, estimant qu’ils seraient plus utiles dans l’Hexagone, à l’image de Léon Blum.
D’autres considèrent qu’il faut refuser l’Occupation en sabotant des lignes téléphoniques ou autres installations, mais très vite ils sont fusillés. Quelques manifestations jalonnent cependant ces années 1940-1942, entre autres un défilé d’étudiants et de lycéens sur les Champs-Élysées le 11 novembre 1940, ou encore la mise en place du réseau du musée de l’Homme, à Paris, qui est très vite décapité.
Parmi ces résistants de la première heure, on compte beaucoup d’hommes et de femmes de gauche, qui retrouvent les réflexes de défense républicaine (1793, 1871, 1914, 1934), mais aussi quelques hommes de droite, tels Henri Frenay ou Emmanuel d’Astier de La Vigerie. Toutefois, ces actes restent épars et les contacts avec Londres ne sont établis que tardivement, entre 1941 et 1942.
Engagement massif des communistes en 1941
Des mouvements commencent à organiser les premiers résistants, qui ont pour objectif essentiel de sensibiliser la population, notamment en diffusant tracts et presse clandestine. Une grande grève doit être signalée dans cet élan : c’est celle des mines du Nord et du Pas-de-Calais, en mai-juin 1941.
Si la répression est brutale, ces actions suscitent des espoirs face à la révolution nationale de Vichy, l’exclusion mise en œuvre et surtout la politique de collaboration. L’année 1941 voit un engagement massif des communistes dans la Résistance, se livrant à des sabotages et à la lutte armée, mettant en place le « Front national de lutte pour l’indépendance de la France », dont le recrutement va largement au-delà de la famille communiste.
En quelques mois, le parti sort du ghetto où l’avaient plongé le pacte germano-soviétique et son interdiction. Dès lors, la ligne patriotique des années du Front populaire, marquée par un antifascisme viscéral, est réactivée, soulageant et surtout levant les doutes de certains dirigeants de la Main-d’œuvre immigrée (MOI). Les premiers contacts sérieux avec Londres, qui ont eu lieu en décembre 1941, permettent aux mandataires de la France libre d’être parachutés en France, comme Jean Moulin, puis Pierre Brossolette. Ils entrent en contact avec les partis clandestins et les différents acteurs de la Résistance.
Mai 1943, naissance du Conseil national de la Résistance
Il s’agit de penser les futures bases démocratiques à la Libération, pour reconstruire une vie politique autour d’un grand mouvement issu de la Résistance et se défaire du fascisme. C’est en mai 1943, avec la naissance du Conseil national de la Résistance (CNR), que s’achève le processus d’unification des forces résistantes, sous l’égide de Jean Moulin, regroupant huit composantes de la résistance (ceux de la Libération, ceux de la Résistance, Front national, Libération Nord, Organisation civile et militaire, Combat, Franc-Tireur, Libération Sud), six partis politiques (Alliance démocratique, Démocrates populaires, Fédération républicaine, Parti communiste, Parti socialiste, Radicaux socialistes) et deux organisations syndicales (CGT et CFTC).
Première instance coordinatrice entre la zone Nord et la zone Sud, le CNR constitue la matrice des projets futurs. Il s’agit de reconnaître l’autorité du général de Gaulle et de penser l’avenir en préparant la Libération, mais aussi la reconstruction du pays et la restauration de l’idéal républicain et démocratique.
Plusieurs projets sont alors proposés, mais celui de Pierre Villon offre une synthèse ou un équilibre entre tous. Le CNR s’affirme rapidement et adopte le 15 mars 1944 un programme qui définit la nécessité de la lutte armée et la préparation de l’insurrection nationale. Ce programme de gouvernement est connu alors sous le nom de « charte du CNR ». Elle envisage le retour à la République après les années du gouvernement du maréchal Pétain. Il s’agit dans ce contexte d’enrichir la « démocratie libérale » et surtout l’élargir à la « démocratie sociale ».
Renouer avec le souffle de 1936
Cette charte propose de mettre en place une « véritable démocratie économique et sociale », de participer à « l’éviction des grandes féodalités » et promouvoir la « participation des travailleurs à la direction de l’économie », tout en réalisant un plan complet de sécurité sociale, la sécurité de l’emploi et les nationalisations.
Il faut alors restaurer le régime républicain, mais surtout le refonder. Si le projet prend racine dans le référentiel du Front populaire sur des bases de justice sociale tout en composant avec l’ensemble des forces politiques de la Résistance, il est important de renouer avec le souffle de 1936. Ainsi, à la Libération, les notables traditionnels, pour une bonne part compromis avec le régime de Vichy, perdent leur place.
Une fois la Libération acquise à l’été et l’automne 1944, la transition démocratique se fait dans un cadre légal. Les premières consultations électorales – suivant l’ordonnance du 21 avril 1944 où le suffrage universel prend enfin tout son sens, les femmes pouvant voter – ont lieu au printemps 1945 avec les municipales, puis à l’automne les législatives pour l’Assemblée constituante.
« Après 8 ans de choix fiscaux qui ont avantagé les plus riches »
:
le Pacte du pouvoir de vivre s’invite dans le débat budgétaire
Hélène May sur www.humanite.fr
Les soixante-cinq organisations du Pacte appellent gouvernement et parlementaires à cesser d’utiliser les difficultés financières pour sacrifier les mesures sociales et environnementales.
Les impératifs budgétaires ont bon dos ont rappelé mardi 6 mai les membres du Pacte du pouvoir de vivre, un collectif fondé en 2019 de 65 organisations de la société civile dont, Oxfam, La fondation pour le logement, la CFDT, ATD quart-monde et le Réseaux action climat (RAC). « Les débats sur la réduction du déficit ou sur le financement de la défense servent trop souvent de prétexte à une importante remise en cause de nos piliers collectif », soulignent-elles dans leur communiqué.
Sans nier l’importance de la dette publique, elles mettent en garde contre l’obsession des dirigeants pour cette question, et leur aveuglement face à la dégradation de la situation sociale, environnementale et même démocratique de la société française. « La nécessité de maîtriser la dette publique, ne peut pas et ne doit pas se faire au détriment des plus fragiles, ni au prix d’un renoncement à la transformation écologique » assure Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT.
Sous l’austérité, le démantèlement
Sous ses aspects comptables et techniques, la lutte contre les déficits, surtout depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron est un outil de détricotage des services publics. Elle a aussi servi à la remise en cause des droits des plus fragiles (réforme de l’assurance chômage, du RSA, des APL…) et depuis peu, au renoncement à toutes ambitions de limiter le réchauffement climatique et de s’y adapter.
« Un des nœuds du problème c’est la tentation de répondre dans l’urgence à des problèmes à long terme » tacle Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif, membre du collectif. Cette politique est validée par un discours ambiant sur le « trop d’impôts », qui fait de la réduction des dépenses une nécessité. Pourtant, « après huit ans de choix fiscaux qui ont avantagé les plus riches, il est peut-être temps que ça s’inverse » souligne la présidente d’Oxfam, Cécile Duflot.
La justice fiscale est possible
Un autre choix de société est possible estiment les associations membres du Pacte qui proposent une série de mesures applicables tout de suite. La première est le retour de la justice fiscale « élément fondateur du pacte social », dans un pays où « on assiste à une aggravation des inégalités de patrimoine et au retour à une société d’héritiers comme au XIXe siècle » martèle Cécile Duflot.
Cela passe entre autres, par le retour de l’ISF, une meilleure taxation des successions, des transactions financières, ou des ventes d’actions. Des actions plus ciblées pourraient aussi être mises en place pour améliorer le quotidien, comme la pérennisation de la loi sur l’encadrement des loyers, le triplement des chèques énergies, la refonte du système des bourses étudiantes pour élargir la couverture, ou la fin des sanctions contre les bénéficiaires du RSA.
Encore faudrait-il que le politique, à commencer par le premier ministre et son ministre de l’économie, qui sont aux commandes, se saisissent de ces propositions concrètes venues d’acteurs du terrain. Jusqu’à présent en tout cas, et malgré les appels de François Bayrou à un grand débat budgétaire, ni l’un ni l’autre n’a répondu aux courriers que le Pacte leur a envoyés.
mise en ligne le 7 mai 2025
Impunité d’Israël :
encore plus loin dans
le génocide et l’effacement des Palestiniens
AFPS Association France Palestine Solidarité sur https://blogs.mediapart.fr/
L’heure est aux sanctions contre les criminels et pas contre celles et ceux qui dénoncent ce génocide en cours et ont l’impression de hurler dans le désert depuis plus de 19 mois. C’est notre humanité à toutes et tous qui est en jeu : soit nous réagissons, soit nous sombrons. Par Anne Tuaillon, Présidente de l’Association France Palestine Solidarité.
Après avoir rétabli un blocus total le 2 mars et rompu le cesse- le-feu le 19, après avoir annoncé le partage de la bande de Gaza en cinq zones encadrées par des zones militaires, Israël a annoncé le 5 mai un « plan de conquête » de la bande de Gaza et rappelé des dizaines de milliers de réservistes. Avec pour objectif le « départ volontaire des Gazaouis », en clair un nettoyage ethnique, une aggravation du génocide en cours et une occupation complète et prolongée de la bande de Gaza.
Pour le ministre des armées Israël Katz, les Gazaouis n’ont d’autre choix que « partir ou mourir ». D’octobre 2023 à juin 2024, Amnesty International avait déjà recensé 102 appels criminels de ce genre à la destruction d’un peuple émanant de responsables israéliens. Les Palestiniens savent depuis l’exode forcé de 1948 que partir c’est ne jamais pouvoir revenir dans leur patrie. C’est le cas de 70% des Gazaouis réfugiés dans des camps depuis cette Nakba.
Ce nouveau plan israélien est celui qui se dessinait dès le 8 octobre. Il piétine le droit international, le droit humanitaire, les Conventions de Genève et la Convention contre le génocide. Le 5 mai, l’Union européenne se dit préoccupée, Berlin rejette ce plan, Paris finit par réagir. Mais aucun État européen n’annonce de mesures diplomatiques (rappel d’ambassadeurs…), économiques (interdiction du commerce des produits venant des colonies…). Aucun ne demande de suspendre l’accord d’association UE-Israël en vertu de son article 2 bafoué par Israël ou d’exclure Israël d’autres partenariats comme cela a été appliqué à la Russie dès son agression contre l’Ukraine.
La seule réponse de la France sous la forme d’une reconnaissance très tardive et conditionnelle de l’État de Palestine est en décalage complet avec l’urgence absolue de protéger le peuple palestinien en grand péril.
Bien que le « bilan » soit déjà terrible et aurait dû leur suffire depuis longtemps pour agir et sanctionner, une bonne partie du monde politique, médiatique, intellectuel… refuse encore de nommer le crime, refuse d’utiliser le terme génocide et même « génocide plausible » comme a conclu la Cour Internationale de Justice (CIJ) dès le 26 janvier 2024… il y a plus de 16 mois. D’autres sont dans l’indifférence complice, dans la cécité volontaire ou le soutien ouvert et assumé au génocide !
Bien que les grandes ONG de terrain et les agences de l’ONU rapportent et alertent le monde entier sur ce génocide largement aggravé et avéré, aucune sanction n’est évoquée ou envisagée. Dix-neuf mois après l’attaque criminelle et meurtrière des groupes armés palestiniens le 7 octobre en Israël ayant fait 1200 morts, et la prise de 250 otages, les tirs et bombardements israéliens ont tué au moins 53 000 personnes dans la bande de Gaza dont 17 000 enfants, des dizaines de milliers de malades chroniques sont morts faute de soins, des milliers de victimes encore sous les décombres. Au total 200 000 morts selon des experts médicaux. À l’échelle de la population française, 34 fois plus nombreuse, ce serait 1,8 millions de tués dont plus de 578 000 enfants. Effroyable, monstrueux !
Combien faut-il encore de dizaines ou de centaines de milliers de personnes tuées pour agir et prendre des sanctions : 300 000 ? Plus ? 40 000, 100 000 enfants ?
Combien faut-il encore de quartiers, hôpitaux, tentes, distributions alimentaires bombardées, de centaines de soignants, humanitaires (400) et journalistes (212) assassinés ?
En Cisjordanie occupée, dont Jérusalem-Est, le nettoyage ethnique et la violence de l’armée et des colons sont décuplés : plus de 1000 tués, expulsion de 40 000 personnes de camps de réfugiés, récoltes et vergers détruits, villages rasés, habitations détruites, bombardements, plus de 10 000 prisonniers politiques dans des prisons transformées en centres de torture : Israël y reproduit la stratégie en cours à Gaza.
Josep Borrell, ancien haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères plaide le 29 avril pour le retour urgent au droit international, le recours aux leviers d’action contre Israël, et le refus du « fait accompli ». L’Assemblée générale des Nations unies a aussi exigé le 18 septembre 2024 qu’Israël mette fin dans un délais de 12 mois à l’occupation illégale du territoire palestinien et à sa colonisation, un crime de guerre. C’est précisément le contraire que fait Israël : toujours plus loin dans l’occupation, dans la colonisation, dans l’annexion de territoire et dans son régime d’apartheid.
À quelques jours du 15 mai, jour de la commémoration de la Nakba, la catastrophe qui a vu 800 000 Palestinien·nes chassé·es et dépossédé·es de leurs terres entre 1947 et 1949, après plus de 77 ans de dépossession et d’expulsion, la Nakba continue et arrive à un paroxysme : c’est l’existence même du peuple palestinien qui est menacée, c’est son effacement qu’Israël vise par son génocide.
L’heure n’est donc plus aux paroles ou aux déclarations d’intention mais définitivement aux actes, aux sanctions contre un État génocidaire à qui le monde doit imposer le droit face à la faillite totale dont il se rend coupable jusqu’à maintenant.
L’heure est aux sanctions contre les criminels et pas contre celles et ceux qui dénoncent ce génocide en cours et ont l’impression de hurler dans le désert depuis plus de 19 mois !
C’est notre humanité à toutes et tous qui est en jeu : soit nous réagissons, soit nous sombrons !
La France et l’UE doivent agir, fortement et rapidement !
Les sanctions c’est maintenant !
mise en ligne le 6 mai 2025
« Un recul pour la santé publique » : 1 300 médecins
et scientifiques dénoncent la réintroduction de pesticides interdits
Clara Gazel sur www.humanite.fr
1 279 chercheurs, médecins, soignants publient ce lundi 5 mai une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la proposition de loi Duplomb. Débattu cette semaine en commission à l’Assemblée nationale, le texte prévoit notamment de réintroduire des pesticides interdits, dont des néonicotinoïdes.
Plus d’un millier de chercheurs et scientifiques alertent sur les dangers de la proposition de loi Duplomb, qui doit être soumise au vote de l’Assemblée nationale fin mai 2025. Ils publient ce lundi 5 mai une lettre ouverte aux ministères de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Environnement, les quatre tutelles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), dans laquelle ils alertent sur les risques majeurs que ce texte ferait peser sur la santé publique, l’environnement et l’indépendance de l’expertise scientifique.
Initiée par Médecins du Monde et le collectif Alertes des médecins sur les pesticides, cette lettre est publiée à la veille de l’examen du texte par les députés en commission du développement durable. Les signataires – parmi lesquels le biologiste du muséum d’histoire naturelle Marc André Selosse et le président de Médecins du Monde Jean-François Corty – pointent les effets néfastes des pesticides interdits sur la santé, et redoutent en particulier la « ré-autorisation de certains néonicotinoïdes, ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2016 », qui inquiètent à la fois les professionnels de santé et les apiculteurs.
L’Anses remise en cause, son président menace de démissionner
Autre motif d’alerte pour les signataires : la création d’un « comité d’orientation pour la protection des cultures », inscrit dans la proposition de loi. « Nous nous opposons à la création d’un Conseil d’orientation agricole qui dessaisirait l’Anses d’une partie du contrôle scientifique et de la responsabilité assortie », dénoncent-ils.
Ce nouveau conseil aurait la possibilité d’identifier les pesticides jugés essentiels, ceux pour lesquels il est estimé qu’il n’y a pas d’alternative. Dans ce cas, le ministère de l’Agriculture pourrait passer outre l’avis de l’Anses, pourtant chargée jusqu’ici d’évaluer les dangers des pesticides et de délivrer les autorisations.
Pour le millier de chercheurs et scientifiques, la création de ce « conseil » serait « un recul pour la santé publique » s’il venait à imposer l’autorisation de pesticides « sans considération suffisante pour les risques sanitaires et environnementaux ». Avant d’exhorter les ministres à « garantir l’indépendance de l’Anses et de son expertise scientifique face aux pressions économiques et politiques. »
Le directeur général de l’Anses, Benoît Vallet, avait menacé lors de son audition à l’Assemblée le 25 mars de démissionner en cas d’adoption de la loi Duplomb. Après son examen en commission, la proposition de loi doit être débattue en séance à la fin du mois de mai par les députés.
Des pesticides interdits
toujours utilisés en France
sur https://reporterre.net/
Des insecticides et herbicides interdits dans l’Union européenne, parfois depuis plus de vingt ans, sont encore « régulièrement source d’intoxications » en France. C’est ce que révèle un rapport de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), publié le 5 mai. Ces pesticides ont pu être stockés ou importés de pays qui les autorisent toujours.
L’Anses a analysé 599 expositions et intoxications enregistrées par des centres antipoison sur le territoire, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. 150 produits phytopharmaceutiques sont impliqués, dont 64 substances actives non approuvées. Les trois quarts de ces expositions ont été accidentelles, et un quart relevait de « conduites suicidaires », précise l’agence.
Parmi les principaux produits en cause figurent surtout des insecticides (60 %), des herbicides (19 %) et des taupicides (5 %). La moitié de ces produits, fabriqués à base de dichlorvos (insecticide et acaricide), ont été achetés en France auprès de vendeurs à la sauvette sur des marchés, dans des commerces ou sur internet. Près de 80 % des expositions au dichlorvos concernaient le Sniper 1 000, un insecticide utilisé pour l’agriculture en Afrique, importé illégalement en France contre les punaises de lits et les cafards.
Les zones les plus touchées sont des territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et La Réunion), l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie.
mise en page le 6 mai 2025
Gauche, syndicats :
la pureté de chacun causera la perte de tous
Loïc Le Clerc sur www.politis.fr
La gauche peut-elle se payer encore longtemps le luxe de ses divisions intestines ? Quand le monde brûle, on ne débat pas de la couleur de l’extincteur.
Prédation sur les droits des chômeurs, des retraités, des jeunes, des prisonniers, austérité budgétaire, défense des valeurs traditionnelles, attaques incessantes contre les minorités religieuses, atteintes à l’environnement et à la recherche, fermeture d’un tiers des agences de l’État, taxation des plus modestes pour payer les cadeaux fiscaux des plus riches, remise en cause de symboles des victoires sociales comme le 1er mai chômé. Qui ça ? Donald Trump ? Non, Emmanuel Macron. Rien que pour ces dernières semaines.
Steve Bannon, l’ex-stratège de Donald Trump, aficionado de saluts nazis, avait théorisé la tactique du président américain et se réjouit de la voir à l’œuvre en son pays : « Je pense que vous voyez maintenant l’aboutissement de tout le travail qu’on a fait. Vous assistez à ce que j’appelle « l’inondation de la zone » et il n’y a pas de meilleur moment pour être en vie que maintenant, quand on voit les fruits de ce grand effort. »
« Inonder la zone », ça veut dire bombarder le monde d’infos, de déclarations, de décisions politiques, attaquer à tout-va tous les pans de la société, à la seule fin de créer un tel désordre, une telle dispersion des forces et des esprits qu’aucune union ne sera possible. Et donc aucune réaction, aucune contre-attaque de poids.
Donald Trump le fait et son efficacité fait des émules. Et pas seulement auprès de ses amis argentin, hongrois ou italien. En France aussi, la Macronie mitraille. Sous le tapis de « bombes Banon », il est impossible de tenir son bout de barricade sans regarder ce qu’il se passe pour les autres. La Commune de Paris n’a-t-elle pas été vaincue, bastion après bastion ?
Mais pendant que les droites et les extrêmes droites mondiales organisent leur contre-révolution, les gauches se tirent dans les pattes. Quel que soit le sujet, la division l’emporte. L’écologie ? Oui, mais le nucléaire… Le travail ? Oui, mais le RSA… L’islamophobie ? Oui, mais l’antisémitisme… Comme si le camp d’en face n’allait pas tout brûler.
Ce jeudi 1er mai, les manifestations furent à la fois inquiètes, festives et empreintes de gravité devant l’ampleur des luttes à mener. Le spectacle affligeant des guéguerres intestines, les prises de parole politique qui voulaient voler la vedette aux syndicats, les violences à l’encontre du PS et de ses élus à Paris, montrent que le chemin sera long et périlleux.
La pureté ne vaudra pas grand chose quand on sera tous morts.
En France, les écologistes et les socialistes sont trop occupés par leurs batailles d’appareil que d’idées, il n’est pas question. Le PCF, François Ruffin, Clémentine Autain cherchent, dans des styles différents, une manière d’exister au milieu de l’étau social-démocrate – insoumis. LFI n’est obsédé que par son hégémonie sur le tas de cendre. Tous se contorsionnent pour se démarquer de l’autre.
L’électorat, lui, n’attend plus les lendemains qui chantent, le temps des cerises ou le grand soir. Simplement que ses représentants lui inspirent un peu de joie, un peu moins de honte mais surtout la possibilité de mener des luttes. La pureté ne vaudra pas grand-chose quand on sera tous morts. Et il est à parier que même le choix du cercueil sera objet de controverses !
mise en ligne le 5 mai 2025
Les gagnants et
les perdants du « réarmement » de l’Europe
Francis Wurtz sur www.huma.fr
2370 milliards d’euros, soit plus de 7 fois le budget 2024 de la France, ou bien 11 fois le montant de l’aide publique mondiale au développement, ou encore… 36 fois le budget de tout le système des Nations unies et de ses 43 entités (OMS, FAO, Unesco, Unicef, OIT…) : tel est le montant délirant des dépenses militaires mondiales durant l’année écoulée1. En augmentation constante depuis dix ans, elles viennent d’enregistrer la plus forte progression depuis la fin de la guerre froide.
Le cas de l’Union européenne mérite une attention particulière, le plan de « réarmement » de 800 milliards d’euros (d’ici 2030), adopté le 6 mars dernier par les chefs d’État ou de gouvernement, devant se traduire par une nouvelle explosion, encore plus insensée, des dépenses militaires au fil des cinq prochaines années. À cet égard, plusieurs projets en cours doivent nous alerter. Concernant la France, tout d’abord : Emmanuel Macron a annoncé son intention de s’inscrire dans cette fuite en avant, en évoquant une augmentation progressive de 50 % de la part des richesses produites consacrée à cette gabegie2.
Les travailleurs ont tout à craindre de « l’économie de guerre » dont rêvent d’irresponsables politiciens.
L’Allemagne ensuite : le nouveau Chancelier, Friedrich Merz, entend affirmer le leadership européen de son pays en ambitionnant de porter ses dépenses militaires de quelque 80 milliards d’euros en 2025 (déjà en augmentation de 28 % en un an) à un niveau record se situant entre 200 et 400 milliards d’euros d’ici 20353. La Grande-Bretagne enfin : un sommet UE-Royaume-Uni doit se tenir le 19 mai prochain, à Londres, censé aboutir à un « partenariat stratégique », officiellement fondé sur « la prospérité de tous les citoyens du Royaume-Uni et de l’UE ».
Sauf qu’au cœur de ce « New Deal » post-Brexit figure un projet de « pacte de défense et de sécurité » qui permettrait aux entreprises britanniques de défense d’accéder au pactole de 150 milliards d’euros que l’Union européenne a décidé de consacrer au financement des investissements de défense.
Si les marchands d’armes sont, sans surprise, les grands gagnants de cette folle course aux engins de mort, qu’en est-il des perdants ? Il y a, naturellement, en tout premier lieu, les travailleurs, qui ont tout à craindre de « l’économie de guerre » dont rêvent d’irresponsables politiciens et dont se gargarisent des commentateurs à l’abri du besoin. Comme le souligne sans gêne le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, il faudra bien utiliser « une petite fraction » des dépenses sociales pour augmenter les dépenses de défense.
Mais ce n’est pas tout. D’autres priorités vont pâtir de cette militarisation à outrance. Ainsi des objectifs du « pacte vert » européen en matière de lutte contre le dérèglement climatique, appelés à être en partie sacrifiés. « Nous serons plus flexibles et pragmatiques pour les atteindre », vient d’annoncer la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, provoquant une vive réaction d’Ana Toni, directrice générale de la prochaine Conférence sur le climat de l’ONU, qui a qualifié ce recul européen d’« extrêmement décevant ».
Autre abandon inacceptable : on évoque une baisse à venir de 35 % de l’aide européenne au développement dans le cadre du budget pluriannuel 2028-2034, en cours de discussion. La démocratie, elle-même, subit des attaques significatives dans ce contexte : le matraquage évince le débat et la dramatisation étouffe l’analyse responsable. Le social, l’humanisme, l’esprit de responsabilité : tout nous commande de refuser cette dérive toxique !
1. Rapport de l’Institut international de recherche sur la paix (Sipri)
2. « Le Figaro », 2 mars 2025
3. Site touteleurope.eu, 28 avril 2025
mise en ligne le 5 mai 2025
Énergie : quelle société voulons-nous ?
Jade Lindgaard sur www.mediapart.fr
La production et la consommation d’énergie en France, pour les dix ans qui viennent, sont en discussion à l’Assemblée lundi 28 avril. Derrière les effets de manche et les provocations politiciennes, les enjeux sont énormes et interrogent notre modèle de société.
Quand on ouvre la proposition de « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE), ce document planifiant la production et la consommation d’électricité et d’hydrocarbures jusqu’en 2035 en France, la première chose qui frappe, ce sont les chiffres.
Dans sa version mise en consultation jusqu’au 5 avril, dite « PPE 3 », et dans l’attente de l’arbitrage définitif du gouvernement par décret, les objectifs pour 2035 sont nombreux : jusqu’à 708 térawattheures (TWh) d’électricité décarbonée – contre 390 en 2022 – dont au moins 360 d’électricité nucléaire et si possible 400 ; jusqu’à 90 gigawatts (GW) de photovoltaïque – contre 16 en 2022 ; vingt fois plus d’éolien en mer qu’aujourd’hui, et au moins le double en éolien terrestre.
D’ici dix ans, il faudrait aussi beaucoup plus de « biocarburants » et d’hydrogène. Et réduire la consommation énergétique de 30 % en 2030, avant une baisse de 50 % en 2050.
À titre de comparaison, le pétrole et le gaz comptent pour plus de la moitié (58 %) de la consommation finale d’énergie en France. Or, 73 % des gaz à effet de serre sont dus à l’énergie (en 2022). Ces importations d’hydrocarbures représentent entre 25 et 80 milliards d’euros de déficit commercial chaque année depuis quinze ans.
Le gouvernement va devoir s’en expliquer lundi 28 avril à l’Assemblée nationale. Un débat sur « la souveraineté énergétique » mais sans vote, concédé par François Bayrou pour apaiser les protestations et menaces de censure, notamment du Rassemblement national (RN). La PPE aurait dû faire l’objet d’une loi, et donc d’un vote parlementaire. Mais face au risque de rejet du texte, l’exécutif y a renoncé et a directement rédigé un décret. Sa version finale devrait être publiée après la discussion à l’Assemblée.
La stratégie française sur l’énergie, critiquée pour ses insuffisances par les ONG écologistes, le Haut Conseil pour le climat, et l’Autorité environnementale, se fixe un triple objectif : développer l’indépendance énergétique (la « souveraineté »), décarboner, renforcer la compétitivité. Agir de concert pour le climat, la croissance économique et la puissance géopolitique : ces objectifs peuvent évidemment entrer en contradiction et tracent une trajectoire d’équilibriste pour qui veut s’efforcer de répondre à cette commande très politique.
Nouvelle révolution industrielle
Pour y parvenir, il faudra fournir un « effort inédit dans notre histoire énergétique » de réduction de la consommation et de production énergétiques, explique le rapport en annexe du décret de la PPE. Les investissements requis sont « sans précédent depuis la première révolution industrielle » au XIXe siècle. Et l’objectif est de faire de la France « le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles ».
Mais les chiffres ne sont que des outils de mesure. S’en tenir à un débat sur la quantité de CO2, le volume de gaz ou le nombre de gigawatts d’électricité est tristement réducteur.
Cela empêche d’ouvrir la discussion qui devrait nous agiter, trois ans après le début de la guerre en Ukraine, sept ans après les « gilets jaunes », et en pleine bataille des droits de douane menée par les États-Unis de Donald Trump : en matière d’énergie, quelle société voulons-nous ?
Le climat dans la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie)
En 2024, la baisse des gaz à effet de serre a été insuffisante, autour de − 1,8 %. Ce fut pourtant l’année la plus chaude jamais mesurée dans le monde. Le dérèglement climatique avance inéluctablement, les gouvernements ayant trop tardé à réagir. La gravité de ses effets dépendra de la quantité d’émissions de CO2 qu’ils vont réussir à empêcher dans les années qui viennent.
Le chiffrage de la PPE jusqu’en 2035 s’appuie sur des modélisations de l’administration et, pour l’électricité, sur le rapport « Futurs énergétiques 2050 », de RTE, gestionnaire des réseaux transportant le courant électrique. La PPE est établie pour cinq ans, donc jusqu’en 2030, puis actualisée pour les cinq années suivantes, jusqu’en 2035. Elle doit permettre la sécurité d’approvisionnement du pays, l’amélioration de l’efficacité énergétique – utiliser moins d’énergie pour un besoin –, le développement des énergies renouvelables, l’équilibre des réseaux, la préservation du pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des prix.
Une société dans laquelle les besoins vitaux de toutes et tous sont satisfaits, à un prix abordable pour les plus précaires, et sans dégrader les écosystèmes ? Ou est-ce qu’attirer les industries et leur offrir une énergie abondante et décarbonée (« Plug baby, plug ») est ce qui compte le plus, quelles qu’en soient les conséquences sociales et environnementales ?
Il en va de l’énergie comme de l’alimentation et de la santé : c’est avant tout une réflexion profondément humaine, qui touche au cœur de la vie quotidienne et des aspirations de chacune et de chacun. Mais les instrumentalisations politiciennes et populistes ont tué dans l’œuf des questionnements essentiels. Il n’est pas trop tard pour les réactiver.
Système public ou privatisation ?
L’économie de la « transition énergétique », expression aussi galvaudée que critiquée, crée un énorme effet d’aubaine pour l’industrie et la finance. Le phénomène assez ahurissant des start-up nucléaires, alléchées par le robinet intarissable de subventions pour les SMR, ces « petits » réacteurs atomiques en projet un peu partout, en est un exemple.
Mais ce n’est pas le seul secteur sensible pour la « souveraineté énergétique » qui suscite l’engouement des industriels : usines de batteries du groupe Bolloré, mines de minerais d’Eramet et Imérys, sites de STMicroelectronics et Soitec pour la fabrication de puces, parc éolien flottant en Méditerranée remporté par Engie et le groupe portugais EDP, éoliennes d’Iberdrola au large de Saint-Brieuc, usines d’hydrogène, etc.
Du côté de la consommation électrique, les gros opérateurs de data centers (Equinix, Digital Realty…), encore plus énergivores avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), et les entreprises du numérique deviennent des acteurs publics importants aux yeux de l’Élysée, qui leur a consacré un sommet.
Dans un contexte politique où les régulations environnementales et sociales sont violemment attaquées par la droite, l’extrême droite et une partie de l’industrie, est-il soutenable de continuer de confier au privé des investissements si importants pour le sort collectif ?
À l’inverse, l’idée de créer des « communs de l’énergie », autour d’un service public renforcé et impliquant les collectivités locales, fait consensus sur un large spectre politique : de la CGT et de représentant·es syndicaux d’EDF et Enedis, à des élus locaux et associations comme Énergie partagée, des chercheuses comme Fanny Lopez, sans oublier l’Union européenne (et ses « communautés énergétiques citoyennes »), et même l’ancien PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy.
Loin d’être seulement théorique, ce débat est très concret puisqu’il concerne le sort des barrages, dont l’Union européenne veut ouvrir les concessions à la concurrence. Et aussi le marché de l’électricité, dont l’économiste Anne Debregeas, porte-parole de Sud Énergie, propose de sortir en créant un opérateur public. Celui-ci détiendrait les grands moyens de production et facturerait l’ensemble des consommateurs et consommatrices selon une grille tarifaire qui permettrait de recouvrir les coûts.
Veut-on ou non des énergies renouvelables ?
C’est le nouveau jeu de massacre, à coups de posts sur les réseaux sociaux : accuser les énergies renouvelables d’être responsables de « surproduction » d’électricité et de déstabiliser le réseau – qui doit en permanence équilibrer offre et demande, à la seconde près. Le haut commissaire à l’énergie atomique, Vincent Berger, réclame que « la croissance du photovoltaïque [soit] revue à la baisse ». Une prise de position qui vient après la tribune d’anciens dirigeants d’EDF et de l’ex-président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, et qui appelle à l’arrêt de « la politique ruineuse » de soutien à l’éolien et au solaire.
Une autre, signée par des parlementaires, souhaite un moratoire sur les subventions aux renouvelables. À ce stade, le ministre de l’industrie et de l’énergie, Marc Ferracci, maintient les objectifs les concernant – avec une baisse sur le photovoltaïque par rapport à la première version de la PPE. Mais la chute des tarifs d’achat ainsi qu’un durcissement des périmètres d’installation des éoliennes inquiètent les professionnels du secteur.
Le Rassemblement national tente de s’approprier les oppositions locales à l’éolien.
Le fait est que la consommation est trop basse pour absorber toute la production d’électricité quand elle atteint des pics – dernier épisode en date, mi-avril. Il faut alors vendre ces électrons sur le marché européen. Quand ils ne trouvent pas preneur, se produit, dans certains rares cas, un phénomène baroque de « prix négatifs » que les antirenouvelables adorent monter en épingle. Invendu, ce courant coûte à l’opérateur.
RTE a temporisé, le 17 avril, expliquant que « la France est un pays exportateur net d’électricité » et « a donc, sauf rare exception, toujours produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme », et notamment grâce à son parc nucléaire. En 2024, le solde exportateur de la France a atteint un record historique de 89 TWh – soit 89 milliards de kilowattheures –, rapportant 5 milliards d’euros.
De dossiers du Point aux éditos de Valeurs actuelles, les énergies renouvelables sont devenues une cible privilégiée de la droite, tandis que le Rassemblement national tente de s’approprier les oppositions locales à l’éolien. À force de lobbying, ces arguments créent un effet diffus d’intimidation.
Pourtant, la matérialité des faits est simple : plus d’électricité disponible, c’est moins de gaz naturel liquéfié à importer de la Russie de Poutine – importations qui ont explosé en France en 2024 – et des États-Unis de Donald Trump. C’est bon pour le climat et mieux pour la démocratie. Les nouveaux réacteurs nucléaires EPR de Penly, Gravelines et Bugey, s’ils voient le jour, ne sont pas prévus avant 2038. D’ici là, pour produire plus d’électricité décarbonée, il n’y a pas d’autre voie que les renouvelables. « Se résigner à ce que la conversion du fossile vers l’électrique ne se fasse pas est un discours décliniste et anticlimatique qu’il faut combattre », résume l’expert Nicolas Goldberg, qui a cosigné une tribune pour cesser d’opposer nucléaire et renouvelables.
Autre rappel à la réalité, économique cette fois : les coûts des renouvelables sont en deçà de ceux du nucléaire. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) devrait estimer, d’ici à l’été, le coût complet du nucléaire autour de 67 euros par mégawattheure, selon Les Échos. Or le parc éolien en construction au large de Dunkerque (Nord) a été attribué par appel d’offres en juin 2019 pour un coût de 44 euros le mégawattheure. D’ici à 2050, le coût de production devrait être de l’ordre de 30 euros le mégawattheure pour le solaire au sol, d’environ 45 euros pour les grandes toitures et, d’ici vingt-cinq ans, l’éolien terrestre devrait produire des électrons à un peu moins de 40 euros, selon RTE. La Cour des comptes estime le coût total du réacteur EPR construit à Flamanville (Manche) à 23,7 milliards d’euros. Le coût de production de son électricité s’établirait entre 110 et 120 euros par mégawattheure, en valeur de 2015, pour une hypothèse de rentabilité – basse – de 4 %, soit entre 132 et 144 euros en comptant l’inflation. Il monterait à 176 euros par mégawattheure, pour un taux de rentabilité de 7 %.
Quelle « neutralité technologique » ?
C’est une expression que l’on entend de plus en plus à Bruxelles : la « neutralité technologique » apparaît à plusieurs reprises dans le Pacte pour une industrie propre présenté par la Commission européenne. Dans le contexte européen, cette formulation signifie que chaque État doit rester maître du choix de ses sources d’énergie, du moment qu’elles lui permettent de réduire ses émissions de CO2 – l’objectif est de baisser de 90 % les gaz à effet de serre d’ici à 2040. La France y tient beaucoup, car elle garantit la place du nucléaire dans les réglementations de l’UE, et, potentiellement, son accès aux financements.
Mais pourquoi limiter l’idée de neutralité aux rejets de CO2 et ne pas y faire entrer celle des déchets ? Tous les équipements industriels, y compris les composants d’éoliennes et de photovoltaïques, génèrent des déchets in fine. Une tendance nourrie par la numérisation de l’économie et des pratiques. Mais la gestion des déchets du nucléaire est à l’origine de toute une infrastructure d’équipements particulièrement polluants, comme sur le site d’Orano à La Hague (Manche), et coûteux. Le projet d’enfouissement en couche géologique profonde à Bure (Meuse) est toujours en cours d’instruction et soulève de lourdes questions éthiques.
Enfin, ne serait-il pas plus réaliste de prendre en compte le sujet des combustibles ? Par définition, les éoliennes et les panneaux solaires n’en ont pas besoin. C’est ce qui rend leur coût si bas une fois qu’ils sont installés : ils n’ont besoin que de vent et de lumière, fournis gratuitement par la planète. C’est leur immense avantage sur les centrales à gaz et les chaudières à fioul, mais aussi sur les réacteurs nucléaires, qui nécessitent du combustible en uranium, que la France doit importer à 100 % et transformer par un processus générateur de pollutions et de risques liés au transport.
En 2019, Emmanuel Macron avait créé une Convention citoyenne pour le climat pour sortir de la crise des gilets jaunes. Ces résultats ont été ignorés sans scrupule par le pouvoir. Mais elle fut un événement politique qui continue de faire date, démontrant in vivo qu’une délibération démocratique et informée sur le climat et l’énergie peut conduire à formuler des propositions politiques fortes. Peut-être est-il temps de former une convention citoyenne des besoins énergétiques. Et de le faire par le bas, en partant des innombrables collectifs et associations engagés dans la transformation écologique et sociale.
mise en ligne le 4 mai 2025
Sans syndicat, pas de salut : la gauche absente là où le salariat est abandonné
Pablo Pillaud-Vivien sur www.regards.fr
Les dernières élections professionnelles confirment une réalité inquiétante : là où les syndicats sont affaiblis ou absents, la gauche peine à convaincre.
On s’en doutait, les chiffres le confirment. Les élections professionnelles 2024 dans les fonctions publiques et dans le privé ont reconduit une tendance qui s’installe dangereusement : une baisse générale de la participation, une fragmentation accrue de la représentation, et surtout, une corrélation frappante entre la défaite syndicale et l’effacement politique de la gauche.
Dans les services publics et les industries (ou ce qu’il en reste parfois…), là où les bastions syndicaux tiennent bon — enseignement, santé, transports, collectivités — la gauche garde encore un ancrage. Mais dans les zones grises du salariat contemporain, dans les entreprises sous-traitantes, les entrepôts de la logistique, les plateformes numériques, le petit commerce, les sociétés de nettoyage ou de sécurité, la gauche est introuvable. Et pour cause : ces secteurs sont aussi ceux où les syndicats sont les plus faibles, parfois absents, souvent réprimés.
Le lien est clair : sans organisation collective du travail, sans culture de la lutte, sans relais syndicaux, les salariés sont livrés à eux-mêmes. L’individualisme forcé — celui de la survie économique, du contrat précaire, de la peur du licenciement — rend toute politisation difficile. Dans ces zones d’ombre, la gauche parle une langue étrangère, souvent inaudible. Le développement des très petites entreprises (près de 5 millions aujourd’hui quand il y en avait moins de la moitié moins il y a 10 ans) affiche un taux de participation aux élections professionnelles éloquent : sous les 5%. Les relations de classes y sont complexes car les relations patrons-salariés intriquées, les revendications sont difficiles à faire entendre, les solidarités professionnelles prennent d’autres formes que dans les grandes entreprises.
On retrouve ce même abandon dans le monde agricole. Les dernières élections aux chambres d’agriculture ont vu une nouvelle fois triompher la FNSEA, syndicat historiquement proche du pouvoir et des logiques productivistes. Le tout avec moins de la moitié des suffrages des agriculteurs… En face, la Confédération paysanne — seule voix clairement ancrée à gauche, écologiste et sociale — peine à élargir sa base. Pourquoi ? Parce que la gauche, trop longtemps déconnectée du monde rural, a déserté les campagnes. Or, l’agriculture est un champ de bataille social comme un autre : endettement massif, précarité des salariés agricoles, isolement, suicides… Et surtout incompréhension des réalités d’un monde pourtant d’une nécessité absolue pour notre société. Là encore, là où la gauche syndicale ne s’organise pas, c’est la droite et l’extrême droite qui prospèrent.
Autre exemple, ce sont près de 40% des salariés qui travaillent, selon le ministère du travail, dans les professions intermédiaires ou employées. Parmi eux, la grande majorité sont des personnels administratifs, de l’agent d’accueil au secrétaire de direction, en passant par toutes les fonctions dites supports qui sont le coeur battant des entreprises et des services publics. Pour ces travailleurs là, ni la gauche syndicale ni la la gauche politique n’offre de propositions de projet adapté. Autrement dit : bien sûr qu’il est important de mettre en avant les caristes et les chauffeurs Uber, les soignants et les postiers, les professeurs et les ouvriers des hauts fourneaux, mais quid de tous ceux qui remplissent les tableaux Excel et les agendas, répondent aux emails et au téléphone ?
Pire : là où les syndicats sont faibles, c’est souvent l’extrême droite qui avance. À force d’abandonner les salariés précaires, de mal comprendre les réalités du travail fragmenté, la gauche a laissé un vide que d’autres s’empressent de combler — par la haine et le ressentiment. Le repli identitaire prospère là où le combat social ne se donne plus les moyens de lutter – et de comprendre ! Le RN se fout du monde du travail – ou plutôt fait le strict minimum pour faire croire mensongèrement qu’il est du côté des travailleurs – mais il offre une grille de lecture du monde qui dépasse le poste de travail : le problème, y compris pour le travailleur, c’est l’arabe, le musulman, l’étranger. Au fond, sa réussite tient aussi du fait que les responsables du parti ont compris qu’un salarié ne devait pas se réduire à ses conditions matérielles de travail mais qu’il avait des rêves et des peurs – ce sur quoi ils ont décidé de capitaliser.
Il y a donc ici une urgence stratégique. Réarmer la gauche politiquement passe nécessairement par un réarmement syndical. Et il ne sert à rien de fustiger, de l’extérieur, une soi-disant « bureaucratie syndicale » selon l’adage trotskiste vieux comme Léon. Les fédérations continuent de structurer un espace qu’elles sont les seules à investir. Mais il est aussi besoin d’un patient travail d’organisation de ce salariat oublié voire négligé : syndiquer dans l’intérim, dans les entrepôts, chez les aides à domicile et les personnels administratifs. Il ne peut y avoir de stratégie électorale sans stratégie d’organisation. Mieux : on ne peut penser la société si on n’a pas des représentants de tous ses espaces pour y travailler.
La gauche qui gagne est une gauche qui s’ancre. Et s’ancrer, aujourd’hui, c’est retourner là où elle a déserté : les lieux de travail. Sans mépris pour ceux que l’on considérerait comme non-nécessaires ou concentration univoque sur ceux qui sont d’ores et déjà les atouts de la gauche. Sinon, elle restera ce qu’elle devient peu à peu : une force bavarde et impuissante.
Pour aller plus loin – car oui, certains s’y attèlent ! – : https://laviedesidees.fr/Travailler-mieux-un-recueil-de-propositions
mise en ligne le 4 mai 2025
Pressions économiques, déserts informationnels… Reporters sans frontières alerte sur l’apparition d’une hécatombe mondiale des médias
Tom Demars-Granja sur www.humanite.fr
L’ONG Reporters sans frontières dévoile, vendredi 2 mai, son nouveau classement annuel de la liberté de la presse. Le constant est sans appel : rarement la situation économique des médias à l’international n’aura été si fragile. Alors que la montée des extrêmes droites, comme de la guerre, ne cesse de bouleverser l’échiquier mondial, les déserts informationnels se multiplient.
Les États-Unis chutent par exemple à la 57e place (-2), l’Argentine à la 87e (-21) et la Tunisie à la 129e place (-11). Sur les 32 pays et territoires de la zone Asie-Pacifique, vingt ont vu leur score économique baisser. Celui de l’Afrique subsaharienne connaît, lui aussi, une dégradation inquiétante : 80 % des pays de la région connaissent des difficultés financières qui se ressentent sur les médias locaux. Par exemple au Burkina Faso (105e, -19), au Soudan (156e, -7) ou au Mali (119e, -5), « où des rédactions sont contraintes à l’autocensure, à la fermeture ou à l’exil ».
La France, où une « part significative de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes », souligne RSF, chute, elle, de la 21e à la 24e place. « Cette concentration croissante restreint la diversité éditoriale, accroît les risques d’autocensure et pose de sérieuses questions sur l’indépendance réelle des rédactions vis-à-vis des intérêts économiques ou politiques de leurs actionnaires », alerte le rapport. Selon RSF, la propriété de médias est plus largement très concentrée, voire entièrement aux mains de l’État ou de milliardaires, dans 46 pays étudiés, de la Russie à la Tunisie, en passant par Hong Kong, le Pérou ou la Géorgie.
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche est un autre exemple de la nouvelle donne avec laquelle doit composer le champ médiatique. La fermeture ou réduction des moyens consécutifs des médias Middle East Broadcasting (à destination du Moyen-Orient), Radio free Asia (à destination de l’Asie) et Voice of America (à destination des États-Unis), couplé au démantèlement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) – le président des États-Unis a ordonné, début mars, le gel 83 % des programmes de l’Agence – « sont des contresens géopolitiques et aussi une faute morale », estime Thibaut Bruttin.
« Il est difficile de gagner sa vie en tant que journaliste »
Le directeur général de Reporters sans frontières y voit – en complément de la défiance que porte l’élu républicain pour l’indépendance de la presse – une motivation raciste. « Il a réussi à couper ces médias de leur principale main-d’œuvre, eux qui sont massivement opérés par des journalistes locaux, et donc étrangers, résume-t-il. Ils les abandonnent à leur sort. »
En résulte l’apparition de déserts informationnels tant aux États-Unis que dans certaines régions du monde dépendantes de l’aide financière états-unienne, comme l’Ukraine. « Le journalisme local paie le prix fort de la récession économique : plus de 60 % des journalistes et experts des médias sondés en Arizona, en Floride, au Nevada et en Pennsylvanie, s’accordent à dire qu’il est « difficile de gagner sa vie en tant que journaliste » et 75 % que « la viabilité économique d’un média moyen est en difficulté » », révèle le rapport de RSF.
En Europe, les pouvoirs publics tiennent bon malgré la vague brune qui s’abat sur eux, note RSF. « En Tchéquie, on a utilisé toutes sortes d’arguments pour essayer de porter atteinte à la stabilité et à la pérennité du financement de l’audiovisuel public, y compris en invoquant à tort l’argument français, rappelle Thibaut Bruttin. Heureusement, la majorité actuelle – et on ne sait pas combien de temps elle durera face au rouleau compresseur Andrej Babiš (chef de file du parti populiste d’extrême droite ANO – NDLR) – a réussi à faire passer une loi pour augmenter la redevance de l’audiovisuel public. »
Si « on ne peut pas non plus parler de phénomène d’extinction », estime le directeur général de RSF, ce dernier demande que les pouvoirs publics s’emparent réellement du sujet. « Les gouvernements souvent nous disent : « Mais la liberté de la presse, c’est surtout la garantie que le gouvernement n’interfère pas avec les journaux, les télévisions et les radios. » C’est en partie vrai. Mais il est aussi attendu, dans les textes internationaux et dans les constitutions, que les gouvernements garantissent un cadre qui soit favorable à l’exercice du journalisme. » Au vu des résultats de cette nouvelle étude, les médias semblent plutôt abandonnés à leur sort.
3 mai 2025 :
le journalisme indépendant
est en danger, partout
Yavuz Baydar sur https://blogs.mediapart.fr/
Un jour de célébration — ou de deuil ? Le 3 mai marque la Journée mondiale de la liberté de la presse — une journée instaurée par l’ONU pour mettre en lumière un journalisme libre, pluraliste et indépendant. Mais aujourd’hui, il s’agit surtout de défendre quelque chose qui disparaît à grande vitesse.
L’atmosphère générale que j’ai observée lors du très fréquenté Festival international du journalisme à Pérouse, en Italie, il y a trois semaines, était profondément sombre et chargée de symbolisme.
Pour la plupart d’entre nous, qui avons essuyé de rudes coups de la part d’autocrates, de dirigeants populistes et de leurs sbires corrompus dans diverses régions du monde, il est devenu évident que nos collègues américains avaient commencé à parler le même langage et à partager une inquiétude que nous exprimons depuis au moins une décennie — recevant ainsi cette formule d’accueil : « bienvenue au club ». Le fait que de nombreux participants cette année soient issus d’organisations de défense des droits humains était également très révélateur.
L’Indice mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières (RSF), la veille du 3 mai, dresse un constat encore plus préoccupant de la situation mondiale.
La fragilité économique constitue une menace majeure, les médias ayant du mal à préserver leur indépendance face à la pression financière. « L’indicateur économique de l’indice 2025 de la liberté de la presse de RSF est au plus bas niveau de son histoire, et la situation mondiale est désormais qualifiée de ‘difficile’ », indique le rapport.
Des médias ferment en raison de difficultés économiques dans près d’un tiers des pays à travers le monde. Trente-quatre pays se distinguent par la fermeture massive de leurs organes de presse, ce qui a conduit à l’exil de journalistes ces dernières années.
La montée en puissance des oligarques de la tech complique encore davantage le paysage médiatique. Des plateformes dominantes telles que Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft ont accaparé une part importante des revenus publicitaires numériques, mettant à mal la viabilité financière des médias traditionnels. RSF souligne qu’en 2024, ces plateformes ont récolté 247,3 milliards de dollars de revenus publicitaires, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente.
Ces constats recoupent ceux d’un autre organisme de surveillance. Un rapport récent de la Civil Liberties Union for Europe (Liberties), basé sur le travail de 43 organisations de défense des droits humains dans 21 pays, conclut que plusieurs gouvernements de l’Union européenne attaquent la liberté de la presse ou affaiblissent l’indépendance et la régulation des médias.
Combinés à des règles de transparence faibles en matière de propriété, à une influence croissante de l’État sur les médias de service public, et aux menaces visant les journalistes, le rapport affirme que le pluralisme est « attaqué dans toute l’UE — et dans certains cas, il lutte pour sa survie ».
Le rapport, cité par The Guardian, indique que les médias publics en Hongrie sont devenus de véritables « porte-voix du gouvernement », et que les développements en Slovaquie vont dans la même direction, où de nouvelles lois ont supprimé les garanties d’indépendance éditoriale.
Le rapport souligne une « concentration excessive de la propriété des médias » comme une inquiétude particulière en France, Croatie, Hongrie, Pays-Bas, Slovénie, Espagne et Suède, la propriété étant souvent entre les mains de quelques individus ultra-riches. La France est confrontée à « d’importants défis en matière de pluralisme des médias », indique le rapport, soulignant l’acquisition du groupe Hachette par Vincent Bolloré et la nomination, dans plusieurs de ses maisons d’édition, de dirigeants favorables aux convictions du milliardaire conservateur.
Selon ce même rapport, les médias de service public sont également vulnérables en Croatie, Grèce, Bulgarie et Italie. De l’autre côté de l’Atlantique, le dernier décret présidentiel de Donald Trump visant à « supprimer le financement fédéral de NPR et PBS » s’inscrit parmi les mesures les plus récentes pour étouffer les médias publics, socle des démocraties.
Au cours des quatre dernières décennies, les plus grandes organisations de presse aux États-Unis ont progressivement perdu leur indépendance, absorbées par vagues successives de fusions et d’acquisitions.
Aujourd’hui, elles ne sont plus que de petits rouages dans d’immenses machines corporatives, où le journalisme ne figure presque jamais — voire jamais — en haut de l’agenda. Dans le même temps, les conditions économiques du journalisme se dégradent partout dans le monde. Les rédactions locales disparaissent, les algorithmes favorisent les contenus putaclics et les fausses nouvelles, et le journalisme peine à affirmer sa valeur dans une culture numérique chaotique.
Dans de nombreux pays, la censure prend la forme d’une pression économique.
Mais il y a bien plus que cela.
Jusqu’ici, j’ai mis en lumière les nuages noirs qui planent sur deux piliers fondamentaux du journalisme : l’indépendance et le pluralisme. Mais selon Reporters sans frontières, le constat est tout aussi sombre concernant le troisième pilier : la liberté.
« Pour la première fois dans l’histoire de l’Indice, les conditions d’exercice du journalisme sont jugées “difficiles” ou “très graves” dans plus de la moitié des pays du monde, et satisfaisantes dans moins d’un quart.
Dans 42 pays — abritant plus de la moitié de la population mondiale — la situation est classée comme ‘très grave’. Dans ces zones, la liberté de la presse est totalement absente et exercer le journalisme y est particulièrement dangereux », souligne RSF.
La Turquie, le pays qui m’a forcé à l’exil, se distingue dans l’Indice RSF 2025 comme un exemple flagrant de « chute libre ». Classée 159e sur 180 pays, elle a perdu 60 places en 23 ans. Elle figure désormais parmi les pires ennemis mondiaux de la liberté des médias.
La Turquie d’aujourd’hui n’emprisonne pas seulement les journalistes — elle détruit systématiquement une profession honorable. Depuis les manifestations de Gezi en 2013, le bureau du président Erdoğan a intensifié la répression de toute critique, transformant le diffuseur public TRT en un simple porte-voix du pouvoir. Les chaînes de télévision critiques — il n’en reste qu’une poignée — sont devenues les médias les plus surveillés et les plus lourdement sanctionnés.
Après douze ans de répression, le paysage médiatique s’est transformé en une véritable machine de propagande “goebbelsienne”, tandis que la petite fraction de médias critiques ou partisans (environ 5 % du secteur) lutte pour survivre. Les poursuites judiciaires contre les journalistes, la censure et la fermeture de rédactions sont devenues monnaie courante, étouffant toute dissidence et limitant l’accès du public à une information impartiale.
Mais ce déclin n’est pas un cas isolé.
En Russie comme en Biélorussie et Azerbaïdjan, tous les médias critiques sont réduits au silence. La Hongrie d’Orban suit le même chemin.
« À Gaza, l’armée israélienne a détruit des rédactions, tué près de 200 journalistes et imposé un blocus total de la bande pendant plus de 18 mois », selon RSF. En Inde, le gouvernement instrumentalise le système judiciaire pour museler le journalisme d’investigation. Au Mexique — où règnent cartels et corruption — le journalisme est l’une des professions les plus dangereuses qui soient.
Le soutien économique aux médias indépendants, les protections juridiques pour les journalistes, et les efforts pour contrer la domination des géants du numérique dans l’écosystème informationnel sont des étapes cruciales.
Sans ces mesures, le déclin de la liberté de la presse — tel qu’observé en Turquie — risque de devenir un phénomène généralisé, menaçant les fondations mêmes des sociétés démocratiques.
Un média libre, indépendant et pluraliste n’est pas une entreprise comme les autres — c’est un bien public, un pilier de la démocratie.
C’est le journalisme libre qui fournit la matière première indispensable à l’autogouvernement.
mise en ligne le 3 mai 2025
Contre la faim à Gaza,
les mots ne suffisent plus
Gwenaelle Lenoir sur www.mediapart.fr
Alors que l’aide humanitaire est bloquée depuis deux mois, de plus en plus de voix critiquent durement Israël. Mais en l’absence de toute sanction, elles sont absolument inefficaces et, dans Gaza, la faim s’installe.
Soixante et un jours de blocus complet. Soixante et un jours sans qu’une tasse de farine, un comprimé d’antidouleur, une boîte de conserve entre dans la bande de Gaza. Des milliers de camions stationnent à proximité des points de passage et des millions de Palestinien·nes sont tenaillé·es par la faim et l’absence de soins médicaux.
Depuis le 2 mars, Israël a hermétiquement bouclé la bande de Gaza. Rien ne lui est plus facile : l’État hébreu a un contrôle total sur les frontières, y compris celle avec l’Égypte.
Une étude menée sur le terrain depuis le 28 avril par l’organisme de surveillance de la faim dans le monde, le Cadre intégré de classification des phases de la sécurité alimentaire (IPC), dira dans quelques jours si la bande de Gaza est passée de « risque de famine » à « famine ».
Les statistiques seront froides, comme celles des victimes des actes de guerre – bombardements, tirs de drones ou de soldats – qui ont redoublé d’intensité après la rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël le 18 mars. Depuis, indique le ministère de la santé de la bande de Gaza, dans son bilan quotidien daté du 1er mai, 2 326 personnes ont été tuées par des opérations de guerre, et 6 050 blessées. Soit 52 418 mort·es recensé·es et identifié·es depuis le 8 octobre 2023, et 118 091 blessé·es.
Les chiffres sont froids, les informations et les images moins. Ainsi le 2 mai, une cuisine communautaire a été bombardée par un drone dans Gaza ville même, tuant au moins cinq personnes. Une tente de deuil à Beit Lahia, dans le nord du territoire, a été visée. Des dizaines de personnes venues présenter leurs condoléances ont été touchées, sept d’entre elles ont succombé. Ce ne sont là que deux épisodes parmi les dizaines rapportés chaque jour par des journalistes ou des témoins à Gaza.
Sentiment d’urgence
« Le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct », écrit Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International dans le rapport annuel qui vient de paraître. « Gaza a été transformée en charnier pour les Palestinien·nes et ceux qui les aident », a déclaré Médecins sans frontières dans un communiqué du 16 avril. « Les autorités israéliennes doivent mettre fin aux punitions collectives infligées aux Palestiniens. Nous demandons instamment aux alliés d’Israël de mettre fin à leur complicité et de cesser de permettre la destruction de vies palestiniennes », conclut le texte.
Nombre de réactions internationales adoptent le même ton pressant : il y a urgence face à cette nouvelle escalade dans la guerre génocidaire d’Israël.
Les Nations unies s’émeuvent, encore plus qu’à l’habitude. « Pendant près de deux mois, Israël a bloqué l’entrée à Gaza de nourriture, de carburant, de médicaments et de fournitures commerciales, privant ainsi plus de 2 millions de personnes d’une aide vitale. L’aide n’est pas négociable. Israël doit protéger les civils, accepter les programmes d’aide et les faciliter », déclare le 30 avril, sur le réseau social X, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.
Déjà, le 8 avril, il avait fustigé le blocus israélien : « Plus d’un mois entier s’est écoulé sans qu’une seule goutte d’aide parvienne à Gaza. Pas de nourriture. Pas de carburant. Pas de médicaments. Pas de fournitures commerciales. Alors que l’aide s’est tarie, les vannes de l’horreur se sont rouvertes. »
La mauvaise conscience de certains pays européens vis-à-vis de l’Holocauste [...] risque de nous rendre complices de crimes contre l’humanité. Josep Borrell, ancien chef de la diplomatie européenne
Même vive critique du haut-commissaire des Nations unies aux droits humains, Volker Türk, qui rappelle qu’affamer une population est une punition collective et un crime de guerre, que les autres États doivent empêcher : « Les États tiers ont clairement l’obligation, en vertu du droit international, de veiller à ce que de tels comportements cessent immédiatement et ils doivent agir en conséquence. »
Les appels se multiplient. D’anciens ambassadeurs et des chercheurs français affirment dans une tribune publiée le 12 avril dans Le Monde : « Aujourd’hui il y a urgence et le silence devient coupable », fustigeant l’« absence de vraie opposition politique et populaire internationale » à une « nouvelle idéologie suprémaciste ». Celle-ci est portée par Israël, qu’ils décrivent comme « un État membre des Nations unies réputé modèle de démocratie [qui] ne respecte plus aucune règle internationale ni aucun principe moral, religieux ou humain ».
Un autre texte, publié fin avril dans le même quotidien, signé par plus de deux cents professeur·es d’université et écrivain·es du monde entier, appelle l’Union européenne à soutenir le projet d’une confédération de deux États indépendants, israélien et palestinien. En somme à prendre l’initiative et à faire à la fois de la diplomatie et de la politique, face à une administration états-unienne hors jeu du fait de son implication manifeste aux côtés du gouvernement israélien. « Le cycle actuel de la guerre, de l’occupation et du déplacement a atteint un point de rupture politique et moral », écrivent ces intellectuel·les.
Des mots, mais pas d’action
C’est de morale aussi, de respect par l’Union européenne de ses propres valeurs, et d’action que parle Josep Borrell dans une tribune du 29 avril, également dans Le Monde. L’ancien haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, qui a quitté ses fonctions le 1er décembre 2024, constate l’émotion suscitée par la photo de cet enfant palestinien amputé des deux bras, qui a remporté le World Press Photo 2025.
« Mais bon sang, s’exclame Josep Borrell. Ce n’est pas un, ni cent, ni mille, ce sont des milliers d’enfants qui sont morts ou ont été mutilés à Gaza. Et dans quelles conditions ! Gaza, c’est d’abord une guerre contre les enfants. » Il ajoute, comme un coup de pied à la nouvelle administration européenne, mais tout en reconnaissant son échec quand il était lui-même en poste : « La mauvaise conscience de certains pays européens vis-à-vis de l’Holocauste, transformée en “raison d’État” justifiant un soutien inconditionnel à Israël, risque de nous rendre complices de crimes contre l’humanité. Une horreur ne saurait en justifier une autre. »
Refuser de secouer son impuissance, c’est bien ce que l’Union européenne persiste à faire. Incapables de se mettre d’accord sur une politique un tant soit peu ferme vis-à-vis d’Israël, ni même de menacer d’envisager une révision de l’accord d’union avec Israël ou une sanction quelconque, les Vingt-Sept remplacent la politique par l’assistance.
Les restrictions à son accès doivent être levées sans délai. L’ensemble des points de passage doivent être levés. Le passage des acteurs humanitaires doit être facilité. Diego Colas, représentant français devant la CIJ
Ainsi, mi-avril, Kaja Kallas, successeuse de Josep Borrell, annonce une aide de 1,6 milliard d’euros étalée jusqu’en 2027 aux Palestinien·nes pour, notamment, renforcer l’Autorité palestinienne et, ainsi, stabiliser Gaza et la Cisjordanie. L’exécutif de l’UE pourrait difficilement sembler plus éloigné des réalités d’un terrain où les destructions massives se poursuivent jour après jour et nuit après nuit, où pas un clou n’est entré depuis le 2 mars et où les bulldozers servant à déblayer les gravats sont eux-mêmes visés par les frappes israéliennes…
Les gouvernements des États de l’UE peuvent donner de la voix, plus personne n’en attend le moindre effet concret. Les ministres des affaires étrangères français, allemand et britannique demandent « instamment à Israël de rétablir l’acheminement rapide et sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza », rappellent le droit international et font état de leur « indignation » devant les frappes israéliennes contre le personnel et les structures humanitaires, sans évoquer à aucun moment une possible action. Ce qui, à coup sûr, laisse absolument indifférent le cabinet de Benyamin Nétanyahou.
« Exceptionnalisme »
Les voilà bien vocaux, également, devant la Cour internationale de justice (CIJ), qui, pour la quatrième fois depuis le 7-Octobre, est appelée à statuer sur une question impliquant Israël.
Saisie en décembre 2024 par l’Assemblée générale des Nations unies à la demande de la Norvège, elle a tenu des auditions toute cette semaine sur les entraves israéliennes au travail de l’UNRWA, l’agence onusienne d’assistance aux réfugié·es palestinien·nes, et à l’acheminement de l’aide humanitaire en général. Plus de quarante États et trois agences onusiennes se sont succédé devant les juges de la CIJ. Si les États-Unis, suivis de la Hongrie, ont, sans surprise, soutenu le point de vue d’Israël à décider seul de quand et comment l’aide allait parvenir à la population de l’enclave palestinienne, nombre de représentant·es diplomatiques ont affirmé fermement les principes du droit humanitaire international.
Le Qatar, pays médiateur entre Ie Hamas et Israël, a dénoncé une « punition collective », accusant Israël d’utiliser « l’aide comme un outil d’extorsion pour avancer ses objectifs militaires ». L’Afrique du Sud, qui porte devant la même CIJ la plainte pour génocide contre Israël, a critiqué l’impunité dont bénéficie Israël, due à « une forme d’exceptionnalisme en ce qui concerne sa responsabilité face aux lois et aux normes internationales ».
La France, qui envisage de reconnaître l’État palestinien en juin, a exigé que l’aide humanitaire parvienne « massivement à Gaza ». « Les restrictions à son accès doivent être levées sans délai. L’ensemble des points de passage doivent être levés. Le passage des acteurs humanitaires doit être facilité », a affirmé le représentant français, Diego Colas.
Seulement, la Cour internationale de justice mettra des semaines à statuer. Et, bien que ses décisions soient contraignantes, elle ne possède aucun moyen de les faire appliquer.
Les Palestinien·nes de Gaza n’ont plus le luxe d’attendre. Les entrepôts du programme alimentaire mondial sont vides depuis une semaine. Les cuisines communautaires, qui recevaient les produits via l’agence onusienne et les préparaient, arrivent au bout de leurs réserves et ferment les unes après les autres. « La faim s’accroît jour après jour. Il n’y a presque plus rien sur les marchés. Ce qui reste atteint des prix délirants. Je ne sais plus quoi faire pour trouver à manger à mes enfants », nous a écrit un jeune père de famille, mercredi 30 avril.
Guerre à Gaza : un bateau humanitaire attaqué par des drones israéliens, selon la Flottille de la liberté
Théo Bourrieau sur www.humanite.fr
Des membres de la Flottille de la liberté, une coalition d’ONG dénonçant le blocus de la bande de Gaza, ont affirmé, vendredi 2 mai, qu’un de leurs navires chargé d’aide humanitaire avait été attaqué par des drones israéliens dans les eaux internationales au large de Malte.
Dans la bande de Gaza, de longue file d’attente sont nécessaires pour tenter d’obtenir un peu de nourriture. Ici, des Palestiniens, principalement des
enfants, tendent des casseroles vides dans le camp de Nuseirat pour recevoir un repas chaud distribué par des organisations humanitaires.
« À 00 h 23, heure maltaise (22 h 23 GMT), le Conscience, un navire de la Coalition de la Flottille de la liberté, a été directement attaqué dans les eaux
internationales », écrit vendredi 2 mai l’organisation dans un communiqué. « Des
drones armés ont attaqué l’avant d’un navire civil non armé à deux reprises, provoquant un incendie et une importante brèche dans la
coque », ajoute la coalition d’ONG militant pour la fin du blocus israélien illégal de la bande de Gaza. Israël n’a pas pour
l’instant pas commenté ces accusations.
Selon les militants, l’électricité a été coupée sur le navire après cette frappe, qui semblait viser le générateur. Aucun blessé n’a été signalé. Après le lancement d’un signal de détresse, Chypre et l’Italie ont envoyé chacun un navire sur les lieux, selon le communiqué.
Les opérations humanitaires à Gaza sont « au bord de l’effondrement total », a mis en garde le même jour le Comité international de la Croix-Rouge. L’Organisation mondiale de la santé avait qualifié jeudi 1er mai « d’abomination » la situation à Gaza, exprimant sa colère face à l’inaction pour venir au secours de sa population.
Guerre à Gaza :
l’Europe devient
un hub quasi intraçable pour armer Israël
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Pour son entreprise génocidaire menée à Gaza, Benyamin Netanyahou a besoin d’équipements militaires sophistiqués. Ils continuent à affluer, malgré les plus de 50 000 morts palestiniens. Le transit se fait par terre, air et mer, le plus souvent via le Vieux Continent. Pister les cargaisons s’avère difficile, car les composants sont fabriqués dans différents pays avant d’être assemblés et expédiés vers Israël.
C’était en mai 2024. Josep Borrell, encore haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, se lançait dans des déclarations surprenantes. Sans doute parce que son mandat prenait fin quelques mois plus tard. « Certains dirigeants disent qu’il y a de nombreux morts à Gaza, mais la question qui doit être posée est : combien de personnes doivent encore mourir ? Devons-nous attendre qu’il y ait 50 000 morts avant de prendre les mesures nécessaires pour empêcher plus de pertes ? » Ce chiffre terrible de 50 000 morts a depuis été pulvérisé.
Si les actionnaires ont sans surprise rejeté la résolution, cette action a permis de (re) mettre en lumière ces activités occultes du groupe, même si les dirigeants de Maersk s’en défendent. Le transporteur a expliqué mener une « politique stricte consistant à ne pas expédier d’armes ou de munitions vers les zones de conflit actives », assurant ne jamais avoir transporté ni armes ni munitions dans le cadre de son contrat avec le gouvernement américain. « Nous menons des vérifications renforcées, en particulier dans les régions touchées par des conflits actifs, notamment Israël et Gaza, et adaptons régulièrement cette vigilance au contexte en évolution », a-t-il certifié.
Pourtant, en mai 2024, un porte-conteneurs de l’armateur s’est vu refuser l’entrée du port espagnol d’Algésiras au motif qu’il aurait à son bord des armes pour Israël. Depuis le printemps 2024, en effet, l’Espagne refuse aux navires transportant une cargaison d’armes à destination de ce pays l’autorisation d’accoster. « Cependant, il semble que Maersk ignore sciemment cette décision, plus de 944 de ses 2 110 expéditions destinées à l’armée israélienne ayant transité par le port d’Algésiras après la date de cette annonce », affirme le Palestinian Youth Movement, qui poursuit : « On ignore si le gouvernement espagnol est au courant de cette situation ou s’il dispose de procédures pour des mesures d’application supplémentaires. »
Des cargaisons « contenant des pièces détachées pour F-35 »
Maersk est également dans le collimateur de DeclassifiedUK, un site d’investigation britannique, qui expliquait le 4 avril que « le géant danois du fret maritime A.P. Moller-Maersk transporte discrètement du matériel d’équipement d’avions de combat vers Israël ». Declassified, qui travaille en partenariat avec The Ditch, un autre site d’investigation, précisait début avril : « Les données indiquent comment les marchandises de l’usine 4 de l’US Air Force à Fort Worth sont transportées vers le port de Haïfa, en Israël, sur deux porte-conteneurs Maersk entre le 5 avril et le 1er mai, puis une société distincte les acheminera par voie terrestre vers la base aérienne de Nevatim. »
L’usine Air Force Plant 4 est une installation appartenant au gouvernement américain et exploitée par Lockheed Martin, le principal entrepreneur du consortium international. Celui-ci produit les avions F-35, conçus pour l’attaque au sol et les missions de supériorité aérienne, financés et réalisés par une dizaine de pays de l’Otan auxquels est associé Israël. Ces composants de F-35 sont acheminés sur la base israélienne de Nevatim, près de Beer-Sheva, d’où partent ces avions furtifs pour bombarder Gaza. Les Houthis du Yémen ont ciblé à plusieurs reprises les bateaux de Maersk dans le détroit d’Aden.
Évoquant Maersk Detroit et Nexoe Maersk, des dirigeants ont reconnu que ces bateaux incriminés « transportent des conteneurs contenant des pièces détachées pour F-35. Cependant, ces expéditions sont destinées à d’autres pays participant au programme F-35. Dans le cadre de la construction de la coalition pour le F-35, Maersk Line Limited transporte régulièrement des pièces détachées entre les pays participants, dont Israël, où sont fabriquées les ailes du F-35. Ces expéditions sont toutefois effectuées pour le compte de fournisseurs, et non du ministère israélien de la Défense. »
Ce qui, en soi, ne prouve rien quand on sait que l’industrie de la défense, en Israël comme ailleurs, n’est plus seulement entre les mains des États. Des compagnies privées, dont Elbit Systems en Israël, en tirent d’énormes profits et il est difficile de tracer les volumes de production ainsi que leurs destinations. Les différentes pièces sont fabriquées dans plusieurs pays puis expédiées là où elles seront finalement assemblées, souvent aux États-Unis, avant d’être réexpédiées via l’Europe et la Méditerranée.
Quatre entreprises irlandaises incriminées
Parti le 5 avril du port de Houston (Texas), Maersk Detroit, le premier navire, a fait escale à Casablanca (Maroc) le 18 avril, puis le 20 à Tanger où l’attendaient des milliers de Marocains venus protester aux cris de : « Le peuple veut l’interdiction du navire », « Pas d’armes génocidaires dans les eaux marocaines ». Ils ont également appelé à la fin de la normalisation entre le Maroc et Israël, actée fin 2020 en échange de la reconnaissance par Washington de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental.
Le second navire, Nexoe Maersk, dans lequel était transbordée la marchandise, devait par la suite faire escale à Fos-sur-Mer. Alertés, les dockers CGT sont intervenus. « Maersk a mis à disposition le manifeste du navire et l’ensemble des conteneurs a été contrôlé. Rien à signaler, ni armes ni pièces », a fait savoir le syndicat. Difficile en l’absence de preuves tangibles d’aller plus loin, même si les dockers réaffirment « militer pour la paix et l’arrêt du génocide ». Le Nexoe Maersk se trouve maintenant dans le port de Haïfa et doit appareiller bientôt pour l’Égypte.
Il reste que des armes partent bien vers Israël. Ainsi, The Ditch affirme que « quatre entreprises irlandaises fournissent des pièces détachées au principal fournisseur d’armes de l’armée israélienne », à savoir Elbit Systems, dont le siège social est à Haïfa. Des pièces très certainement plus difficiles à détecter comme composants d’armements. C’est le cas des adhésifs UV Optimax, livrés par Novachem, basé dans le comté de Meath. Le 11 mars, Powell Electronics, basé dans la ville irlandaise de Kildare, a expédié des marchandises décrites comme des « connecteurs » sur les bordereaux d’expédition à l’usine Cyclone d’Elbit Systems à Karmiel, au centre de la Galilée. Cette usine fabrique des pièces pour les avions de chasse F-35 et F-16.
Les exportations françaises
Une enquête publiée par le site Disclose et le journal Marsactu, le 25 mars 2024, a affirmé que la France avait envoyé, à la fin du mois d’octobre 2023, au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils-mitrailleurs susceptibles d’être utilisés à Gaza. En septembre 2024, Fabien Gay, sénateur communiste (par ailleurs directeur de notre journal), interrogeait le ministre français des Affaires étrangères sur les ventes d’armes opérées par la France à Israël en 2023 et 2024.
Il rappelait à cette occasion : « L’existence d’un risque génocidaire plausible à Gaza, reconnu par une haute instance internationale, oblige désormais expressément l’ensemble des États, qui sont notamment tenus de cesser tout export d’armes, de matériels ou de technologies militaires vers Israël. » Le gouvernement français, poussé dans ses retranchements, devait finalement avouer procéder à des exportations, mais que « celles-ci ne sont autorisées que dans un cadre strictement défensif ».
« Les données officielles ne disent rien, par exemple, des livraisons d’armes d’entreprises françaises via d’autres pays », fait remarquer l’Observatoire des multinationales. « C’est ainsi qu’un capteur sensoriel produit en France par Exxelia avait été retrouvé parmi les débris d’un missile qui a tué trois enfants en 2014 à Gaza. » Le syndicat CGT de l’entreprise STMicroelectronics Crolles indiquait dans une lettre adressée aux « camarades syndicalistes de Palestine », en date du 11 décembre 2023 : « Nous n’avons pas aujourd’hui d’éléments sur la présence de puces fabriquées dans nos usines dans l’armement israélien qui frappe avec tant de violences le peuple palestinien. Mais cela reste possible. »
Tout est effectivement possible, même et surtout l’impensable. The Ditch a identifié six vols cargo de la Lufthansa qui transportaient des composants essentiels pour les avions de combat F-35 de l’armée israélienne à travers l’espace aérien souverain irlandais en avril, mai, juin et juillet 2024. Rien ne dit que cela ne continue pas. Surtout pas les cris d’orfraie poussés par les gouvernements européens. En secret et sans aucun contrôle des peuples, ils continuent à laisser les canaux ouverts, alimentant ainsi Israël dans son entreprise génocidaire à Gaza.
mise en ligne le 3 mai 2025
L’État à l’encan
Par Jean-Christophe Le Duigou sur www.humanite.fr
Les choix d’une austérité renforcée qui s’annoncent font peser une incertitude quant au devenir de l’État pour la période qui s’ouvre. Sa situation financière dégradée, qui se manifestera au fil des budgets par un coût de la dette publique croissant, comptera beaucoup. Les marchés financiers vont faire peser une hypothèque sur les dépenses utiles. Il ne suffira pas dès lors au président de la République d’invoquer, au fil de ses interventions sa conviction que « l’État tient la Nation ». L’addition risque d’être lourde. À l’opposé, l’irrésistible montée des besoins de services, donc aussi de services publics, ne pourra être ignorée.
L’avenir de la puissance publique
Le devenir de la puissance publique sera largement influencé par la nature des arguments que les forces sociales auront la capacité d’imposer. Le mouvement syndical et plus largement le mouvement social et politique sont légitimes à imposer une véritable confrontation sur l’avenir de la puissance publique. Le peuvent-ils ?
Au-delà des luttes tenaces qui marquent un certain nombre de secteurs (hôpital, recherche, université, poste, finances…), au-delà des batailles pour relégitimer des politiques publiques dignes de ce nom comme en matière industrielle, d’énergie, de transport, de logement, quelques initiatives transversales sont nées dans la dernière période.
Ces initiatives, qui participent pleinement du mouvement d’opposition aux mises en cause des services publics, peinent cependant à déboucher sur des mobilisations massives, en tout cas suffisantes pour créer le rapport de force indispensable. Est en cause notre capacité collective à définir et porter les lignes directrices d’une véritable réforme de l’État. Cet effort de proposition est pourtant indispensable. Il implique de répondre à une série de questions nouvelles qui balisent la voie pour un nouveau modèle de pouvoir.
Le nouveau profil du pouvoir de demain va se jouer en fait autour de plusieurs questions essentielles qui renvoient aux fondements des missions publiques : que peut apporter la puissance publique à une nouvelle logique de développement ? Quels seront le sens et la place de la loi et de la gestion publique ? Que sera l’intervention publique notamment dans les champs économiques et sociaux ? Quel sera le rapport entre droits individuels et systèmes collectifs de solidarité ?
Ne s’agit-il pas en fait, après « l’État monopoliste social » de tracer les contours d’un nouveau type d’État, « l’État-social-développeur ».
mise en ligne le 2 mai 2025
Islamophobie :
le pouvoir en panne de solutions
Ilyes Ramdani sur www.mediaqpart.fr
Depuis le crime de La Grand-Combe, l’exécutif peine à apporter d’autres débouchés politiques que des formules incantatoires sur l’universalisme et la République. Tel un symptôme de l’échec d’Emmanuel Macron et de ses soutiens à penser le racisme et les discriminations.
Moins d’une semaine après l’assassinat d’Aboubakar Cissé, vendredi 25 avril à La Grand-Combe (Gard), l’exécutif tente toujours de se dépêtrer des accusations d’apathie qui l’accablent. À la tribune de l’Assemblée nationale, mardi, les figures de la coalition au pouvoir ont multiplié les grandes déclarations pour assurer de leur émotion et de leur détermination à agir. « Jour après jour, nous défendrons notre devoir de vivre ensemble », a promis le premier ministre François Bayrou.
Avant lui, Gabriel Attal, chef de file du parti présidentiel, a appelé à « lutter pour la République », qui « rassemble » et qui « protège », ainsi que pour « l’universalisme ». Un concept également utilisé par Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, qui a résumé sa pensée d’une formule : « La République, toute la République, rien que la République ! »
La ligne défendue mardi est celle qu’avait appelée de ses vœux Emmanuel Macron, la veille, en ouverture du conseil des ministres. Ainsi que l’a raconté Le Parisien, le président de la République a demandé, en réaction au drame survenu dans le Gard, à se tenir « derrière chaque Français » et exhorté ses ministres à tenir « un discours ultrarépublicain ».
Dans l’esprit du chef de l’État et de ses soutiens, l’invocation du totem républicain est une manière habile d’envoyer deux messages en un : d’un côté, dénoncer le crime de La Grand-Combe et défendre l’égalité comme principe ; de l’autre, s’en prendre à La France insoumise (LFI), accusée de récupération et de clientélisme électoral. « Honte à ceux qui font le choix du pire, le choix du communautarisme ! », a lancé Gabriel Attal, applaudi au centre, à droite et à l’extrême droite.
Bayrou réunit des ministres… pour parler de l’espace
L’emphase du camp présidentiel peine toutefois à masquer sa difficulté à donner une suite politique à l’attaque du 25 avril. « On sent qu’ils ont réalisé au bout de quelques jours l’extrême gravité de ce qu’il s’est passé, pointe la députée écologiste des Hauts-de-Seine Sabrina Sebaihi. Mais, pour le moment, ils en restent au stade de la communication. Si aucun acte fort ne suit derrière, ça sera même le symbole d’une grande hypocrisie. »
C’est également la demande qu’ont formulée à l’adresse d’Emmanuel Macron Chems-Eddine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris, et Najat Benali, présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris, reçu·es mardi à l’Élysée. Dans un communiqué, les deux représentant·es du culte ont dit avoir exprimé auprès du président de la République « l’attente légitime d’actes concrets et de décisions courageuses » pour lutter contre la haine antimusulmane.
« Seule une réponse à la hauteur de l’épreuve que traverse notre société permettra de restaurer la confiance abîmée et de préserver l’unité de la Nation », indique leur texte. La réponse, justement, peine à se dessiner au sommet de l’État. Pourtant adepte de réunions de réflexion à l’heure du petit-déjeuner, François Bayrou n’a rien changé à son agenda de la semaine. Et si plusieurs membres du gouvernement ont bien été invités à Matignon vendredi matin pour phosphorer, c’est au sujet… de la stratégie spatiale de la France.
Comme un symbole, le principal débat de fond qui a émergé de l’émotion est celui qui a entouré l’usage du terme « islamophobie ». À gauche comme au sein du « bloc central », des divergences continuent de se faire entendre sur le sujet. Après que François Bayrou a parlé d’une « ignominie islamophobe » sur le réseau social X, le ministre des outre-mer, Manuel Valls, a pointé un « terme qu’il ne faut pas employer ». Une ligne partagée, entre autres, par Bruno Retailleau et Aurore Bergé ; cette dernière assumant de « récuser fermement » le mot.
Coauteur d’un rapport parlementaire sur le sujet, le député Ensemble pour la République Ludovic Mendes reconnaît que la question clive dans les rangs de l’ex-majorité. « Il existe un manque de connaissance et de fraternité sur ces sujets-là, pointe l’élu de Moselle, porte-parole du groupe dirigé par Gabriel Attal. Je crois qu’après ce qu’il s’est passé, plus personne ne peut dire que l’islamophobie n’existe pas en France. Ce n’est pas seulement un acte antimusulman, c’est un acte islamophobe, perpétré dans un lieu de culte. »
L’échec de Macron sur les discriminations
Au-delà du débat sémantique, le camp présidentiel paraît bien en peine de donner du contenu politique à son ode à l’universalisme républicain. Le défi paraît ambitieux après de longues années passées à aborder la question de l’islam à travers le seul prisme de sa visibilité dans l’espace public – et de la manière de la réduire. « Cela fait des semaines, des mois, des années que le seul débat est celui-ci, déplore l’écologiste Sabrina Sebaihi, qui a tenté de créer un groupe d’étude sur l’islamophobie à l’Assemblée nationale. Dès qu’on ose parler de ça, on nous oppose systématiquement la laïcité. Et rien n’avance. »
Le temps paraît loin où Emmanuel Macron se faisait élire président de la République sur la promesse d’une lutte acharnée contre les discriminations. Huit ans plus tard, l’aveu sort de la bouche d’un de ses plus proches conseillers : « C’est sûrement notre principal échec et notre principal regret. » Un ancien ministre partage, dans un soupir, la même déception. « Il considère qu’il a sur les bras une société française qui s’est droitisée, glisse-t-il au sujet du chef de l’État. J’ai envie de croire qu’il a gardé une sensibilité sur le sujet mais il l’a mise en veilleuse. »
Au rang des explications, le mouvement constant du président de la République vers les idées, l’électorat et les cadres de la droite traditionnelle figure évidemment en bonne place. « Tout ça s’inscrit dans des rapports de force où l’extrême droite dicte très fortement l’agenda politique, soulignait récemment le sociologue Julien Talpin, spécialiste des discriminations. La porte, ouverte par Macron en 2017, s’est refermée. Le sujet a disparu de l’agenda macroniste, en partie par peur de donner de l’eau au moulin du Rassemblement national et de finir par le renforcer. »
Si elle est incontestable, l’implantation droitière d’Emmanuel Macron ne suffit pas à expliquer une telle désertion de la lutte contre les discriminations. Dans les années 2000, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont tenu des discours beaucoup plus volontaristes que ceux du moment sur la nécessité d’une lutte ferme contre le racisme et les discriminations.
Ce qu’on dit aux macronistes, c’est : il y a un climat oppressant d’islamophobie, vous avez contribué à l’installer mais vous avez maintenant une chance de vous rattraper. Alors agissez. Sabrina Sebaihi, députée écologiste des Hauts-de-Seine
En 2005, dans un discours sur le sujet, le premier évoquait par exemple la nécessité de ne pas s’en tenir à un discours creux sur l’égalité, celle-ci n’étant « pas un principe gravé une fois pour toutes dans le marbre ». Et le président de la République d’alors de rappeler la nécessité de donner des moyens à la lutte contre le racisme et à « sans cesse affirmer, enrichir, défendre le principe vivant qu’est l’égalité ».
Vingt ans plus tard, le discours chiraquien a laissé place à des incantations creuses sur la République, l’égalité, l’universalisme ; autant de concepts mis en avant comme des acquis intemporels, dont la proclamation suffirait à l’effectivité. Parmi les soutiens d’Emmanuel Macron, quelques-uns invitent timidement à enfourcher à nouveau le cheval de l’antiracisme et de la lutte contre les discriminations. « Mais pour dire quoi ? », répond en creux un de ses proches.
Faute de travail sur le sujet, les propositions se font rarissimes. Et les interlocuteurs qui maintenaient ces sujets-là à l’esprit du président de la République se sont, pour la plupart, éloignés de l’Élysée et du fil Telegram de son locataire. « Il y a une attente extrêmement forte sur le sujet mais ce sont des politiques publiques qui ne se mettent pas en place avec une mesure-choc et de la communication, souligne le chercheur Julien Talpin. Cela demande du travail, des dispositions concrètes à appliquer, des moyens à allouer et des positionnements symboliques à tenir. »
À gauche, Sabrina Sebaihi appelle son camp à ne pas laisser la prochaine actualité chasser celle-là. « Notre responsabilité, c’est de ne pas lâcher, souligne-t-elle. Ce qu’on dit aux macronistes, c’est : il y a un climat oppressant d’islamophobie, vous avez contribué à l’installer mais vous avez maintenant une chance de vous rattraper. Alors agissez. Je ferai partie de ceux qui ne lâcheront pas, pour qu’on n’oublie pas Aboubakar Cissé. Sinon, c’est le genre d’abandon qui peut rompre la confiance des gens dans les institutions. »
D’autres appels de ce type se sont déjà fracassés sur le mur de l’indifférence du camp présidentiel. À l’été 2020, lorsque la mort de George Floyd aux États-Unis et d’importantes mobilisations en France avaient poussé le chef de l’État à parler de « violences policières », il avait suffi que les syndicats de police lèvent la voix pour qu’Emmanuel Macron limoge son ministre de l’intérieur et jette ses ambitions de réforme de la police à la poubelle.
Rebelote à l’été 2023, lorsque la mort de Nahel Merzouk à Nanterre avait fait émerger des revendications sur l’état des quartiers populaires, la relation entre les jeunes et la population ou encore l’égalité d’accès aux services publics. Après avoir donné l’impression d’être prêt à les entendre, le président de la République avait répondu aux révoltes par un mot d’ordre simplissime : « L’ordre, l’ordre, l’ordre. » Sans rien faire des appels à combattre les discriminations dans le pays.
« Actes antimusulmans » : le grand flou des chiffres du ministère de l’intérieur
Sarah Benichou sur www.mediapart.fr
Les chiffres comptabilisés par la police, boussole officielle pour le recensement des actes antimusulmans, sont parcellaires et éloignés de la réalité du racisme au quotidien. Surtout, ils ne permettent pas d’enclencher des politiques publiques dignes de ce nom.
« Qui peut croire qu’en 2025, on annonce 173 actes antimusulmans pour l’ensemble de l’année 2024 ? », interroge, au lendemain de l’assassinat d’Aboubakar Cissé, Bassirou Camara, président de l’Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (Addam), créée en février 2024 au sein du Forum de l’islam de France (Forif).
Présenté en février par le ministre de l’intérieur, « ce chiffre est largement en deçà de la réalité », commente ce responsable associatif, également secrétaire général de la Fédération musulmane du Tarn et pour qui l’annonce ministérielle, mardi 29 avril, d’une hausse de 72 % des actes « antimusulmans » au premier trimestre 2025 ne résout pas le problème : « Il faut des chiffres construits avec méthode, non pas pour le plaisir d’avoir des chiffres mais pour permettre aux décideurs d’avoir une vue plus objective et plus réaliste du phénomène. »
En lien avec le ministère de l’intérieur, le Forif, soutenu par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), l’homme s’apprête donc à lancer une plateforme en ligne devant permettre aux victimes de signaler « tout acte antimusulman ».
Si les chiffres du ministère de l’intérieur quantifiant les actes antisémites sont régulièrement, et unanimement, mobilisés par les acteurs de la lutte contre l’antisémitisme, leur pendant pour les actes antimusulmans suscite de nombreuses interrogations, frustrations et critiques parmi les associations musulmanes et les militant·es contre l’islamophobie.
Issus d’une collecte organisée par les services de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT), que racontent et ne racontent pas ces chiffres très mobilisés dans le débat public ? Invité à réagir sur ce débat récurrent, le ministère de l’intérieur n’a pas répondu à nos questions.
Les plaintes comme seules sources
Pour la sociologue Nonna Mayer, membre de l’équipe produisant le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les chiffres de la DNRT « sont un instrument très utile pour nous donner un reflet minimal des incidents antisémites et antimusulmans les plus graves » et des moments où le nombre de ces actes « explose », mais « on ne peut pas demander plus qu’il ne donne à cet indicateur ».
En effet, ce décompte est le seul disponible offrant une distinction entre actes antisémites et actes antimusulmans, alors que les statistiques dites « ethniques » restent officiellement impossibles en France. Nonna Mayer souligne aussi que c’est grâce à ces chiffres de la DNRT qu’une augmentation de 223 % des actes antimusulmans avait pu être documentée, en 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher et le Bataclan.
Parce que les meurtres, les viols, les menaces de mort, les agressions physiques ou les atteintes aux lieux de culte sont enregistrés par les services de police ou donnent lieu à plus de plaintes, ils constituent une part importante des chiffres de la DNRT. Pourtant, « ce sont les agressions verbales, les injures ou les discriminations au quotidien qui pourrissent la vie des gens », explique Nonna Mayer, soulignant que ces expériences, à l’inverse, ne donnent que rarement lieu à des plaintes.
Les chiffres de la DNRT échouent donc à saisir la « granulosité » du racisme, considère également la sociologue de l’islam Hanane Karimi, mais aussi son ampleur. Issus d’une chaîne de « filtres », à travers lesquels diverses informations se perdent, ces « chiffres du ministère de l’intérieur » ne permettent donc ni de décrire, ni de comparer correctement les racismes entre eux.
Des « filtres »
Le premier est immense et englobe toutes les victimes de racisme : ne pas déposer plainte constitue la norme. Alors que, dans l’Hexagone, plus de 1 million de personnes déclarent avoir subi au moins un acte raciste au cours de l’année en 2022, moins de 3 % ont déposé plainte, selon la dernière enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS).
Deux autres filtres se situent au niveau policier : rien ne garantit qu’une plainte soit effectivement enregistrée, ni qu’elle le soit comme relevant d’un motif « raciste » ou « antireligieux » (ce sont les deux motifs pris en compte par la DNRT). En effet, la compréhension du racisme par les policiers peut manquer de repères et de rigueur, comme l’ont montré trois chercheuses, en 2019, dans l’enquête « Saisir le racisme par sa pénalisation ? ».
Un autre « filtre » correspond à un éloignement singulier des musulmanes et musulmans de la police. « Les lois séparatisme ou immigration n’encouragent probablement pas les musulmans à pousser la porte d’un commissariat », estime Nonna Mayer.
Pour Hanane Karimi, l’approche sécuritaire de l’islam et des musulmans par les politiques et les législateurs depuis plus de trente ans produit des « effets de marginalisation » que « les individus incorporent et qui ont des effets dans leur quotidien ». Ainsi, les comportements « des policiers vis-à-vis des jeunes Arabes et Noirs ou les perquisitions qui ont traumatisé des milliers de familles ont, parmi tant d’autres mesures, installé une véritable crainte de la police parmi les musulmans ».
Par ailleurs, lorsque des victimes d’islamophobie franchissent le pas, la chercheuse observe de nombreuses similitudes entre les conditions hostiles de ces dépôts de plainte et celles décrites par les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles.
« Et la comparaison ne s’arrête pas là », poursuit-elle : « Si déposer plainte ne débouche sur rien, voire expose à des violences supplémentaires, pourquoi le faire ? » Seule solution pour gagner en confiance, être accompagné·e et soutenu·e par une association – « ce que faisait le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) », rappelle Hanane Karimi.
Autodissous pour déménager à Bruxelles avant d’être dissous en conseil des ministres en 2021, le CCIF s’est mué en Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE). Il a perdu sa visibilité médiatique en France mais continue son travail. Reconnu parmi les musulmanes et les musulmans de France, la structure continue de recenser les signalements et d’accompagner juridiquement les victimes d’islamophobie dans leurs démarches. Pour 2024, le collectif comptabilise, lui, 1 037 actes islamophobes, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023.
« Islamophobes » ou « antimusulmans »
Un autre « filtre » pèse sur la capacité de mesure de l’islamophobie par la DNRT, qui utilise l’expressions d’« actes antimusulmans ». Ici se révèlent de manière très concrète les enjeux du débat sémantique entre les deux formulations. Certains actes islamophobes peuvent ne pas apparaître dans les chiffres des « actes antimusulmans » parce qu’ils sont enregistrés « dans les actes anti-Arabes, ou dans les “autres” actes racistes », explique Nonna Mayer.
Pour ventiler ses données, la DNRT dispose en effet de deux grandes catégories : les « actes racistes » et les « actes antireligieux ». Ces derniers regroupent les actes antisémites et antimusulmans ainsi que les actes antichrétiens, et ceux « contre les autres religions ». Dans les « actes racistes », pêle-mêle, se retrouvent tous les actes arabophobes, négrophobes, antiasiatiques, romaphobes, etc.
Alors que l’ensemble des actes visant les juifs en tant que juifs sont comptabilisés dans la catégorie « actes antisémites » – « qu’ils portent sur l’appartenance religieuse de la personne ou son rôle social fantasmé comme le pouvoir ou l’argent », indique Nonna Mayer –, dans la catégorie des « actes antimusulmans » ne sont comptabilisés que les propos ou actes visant très explicitement la religion, c’est-à-dire la pratique, les édifices religieux.
Ainsi, une plainte pour avoir été agressée physiquement en se faisant traiter de « terroriste », parce qu’identifiée comme musulmane, ne rentrerait probablement pas dans la catégorie des « actes antimusulmans » de la DNRT. Les actes islamophobes se trouvent, donc, non seulement singulièrement sous-déclarés, sous-enregistrés mais, aussi, dispersés entre deux groupes.
L’islamophobie, un « fait social »
Surtout, pour Hanane Karimi, « la mesure d’actes ponctuels ne permet pas de saisir la violence du racisme aussi bien qu’en saisissant la répétition d’actes discriminatoires qui, elle, produit d’autres effets ». L’accumulation diffuse et omniprésente, la marginalisation, des rappels à l’ordre insidieux ou menaces institutionnelles pèsent autant que les injures ou la violence, explique-t-elle.
« J’ai rencontré des jeunes femmes portant le foulard qui marchaient déjà courbées, d’autres qui ne pouvaient plus se regarder dans la glace ou qui pleuraient beaucoup : le racisme, au quotidien, altère et modifie les corps, la santé mentale. »
Elle ajoute : « Quand l’accès au travail, aux loisirs, à l’école, à la rue même devient difficile ou dangereux, on finit par se retirer, c’est ce que j’appelle une mort sociale. » Et pour ces cas-là, personne ne tient les comptes.
Sans la reconnaître, on s’empêche de documenter l’islamophobie et de la combattre. Hanane Karimi, sociologue
Directeur de recherche à l’Institut national d’études géographiques (Ined), Patrick Simon partage l’approche de Hanane Karimi. L’enquête « Trajectoires et origines 2 », réalisée par l’Ined et l’Insee en 2019-2020 sur un échantillon de 26 500 personnes – dont 7 500 musulman·es –, relève que 10 % des musulman·es ont déclaré une discrimination religieuse en 2019-2020, contre 5 % en 2008-2009. « Un doublement, c’est une très forte hausse », insiste le démographe, qui regarde les « fluctuations » des chiffres du DNRT avec circonspection. « Ils ne permettent qu’une approche très limitée, du racisme réduit à ses formes d’expression les plus explicites ou violentes. »
L’appartenance à l’islam est « devenue un facteur de discrimination et d’exposition au racisme très marquant », résume le chercheur, pour qui cela « traduit le durcissement de la stigmatisation des musulmans dans le débat public, ainsi qu’une plus grande visibilité des discriminations religieuses venant s’ajouter aux discriminations en raison de l’origine ou la couleur de peau ». Ces statistiques reflètent « de façon plus fiable la place qu’a prise l’islamophobie dans les rapports sociaux et politiques,en dix ans ».
En décembre 2024, l’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur rendait un rapport à la suite d’un testing réalisé sur 2 000 petites ou moyennes entreprises (PME) d’Île-de-France : porter un foulard pour postuler à une alternance professionnelle abaisse de plus de 80 % les chances de recevoir une réponse positive, que les candidates soient blanches ou non.
Des chiffres qui recoupent ceux déjà produits par le Défenseur des droits, qui « fait partie des premières institutions officielles à avoir utilisé le mot “islamophobie” et à avoir documenté le phénomène », souligne Hanane Karimi.
Les conséquences de ce déni sont multiples : « Sans la reconnaître, on s’empêche de documenter l’islamophobie et de la combattre », et ce déni fournit, également, « le carburant d’une mise en concurrence » entre les victimes d’islamophobie et les victimes d’antisémitisme, alerte Hanane Karimi.
Bassirou Camara, le président de l’Addam, l’avoue sans difficulté : s’il a fait le choix d’utiliser la terminologie du ministère de l’intérieur, en parlant d’« actes antimusulmans » seulement, c’est pour s’éviter que des portes politiques se ferment.
Pour l’Addam, précise-t-il, « un fait antimusulman, désigne tout fait raciste, discriminatoire ou haineux visant une personne ou une institution, quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ».
Bassirou Camara veut convaincre les autorités de la nécessité de mettre en place des politiques publiques contre l’islamophobie, « quelle que soit la façon dont on l’appelle ». Il souligne que le sujet est, d’ailleurs, complètement absent du dernier plan de lutte contre le racisme.
« Ce n’est pas une coquetterie de vocabulaire. L’islamophobie, c’est un fait social », veut rappeler la chercheuse Hanane Karimi, pour qui le débat sémantique entre « islamophobie » et « actes antimusulmans » agit comme un écran de fumée pour ne pas parler du fond du problème, « le refus de nommer le racisme ».
La sociologue revient sur les propos de l’assassin d’Aboubakar Cissé : « Il a émis une critique de la religion, il a dit : “Ton Allah de merde.” » Pour elle, ces mots sont les mêmes que ceux qu’utilisent les agresseurs et agresseuses des femmes qui portent le foulard : « Ces mots tuent, le racisme tue. »
mise en ligne le 2 mai 2025
À Dunkerque,
« si ArcelorMittal tombe, c’est toute la région qui est menacée »
Elisa Perrigueur sur www.mediapart.fr
Près de 1 500 personnes ont manifesté jeudi 1er mai à l’appel de la CGT, après l’annonce de la suppression de plus de 600 postes en France par le géant de l’acier ArcelorMittal. Plusieurs figures nationales de gauche ont fait le déplacement.
Dunkerque (Nord).– Un ouvrier CGT s’égosille à la tribune dressée près de la gare. Il annonce déjà la prochaine action : une descente à Paris, le 13 mai, pour le prochain comité social et économique (CSE) d’ArcelorMittal. Des bus seront affrétés. Un collègue lui succède au micro : sans réponse sur leur sort dans les deux mois, les salarié·es vont « tout bloquer » et empêcher le passage du Tour de France, début juillet, entre Valenciennes et Dunkerque, prévient-il.
En fond, la sono crache « La jeunesse emmerde le Front national » de Bérurier noir. Dans le cortège, on arbore des banderoles et stickers « Du métal sans Mittal ».
Les salarié·es d’ArcelorMittal, qui tractent depuis des semaines sur les marchés du coin, veulent montrer à la foule, des hommes, des femmes, des adolescent·es, que la lutte ne fait que commencer face aux 636 suppressions de postes annoncées en France par le géant de l’acier ArcelorMittal.
Des ténors de la gauche ont pris la route de Dunkerque, jeudi 1er mai, pour les soutenir, à l’image du député de la Somme François Ruffin, du premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure ou de la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier… Au total, environ 1 500 personnes ont répondu à l’appel de la CGT, pour « défendre l’industrie et sauver ArcelorMittal ». Trois fois plus de monde que l’année précédente, précise un syndicaliste, qui se dit « satisfait ».
Le géant de l’acier avait accentué la colère des Nordistes en détaillant deux jours plus tôt son plan sur les sept sites français concernés. Dunkerque est en première ligne, avec 295 emplois supprimés sur son site de Grande-Synthe qui en compte 3 200.
Subissant la chute de l’automobile européenne, la flambée des prix de l’énergie, la concurrence des entreprises chinoises, la multinationale s’attaque surtout aux postes de maintenance, faisant craindre une stratégie du délitement et un désengagement progressif.
La peur pour la région
Hélène Casteleyn, fonctionnaire territoriale à la retraite, s’en inquiète : « C’est un tsunami dans le Dunkerquois », qui compte 200 000 habitant·es. L’usine sidérurgique, entrée en fonction en 1963, sous le nom d’Usinor, devenue Arcelor en 2002, puis ArcelorMittal en 2006, rachetée par le groupe Mittal Steel, fondé par l’indien Lakshmi Mittal, « avait suscité beaucoup d’espoir à la reprise », se souvient-elle. « Cela a fonctionné pendant une dizaine d’années. Mais les politiques et l’Europe ne soutiennent pas l’acier. »
Pour Timothée Bracco, 16 ans, qui a rejoint des amis dans la foule, « le combat est intergénérationnel » « Je connais plein de parents d’amis qui y travaillent. Les ouvriers sont les premiers touchés par les politiques économiques libérales. Vivre sans Arcelor, ce serait un énorme choc. »
Si Arcelor meurt, Dunkerque meurt, les usines tombent. Patrice Ryckebusch, ouvrier retraité
Le terme « poumon » de l’économie dunkerquoise revient souvent. Impossible de ne pas voir cet horizon de ferraille fumant au bout de la digue de Malo-les-Bains, où les badauds sont venus par centaines en quête de moules-frites et de bains de mer, ce 1er-Mai. S’étirant sur 450 hectares, le mastodonte recrache jusqu’à 7 millions de tonnes d’acier par an que l’on retrouve dans les voitures, les boîtes de conserve…
« Si ArcelorMittal tombe, c’est toute la région qui est menacée. Ce sera un effet domino pour l’économie et nos services. Par exemple, elle finance à hauteur de 3 millions d’euros par an le service de bus gratuits de Dunkerque. Allez à Grande-Synthe, le midi, les ouvriers qui déjeunent dépendent tous d’Arcelor. Elle génère des dizaines de milliers d’emplois indirects », précise Gaëtan Lecocq.
Le secrétaire général CGT chez ArcelorMittal Dunkerque, casque de chantier vissé sur la tête, est devenu la figure médiatisée de cette contestation. Ce technicien logistique rappelle, voix calme, qu’Arcelor est aussi une affaire de famille. On y travaille de mère et père en fils et filles depuis des décennies. Lui-même incarne ce schéma : « Trois générations qu’on travaille à Arcelor ! »
L’usine puise dans le bassin d’emploi. Depuis 2023, le sidérurgiste a même sa propre école, la « Steel Academy », pour « optimiser » son recrutement local. Patrice Ryckebusch, ouvrier retraité au chapeau orné de pin’s du carnaval – une institution dans la ville –, soupire : « Mon beau-fils vient d’être embauché en CDI, il a même pris un crédit pour sa maison… Si Arcelor meurt, Dunkerque meurt, les usines tombent. »
À gauche, l’appel à l’État
Le cas actuel d’ArcelorMittal résonne fort chez David Croquelos. L’homme au teint hâlé et gilet rouge longe avec la foule les canaux de Dunkerque. Il l’assure : les plans sociaux, les délocalisations, sans qu’aucune solution se dessine, il en a connu. « J’ai travaillé à l’usine Eupec à Gravelines, qui travaillait elle-même avec ArcelorMittal. Nous aussi, nous avons eu notre saignée. En 2020, ils ont délocalisé mon poste et m’ont proposé d’aller en Inde, avec ma famille, avec un salaire local ! »
Les dirigeants du Parti socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, Olivier Faure et Patrick Kanner, lors du défilé du 1er-Mai dans les rues de Dunkerque (Nord), avec les salariés d’ArcelorMittal. © Photo Edouard Bride pour Mediapart
Depuis la proposition de cette « fausse solution », il vivote difficilement de petits boulots dans le BTP et l’horticulture en attendant la retraite. « Les ouvriers, on se connaît tous ici, on est tous solidaires », insiste-t-il.
Mais que peut le politique face aux plans sociaux de multinationales privées ultrapuissantes ? Dans le cortège, on rappelle avec amertume qu’ArcelorMittal aurait même dû être un acteur de poids de la transition écologique. L’usine a lancé en 2024 en grande pompe un fameux projet de « décarbonation ». Elle est l’un des plus gros polluants du secteur industriel du dunkerquois, qui génère plus de 13 millions de tonnes de CO2 par an, soit 21 % des émissions industrielles de France.
Fin 2024, Arcelor a retropédalé, suspendant ce plan chiffré à 1,8 milliard d’euros, dont une aide de l’État allant jusqu’à 850 millions d’euros. « Quelques millions avaient déjà été investis », assure la CGT.
C’est le deux poids, deux mesures, « comme toujours », peste Richard, salarié de l’hôpital maritime de Zuydcoote, commune du littoral. « Les services publics qui prétendument ne rapportent pas n’ont rien et les entreprises privées ont des aides en un claquement de doigts, s’indigne-t-il. Arcelor a pris des millions d’aides publiques [392 millions d’euros d’aides publiques de 2013 à 2023 – ndlr], alors que notre hôpital, qui a besoin de rénovations, n’a jamais assez. Le service public s’endette, alors que le privé se gave sans contrepartie. C’est de la maltraitance institutionnelle et ça devient intolérable ! »
À gauche, la réponse face à l’annonce d’ArcelorMittal semble toute trouvée : l’État. François Ruffin, député de la Somme, n’en est pas à son premier 1er-Mai à Dunkerque. Il l’assure : « Le politique peut quelque chose, mais c’est un choix ! Depuis quarante ans, on a décidé de laisser faire le marché. Il faut changer la donne : pas un euro de subvention sans contrepartie ; l’État doit devenir acteur du capital, peser sur les décisions des entreprises et non les subir… Cela doit se faire pour les cent produits stratégiques en France, à l’image des médicaments, des armes, des aliments, de l’acier. »
« Politiquement, nous avons le devoir de ramener Mittal à ses engagements, il n’est jamais là. L’État doit maintenant montrer les muscles », précise pour sa part Boris Vallaud, président du groupe socialiste, également du cortège.
Derrière la mer du Nord, au Royaume-Uni, le Parlement a voté en avril une loi d’urgence pour prendre le contrôle de British Steel, entreprise menacée, et aux mains d’un groupe privé chinois. Mais en France, le gouvernement ferme pour l’heure la porte à l’option de la nationalisation : « Pas à l’ordre du jour », a déclaré Marc Ferracci, ministre de l’industrie et de l’énergie, mardi. « Nous attendons des actes. Arcelor va nous laisser crever », alerte, dans la foule, le cégétiste de Dunkerque, Gaëtan Lecocq.
À Dunkerque, un défilé du 1er mai avec la nationalisation d’ArcelorMittal dans toutes les têtes
Ludovic Finez sur www.humanite.fr
La manifestation du 1er mai a pris une ampleur particulière, quelques jours après l’annonce de 636 licenciements chez ArcelorMittal, dont la plus importante usine française est sur la Côte d'Opale.
À Dunkerque, la manifestation du 1er mai enregistre une affluence record et la présence de nombreuses figures politiques nationales de la gauche,
dont les chefs du PS, Olivier Faure, et des Écologistes, Marine Tondelier.
« Je marche pour que mon papa garde son travail. » La pancarte en carton est tenue par une
petite fille de 8 ans dont le père, Emerson Haegman, est ouvrier de maintenance chez ArcelorMittal. Il a été embauché en 2006, année de la fusion des groupes français Arcelor et indien Mittal.
Sa fille attend le départ de la manifestation du 1er mai à
Dunkerque, tandis que les prises de parole de la CGT, de la FSU et de Solidaires dénoncent « l’horreur » du meurtre d’Aboubakar Cissé à la mosquée de La Grand-Combe (Gard), affirment le soutien
aux « Ukrainiens et Palestiniens »,
fustigent « l’abandon des services publics » ou soulignent
la nécessité d’une « riposte antifasciste populaire ».
« Nationalisation » : le mot d’ordre revient en boucle. Aurélie Trouvé, présidente LFI de la commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale, y ajoute « l’interdiction des licenciements boursiers quand il y a des versements de dividendes ». « Il ne doit plus y avoir 1 euro d’aide sans la contrepartie d’une entrée de l’État au capital », complète le député Notre France François Ruffin, qui réclame également « une protection au niveau européen, avec des barrières tarifaires aux frontières ».
Karine Trottein, secrétaire du PCF du Nord, élargit à « la remise en cause des traités sur la libre concurrence et des accords de libre-échange ». De son côté, le député écologiste Benjamin Lucas annonce que la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements a décidé de convoquer la direction d’ArcelorMittal, qui « va devoir s’expliquer sous serment ».
Le manque d’investissement, une vraie stratégie
De son côté, c’est tout un système que décrypte Reynald Quaegebeur, délégué central CGT à ArcelorMittal France. « La concurrence chinoise existe, on ne va pas le nier, mais le manque d’investissement d’ArcelorMittal (en France, NDLR), c’est stratégique. Mittal a récupéré les brevets, le savoir-faire et il est désormais capable de produire dans des usines où ça lui coûte moins cher, du point de vue social et environnemental. En 2006, ArcelorMittal France comptait sept hauts-fourneaux et une capacité de 20 millions de tonnes d’acier par an. Aujourd’hui, trois hauts-fourneaux sont en activité, pour une production de 8 millions de tonnes. »
Colette1, infirmière à l’usine de Dunkerque, a observé l’effet des économies jusque dans son service : « Avant, nous étions postées, donc présentes 24 heures sur 24. Nous sommes passées “de jour”, sous prétexte de qualité de vie. » Résultat : de plus en plus souvent, les ouvriers qui se blessent sont contraints d’aller aux urgences de l’hôpital de Dunkerque ou renoncent à tout soin. « Les infirmières qui étaient postées avaient demandé à l’être », insiste Colette.
À ses côtés, Laura2, qui travaille chez un sous-traitant chargé du nettoyage des douches, de l’infirmerie ou encore du réfectoire d’ArcelorMittal Dunkerque. Dans son entreprise, une cinquantaine de salariés sont spécifiquement dédiés à ce contrat. « Personnellement, je suis bientôt à la retraite, mais je suis inquiète pour mes petits-neveux et nièces. » Et dans le Dunkerquois, les entreprises qui dépendent du sort d’ArcelorMittal sont nombreuses. Exemple, la centrale DK6 (groupe Engie), où 75 salariés produisent de l’électricité à partir de la combustion des gaz émis par l’usine sidérurgique. « On ne veut pas être les dindons de la farce », prévient le délégué CGT Stéphane Avonture.
mise en ligne le 1er mai 2025
Un 1er mai aux allures de luttes joyeuses à Montpellier
Khalie Guirado sur https://lepoing.net/
Sur le parvis de la place Albert 1er le départ de la manif prend de joyeuses allures de village associatif en ce milieu de matinée. Stand de Formes des luttes avec stickers et posters en vente, affiches en tout genre, brins de muguet communistes ou atelier pancarte du Quartier Généreux, vers 11h tout le monde est fin prêt à s’élancer. Le traditionnel cortège de la CGT en tête, avec un dj aux commandes particulièrement motivé. Si l’on pouvait croire que la venue de Bardella et Le Pen pour un meeting à Narbonne et la contre mobilisation qui s’y organise aurait pompé toutes les énergies, le cortège montpelliérain n’était finalement pas en reste puisqu’il fallait vingt minutes entières pour atteindre un bout et l’autre. La batucada de La Battante dynamisant comme à son habitude le milieu du cortège était joyeusement concurrencé par l’énergie Kanaky et et le cortège pour la Palestine qui le talonnait. L’inter orga féministe était également de la partie affichant une « solidarité internationale et antipatriarcale » (d’ailleurs on vous en parle un peu plus dans le prochain numéro papier du Poing qui arrive très bientôt).
Cette manifestation du 1er mai était également l’occasion de mobiliser pour les prochains évènements à venir. Parmi eux ce samedi 3 mai devant l’Hôtel de Région de Montpellier à 13h30 est appelé un rassemblement antimilitariste contre la surenchère militaire de la Région et de sa présidente Delga qui souhaite faire de la région un acteur clé du réarment voulu par Macron et a consacré pour cela une enveloppe spécifique de 200 millions d’euros. Également, l’anniversaire du soulèvement Kanaky à Macondo (Montarnaud) les 16, 17 et 18 mai avec de nombreuses tables rondes. Rendez-vous était également donné le samedi 24 mai à 14h au Peyrou « pour que l’eau reste un bien commun » où une « déambulation festive et familiale » est prévue contre le projet du Département de construction de quatre bassines, contre le projet d’usine d’embouteillage de Montagnac et la ligne LGV qui menace des nappes phréatiques.
Finalement, en ce 1er mai, jour de lutte pour les droits des travailleur-euses, c’est contre tout un système colonial, capitaliste et guerrier qu’il nous faut nous retrousser les manches. Puisse l’esprit festif du jour aider !
Narbonne : entre 3 000 et 5 000 personnes défilent pour le 1er-Mai et contre la venue du RN
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Plusieurs milliers de personnes (3 000 selon la police, 5 000 selon les organisateurs), ont manifesté dans les rues de la sous-préfecture de l’Aude ce jeudi 1er mai lors d’une manifestation intersyndicale unitaire, pour les droits des travailleurs et en réponse à l’organisation d’un meeting du Rassemblement National à l’Arena de Narbonne
“De mémoire, on a jamais vu autant de gens dans la rue un 1er-Mai à Narbonne”, souffle un manifestant audois, alors que la foule s’amasse devant la sous-préfecture de l’Aude, vers 11 heures. Il faut dire que ce n’est pas un 1er-Mai ordinaire : le Rassemblement National y organise un grand meeting en présence de Marine Le Pen et Jordan Bardella. “C’était important de montrer qu’on ne voulait pas laisser l’extrême-droite s’installer”, explique Benoït Perez, président de la section Narbonnaise de la Ligue des Droits de l’Homme. “On a pensé cette journée comme une riposte antifasciste et sociale, on a monté un collectif réunissant le maximum d’organisations et d’associations de gauche.”
Et elles ont répondu à l’appel : Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l’homme (LDH), Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, Dominique Sopo, président de SOS Racisme ; Youlie Yamamoto, porte-parole de l’association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) et fondatrice du collectif féministe les Rosies, ou encore Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, étaient dans le cortège.
Philippe Poutou, figure du NPA et candidat aux précédentes législatives dans l’Aude, qui a vu ses trois circonscriptions basculer aux mains du Rassemblement National, est également présent : “L’Aude est une terre historiquement de gauche, mais aujourd’hui le RN s’y sent en terre conquise. C’est un des départements les plus pauvres de France, et beaucoup de gens se tournent vers l’extrême droite par résignation ou désillusion. A nous de combattre de manière unitaire pour imposer un autre discours”, affirme-t-il.
Au micro, les prises de parole syndicales se succèdent : “Le Rassemblement National a dévoyé le sens du 1er-Mai, l’extrême droite a toujours été l’ennemie des travailleurs et des travailleuses”, scande l’intervenante de la FSU. Les interventions dénonçant “l’économie de guerre” du gouvernement Macron, “la cure d’austérité sur les services publics”, sans oublier la réforme des retraites, s’enchaînent.
C’est sous la surveillance d’un nombre impressionnant de CRS casqués que le cortège, joyeux et festif, traverse le centre-ville. Arrivé devant la bourse du travail, un “village antifasciste” accueille concerts, conférences et stands de diverses associations. De l’autre côté de la ville, le parti à la flamme attend 5 000 militants pour un grand meeting, soit à peu près le même nombre que les participants de la manifestation. “L’heure est grave, je m’attendais à ce qu’on soit beaucoup plus nombreux pour faire face à l’extrême droite, je ne comprends pas pourquoi les syndicats n’ont pas affrété des bus de toute la région pour venir ici, on aurait du être au moins le double”, souffle une militante Toulousaine, un peu déçue.
mise en ligne le 1er mai 2025
Libération :
entre 1944 et 1945, restauration ou refondation
de la République ?
Pierre-Henri Lab sur www.humanite.fr
Période d’effervescence politique et sociale, la Libération a vu les forces de la Résistance poursuivre la guerre jusqu’à la défaite de l’Allemagne nazie tout en s’employant à édifier un modèle de société véritablement démocratique et social.
Le 4 avril dernier, avec le concours de l’Institut CGT d’histoire sociale (IHS CGT), de la Société française d’histoire politique (SFHPo) et l’Association française pour l’histoire des mondes du travail, la Fondation Gabriel-Péri organisait sous le parrainage du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) un colloque à l’Assemblée nationale intitulé « Restauration ou refondation de la République » consacré à la Libération. L’Humanité a réuni trois des intervenants pour revenir sur cette période.
Gilles Richard est historien et président de la Société française d’histoire politique
Michel Pigenet est historien et auteur de les États généraux de 1945. Une expérience démocratique oubliée (éditions du Croquant)
David Chaurand est directeur de l’Institut CGT d’histoire sociale
Quel est le contexte politique à l’été 1944 en France ?
Gilles Richard : La France n’est pas libérée le 6 juin 1944 au soir du débarquement. La Libération s’étend sur neuf mois. Les deux dernières poches allemandes, Dunkerque et La Rochelle, ne se rendent que le 9 mai 1945. Les combats font 100 000 morts. La France est dirigée par les forces de la Résistance unies derrière Charles de Gaulle.
Au sein du gouvernement provisoire de la République française (GPRF) et du Conseil national de la Résistance (CNR) se retrouvent les deux résistances, celle de l’extérieur et celle de l’intérieur. La France libre est dominée par les forces de droite tandis qu’à l’intérieur, les forces de gauche sont majoritaires.
Ces forces partagent le même objectif de gagner la guerre et sa poursuite permet à Charles de Gaulle de brider les forces de gauche de la Résistance intérieure, sans qu’il n’y ait jamais eu de volonté du PCF de faire un putsch. Militants et dirigeants, tel André Marty, qui y étaient favorables étaient très minoritaires. De Gaulle a les cartes en main parce que la Libération s’est d’abord faite grâce aux forces militaires alliées.
La Résistance armée a joué un grand rôle en gênant les déplacements de troupes allemandes mais il n’y a pas eu d’insurrection armée dans la France entière. L’insurrection n’a eu lieu que dans quelques villes, dont Paris. La population n’est pas mobilisée politiquement pour s’emparer du pouvoir.
Michel Pigenet : Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) ont conscience de leur infériorité militaire face à l’armée allemande, raison pour laquelle les Francs-tireurs et partisans (FTP) préconiseront la « goutte de mercure » insaisissable. Il faut s’entendre sur la notion d’« insurrection ». Ce qui se passe après le 6 juin 1944 en revêt bien des aspects.
Une formidable levée en masse gonfle les rangs des FFI, dont les effectifs quintuplent en quatre mois. Toute la Résistance bascule dans la lutte armée, tandis que de nouvelles autorités issues de la clandestinité se substituent aux précédents cadres politiques et administratifs…
Tout va très vite. Les contemporains disposent, certes, de repères sur les possibles et contraintes de l’heure, à l’aune desquels ils s’efforcent de percevoir les rapports de force. Les dynamiques à l’œuvre interdisent toutefois les pronostics trop précis.
Les différents acteurs identifiés par Gilles Richard tentent de consolider leurs positions et de peser sur le cours des choses, ce qui ne va pas sans tensions, que chacun veille toutefois à ne pas conduire jusqu’à la rupture. Le CNR reconnaît ainsi l’autorité du général de Gaulle, qui dirige le GPRF d’une main de fer et se garde de la moindre référence au programme commun de la Résistance.
Fort d’un prestige qu’il excelle à entretenir, le chef du gouvernement bénéficie rapidement du soutien décisif du cœur de l’appareil d’État, qui a reconnu en lui le garant d’une « restauration » rassurante. Pour autant, si la légitimité patriotique tient lieu de légitimité politique, elle ne vaut pas certificat de légitimité démocratique.
Or, ni la guerre, ni l’état du pays, ni l’absence des prisonniers et des déportés ne rendent envisageable une rapide validation électorale. Jusque-là, irresponsable devant l’Assemblée consultative, dont l’intitulé résume les limites, le GPRF, instance exécutive et législative, gouverne sans véritable contrôle.
Le CNR ne jouit, lui, d’aucune prérogative officielle, mais n’entend pas s’effacer. Résolu à tenir un rôle de tuteur moral et politique, il considère plus que jamais son programme comme étant d’actualité. À cette fin, il peut compter sur le maillage des comités de libération, qui, localement, sont à l’initiative dans l’organisation du ravitaillement, la relance économique, l’épuration, etc.
Quelle carte vont jouer les différentes composantes du CNR ?
Michel Pigenet : Le CNR, une exception dans l’Europe occupée, a été réuni par Jean Moulin pour signifier le soutien de la Résistance à de Gaulle. Sa large composition, qui laisse à l’écart l’extrême droite et le patronat, assure sa représentativité. Ses décisions ne valent qu’à l’unanimité qu’autorise son ciment patriotique.
À partir de là, les priorités et solidarités du combat clandestin facilitent la dynamique de rapprochements improbables où l’estime et la confiance ont leur place. Ainsi, c’est au communiste Pierre Villon, délégué du Front national, que celui de la très réactionnaire Fédération républicaine, Jacques Debû-Bridel, confie le mandat de la représenter au bureau restreint du Conseil.
Quant aux mouvements de Résistance, ils échappent aux critères de classement partisans, mais le volontarisme inhérent à leur rébellion initiale n’est pas étranger à la radicalité de plusieurs de leurs positions. En termes d’institutions, il s’agit moins, enfin, pour le CNR de « restaurer » la République sur le modèle de la IIIe République, discréditée par sa capitulation, que d’en instaurer une « vraie », démocratique et sociale.
Qui porte cette ambition ?
Michel Pigenet : L’ambition du programme du CNR ne vient pas forcément d’où on pourrait le penser. Dans « les Jours heureux », il y a la lutte immédiate et les premières mesures à prendre après la Libération. Au moment de l’élaboration, les communistes insistent surtout sur la première partie.
Ils ne souhaitent pas rétrécir le CNR par une orientation trop marquée à gauche. Ils ont tendance à rétrécir la partie programme alors que socialistes et syndicalistes poussent des réformes de structure, des nationalisations et la planification.
Comment expliquer cette priorité à la lutte armée ?
Michel Pigenet : Cette priorité procède d’une approche globale du conflit et de la solidarité avec l’URSS. Tout ce qui nuit à l’effort de guerre de l’occupant et entretient l’insécurité de ses troupes à l’Ouest soulage l’Armée rouge à l’Est.
Gilles Richard : Si les communistes insistent tant sur la Libération par le soulèvement national, c’est aussi pour asseoir la légitimité de la Résistance intérieure. L’insurrection populaire devait permettre de faire contrepoids à de Gaulle et à l’armée.
Quel rôle joue la CGT ?
David Chaurand : La présence de la CGT et la CFTC au sein du CNR est importante. Alors que les tensions étaient fortes avant-guerre entre unitaires et confédérés, les deux composantes de la CGT se réunifient en avril 1943. Cela a été la première étape vers la création du CNR. La CGT y est représentée par Louis Saillant, qui en sera d’ailleurs le dernier président. Elle joue un grand rôle dans l’élaboration du programme.
La CGT sort de la guerre avec une légitimité renforcée. Elle n’a jamais été aussi forte, sans doute davantage qu’elle ne l’a été en 1936. Dans ses rangs, plusieurs millions d’adhérents. La CGT est désormais un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics dans le cadre de la reconstruction. Elle est présente au gouvernement à travers les ministres communistes comme Marcel Paul ou Ambroise Croizat, qui sont aussi des dirigeants de la CGT.
Michel Pigenet : Des centaines de cégétistes participent, en outre, à la gestion de la Sécurité sociale, confiée aux deux tiers à des administrateurs salariés, proportion portée aux trois quarts par Ambroise Croizat. D’autres figurent dans les conseils d’administration tripartites des entreprises nationalisées. Partie prenante des 25 commissions du plan, la CGT en préside 4.
Que se passe-t-il dans les entreprises ?
David Chaurand : L’effervescence de la Libération touche aussi les entreprises. La CGT va tenir une place importante dans les comités patriotiques et d’épuration qui se forment dans de nombreuses entreprises. Les travailleurs sont à l’initiative de multiples façons. On pense d’emblée aux comités de gestion, qui associaient donc les travailleurs à la gestion de l’entreprise. Robert Mencherini a mis en évidence ces expériences à Marseille, Rolande Trempé à Toulouse, sans oublier ce qui se passe à Montluçon ou à Lyon. Antoine Prost les chiffre à une centaine mais c’est peut-être sous-estimé.
Mais l’intervention des travailleurs ne doit pas être limitée aux comités de gestion. Les usines sont confrontées à une diversité de problèmes qui vont des difficultés d’approvisionnement aux défaillances administratives et qui obligent les travailleurs à s’impliquer dans leur remise en marche et à prendre des initiatives. C’est un sujet qui mérite d’être mieux étudié, ce que nous avons d’ailleurs commencé à entreprendre à l’IHS CGT.
Gilles Richard : L’ampleur des problèmes de ravitaillement est telle qu’en juin 1943, le ministre de Vichy qui en a la charge affirme que la France connaît une situation de « famine lente ». Or, la situation s’aggrave dans les années suivantes. Depuis le XVIIIe siècle, jamais la population n’avait connu un tel recul du niveau de vie.
David Chaurand : L’intervention des travailleurs est aussi patriotique que vitale pour eux et leur outil de travail. Elle est spontanée et ne semble pas relever d’une stratégie quelconque. Ces prises d’initiatives, quelles que soient leurs formes, sont importantes car elles modifient le rapport de force dans les entreprises. Les comités de gestion sont souvent mis en place dans les entreprises où le pouvoir est vacant.
Accusés de collaboration, les patrons ont fui ou ont été emprisonnés. C’est le cas de Berliet à Lyon, par exemple. La prise de pouvoir se fait différemment d’une région à une autre. À Toulouse, elle est plus négociée tandis qu’à Marseille ou Montluçon, les travailleurs s’imposent au point qu’est dénoncée « une soviétisation ». Le patronat a très peur de ce qui se passe et utilisera notamment l’arme juridique pour se défendre.
Michel Pigenet : La Libération précipite, dans maintes entreprises, un renversement du rapport des forces sociopolitiques. Au service de l’occupant et avec la complicité de larges fractions du patronat, Vichy a paupérisé le gros des salariés, allant jusqu’à leur imposer un service de travail obligatoire en Allemagne.
Si la révolution n’est pas à l’ordre du jour ouvrier de 1944-1945, les règlements de comptes de la période ont à voir avec la lutte des classes. Ici et là, des employeurs de combat sont exécutés. D’autres, plus prudents, s’éclipsent, tandis que la plupart font le dos rond. Un peu partout, sur fond de pénurie de matières premières et de pièces, les syndicats relèvent le défi et sont à l’initiative.
Il s’agit d’abord de relancer la production, de garantir l’emploi et les salaires. Avec ou sans le concours des patrons, de préférence avec celui des cadres. Mais ce qui est en jeu, c’est aussi la capacité ouvrière d’intervenir sur le terrain inédit de la gestion et, chemin faisant, d’empiéter sur les prérogatives patronales.
Exemple parmi des centaines d’autres, chez Ford, à Poissy, les cégétistes se procurent les pièces nécessaires à la bonne marche de l’usine et, simultanément, exigent un droit de regard sur la désignation des contremaîtres. Au jour le jour, un syndicalisme de réalisation et de transformation sociale s’affirme aux quatre coins du pays à travers des milliers d’expériences dont nous n’avons qu’une connaissance partielle.
Les états généraux de la renaissance s’inscrivent-ils dans cette dynamique ?
Michel Pigenet : Entre le moment où l’idée prend forme, en septembre 1944, et la réunion, à Paris, du 10 au 13 juillet 1945 de leurs 2 000 délégués nationaux, les états généraux ont atteint l’objectif d’une appropriation dynamique du programme du CNR, leur initiateur.
Substitut à l’absence d’élections générales, la procédure, inspirée de 1789, participe d’une remarquable expérience de « démocratie agissante » qu’illustre la rédaction, à l’échelle des communes, de milliers de cahiers de doléances. Ceux-ci saisissent les aspirations et les certitudes de l’époque. Ils confirment l’adhésion massive à de substantiels progrès sociaux, éducatifs et culturels, que tempère une certaine frilosité sociétale et coloniale.
Gilles Richard : Les états généraux s’inscrivent aussi dans cette période où s’affrontent les partisans d’un nouveau Front populaire et leurs adversaires, qui se rangent derrière de Gaulle. Ils sont une manière, d’abord pour le PCF, de reprendre une partie de la légitimité politique que de Gaulle a construite depuis 1940.
Comment se déroulent les élections à la Constituante ?
Gilles Richard : La grande nouveauté, c’est le droit de vote des femmes, qui fait plus que doubler la taille du corps électoral. C’est l’aboutissement des combats féministes depuis cent cinquante ans. Dans les colonies, le droit de vote est aussi accordé à une fraction des colonisés. Jusque-là, seuls les Français installés dans les colonies votaient.
Les gauches en sortent majoritaires avec un avantage de près de 3 % pour le PCF sur la SFIO. Cette majorité socialo-communiste est une première et ne s’est reproduite qu’une seule fois, en 1981. Cette victoire des gauches provoque rapidement un conflit avec de Gaulle sur la nature de la Constitution à adopter et provoque son départ. Elle ouvre en même temps une période où de grandes lois économiques et sociales sont adoptées, jetant les bases de ce que Jaurès appelait « la République sociale ».