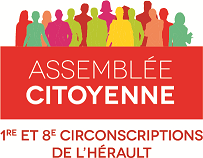octobre 2025
mise en ligne le 9 octobre 2025
« Taxer un peu plus les riches, ça nous parle » : dans la Loire, des grévistes victorieux se démarquent de l’instabilité politique
Mathilde Goanec sur www.mediapart.fr
Les salariés de JDE Peet’s, qui fabriquent les capsules de café L’Or près de Saint-Étienne, viennent de remporter une manche pour un meilleur partage des richesses dans leur entreprise. S’ils regardent souvent de loin les débats partisans du moment, ils appellent à s’inspirer de leur « solidarité ».
Andrézieux-Bouthéon (Loire).– Son téléphone sonne sans arrêt, tout le monde vient aux nouvelles. Mais mercredi 8 octobre, ce n’est pas de l’éventuelle nomination d’un nouveau premier ministre ou d’une éventuelle suspension de la réforme des retraites qu’on parle à Jérôme Stravianos, délégué syndical CFDT de l’usine JDE Peet’s à Andrézieux-Bouthéon.
« Ouais, on vient de signer à l’instant, c’est bon », répond invariablement le responsable syndical du site situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Saint-Étienne. Après seize jours de grève, une semaine de blocage des camions à l’entrée de l’usine et un rond-point occupé jour et nuit, la direction de cet énorme groupe de café basé à Amsterdam et coté en Bourse a enfin lâché sur les augmentations de salaires que réclamaient les grévistes – 180 personnes au pic de la mobilisation, soit la moitié de l’usine et la quasi-totalité du personnel de production et de maintenance.
Il était temps, « la fatigue commençait à s’installer », raconte Jérôme Stravianos, près du monticule de palettes qui brûlent pour quelques heures encore. Les salarié·es ont obtenu 160 euros brut supplémentaires par mois, contre les 50 proposés au début de la négociation, ainsi qu’une prime annuelle de 1 500 euros, 500 euros de mieux que ce que la direction proposait au départ.
Une « victoire » revendiquée par les grévistes, qui éclipse l’agitation politique du moment et que l’on célèbre en se tapant dans le dos. Même si les salarié·es sont lucides sur le poids réel des sommes en jeu. Le commerce du café est florissant et JDE Peet’s a engrangé 422 millions de bénéfices au cours des six derniers mois, dont 350 millions reversés aux actionnaires. Du haut de ces montagnes de profits, les augmentations arrachées au forceps ne constituent qu’une poussière.
Car si le groupe néerlandais, qui se donne pour mission incongrue de « libér[er] le potentiel du café et du thé pour créer un avenir meilleur », est inconnu du grand public, ses marques sont célèbres : L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre, Grand’Mère, Maxwell House… L’usine d’Andrézieux-Bouthéon fabrique principalement les capsules de café L’Or qui sont vendues dans toute l’Europe.
Le partage des richesses, donner à chacun sa part du gâteau, c’est aussi tout ce dont les gouvernements successifs ne veulent pas. Christophe, salarié de JDE Peet’s
Christophe dit que le conflit social, auquel il a pris part avec constance, l’a « réveillé ». Et il assure que l’enjeu local « résonne complètement » avec la situation politique qui prévaut au niveau national, et la litanie de blocages institutionnels dans lesquels la France s’englue depuis deux ans. « Le partage des richesses, donner à chacun sa part du gâteau, c’est aussi tout ce dont les gouvernements successifs ne veulent pas, trop occupés par leurs petites personnes », estime le salarié.
Patrice Badiou, qui représentait la CGT dans la négociation, a quant à lui pensé au débat sur la taxe Zucman tandis qu’il bataillait sec pour ses collègues. « Nous faisons face à une société qui est la championne de l’optimisation fiscale, et qui nous a transformés en “centre de coûts” [un site qui concentre les pertes – ndlr] pour payer le minimum d’impôts en France, analyse-t-il. Donc taxer un peu plus les riches, et voir l’opposition que cela soulève, cela nous parle. »
Une « faille » dans le système
Afin d’occuper le rond-point en continu, les salarié·es en cinq-huit (cinq équipes se relaient sur des plages de huit heures) ont reproduit les rotations de l’usine, celles qui avalent régulièrement leurs soirées, leurs nuits et leurs week-ends. Pendant la grève encore, les un·es ont relevé les autres dans un ballet bien rodé. Mais Leila s’est « régalée » de ces moments nouveaux, hors de la routine, à discuter des heures durant avec les collègues.
Bien sûr, la conversation a parfois roulé vers la politique et l’instabilité à la tête de l’État. « S’ils ne réussissent pas à former un gouvernement, ce n’est quand même pas nous qui allons le faire ! Mais ce serait bien que les choses changent, considère la gréviste. Il y a une faille dans le système, ceux qui s’enrichissent, ce sont toujours les mêmes. » Ses collègues et copines ironisent : « Le plein de courses, il est à 300 euros net, et ça, ça ne change pas ! »
C’est une forme d’indifférence qui domine pourtant face aux tractations politiciennes de ces derniers jours. « C’est sûr, on était “focus” sur ce qui nous arrive à nous, mais nous sommes aussi lassés de la politique, explique Slimane. Macron, il change de ministre toutes les cinq minutes, on n’arrive même plus à tenir le compte ! »
L’homme, « douze ans de boîte », préfère évoquer les « vingt balles » seulement d’augmentation obtenus en 2024 malgré des résultats déjà record, l’intéressement qui se réduit comme peau de chagrin en raison d’objectifs à atteindre trop élevés, mais aussi ces « 80 millions d’euros perdus par ligne de production et par jour » quand les ouvriers d’Andrézieux-Bouthéon ont décidé de s’arrêter. « Le moyen d’action, il est ici », revendique Slimane.
« C’est le chaos à Paris, mais les gens vivent leur fin de mois ici, confirme Patrice Badiou. Je suis syndicaliste, je ne dis pas que le système politique actuel et la bataille qu’on mène ici ne sont pas liés. Mais disons que si on regarde l’énergie qu’il faut déployer, on pense que cela a plus de sens de la mettre dans le genre de lutte que nous avons menée ici. »
De cette grève chez JDE Peet’s, historique par sa durée pour celles et ceux qui l’ont conduite, Christophe veut avant tout retenir la solidarité qu’il a ressentie et expérimentée pendant deux semaines. « Et la solidarité, tout là-haut, patrons ou politiques, ils n’aiment pas ça, cingle-t-il. Ce n’est pas facile à gouverner, un peuple solidaire. Et parfois, ça coupe des têtes. »
mise en ligne le 9 octobre 2025
« Si les macronistes ne veulent pas la dissolution, c’est la cohabitation » : après la déclaration de Lecornu, PS, PCF et Écologistes poussent leur candidature à Matignon
Florent LE DU sur www.humanite.fr
L’entretien du premier ministre démissionnaire à France 2 n’ayant pas apporté de réels enseignements, chaque parti de gauche reste depuis sur ses positions. La revendication de former un gouvernement de cohabitation à gauche pour les uns, l’appel au départ du chef de l’État pour les autres.
Les concessions sont si rares, en huit ans de Macronie au pouvoir, qu’il faut savoir les exploiter. Mercredi soir, sur France 2, Sébastien Lecornu n’est pas allé jusqu’à lâcher quoi que ce soit pour convaincre la gauche, mais il a concédé, sur la réforme des retraites, la nécessité « que le débat ait lieu ». En 2023, celui-ci avait été empêché par le 49.3 d’Élisabeth Borne, arme que le premier ministre démissionnaire a recommandé de ne pas utiliser pour le futur vote du budget.
Le parti socialiste y a vu une brèche dans laquelle s’engouffrer. « J’entends de la voix du Premier ministre démissionnaire qu’il y a un certain nombre de fenêtres d’opportunité qui s’ouvrent sur la question de la réforme des retraites, sur la question d’un débat parlementaire apaisé avec l’abandon du 49.3 », a jugé sur LCI le secrétaire général du PS Pierre Jouvet. Pour lui, cela ne peut ouvrir que sur une solution : « Nommer un Premier ministre de gauche et des Écologistes pour mener à bien la réconciliation du pays ».
En marge de la journée de mobilisation de la CGT Santé, Sophie Binet a également souligné cette référence à la réforme de 2023 : « Nous sommes en position de force depuis qu’Emmanuel Macron a fait passer en force la réforme des retraites, nous avons déjà enterré cinq premiers ministres. Il n’y aura pas de stabilité politique sans justice sociale et sans abrogation de la réforme », clame la secrétaire générale de la CGT.
« Rien n’est clair, tout reste nébuleux »
L’autre enseignement de cette prise de parole est que Sébastien Lecornu et probablement Emmanuel Macron par extension sont persuadés qu’il est encore possible d’éviter de nouvelles législatives anticipées. « Il y a une majorité absolue à l’Assemblée nationale qui refuse la dissolution », a indiqué le premier ministre démissionnaire pour justifier qu’un nouveau gouvernement soit nommé, d’ici vendredi soir. « Si les macronistes ne veulent pas la dissolution, je n’ai qu’une seule solution pour eux, c’est la cohabitation », a rebondi la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier.
Des interprétations faussement naïves des paroles de Sébastien Lecornu. En réalité, la gauche n’est pas dupe : « Si les Français attendaient une clarification de la part du premier ministre démissionnaire, ils ont dû être déçus. Rien n’est clair, tout reste nébuleux, remarque Ian Brossat, sénateur et porte-parole du PCF. La seule chose qui en ressort, c’est la volonté des macronistes de rester coûte que coûte au pouvoir pour poursuivre la même politique, moyennant quelques aménagements. Si tel devait être le cas, le couperet de la censure tomberait rapidement. »
La France insoumise, qui ne croit pas en la nomination d’un gouvernement de gauche en l’état et donc ne revendique pas Matignon – « il faut cesser de croire à cette farce », a encore déclaré Manuel Bompard mercredi soir – a elle aussi cherché à prendre aux mots Sébastien Lecornu.
En particulier lorsque ce dernier a glissé que la question des retraites « s’invitera à l’élection présidentielle ». Une manière de la repousser à plus tard ? « Puisque le Premier ministre a indiqué ce soir qu’aucun sujet ne pouvait être tranché pendant 18 mois en attendant l’élection présidentielle de 2027, nous proposons, nous, comme solution, que le peuple français puisse décider de son avenir dès maintenant et qu’avec le départ d’Emmanuel Macron, il puisse y avoir une présidentielle anticipée », a alors réagi Mathilde Panot, présidente du groupe insoumis à l’Assemblée nationale. En attendant de voir la couleur du gouvernement que va choisir Emmanuel Macron, chaque parti de gauche reste donc sur ses positions.
mise en ligne le 8 octobre 2025
Le progrès social,
seule issue à la crise !
Communiqué CGT sur https://www.cgt.fr/
Le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce lundi sa démission 27 jours seulement après sa nomination, avant même d’avoir prononcé son discours de politique générale et présenté son budget. Depuis sa nomination, les travailleurs et les travailleuses se sont mobilisés à trois reprises pour dénoncer la violence du budget en préparation et exiger des réponses sociales, écrivant ainsi une rentrée sociale inédite.
Au lieu de revoir sa copie, de renoncer aux reculs sociaux (année blanche, réforme de l’assurance chômage, doublement des franchises médicales…), au lieu de mettre en place la justice fiscale et d’abroger la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a préféré maintenir le budget et le gouvernement de son prédécesseur. Il n'a pas eu le courage d'affronter les grands patrons et les plus riches et de rompre avec la politique de l'offre d'Emmanuel Macron.
Il est donc le 5e Premier ministre en 2 ans à être contraint à la démission du fait de la violence sociale de sa politique
Encore une fois, au lieu de changer de politique le président de la République fait le choix du chaos institutionnel. Il prend le risque de transformer une crise sociale et démocratique en crise de régime. Le Medef, quant à lui, en multipliant les gesticulations pour empêcher toute justice fiscale et sociale, porte une lourde responsabilité.
Cette décision est d'autant plus grave dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, alors que l'extrême droite représente un danger central pour les démocraties, les libertés et les droits sociaux en France et dans le monde.
Les travailleuses et les travailleurs, les jeunes et les retraité·es ont construit une mobilisation historique pendant 2 ans et demi contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait le choix de l'ignorer et d'imposer sa réforme par 49-3. Il a donc été sanctionné par les urnes et a perdu toute majorité suite à sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale. Les travailleurs et les travailleuses, et la population doivent être entendus. Les dénis démocratiques et les passages en force doivent cesser.
Comme la CGT le martèle : il n'y aura pas de stabilité sans justice sociale
Face à l'irresponsabilité du président de la République, du gouvernement et de leurs alliés patronaux, la CGT appelle au rassemblement des forces de progrès social pour barrer la route à l’extrême droite et gagner enfin la réponse aux urgences sociales et environnementales :
-
Mettre en place la justice fiscale
-
Débloquer les moyens nécessaires pour nos services publics et pour la transformation environnementale
-
Abroger la réforme des retraites
-
Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux
-
Arrêter les licenciements, réindustrialiser et décarboner le pays
-
Mettre fin à la chasse aux travailleuses et travailleurs sans papier et à la stigmatisation des étrangers et des précaires
Dans ce contexte d'instabilité maximum, la CGT continuera à prendre toutes ses responsabilités pour que le monde du travail soit enfin entendu
Plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, privé.es d'emploi, jeunes retraité.es se sont déjà mobilisé·es les 10, 18 septembre et 2 octobre dans le cadre d'une rentrée sociale d'ampleur historique. Le 9 octobre, à l’initiative des professionnels de la santé et de l’action sociale, de la sécurité sociale et du médicament une manifestation nationale aura lieu pour exiger un tout autre budget de la Sécurité sociale à la hauteur des besoins.
La CGT appelle les travailleuses et les travailleurs à continuer leurs actions dans les entreprises pour les salaires, l’emploi et les conditions de travail.
La CGT continuera à travailler pour renforcer l’unité syndicale et permettre les mobilisations les plus larges.
mise en ligne le 8 octobre 2025
Génocide à Gaza :
une guerre au service du « Grand Israël » et d'un remodelage régional
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Benyamin Netanyahou veut en finir avec la question palestinienne pour bâtir le « Grand Israël ». En s’attaquant aux pays de la région – Syrie, Liban, Iran –, le premier ministre permet aux États-Unis d’asseoir leur domination alors qu’un corridor énergétique allant du golfe Persique à l’Europe en passant par Israël est à l’ordre du jour.
Le 7 octobre 2023, l’attaque terroriste déclenchée par le Hamas faisait près de 1 400 morts, la plupart israéliens. Aujourd’hui, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués et plus de 167 000 blessés. La puissance de feu déclenchée contre la bande de Gaza et ses habitants par l’armée israélienne, l’une des plus puissante au monde, sous prétexte de détruire le Hamas, a en réalité visé tous les édifices, à commencer par les immeubles d’habitation, mais également les écoles, les universités, des mosquées, des églises, des bâtiments relevant du patrimoine culturel de l’humanité…
Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à plusieurs reprises, rappelant aux Palestiniens la Nakba (la catastrophe).
Le projet politique derrière l’offensive israélienne
« Quand on détruit avec des bombes d’une tonne, généreusement livrées par les États-Unis d’Amérique, un territoire exigu avec une des densités démographiques les plus élevées au monde, comme territoire urbain, cela va forcément donner un génocide », rappelle Gilbert Achcar, chercheur franco-libanais, professeur à la School of Oriental and African Studies de l’université de Londres.
L’entreprise lancée par Benyamin Netanyahou s’inscrit dans le projet sioniste, celui du « Grand Israël ». Le premier ministre israélien a très vite compris – certains anciens hauts officiers pensent même que les autorités étaient au courant de la préparation de l’attaque du 7 Octobre – qu’il pouvait utiliser le massacre perpétré par le mouvement islamiste pour en finir une fois pour toutes avec la revendication palestinienne du droit à l’autodétermination et donc à la création d’un État. Une stratégie ancienne qui est allée – comme l’a toujours fait Tel-Aviv – jusqu’à aider le Hamas lorsque nécessaire lors de sa création en 1987 ou encore en le faisant financer par le Qatar.
L’émotion mondiale lui donnait tous les droits, pensait-il. Pendant que les projecteurs étaient braqués sur Gaza, l’armée venait épauler les colons de Cisjordanie afin d’entreprendre un nettoyage ethnique. Pour faire bonne mesure, Benyamin Netanyahou s’attaquait également au Liban et au Hezbollah, grignotait le territoire syrien à la faveur de la chute de Bachar al-Assad et bombardait l’Iran au risque d’une déflagration régionale.
Il faisait ainsi d’une pierre deux coups, confortant sa vision du « Grand Israël ». Mieux, il a convaincu la Maison-Blanche – Joe Biden, puis Donald Trump – qu’une telle stratégie permettrait le remodelage de la région tant recherché depuis plus de trente ans par les États-Unis.
Gaza sous la pression de l’armée israélienne
C’est-à-dire ne plus avoir de pays trublions capables de s’opposer à leur hégémonie. Aujourd’hui, au Moyen-Orient, tout le monde est rentré dans le rang – à l’exception des Houthis du Yémen – et la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, les accords d’Abraham, bien que gelée, reste d’actualité.
Le Maroc, les Émirats arabes unis, le Soudan et Bahreïn ont déjà franchi le pas. Reste maintenant à décrocher la signature de l’Arabie saoudite.
Riyad semble se faire tirer l’oreille, mais, en réalité, profite d’être courtisé pour tirer son épingle du jeu et obtenir le maximum d’avantages. En marge du sommet du G20 qui s’est tenu à New Delhi en septembre 2023, l’Inde, l’Union européenne (UE) et les États-Unis ont annoncé le lancement d’un corridor.
Ce dernier doit relier l’Inde à l’Europe via le Moyen-Orient, équipé d’une liaison ferroviaire, d’un câble transcontinental haut débit et d’un futur gazoduc à hydrogène, et passerait par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël. Un projet qui a de quoi réconcilier les pétromonarchies et Tel-Aviv, mais qui a besoin d’un environnement sécurisé autour des ports israéliens. C’est-à-dire une bande de Gaza ne présentant aucun danger.
Un territoire au cœur des spéculations immobilières
Les projets les plus hallucinants évoqués un temps comme celui d’une « Riviera du Moyen-Orient » font scintiller les yeux de l’agent immobilier Donald Trump et ceux de l’inévitable ancien premier ministre britannique Tony Blair.
Le tout sous la houlette de Jared Kushner, le gendre du président états-unien dont la société de placements bénéficie de l’apport des Saoudiens et des Qataris. Dans ce cadre, l’expulsion des Palestiniens de Gaza était programmée, le Hamas décapité, l’Autorité palestinienne marginalisée et l’opinion publique internationale muselée.
Premier accroc : dès le mois de décembre 2023, l’Afrique du Sud saisissait la Cour internationale de justice (CIJ). Celle-ci reconnaissait, le 26 janvier 2024, qu’il existait un « risque sérieux de génocide » et qu’il était urgent de prendre des mesures conservatoires pour défendre la population palestinienne de Gaza. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale (CPI) délivrait un mandat d’arrêt à l’encontre de Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense de l’époque, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et des responsables du Hamas qui ont été tués.
Du jamais-vu pour Israël, État qui n’a appliqué aucune des résolutions de l’ONU le concernant. Le mot « génocide » appliqué à Gaza n’est plus tabou et largement partagé de par le monde, y compris par des sommités juridiques internationales et des organisations israéliennes.
Les accusations d’antisémitisme lancées contre tous ceux qui dénonçaient la politique de Tel-Aviv n’ont plus eu la même portée. Les manifestations pour exiger « l’arrêt du génocide » se sont amplifiées sur l’ensemble des continents. Des personnalités du monde culturel et sportif ont osé mêler leurs voix aux chœurs de protestations. En septembre 2025, 10 nouveaux pays, dont la France, poussés par leurs opinions publiques, ont reconnu l’État de Palestine, comme l’avaient fait, entre autres, la Norvège, l’Irlande et l’Espagne en 2024.
Le plan de Donal Trump écarte les Palestiniens
Mais ce n’est pas encore suffisant. Deux ans après, la guerre se poursuit. La reconnaissance de l’État de Palestine reste lettre morte en l’absence de mesures coercitives, politiques et économiques visant à forcer Israël à mettre fin à la colonisation et à l’occupation. Le mandat de la CPI n’est pas exécuté. Alors qu’un 18e train de sanctions a été décidé par l’UE contre la Russie en juillet, on attend toujours la suspension de l’accord commercial d’association avec Israël.
Percevant l’isolement qui menaçait les États-Unis, Donald Trump présentait, le 29 septembre, un plan qu’il qualifiait de paix mais qui risque de n’en avoir que le nom. « Les Palestiniens sont totalement écartés. Quelle loi leur permet de venir et de nous prendre en main, nous Palestiniens, plutôt que de respecter notre droit à nous gérer nous-mêmes ? » s’insurge Mustafa Barghouti, membre du comité exécutif de l’OLP.
Un projet élaboré avec les Israéliens mais sans les Palestiniens. Acceptées partiellement par le Hamas, des premières discussions ont commencé le 6 octobre visant à mettre en place un mécanisme de libération de tous les captifs israéliens, vivants ou morts, toujours dans la bande de Gaza. Suivrait alors la libération de centaines de prisonniers palestiniens.
À condition que Benyamin Netanyahou tienne ses engagements, alors qu’il peut, seul, décider que la partie palestinienne ne respecte pas les siens, auquel cas il reprendrait la guerre. Il a déjà montré que telle était sa volonté, après avoir rompu, en mars, un cessez-le-feu promulgué deux mois auparavant. Et il a annoncé que les soldats israéliens resteront dans une zone tampon à l’intérieur même du territoire.
Israël toujours impuni par la CPI
Le plan Trump risque de n’être qu’un feu de paille, d’autant que sur les 20 points qu’il contient, la mention de l’autodétermination du peuple palestinien ne préjuge en rien de la création réelle d’un État palestinien pour la simple raison que la fin de l’occupation israélienne n’est pas mentionnée. Meurtrie par les attaques du Hamas il y a deux ans, la société israélienne est aujourd’hui fracturée, malade.
En Israël même, Netanyahou est conspué. Certains veulent renforcer l’extrême droite alors que d’autres commencent à s’interroger sur la réalité de l’occupation et le calvaire des Palestiniens. Les juifs dans le monde sont divisés. À l’image de Peter Beinart, considéré comme l’une des voix les plus influentes dans le débat sur Israël aux États-Unis et auteur de Being Jewish After The Destruction of Gaza : A Reckoning (être juif après la destruction de Gaza : un bilan).
Ce journaliste et juif pratiquant est passé ces dernières années du statut de sioniste libéral à celui d’un des critiques les plus virulents du sionisme. Une profonde critique d’Israël et du sionisme sera peut-être le débat qui va monter dans les prochaines années.
Les Palestiniens, eux, doivent retrouver leur unité géographique et politique, pour mettre en place une résistance populaire et pacifique et enfin gagner leur autodétermination. Le chemin risque d’être encore long. C’est pourtant là que se trouve la solution. Pour que, dans l’avenir, aucun 7 Octobre n’ait plus lieu en Israël et qu’aucun génocide ne vienne éradiquer le peuple palestinien.
mise en ligne le 7 octobre 2025
Menacés de dix ans de prison pour avoir aidé des exilés
par Maël Galisson sur https://basta.media/
Sept militant·es solidaires risquent dix ans de prison et 250 000 euros d’amendes pour avoir aidé des personnes exilées à passer la frontière lors d’un évènement sportif basque. Leur procès se tient à Bayonne mardi 7 octobre.
La pile de courriers d’auto-inculpation ne cesse de grandir sur la table du café Korail accolé à la gare de Bayonne. « On s’approche des 4000 lettres, on ne pensait pas qu’on arriverait à ce chiffre quand on a lancé la campagne », dit Barthélémy Mottay, qui représente la Fédération syndicale unitaire (FSU) au sein d’un collectif créé en novembre 2024, nommé “J’accuse”. « Beaucoup de personnes ont signé ces lettres, tant dans le Pays basque Nord que dans la partie Sud, mais également à l’international » précise le syndicaliste.
Le collectif rassemble 80 organisations, associations d’aide aux migrants, syndicats, partis politiques. Il mène depuis près d’un an une campagne pour soutenir sept militant·es solidaires des exilé·es, inculpé·es par le parquet de Bayonne. Les quatre hommes et trois femmes sont poursuivi·es pour « avoir facilité l’entrée ou la circulation en France de personnes étrangères », avec la circonstance aggravante que les faits auraient été commis « en bande organisée » selon l’acte d’accusation. Ils et elles risquent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende. Leur procès se tient mardi 7 octobre à Bayonne.
Le parquet reproche aux prévenu·es d’avoir aidé 36 personnes à passer la frontière le 14 mars 2024, à l’occasion de la Korrika, une course à pied transfrontalière entre les villes d’Irun et de Bayonne. L’action avait ensuite été revendiquée quelques jours plus tard, dans un communiqué signé par une vingtaine d’organisations et accompagné d’une vidéo réalisée pendant la course par un média militant basque, le site Ahotsa info.
Durcissement des contrôles de police
Depuis 2015, les autorités françaises ont rétabli les contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen. À Hendaye, le long du fleuve Bidassoa, qui fait office de frontière entre l’Espagne et la France, et jusque dans les montagnes des Pyrénées-Atlantiques, cette décision s’est alors traduite par un net durcissement des contrôles de police à l’encontre des étranger·es sans-papiers. Les exilé·es, originaires pour la plupart d’Afrique de l’Ouest, butent alors contre cette frontière verrouillée par les forces de l’ordre.
« Tous les jours, il y a des personnes qui attendent de passer la frontière, reprend Barthélémy Mottay. Quand elles y parviennent et qu’on les voit sur le bord de la route, on s’arrête et on les prend dans sa voiture, tout simplement. » Les habitant·es solidaires déposent ensuite les nouvelles et nouveaux arrivant·es à Bayonne, au centre Pausa, un lieu d’accueil ouvert en 2018 et financé par la communauté d’agglomération du Pays basque.
Elles sont sept personnes à passer en procès cette semaine. Mais « des dizaines d’autres personnes solidaires auraient pu être à la place des sept poursuivi·es », pointe le syndicaliste. Parmi les courriers d’auto-inculpation récoltés par le collectif qu’il anime, on trouve l’artiste basque Fermin Muguruza ou encore les sociologues Ugo Palheta et Michaël Löwy. « C’est aussi une manière de renverser la charge accusatoire, complète Thibaud Catté, du Nouveau parti anticapitaliste, membre du collectif. Ces personnes solidaires n’ont fait qu’aider des gens, or la réponse de l’État français, c’est la répression policière et judiciaire. »
Le militant estime que l’accusation devrait davantage se porter sur la France et les pays européens, responsables selon lui de politiques migratoires ayant provoqué des dizaines de milliers de morts aux frontières extérieures de l’Europe. L’ONG espagnole Caminando fronteras estime ainsi qu’en 2024, plus de 10 400 exilés ont perdu la vie ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Espagne, étape migratoire précédant l’arrivée au Pays basque. « Au Pays Basque, au moins neuf personnes exilées sont mortes en tentant de franchir la frontière, noyées dans la Bidassoa ou percutées par un train en longeant la voie ferrée », rappelle Thibaud Catté.
Le procès survient dans un contexte local d’accentuation de la pression policière à l’encontre du réseau militant. « Avant, les personnes solidaires subissaient des contrôles répétés des forces de l’ordre, mais cela ne s’était jamais soldé par des poursuites judiciaires », note Amaia Fontang, membre de la fédération Etorkinekin-Diakité, qui regroupe 12 associations de soutien aux personnes exilées mobilisées dans le Pays basque.
Les choses ont changé en mars 2023, quand trois militant·es ont été placé·es en garde à vue, pour « infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’étrangers en France. « Un des militant·es a appris au cours de sa garde à vue qu’il était surveillé depuis des mois, qu’il avait été mis sur écoute », rappelle Amaia Fontang.
Le parquet saisi par le préfet
Si aucune suite judiciaire n’a été donnée après ces gardes à vue, Amaia Fontang y voit malgré tout « un moment charnière ». Pour elle, les poursuites engagées suite à l’action menée pendant la Korrika, qui se sont soldées en octobre 2024 par le placement en garde à vue des sept personnes aujourd’hui mises en cause, représente un pas de plus dans « la criminalisation des solidaires ».
« Cette affaire revêt un caractère particulier, notamment car c’est le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a saisi le procureur », note pour sa part maître Maritxu Paulus Basurco, avocate de six des sept prévenu·es. Elle plaidera la relaxe lors de l’audience. « On se pose beaucoup de questions, ajoute-t-elle. Sept personnes sont accusées uniquement à partir d’une vidéo qui a été rendue publique après la Korrika. Pourquoi ces personnes-là plus que d’autres comparaissent ? »
Initialement prévu le 28 janvier dernier, le procès avait été reporté au 7 octobre, afin de permettre au parquet de Bayonne d’examiner les questions préjudicielles que les avocates des solidaires souhaitaient poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à propos notamment de l’interprétation du délit d’aide à l’entrée de migrants sur le sol français lorsqu’il s’agit d’un geste purement humanitaire.
Des personnes solidaires assimilées à des passeurs
« À Bayonne, le tribunal a l’habitude de juger des personnes qui ont fait passer la frontière à des personnes exilées avec une contrepartie, développe l’avocate Maritxu Paulus Basurco. Ce n’est pas du tout le cas dans cette affaire, où on est dans un acte militant. » Pour l’avocate, il s’agit ici « d’une action de désobéissance civile ».
À l’approche du procès, plusieurs élu·es locaux ont exprimé·es leur soutien aux militant·es solidaires. Dans un manifeste rendu public en septembre, 17 maires de villes basques situées de part et d’autre de la frontière, dont les élu·es d’Hondarribia, de Ciboure et d’Urrugne, demandent l’acquittement des sept citoyen·nes poursuivi·es et revendiquent « la nécessité d’une politique migratoire humaniste et réaliste dans laquelle la garantie des droits de toutes et tous sera une priorité ».
Dans un post Instagram du 1er octobre, les député·es Capdevielle Colette (Parti socialiste) et Peio Dufau (Euskal Herria Bai, une coalition de partis de gauche du Pays basque) défendent les militant·es poursuivi·es « pour avoir agi par humanité et solidarité » et déplorent que ce procès « criminalise la solidarité ».
Amaia Fontang craint que ce procès ne participe à jeter le discrédit sur le réseau d’aide aux exilés, « en diffusant, dans les médias et dans l’opinion publique, l’idée que des personnes solidaires soient assimilées à des passeurs ». La situation n’a toutefois pas atteint la détermination de la militante basque : « On se retrouve face à des autorités préfectorales et judiciaires qui essaient d’enrayer le mouvement de solidarité avec les exilés. Mais cette dissuasion ne fonctionnera pas, nous continuerons à aider et accompagner ces personnes. »
mise en ligne le 7 octobre 2025
Pourquoi les pénuries de médicaments battent des records en Europe
Christophe Prudhomme sur www.humanite.fr
Selon un récent rapport de la Cour des comptes européenne, le nombre de pénuries de médicaments signalées dans les pays européens a atteint de nouveaux sommets en 2023 et 2024. Le bilan est sans appel : l’Agence européenne du médicament a été impuissante et un système efficace de gestion des pénuries critiques fait toujours défaut.
Entre janvier 2022 et octobre 2024 ont été relevées plus de 136 pénuries dites critiques, une absence d’alternative appropriée pour le patient, ce qui peut avoir de graves conséquences sur sa santé. Les recommandations ne proposent pas de s’attaquer au problème à la racine mais simplement « d’améliorer le système de gestion des pénuries ». Ce constat, accablant, démontre que les simples mesures de régulation du marché proposées sont inefficaces.
« La marge brute sur un médicament vendu 10 euros est de 7,65 euros »
Le problème de fond est la mainmise de la production de médicaments par quelques grandes entreprises pharmaceutiques internationales dictant leur loi, celle du profit maximal, au détriment des enjeux de santé publique. Plus grave encore est le chantage exercé sur les gouvernements qui tentent de leur imposer quelques règles.
Ainsi, face aux diminutions de prix mises en œuvre par certains pays pour des produits dont les marges sont visiblement excessives, des firmes expliquent qu’elles préfèrent fournir ceux qui proposent de meilleurs prix et provoquent une pénurie pour punir ceux qui refusent d’accepter les tarifs qu’elles veulent imposer. Cette situation nécessite d’imposer une autre logique pour les médicaments, qui doivent devenir un bien commun échappant à cette logique du marché.
Ainsi, les ventes mondiales de médicaments ont dépassé 1 600 milliards de dollars en 2023, en augmentation de 8,2 % par rapport à 2022. Par ailleurs, la marge bénéficiaire des sociétés pharmaceutiques est très supérieure à celle des autres entreprises cotées en Bourse : 76 % contre 37 %. Traduction : la marge brute sur un médicament vendu 10 euros est de 7,65 euros !
La seule solution efficace est de travailler à la mise en place d’un pôle public du médicament en France et en Europe. Assez de beaux discours, sur l’indépendance industrielle quand on laisse persister un système où 80 % des principes actifs sont produits en Asie.
Assez de beaux discours sur l’innovation qui serait liée au dynamisme d’entrepreneurs privés, alors que l’essentiel des recherches permettant la mise au point de nouveaux traitements est effectué dans les universités et les instituts publics.
Assez de beaux discours sur les coûts de mise au point des médicaments quand les dépenses de marketing des firmes pharmaceutiques dépassent celles consacrées à la recherche. L’autre intérêt du pôle public du médicament serait de se soustraire aux brevets, mis en place dans les années 1960 dans le seul intérêt des investisseurs pour obtenir le meilleur rendement de leur capital.
mise en ligne le 6 octobre 2025
En Gironde, un dimanche révélateur des divisions « délétères » de la gauche
Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Pendant que Raphaël Glucksmann faisait sa rentrée à La Réole en réitérant son rejet de toute alliance avec La France insoumise, un collectif citoyen manifestait dans une commune voisine contre le Rassemblement National. Face à l’extrême droite qui convoite cette circonscription rurale gagnée par LFI en 2024, la demande d’unité à gauche n’a pas disparu.
La Réole, Saint-Macaire (Gironde).– Bernard n’est pas un fervent défenseur des partis de gauche. Béret vissé sur la tête, le retraité a plutôt tendance avec l’âge à se radicaliser plus à gauche qu’eux. Syndiqué à la CGT quand il officiait comme technicien du spectacle, il a fini par rejoindre l’anarchiste Confédération nationale du travail (CNT). Et pourtant, dimanche 5 octobre à Saint-Macaire, village de 2 500 habitant·es en Gironde dans lequel il réside depuis vingt ans, il défend l’union de la gauche.
« Du NPA [Nouveau Parti anticapitaliste – ndlr] jusqu’à certains du PS [Parti socialiste – ndlr], on est tous solidaires contre un même ennemi », dit-il en choisissant ses mots. Cet ennemi, c’est l’extrême droite qui tisse sa toile dans le département, comme partout en France. Ce jour-là, le militant a donc encore une fois pris le chemin de la rue pour protester, alors qu’Edwige Diaz, députée de la 11e circonscription de Gironde et vice-présidente du Rassemblement national (RN), tient une réunion publique dans la salle municipale François-Mauriac.
Officiellement, l’événement fait office de bilan de mandat pour l’élue d’extrême droite, mais la présence de François-Xavier Marques, ancien candidat aux législatives et référent du RN dans la 9e circonscription, ne trompe personne sur la volonté du parti de s’implanter là où il n’est pas encore installé. Dans la 12e circonscription, dont Saint-Macaire fait partie, une députée de La France insoumise (LFI), Mathilde Feld, a été élue de justesse – avec 480 voix d’écart – face au RN en 2024, sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).
« C’est une députée aux abois, elle se sait extrêmement menacée sur sa circonscription en cas de dissolution », a déjà eu l’occasion de dire Edwige Diaz à son sujet. Les élections municipales sont aussi dans le collimateur du parti de Marine Le Pen. Pour assister à la réunion de Saint-Macaire, il fallait s’inscrire. Manière de se constituer un fichier à l’approche de cette échéance, en mars 2026, et en cas d’imprévu – une dissolution, que la composition du nouveau gouvernement révélée dimanche soir et la démission du premier ministre, Sébastien Lecornu, dès le lendemain, ne font que rendre plus probable à terme.
Une résistance locale unitaire
Bernard a répondu à L’Appel du 18 mai, un collectif citoyen formé depuis les élections européennes de 2024, dont le tract très neutre en apparence et vierge de tout logo a essaimé partout dans le village : « Nous sommes la majorité ! Nous ne voulons pas que le fascisme et le racisme prospèrent dans nos sociétés », se concluait-il. Environ 150 personnes ont suivi son exemple. « RN, parti corrompu », « Marre des fachos », lit-on sur les pancartes confectionnées pour l’occasion.
« La résistance locale doit se construire. On n’a pas la garantie que Mathilde Feld soit reconduite si on ne se mobilise pas dès maintenant pour les municipales », prévient au micro Jacques, un membre du collectif, avant que des militant·es reprennent des airs connus avec des paroles engagées à la manière des Goguettes, sous le kiosque à musique du village. La réunion du RN commence à quelques dizaines de mètres de là, sous les huées et le regard patibulaire du service de sécurité. Quelques retardataires entrent, parfois une capuche sur la tête pour se cacher – ici tout le monde se connaît.
Des crânes rasés et des chaussures coquées ont aussi été aperçus. Deux mondes se font face. Le maire Cédric Gerbeau a fait valoir dans un communiqué « le principe d’égalité et la liberté de réunion », précisant que la majorité municipale « s’oppose fermement à tous les préceptes développés historiquement par ce parti politique d’extrême droite ». La réservation de la salle n’avait pas été faite au nom du RN. Sylvain Capelli, adjoint au sport présent au contre-rassemblement, fait face aux récriminations des militant·es de gauche en pointant le manque de solidarité des élu·es locaux du département.
Ces derniers craignent de braquer un électorat qui se manifeste toujours plus massivement dans les urnes. Bernard l’admet : « Dans les milieux ruraux, les gens ne s’informent que par la télé, et on sait ce que c’est devenu : des médias clairement d’extrême droite, qui font de la propagande et tournent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je connais dans le coin des gens qui se laissent laver le cerveau en regardant ça. » Entre deux slogans lancés devant la salle municipale, qui s’est remplie d’une centaine de personnes, Annie Descot, militante à Attac, rapporte le même constat : « Dans mon village, ce sont les mêmes qui votaient François Hollande il y a quinze ans. »
Si l’on suit son regard, la responsabilité de l’ancien président socialiste, dont le quinquennat a dévasté la gauche, est engagée. Celle d’Emmanuel Macron, qui n’a accédé à aucune des revendications des Gilets jaunes, aussi. « La colère est profonde », dit-elle en espérant « que le NFP gardera sa structuration » en cas de dissolution. Pour elle, seul un « rassemblement le plus large possible de la gauche » permettrait de résister. « Et pas des sociaux-libéraux », précise-t-elle.
« Les gens veulent une gauche combative »
Au même moment, à quinze kilomètres de là, le long de la Garonne, Raphaël Glucksmann concluait ses journées de rentrée à La Réole. Le fondateur de Place publique a lui aussi l’hypothèse d’une dissolution en tête, mais il martèle qu’il n’y aura plus d’alliance avec LFI. « Si le seul objectif est de barrer la route au RN, alors avoir un candidat LFI est la pire des choses possibles », assumait-il devant des journalistes, samedi 4 octobre. Le credo de Place publique a fini par infuser dans une bonne partie du PS, qui avait envoyé une délégation de représentant·es.
Mais même chez les sympathisant·es de l’eurodéputé, l’idée fait grincer des dents. Gaétan Loustalot, jeune élu de 23 ans au conseil municipal de La Réole – ville dirigée par le maire Place publique Bruno Marty –, n’a pas oublié les tags retrouvés à la mi-septembre dans la commune de 4 500 habitant·es : une flopée d’insultes racistes et un vœu sinistre : « Bardella 2027 », « RN 2027 »… « Le climat n’a pas beaucoup évolué dans le territoire depuis les législatives de 2024, mais en cas de dissolution, s’il n’y a pas une alliance à gauche, la circonscription peut basculer. Si la députée sortante fait face à une candidature PS, ce sera compliqué », dit-il, un peu gêné.
« C’est certain que cela pénaliserait la gauche, alors que des pans entiers de la population penchent très fort vers le RN, abonde Guillemette Tracou, investie dans la vie associative locale. Beaucoup de gens ont été déçus que Bruno Marty ne soit pas investi en 2024, mais Mathilde Feld est aussi une femme de valeur. »
Lors d’une table ronde dimanche 5 octobre sur les « petites communes », le sujet de la montée du RN était en arrière-plan, sans que la réponse politique de la gauche soit abordée. Bouchra Talsaoui et Khalid Benjilali, qui tiennent le Café de la gare de La Réole depuis 2021, ont pourtant été marqués par l’épisode des tags. Ils rapportent que des client·es assument désormais un vote RN, ce qui n’était pas le cas avant. « Il faut que la gauche soit unie, c’est clair, dit Khalid, qui y intègre LFI. Vu le contexte économique, les gens veulent une gauche combative, une gauche qui retrouverait son projet initial. La division serait délétère. »
En 2022, le maire Bruno Marty s’était présenté aux législatives en dissidence à la candidature de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), déjà représentée par Mathilde Feld. Il avait obtenu 9,7 % des suffrages exprimés. En 2024, il n’avait pas réitéré. Que fera-t-il aux prochaines échéances, alors que Raphaël Glucksmann n’arrête pas de répéter que la rupture avec LFI est « définitive » ?
« Quand on discute avec les gens, ils ont l’impression qu’on leur demande de faire un choix entre l’extrême gauche et l’extrême droite. Dans le monde rural, le discours de LFI, souvent orienté vers la France des banlieues, ne passe pas. Il faut que la ligne politique soit claire, sinon les gens de gauche finiront par s’abstenir, voire voter RN », déclare l’édile. À propos du rassemblement contre le RN à Saint-Macaire, il commente : « Ces initiatives sont importantes, mais ça ne fera pas tout. Il faut parler aux Français, on a besoin d’une gauche qui ne juge pas le monde rural. »
À La Réole ce week-end, Raphaël Glucksmann, persuadé qu’il ne faut pas laisser le sujet de l’identité française au RN, avait teinté son discours de patriotisme : « Il y a dans ce pays une angoisse sur ce que veut dire être français, il faut y répondre. » L’angoisse tout aussi réelle sur ce que voudrait dire une gauche divisée, ou qui tournerait le dos à ses engagements, était absente.
mise en ligne le 6 octobre 2025
Gaza : « Les pays arabes, les Européens et les Américains ont été d’une
lâcheté totale », dénonce Leïla Shahid
Vadim Kamenka sur www.humanite.fr
La bande de Gaza est livrée à un génocide. Leïla Shahid, qui condamne l’assassinat de civils israéliens le 7 octobre 2023, dénonce la passivité de la communauté internationale, incapable depuis deux ans d’obtenir un cessez-le-feu durable.
Leïla Shahid est ex-déléguée générale de la Palestine en France et ancienne ambassadrice auprès de l’UE
Deux ans plus tard, quel regard portez-vous sur ce triste anniversaire du 7 Octobre ?
Leïla Shahid : C’est une catastrophe à tous les niveaux. Une catastrophe, car l’attaque du Hamas a visé des militaires mais aussi des civils, dont des femmes et des enfants qui habitaient dans les kibboutz. Ils n’avaient rien à voir avec l’armée d’occupation israélienne. C’est ce qui m’a le plus touchée et horrifiée.
Je me suis toujours opposée aux meurtres perpétrés par n’importe quel groupe contre des civils. Il s’agit d’assassinats. Je ne comprends pas comment le Hamas peut le justifier. La Cour pénale internationale devra les juger un jour pour crime de guerre.
Mais pour l’heure, la réaction du gouvernement israélien, qui se déchaîne contre la bande de Gaza et commet un génocide, démontre que le 7 Octobre a été une aubaine pour tout détruire. Pourquoi, sinon, bombarder des écoles, des hôpitaux, des musées, des sites archéologiques ? Pourquoi faire tomber des immeubles entiers où résident des civils ? Il ne s’agit pas de tunnels.
Dans l’histoire de la Palestine, c’est sûrement une des pires périodes. Sur le plan humain, c’est un cataclysme. Le monde entier a les yeux rivés sur les images de la télévision et voit des enfants mourir de faim, des personnes âgées semblables à ceux sortant des camps de concentration en 1945. La communauté internationale a été d’une lâcheté totale et j’inclus les pays arabes, les Européens et les Américains.
Vous évoquez la lâcheté des gouvernements. Aucun cessez-le-feu n’a abouti et les rares avancées résident en une récente reconnaissance à l’ONU de la Palestine par une dizaine de pays et un projet de Donald Trump qu’on présente comme un « plan de paix ». Est-ce suffisant ?
Leïla Shahid : D’abord, je suis profondément choquée qu’aucun cessez-le-feu n’ait été instauré pour arrêter un massacre qui dure depuis deux ans. Je crois malheureusement que c’est un indice de ce qu’est devenu le monde politique international aujourd’hui. Mais je vais être en désaccord avec vous.
La reconnaissance de l’État de Palestine, elle a déjà été faite à plusieurs reprises. En 1982, François Mitterrand avait prononcé un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, réaffirmant la solution à deux États dont un État palestinien. Valéry Giscard d’Estaing, qui a ouvert un bureau de l’OLP à Paris, en 1975, a rappelé le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Jacques Chirac a parlé d’un État palestinien.
La reconnaissance un peu pompeuse, le 22 septembre aux Nations unies, n’était pas le résultat du terrible génocide. Le résultat, c’est le retour du peuple palestinien sur la scène internationale. Avec 66 000 victimes, plus de 150 000 blessés et des milliers d’estropiés dont des enfants, le prix est inhumain.
Les Palestiniens sont occultés depuis 1947. À l’époque, le pays était habité en majorité par des Palestiniens. Il y avait bien sûr la communauté juive de la Palestine qui, elle, n’était pas sioniste. Cette communauté d’orthodoxes qui sont des pratiquants considérait qu’un État devait se constituer avec l’arrivée du Messie.
Ce gouvernement israélien, qui est sûrement l’un des pires depuis la fondation de l’État d’Israël, a imaginé qu’en interdisant les journalistes étrangers d’entrer à Gaza, il n’y aurait pas d’images. Mais ils ont oublié que de nombreux journalistes travaillent sur place avec la presse internationale depuis des années. Avant même cette offensive de l’armée israélienne, accéder à Gaza était extrêmement difficile. L’enclave a déjà subi quatre guerres ces vingt dernières années. Grâce à ces journalistes, les gens ont pu assister à la réalité de Gaza : enfants estropiés, bébés qui meurent de faim.
Mais il ne faut pas oublier que l’armée israélienne fait la même chose en Cisjordanie. La seule raison pour laquelle ils ne peuvent pas la bombarder, c’est que 700 000 colons vivent entre les villages palestiniens. Benyamin Netanyahou leur a permis de construire de nouvelles colonies.
À la place, l’armée s’en prend aux camps de réfugiés comme à Jénine, Tulkarem, Naplouse, mais pas aux villes. Comme s’il avait compris que la révolution palestinienne, depuis sa naissance en 1964, était l’initiative des réfugiés expulsés en 1948.
Pourquoi, au bout de deux ans, la guerre se poursuit-elle dans la bande de Gaza ?
Leïla Shahid : La guerre continue car nous sommes dans une situation classique de colonialisme. L’armée israélienne réoccupe 80 % de la bande de Gaza qu’Ariel Sharon avait évacuée. Ce criminel, qui a perpétré énormément de massacres dont Sabra et Chatila au Liban, avait retiré l’armée de la bande de Gaza et les colons en 2005. L’ancien général voulait éviter de perdre davantage de soldats pour protéger les colons. Mais Sharon lui-même a compris qu’il ne fallait pas occuper Gaza, qui a la plus grande densité au monde.
Aujourd’hui, Benyamin Netanyahou affirme vouloir nettoyer le territoire du Hamas, c’est de la folie. Cette organisation est un mouvement social, politique, militaire, idéologique qui fait partie de la société. Ce n’est pas un parti politique avec une carte d’appartenance. Plus on tue de Gazaouis, plus on les pousse dans les bras du Hamas.
Vous imaginez le sentiment de vengeance lorsque vos enfants, vos parents, vos cousins, vos voisins sont exterminés par ces bombardements ? Malgré la différence de rapport de force sur le plan militaire, l’armée israélienne paye un lourd tribut. Plusieurs officiers israéliens refusent d’aller servir en disant : « Ce n’est pas notre guerre. »
Néanmoins, le Hamas souhaite un compromis depuis le début des négociations lancées avec le Qatar et l’Égypte comme intermédiaires. Il y a plusieurs mois, le mouvement était prêt à signer un cessez-le-feu pour libérer les otages et arrêter les attaques. Mais c’est Benyamin Netanyahou qui n’a pas voulu. Car il s’agit de son seul moyen de rester au pouvoir et d’éviter les tribunaux.
Le plan présenté en début de semaine par Donald Trump est-il porteur d’espoir ?
Leïla Shahid : Je récuse totalement l’expression de « plan de paix ». Je suis scandalisée que la presse soit entrée dans le jeu du président des États-Unis. Donald Trump est un immense irresponsable, inculte et un grand danger pour la paix dans le monde.
Les 20 points n’ont rien de très spécial et ce n’est même pas un plan. Et surtout pas un plan de paix. C’est prendre l’opinion publique pour des imbéciles. Il n’y a pas une référence au droit international qui a déjà défini les deux États et l’autodétermination du peuple palestinien.
Aucune consultation n’a eu lieu en amont avec la partie palestinienne. Comment cela peut-il être un plan de paix si on ne demande son avis qu’à l’autorité israélienne ? Trump a négocié avec Netanyahou mais ne l’a pas fait avec les Palestiniens, ni avec les États arabes à qui il a demandé d’intervenir. C’est un mépris qui relève du racisme à l’égard de la partie arabe. Il pense que les Palestiniens, les Qataris et les Égyptiens ne sont pas capables de réfléchir sur un vrai plan de paix ? Ce conflit vient d’un processus de décolonisation.
La manière dont il parle des Palestiniens me choque énormément. Si nous avons préservé quelque chose de notre lutte de soixante-dix-huit ans, c’est notre dignité. Lorsque vous devenez apatrides, pauvres, jetés dans un camp, et que vous n’avez personne pour vous protéger, ni gouvernement, ni État, vous faites la révolution. Une population entière qui était humiliée et niée dans son existence s’est relevée et a fondé un mouvement de lutte armée. Elle a décidé d’aller se battre au nom de la décolonisation de la Palestine.
Ce plan évince-t-il totalement les Palestiniens ?
Leïla Shahid : Ni l’Autorité palestinienne, ni le Hamas, ni d’autres organisations palestiniennes ne font partie de la direction de Gaza imaginée par Donald Trump. Que représente-t-il pour décider à la place des Palestiniens ? Tous les mouvements de la société palestinienne doivent être parties prenantes : le Front populaire de libération (FPLP), le front démocratique (FDLP), les communistes (PPP), le Fatah, les indépendants et le Hamas.
Ce comité international n’a aucune légitimité pour imposer à tous ces mouvements qui font l’histoire contemporaine de la Palestine une nouvelle forme de colonialisme. Il y a une très bonne expression anglaise qui résume la situation : « Damned if you don’t, damned if you do. » C’est un drame si vous le refusez et c’est un drame si vous l’acceptez.
Car ils évoquent enfin un cessez-le-feu, le retour de l’aide humanitaire alors que la population meurt de faim. Mais c’est à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité d’imposer un cessez-le-feu.
Quel rôle peut jouer aujourd’hui l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ?
Leïla Shahid : Je suis de la génération de l’OLP. Je suis née en 1949, un an après la Nakba, de deux parents qui sont tous les deux nés en Palestine. Mon père à Saint-Jean-d’Acre et ma mère à Jérusalem. Mon grand-père était très impliqué dans la lutte anticoloniale britannique. Il n’a combattu ni les Israéliens ni les juifs, il a combattu les Britanniques, qui avaient promis un foyer national juif en Palestine.
En tant qu’homme politique de l’époque, il voyait venir cette guerre entre les juifs qui arrivaient d’Europe et les Palestiniens qui habitaient là. Et le mandat britannique, normalement, comme le mandat français au Liban ou en Syrie, devait préparer la population à l’indépendance. Ils n’avaient aucun droit de donner le pays à quelqu’un d’autre.
Or, en 1947, il y a eu le plan de partage, c’est-à-dire la résolution 181. Cette résolution dit qu’il faut créer deux États, un État juif qui s’appellera Israël et un État palestinien qui s’appellera la Palestine. Et Jérusalem doit rester un corpus separatum. Mais l’État arabe n’a jamais vu le jour.
En 1988, lorsque Yasser Arafat proclame l’État palestinien, il le déclare sur la base de la résolution 181, ça veut dire la même résolution qui légitime un État juif en Palestine. Ce n’était pas un hasard. Nous avons voté la reconnaissance d’Israël en 1988 au Conseil national palestinien d’Alger. Eux n’ont jamais reconnu la Palestine. L’État proclamé porte seulement sur 23 % du territoire du mandat où habitent les Palestiniens : Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.
Pourtant, le plan de partage donne aux Palestiniens 54 % de la Palestine mandataire et nous avons reconnu à l’État d’Israël 77 % du territoire. Arafat voulait mettre un terme à la guerre par le compromis. Sauf que personne n’a aidé le président Arafat et le peuple.
Les Palestiniens, d’ailleurs, ne pardonnent pas à Mahmoud Abbas d’avoir accepté cette humiliation depuis deux ans. En tout cas, je ne lui pardonne pas. Même si le rapport de force n’est pas égal, on doit se battre pour préserver sa dignité, son droit d’être un peuple libre. La seule chose qu’il a réalisée, c’est cette rencontre à New York avec Macron et Mohammed Ben Salmane. Et cette initiative n’a rien changé au génocide, alors qu’on la présente comme un changement historique.
mise en ligne le 5 octobre 2025
En Espagne,
l’État providence rapporte
un pognon de dingue
Luis Reygada sur www.humanite.fr
Le gouvernement de coalition de gauche mené par Pedro Sanchez fait figure de meilleur élève européen en menant des politiques inverses aux diktats néolibéraux et austéritaires. L’État providence espagnol fait recette. Étonnant ?
Fort d’un bilan économique qui se distingue très clairement dans une Europe atone, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, pouvait, fin juillet, lors de la présentation de son bilan annuel, affirmer que le pays qu’il dirige depuis juin 2018 « traverse l’une des périodes les plus prospères de son histoire démocratique ».
Exagération de la part du chef d’État socialiste, qui assume en plus vouloir continuer à renforcer sa politique d’« État providence », pour le bénéfice de la plus grande partie de la population ? N’en déplaise à son opposition, les chiffres lui donnent raison, et certains vont même jusqu’à parler de « miracle espagnol ».
Le royaume ibérique fait d’ailleurs office de locomotive de l’Union européenne (UE), paraissant laisser loin derrière les conséquences des crises économiques liées à la pandémie de Covid (récession) puis à la guerre en Ukraine (inflation). Même la guerre commerciale déclarée par les États-Unis paraît à peine effleurer l’économie espagnole.
Des statistiques au beau fixe
L’année dernière, le produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne – la quatrième économie de la zone euro – avait bondi de 3,5 %, soit une progression quatre fois supérieure à la moyenne de l’UE. Pour 2025, le taux de croissance ne devrait atteindre « que » 2,7 %, alors que la Commission européenne prévoit une croissance moyenne de 0,9 % dans l’UE.
L’Espagne devance ainsi toutes les grandes économies voisines (0 % de croissance prévue pour l’Allemagne, 0,6 % pour la France et l’Italie) et va même jusqu’à représenter à elle seule 50 % de la croissance de la zone euro.
En parallèle, le déficit public de l’Espagne affiche sa quatrième année consécutive de baisse (2,8 % du PIB, soit 44,6 milliards d’euros), une tendance que suit aussi la courbe du chômage : même si, avec 10,3 %, son taux reste bien plus élevé que la moyenne européenne (6 %), il est actuellement à son plus bas niveau depuis 2008.
Aujourd’hui, le pays – qui accumule le quart des nouveaux emplois créés dans l’UE durant ces cinq dernières années – compte 2,3 millions d’emplois de plus qu’avant la pandémie, tandis que son PIB par habitant a augmenté de 16,4 %.
Le pouvoir du pouvoir d’achat
Pour atteindre ce niveau de dynamisme, l’Espagne s’appuie sur plusieurs leviers. Un commerce extérieur avec le vent en poupe et peu dépendant des États-Unis (son 6e partenaire commercial), des entreprises qui investissent (+ 2,1 %), un tourisme (2e place mondiale) qui bat tous les records avec 94 millions de visiteurs étrangers en 2024 (+ 10 %) et 126 milliards d’euros dépensés par ceux-ci (+ 16 %).
Les aides de l’UE jouent aussi un rôle considérable : avec 55 milliards d’euros reçus depuis 2021, Pedro Sanchez a fait de l’Espagne le premier pays bénéficiaire depuis le lancement des divers plans de relance destinés à aider les États membres de l’UE à se remettre de la pandémie de Covid.
Le gouvernement a très clairement fait de la captation de ces ressources une de ses priorités, facilitant les démarches aux différents niveaux administratifs pour ne pas laisser échapper la manne bruxelloise.
Néanmoins, ce sont surtout la hausse de la consommation des ménages (+ 2,8 % annuels) ainsi que de la consommation publique (+ 18,4 % depuis l’avant-pandémie, 7 points de plus que la moyenne de l’UE) qui sont les facteurs réellement déterminants de l’autre côté des Pyrénées.
L’austérité n’est pas un passage obligé
Pour la gauche au pouvoir en Espagne, c’est avant tout l’inverse du modèle néolibéral promu par Bruxelles qu’il fallait surtout suivre, et mettre en place au contraire une politique de la demande, basée sur le moteur qu’est l’emploi.
« À partir de 2020, avec l’arrivée du premier gouvernement de coalition, un changement de stratégie clair s’est opéré en matière de politique économique. La politique d’austérité et de dévaluation salariale – imposée après la crise financière de 2008 et très coûteuse en termes de bien-être social – a été abandonnée au profit d’une politique budgétaire expansionniste », explique l’économiste Ignacio Alvarez Peralta, secrétaire d’État aux Droits sociaux entre 2020 et 2023 et actuellement professeur à l’université autonome de Madrid.
Pour lui pas de doute : avec une hausse du pouvoir d’achat à la suite d’un bond de 60 % du salaire minimum en cinq ans (1 184 euros net par mois aujourd’hui) et une réforme du travail, en 2022, qui a notamment transformé 1,5 million de CDD en CDI tout en renforçant une série de droits pour les travailleuses et les travailleurs, difficile d’échapper à une « phase de croissance remarquable »…
Soutenues par une augmentation de la consommation publique (croissance réelle de 40 % des dépenses publiques entre 2019 et 2024) et de la consommation privée, ainsi que des recettes fiscales (+ 10 % durant le premier semestre 2025), notamment grâce à de nouveaux impôts visant les revenus du capital et les plus hauts contributeurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
L’emploi, source de richesse
En définitive, les performances économiques de l’Espagne n’ont rien d’un miracle, et c’est plutôt du côté du dynamisme de l’emploi qu’il faut se pencher, ainsi que du rôle positif et clairement assumé par le gouvernement que joue l’immigration, primordiale pour maintenir sur le long terme le marché du travail à flot ainsi que l’équilibre financier du système des retraites.
« Plus d’emplois, c’est plus de richesses susceptibles d’être distribuées sous forme de salaires, plus de cotisations sociales, plus de rentrées fiscales, et plus d’investissements publics », souligne Denis Durand, membre de la commission économique du PCF.
Pour cet ancien directeur adjoint à la Banque de France, les points forts de l’économie espagnole révèlent combien les politiques économiques menées dans la zone euro – compression et précarisation des emplois, obsession de la baisse du coût du travail, appauvrissement des services publics – « sont aberrantes ».
L’immigration facteur de croissance ?
« La contribution des travailleurs migrants à notre économie, notre système social ou à la soutenabilité des retraites est fondamentale. Pour l’Espagne, la migration est synonyme de richesse, de développement et de prospérité », déclarait Pedro Sanchez l’année dernière.
Dans une récente étude, le think tank Terra Nova s’est penché sur la question en montrant « comment un pays garde-frontière de l’Europe a su transformer l’immigration en levier de croissance et de vitalité démographique », en misant notamment sur des régularisations d’ampleur de travailleurs sans papiers, l’inclusion par le travail et le dialogue social. Le tout encadré par des choix politiques, économiques, démographiques ainsi qu’une approche humaniste assumés par Madrid, et largement soutenus dans l’opinion publique.
Salaire, emploi, temps de travail... Comment l'Espagne a tourné la page du néolibéralisme ? Réponses du député de Sumar Manuel Lago
Luis Reygada sur www.humanite.fr
Pour le député de Sumar Manuel Lago, le gouvernement espagnol prouve que les politiques de progrès social favorisent à la fois les travailleurs et l’économie.
Comment expliquez-vous le dynamisme de l’économie espagnole ?
Manuel Lago : Nous sommes face à ce que j’appelle un cercle vertueux, multifactoriel, mais principalement stimulé par les moteurs que sont l’emploi et le travail, c’est-à-dire à contre-courant du modèle classique libéral. L’élément clé de notre croissance est la demande intérieure.
Cette demande est stimulée par la consommation des ménages, l’investissement, les dépenses publiques…
Manuel Lago : Effectivement, mais à cela s’est ajouté un changement de paradigme en matière de relations de travail. La crise financière de 2008 avait été suivie d’une décennie d’austérité pendant laquelle le modèle promu par l’Union européenne consistait à dévaluer le facteur travail, pour « être compétitif ». L’arrivée de la gauche au pouvoir a entraîné une réorientation radicale.
Qu’entendez-vous par « changement de paradigme en matière de relations de ravail » ?
Manuel Lago : Avec l’arrivée au pouvoir de partis à la gauche du Parti socialiste – d’abord avec la coalition Unidas Podemos (en janvier 2020) puis avec Sumar (depuis novembre 2023 avec l’actuel gouvernement Sanchez III – NDLR) –, les politiques de précarisation, d’emploi mal rémunéré et de réduction des droits ont été abandonnées au profit d’une nouvelle orientation reposant sur trois axes.
D’abord, une intervention de l’État face à la crise provoquée par la pandémie de Covid, avec des mesures visant à protéger les emplois et le tissu productif. Auparavant, toute crise entraînait chez nous des licenciements massifs (3,5 millions d’emplois détruits après 2008).
Ensuite, un changement en matière de politique salariale, avec un salaire minimum qui est passé de 736 euros par mois en 2019 à 1 184 euros aujourd’hui, soit une augmentation de 61 %. Le troisième axe est la réforme du travail, approuvée en février 2022.
Il s’agit du décret-loi « pour la garantie de la stabilité de l’emploi et la transformation du marché du travail »…
Manuel Lago : Tout à fait. Il est le fruit d’un accord atteint par le gouvernement représenté par la ministre du Travail, Yolanda Diaz, après plusieurs mois de dialogue social avec les syndicats de travailleurs et patronaux. Ce texte a modifié les relations de travail, notamment en privilégiant les contrats à durée indéterminée plutôt que ceux à durée déterminée. Depuis, le taux de CDD est passé de 30 % à 12 %.
Quelles sont les conséquences de la politique de sécurisation de l’emploi ?
Manuel Lago : Avoir de la stabilité change la vie de millions de personnes. Nous sommes passés d’un modèle néolibéral socialement très injuste à un modèle avec des emplois stables, mieux rémunérés et offrant davantage de droits. Cela favorise la consommation, et si l’on ajoute les augmentations des retraites (10 millions d’ayants droit) ainsi que des allocations perçues par les chômeurs (2 millions d’ayants droit), nous atteignons ce cercle vertueux dans lequel la population a plus de pouvoir d’achat et consomme davantage, principalement dans sa communauté, générant une demande et une activité accrues pour les entreprises locales, qui, à leur tour, embauchent…
Qu’en est-il du poids du secteur touristique dans le PIB ou du rôle de l’immigration dans la croissance ?
Manuel Lago : Ce cercle vertueux a aussi enclenché un début de changement dans notre structure productive. Le relèvement des normes du travail élimine du marché les entreprises qui s’appuient sur la surexploitation des travailleurs, et renforce au contraire les entreprises les plus solides.
S’il est vrai que le tourisme joue un rôle très important, ce ne sont plus la construction, le commerce et l’hôtellerie qui sont les secteurs où l’emploi augmente le plus, mais bien les activités productives qui génèrent le plus de valeur. Le chômage vient d’atteindre son taux le plus bas depuis 2008 (10,3 % – NDLR) ; les migrants qui viennent en Espagne trouvent du travail car il y a une croissance et des entreprises qui recherchent de la main-d’œuvre.
Les grandes entreprises se portent en effet très bien, et la Bourse de Madrid bat des records…
Manuel Lago : Je pense que c’est la grande leçon que donne l’Espagne, en mettant en œuvre ce que l’on pourrait appeler un « keynésianisme de gauche du XXIe siècle ». Nous démontrons que les politiques de progrès social améliorent non seulement la vie d’une part importante de la population, mais ont aussi un impact positif sur l’ensemble de la société.
Notre formule n’est pas parfaite, mais elle fonctionne. Nous sommes le gouvernement le plus progressiste d’Europe, avec un modèle dont la force et le succès résident dans l’unité de la gauche.
Quels sont les prochains chantiers de ce gouvernement ?
Manuel Lago : La réduction du temps de travail, pour passer de 40 à 37,5 heures hebdomadaires sans réduction salariale. Ce projet de loi a déjà été approuvé par le Conseil des ministres et doit maintenant être débattu au Congrès. Il s’agit d’une mesure qui profitera tant aux travailleurs qu’aux entreprises et qui met en jeu la justice sociale.
mise en ligne le 5 octobre 2025
La Sécu
contre l’absurdité libérale
Sébastien Crépel sur www.humanite.fr
Quoi de mieux qu’une mobilisation interprofessionnelle pour l’anniversaire de notre bonne vieille Sécu, qui souffle ses 80 bougies le 4 octobre ? La journée d’action et de grève du 2 octobre ne pouvait tomber plus à propos pour rappeler que la Sécurité sociale n’est pas une banale administration. Encore moins un appendice d’un « État providence ». Elle est le bien commun des travailleuses et des travailleurs, conquis de haute lutte à la Libération et financé par une fraction de leur salaire mutualisé. Un modèle « inspiré du souci de confier à la masse des travailleurs, à la masse des intéressés la gestion de leur propre institution », exposait le 8 août 1946 aux députés le ministre communiste Ambroise Croizat, à l’origine de cette création.
C’est cette marque de propriété collective qui lui vaut les attaques incessantes de ceux qui veulent récupérer l’argent et sa gestion, en les étatisant d’abord, pour mieux les privatiser ensuite. Les deux ne sont pas antinomiques, au contraire. D’abord élus directement par les salariés, les administrateurs de la Sécu ont intégré des représentants patronaux en 1967, avant que les élections soient supprimées après 1983, tandis que l’État prenait l’essentiel du contrôle financier en substituant les impôts (la CSG et la TVA, notamment) aux cotisations et en contraignant les budgets.
L’absurdité libérale est à son comble : on compterait aujourd’hui 1,7 milliard de combinaisons de barèmes de cotisations possibles.
Le casse du siècle a pu s’opérer tranquillement : à partir de 1993 sont apparus les fameux « allègements de charges » sociales exonérant les employeurs du versement des cotisations qui font partie intégrante du salaire. Ces exonérations ont culminé à 77 milliards d’euros en 2024, jusqu’à devenir « le troisième budget de l’État hors charge de la dette après la défense et l’enseignement scolaire », selon la commission sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises. Soit plus de 35 % des 211 milliards d’euros toutes aides confondues chiffrés par le rapporteur de la commission, Fabien Gay, également directeur de « l’Humanité ».
L’absurdité libérale est à son comble : on compterait aujourd’hui 1,7 milliard de combinaisons de barèmes de cotisations possibles avec les différents dispositifs d’allègement. Plus qu’il n’existe d’entreprises sur Terre. Pour un résultat sur l’emploi inversement proportionnel aux moyens dépensés. Ainsi, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), impulsé par François Hollande à partir de 2013 et intégré au barème des cotisations comme baisse pérenne en 2019, aurait permis, selon France Stratégie, la création de 100 000 à 400 000 emplois pour un coût de 18 milliards en 2016. Soit une aide de 45 000 à 180 000 euros par an et par emploi, c’est-à-dire davantage que la totalité des salaires versés.
Les cotisations représentent désormais moins de la moitié (49 %) des recettes des régimes de base de la Sécu, contre 82 % en 1993. Les travailleurs sont peu à peu dépossédés de leur bien commun : la gestion, le financement, et pour finir leurs droits leur sont progressivement retirés. On a vu où cela conduit avec l’assurance-chômage, qui « n’est plus du tout financée par les cotisations des salariés, relevait Emmanuel Macron devant le congrès du Parlement en 2018. Cette transformation, il faut en tirer toutes les conséquences, il n’y a plus un droit au chômage, au sens où l’entendait classiquement. »
L’anniversaire de la Sécurité sociale, avec les colloques et la littérature qui l’accompagnent, peut être l’occasion de reprendre collectivement la main. Le bouillonnement social autour du contrôle des aides aux entreprises et de la taxe Zucman sur le capital y invite. Le rapport de force idéologique place les dépeceurs de la Sécu sur la défensive. C’est le moment de regagner le terrain perdu.
Carte vitale d’alimentation, sécurité sociale funéraire… Quelle Sécu pour le XXIe siècle ?
Cyprien Boganda sur www.humanite.fr
La Sécurité sociale, qui fêtera ses 80 ans ce samedi 4 octobre, subit des attaques sans précédent. Ses défenseurs – partis de gauche, syndicats, associations – rivalisent de propositions pour étendre son champ d’action, en restant fidèle aux objectifs de ses fondateurs.
Ce n’est pas tous les jours qu’on célèbre l’anniversaire d’une conquête sociale. Ce 4 octobre, une vieille dame toujours verte fêtera quatre-vingts ans d’une histoire tumultueuse, jalonnée d’avancées exemplaires et de reculs douloureux, qui ont transformé le visage du pays.
Aujourd’hui comme hier, la « Sécu » se retrouve sur la ligne de front d’une bataille idéologique : la gauche, qui y voit une réponse à la toute-puissance du marché, veut la protéger contre vents et marées ; les plus libéraux la vouent aux gémonies pour les mêmes raisons. L’immense majorité des assurés, eux, ont conscience de son utilité sans forcément prendre la mesure de ce qu’ils lui doivent : combien savent, par exemple, que sans elle, un accouchement leur coûterait 2 500 euros ?
Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d’une ambition aussi louable que titanesque (« en finir avec la peur du lendemain »), la Sécurité sociale n’est pas qu’une institution à préserver ou une vieillerie à chérir, c’est un horizon politique à conquérir, une idée à défendre et à réinventer sans cesse.
1. Une Sécu de la naissance à la mort
Henri Raynaud, ancien dirigeant de la CGT, fixait ainsi le cap, en 1947 : « Il s’agit de couvrir (les travailleurs) de tous les risques, de tous les cas dans lesquels leur salaire ou le fruit de leur travail se trouve diminué. » Vaste programme !
Aujourd’hui, les promoteurs de cette institution rêvent d’élargir sa palette en garantissant à l’ensemble des travailleurs une couverture complète contre l’ensemble des risques, de la naissance à la mort en passant par la retraite ou la maladie. À l’heure où les gouvernements ne parlent que de « déremboursement » de soins, la CGT plaide ainsi pour une « prise en charge à 100 % », ce qui supposerait de refonder l’offre de soins (développement de centres de santé pluriprofessionnels employant des médecins salariés, création d’un pôle public du médicament, etc.).
« Dans le cadre du « 100 % Sécu », les coûts liés aux activités de soins sont pris en charge, résume le syndicat. Il n’y a plus de mécanisme de remboursement dans la mesure où les actes médicaux sont réalisés par des personnels payés directement par la Sécu et où les médicaments et produits de santé sont produits et distribués directement par la Sécurité sociale. » Dans les faits, cela permettrait de dire adieu aux franchises et autres dépassements d’honoraires. Ce qui n’a rien d’un détail, quand on sait que les seuls dépassements d’honoraires ont représenté la somme astronomique de 4,3 milliards d’euros en 2024.
La « démarchandisation » s’étendrait aussi à la prise en charge de la dépendance. « Les aides à domicile seraient salariées directement par la Sécurité sociale et les familles n’auraient plus à faire d’avance, explique Cécile Velasquez, secrétaire générale de la CGT Organismes sociaux. Aujourd’hui, cela coûte environ 23 euros de l’heure en moyenne, c’est très cher. Demain, c’est la Sécu qui prendrait en charge. »
Pour parachever une Sécu couvrant la totalité des risques de l’existence, le député LFI Hadrien Clouet entend déposer une proposition de loi actant la création d’une sécurité sociale du funéraire. « Nous avons calculé qu’une cotisation de 0,3 point sur le salaire brut permettait de couvrir l’ensemble des frais moyens des obsèques, qui s’élèvent à environ 4 000 euros », indique le parlementaire.
Et d’ajouter, pour étayer son raisonnement : « Le risque de mourir étant par définition imparable, c’est un risque social que l’on doit couvrir légalement. Il est urgent de démarchandiser le secteur du funéraire, géré à 40 % aujourd’hui par trois entreprises uniquement, qui proposent des tarifs exorbitants. Avec notre système, il y aurait demain des pompes funèbres conventionnées, dont les actes seront pris en charge par la Sécu. »
2. L’alimentation, nouvel enjeu ?
Certains défenseurs de l’institution voudraient couvrir les assurés contre des risques non pris en charge aujourd’hui. C’est le cas de la précarité alimentaire, qui frappe des millions de personnes (jusqu’à 16 % de la population selon certaines études).
Le projet de Sécurité sociale alimentaire (SSA), portée par diverses associations (Confédération paysanne, Ingénieurs sans frontières Agrista, Réseau salariat…) repose sur une idée simple : permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des produits alimentaires de qualité, en allouant 150 euros par mois et par personne (c’est la « carte vitale d’alimentation ») qui permettront d’acheter des aliments de producteurs et structures conventionnés.
Reste que le coût du dispositif (120 milliards d’euros tout de même) implique de mener un vaste débat sur son financement. Les promoteurs de la SSA privilégient la cotisation sociale, tout en se disant ouvert au débat.
3. La question centrale du financement
De toute façon, renforcer la Sécu suppose de trouver des ressources nouvelles. Les libéraux expliquent depuis des années que le financement de notre modèle de protection sociale reposerait trop sur le travail, d’où la nécessité selon eux de transférer une part croissante de ce financement vers d’autres prélèvements, comme la TVA par exemple. À gauche, on rétorque que la TVA est par nature le plus inégalitaire des impôts (les plus pauvres consacrent une part proportionnellement plus importante de leurs revenus à la consommation), et on insiste sur la primauté de la cotisation sociale.
« Il faut que la Sécu reste majoritairement financée par la cotisation, c’est-à-dire la richesse produite par le travail, rappelle Yannick Monnet, député PCF. Et il faut absolument constitutionnaliser ce principe, car cela permettra de mettre fin à la dérive du financement de la Sécurité sociale par l’impôt : cette dérive transforme la Sécurité sociale en système assurantiel, dans lequel on paye en fonction de ses moyens et où on reçoit aussi en fonction de ses moyens. »
La CGT avance une série de propositions : intégration des rémunérations comme l’intéressement et la participation dans le salaire (entre 4,1 milliards d’euros et 5,7 milliards d’euros de ressources nouvelles), hausse d’un point de cotisation (10,5 milliards d’euros), lutte contre la fraude aux cotisations sociales du fait du travail dissimulé (au moins 6 milliards d’euros), etc.
4. Des caisses gérées par les travailleurs
À l’origine, la Sécu était gérée par les travailleurs eux-mêmes, ou plus exactement par leurs représentants siégeant au sein des différents conseils d’administration (CA). Le patronat avait aussi des représentants, mais dans des proportions très inférieures. L’avènement du paritarisme, en 1967, mettra un terme à cette parenthèse (presque) autogestionnaire.
« Aujourd’hui, la Sécu est gouvernée par l’État de la Ve République, c’est-à-dire un État à la fois très centralisé et autoritaire, qui a tendance à servir davantage les intérêts du capital que ceux du travail, explique Nicolas Da Silva, économiste spécialiste de la santé. Un exemple parmi d’autres : dans la santé, l’État développe le marché et finance son extension, à travers le soutien aux cliniques privées, à l’industrie pharmaceutique, etc. À l’inverse, si la Sécu était gouvernée de manière plus démocratique, le sens des politiques publiques serait peut-être différent. »
Exemple : une Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pilotée par des représentants de salariés et des associations d’usagers aurait-elle validé l’application de la réforme des retraites de 2023 ?
Aujourd’hui, beaucoup plaident pour démocratiser la Sécu en redonnant le pouvoir aux représentants de salariés, même si les modalités diffèrent en pratique : faut-il confier la gouvernance aux seules organisations de salariés, comme le réclame la CGT ? Ou bien y faire entrer des représentants du patronat, des indépendants, voire des associations de patients ? Tous s’accordent en revanche sur la volonté d’exclure progressivement l’État de la gestion de la Sécurité sociale.
« Ça n’a jamais été autant le désordre que depuis que l’État, via le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFFS), met les mains dans le budget de la Sécu, martèle le député Yannick Monnet. Il faut que cette valeur ajoutée créée par le monde du travail soit gérée par le monde du travail. Et que nous, parlementaires, n’ayons plus à y revenir. »
« Quelle que soit la répartition du pouvoir dans les CA, le plus important, c’est que la Sécu soit gérée par les assurés eux-mêmes, résume de son côté le député Hadrien Clouet. L’autonomie des caisses est centrale, car elle permettra d’ouvrir de nouveaux espaces d’exercice du pouvoir, en dehors de l’État. C’était l’ambition originelle de la Sécu. »
mise en ligne le 4 octobre 2025
Le « oui, mais » du Hamas au plan de Trump
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Alors que le président des États-Unis avait lancé un ultimatum, le mouvement palestinien a répondu vendredi soir, en se disant prêt à libérer tous les Israéliens, vivants et morts, encore retenus dans la bande de Gaza. La Maison-Blanche a ordonné à Israël de cesser de bombarder ce territoire palestinien.
Le Hamas n’aura pas attendu l’échéance de l’ultimatum lancé par Donald Trump, à son plan de paix présenté le 29 septembre à la Maison-Blanche, pour donner sa réponse, qui sonne comme un « oui, mais ». Le Jihad islamique a fait de même.
Après avoir donné soixante-douze heures de délai, le président états-unien s’était fait plus pressant le jeudi 2 octobre en exigeant une réponse d’ici dimanche soir. L’organisation islamiste, que l’on disait divisée sur l’attitude à adopter, est finalement intervenue vendredi soir. Le mouvement accepte de libérer tous les prisonniers israéliens détenus à Gaza (ils seraient 48, dont la moitié sont toujours vivants), « d’une manière qui permette » la fin de la guerre israélienne et un retrait total de la bande de Gaza. Il a également affirmé qu’il remettrait le pouvoir à Gaza à un groupe de technocrates palestiniens. Pour le reste du plan en 20 points de Trump, qui comprend le désarmement du groupe, il a déclaré qu’il devrait être « discuté dans un cadre national palestinien global, dans lequel le Hamas sera inclus et contribuera en toute responsabilité ».
« Israël doit immédiatement cesser de bombarder Gaza »
Immédiatement après, Trump a salué cette réponse du Hamas, écrivant même sur son site Truth Social qu’il pensait que le groupe palestinien était « prêt pour une PAIX durable », avec l’utilisation de majuscules dont il est coutumier. Il a même ajouté : « Nous discutons déjà des détails à régler. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant recherchée au Moyen-Orient. » Plus surprenant sans doute est l’ordre lancé à Benyamin Netanyahou : « Israël doit immédiatement cesser de bombarder Gaza ».
Pour Ayman Odeh, chef de file des députés communistes israéliens à la Knesset, le parlement israélien, « depuis que le Hamas a répondu positivement à la proposition, Netanyahou n’a pas dormi. La réponse de Trump le rend fou et il fera tout pour saboter l’accord et la fin de la guerre destructrice à Gaza. Netanyahou sabote et sabotera tout ce qui pourrait mettre fin à la guerre, car il n’a rien à offrir, si ce n’est davantage de destruction, de dévastation et de bombardements. Il ne doit pas être autorisé à agir ainsi. »
On se souvient que, lors de la présentation du plan, aux côtés de Donald Trump, le premier ministre israélien avait dit « soutenir » l’initiative et avait souligné, en anglais, que si le Hamas rejetait le plan, « ou s’il l’acceptait et faisait ensuite tout pour le contrer », Israël « finirait le travail tout seul ». Changement de ton quelques heures plus tard, en s’adressant, en hébreu cette fois, aux Israéliens. Il révélait (quel scoop !) qu’il n’avait pas accepté la création d’un État palestinien et promettait que l’armée israélienne resterait dans la majeure partie de Gaza.
« La raison de cet accueil conditionnel d’un plan qui répond à la plupart des exigences israéliennes, utilisant une formule du ” oui, mais ” sans acceptation ni rejets complets, est que le rejet équivaut à un suicide politique et militaire, car il offre à Israël une couverture régionale et internationale pour poursuivre son génocide avec une férocité accrue », estime Hani al Masri, directeur de Masarat, le Centre palestinien de recherche politique et d’études stratégiques, basé à Ramallah. « À l’inverse, poursuit-il, une acceptation absolue signifie une reddition sans garanties quant à l’arrêt de la guerre, à la prévention des déplacements, au retrait et à la reconstruction. Le Hamas parie que la principale préoccupation de Trump est de réaliser un exploit personnel qui satisfasse son ego et augmente ses chances de remporter le prix Nobel de la paix. Cela peut se faire par un échange de prisonniers et un cessez-le-feu, tandis que les autres questions restent secondaires à ses yeux. »
Prochaine étape : de probables discussions au Caire
Des discussions devraient très prochainement démarrer au Caire. « Le mouvement confirme sa volonté d’entamer immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs pour discuter des détails », a fait savoir le Hamas. Avec dans un premier temps, la question de la libération des captifs israéliens. Mais Tel-Aviv va certainement s’efforcer de poser le plus rapidement possible la question du désarmement de l’organisation islamique.
Il semblerait que vendredi soir, les opérations militaires israéliennes se soient ralenties et même arrêtées. « Après l’annonce de la nouvelle, les cris de joie ont retenti dans les camps de déplacés. Maintenant, tout le monde est optimiste, tout le monde en parle. Tout le monde dit que ça va enfin finir et que nous allons retourner dans la ville de Gaza », a fait savoir à l’Humanité, la journaliste Maha Hussaini qui se trouve dans l’enclave palestinienne.
Le Hamas dit « oui mais » au plan Trump
Clothilde Mraffko et Ilyes Ramdani sur www.mediapart.fr
Le mouvement islamiste palestinien a fini par accepter le plan de Donald Trump mais demande à négocier en amont de la libération de tous les otages israéliens. Il exige également de continuer à faire partie du paysage politique.
Le président états-unien Donald Trump avait donné « trois ou quatre jours » au Hamas pour répondre à son plan pour Gaza. Le mouvement islamiste, divisé entre sa direction à l’étranger et des commandants dispersés sur le terrain dans l’enclave palestinienne, a semblé mener d’intenses tractations internes dont quasiment rien n’a filtré. Il a fini par donner sa réponse vendredi 3 octobre au soir, via un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram.
Le groupe palestinien s’est dit prêt à libérer tous les otages israéliens, vivants et morts, afin de mettre fin à la guerre génocidaire d’Israël à Gaza et d’assurer le retrait des forces israéliennes.
Le plan Trump, concocté sans les Palestinien·nes et présenté le 29 septembre, propose un cessez-le-feu sans garanties pour le Hamas. Ce dernier est sommé de désarmer et de libérer les otages en une seule fois, sans être assuré que la partie israélienne respectera ses engagements. Israël s’est d’ailleurs empressé de faire savoir qu’il conserverait le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza, y compris en se maintenant sur le terrain.
Le mouvement palestinien a donc mis un bémol à son approbation, évoquant des «négociations par l’intermédiaire des médiateurs afin de discuter des détails de cet accord ».
Cette déclaration a été saluée par Donald Trump. « Sur la base de la déclaration qui vient d’être publiée par le Hamas, je crois qu’ils sont prêts pour une paix durable. Israël doit immédiatement arrêter le bombardement de Gaza, pour qu’on puisse sortir les otages rapidement et en sécurité ! C’est beaucoup trop dangereux actuellement pour le faire. Nous sommes déjà en discussion sur les détails à finaliser. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, il s’agit d’une paix recherchée de longue date au Moyen-Orient », a-t-il affirmé sur son réseau Truth Social.
« Nous avons maintenant la possibilité d’avancer de manière décisive vers la paix », a de son côté indiqué le président français Emmanuel Macron sur X.
Israël a pris acte de la réponse du mouvement palestinien et dit samedi se préparer « pour la mise en œuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages », sans évoquer à ce stade d’autres aspects du plan.
Mais la Défense civile de Gaza a fait état d’un pilonnage israélien « violent » nocturne ayant fait six morts dans le territoire palestinien affamé et assiégé.
« Les troupes israéliennes mènent toujours des opérations à Gaza-ville, et il est extrêmement dangereux d’y retourner. Pour votre sécurité, évitez de retourner dans le nord ou de vous approcher des zones où les troupes sont actives, y compris dans le sud de la bande de Gaza », a déclaré pour sa part Avichay Adraee, un porte-parole de l’armée israélienne.
Le Hamas veut rester dans le jeu politique
La feuille de route israélo-états-unienne inclut une mise sous tutelle de l’enclave palestinienne qui serait régie par des technocrates palestiniens dont on ignore tout, placés sous l’autorité d’un conseil de paix piloté par les États-Unis et dont l’ex-premier ministre britannique Tony Blair serait membre.
Cette « dépossession du territoire et de l’avenir politique pour les Palestiniens est une ligne rouge, car elle touche à l’essence même du Hamas, qui fait partie du mouvement national palestinien pour aboutir à l’autodétermination d’un État palestinien », analyse Sarah Daoud, docteure en science politique associée au Centre de recherches internationales de Sciences Po et en post-doctorat à Sciences Po Grenoble.
Le Hamas s’est dit prêt à confier l’administration de Gaza à un organisme indépendant de technocrates palestiniens, « sur la base du consensus national palestinien et du soutien arabe et islamique » - sans mention donc du tandem Trump/Blair.
Il a en revanche posé une condition qui pourrait compliquer les discussions à venir : les questions qui entourent « l’avenir de la bande de Gaza et les droits légitimes du peuple palestinien » seront traitées « dans le cadre d’un cadre national palestinien global, auquel le Hamas participera et contribuera de manière responsable ». Le mouvement islamiste entend donc rester dans le jeu politique.
Du côté des chancelleries occidentales et arabes, l’éviction du Hamas des plans pour le « jour d’après » à Gaza a fini par faire consensus. À l’ONU, fin juillet, un texte à l’initiative de la présidence franco-saoudienne de la conférence sur la Palestine acte la condamnation du 7-Octobre, l’appel au désarmement du Hamas et à son exclusion de la gouvernance de la bande de Gaza. Des points qui nourrissent à l’époque les réserves de plusieurs pays de la région, dont la Turquie et le Qatar, perçus comme proches du Hamas.
À New York, la France fait passer le message suivant : puisqu’elle, le Royaume-Uni, le Canada et d’autres ont avancé sur la reconnaissance de la Palestine, aux pays arabes de faire un pas vers les positions occidentales. Chacun mesure qu’il sera impossible d’embarquer les États-Unis et Israël sans une condamnation ferme du Hamas. L’Arabie saoudite finit de convaincre les Turcs et Qataris de ratifier le document.
« Chaque mot a fait l’objet d’une négociation serrée, c’était vraiment âpre », raconte un diplomate français qui a participé aux échanges. « C’est une victoire considérable, historique », se félicite à l’époque le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Une étape supplémentaire est franchie le 12 septembre, lorsque l’Assemblée générale approuve la « déclaration de New York » à une large majorité de 142 États. Avec les promesses de réforme de l’Autorité palestinienne, les alinéas concernant le Hamas sont présentés par la France et l’Arabie saoudite comme le point de bascule ayant convaincu Donald Trump. « Ça a ôté tout prétexte à Israël de continuer de refuser le dialogue », affirme le diplomate cité plus haut.
Hamas sous pression
La mise à l’écart du Hamas a été décidée sans négociations de terrain. « Ce parachutage de solutions politiques par le haut, on sait très bien que sur le long terme, ça ne fonctionne pas, remarque Sarah Daoud. Ce n’est pas une solution pacifique. » Josh Paul, un ancien consultant pour la coalition américaine en Irak et conseiller en gouvernance de la sécurité pour les États-Unis en Israël et dans les territoires palestiniens, a mis en garde dans les colonnes du journal britannique The Guardian : le gouvernement imposé par l’extérieur à Gaza est « une greffe incompatible qui sera rejetée par l’organisme, conduisant à un cycle de violence ».
Depuis le 7-Octobre, et encore davantage ces derniers mois, le Hamas apparaît isolé, même parmi ses soutiens à l’étranger – « l’axe de la résistance », piloté par l’Iran, est aujourd’hui largement affaibli. Selon le site d’information états-unien Axios, le premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane al-Thani, le chef des renseignements égyptien, Hassan Rashad, mais aussi turc, Ibrahim Kalin, ont rencontré les dirigeants du Hamas à Doha le 1er octobre pour tenter de les convaincre d’accepter l’accord.
Le plan Trump a d’ailleurs été salué un peu partout – quelques réserves ont fuité dans la presse du côté des médiateurs. Il est bien plus flou que la feuille de route imaginée par la Ligue arabe au début de l’année, en deçà des ambitions françaises de juin sur un véritable processus démocratique en Palestine. Mais dans le vide politique international face à l’expansionnisme israélien dans la région, il est la seule vraie proposition sur la table aujourd’hui.
« Du côté des pays arabes, et notamment du Qatar, il y a une vraie lassitude vis-à-vis des négociations », note Sarah Daoud. Les frappes israéliennes sur Doha le 9 septembre ont renforcé leur détermination à accélérer un règlement. Le jour de la publication de son plan pour Gaza, le président Donald Trump a signé un décret qui s’engage à protéger la sécurité du Qatar, indiquant que « toute attaque armée » contre l’émirat serait considérée par Washington comme « une menace pour la sécurité des États-Unis ».
Le Hamas, combien de divisions ?
L’une des rares concessions du plan – l’amnistie promise sous conditions à certains membres du mouvement islamiste palestinien – paraît difficile à jauger au regard de la longue histoire d’assassinats ciblés menés par Israël à l’étranger, dont celui du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, le 31 juillet 2024 à Téhéran.
Les informations du renseignement français jugent que la poursuite des opérations militaires à Gaza engendre un renouvellement des forces du Hamas dans l’enclave – lequel avait poussé les Israéliens à privilégier une solution politique. Les chancelleries occidentales sont dans le flou quant à l’état actuel des forces du mouvement islamiste.
Le sujet a fait l’objet de plusieurs échanges, dès le printemps 2025, entre Emmanuel Macron et les dirigeants saoudiens, émiratis, égyptiens et qataris. « On estime qu’il reste quelques dizaines de gradés du Hamas, expliquait en mai une source officielle française. Le reste, ce sont des recrues très récentes. On nous dit qu’un officier du Hamas a aujourd’hui 19 ans en moyenne. »
Israël a poursuivi son opération génocidaire et transmis à ses alliés occidentaux des nouvelles censées attester de sa réussite militaire. Au cœur de l’été, des sources diplomatiques faisaient état d’une vingtaine de cadres du Hamas encore présents à Gaza et d’une « destruction quasi totale des capacités militaires ». L’offensive sur la ville de Gaza montre pourtant que « beaucoup moins de combattants du Hamas et du Jihad islamique ont été éliminés que ce qu’on a voulu dire, nuance Sarah Daoud. Les groupes sur place ont essayé de transformer leur stratégie militaire sur le terrain, qui consiste essentiellement aujourd’hui à créer des embuscades. Les hostilités sont loin d’être à l’arrêt ».
Le plan Trump parle d’une démilitarisation « sous la supervision de contrôleurs indépendants », un point qui n’est pas précisé. « La remise des armes pose une vraie question », reconnaît une source officielle citée plus haut, alors que flottait en septembre l’idée d’un dépôt aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, qui les remettraient elles-mêmes à une tierce partie.
Des échos dans la presse israélienne au cours des derniers mois laissaient entendre que certaines voix au sein du Hamas étaient ouvertes à un désarmement partiel et à un exil limité dans le temps de certains cadres. Le mouvement islamiste semble donc prêt à abandonner une partie du terrain militaire, mais pas la souveraineté palestinienne, ligne rouge au coeur de son projet.
mise en ligne le 4 octobre 2025
Grands patrons :
le loup sort du bois
Maryse Dumas sur www.humanite.fr
« Il faut dire les choses comme elles sont, affirme Michel Picon, président de l’organisation patronale U2P (entreprises artisanales et de proximité), au Medef et à l’U2P, on ne défend pas les mêmes intérêts. » Il reproche au Medef de vouloir mener « une lutte des classes à l’envers » et de donner l’impression que le « monde de l’entreprise est opposé à celui du travail ». Non, le président de l’U2P ne participera pas au meeting patronal du 13 octobre annoncé par Patrick Martin, président du Medef, qui n’a même pas pris, dit-il, la peine de le consulter. C’est en quelque sorte « ralliez-vous à mon panache blanc », ajoute-t-il.
Ces propos ne manquent pas de sel. On est certes habitués aux coups de gueule des professions artisanales contre le Medef. Mais ils portent en général davantage sur la représentativité patronale que sur les questions de fond. Malheureusement, ils ne vont qu’exceptionnellement jusqu’à rompre le front patronal face aux organisations syndicales dans les négociations collectives. Mais il y a, cette fois, du neuf dans le propos : c’est la notion de différence, voire de divergence, d’intérêts entre les très petites entreprises où le patron met la main à la pâte et celles où les très grands actionnaires s’enrichissent de plus en plus fortement en exploitant le travail des autres, entreprises sous-traitantes comprises.
Les intérêts de la classe du travail sont fondamentalement opposés à ceux de la classe du capital.
La notion d’intérêts divergents est précisément le cœur de l’analyse, en termes de classe, des contradictions de la société. Ces dernières ne résultent pas d’oppositions entre des « méchants et des gentils », entre des personnes « méritantes » ou d’autres qui ne « sont rien », entre des travailleurs français ou des travailleurs immigrés. Elles tiennent au fait que, selon la place que l’on tient dans la production et dans la propriété ou non du capital, non seulement on n’a pas les mêmes intérêts, mais on a des intérêts qui s’opposent.
Les intérêts de la classe du travail sont fondamentalement opposés à ceux de la classe du capital, et cela quel que soit le degré de conscience que l’on en a. C’est ce lièvre que lève Michel Picon. Il confirme, en creux, la nature de classe des contradictions à l’œuvre au sein de la partie patronale.
Souhaitons que ce début de prise de conscience puisse connaître des prolongements jusqu’à isoler cette oligarchie qui pille les richesses produites, creuse les inégalités et menace l’avenir climatique. À l’évidence, le grand patronat ressent le danger. Habituellement discrets, ses représentants sortent aujourd’hui la grosse artillerie : le président actuel du Medef menace : « On est capables d’être plus radicaux et ce, sur le champ politique s’il le faut » et il fait ses choix : « Attal, Retailleau et Bardella sont les plus conscients des périls économiques. »
Tous les jours on entend ses prédécesseurs, Roux de Bézieux ou Gattaz, mais aussi le PDG de LVMH, Bernard Arnault, entre autres, tirer la sonnette d’alarme, menacer. Pour eux, il y a vraiment le feu au lac. Ils estiment que la faiblesse du gouvernement peut faire la force du mouvement social et de cette exigence qui monte d’une meilleure répartition des richesses et d’une fiscalité plus juste. Ce n’est pas « à l’envers » que ces grands capitalistes mènent la lutte de classes, mais à l’endroit, comme ils l’ont toujours fait. Que le loup se sente obligé aujourd’hui de sortir du bois est une bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui n’ont jamais cru la lutte des classes dépassée. Elle est au contraire plus exacerbée que jamais.
mise en ligne le 3 octobre 2025
Mobilisation du 2 octobre : une troisième manifestation contre un Premier ministre sans gouvernement
ni budget
Naïm Sakhi et Léa Darnay sur www.humanite.fr
Sans budget ni gouvernement, une troisième mobilisation en un mois, la seconde à l’appel de l’intersyndicale, s’est tenue ce 2 octobre. Maintenant la pression, les centrales attendent de pied ferme le discours de politique générale. La CGT annonce jeudi « près de 600 000 » manifestants.
Justice fiscale. Le mot d’ordre revient avec insistance parmi les 140 000 personnes (24 000 selon la préfecture) qui ont défilé, à Paris, au départ de la place d’Italie. « J’en suis à ma deuxième journée de grève depuis la rentrée. Le budget Bayrou est une honte. J’enseigne à des classes de 35 élèves, ce ne sont pas des conditions pour exercer correctement, tance Bartolomé Pidutti, professeur dans le Val-de-Marne. La justice fiscale devient un devoir. »
Ce jeudi 2 octobre, l’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) appelait à une nouvelle journée de grève et de manifestations, après le succès du 18 septembre, qui avait rassemblé 1,1 million de personnes. « L’exécutif a cherché à dégonfler la colère sociale, avant le 10 septembre, avec le départ de Bayrou. C’est loupé. Puis, avec la non-suppression des deux jours fériés, à l’approche du 18. »
Loupé encore, rappelle Sophie Binet la secrétaire générale de la CGT. « Les deux heures de langue de bois de Sébastien Lecornu lors de sa rencontre avec l’intersyndicale, la semaine dernière, se sont soldées par un échec : les organisations syndicales sont encore dans la rue », se réjouit-elle.
Une troisième mobilisation en un mois
Cette troisième journée de grève maintient la pression sur un Premier ministre toujours dépourvu de gouvernement et de budget. Sébastien Lecornu s’est tout juste contenté de quelques fuites bien placées dans la presse. En tête du cortège parisien, Marylise Léon confirme l’agacement des centrales. « Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’égrener un certain nombre de mesures, martèle la secrétaire générale de la CFDT. Qu’est-ce qui sera vraiment dans le budget ? » demande-t-elle.
Pour tenter de diviser le front syndical, Sébastien Lecornu a envoyé une missive aux organisations représentatives, lundi 29 septembre. L’hôte de Matignon entend consulter les syndicats et le patronat sur 5 sujets clés : financement de la Sécurité sociale, souveraineté économique, avenir du paritarisme, du « dialogue social » et du marché du travail.
Pas de quoi convaincre François Hommeril, président de la CFE-CGC : « Ce courrier est symptomatique d’un effondrement de l’exécutif. Dans les deux pages qui nous sont adressées, le premier ministre n’apporte aucune réponse aux attentes des salariés. »
Alors que Matignon a laissé entendre que Sébastien Lecornu pourrait reprendre dans le budget 2026 une mesure issue du conclave revalorisant les retraites des femmes, le représentant des cadres met en garde : « Présenter cette mesure comme une avancée décisive, c’est se moquer du monde, c’est la moins coûteuse du conclave. Or ce dernier devait déboucher sur un compromis durable, matérialisé dans un texte de loi. C’est pour cela que le Medef s’est empressé de le torpiller. »
« Le Smic est le salaire d’entrée dans la vie active, pas un plafond »
La baisse de l’impôt sur le revenu pour les couples rémunérés au Smic, qui avait opportunément fuité avant le départ du cortège parisien, ne rencontre pas un meilleur accueil. « Il faut des hausses de salaires pour reconnaître les compétences des travailleurs. La question n’est pas de payer des impôts, mais combien de temps un salarié reste au Smic avant d’évoluer. Le Smic est le salaire d’entrée dans la vie active, pas un plafond », clame Marylise Léon.
À ses côtés, Sophie Binet met en garde sur une éventuelle réforme du financement de la Sécurité sociale : « Alors qu’elle fête ses 80 ans, vouloir asseoir son financement non pas sur le travail mais sur la fiscalité, c’est ignorer son histoire. La fiscalisation, c’est tendre vers un filet minimum, c’est-à-dire transformer la Sécurité sociale. C’est encore un cadeau pour les patrons. »
« Matignon n’apporte aucune réponse à nos revendications mais veut nous remettre autour de la table. Nous ne comprenons pas la logique », soutient Murielle Guilbert, codéléguée de Solidaires. Tout en restant en contact permanent, les huit centrales attendent désormais le discours de politique générale prévu mardi prochain, pour déterminer les suites de la mobilisation.
Si les cortèges étaient plus clairsemés que le 18 septembre, avec 600 000 manifestants en France selon la CGT, les travailleurs restent mobilisés. À l’image de ceux de la culture, qui occupaient depuis l’aube le palais de Tokyo. « Nous pensons qu’il est important de manifester mais aussi d’occuper les lieux », note Salomé Gadas (CGT spectacle). « Les coupes budgétaires de l’année dernière, au niveau du ministère ou des collectivités territoriales, sont dramatiques, se désole-t-elle. Des personnes déjà précaires ont basculé dans la pauvreté. »
Dans les rangs hospitaliers, la colère est aussi vive. Malika Belarbi, aide-soignante à Boulogne-Billancourt, dénonce le manque d’effectifs et les bas salaires. « Ils ponctionnent dans le budget de la santé alors qu’elle est essentielle ! » s’indigne-t-elle. À ses côtés, Roselyne, infirmière drapée d’une chasuble cégétiste, poursuit : « Quand on s’attaque à la Sécurité sociale, on s’attaque à la santé des citoyens. Qu’ils aillent chercher l’argent chez les 2 % les plus riches, cela ne va pas les tuer. »
Mobilisation dans le médico-social et la santé le 9 octobre
Un avis que partage Romain. « Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les mesures ne vont jamais dans le sens des travailleurs », déplore le jeune cédétiste de 25 ans, salarié dans la cybersécurité. Car, dans le cortège parisien, les inquiétudes dépassent largement la seule fonction publique. Nadia Berghout, représentante syndicale CFDT à la Sécurité sociale, décrit des conditions de travail intenables.
« On est à flux tendu dans le traitement des dossiers. Les logiciels sont obsolètes. Les salaires sont bloqués au Smic sans aucune augmentation collective… » L’agente explique « avoir beaucoup de craintes » concernant une nouvelle réforme sur la Sécurité sociale « qui n’aurait pour seul but que de réaliser plus d’économies ».
Tous s’accordent sur un point. « La mobilisation doit continuer, assure Thomas Baniol, secrétaire départemental de la FSU parisienne. Dans chaque mouvement, il y a des temps forts et des temps faibles. Celle-ci peut repartir de plus bel », affirme-t-il, la journée d’actions du 9 octobre dans le médico-social et la santé en tête.
Grève 2 octobre : en attendant
un nouveau budget,
la mobilisation s’affaiblit
Stéphane Ortega et Guillaume Bernard sur https://rapportsdeforce.fr/
600 000 personnes ont défilé dans près de 250 manifestations pour la journée du grève du 2 octobre, selon l’intersyndicale. Des chiffres en baisse par rapport au 18 septembre. Depuis la précédente journée de mobilisation, deux semaines plus tôt, le pays n’a toujours pas de gouvernement et les éléments du prochain budget ne filtrent qu’au compte goutte.
« On reprend notre souffle », sourit Julien Troccaz, membre du secrétariat fédéral de SUD-Rail. Une boutade pour admettre que la mobilisation de ce 2 octobre est en baisse par rapport à celle du 18 septembre, mais qu’elle pourrait rebondir. « Je n’ai jamais vu une société qui attend aussi impatiemment un budget », assure-t-il. Le cheminot soutient que nombre de ses collègues l’attendent avant de se mobiliser de nouveau. Depuis la démission du Premier ministre François Bayrou, le pays n’a ni gouvernement, ni projet de budget.
Moins de grévistes
Dans ce contexte, les chiffres de grèves sont en recul comparativement à la journée de mobilisation du 18 septembre. Dans les collèges et les lycées, le taux de grévistes passe de 45 % à 27%, selon le SNES-FSU (premier syndicat enseignant). Dans les écoles, la baisse est plus nette : de 30 % à 10 % selon le syndicat majoritaire du premier degré, le Snuipp-FSU. De son côté, le ministère annonce 6,42 % de grévistes dans l’Éducation nationale, même si sa méthode de comptage est contestée.
« La journée est moins forte que le 18 septembre. Ce n’est pas une surprise parce que le 18 était inédit et très fort au regard de la proximité de la rentrée scolaire. Et c’est normal que les taux baissent avec déjà une journée de grève faite par beaucoup d’agents. De plus, le Premier ministre tarde à nommer un gouvernement et les personnels ne voient pas comment les choses se dessinent. Toutefois les remontées du terrain montrent qu’il n’y a pas de décrue de l’adhésion aux revendications », soutient Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU.
Dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, les ministères annoncent respectivement 3,7 % et 2,35 % de grévistes, contre 7,5 % deux semaines plus tôt.
A la SNCF, l’érosion du nombre de grévistes par rapport au 18 septembre est plus mesurée. « Entre 15 % et 20 % ce 2 octobre pour les agents soumis à l’obligation de se déclarer grévistes 48h en amont (20 % à 25 % pour les roulants), selon Julien Troccaz de SUD-Rail. Ce sera probablement un peu moins de 15% tous personnels confondus, cadres compris. »
A titre de comparaison, le 18 septembre, la direction comptabilisait un total de plus de 20 % de grévistes. Et autour de 15 % le 10 septembre, lors de la journée « Bloquons tout », où seuls la CGT et SUD avaient déposé un préavis de grève.
A la RATP, seul le RER B, également administré par la SNCF, a été perturbé. « Les syndicats représentatifs ont sorti leur communiqué d’appel à manifester le 29 septembre au soir. Les gens l’ont lu le 30… c’était tardif sachant qu’il faut se déclarer gréviste deux jours avant. Cela n’a pas aidé à mobiliser. Tant qu’il n’y aura pas revendication sectorielles sur les salaires et les retraites RATP, il sera difficile de faire sortir les collègues », assure François-Xavier Arouls, co-secrétaire de Solidaires RATP, syndicat non représentatif. Pour rappel, le taux de gréviste avoisinait les 95% chez les conducteurs à la RATP le 18 septembre. Enfin, la mobilisation continue chez les énergéticiens de la CGT sont toujours en lutte pour leurs augmentations de salaire et maintiennent la pression sans que des chiffre nationaux de grève ne soient communiqués.
Des manifestations moins fournies mais conséquentes
Les cortèges ont aussi été moins imposants que lors du 18 septembre. A Paris, la préfecture annonce 24 000 manifestants contre 140 000 pour la CGT. A Marseille, plus de 10 000 personnes étaient présentes dans la manifestation selon nos sources, alors que la préfecture annonce 4000 manifestants et la CGT des Bouches-du-Rhône 120 000.
La mobilisation était aussi en baisse à Lyon, où les syndicats annoncent 12 000 manifestants contre 20 000 le 18 septembre. Même tendance à Rennes où les organisateurs évoquent le chiffre de 10 000, à Caen 8000, ou encore 7500 à Nantes selon Ouest France. Même tendance dans les communes de taille plus réduite. A Brest ils étaient plus de 5000 selon les syndicats, 2500 à Tarbes, 1200 à Laval ou encore un millier à Niort.
Les blocages étaient également en reflux. Seul une cinquantaine de lycées ont été perturbés ou bloqués selon le ministère de l’Intérieur, deux fois moins que lors de « Bloquons tout », selon la même source. Peu d’axes routiers ont été visés ce 2 octobre, contrairement au 10 septembre où les forces de police avaient procédé par le force à de nombreux déblocages. Elément notable : après l’arrestation des membres de la Global Sumud Flotilla par l’armée israélienne, de nombreuses manifestations de soutien sont organisées ce soir dans les grandes villes, notamment par des syndicats. La journée de mobilisation n’est donc pas finie.
Et après la grève du 2 octobre ?
L’intersyndicale ne devrait se réunir qu’après le discours de politique générale de Lecornu, la semaine prochaine. Une nouvelle date, sans budget, sans gouvernement et sans un mouvement qui grossit n’étant pas envisageable. Mais le mouvement connaîtra probablement un rebond dans les semaines à venir, une fois connues les mesures du budget. D’ici-là, « on doit labourer le terrain, ne pas se faire happer par séquence parlementaire. On doit être acteur et non spectateur » explique Julien Troccaz de SUD-Rail.
mise en ligne le 3 octobre 2025
Taxe Zucman :
des économistes multiprimés font la leçon aux patrons français
Mathias Thépot sur www.mediapart.fr
Deux économistes à la renommée mondiale se sont invités à l’Assemblée nationale pour soutenir la taxe portée par leur confrère Gabriel Zucman. Ils se sont attelés à démystifier les fantasmes du camp du capital autour de cet impôt qui leur paraît plus que nécessaire.
Il y avait foule rue de Bourgogne à Paris, dans une dépendance de l’Assemblée nationale, où les député·es de la commission des finances ont accueilli mercredi 1er octobre les économistes Jayati Ghosh et Joseph Stiglitz, coprésident·es de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (Icrict).
La première, de nationalité indienne, est multiprimée par ses pairs pour ses travaux sur le développement, les inégalités et la gouvernance mondiale ; le second, états-unien, fut lauréat du prix Nobel d’économie en 2001 pour ses travaux sur le caractère non efficient des marchés et les asymétries d’information.
Tous deux étaient venu·es apporter leur soutien à la proposition d’impôt plancher de 2 % par an sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros en France, portée par leur confrère Gabriel Zucman, également présent dans la salle. Une proposition dont le principal objectif est, rappelons-le, d’empêcher l’optimisation fiscale généralisée chez des ultrariches, qui leur permet de ne payer quasiment aucun impôt sur leurs revenus économiques.
Face à une audience dans son immense majorité composée de député·es de gauche, les trois économistes se sont attelé·es à démystifier les arguments du camp du capital, qui fait feu de tout bois pour abattre ladite taxe. Citons le patron du Medef, Patrick Martin, qui a qualifié la taxe Zucman de « proposition lunaire » contre laquelle il va organiser un grand rassemblement patronal le 13 octobre.
Mais aussi le directeur de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, qui estime que la taxe Zucman est d’obédience « communiste », fruit d’une « histoire de jalousie à la française, une haine du riche ». Et que dire du milliardaire Bernard Arnault, patron du géant du luxe LVMH et directement concerné par la proposition, qui a accusé Gabriel Zucman d’être un « militant d’extrême gauche » qui « met au service de son idéologie (qui vise la destruction de l’économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous) une pseudo-compétence universitaire qui, elle-même, fait largement débat ».
Présent dans la salle ce 1er octobre, le président insoumis de la commission des finances, Éric Coquerel, s’est ému de « la virulence des propos venant de personnes directement concernées par la taxe, de leurs représentants, ou dans les médias qu’ils détiennent » : « Cela me rappelle un peu quand en 1981, on nous expliquait que les chars soviétiques seraient sur les Champs-Élysées si François Mitterrand était élu. »
Pas une proposition radicale
L’économiste Joseph Stiglitz – qui ne peut raisonnablement pas être qualifié d’économiste d’extrême gauche – a également fait part de son étonnement face à un tel dénigrement de la taxe Zucman en France : « C’est une proposition simple qui ne vise qu’à s’assurer que les super-riches paient leur juste part. »
Il a rappelé que taxer à hauteur de seulement 2 % par an le patrimoine des milliardaires, dont les rendements annuels oscillent plutôt entre 6 % et les 10 %, « est en fait une approche très prudente. C’est très étrange qu’elle soit décrite comme si radicale ! ».
« Il faut le dire : avec une telle taxe, les ultrariches resteront très riches à la fin de l’année, ils ne vont pas d’un coup devenir pauvres... », a abondé Jayati Ghosh, qui s’inquiète du « dénigrement des évidences scientifiques qui a cours » dans le capitalisme français. « Nous assistons à une évolution similaire en Inde. Et l’on voit aussi cela aux États-Unis de Donald Trump, c’est très dangereux », a-t-elle déploré.
Par ailleurs, a ajouté Joseph Stiglitz, « en matière d’efficacité économique, il n’a été donné aucun argument permettant de justifier d’une qualité spécifique de cette catégorie de la population [les ultrariches – ndlr] qui justifierait qu’elle paie en proportion moins d’impôts que le reste ».
S’est ensuivie une déconstruction méthodique des arguments du camp du capital contre le principe d’un impôt plancher sur le patrimoine des milliardaires.
Aux critiques qui disent que les contribuables concerné·es ne pourraient pas s’en acquitter, faute de liquidité disponible, Joseph Stiglitz a répondu : « Il n’y a aucune preuve pour appuyer cette idée. Si vous avez des centaines de millions ou même des milliards à votre disposition, vous pouvez tout à fait convertir une partie de cette richesse en liquidité et payer 2 % d’impôts. »
À d’autres critiques, encore plus catastrophistes, qui stipulent qu’un tel niveau d’imposition des ultrariches ruinerait l’économie française, les deux économistes répondent le contraire. En effet, nous disent Jayati Ghosh et Joseph Stiglitz, c’est paradoxalement à cause de la soustraction à l’impôt des ultrariches que les moyens viennent à manquer pour soutenir l’économie.
Aller chercher l’argent là où il est
L’optimisation fiscale mondialisée assèche en effet les finances publiques, et les gouvernements ont de moins en moins de moyens « pour investir dans l’éducation, les infrastructures, la santé ou l’innovation ». Or ces investissements publics, robustes naguère, ont été « un des principaux moteurs de la croissance économique » de l’après-Seconde Guerre mondiale. « Il faut rappeler que l’avantage compétitif des États-Unis vis-à-vis du reste du monde vient, à la base, des investissements publics dans les sciences et les technologies », a martelé Joseph Stiglitz.
Selon l’économiste, il y a là une « forme de contradiction » chez les milliardaires qui se prétendent être les premiers promoteurs de la croissance économique, alors qu’ils en obèrent par ailleurs l’un des principaux leviers en se soustrayant à l’impôt.
Par ailleurs, les investissements publics dont ont bénéficié ces grands capitalistes ont généré « des déficits publics importants ». Dès lors, il paraît normal « d’aller chercher l’argent là où il est aujourd’hui », c’est-à-dire dans les poches des ultrariches, a ajouté Joseph Stiglitz.
Un autre argument régulièrement cité contre la taxe Zucman est qu’elle nuirait à l’esprit d’entreprendre et à l’innovation. De quoi faire bondir Jayati Ghosh. Pour elle, cela dénote une « grande incompréhension sur la nature du capitalisme ». Elle a rappelé que l’innovation dans le secteur privé « vient principalement des très petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas touchées par cette taxe. On peut même dire qu’elles sont les perdantes du système fiscal actuel ».
À l’inverse, les tenants du grand capital, qui seraient effectivement concernés par l’impôt Zucman, « n’ont pas fait leur fortune sur l’innovation ». Et l’économiste de citer l’exemple de Bernard Arnault : « Si sa fortune a augmenté, c’est plutôt parce qu’il a multiplié les acquisitions partout dans le monde. »
In fine, a-t-elle résumé, « le grand capital use de sa position dominante sur le marché pour capturer le pouvoir politique, racheter des entreprises, de la propriété intellectuelle, des brevets, etc., et ainsi extraire toujours plus de rente. C’est de là que viennent les profits du grand capital, pas de sa capacité à innover ».
Pas de grand exode à prévoir
Autre critique anti-taxe Zucman : la fuite des riches qui en découlerait. Agacé par ce qu’il estime être un sophisme, Gabriel Zucman a rappelé lors de la conférence du 1er octobre que « l’exil fiscal n’était pas une loi de la nature : c’est un choix de politique publique. On peut le tolérer, l’encourager, ou le limiter ». Il propose d’ailleurs de coupler sa proposition à une « exit tax » qui s’appliquerait pendant cinq ans aux riches contribuables qui souhaiteraient échapper à son impôt en s’exilant à l’étranger.
Allant dans son sens, Jayati Ghosh a, du reste, coupé court aux fantasmes de grand exode fiscal : « Il existe des petites économies – bien moins puissantes que la France – qui imposent déjà une taxe sur les patrimoines des ultrariches. Prenons l’exemple de la Colombie, qui l’a fait récemment [fin 2022 – ndlr]. Cela n’a créé ni grande catastrophe économique, ni exode massif. Mieux : le produit de cette taxe permet désormais de financer des investissements dans les infrastructures. » Jayati Ghosh a aussi cité l’Espagne, qui a instauré un impôt sur la fortune en 2022 « où l’on ne voit pas non plus de déflagration, ni de fuite des richesses ».
Même son de cloche du côté de Joseph Stiglitz, qui s’est lancé dans une analyse comportementale des milliardaires : « Ce qui guide les super-riches, ce n’est pas le taux d’imposition dont ils s’acquittent, mais de pouvoir être toujours plus riches : gagner au Monopoly, en somme. Ils aiment avoir cette domination sur le marché, sur leurs concurrents. C’est ce qui leur donne envie d’avancer et je ne crois pas que cette attitude changera avec une plus forte imposition. » Il ajoutait : « Je connais de nombreux milliardaires et la plupart d’entre eux travailleraient aussi dur et seraient aussi ambitieux si on les imposait plus. »
Reste enfin l’idée que si la France était le seul pays à appliquer une telle taxe sur les hauts patrimoines, elle serait le dindon de la farce, perdant toutes ses richesses. Là encore, les deux économistes ont retourné l’argument : « Je ne pense pas que la France doive attendre que les autres pays se mettent en ligne avec elle. Au contraire, cela aurait l’effet de leadership qui entraînerait les autres », a répondu Joseph Stiglitz.
Par ailleurs, précisait Jayati Ghosh, « pour pousser sa taxe, la France pourrait s’appuyer sur les négociations en cours à l’Organisation des Nations unies (ONU) pour un impôt minimum mondial sur les hauts patrimoines ». Le sujet est dans l’air du temps.
Les macronistes ont déserté
Durant cette conférence, qui a parfois pris des allures de cours magistral, les député·es du bloc central, de la droite et de l’extrême droite avaient hélas quasi toutes et tous déserté. La seule voix discordante qui s’est exprimée a été celle du rapporteur Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) de la commission des finances, Charles de Courson, qui estime que « la taxe Zucman est une mauvaise réponse à un vrai problème ».
Le « vrai problème » dont il parle est celui de l’optimisation fiscale des ultrariches, qui s’est renforcée depuis la surpression de l’impôt de solidarité sur la fortune par Emmanuel Macron en 2018. Mais pour Charles de Courson, la taxe Zucman risquerait de toucher certains hauts patrimoines, « dont les rendements sont inférieurs à 2 % », ce qui risquerait de rendre la taxe confiscatoire pour certain·es, et donc de s’attirer la censure du Conseil constitutionnel.
Lui propose plutôt de s’attaquer, quasiment un par un, aux dispositifs d’optimisation fiscale utilisés par les ultrariches pour échapper à l’impôt en France. Il propose notamment de taxer à hauteur de 15 % les milliards de dividendes accumulés et non distribués qui dorment dans les holdings familiales.
Mais aussi de revoir le pacte Dutreil qui est, à la base, un dispositif fiscal censé faciliter les transmissions de petites et moyennes entreprises familiales, mais qui est aujourd’hui largement utilisé par les centimillionaires et milliardaires pour échapper à l’impôt.
La niche fiscale dite « d’apport-cession », qui permet de renvoyer aux calendes grecques l’imposition sur les plus-values des titres de sociétés apportés à des holdings, est également dans le viseur de Charles de Courson. Et plus globalement la fiscalité sur les héritages des ultrariches.
Certes techniques, toutes ces contrepropositions du rapporteur de la commission des finances ont le mérite de poser un débat démocratique de bon niveau. Bien loin des arguments trompeurs du camp du capital qui nie tout problème d’égalité face à l’impôt en France.
mise en ligne le 2 octobre 2025
Grève du 2 octobre : l’arrêté de tri des manifestants jugé illégal,
le préfet prétendait lutter contre l’extrême droite
Jules Panetier sur https://lepoing.net/
Pour réprimer la troisième journée de mobilisation du mouvement « On bloque tout », ce 2 octobre, le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, avait publié la veille un arrêté interdisant « la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants ». L’arrêté, discriminatoire, a été suspendu par la justice.
L’arrêté, qui prévoyait également la captation d’images par drones et l’interdiction d’accès à l’Écusson, a en effet été jugé illégal, à la suite d’une saisine en référé du tribunal administratif de Montpellier par la Ligue des droits de l’Homme. Sa porte-parole locale, Sophie Mazas, a insisté, lors de l’audience qui s’est tenue ce 2 octobre au matin, sur le fait qu’aucune jurisprudence ne permettait un tel tri des manifestants. Une argumentation complétée par le Syndicat des avocats de France, notamment sur l’absence de toute base légale pour interdire spécifiquement l’accès au centre-ville.
De son côté, le directeur de cabinet du préfet a justifié la mesure par la nécessité de lutter… contre l’extrême droite ! L’argument est pour le moins cocasse, alors qu’un groupe identitaire a pu tranquillement agresser des manifestants le 18 septembre, sous les yeux de la police. L’agent de l’État a aussi prétendu que l’arrêté était le fruit de discussions avec les syndicats, ce qui a provoqué la désapprobation des syndicalistes de Solidaires présents dans la salle d’audience.
mise en ligne le 2 octobre 2025
La quasi-totalité des bateaux de la flottille pour Gaza interceptés
Caroline Coq-Chodorge et Agence France-Presse sur www.mediapart.fr
Quarante des quarante-quatre navires ont été interceptés par la marine israélienne ou semblent en passe de l’être, selon le système de surveillance de la flottille pour Gaza, alors que les organisateurs ont déclaré avoir perdu le contact avec plusieurs bateaux.
Au crépuscule, mercredi 1er octobre, les membres de la flottille Global Sumud pour Gaza ont vu se dessiner au large les silhouettes d’une vingtaine de navires. Leurs quarante-quatre bateaux, partis depuis plusieurs semaines en Méditerranée pour briser le blocus de l’enclave palestinienne, se sont retrouvés au contact des forces navales israéliennes autour de 20 heures (heure française).
« Plusieurs navires de la flottille […] ont déjà été arrêtés en toute sécurité et leurs passagers sont en cours de transfert vers un port israélien », a confirmé le ministère des affaires étrangères israélien sur le réseau social X. Jeudi matin, il a annoncé qu’il expulserait vers l’Europe tous les militants et militantes qui se trouvaient à bord des navires. « Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d’expulsion vers l’Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé », a déclaré le ministère sur X.
Le ministre démissionnaire des affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a appelé mercredi « les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais ».
Jeudi midi, quarante navires avaient été interceptés par la marine israélienne ou semblaient en passe de l’être, selon le système de surveillance de la flottille pour Gaza, alors que les organisateurs ont déclaré avoir perdu le contact avec plusieurs bateaux.
Parmi les quatre bateaux non interceptés, deux d’entre eux semblent faire route vers le nord en direction de Chypre, selon le tracker, et un autre se trouve toujours au large des côtes égyptiennes. Reste le navire Mikeno : la dernière mise à jour, à 8 h 21, du système de surveillance indiquait qu’il se situait à une dizaine de kilomètres des côtes de la bande de Gaza.
Les membres de la flottille, au nombre d’une centaine, ont suivi les instructions qu’ils répétaient jour après jour depuis un mois. Pour ne laisser aucune trace de leurs échanges à l’armée israélienne, ils ont jeté à l’eau leurs téléphones portables. Pour ne donner aucune justification à la violence, ils ont aussi jeté leurs couteaux, leurs scies, tout ce qui pourrait ressembler à une arme. Et ils ont enfilé un gilet de sauvetage. Quand les militaires israéliens sont montés sur leurs navires, ils n’ont montré aucune résistance ou opposition. Ils ont baissé les yeux pour ne pas rencontrer ceux des soldats.
Les communications étant coupées, les informations sur la suite des événements sont parcellaires. L’armée israélienne s’est adressée à la flottille, informant que ses passagers et passagères étaient entré·es « dans une zone militaire active », leur proposant de rejoindre le port israélien d’Ashdod et les menaçant de confisquer leurs bateaux. En réponse, des membres de la flottille ont répliqué qu’ils entraient dans une « zone où sont commis des crimes de guerre » pour y acheminer de l’aide humanitaire.
À 21 h 30, un communiqué de la flottille Global Sumud, organisatrice de l’action humanitaire, indiquait que des militaires israéliens étaient montés sur au moins leurs trois principaux bateaux : l’Alma, le Sirius et l’Adara. « Outre les bateaux dont l’interception est confirmée, la retransmission en direct et les communications avec plusieurs autres bateaux ont été perdues », ont dénoncé les organisateurs.
À 22 heures, Réva Seifert Viard, le skipper du Mia Mia, a précisé l’information à Mediapart : « Les Israéliens sont sur cinq ou six bateaux, les plus importants. De notre côté, nous continuons notre route vers Gaza. »
La flottille Global Sumud a dit travailler « sans relâche pour retrouver tous les participants et membres d’équipage ». Il s’agit « d’une attaque illégale contre des humanitaires non armés », a déclaré l’organisation, appelant « les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales à exiger la sécurité et la libération de toutes les personnes à bord ». Elle a assuré sur X à 2 h 20, jeudi, que « 30 bateaux continuent leur route vers Gaza, et se trouvent à 46 milles nautiques [85 kilomètres – ndlr] malgré les agressions incessantes » de la marine israélienne. « Ils sont déterminés. Ils sont motivés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour briser le blocus tôt ce matin », a assuré Saif Abukeshek, porte-parole de la flottille.
Deuxième tentative
Mercredi en fin d’après-midi, sur le Captain Nikos, l’eurodéputée La France insoumise (LFI) Rima Hassan racontait les manœuvres israéliennes au cours de la nuit qui avait précédé : « Ils ont fait quelques tentatives d’intimidation. Une vingtaine de drones nous ont survolés. Ils ont coupé les communications sur deux ou trois bateaux. »
C’est la seconde fois que l’élue participe à une flottille afin de briser le blocus qui entoure Gaza, imposé par les Israéliens. En juin, elle a été arrêtée et emprisonnée pendant trois jours en Israël. Mercredi après-midi, elle disait craindre une « interpellation plus violente » : « Le gouvernement a militarisé sa communication, insisté sur nos soi-disant liens avec le Hamas, préparé son opinion à une attaque. Ils ont aussi promis un “traitement spécial” pour les récidivistes. Est-ce que ce sera l’isolement, une prison de haute sécurité ? », s’interrogeait-elle.
J’actualise la mémoire de ma tante, elle serait sur cette flottille. Isaline Choury Amalric, nièce de la résistante communiste Danielle Casanova
Quelques heures avant l’interception israélienne, elle insistait surtout sur « la solidarité au sein de la flottille, qui permet de dépasser cette peur » : « Il y a des députés, l’ancienne maire de Barcelone, des médecins humanitaires, des marins, des activistes pour le climat, de quarante-six nationalités. Toutes sortes de gens ont rejoint la cause de la Palestine, par différents canaux. Plein de choses pourraient nous séparer : notre classe sociale, notre culture, notre religion. La composition des bateaux est aléatoire, mais on fait tous à manger, le ménage, la lessive pour les autres. On fait famille. »
« Être au milieu de tous ces bateaux, c’est porteur d’espérance », disait, avant l’interception israélienne, Réva Seifert Viard, le skipper du Mia Mia. Lui aussi était déjà sur le Madleen en juin, aux côtés de Rima Hassan et de l’activiste suédoise Greta Thunberg. Il est reparti pour la même raison : « Briser le blocus de Gaza, créer un couloir humanitaire, et livrer de l’aide pour redonner un peu d’humanité à Gaza. »
Le skipper a confirmé que la flottille s’est préparée au pire : « Des bateaux, des drones, des hélicoptères, des filets qui nous entravent. Mais on espère surtout que la mobilisation citoyenne poussera Israël à se ranger du côté de la raison, de la dignité. S’ils nous attaquent, vu le nombre de gens sur ces bateaux, de toutes nationalités, cela enflammera l’opinion », pensait-il.
À deux ou trois jours de mer naviguent dix autres bateaux de la Global Sumud. Sur le Conscience, un grand navire qui transporte une centaine de personnes, se trouve Isaline Choury Amalric. L’activiste de 82 ans est la nièce de Danielle Casanova, héroïne de la résistance communiste. « J’actualise la mémoire de ma tante, elle serait sur cette flottille. »
Elle raconte une vie d’engagement « contre l’antisémitisme, le colonialisme » : « J’ai réalisé que ce n’était pas fini. L’Europe soutient Israël, et le principe de la suprématie des Blancs sur les Arabes. Si on perd Gaza, on perd aussi le droit international, la démocratie. Et que personne ne me traite d’antisémite. C’est Nétanyahou qui fait monter l’antisémitisme. »
Jean-Noël Barrot « fait honte à notre pays », estime Jean-Luc Mélenchon
L’Italie et l’Espagne avaient dépêché des navires militaires pour escorter la flottille après des « attaques par drones » dans la nuit du 23 au 24 septembre, dénoncées par l’ONU et l’Union européenne, similaires à deux attaques attribuées à Israël par la flottille quand elle était ancrée le 9 septembre près de Tunis.
Mais mercredi, le gouvernement espagnol a demandé à Global Sumud « de ne pas entrer dans les eaux désignées comme zone d’exclusion par Israël » et souligné que le navire espagnol ne franchirait pas cette limite. La veille, la flottille avait dénoncé une décision de l’Italie de stopper, à la limite de la zone « critique » des 150 milles nautiques, la frégate chargée de l’accompagner, afin « de dissuader et miner une mission humanitaire pacifique ».
Alors que des manifestations ont éclaté mercredi soir dans plusieurs grandes villes du sud de l’Europe, comme Barcelone, Milan, Naples ou Rome, une grève générale a été décrétée en Italie par les syndicats autonomes et les grandes centrales pour vendredi 3 octobre.
Après l’arraisonnement de la flottille, Jean-Luc Mélenchon s’en est pris au chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot. « Les parlementaires français et les personnes embarquées pour briser le blocus de Gaza sont enlevés dans les eaux internationales par les milices de Nétanyahou. Le ministre français Barrot se comporte comme le nul qu’il est en donnant raison à Nétanyahou. Il fait honte à notre pays », a écrit sur X le leader de LFI, mouvement qui compte plusieurs représentant·es à bord des bateaux.
Depuis le départ de la flottille, Emmanuel Macron n’en a pas dit un mot.
Le ministère des affaires étrangères turc a accusé Israël de commettre « un acte de terrorisme ». « L’attaque des forces israéliennes dans les eaux internationales contre la flottille Global Sumud, qui était en route pour livrer de l’aide humanitaire à la population de Gaza, est un acte de terrorisme qui constitue la violation la plus grave du droit international et met en danger la vie de civils innocents », a dénoncé le ministère dans un communiqué.
Le Hamas a lui aussi condamné l’interception. « Nous condamnons dans les termes les plus forts l’agression barbare lancée par l’ennemi contre la flottille Sumud et affirmons que l’interception de la flottille est un acte criminel qui doit être condamné par tous les peuples libres du monde », peut-on lire dans un communiqué publié jeudi par le mouvement islamiste palestinien, qui appelle à des actions de protestation partout dans le monde.
Le président colombien Gustavo Petro a annoncé l’expulsion de la délégation diplomatique israélienne dans son pays en réaction. Le Brésil « déplore l’action militaire du gouvernement israélien, qui viole les droits et met en danger l’intégrité physique de manifestants pacifiques », a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué. « La responsabilité de la sécurité des personnes détenues incombe désormais à Israël », précise le texte.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié l’interception de « grave offense » envers « la solidarité et [le] sentiment mondial qui visent à soulager les souffrances à Gaza ». « L’interception de la flottille dans les eaux internationales est contraire au droit international », dénonce-t-il dans un communiqué publié sur X. « Cette action viole également une injonction de la Cour internationale de justice selon laquelle l’aide humanitaire doit pouvoir circuler sans entrave », ajoute-t-il. Le dirigeant sud-africain appelle Israël à « libérer immédiatement » les Sud-Africains enlevés dans les eaux internationales, y compris Mandla Mandela, petit-fils de Nelson Mandela.
mise enligne le 1er octobre 2025
Grève du 2 octobre : le préfet de l’Hérault veut décider de qui a le droit de manifester
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Dans un arrêté préfectoral paru ce mercredi 1er octobre, le préfet de l’Hérault annonce interdire au sein du cortège “la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants”. Une grave attaque sur la liberté de manifester
Alors qu’une manifestation intersyndicale contre l’austérité est prévue ce jeudi 2 octobre à partir de 10 h 30 au départ d’Albert 1er à Montpellier, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault a décidé de trier les “bons” des “mauvais” manifestants. Un arrêté paru ce mercredi 1er octobre prévoit, outre la captation d’images par aéronef et l’interdiction de l’Écusson, une nouvelle disposition inédite et pour le moins hallucinante : “La présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants, est interdite au sein du cortège.”
Le préfet justifie cette mesure liberticide en évoquant la manifestation sauvage du 10 septembre, la présence de “militants au profil black bloc” qui ont pris la tête du cortège le 18 septembre, ou les agressions d’extrême droite qui ont eu lieu la même journée. Pour Sophie Mazas, avocate Montpelliéraine spécialiste des libertés fondamentales, cette décision “ne s’appuie sur aucun fondement légal. En aucun cas l’autorité administrative ne peut décider de qui a le droit de manifester, mis à part les interdictions judiciaires.”
Elle dénonce une “attaque très grave à la liberté de manifester” et soulève une question pragmatique : “Est-ce que la police va contrôler tout le monde pour vérifier qui est adhérent ou sympathisant d’un syndicat ? Et comment le prouver, en montrant une carte d’adhérent ? Cela serait illégal car ça pourrait entraîner un fichage, il y a une large part d’arbitraire dans cette décision.” Et l’avocate, par ailleurs membre de la Ligue des Droits de l’Homme, d’ajouter avec ironie : “Cela veut dire que la LDH, qui n’est pas membre de l’intersyndicale, ne peut pas venir à la manifestation ?” Un référé devrait être déposé au tribunal administratif pour contester l’arrêté, qui marque selon elle “une stratégie politique de division au sein du mouvement entre syndiqués et non-syndiqués.”
mise en ligne le 1er octobre 2025
« Le plan présenté
par Trump est miné » :
le décryptage de Mustafa Barghouti, leader de l'Initiative nationale palestinienne
Pierre Barbancey sur www.humanite.fr
Mustafa Barghouti, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, se réjouit d’un possible arrêt de la guerre génocidaire menée à Gaza, mais exprime ses craintes après les déclarations de Benyamin Netanyahou.
Pour le leader de l’Initiative nationale palestinienne et membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), candidat à l’élection présidentielle de 2005 face à Mahmoud Abbas ayant recueilli 20 % des suffrages, Mustafa Barghouti, le plan en 20 points, s’il peut conduire à mettre un terme au génocide, écarte les Palestiniens de la conduite de leurs propres affaires.
Ce plan présenté par Donald Trump avec, à ses côtés, Benyamin Netanyahou, va-t-il réellement apporter la paix ?
Mustafa Barghouti : Je dois dire ma déception concernant deux points fondamentaux. Tout d’abord le parti pris total du président états-unien pour la partie israélienne. Il n’a même pas prononcé les mots « en finir avec l’occupation ». Il a même assuré qu’il comprenait le rejet par Netanyahou d’un État palestinien.
De quelle paix parlons-nous si l’idée même de la fin de l’occupation n’est pas mentionnée ? Mais, évidemment, tout le monde veut mettre fin à cette guerre génocidaire. Si Israël est forcé d’arrêter la guerre, il s’agit bien sûr d’une chose positive.
De même, l’objectif israélien de nettoyage ethnique total de la bande de Gaza n’a pas été atteint, même si le territoire est totalement détruit. Ce plan présenté par Trump est en fait rempli de mines qui pourraient mettre en danger sa mise en œuvre même. Il ignore les Palestiniens et les causes du conflit : l’occupation et l’apartheid.
La plus grosse interrogation réside dans ce que qu’on peut attendre de l’attitude d’Israël une fois qu’il aura récupéré ses prisonniers ou, comme ils sont appelés, ses otages. Est-ce que Netanyahou va reprendre la guerre ? Quelles sont les garanties qu’il ne s’engagera pas dans cette voie ?
Les déclarations de Netanyahou ne vous apparaissent-elles pas rassurantes ?
Mustafa Barghouti : Lors de la présentation du plan, le premier ministre israélien a déclaré deux choses. La première est que le retrait de ses troupes, tel qu’il est prévu, se fera lentement. Nous avons également vu cette carte mentionnant un retrait graduel, ce qui est particulièrement dangereux parce que maintenir des soldats dans la bande de Gaza n’est rien d’autre que maintenir les causes d’une explosion. Le deuxième argument préoccupant développé par Netanyahou réside dans ce droit qu’il se donne de reprendre la guerre pour n’importe quelle raison.
Nous savons que les Israéliens excellent dans cet exercice, celui d’inventer des causes pour pouvoir faire ce qu’ils veulent (la trêve conclue en janvier sous l’égide des États-Unis a été rompue unilatéralement quelques semaines plus tard par Benyamin Netanyahou – NDLR).
Tout cela ne rend pas tellement optimiste. D’autant qu’il faut ajouter un troisième point : les Palestiniens sont totalement écartés, la représentation officielle palestinienne est exclue. Ce plan prévoit ce qu’ils appellent un « conseil d’administration international » pour gérer Gaza. Quelle loi leur permet de venir et de nous prendre en main, nous Palestiniens, plutôt que de respecter notre droit à nous gérer nous-mêmes ?
Le Hamas peut-il accepter ce plan ?
Mustafa Barghouti : C’est une décision très difficile à prendre. Est-ce que le Hamas et les autres groupes palestiniens réalisent l’importance de mettre fin à cette guerre génocidaire ? Chaque jour, près de cent personnes sont tuées.
Israël détruit maintenant la cité historique de Gaza. Et il y a cet élément important qu’il est possible d’empêcher le nettoyage ethnique de Gaza. Mais, comme je vous l’ai dit, il y existe beaucoup de mines à l’intérieur de ce plan.
De quoi Donald Trump parle-t-il lorsqu’il évoque des réformes de l’Autorité palestinienne ?
Mustafa Barghouti : Ce n’est absolument pas clair. S’agit-il de réelles réformes démocratiques, de l’organisation d’élections présidentielle et législatives, ou s’agit-il de faire de l’Autorité palestinienne un simple sous-agent pour la sécurité d’Israël ?
Le nom de Tony Blair a été évoqué pour faire partie de ce Conseil d’administration international. Qu’en pensez-vous ?
Mustafa Barghouti : C’est l’idée la plus terrible. La pire menace est l’imposition d’une domination étrangère aux Palestiniens de Gaza, qui séparerait la bande de Gaza de la Cisjordanie et saperait tout potentiel d’un État palestinien indépendant. Tony Blair n’a rien à faire dans l’administration de Gaza.
Nous nous sommes déjà trouvés sous la domination coloniale britannique auparavant (durant la période dite de la Palestine mandataire de 1920 à 1948 – NDLR). Nous nous sommes battus pendant des décennies pour nous débarrasser de ce colonialisme. Puis il y a eu l’occupation israélienne. Il est inacceptable qu’une personnalité étrangère gère Gaza, surtout avec la réputation que traîne Tony Blair (premier ministre britannique lors de l’invasion de l’Irak en 2003 – NDLR).