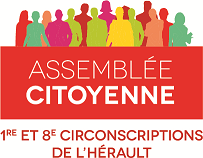septembre 2025
mise en ligne le 30 septembre 2025
Dans l’agriculture,
la traite des êtres humains bat son plein
Simon Guichard et Hélène Servel sur www.humanite.fr
Durant cinq mois, Mohammed, travailleur marocain, a été victime de traite dans les champs du sud de la France. Il témoigne pour la première fois auprès de l’Humanité. Pour les centaines de petites mains comme lui, l’État français a toutes les peines du monde à faire respecter la loi et protéger ces travailleurs saisonniers indispensables à l’agriculture française.
Son calvaire a duré cinq mois. Mohammed en parle avec un mélange de tristesse et de rage : « Ils nous traitaient comme des chiens. » Entre avril et août 2023, il a travaillé dans une exploitation fruitière du sud de la France, sept jours sur sept, entre douze et quatorze heures et surveillé en permanence par les sbires de son patron.
Tout a commencé pour lui au Maroc. Approché quelques mois plus tôt par des intermédiaires qui lui avaient promis un contrat de trois ans et un salaire de 3 000 euros par mois, ce travailleur de 34 ans au chômage a payé plus de 13 000 euros à ses futurs exploiteurs pour obtenir ce contrat et les papiers nécessaires pour traverser la Méditerranée.
« On m’a promis dix fois plus que ce que je touchais au Maroc, je me suis endetté auprès de mes proches, mais je me disais qu’avec un tel salaire ce serait vite remboursé. » Autorisation de travail dûment frappée du sceau de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) et billet d’avion en poche, Mohammed débarque dans l’Hexagone.
Voyage au bout de l’enfer
À son arrivée, il déchante. On lui avait promis une chambre dans une colocation avec quatre personnes, il se retrouve avec 13 compagnons d’infortune dans une maison insalubre de 50 m², infestée de punaises de lit, le tout pour un loyer de 150 euros par mois.
Mais c’est dans les vergers que le supplice prend toute son ampleur. La chaleur est écrasante. L’eau manque. À la cueillette des fruits s’ajoute l’arrachage des mauvaises herbes, à genou durant des heures. Sans compter es pesticides épandus par les travailleurs sans aucun équipement de protection.
Le tout rythmé par les insultes et les cris des contremaîtres. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Mohammed doit même régler 60 euros par mois pour le transport jusqu’aux champs. Certains week-ends, les Marocains sont aussi réquisitionnés pour effectuer des travaux d’aménagement dans la demeure de leur patron.
Quand ils osent protester, la violence se déchaîne. Et pour tous, la même menace : le non-renouvellement du contrat, et le risque de se retrouver à la rue, sans papiers. En cinq mois, Mohammed a gagné un peu plus de 9 000 euros pour ses journées de travail. Moins de 7 euros de l’heure. Pas assez pour rembourser ses dettes.
À bout, il se résout à dénoncer ce système qui l’a broyé. Il alerte d’abord l’OFII, qui l’oriente vers l’inspection du travail. Face à son témoignage, le fonctionnaire le renvoie vers la gendarmerie du coin, pour porter plainte pour traite des êtres humains.
Les menaces de mort ne tardent pas à arriver : « J’ai reçu un message vocal où deux hommes me disaient qu’ils allaient me tuer. Puis, l’un des contremaîtres a dit aux collègues de travail qu’il allait payer un tueur à gages pour s’occuper de moi. Ma mère aussi a été menacée au Maroc, car ils connaissaient mon adresse. » Terrifié, il monte dans le premier train direction Paris.
Dans la capitale, Mohammed entre en contact avec le CCEM. Cette association fondée en 1994 est devenue au fil des ans la référence dans la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. Depuis, c’est elle qui le loge dans son appartement d’urgence, et l’aide dans ses démarches pour faire reconnaître son statut de victime.
« La traite des êtres humains, c’est à la fois une action, un moyen et un but », décrypte Béatrice Mésini, chargée de recherche au CNRS et membre du Collectif de défense des travailleur·euses étranger·ères dans l’agriculture (Codetras), qui lutte depuis vingt ans pour aider les étrangers exploités dans les champs du sud de la France. « Même si la traite est mieux reconnue aujourd’hui, elle n’est pas systématiquement qualifiée comme telle par la justice, et obtenir réparation relève du parcours du combattant. »
Mohammed n’échappe pas à cette galère. Lorsqu’il a porté plainte pour traite la première fois, il n’a pas reçu de titre de séjour. C’est pourtant un droit accordé aux étrangers dans le cadre des affaires de traite, le temps de la procédure judiciaire.
« Souvent, les gendarmes qui instruisent les affaires ont tendance à écarter la qualification de traite des êtres humains, éclaire un inspecteur du travail sous couvert d’anonymat. Ils vont parfois requalifier et minimiser les infractions pour boucler les affaires plus vite. Ça peut aussi être une manière d’empêcher les victimes d’avoir un titre de séjour. »
La plupart de ces travailleurs étrangers connaissent mal leurs droits et ignorent souvent tout du système judiciaire français. Sans le soutien de rares inspecteurs du travail, de syndicats, d’associations et de militants qui se battent au long cours à leur côté, la quête de justice est impossible, ou presque.
C’est quoi la traite d’êtres humains ?
Aussi appelée communément “esclavage moderne”, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail correspond à une infraction pénale depuis 2003.
Pour être caractérisée, elle doit rassembler trois éléments :
L’action : le recrutement ; le transport ; le transfert ; l’hébergement ou l’accueil de la victime.
Le moyen : menaces ; contrainte ; violence ou menaces de violence ; tromperie ; le lien d’ascendance légitime (naturel ou adoptif) ; abus de la vulnérabilité connue de l’auteur (minorité, maladie, grossesse, handicap) ; échange ou octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou avantage.
Le but : agression ou atteintes sexuelles ; proxénétisme ; prélèvement d’organe ; contrainte à commettre tout crime ou délit ; exploitation de la mendicité ; soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et/ou d’hébergement indignes ; soumission à du travail ou à des services forcés ; réduction en servitude ; réduction en esclavage.
En gras, ces buts relèvent de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation « par le travail », par degré de gravité.
Contre la traite, un combat « très loin d’être gagné » par l’État français
La France a beau afficher la lutte contre la traite des êtres humains comme une priorité politique, le nombre de condamnations reste très faible. En cause, un manque structurel de contrôles et de moyens. En 2023, l’État s’est doté d’un plan d’action, mais celui-ci priorise la lutte contre l’exploitation sexuelle, reléguant l’exploitation par le travail au second plan. Dans l’éditorial de ce plan national, la ministre de l’Égalité de l’époque, Bérangère Couillard, concédait que le combat contre la traite « est très loin d’être gagné ».
Audités l’an dernier par le Conseil de l’Europe, les pouvoirs publics ont rendu en février 2025 au groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (Greta) une copie pour le moins lacunaire. L’État français n’a ainsi pas répondu sur « les initiatives socio-économiques s’attaquant aux causes profondes et structurelles pour réduire la vulnérabilité des personnes issues de minorités défavorisées à la traite ».
Pourtant, contrôler les exploitations agricoles ayant recours à des travailleurs saisonniers étrangers pourrait permettre de déceler de nombreuses victimes. Pour en saisir l’enjeu, il faut revenir aux éléments constitutifs de la traite : la soumission d’une personne à des conditions d’hébergement indignes est l’un des principaux motifs retenus pour qualifier la traite lors des contrôles.
« Les situations de traite peuvent être plus présentes dans le secteur agricole, car l’hébergement est plus important que dans d’autres secteurs, et que l’on a recours à une main-d’œuvre étrangère dans des proportions importantes », analyse Lucas Dejeux, de la CGT Travail Emploi Formation professionnelle.
De combien de personnes parle-t-on ? Faute de statistiques officielles, les pouvoirs publics peinent à mesurer l’ampleur du phénomène. Seuls les chiffres du CCEM permettent d’établir un semblant d’état des lieux : en 2024, 38 des 327 personnes suivies par l’association ont été exploitées dans l’agriculture.
Mais ce nombre ne tient pas compte des procédures collectives, regroupant des dizaines de victimes qui ne sont pas toutes suivies par l’association. Les seuls dossiers de traite lors des vendanges comptent plus de 300 victimes. Sans compter tous les travailleurs exploités qui ne portent pas plainte et passent ainsi sous les radars.
La France est incapable de formuler une réponse au Greta sur les mesures spécifiques prises pour réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants.
Mais même sans répondre, l’État a toujours un temps de retard. « Les systèmes d’exploitation et le degré d’inventivité des stratégies déployées dans les pays d’origine et d’accueil pour vendre sous le manteau ces contrats saisonniers se sont particulièrement renforcés ces dernières années », pointe Béatrice Mésini. Ces stratégies sont possibles grâce à l’externalisation de la main-d’œuvre, structurelle dans le monde agricole. Ces systèmes de sous-traitance en cascade diluent les responsabilités et permettent aux commanditaires de ne jamais être inquiétés.
Consciente de ce phénomène, la France répond au Greta qu’« il pourrait être envisagé de renforcer la responsabilité pénale du maître d’ouvrage (bénéficiaire économique final) en lui imposant des obligations précises en matière de protection des travailleurs impliqués dans la chaîne de valeur ». À Bruxelles pourtant, le gouvernement français a pesé de tout son poids pour affaiblir la directive sur le devoir de vigilance des entreprises.
Une affaire a récemment mis en lumière la difficulté pour la justice de remonter jusqu’en haut de la pyramide. En 2023, les « vendanges de la honte » avaient choqué la Champagne et la France entière. 53 travailleurs sans papiers originaires d’Afrique de l’Ouest avaient été exploités par des sous-traitants, condamnés en première instance à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison.
À l’audience, le nom d’une des maisons de champagne ayant acheté les raisins récoltés par ces esclaves modernes a fini par être lâché à la barre : Moët & Chandon. L’entreprise filiale de LVMH n’était pas sur le banc des accusés. Elle était partie civile, en tant que membre du Comité champagne, qui regroupe les principaux acteurs de la filière. Lequel a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts dans cette affaire, au titre du préjudice d’image.
Nous avons tenté de savoir si le Comité champagne avait mené un audit pour définir qui avait bénéficié de ces raisins de la misère et si les maisons impliquées avaient fait l’objet d’une sanction, mais celui-ci n’a pas répondu aux questions de l’Humanité.
Contrôles inexistants
Pour Me Mehdi Bouzaïda, l’avocat du CCEM qui a plaidé dans cette affaire, « Le système capitaliste vise à dégager une marge sur le travail des salariés. Dans l’agriculture, avec la sous-traitance, ce raisonnement est poussé à l’excès et ce n’est malheureusement pas étonnant d’y rencontrer ce type de situation. »
« Il est actuellement impossible de garantir qu’il n’y a pas eu de misère humaine le long de notre chaîne d’approvisionnement, alerte Philippe Cothenet, secrétaire général adjoint de l’intersyndicat CGT du champagne. En plus des vendanges, il y a de plus en plus de sociétés de prestations tout au long de l’année, pour le relevage, l’ébourgeonnage ou la taille des vignes. »
Face à cette situation, la députée LFI de Gironde Mathilde Feld déposera dans les prochains mois une proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains ».
« Auparavant, l’inspection du travail recevait les patrons des entreprises qui souhaitaient embaucher de la main-d’œuvre étrangère. Aujourd’hui elle a été remplacée par des plateformes, pointe l’élue. C’est la première étape de la déshumanisation. Les contrôles sont inexistants, et beaucoup d’acteurs véreux s’infiltrent dans cette brèche. »
Mohammed peut en témoigner. L’entreprise qui l’a recruté « a obtenu environ 130 autorisations de travail entre 2022 et 2025. » Et « a employé 60 saisonniers marocains », nous a confirmé l’OFII. Soit autant de victimes potentielles. Mais l’office assure qu’« aucun visa n’a été délivré pour des candidats demandés par cette entreprise en 2024 et 2025 ».
La plainte pour traite des êtres humains de Mohammed et cinq autres collègues marocains a été jugée recevable. « Je veux que l’on reconnaisse la vérité », nous glisse-t-il. Mohammed tente de reprendre le cours de sa vie, et s’apprête à quitter le logement d’urgence du CCEM. Il a trouvé un nouveau travail, loin des champs. Pour lui, une chose est sûre : il sera là, au tribunal de Nîmes, en mars 2026, face à ses employeurs, présumés innocents.
Cette enquête a été réalisée avec le soutien de Journalismfund Europe.
mise en ligne le 30 septembre 2025
Jamal al-Dura : « Le sang de Mohammed n’en finit pas de couler »
Gwenaelle Lenoir sur www.mediapart.fr
Il y a vingt-cinq ans, le 30 septembre 2000, Mohammed al-Dura mourait dans les bras de son père, tué par des balles israéliennes, derrière un cylindre de béton, à un carrefour de la bande de Gaza. Ce père, Jamal al-Dura, vit toujours dans le camp d’Al-Bureij. Mediapart a pu le joindre et l’écouter.
L’image est mauvaise, le son se hache avant de revenir et puis de repartir, la liaison coupe souvent. Mais les mots et les traits de Jamal al-Dura nous parviennent quand même, depuis le camp d’Al-Bureij, dans la partie centrale de la bande de Gaza. Son visage est long et émacié, ses cheveux gris, sa peau semble un peu jaune. « Je me suis rendu chez des amis pour vous parler, dit-il à Mediapart, le 15 septembre en fin d’après-midi. Chez moi, c’est impossible, j’habite dans les ruines de ma maison, j’ai réussi à y aménager un coin, mais obtenir une liaison internet est impossible. »
Il montre ses cicatrices au bras droit, ses doigts recroquevillés, inutilisables. Il en a aussi à l’aine, mais celles-ci restent dissimulées, par pudeur. « Je ne peux plus prendre mon traitement, il n’y a plus de médicaments dans la bande de Gaza, même pas de paracétamol, reprend-il. J’ai fait toutes les pharmacies, je n’ai pas réussi à dénicher un seul comprimé. »
Ses vieilles blessures le font souffrir depuis un quart de siècle. Elles ne sont pas que physiques. Jamal al-Dura n’en finit pas de pleurer les siens.
Le 30 septembre 2000, la vie de cet ouvrier en bâtiment, alors âgé de 35 ans, bascule dans la tragédie palestinienne. Il en devient une icône, avec son fils Mohammed, cet enfant que son père ne peut pas protéger des balles israéliennes et qui meurt sur ses genoux.
Ce matin-là, Jamal al-Dura quitte le camp de réfugié·es d’Al-Bureij, où il habite, pour aller acheter une voiture d’occasion. Il emmène avec lui son deuxième fils, Mohammed, 12 ans.
La veille, la deuxième Intifada a éclaté à Jérusalem, après l’incursion provocatrice d’Ariel Sharon, alors chef du Likoud, le grand parti de droite, sur l’esplanade des Mosquées, qui abrite la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, troisième lieu saint de l’islam.
Dans la bande de Gaza, le vendredi 29 septembre 2000 est encore calme. Mais ce samedi midi, au checkpoint de Netzarim, qui protège la route menant aux colonies israéliennes (évacuées en 2005) du centre de la bande de Gaza, des manifestants palestiniens commencent à jeter des pierres sur la base militaire israélienne, située face à un poste de police palestinien, comme le prévoient les accords d’Oslo de 1993. Les balles, réelles, pleuvent, comme le raconte le caméraman de France 2, Talal Abou Rahma.
Les images de la terreur
De l’autre côté de la route, un homme et un enfant sont recroquevillés derrière un bloc de béton cylindrique. Ce sont Jamal et Mohammed al-Dura, pris sous le feu. Ils n’ont pas trouvé la voiture qu’ils cherchaient, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment.
Le caméraman filme la terreur de l’enfant, ses cris, le geste du père qui tente de protéger son fils, de le cacher derrière lui, qui hurle de cesser le feu. Un instant plus tard, Mohammed al-Dura gît inanimé sur les genoux de son père affalé contre le mur, la tête penchée.
Un enfant est mort*, et Mohammed al-Dura vient de devenir un symbole de la lutte et de la souffrance palestiniennes. Son image est reproduite sur des fresques, des affiches, des timbres.
L’armée israélienne reconnaît dans un premier temps que les tirs provenaient de sa base, avant de se rétracter. Pendant des années, une campagne est orchestrée depuis les bureaux de Benyamin Nétanyahou et par des soutiens fervents de l’État hébreu, pour nier jusqu’à la mort de Mohammed al-Dura et la réalité des blessures de Jamal.
Une des cibles en sera Charles Enderlin, à l’époque des faits correspondant de France 2 à Jérusalem, qui monta, commenta et diffusa le reportage le 30 septembre 2000. Accusé d’avoir trafiqué les images, il obtint gain de cause en 2013 au terme d’une très longue procédure.
Aujourd’hui, les enfants sont des squelettes qui cherchent dans les rues de quoi rapporter deux sous à leur famille. Jamal al-Dura
Vingt-cinq ans plus tard, Jamal al-Dura espère toujours que soient jugés les coupables de la mort de son fils. « Tuer est une décision politique. Le soldat exécute les ordres. Il faut juger les deux », affirme-t-il. Il a entamé des procédures, a dû les abandonner faute de moyens, mais cherche encore aujourd’hui, en pleine guerre génocidaire, dans les ruines de sa maison bombardée, de l’aide pour aller devant une juridiction européenne.
Pendant des années, raconte-t-il encore, il est allé de conférence en conférence, là où on l’invitait, pour parler des souffrances du peuple palestinien et raconter Gaza. Le père blessé portait le cri de l’enfant, et à travers lui, celui de tous ses concitoyen·nes. « Je disais partout, et je le dis encore aujourd’hui, je n’ai rien contre les Israéliens juifs, assure-t-il depuis le camp d’Al-Bureij. Je suis contre l’occupation de mon peuple et le vol de ses terres. »
C’est pour cela qu’il est revenu dans la bande de Gaza, après trois mois de soins intensifs en Jordanie, et après chaque tournée à l’étranger. « C’est mon pays. C’est ma vie. C’est ma terre. Et on ne brade pas sa terre comme ça », affirme-t-il. Et la tombe de Mohammed, qu’il visite souvent, se trouve dans le cimetière du camp d’Al-Bureij.
« Mohammed est une icône depuis le jour de son martyre, et il l’est encore aujourd’hui, parmi les Palestiniens, dans le monde arabe et partout ailleurs, reprend-il. On voit tous les jours des posts un peu partout sur les réseaux sociaux à propos de Mohammed al-Dura. Nous n’avons jamais cessé de parler de lui, et ça nous remontait le moral. »
Le bombardement de l’hôpital Al-Dura
Un hôpital pédiatrique de la bande de Gaza a reçu le nom de l’enfant l’année même de sa mort. L’établissement a été bombardé au phosphore blanc le 13 octobre 2023 et peu après déclaré hors service. Son directeur a été tué dans la frappe de sa maison, avec sa femme et ses deux filles.
Ce fut comme si Mohammed était touché une nouvelle fois. Deux jours plus tard, un bombardement israélien frappe une maison de la famille al-Dura. Jamal perd deux frères, une belle-sœur et sa nièce. « La maison s’est écroulée sur leurs têtes. Nous y sommes allés le lendemain, pour récupérer les dépouilles et nous ne les avons pas trouvées. Ils se sont évaporés », se souvient-il.
Le 18 janvier, encore une frappe israélienne, Jamal pleure un deuxième fils, Ahmed. Il avait 33 ans.
Pendant la période de la deuxième Intifada, on tuait des gens de mon peuple, mais pas par milliers. Jamal al-Dura
« J’ai perdu quatre-vingt membres de ma famille, dont un fils, encore, déplore-t-il. Le sang de Mohammed n’en finit pas de couler. Pourquoi ? Pourquoi tuent-ils les enfants ? Les médecins ? Les professeurs ? Les secouristes ? Pourquoi visent-ils les boulangeries et les ambulances ? Il ne reste plus rien de la bande de Gaza, plus un arbre, plus un bâti. Aujourd’hui, les enfants sont des squelettes qui cherchent dans les rues de quoi rapporter deux sous à leur famille. J’ai 60 ans et je ne pensais pas voir ça un jour, la famine à Gaza. »
La vie de Jamal al-Dura colle à l’histoire de la tragédie palestinienne. Ses parents ont vécu la Nakba, « catastrophe » en arabe, nom donné à l’exode forcé de 700 000 à 750 000 Palestinien·nes, chassé·es de leurs villes, de leurs villages et de leurs terres par un mélange d’actions militaires des milices juives puis de l’armée du jeune État hébreu, de massacres et de propagande. Le jeune Jamal est retourné avec son père dans leur village de Wadi Hunein, près de Ramleh, il avait 16 ans, il y a vu des ruines.
À l’automne 2023, il a dû quitter son domicile et partir vers le sud, vers Rafah, sur ordre de l’armée israélienne. Il y a vécu sous une tente, jusqu’à son retour dans les décombres de sa maison bombardée à Al-Bureij, à l’occasion du cessez-le-feu de janvier 2025.
« La tente, c’est une vie de cauchemars. L’été, il faut sortir très tôt, à cause de la chaleur, on ne peut pas rester sous la tente. Les mouches, les moustiques, les insectes, c’est très pénible, très humiliant, relate-t-il. L’hiver, la pluie traverse et il fait froid, tout est mouillé et rien ne sèche. Et puis avec le temps, les tentes s’abîment, le tissu craque. C’est une vie sans dignité. »
Ce que vit le peuple de la bande de Gaza dans cette guerre génocidaire, c’est, en pire, la continuation des séquences précédentes.
« Nous avons été expulsés en 1948 et maintenant, ils essaient de nous expulser de Gaza. C’est une scène qui se rejoue aujourd’hui, le même exode, mais avec une violence inouïe, beaucoup plus de violence qu’en 1948. C’est la même méthode, mais en plus criminel, décrit Jamal. Et pendant la période de la deuxième Intifada, on tuait des gens de mon peuple, mais pas par milliers. On n’utilisait pas les armes des missiles, l’aviation. On ne bombardait pas. Ce qui se passe, c’est un génocide. Ça vise n’importe quel Palestinien. Ce n’était pas pareil. Ils détruisent tout maintenant, absolument tout. »
Les fils de Jamal risquent leur vie en allant chercher des colis alimentaires sur le site de la Fondation humanitaire pour Gaza le plus proche. L’un d’eux, 22 ans, se prénomme Mohammed.
Boîte noire
* Un enfant est mort est le titre d’un livre de Charles Enderlin sur ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Mohammed al-Dura », publié en 2010 aux éditions Don Quichotte.
mise en ligne le 29 septembre 2025
Aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail : l’intersyndicale appelle à une mobilisation massive le 2 octobre !
sur https://www.cgt.fr/
Communiqué intersyndical de la CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires
Aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail : l’intersyndicale appelle à une mobilisation massive le 2 octobre !
Après la réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre, l’ensemble des organisations syndicales avait posé un ultimatum. Elles ont été reçues ce matin par le Premier ministre, pour
obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées par les travailleuses et les travailleurs.
L’intersyndicale déplore une occasion manquée. Après un long échange avec le Premier ministre sur les enjeux qui se posent pour le monde du travail, aucune réponse claire n’a été apportée à la colère des salarié·es, agent·es, demandeurs·euses d’emploi, jeunes, retraité·es …
Le Premier ministre a expliqué qu’il n’était pas en mesure de connaître la copie finale du budget 2026 qui sera adoptée par le Parlement, alors que l’intersyndicale attendait au moins des pistes sur une copie initiale. Ni rupture avec les mesures présentées en juillet, ni engagement sur ce que pourraient être des mesures de justice sociale et fiscale.
Le monde du travail a assez souffert et c’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales appelle à amplifier la mobilisation lors d’une nouvelle journée d’action et de grève interprofessionnelle le jeudi 2 octobre prochain pour exiger :
➡️ L’abandon de l’ensemble du projet de budget et notamment le doublement des franchises médicales, l’année blanche (désindexation des pensions, des prestations sociales, des salaires des agent·es de la fonction publique et du budget des services publics), la suppression de 3000 postes de fonctionnaires et la réforme de l’assurance chômage, ainsi que des projets attaquant le code du travail, et le 1er mai ;
➡️ La justice fiscale, avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, et contraignent le versement des dividendes ;
➡️ La conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises privées ;
➡️ Des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics partout sur le territoire ;
➡️ Une protection sociale de haut niveau et l’abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ;
➡️ Des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France, et des mesures contre les licenciements.
Pour préparer et réussir les grèves et manifestations du 2 octobre, les travailleuses et travailleurs et leurs syndicats maintiendront la pression et leurs revendications salariales par des actions dans les entreprises, les services et administrations, par différentes initiatives, organisations de réunions d’information, assemblées générales du personnel …
Les organisations syndicales conviennent d’ores et déjà de se revoir très rapidement.
Paris, le 24 septembre 2025
mise en ligne le 29 septembre 2025
La « marche des résistances », nouveau levier de la convergence des luttes
Mathias Thépot sur www.mediapart.fr
Associations, syndicats et partis de gauche ont manifesté ensemble dimanche 28 septembre contre les crises écologique, sociale et démocratique. Face à la montée de l’extrême droite et à la toute-puissance des milliardaires, l’idée est de faire front commun.
À l’approche de la COP30, qui se déroulera au Brésil en novembre, plusieurs milliers de manifestant·es se sont mobilisé·es dimanche 28 septembre dans plus de 70 villes de France, de Paris à Marseille, en passant par Nantes, Montpellier et même Saint-Pierre sur l’île de La Réunion, pour affirmer qu’un autre avenir était possible face aux crises écologique, sociale et démocratique.
Dans la capitale, le cortège, composé d’une foule compacte, s’étalait sur un peu plus de 500 mètres. Il est parti de la gare du Nord pour rejoindre la place de la République en passant par les grands boulevards.
Cette « marche des résistances », réalisée à l’appel d’une douzaine d’organisations qui luttent contre le changement climatique (Alternatiba, Attac, Greenpeace, Réseau action climat, ActionAid, 350.org…), affichait pour slogan « Climat, justice, libertés ! ». Les partis de gauche, notamment La France insoumise et Les Écologistes, étaient aussi présents dans les cortèges.
Cette mobilisation du 28 septembre, précise Dahlia Stern, porte-parole d’Action justice climat, voulait s’inscrire « dans la lignée du mouvement “Bloquons tout” du 10 septembre, et de la mobilisation syndicale du 18 septembre ».
Nouveauté : la CGT – qui se positionnait jusqu’ici plutôt en marge des marches pour le climat – a participé à l’organisation de l’événement. « Dans un contexte où les discussions budgétaires vont s’engager, nous pensons qu’il faut plus de moyens pour protéger les travailleuses et les travailleurs des dégâts causés par le changement climatique. Et de manière plus profonde, en tant que syndicalistes, nous nous posons la question des modes de production », explique Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris, présent en tête de cortège avec ses camarades.
La question de la convergence des luttes sociales et écologiques, qui font souvent l’objet d’événements séparés, était au centre des discussions. « Nous ne pouvons plus aujourd’hui avoir les manifestations des organisations écologistes d’un côté, et celles des syndicats de l’autre », estime le porte-parole de Greenpeace, Jean-François Julliard.
Il justifie : « Les émissions de gaz à effet de serre remontent dans le monde et les inégalités sociales se creusent. Or, en parallèle, il y a une offensive réactionnaire et autoritaire, en alliance avec les industries polluantes et les milliardaires. D’où la nécessité de travailler tous ensemble pour lutter. » « Il n’y a pas de justice sociale sans justice écologique, et inversement », résume la porte-parole d’Attac, Youlie Yamamoto, elle aussi présente.
Les milliardaires dans le viseur
Dans les rangs du cortège parisien, les principaux sujets dénoncés par les manifestant·es étaient donc l’inaction climatique des gouvernant·es, la montée de l’extrême droite, la sous-imposition des ultrariches et la guerre génocidaire menée par l’État d’Israël à Gaza.
Les personnes d’Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Donald Trump, de Benyamin Nétanyahou, ainsi que le PDG de Total Patrick Pouyanné et les milliardaires Vincent Bolloré et Bernard Arnault étaient les plus ciblés comme responsables du marasme actuel. « Ils détruisent, on s’unit », pouvait-on lire sur les banderoles.
« Nous dénonçons les responsables de la crise climatique que sont le système capitaliste, les multinationales, mais aussi la France, qui ne prend pas sa part, notamment dans ses soutiens à destination des pays du Sud », lance Veronica Velásquez, porte-parole d’ActionAid, une association de solidarité internationale.
De nombreux panneaux dénonçant la crise écologique étaient brandis, comme celui-ci, où l’on pouvait lire : « Fin de l’empoisonnement : abrogation loi duplomb et plan chlordécone, maintenant ! » Les slogans anti-extrême droite tels que « Rage against the Fascism » faisaient aussi mouche dans les rangs du cortège.
Mais le sujet de loin le plus abordé sur les banderoles concernait l’imposition des milliardaires. Preuve que tout le débat autour de la taxe Zucman a imprégné les consciences. Entre autres messages : « Pour notre survie : taxez les riches, financez la transition » ou « Bernard [Arnault], passe ton RIB pour la dette écologique ».
« C’est aux ultrariches et aux multinationales d’encaisser l’austérité !, estime Youlie Yamamoto, d’Attac. C’est pourquoi nous soutenons, dans le cadre du projet de budget 2026, la taxe Zucman, et aussi la retour d’un ISF [impôt sur la fortune] avec un volet climatique. »
Les militant·es écologistes étaient enfin présent·es pour mobiliser sur les enjeux de la COP30, qui débutera le 10 novembre 2025 dans la ville de Belém. Seront abordés le sujet des aides financières apportées par les pays riches aux pays les plus menacés par le réchauffement climatique, mais aussi les questions de déforestation et d'exploitation pétrolière, deux thèmes qui sont très sensibles au Brésil, où un énorme projet pétrolier est notamment en cours.
Au-delà des dégâts écologiques qu’ils génèrent, la déforestation et les nouveaux projets d’exploitation des combustibles fossiles ont des conséquences directes sur l’habitat et la santé des populations autochtones, aux revenus souvent très modestes.
L’activiste brésilienne Andressa Dutra, pour Rio sans pétrole et Greenfaith, était présente dans le cortège parisien pour sensibiliser sur la violence extrême générée dans son pays par les enjeux climatiques. « Il faut que les communautés autochtones au Brésil, qui sont les premières victimes de l’exploitation des combustibles fossiles, gagnent en visibilité grâce à la tenue de la COP. Elles subissent directement le racisme environnemental. » Et de rappeler que « le Brésil est le deuxième pays où l’on tue le plus les activistes de l’environnement ».
mise en ligne le 28 juillet 2025
L'ONU recense 158 sociétés, dont Egis et Carrefour, impliquées dans le développement de colonies israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés
Luis Reygada sur www.humanite.fr
Dans un rapport onusien, deux entreprises françaises, Carrefour et Egis, sont dénoncées pour leurs activités dans les colonies israéliennes illégales implantées dans les territoires palestiniens occupés.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié vendredi 26 septembre une mise à jour de sa base de données sur les entreprises impliquées dans le développement des colonies israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés.
Si l’écrasante majorité de ces sociétés se rendant complices du gouvernement de Benyamin Netanyahou sont israéliennes, une vingtaine d’autres ont leur siège en Europe ou en Amérique du Nord.
Les ONG dénoncent le commerce avec les colonies israéliennes
Parmi les 158 entreprises répertoriées par le HCDH (qui s’est limité, par manque de moyens, à l’étude de 215 cas sur près de 596 sociétés initialement ciblées), on retrouve les états-uniennes Airbnb, Booking.com, Motorola ou encore Trip Advisor, mais aussi le français Egis et sa filiale Egis Rail, pointés du doigt pour leur participation au développement du tramway reliant Jérusalem aux implantations illégales situées sur des terres palestiniennes, à l’est.
De quoi mettre en doute le supposé attachement du groupe (2,16 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, + 14 %) à la promotion des droits de l’homme.
Si le géant Alstom a été retiré du nouveau rapport du HCDH, le français Carrefour – qui ne figure pas dans la liste non exhaustive de l’ONU – est pour sa part dénoncé par une coalition internationale de plus de 80 ONG (dont Oxfam, la Ligue des droits de l’homme et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine) dans le cadre de la campagne « Stop au commerce avec les colonies », lancée le 15 septembre.
L’appel au boycott de Francesca Albanese
Accusée de se rendre « complice d’un système de colonisation qui spolie les Palestiniens de leurs terres et ressources », l’enseigne française de grande distribution est visée à la suite d’accords de franchise rendant possible l’implantation d’au moins neuf magasins dans des colonies illégales, notamment à Ariel et Maalé Adumim, ou encore à Jérusalem-Est.
Carrefour aurait aussi « renforcé ses liens avec des acteurs clés de la colonisation », notamment avec deux start-up israéliennes « directement impliquées dans l’expansion des colonies et répertoriées par l’ONU ».
Tout en dénonçant la complicité de certaines multinationales avec Tel-Aviv, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, avait lors de sa participation à la Fête de l’Humanité rappelé « le pouvoir (qu’ont les gens, à travers leur façon de consommer) de ne pas soutenir les entreprises se rendant complices des crimes d’Israël ».
mise en ligne le 28 septembre 2025
En Nouvelle-Calédonie,
le désarroi des familles
face à une justice
« à deux vitesses »
Jeanne Sterni www.mediapart.fr
Dossiers toujours en souffrance plus d’un an après la mort de leurs proches, questionnements sur le statut des auteurs de tirs visant des Kanak, peines à géométrie variable... En Nouvelle-Calédonie, les familles de victimes des forces de l’ordre désespèrent d’obtenir des réponses.
ÀÀ Plum, la stupeur a fait place à la colère. Dans ce petit village de la commune du Mont-Dore, à 30 kilomètres au sud de Nouméa, un jeune homme de 32 ans, Faara Tournier, a été mortellement blessé jeudi 18 septembre lors d’une intervention des forces de l’ordre pour une rixe en marge de la fête à laquelle il participait.
Plusieurs coups de feu ont été tirés. Deux, reconnaît le gendarme mobile, qui « se serait senti en danger » alors qu’un pick-up effectuait des embardées en se dirigeant vers lui, selon le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas. Trois, selon plusieurs jeunes présents à la soirée. Le projectile que Faara a reçu juste sous l’œil gauche ne lui a en tout cas laissé aucune chance. Il est mort deux jours plus tard.
Ce qui choque aujourd’hui son oncle, Soane Tafusimai, c’est que le gendarme n’a pas été mis en examen, mais placé sous le statut de témoin assisté. « Pour nous, il y a une justice à deux vitesses, c’est comme si on nous disait que c’était normal de l’avoir tué », déplore-t-il. « La façon dont on parle de mon frère, du fait qu’il y avait une fête et de l’alcool, c’est presque comme si c’était lui le coupable, raconte aussi Heirarii Tournier, le frère de la victime. Mais il était juste sur le trottoir avec ses amis. On appelle tout le monde au calme, mais ils n’avaient pas à utiliser d’arme. Pour moi, il a été abattu comme un chien. »
« Les gendarmes veulent se protéger, estime Cécilia, une tante de Faara. Ils minimisent, mais nous, on ne pourra pas voir une dernière fois notre garçon, le cercueil sera fermé à cause de ses blessures. On est anéantis, mais d’abord en colère. On voudrait juste qu’ils reconnaissent les faits. »
En bénéficiant du statut de témoin assisté, le gendarme mis en cause ne pourra être ni placé sous contrôle judiciaire ni assigné à résidence, et encore moins être envoyé en détention provisoire. « On ne voit jamais ça dans ce type d’affaires, explique un avocat du barreau de Nouméa. Le juge d’instruction a tout intérêt à demander la mise en examen, quitte à revenir dessus plus tard, pour avoir le plus de moyens d’action à sa disposition. »
Pourtant, quand ce sont les gendarmes qui sont visés, le parquet n’hésite pas à étendre au maximum les qualifications pénales pour obtenir des moyens d’enquête supplémentaire. Le 15 août, lorsqu’un véhicule vide stationné le long d’une maison occupée par des gendarmes a été visé par des tirs au milieu de la nuit, le procureur de la République avait ainsi ouvert une enquête pour tentative de meurtre.
« Un climat de peur »
L’affaire de Plum tombe au mauvais moment pour les autorités, alors qu’elles ont déployé un important dispositif de sécurité dans l’archipel par crainte de nouvelles tensions liées au 24 septembre, date de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853, considérée par les indépendantistes comme le jour du deuil du peuple kanak.
Actuellement, 2 770 policiers et gendarmes sont sur le terrain. Gendarmes qui sont en grande partie des mobiles, déployés pour trois mois, et parfois très jeunes. Un point que n’a pas manqué de relever le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) : « La pression permanente [des forces de l’ordre] nourrit un climat de peur et de méfiance réciproque. À cela s’ajoute l’envoi de jeunes gendarmes métropolitains, fraîchement arrivés, qui ne connaissent rien au pays, ni nos manières ni nos façons de faire », écrit le mouvement indépendantiste dans un communiqué.
Et d’ajouter : « Placés dans un environnement qu’ils ne comprennent pas, ils projettent leurs propres représentations, se croyant dans les cités métropolitaines, et réagissent dans la panique, avec des réflexes inadaptés. Le drame de Plum en est une tragique illustration. » Selon plusieurs sources, le gendarme qui a tiré serait arrivé trois jours plus tôt dans l’archipel.
On n’attend pas grand-chose de la justice.
Allan Païta, l’oncle de Lionel Païta, tué par un gendarme le 3 juin
2024
Quand ce n’est pas le statut judiciaire de l’auteur qui pose question aux familles, ce sont d’interminables délais qui éreintent leurs espoirs d’obtenir un jour justice. Lionel Païta, 26 ans, a été mortellement blessé le 3 juin 2024 par un gendarme en permission et en civil. Ce jour-là, quinze balles ont été tirées sans sommation par deux mobiles âgés de 23 ans. L’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a entendu les témoins du drame, mais pas la justice.
À ce jour, l’affaire ne fait toujours pas l’objet d’une information judiciaire. Une attente interminable et surtout hors norme, qui finit d’accréditer dans le monde kanak la thèse d’une justice coloniale. « On n’attend pas grand-chose de la justice, explique au nom de la famille Allan Païta, l’oncle du jeune homme. Ça crée beaucoup de frustration dans la jeunesse de la tribu. Et ce qui s’est passé à Plum trouve de l’écho chez eux. De temps en temps, il y a encore des petits feux allumés par-ci par-là : pour moi, c’est lié à ce sentiment d’impunité. »
Dans le fief indépendantiste de Saint-Louis au Mont-Dore, les familles de Samuel Moekia et Johan Kaidine, tués au cours d’une opération du GIGN qui visait à les arrêter le 19 septembre 2024, sont dans la même situation. Les forces de l’ordre évoquent un tir de riposte et une enquête de l’IGGN a là encore été ouverte, mais rien du côté du parquet.
En principe, les familles peuvent saisir directement un juge d’instruction, en se portant parties civiles. Mais il leur faudrait alors verser une consignation en plus de frais d’avocats déjà très élevés pour des personnes qui ont pour point commun d’être très modestes.
Quant aux peines prononcées par le tribunal de Nouméa, elles ne sont pas pour les rassurer. Mardi 23 septembre, un jeune de Saint-Louis a été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir jeté un caillou sur un gendarme. Jugé le même jour, un habitant de la commune rurale de Boulouparis, qui avait tiré dans la fesse d’un jeune Kanak sur fond d’insultes mutuelles, s’en est, lui, sorti avec douze mois de prison avec sursis.
mise en ligne le 27 septembre 2025
Montpellier : un nouveau collectif lutte contre les problèmes liés au logement à la Paillade
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Ce vendredi 26 septembre, le Comité populaire d’entraide et de solidarité de la Pallaide, collectif né cet été, a organisé son premier rassemblement public devant les locaux d’ACM au Grand Mail pour dénoncer les problèmes de logement qui touchent le quartier.
Leur simple venue a fait fermer les grilles de l’agence ACM Habitat (principal bailleur social de la Métropole de Montpellier) de la Mosson. Ils étaient une quinzaine ce vendredi 26 septembre, à s’être rassemblés à l’appel du Comité populaire d’entraide et solidarité (CPES) de la Paillade, collectif créé cet été afin fédérer les habitants autour d’actions collectives pour améliorer leurs conditions de vie.
Paul, co-fondateur du collectif, raconte : “Il a été fondé par et pour les habitants en s’inspirant de comités similaires dans d’autres villes comme Lyon ou Toulouse, qui ont réussi, par la lutte, à obtenir des réparations dans leurs logements de la part des bailleurs.”
Le logement est justement au cœur du rassemblement du jour. Ascenseurs en panne, cafards, pénurie de chauffage… Les griefs sont nombreux et visent bailleurs sociaux comme privés.AbdelMjid, habitant de la résidence de l’Hortus, est venu en soutien. “Dans notre résidence, on a été en panne d’ascenseurs pendant neuf mois. Il a fallu entamer une procédure en justice pour obtenir réparation. Alors forcément, je suis solidaire du reste du quartier sur les questions de logement.”
Un autre habitant, qui préfère rester anonyme, évoque quant à lui “des cafards dans tout l’immeuble” et une “régularisation tardive de charge” de 3 000 euros, jugée infondée. “Qui peut payer ça ?”, s’interroge-t-il.Certains habitants de la Paillade ont monté des collectifs dans leur immeuble, on va essayer de tous les fédérer pour agir ensemble”, détaille Paul.
Outre les problèmes de logement, le CPES entend créer des espaces de solidarités autour du sport, notamment en organisant des tournois de foot en soutien à la Palestine, ou des moments culturels, et créer une coordination nationale avec les comités des autres villes
mise en ligne le 27 septembre 2025
Budget : la bataille est aussi idéologique
L'éditorial de Fabien Gay sur www.humanite.fr
Rupture. Le mot est lâché par le premier ministre, Sébastien Lecornu. Les consultations des forces politiques semblent convaincre le nouveau locataire de Matignon de faire autrement. Mais le sempiternel discours sur la « méthode » ne fonctionne plus. Barnier, Bayrou comme Lecornu, illégitimes au regard du vote populaire, ne sont prêts en réalité à aucune concession.
On sait que le mot rupture ne dit rien en soi. La vraie et l’unique rupture doit être sur le fond contre ces projets d’austérité, saupoudrés de poussées autoritaires et de remises en cause de l’État de droit voulues par Bruno Retailleau et l’extrême droite. Dans ce contexte, la bataille idéologique fait rage. Les soutiens des droites coalisées à l’extrême droite matraquent en permanence leur discours sur l’immigration, l’insécurité et l’islam, relayés par des puissants médias détenus par quelques milliardaires. Ils le doublent maintenant d’un discours sur la dette, promettant du sang et des larmes aux travailleurs.
Et pourtant, malgré ce matraquage en continu, la politique de l’offre et la théorie du ruissellement sont rejetées massivement. Il faut dire qu’avec 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qu’avec des cohortes de privés d’emploi subissant les dégâts de la désindustrialisation et des réformes successives de l’assurance-chômage, le bilan macroniste n’est pas glorieux. Il y a une soif de justice sociale et fiscale qui émerge, comme le démontrent les mobilisations récentes.
Les principes de contrôle de l’argent public versé aux grandes entreprises, au lieu de nourrir les actionnaires, comme une taxation plus élevée des ultra-riches, qui ont largement profité de la crise, sont largement partagés. La taxe Zucman, un impôt plancher de 2 % sur les revenus du patrimoine au-delà de 100 millions, comme le contrôle des 211 milliards d’aides publiques aux grandes entreprises aujourd’hui versés sans transparence, ni suivi ni évaluation, sont désormais des revendications populaires. Rien ni personne ne peut arrêter une idée qui s’empare des masses.
Fébrile, le camp du capital contre-attaque et tente de discréditer, caricaturer, moquer ou invisibiliser ces deux propositions. Tour à tour, le patronat, Bernard Arnault en tête, et les éditorialistes libéraux tentent d’éteindre le feu. Leur morgue démontre leur fébrilité. La colère est grande face à celles et ceux qui veulent faire croire que l’austérité est la seule voie, sans s’interroger sur leur propre responsabilité quant au manque d’argent dans les caisses de l’État.
Celles et ceux qui sont en colère ne sont pas des irresponsables qui voudraient le chaos, ce ne sont pas de doux rêveurs qui planeraient face à des pragmatiques réalistes quant à la situation économique. Ce sont des hommes et des femmes qui sont lucides sur les dégâts causés, partout dans la société, par des années de politiques libérales.
La foule est aux trousses du couple exécutif et prépare l’après-Macron. Le peuple fera de l’examen budgétaire un temps fort de notre démocratie. Le futur gouvernement n’aura d’autre choix que d’écouter pour répondre aux besoins populaires. Ils sont acculés, au bout de leur logique libérale et antidémocratique.
La gauche a marqué des points dans la bataille idéologique. Et chacun sait qu’elle est le préalable à toute victoire électorale. Il faut donc unir nos forces pour transformer l’essai et répondre à cette volonté populaire, qui s’est exprimée successivement le 10 septembre, puis à la Fête de l’Humanité, et le 18 septembre dernier, pour en faire une victoire politique durable.
mise en ligne le 26 septembre 2026
Le coût des pesticides
sur le système de santé inquiète des mutuelles
Par Nicolas Malarte sur https://reporterre.net/
Vingt mutuelles françaises et belges se mobilisent contre l’usage des pesticides en Europe. Responsables de maladies chroniques, ces produits participent au déséquilibre budgétaire du système de santé.
Une agriculture sans pesticides, c’est une perspective souhaitable, autant pour la santé humaine... que pour les dépenses des mutuelles. Lors d’un point presse tenu le 23 septembre aux côtés d’organisations écologistes [1], l’association Mutuelles pour la santé planétaire a rappelé la menace que les produits phytosanitaires font peser sur leurs budgets.
Ces vingt mutuelles françaises et belges (Aésio, Mutualis, Solimut...) représentent plus de 12 millions de personnes et appellent à tendre vers un futur européen sans pesticides. Suppléant la Sécurité sociale, les mutuelles sont des sociétés à but non lucratif, qui gèrent notamment les complémentaires santé de leurs membres.
Au vu de la tendance d’austérité qui entoure le futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, l’association mutualiste s’inquiète. « Dernièrement, les PLFSS visaient à transférer les déficits de la Sécurité sociale vers les mutuelles, donc les assurés », explique la trésorière de l’association, Jocelyne Le Roux. Selon elle, interdire les pesticides pourrait permettre de réduire les dépenses et ne pas faire peser ce coût sur les cotisations des assurés.
Les pesticides favorisent les maladies chroniques
Parmi ces dépenses qui inquiètent, ce sont surtout les traitements des maladies chroniques, ou affections de longue durée (ALD), qui sont ciblés. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a établi un lien entre exposition aux pesticides et plusieurs ALD. Entre autres, sont listés la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs et le cancer de la prostate.
Leurs traitements et soins associés sont totalement couverts par le système de santé français, dont elles constituent le plus gros poste de remboursement. En 2022, près des deux tiers des dépenses de l’assurance-maladie ont été adressées aux assurés ALD, soit 126 milliards d’euros.
Ce régime concernait 13,8 millions de personnes en France cette année-là, un nombre qui ne fait qu’augmenter selon Martin Rieussec-Fournier, président de l’association mutualiste. « On voit une augmentation des maladies dégénératives et hormonales », dont sont en partie responsables les pesticides et les perturbateurs endocriniens qu’ils contiennent, avance-t-il.
La situation fait donc peser un risque sur le système de santé, surtout dans un contexte budgétaire serré. S’appuyant sur un rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale, Jocelyne Le Roux rappelle l’importance d’interdire les pesticides. « Sur le déficit annuel de la Sécu, qui devrait dépasser 20 milliards d’euros en 2025 [...] 10 milliards viendraient des maladies chroniques », auxquelles l’exposition aux pesticides contribue.
Le coût caché des pesticides
Ainsi, s’attaquer à l’utilisation des pesticides est une façon pour ces vingt mutuelles de baisser le coût qu’ils induisent sur la santé et la société. Un coût caché « qui met en danger la Sécu et les mutuelles, mais qui reste difficile à estimer », selon Martin Rieussec-Fournier.
En 2022, un rapport du Bureau d’analyse sociétale d’intérêt collectif (Basic) considérait que les effets de ces produits phytosanitaires avaient généré au moins 372 millions d’euros de dépenses publiques pour l’année 2017 en France. Sur cette somme, 48,5 millions d’euros correspondent aux dépenses de santé (la majorité de la part restante est liée au traitement de l’eau).
Si les travailleurs agricoles sont les premières victimes des effets des produits phytosanitaires, le président des Mutuelles pour une santé planétaire rappelle que tout le monde est touché : « On retrouve des résidus dans l’air, les aliments non bio, l’eau du robinet... » La situation concerne par exemple les riverains d’exploitations viticoles, comme en témoigne une étude parue en septembre. Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a enregistré une hausse de 43 % des demandes en 2024.
Garder le cap européen
Les Mutuelles pour la santé planétaire et leurs associations partenaires entendent élargir la mobilisation au niveau européen. Elles appellent notamment à appliquer la législation européenne sur l’évaluation de la toxicité des pesticides et à maintenir les objectifs de réduction de moitié des pesticides d’ici à 2030, comme le prévoyait le Pacte vert européen, et 100 % pour 2050.
Ces demandes seront portées par l’Odyssée pour notre santé, une caravane à vélo qui traversera l’Europe d’ici à 2027 pour « toucher le grand public sur les problématiques des pesticides et proposer des alternatives », explique Martin Rieussec-Fournier. Organisée par les quatre associations, la caravane partira du Parlement européen de Bruxelles, samedi 27 septembre, à 14 heures.
mise en ligne le 26 septembre 2025
La Flottille pour Gaza visée
par des attaques d’ampleur en mer
François Bougon, Nejma Brahim et Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Douze bateaux sur la cinquantaine qui se dirigent vers l’enclave palestinienne ont été touchés par des tirs de drones dans la nuit de mardi à mercredi. « Ces 48 prochaines heures vont être critiques », alerte l’eurodéputée Emma Fourreau, tandis que Madrid et Rome envoient des navires les assister.
Elle ne représente aucune menace, et pourtant elle a été lourdement attaquée dans la nuit du 23 au 24 septembre. La flottille humanitaire internationale, comprenant 51 bateaux, se dirige depuis plusieurs semaines vers Gaza dans l’objectif de briser le blocus imposé par Israël, qui multiplie les massacres dans l’enclave palestinienne. « J’étais à bord du Zéphyro, un petit voilier qui a été le plus endommagé par l’attaque. On était sept à bord. Ils ont commencé à bombarder entre minuit et 5 heures, les bombes sont tombées uniquement sur les plus petits voiliers », raconte Noé Gauchard, assistant parlementaire de l’eurodéputée Emma Fourreau (La France insoumise).
Il évoque de « petits drones très rapides » et sans lumière, planant au-dessus des bateaux et larguant des explosifs. « Douze bateaux ont été touchés, quatre ont eu des dégâts matériels », poursuit le militant LFI. Le voilier sur lequel il voyageait ne peut plus continuer : son foc a été endommagé. « La bombe a cassé un câble en acier qui est tombé sur nous, ça aurait pu faire des dégâts humains. Le Zéphyro va partir au port, en Crète, où les dégâts vont être examinés. » Les équipes du voilier ont depuis été réparties sur d’autres bateaux. Pour Noé Gauchard, il ne s’agit plus d’« intimidation » venant d’Israël, mais de « sabotage ».
Du fait des attaques, explique Baptiste André, médecin qui s’apprête à rejoindre la flottille, des membres d’équipage souhaitent être débarqué·es. « C’est la raison pour laquelle on va aller prêter main-forte dès aujourd’hui ou demain. » Ils sont deux médecins et un skipper à partir pour la Crète, où ils rejoindront l’un des bateaux de la flottille humanitaire. Déjà présent à bord du Madleen en juin, Baptiste André souhaite poursuivre son engagement : « Cette action est nécessaire puisqu’il n’y a pas de réponse claire des États occidentaux pour empêcher le génocide et permettre à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza. »
Le jeune homme reste lucide sur le risque pour la flottille d’être à nouveau « interceptée illégalement en eaux internationales ». « Les moyens déployés par l’armée israélienne sont très grands et les intimidations vont s’intensifier. Cette fois, il n’y a pas un bateau mais une cinquantaine. Il y a donc un espoir, certes raisonné, de pouvoir briser le siège à Gaza et installer un corridor humanitaire. C’est par la répétition de ces actions que nous y arriverons. »
Espagne et Italie répondent présentes
« Ces quarante-huit prochaines heures vont être critiques : on sait de sources sûres qu’Israël est prêt à assumer des blessés voire des morts, ce n’est pas un tabou pour Israël », alerte l’eurodéputée Emma Fourreau, également à bord de la flottille, jointe ce jeudi après-midi. « Un rappel [a été] fait à tous les participants », explique Emma Fourreau, au sujet des risques très forts entrepris en s’engageant avec la flottille humanitaire, « pour que toutes les personnes qui ne le sentent pas » abandonnent. Pour l’heure, seuls des dégâts matériels ont été enregistrés.
Mais la violence des attaques, attribuées à Israël par les équipages et de nombreuses personnalités, ce qui est l’hypothèse la plus plausible à ce stade, laisse présager le pire pour la suite. L’eurodéputée dit donc se tourner vers les institutions pour les protéger. « L’Espagne et l’Italie vont nous porter assistance : attaquer des navires civils pacifiques est une chose, se confronter à des navires de guerre européens, c’en est une autre. Nous comptons donc sur la mobilisation populaire, car ce sont les grèves massives qui ont fait bouger le gouvernement italien. »
Depuis le siège des Nations unies, à New York, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a en effet confirmé, mercredi 24 septembre lors d’une conférence de presse, l’envoi d’un patrouilleur de la marine espagnole dont la mission est de secourir, en cas de nécessité, les membres de la flottille. Et pas seulement les ressortissant·es de son pays.
« D’autres pays ont déjà pris cette décision, comme l’Italie par exemple, a-t-il déclaré. Et nous, bien évidemment, nous allons fournir cette protection, cette sécurité à nos concitoyens, qui ne font qu’exprimer la solidarité de millions et de millions de personnes dans le monde, comme nous l’avons vu à l’Assemblée générale des Nations unies, où il est clair qu’une immense majorité de pays, et donc de sociétés, n’acceptent pas la situation dans laquelle se trouve, dans ce cas précis, la population gazaouie. »
Pedro Sánchez a souligné que son gouvernement exige « que le droit international soit respecté et que le droit de nos citoyens à naviguer en toute sécurité en Méditerranée soit garanti ». Le navire Furor, qui dispose, selon El País, d’un canon et de deux mitrailleuses, ainsi que d’un hélicoptère et d’un drone de surveillance et peut accueillir jusqu’à quatre-vingts personnes à son bord, devait partir jeudi du port de Carthage, dans le sud de l’Espagne.
La veille, le gouvernement italien avait annoncé l’envoi de la frégate Fasan, « afin de garantir l’assistance aux citoyens italiens présents dans la flottille » et d’effectuer « d’éventuelles opérations de sauvetage ». Jeudi, devant la Chambre des députés, le ministre de la défense, Guido Crosetto, a indiqué qu’un deuxième bateau serait envoyé sur zone. Il a cependant mis en garde les membres de la flottille, faisant écho aux propos de la première ministre, Giorgia Meloni, qui, à New York, avait jugé l’initiative « gratuite », « dangereuse » et « irresponsable ».
« Nous continuerons à œuvrer pour qu’aucun incident ne survienne à la flottille et je vous demande votre aide à cet égard, indépendamment des divergences politiques, a-t-il dit, selon l’agence italienne Ansa. Le climat est inquiétant et je tiens à dire que nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité des bateaux en dehors des eaux internationales. »
Le ministre a appelé les membres de la flottille à répondre positivement à l’offre de l’Église catholique. Cette dernière a proposé de transporter l’aide à Chypre puis de la confier au patriarcat latin de Jérusalem pour l’acheminer à Gaza. Toujours selon El País, le ministère de la défense espagnol a contacté son homologue italien pour coordonner leurs actions.
La France reste passive
Et la France, dans tout ça ? Rien, hormis un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères le 24 septembre, indiquant que « la France suit de près et avec une grande préoccupation le parcours de la flottille Global Sumud vers Gaza », « condamne toute attaque en mer et appelle au respect du droit international, en particulier le droit de la mer ».
Le ministère précise toutefois : « Les participants à cette expédition en faveur de Gaza ont été informés des risques encourus. Comme rappelé par le ministre, se rendre à Gaza est dangereux et strictement déconseillé, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Les conseils aux voyageurs s’appliquent à tous y compris aux parlementaires et aux journalistes. » Les participant·es de la flottille sont laissé·es responsables de leur sort, alors qu’ils n’ont même pas encore atteint Gaza et naviguent en eaux internationales.
« Les camarades d’autres nationalités se moquent de nous à propos des déclarations du gouvernement français, déplore Emma Fourreau. Dire que les règles s’appliquent à tous les voyageurs, qu’ils soient journalistes ou députés, c’est la France qui s’humilie. La France peut encore sauver son honneur, mais il est fort possible qu’on soit attaqués cette nuit. Elle n’aura alors pas protégé ses quarante-quatre ressortissants. »
Et son assistant parlementaire d’abonder : « On n’arrête pas d’interpeller le Quai d’Orsay pour avoir une protection. Le directeur de L’Humanité a interpellé le président, car Émilien Urbach, journaliste, est à bord, et la réponse est scandaleuse : “Les conseils aux voyageurs s’appliquent à tous.” C’est lunaire : se rendre à Gaza est dangereux, d’accord, mais pourquoi ? On n’est pas sur un voyage de tourisme, on est sur des bateaux civils bombardés au large de la Grèce. »
Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et au ministre démissionnaire des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient réagit vivement au communiqué des autorités françaises publié la veille, rappelant être épris, en tant que juristes, « du respect du droit international et des valeurs de notre République ». « Ce communiqué se contente de condamner l’attaque déjà commise contre la Flottille Global Sumud, ainsi que les probables attaques à venir. » Or, à ce jour, poursuit l’association, « les “condamnations” prononcées contre Israël n’ont constitué que des “blancs-seings” », ajoute l’association.
Des appels au reste du monde
Cinq ONG (Amnesty International France, Reporters sans frontières, Greenpeace France, Médecins du monde et Médecins sans frontières Pays-Bas) ont dénoncé jeudi « les nouvelles attaques illégales de drones » survenues contre la flottille, « initiative pacifique visant à briser le siège illégal d’Israël » de la bande de Gaza.
Face aux risques encourus par les activistes et journalistes présents à bord des bateaux « et face à la situation apocalyptique des populations palestiniennes de Gaza, nous demandons aux États tiers, en particulier aux États européens, de condamner publiquement les attaques contre la flottille ». Les ONG appellent à faire pression sur Israël en parallèle, pour permettre l’entrée de la flottille « en toute sécurité et d’une aide humanitaire en urgence dans la bande de Gaza ».
Lors d’une conférence de presse donnée en fin d’après-midi jeudi, plusieurs participants de la flottille ont appelé la communauté internationale, mais aussi les médias, à réagir. « Nous avons subi une attaque de drones durant plusieurs heures. Heureusement, tout le monde est sain et sauf et nous poursuivons notre mission. Israël nous intimide aujourd’hui avec une violence qui s’intensifie, pour tenter d’arrêter la flottille dont l’objectif est de stopper le génocide et de briser le blocus », a déclaré Mandla Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela, depuis l’un des bateaux.
La militante allemande Yasmin Acar, connue pour son engagement en faveur des réfugié·es, de la justice et de la Palestine, a dénoncé « l’utilisation de faux prétextes par Israël pour justifier ses violences » à leur égard. « Ce n’est pas un cas isolé », a-t-elle souligné, appelant l’Allemagne, qui a longtemps financé l’armement israélien (mais a annoncé en août la suspension de ses exportations d’armes susceptibles d’être utilisées à Gaza), à ne plus se taire face à Israël et à la guerre génocidaire menée en Palestine.
mise en ligne le 25 septembre 2025
En « position de force »,
l’intersyndicale appelle à amplifier la mobilisation
le 2 octobre
Cécile Hautefeuille sur www.mediapart.fr
Après avoir été reçus par le premier ministre, les syndicats déplorent l’absence de réponse claire à leurs revendications et appellent à une nouvelle journée de grève le jeudi 2 octobre. Le patronat, également convié à Matignon, confirme quant à lui la tenue d’un rassemblement le 13 octobre. Dans la soirée, le premier ministre a invité les uns et les autres à revenir discuter.
À entendre les responsables des organisations syndicales, la rencontre avec le premier ministre, ce mercredi 24 septembre, n’aura été que du vent et du vide. « Rien de précis », « Aucune réponse claire », « Une occasion manquée », ont commenté, à chaud, les représentantes et représentants des salarié·es, en sortant de Matignon à la mi-journée.
L’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) appelle donc à une nouvelle journée d’action le jeudi 2 octobre – qui doit être confirmée par un communiqué commun en fin de journée – et invite les travailleuses et travailleurs à « amplifier » le mouvement après la mobilisation du 18 septembre, ayant rassemblé entre 500 000 et 1 million de personnes partout en France.
Au soir de cette journée de grèves et manifestations, le message était clair : « un ultimatum » était lancé au chef du gouvernement, qui devait répondre aux revendications des organisations syndicales contre l’austérité et pour la justice fiscale « d’ici au 24 septembre », faute de quoi elles appelleraient les travailleuses et travailleurs à se mobiliser à nouveau.
Jugeant que « le compte n’y est pas » après plus de deux heures de rencontre avec Sébastien Lecornu, l’intersyndicale met donc sa menace à exécution. « On est restés clairs et lui est resté flou », critique Marylise Léon, invitée au 20 heures de France 2 mercredi soir. Selon la numéro un de la CFDT, « le monde du travail ne doit pas abdiquer, il doit se mobiliser » le 2 octobre. Europe Écologie-Les Verts, la France insoumise et le Parti communiste annoncent d’ores et déjà soutenir cette nouvelle date.
Nouvelle invitation
Dans un communiqué publié en début de soirée, Matignon propose aux partenaires sociaux de revenir discuter « dans les prochains jours pour parler plus précisément du budget et du projet global qu’il portera » et annonce qu’il leur enverra un courrier « pour leur demander leur contribution sur cinq thématiques ». À savoir : le financement de la protection sociale, la réindustrialisation, la qualité de vie au travail, le renforcement du paritarisme et la modernisation du marché du travail.
Sébastien Lecornu assure par ailleurs aux partenaires sociaux qu’il n’entend pas « passer en force » mais « avancer en lien avec eux », ajoutant : « Dans l’histoire récente, jamais un premier ministre n’avait reçu les partenaires sociaux à deux reprises avant même la formation de son gouvernement. »
« Nous sommes en position de force », avait scandé, plus tôt, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, en sortant de Matignon. « Le premier ministre nous a dit que, jamais, dans la Cinquième République, un premier ministre n’avait été aussi fragile », a-t-elle raconté, voyant dans ces propos la seule « bonne nouvelle » du rendez-vous. Sébastien Lecornu aurait ensuite ajouté : « Je ne suis pas Édouard Philippe, je n’ai pas 350 députés sur lesquels m’appuyer. »
Sophie Binet a par ailleurs jugé « lunaire » la présence autour de la table de trois ministres démissionnaires (travail et emploi, santé et travail et fonction publique). « On ne savait plus trop dans quel espace-temps on était […]. Encore au mois de juillet ou bien au mois de septembre ? », a taclé la cégétiste alors que Sébastien Lecornu n’a toujours pas composé de gouvernement, deux semaines après sa nomination.
Les revendications de l’intersyndicale restent les mêmes : abandon de l’ensemble du projet de budget annoncé par François Bayrou mi-juillet, justice fiscale via la taxation des gros patrimoines et revenus, déploiement de moyens « à la hauteur » pour les services publics, abandon de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et conditionnalité « sociale et environnementale » des aides publiques aux entreprises.
Le flou sur l’assurance-chômage
Depuis qu’il est chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, qui prône « la rupture », n’a reculé que sur un point : la suppression de deux jours fériés. « Je souhaite que l’on épargne celles et ceux qui travaillent », a-t-il déclaré, le 13 septembre, dans un entretien à plusieurs titres de la presse régionale.
Face à l’intersyndicale ce mercredi, il n’a, semble-t-il, fait aucune promesse concrète – ni concession ni engagement. Et entretenu le flou sur l’avenir d’une énième réforme de l’assurance-chômage, lancée par l’exécutif dans le cœur de l’été alors que de nouvelles règles sont entrées en vigueur au printemps 2025, après un accord arraché il y a moins d’un an par les partenaires sociaux.
« On a compris que ce serait enterré, mais rien de précis », a estimé Sophie Binet, démentie quelques heures plus tard par les représentants du patronat, également reçus par le premier ministre. « La lettre de cadrage [envoyée début août aux partenaires sociaux – ndlr] n’est pas abandonnée, assure Amir Reza-Tofighi, chef du syndicat patronal la CPME. Ils nous font confiance, les partenaires sociaux, pour trouver des voies de passage. »
En théorie, selon la feuille de route, les représentant·es des salarié·es et du patronat ont jusqu’au 15 novembre pour s’entendre, faute de quoi le gouvernement reprendra la main. Mais dès la mi-septembre, Force ouvrière et la CFDT ont engagé un recours en référé devant le Conseil d’État pour contester la légalité de la lettre de cadrage et notamment la dégradation de la trajectoire financière des comptes de l’assurance-chômage, avancée par l’exécutif.
« Énorme meeting » patronal
Pas étonnant, dans ce contexte, que le premier ministre puisse tergiverser, du moins pour le moment, avant de lancer une nouvelle attaque sur les droits des chômeuses et chômeurs – qui serait la sixième depuis 2019. Selon le représentant de l’Union des entreprises de proximité (U2P), Sébastien Lecornu a toutefois abordé la délicate question d’un durcissement des droits en cas de rupture conventionnelle, sujet au menu de la lettre de cadrage.
Au sortir de leur rencontre avec le premier ministre, les représentants du patronat, dont les attentes sont diamétralement opposées à celles de l’intersyndicale, tenaient en tout cas des propos moins acides. « Il nous a écoutés sur les points d’alerte et les propositions, souligne Patrick Martin, président du Medef. Le premier ministre est encore plus conscient que vous et moi que ses marges de manœuvre sont assez étroites. »
Patrick Martin confirme par ailleurs l’organisation d’un grand rassemblement patronal le 13 octobre, « toutes organisations patronales confondues », un « énorme meeting » souhaité par le patron du Medef « pour dire positivement, joyeusement, ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d’être », avait-il clamé la veille, lors d’un évènement organisé par Bpifrance, la banque publique d’investissement.
Tandis que l’intersyndicale réclame plus de « justice fiscale », le patronat appelle à ne pas « sacrifier les entreprises et l’économie » et fustige la taxe Zucman, proposition d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches, sur la table dans le cadre des négociations de non-censure entre Sébastien Lecornu et le Parti socialiste.
« Moi, je ne sais pas danser la Zucmania, et je n’ai pas l’intention de m’y adonner », prévient Patrick Martin, quand Sophie Binet pourfend l’absence de rupture et les « deux heures de langue de bois » à Matignon, ajoutant : « J’aurais été plus efficace à préparer des banderoles. » Une bataille de punchlines qui comble un peu le vide d’un premier ministre qui, pris entre deux feux, n’a toujours rien dit.
mise en ligne le 25septembre 2025
La France d’Emmanuel Macron est engagée sur une pente « illibérale », selon plusieurs ONG
pour les droits de l’Homme
Alexandre Fache sur www.humanite.fr
Dix mois d’enquête pour une conclusion implacable, publiée ce jeudi : plusieurs ONG, dont la FIDH et la LDH, dénoncent les atteintes « systémiques » de l’État français contre les libertés associatives et la liberté de manifester. Une dérive patente depuis l’accession d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Et où la concentration des médias exerce une « influence considérable ». Voici les marqueurs de ce basculement autoritaire.
« La démocratie en France est malade, elle a été infectée par le virus de l’autoritarisme. » C’est une charge implacable mais très documentée que dressent la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), la Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans un rapport publié ce jeudi. Intitulé « France : démocratie en décrochage.
Entraves à l’exercice des libertés associatives et de la liberté de manifester », ce texte de 80 pages, fruit de dix mois d’enquête, étrille littéralement l’attitude de l’État français vis-à-vis des acteurs associatifs depuis qu’Emmanuel Macron a accédé à l’Élysée en 2017.
« Une dégradation profonde et structurelle »
« Depuis plusieurs années, la France connaît une dégradation profonde et structurelle de l’environnement dans lequel la société civile peut s’exprimer et agir, ainsi qu’une régression préoccupante des libertés publiques », estime le document, qui n’hésite pas à employer le terme de « dérive illibérale ». Responsable du bureau Europe de l’Ouest de la FIDH et rédactrice du rapport, Elena Crespi assume le terme.
« Bien sûr, la France n’a pas atteint les reculs démocratiques constatés en Hongrie sous Viktor Orbán, et on ne peut pas la qualifier aujourd’hui de “démocratie illibérale”. Mais en tenant un discours stigmatisant à l’égard des associations qui contestent sa politique et en pratiquant une répression accrue contre les mouvements sociaux, elle en a pris le chemin », résume la chercheuse, spécialiste du droit européen et international.
Les marqueurs d’un basculement autoritaire
La « patrie des droits de l’homme » aurait donc tourné le dos à son histoire ? Le rapport des ONG n’est pas loin de l’affirmer. « Souvent perçue, à tort, comme étant à l’abri de ces tendances en raison de sa tradition républicaine, (…) la France se distingue aujourd’hui par l’ampleur et la gravité des restrictions imposées aux libertés civiques », appuie le document, qui dresse une liste impressionnante de ces reculs démocratiques.
Intégration dans le droit commun de mesures « d’exception » liées à l’état d’urgence, répression violente des gilets jaunes en 2018-2019, de la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023 ou du mouvement contre la réforme des retraites la même année, multiplication des interdictions de manifester et des détentions arbitraires, transformation de dispositions anciennes (« délit de groupement », dissolution administrative) en armes dirigées contre la société civile…
Autant de marqueurs d’un basculement autoritaire, qu’illustrent aussi, selon le rapport, les choix récents du chef de l’État. « En 2024 et 2025, la nomination à trois reprises d’un premier ministre en dehors de la formation politique arrivée en tête lors des élections législatives a accentué la crise de confiance entre les institutions et la population », souligne le document.
Un effet dissuasif sur la société civile dans son ensemble
Mais, avant de se s’intéresser aux actes, c’est d’abord dans les discours du personnel politique que les auteurs de cette enquête ont constaté un « tournant ». Alors que les associations participent à la vitalité démocratique d’un pays, elles sont de plus en plus nombreuses à être présentées par l’exécutif comme un « ennemi intérieur » à combattre. Un épisode marquant de cette dérive est la façon dont Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, avait, en avril 2023, menacé la LDH d’un retrait de ses subventions, en représailles de son rôle d’observateur des pratiques policières pendant les manifestations.
Une offensive reprise depuis par son successeur Place Beauvau : en avril, sur X, Bruno Retailleau avait accusé la LDH de « faire le jeu des narcotrafiquants et des voyous », au motif que l’association avait effectué un recours contre l’utilisation de drones dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, à Rennes.
Le rapport cite aussi les multiples attaques du même ministre contre les associations de défense des exilés ou encore les propos d’Aurore Bergé, en février 2024. La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes avait alors demandé de « passer au crible » les subventions de toutes les associations féministes, celles-ci n’ayant pas, à son goût, suffisamment dénoncé les violences sexuelles commises par le Hamas, le 7 octobre 2023.
Par ces menaces financières, « le gouvernement exerce un contrôle sur le discours et les actions portés par les associations, entraînant un risque élevé d’autocensure et un effet dissuasif sur la société civile », estime le rapport.
L’« influence considérable » des médias de Vincent Bolloré
Or, dans cette bataille, l’exécutif a trouvé des alliés de choix. « Plus de 80 % des médias français sont détenus par une poignée de milliardaires, dont certains utilisent notoirement ces plateformes pour diffuser des idées d’extrême droite », s’inquiètent les ONG, qui visent en particulier le groupe dirigé par Vincent Bolloré.
« Ses médias semblent avoir une influence considérable dans la fabrique d’un narratif disqualifiant à l’encontre des manifestant·es, des défenseur·es des droits humains et du secteur associatif en général », imposant dans l’espace médiatique « l’assimilation de ces acteurs au « wokisme » ou à « l’islamo-gauchisme » ».
Problème : ce discours s’ancre aussi de plus en plus dans notre droit. Ainsi, la loi dite « de séparatisme » d’août 2021, prise en réaction à l’assassinat de Samuel Paty dix mois plus tôt, a donné à l’exécutif un pouvoir de contrôle décuplé sur les associations, par le biais du « contrat d’engagement républicain » imposé à ces structures ou de l’élargissement des critères permettant leur dissolution.
Résultat : sur la centaine de dissolutions prononcées depuis 1936, « une quarantaine l’ont été depuis le début du premier mandat d’Emmanuel Macron », et 27 lors du seul passage de Gérald Darmanin Place Beauvau. Une accélération spectaculaire.
Premiers visés : les soutiens des Palestiniens et les défenseurs de l’environnement
Le rapport note enfin que, dans cette attaque généralisée contre les porteurs de voix critiques, certains acteurs sont particulièrement ciblés. C’est le cas de ceux qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, « objet d’une répression intense, sur le plan administratif et judiciaire », ou des défenseurs de l’environnement, comme l’a montré « l’usage massif et souvent illégal de la force » à Sainte-Soline ou encore la tentative de dissolution des Soulèvements de la Terre.
Ce constat sévère, les ONG à l’origine de ce rapport ne sont pas les seules à le dresser. Dans un essai publié il y a une semaine, L’État contre les associations. Anatomie d’un tournant autoritaire (Textuel), les sociologues Antonio Delfini et Julien Talpin dénoncent eux aussi les attaques de plus en plus récurrentes contre la société civile. « Elles constituent des rappels à l’ordre, des invitations à se tenir sage et à distance de l’engagement politique », qui visent, au final, à « réprimer et bâillonner » tout contre-pouvoir.
mise en ligne le 24 septembre 2025
Dans les hôtels de luxe parisiens, la révolte des femmes et valets de chambre sans papiers
Par Romane Lizée , Nnoman Cadoret sur https://www.streetpress.com/
Ce 22 septembre, à Paris, des anciens employés sans papiers du groupe Hospitality se sont rassemblés devant un hôtel 5 étoiles pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger leur régularisation. Trois employés sont sous le coup d’une OQTF.
Champs-Élysées, 8e arrondissement de Paris – Poings levés et scotch noir sur la bouche, huit femmes et valets de chambre sans papiers, vêtus de leur blouse bleue de travail, se tiennent devant la porte cochère de la luxueuse « Maison Bauchart ». Autour d’eux, une vingtaine de soutiens cégétistes — éboueurs, trieurs de déchet s, conducteurs d’engins de chantier et autres petites mains invisibles —, hurlent en chœur : « Aujourd’hui, sous-traités, demain, embauchés ! »
À travers les fenêtres, planquée derrière de lourds rideaux, la direction de l’établissement cinq étoiles surveille d’un œil inquiet la scène. Des curieux en costard-cravate observent le rassemblement tout en rejoignant la prestigieuse avenue George V. De l’autre côté de la rue, des employés du Prince de Galles — autre 5 étoiles — en pause cigarette se réjouissent de cet élan de solidarité. L’adresse, qui se veut « intimiste » et « hautement confidentielle », où « l’élégance parisienne se chuchote entre initiés », prend soudain un coup de projecteur embarrassant.
En plein cœur du triangle d’or, à deux pas du siège social de LVMH, huit anciens employés sans papiers de la société de nettoyage Hospitality — sous-traitant notamment du leader européen de l’hôtellerie Accor — se sont rassemblés ce 22 septembre. En juin, la direction a suspendu brutalement leur contrat de travail et leur salaire par une mise à pied, à la suite d’un contrôle de l’Urssaff. Depuis, trois employés sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, selon la CGT.
Ils et elles dénoncent des conditions de travail indignes, « un management par le chantage », des « cadences éreintantes » et réclament leur régularisation par l’embauche. Les responsables de la Maison Bauchart se disent « surpris » par les faits énoncés par le syndicat. Ils déclarent à StreetPress être « attachés au respect des personnels qui interviennent au sein de l’établissement » et précisent avoir « immédiatement diligenté une enquête interne sur la situation décrite par la CGT ». À ce jour, ni le groupe Accor ni la société Hospitality n’avaient répondu aux sollicitations de StreetPress.
Amel arrache le scotch de sa bouche et tend son téléphone, sur lequel défilent des photos d’une des chambres de l’hôtel-spa Maison Bauchart :
« À 3.000 euros la nuit, c’est des milliardaires qui viennent dormir ici. Il y a quatre toilettes rien que dans une suite ! »
La quinqua y a passé du temps dans ces lofts, à récurer le sol, à blanchir les draps des lits king size, à approvisionner les grandes vasques de marbre en savon haut de gamme. Arrivée en 2021 en France, elle est entrée à Hospitality en 2022 avec de faux papiers comme gouvernante — ainsi qu’on appelle les encadrants du personnel d’entretien. Durant trois ans, elle a travaillé dans divers hôtels étoilés d’Île-de-France : au LAZ’ Hotel Spa dans le 9e arrondissement, au Tribe à Saint-Ouen (93), au Courtyard by Marriott à Créteil (94) ou encore à Ecla à Villejuif (94)… « Je n’ai jamais refusé une tâche », s’indigne l’ancienne gouvernante, écoeurée.
En mars, elle s’était vue affecté à la remise en état après le chantier d’un Hilton, un palace ouvert avenue de Saxe, dans le 7e arrondissement de Paris. « C’est un travail dur, on reste des heures dans la poussière », explique-t-elle. Celle qui voulait être maîtresse d’école en Tunisie, son pays d’origine, confie, les yeux embués :
« J’ai un bac+3 en sciences fondamentales, géologie et biologie. Mais parce que je ne sais pas tout à fait parler français, je n’ai pas le droit à des conditions de travail dignes ? »
« Quinze minutes par chambre »
Debout face à la table de réunion de l’Union locale CGT du 8e arrondissement de Paris, Abdeljalil, équipier — un poste dédié au nettoyage des espaces communs —, la trentaine, déroule : « sur le papier » 108 heures de travail au mois de juin, payées 12,17 euros brut de l’heure, en tant qu’agent de service confirmé. Lui aussi est en situation irrégulière. En colère, il lance : « Hospitality connaît notre situation, ses méthodes de recrutement sont bien rodées : embaucher des personnes sans papiers parce qu’on est vulnérables. »
« On était exploités, on n’avait même pas le droit à un arrêt maladie », lance Rebiha, Algérienne de 44 ans, employée pendant deux ans par Hospitality. « Parfois, alors que tu es dans le métro pour aller travailler, on t’envoie un SMS pour te demander d’aller finalement dans un autre hôtel. »
Mouna — 32 ans, arrivée de Tunisie il y a trois ans — avait un contrat en CDI à temps partiel avec 5 heures de travail journalières. Autour de la table, elle explique qu’elle aurait travaillé la plupart du temps « 7 ou 8 heures », sans que ses heures supplémentaires soient payées : « Je devais faire parfois 20 chambres en une matinée, une toutes les quinze minutes ! C’est de l’esclavage. »
Maher assure lui aussi ne pas avoir été payé pour les heures de travail supplémentaires effectuées. Il a été dans le BTP et en cuisine pendant huit ans avant d’arriver en France en 2020. Depuis deux ans, il bossait pour Hospitality en tant qu’équipier. Il lâche, dégoûté : « Quand j’ai demandé à être payé, on m’a menacé en me tendant une lettre de démission. On est muselés. »
Les responsables de la Maison Bauchart assurent à StreetPress ne pas avoir connaissance des faits rapportés par le syndicat, et précisent « devoir procéder aux vérifications nécessaires au regard des faits énoncés par ce syndicat ».
« Pas le choix »
À la suite d’un contrôle de l’Urssaff le 26 juin dans un hôtel Mercure à Gennevilliers (92), trois employés sans papiers reçoivent une obligation de quitter le territoire français, rapporte la CGT. Selon les huit anciens employés, Hospitality aurait alors engagé une série de licenciements à l’encontre de ses équipes. Pour Abdeljalil, la société aurait même essayé de « magouiller » : « Ils voulaient nous inciter à démissionner mais on a refusé de signer », assure-t-il. El Hassane, 39 ans, est l’un des trois travailleurs embarqués par la police ce jour-là :
« Vers 11 heures, les agents sont entrés dans une chambre que je nettoyais et m’ont demandé une pièce d’identité. Je n’avais rien à leur montrer… »
Arrivé en 2017 en France et employé pendant trois ans chez Hospitality, El Hassane jure avoir demandé inlassablement un rendez-vous à la préfecture pour obtenir une carte de séjour, en vain. Il compte former un recours.
Depuis les procédures de licenciement, tout le monde se retrouve sur le carreau. « Heureusement, ma sœur, aussi sans papiers et avec un petit salaire, m’aide à payer le loyer et les courses », confie Imane, 29 ans, qui a travaillé deux ans pour la société dans un hôtel à Bois-Colombes (92). Imane, qui était en études de droit au Maroc, a tenté à son arrivée en France en 2021 de s’inscrire à l’université, sans succès. Elle a dû enchaîner les petits boulots, d’abord sur des marchés, puis comme agente d’entretien dans des bureaux :
« Nous, en France, on n’a pas le choix du métier qu’on veut faire. »
Sous-traitance
Maître Marion Stephan, en charge du suivi des procédures de licenciement des huit travailleurs sans papiers, affirme vouloir « faire valoir les droits des personnes auprès de Hospitality comme des hôtels » et assure que ces derniers « étaient parfaitement au courant que parmi ses équipes se trouvaient des personnes sans papiers ». L’avocate ajoute : « Les grandes entreprises ont l’habitude d’utiliser les sous-traitants pour se protéger de ce type de fraude. »
Avant de s’engouffrer dans le métro, le groupe de femmes et de valets de chambre s’arrête devant l’Arc de Triomphe. « On passe souvent par ici, mais on n’a jamais le temps de profiter de la vue », glisse Mouna en prenant des photos. La bande en profite pour scander quelques derniers slogans :
« La lutte des travailleurs, c’est la grève ! »
Le combat d’Amel, Rebiha, Maher, Imane, Fatiha, Abdeljalil, Mouna et El Hassane suit les traces de la grève victorieuse des femmes de chambre sans papiers de l’Ibis Batignolles, la plus longue de l’histoire de l’hôtellerie française, avec vingt-deux mois de conflit entre 2019 et 2021. Cette lutte très médiatisée a essaimé partout en France. En 2024, les employées de la société Acqua, sous-traitant du luxueux Radisson Blu de Marseille, ont obtenu gain de cause au terme de deux mois de grève. En juin, c’était celles des hôtels Campanile et Première Classe de Suresnes, après neuf mois de mobilisation. Selon la CGT, en l’absence d’une réaction des entreprises visées, une autre action serait programmée le jeudi 25 septembre contre Hospitality et ses établissements clients.
La société Hospitality et le groupe Accor n’ont, à ce jour, pas répondu aux questions de StreetPress.
mise en ligne le 24 septembre 2025
Fiscalité, retraites, services publics :
les masques tombent,
le Rassemblement National
est un parti au service exclusif
des patrons et des riches
Florent LE DU et Gaël De Santis sur www.humanite.fr
Depuis 2022, le parti de Marine Le Pen assume son logiciel libéral et retranscrit dans ses propositions les revendications du Medef. Oubliés la retraite à 60 ans et l’ISF, le Rassemblement national est désormais vent debout contre la taxe Zucman et souhaite réduire drastiquement la fiscalité des entreprises et protéger les riches, quitte à sacrifier les services publics.
Quelle mouche a piqué le Rassemblement national (RN) ? Oublié le soutien aux gilets jaunes, le voilà même qui hurle contre les mobilisations sociales de ces derniers jours. Quant au vernis social, c’est à l’heure où s’exprime une puissante aspiration à la justice fiscale dans le pays qu’il craque.
Le parti à la flamme est monté frontalement au créneau contre la taxe Zucman, pourtant approuvée par 86 % des Français, et même 75 % chez ses propres sympathisants… C’est que Jordan Bardella a une stratégie, et s’y tient : il cherche à se faire adouber par le Medef.
Quand le patronat français met le cap à l’extrême droite
Cela porte ses fruits. Fin août, tirant le bilan des Rencontres des entrepreneurs de France, le patron des patrons, Patrick Martin, lâche que « ce sont Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Jordan Bardella qui se sont montrés les plus conscients des périls que l’on rencontre ». La phrase paraît anodine mais elle symbolise un tournant qui pourrait s’avérer dévastateur pour la démocratie et l’idéal républicain.
Car les grands patrons français ont renoncé à combattre l’extrême droite. Pis, certains y voient désormais une opportunité pour mener la politique économique à laquelle ils aspirent. Y compris les prédécesseurs de Patrick Martin à la tête du Medef. Comme Pierre Gattaz, qui avoue avoir « plus peur de Mélenchon que de Bardella », et Geoffroy Roux de Bézieux, qui juge désormais que « le RN vise juste ».
Le même estimait encore en 2022 que le parti d’extrême droite était « dangereux pour le pays ». Si le Medef a appelé à faire barrage à Marine Le Pen en 2022, il ne l’a pas fait en 2024. Une partie du patronat espère même « une coalition de droite et d’extrême droite qui assure la stabilité du champ politique », analyse Ugo Palheta, sociologue et auteur de Comment le fascisme gagne la France.
Marine Le Pen mise sur le pouvoir d’achat pour gagner en crédibilité
Avec des électeurs dans toutes les couches de la population, le RN a un atout, selon le chercheur : « Il a toujours eu une base plus large que celle d’Emmanuel Macron. L’étroitesse de la base de ce dernier est un des éléments qui expliquent l’instabilité politique. »
Comment, en à peine trois ans, cette bascule a-t-elle pu s’opérer ? À la sortie de la présidentielle de 2022, la campagne de Marine Le Pen, largement axée, dans le discours, sur le « pouvoir d’achat », est, en interne, autant saluée que mise en doute. Marine Le Pen acte alors sa nouvelle priorité : « gagner en crédibilité économique. »
Une stratégie qui n’est pas nouvelle à l’extrême droite, rappelle Ugo Palheta. « Une fois qu’elles ont conquis une partie suffisante des classes populaires et moyennes, quand les extrêmes droites s’avoisinent du pouvoir, elles opèrent un rapprochement avec les classes favorisées et le patronat », rappelle le sociologue. Aujourd’hui, le RN drague les électorats LR ou macronistes et courtise l’appui de certains hommes d’affaires.
Une grande opération séduction a été lancée. Un jeu de rencontres, de mots doux et réconfortants, afin que chacun fasse un pas vers l’autre. Convaincre des figures du capitalisme français, mais aussi être vu à leurs côtés pour briser un cordon sanitaire déjà bien effiloché, est un enjeu primordial pour le RN, qui mandate Sébastien Chenu.
Le RN multiplie les rencontres avec le patronat
Le député est ainsi photographié en 2023 aux côtés de Michel-Édouard Leclerc et a noué de nombreux liens, en particulier dans l’agroalimentaire et dans la grande distribution. Le RN fait ensuite fuiter la rencontre entre Henri Proglio, ancien PDG d’EDF, et Marine Le Pen, début 2024.
Celle avec Patrick Martin, qui a bien eu lieu quelques semaines avant les dernières législatives, est, elle, restée secrète jusqu’aux révélations du journaliste Laurent Mauduit dans son livre-enquête Collaborations (la Découverte).
En parallèle, des signaux sont envoyés. Marine Le Pen publie des tribunes dans les Échos, en février 2024, appelant carrément les économistes à « (l’) aider » à affronter le « mur de la dette » en bâtissant un programme fondé sur la réduction des « coûts » de l’immigration et de la « fraude sociale ».
De son côté, Jordan Bardella a participé à des débats ou auditions à l’initiative de quatre organisations patronales différentes depuis trois ans. Il leur a également adressé un courrier, ce mois-ci, pour les rassurer en vue d’une éventuelle dissolution en prétendant « incarner le véritable garant de la stabilité économique ».
Jordan Bardella favorable à la retraite à 67 ans
Les contacts sont établis, reste au RN à convaincre. Dans un premier temps en abandonnant quelques épouvantails. Puisque le programme économique du parti à la flamme avait la réputation d’être « de gauche », ses dirigeants ont vite gommé tout ce qui a pu être perçu de la sorte. Pas grand-chose, en réalité. L’opposition du RN à la réforme des retraites de 2023 n’était que de façade.
La retraite à 60 ans défendue avant 2022 a été abandonnée. Jordan Bardella le martèle dans ses rencontres avec les entrepreneurs, comme lors d’un déjeuner du mouvement Ethic en avril 2024 lors duquel il précise que « selon notre modèle, un jeune qui entre sur le marché du travail à 25 ans partira naturellement à la retraite à 67 ans ».
Une seule proposition portant sur les salaires est encore d’actualité. Mais elle ne consiste qu’à réduire les cotisations patronales – appelées « charges » – en cas d’augmentation de la paie. « Baisser les cotisations sociales pour augmenter les salariés peut paraître sympathique de prime abord. Mais cela ampute les recettes de la Sécurité sociale : assurance-maladie, retraites. Cela se paie en années de cotisation supplémentaires pour la retraite et en baisse des soins », souligne Dany Lang, membre des Économistes atterrés.
Le reste du programme en matière de pouvoir d’achat a été balayé lors de la campagne des législatives de 2024, comme la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la promesse du maintien des 35 heures ou le rétablissement de l’impôt sur la fortune, que les députés RN n’ont pas voté, ensuite, lors de l’examen du budget 2025.
Des baisses d’impôts pour les plus riches
La tendance perçue en juin 2024 se confirme, malgré la défaite au second tour des législatives. Ce projet économique libéral a été renforcé en se tournant quasi exclusivement vers les chefs d’entreprise. L’iconographie d’un document paru en septembre 2024 parle d’elle-même : Marine Le Pen tout sourire aux rencontres du Medef. Le message est clair.
Ce « livret entreprises » est présenté comme une « base de travail en vue des prochaines échéances électorales nationales », explique le RN. Les catégories populaires tentées par le vote Le Pen seraient bien inspirées de le lire : rien dans ce livret n’est prévu pour elles. « Comme toujours dans l’histoire, l’extrême droite se pare d’aspects sociaux, mais fondamentalement, défend les intérêts des plus aisés », tranche Ugo Palheta.
Dans son livret, le parti d’extrême droite propose 20 % de baisse des impôts de production, la suppression de la contribution foncière des entreprises (qui rapporte 9 milliards d’euros par an), l’exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés (5 milliards d’euros) et la valorisation des crédits d’impôt recherche et innovation, aides perçues principalement par des multinationales, sans aucune contrepartie.
« Le RN ne parle jamais des aides massives aux entreprises », souligne Dany Lang. Elles sont pourtant chiffrées à 211 milliards d’euros par une commission sénatoriale dont Fabien Gay, sénateur PCF et directeur de l’Humanité, était le rapporteur.
Une nouvelle marotte, toute libérale, apparaît également : la suppression massive de normes sociales et environnementales, au nom de la sacro-sainte « simplification ». Le tout en réduisant les contre-pouvoirs avec la proposition de faciliter la création de « syndicats maison » qui seraient affranchis des centrales. Et donc seuls face aux pressions. Une manière de lutter contre la « politisation » des organisations représentatives des travailleurs, assume Jean-Philippe Tanguy.
Éric Ciotti pousse pour un capitalisme extrême inspiré de Musk et Milei
Le projet Medef-compatible du RN, qui inclut aussi une baisse de la fiscalité pour les gros héritages et veut autoriser les dons de 100 000 euros tous les dix ans au lieu de quinze aujourd’hui, implique donc des baisses importantes de recettes. Pour prétendre être « le parti le plus raisonnable face à la dette », comme le clame Jordan Bardella, ces cadeaux fiscaux ont pour corollaire une baisse drastique des dépenses publiques. D’autant que, s’inspirant du voisin allemand, l’extrême droite réfléchit aussi à l’introduction de la « règle d’or » budgétaire, soit le respect des 3 % de PIB de déficit public, dans le droit français.
Le livret entreprises, ainsi que le contre-budget présenté en novembre 2024 et les dernières sorties de Jordan Bardella et Marine Le Pen, donnent un aperçu de ce que ferait l’extrême droite au pouvoir : de l’austérité. « Plus de 100 milliards d’euros peuvent être économisés en mettant fin à l’immigration d’assistanat, au subventionnement des énergies intermittentes, à l’excès de l’aide publique au développement d’autres pays ou encore au millefeuille administratif ainsi qu’au coût exorbitant de la bureaucratie d’État », revendique le président du RN dans sa lettre aux entrepreneurs.
Mais sur ces économies, peu d’éléments sont chiffrés. Et quand des détails sont accessibles, ils présagent d’effets délétères. Dans son contre-budget, le parti à la flamme propose par exemple de supprimer 2 000 postes d’enseignant et de diminuer de 23 à 18 % le personnel non enseignant dans l’éducation nationale, alors même que les AESH, psychologues ou infirmières scolaires travaillent déjà dans des conditions dégradées en raison de leur faible effectif.
Fait important : le livret sur les entreprises ainsi que le contre-budget du RN ont été rédigés par Jean-Philippe Tanguy. Soit le plus protectionniste des cadres du parti, quand Jordan Bardella représente la frange la plus néolibérale. C’est dire si ce dernier a pris la main sur la ligne économique officielle du parti, qui pourrait même aller plus loin sans l’influence des derniers partisans de mesures de régulation.
Nouvel allié du RN, Éric Ciotti, qui se veut le représentant en France du capitalisme sauvage et déshumanisé des libertariens comme Javier Milei ou Elon Musk, pousse en outre pour que le RN s’engouffre dans cette voie. Prêt à sortir la tronçonneuse contre les services publics et les prestations sociales. Et à cracher au visage d’un électorat populaire que le RN veut plus que jamais berner.
mise en ligne le 23 septembre 2025
Polémique Bernard Arnault : non, la taxe Zucman n’est pas confiscatoire
Jérôme Gleizes sur www.politis.fr
Le magnat du luxe voit le prélèvement de 2 % comme une attaque « mortelle contre l’économie française ». Elle ne serait pourtant que le rattrapage d’une anomalie fiscale persistante : les plus riches paient en réalité une part d’impôt inférieure à celle des classes moyennes et populaires.
La controverse entre l’économiste Gabriel Zucman et Bernard Arnault, première fortune française et parfois mondiale, illustre à elle seule ma chronique du 17 février 2025, « Défaire la ploutocratie ». Le polytechnicien devenu magnat du luxe après avoir racheté et morcelé le groupe textile Boussac traite de « militant d’extrême gauche » le normalien, professeur à l’Université de Berkeley, à la London School of Economics et à l’ENS Ulm.
Il dénonce la « taxe Zucman » comme une attaque « mortelle pour l’économie française » alors qu’elle était défendue par sept Prix Nobel d’économie dans une tribune publiée dans Le Monde en juillet dernier ! Nous sommes loin d’une expropriation pour plutôt rétablir une justice fiscale, sans commune mesure avec les dispositifs vraiment confiscatoires du passé, comme celui du président des États-Unis d’Amérique, Franklin D. Roosevelt, qui porta le taux marginal de l’impôt sur les plus hauts revenus à 91 % en 1941.
Restaurer l’équité fiscale
Dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en 2025, ce nouvel impôt s’applique uniquement aux patrimoines nets, qu’ils soient immobiliers ou professionnels, supérieurs à 100 millions d’euros. Son mécanisme repose sur un principe de rattrapage : il garantit que le total des impôts acquittés par les ultra-riches atteigne au moins 2 % de la valeur du patrimoine concerné.
Si la somme de ces contributions est inférieure à ce seuil, la taxe Zucman complète la différence pour atteindre ce niveau plancher. Il ne s’agit donc pas d’un prélèvement confiscatoire absolu, mais d’un impôt différentiellement ajusté pour restaurer l’équité fiscale face aux effets de l’optimisation des plus grandes fortunes françaises.
La concentration des richesses surpasse de loin la croissance économique globale du pays.
Ce rattrapage résulte d’une anomalie fiscale persistante : les plus riches paient en réalité une part d’impôt inférieure à celle des classes moyennes et populaires, alors que le principe de progressivité de l’impôt voudrait que la charge fiscale augmente avec la richesse. Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (note n° 92 de l’IPP) « le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % des foyers les plus riches à seulement 26 % pour les 0,0002 % les plus riches ».
Cette inversion s’explique par la composition des revenus au sommet de la pyramide économique, majoritairement constitués aujourd’hui de bénéfices non distribués issus des sociétés détenues par ces fortunes, lesquels ne sont imposés qu’au niveau de l’impôt sur les sociétés, dont le taux est sensiblement inférieur à celui de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les milliardaires acquittent relativement peu d’impôt personnel direct.
Un patrimoine des 500 plus grandes fortunes multiplié par 14
Surgit alors Mistral AI, valorisée à plus de 11,7 milliards d’euros en deux ans. Elle est régulièrement citée comme contre-exemple pour relativiser la nécessité d’une taxe sur les très grandes fortunes. Si son ascension fulgurante témoigne d’une réelle capacité d’innovation et de succès entrepreneurial, elle reste néanmoins une exception dans le paysage patrimonial national.
Car le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a été multiplié par plus de 14 depuis les années 1990, avec une croissance annuelle de 9,55 %, alors que le PIB français n’a progressé que d’un facteur 2,4 (3,06 % par an) sur la même période. L’exception Mistral AI ne suffit donc pas à masquer la dynamique de concentration des richesses, devenue structurelle, qui surpasse de loin la croissance économique globale du pays.
Prélever 2 % au cas où aucun impôt ne serait payé n’empêchera pas d’accroître le patrimoine des 500 premières fortunes.
Prélever 2 % au cas où aucun impôt ne serait payé n’empêchera pas d’accroître le patrimoine des 500 premières fortunes, et si ce patrimoine est trop sensible à la valorisation boursière, alors il suffirait de le lisser dans le temps.
mise en ligne le 23 septembre 2025
Palestine : et Macron fit quelque chose
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Hier soir à la tribune des Nations unies, la France, par la voix de son président, a reconnu l’État Palestinien. En attendant que les Français organisent enfin une manifestation digne de ce nom.
Cette reconnaissance de l’État de Palestine, Emmanuel Macron l’a fondée sur l’histoire, celle qui en 1947 disait le droit des peuples juif et palestinien à un État et à l’autodétermination. Cette « promesse d’un État arabe, elle, reste à ce jour inachevé ». Le président français a su trouver les mots pour parler du peuple palestinien lui-même. « Cette reconnaissance est une manière d’affirmer que le peuple Palestinien n’est pas un peuple en trop. Qu’il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien pour parler comme Mahmoud Darwich. Un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. »
Ce discours, il le prononçait dans un moment dramatique pour les Palestiniens, celui d’un génocide en cours assorti d’une offensive israélienne pour empêcher jamais l’établissement de leur État : « Le temps de la paix est venu car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir […] Nous savons le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit, toujours doit l’emporter sur la force », a dit le chef de l’État.
Ce rappel de la promesse initiale est fondamental pour maintenir un possible futur. Le premier ministre canadien le disait en ces mots : « Alors que la politique déclarée du gouvernement israélien est qu’il n’y aura jamais d’État palestinien […] ce que nous essayons d’accomplir, c’est de garder cette question sur le devant de la scène ».
Nul ne croit que les reconnaissances qui ont eu lieu ces jours, rompant avec la forte unité occidentale, est un aboutissement. Mais alors que la question palestinienne avait disparu de la scène internationale, ensevelie dans le silence et les accords d’Abraham, elle revient au premier plan. La mobilisation des opinions publiques – en particulier arabes – ont forcé leurs États à ne pas entériner ce qui aurait provoqué l’irréversible pour les Palestiniens.
Les opinions publiques européennes aussi se sont mobilisées par centaines de milliers à La Haye, en Espagne, à Londres, en Italie hier, forçant à poser la question des sanctions de l’UE à l’égard d’Israël. Elles sont enfin à l’agenda. Dans ces circonstances, il y a quelque chose de paradoxal dans la faible mobilisation de l’opinion publique française, dans sa division même.
Dans ce pays qui a pratiqué un antisémitisme officiel et qui est rongé par cette honte indélébile, les accusations d’antisémitisme proférées à l’encontre des militants de la cause palestinienne ont été une tâche et un lourd empêchement. Des manifestations ont été interdites pour ce motif. Ironie, c’est Emmanuel Macron lui-même qui doit se défendre et défendre notre pays d’antisémitisme face aux attaques du pouvoir israélien. L’essentialisation de nos concitoyens arabes ou musulmans, leur identification à des antisémites dormants ou militants, est un poison devenu banalité sur les plateaux télé. L’assimilation dégueulasse de La France insoumise à un antisémitisme électoraliste est l’argument brandi pour sa mise à l’écart, alors que le RN est lavé du passé… et du présent de ses élus et militants.
Tout ceci est vrai et a conduit à inhiber les soutiens aux Palestiniens. Mais les militants en France ne sont pas les seuls à avoir connu répression et accusations ignominieuses. En Angleterre, par exemple, une association propalestinienne a été dissoute et des centaines de ses soutiens arrêtés. En France, comme pour d’autres luttes, la division est venue d’insultes, de propos agressifs, blessants. La France insoumise a choisi de faire de ce combat, non un terrain de rassemblement, mais un objet de clivage avec le reste de la gauche. Hélas, cela a été facilité par les autres partis. Ceux qui ont appelé à interdire les manifestations – hein Carole, on n’oublie pas. Ceux qui ont déserté la rue, en particulier la direction communiste qui, historiquement, était aux premières loges des mobilisations. Un jour, on fera les comptes. En attendant, les maires en hissant le drapeau palestinien au fronton des mairies, les supporters du PSG avec leurs banderoles et leurs tifos, sauvent l’honneur. Merci à eux. Il est plus que temps pour la gauche politique de se ressaisir, là aussi.
mise en ligne le 22 septembre 2025
Taxe Zucman :
sur l’imposition des riches, le RN s’aligne
sur la Macronie et le Medef
Gaël De Santis sur www.humanite.fr
Tout à sa stratégie de séduction auprès du patronat, le Rassemblement national (RN) refuse toute taxe Zucman et ne propose qu’une fiscalité cosmétique du patrimoine.
Une fois n’est pas coutume, le Rassemblement national (RN) se soumet à l’absence de contrôle aux frontières. Interrogé mercredi sur LCI sur le fait que les contribuables qui seraient assujettis à la taxe Zucman pourraient partir, Jean-Philippe Tanguy a pris acte que la porte est grand ouverte pour les fortunés, sans demander que soient érigées des barrières. « Évidemment qu’ils peuvent partir, puisque ce sont les plus favorisés. (…) Il y a une liberté des capitaux dans le monde construit par Macron ou ses prédécesseurs », a déclaré le monsieur économie du RN.
Et voilà donc l’extrême droite qui participe à son tour à délégitimer cette mesure de justice fiscale et sociale réclamée par la gauche, qui contraindrait les grandes fortunes à s’acquitter d’un impôt plancher au moins équivalent à 2 % de leur patrimoine.
Le député RN ne voit dans cette proposition qu’un outil de communication de la gauche et dévoile le fond de sa pensée : haro sur les services publics ! « Ce qui m’a beaucoup choqué dans la taxe Zucman », c’est que « cela empêche de parler des 57 % de dépenses (publiques) dans le PIB », avance Jean-Philippe Tanguy.
Sur le réseau social X, le député de la Somme indique dans la foulée que la priorité pour le RN n’est pas de trouver de nouvelles recettes, mais, à l’instar des macronistes, de « baisser les mauvaises dépenses et les taxes sur les classes moyennes/populaires ainsi que de favoriser le « produire en France » ». Pour combattre l’austérité et défendre les services publics, le RN répond donc une fois de plus aux abonnés absents.
Car, au RN, on n’a qu’une envie : grand-remplacer une Macronie qui se débat pour conserver son titre de meilleur chien de garde du capital. En vue de s’attirer les bonnes grâces du patronat, le président du RN, Jordan Bardella, s’est fendu début septembre d’une lettre aux entrepreneurs dans laquelle il déroule les arguments les plus libéraux. Jusqu’à promettre une réduction de la « mauvaise dépense publique » (ainsi sont appelés les pseudo-coûts de l’immigration et de « l’assistanat »), un allègement du « fardeau normatif », et une fiscalité avantageuse pour le capital par une baisse des « impôts de production » de 20 %.
Autant dire que lors de la rencontre de la délégation du parti postpétainiste avec le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, mercredi, la fiscalité sur le patrimoine n’était pas au cœur des demandes. Démagogue, Marine Le Pen y a rappelé que pendant la dernière campagne présidentielle elle avait « fait la proposition d’un impôt sur la fortune financière » en remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière.
Un impôt qu’elle vide toutefois de toute substance, précisant sur le perron de Matignon : « Nous préservons les biens professionnels », derrière lesquels se cachent les milliardaires. Dans son projet de contre-budget en 2024, le RN comptait sur cette mesure pour rapporter 3 milliards d’euros. Soit bien moins qu’une taxe Zucman, qui fournirait 20 milliards d’euros aux caisses de l’État. Dès lors qu’il s’agit de s’en prendre aux riches, le RN est gagne-petit.
mise en ligne le 22 septembre 2025
COP30 : la trajectoire climatique européenne s’embourbe, la faute à la France qui trouble le jeu
Antoine Portoles sur www.humanite.fr
COP30 - À moins de deux mois du prochain sommet onusien sur le climat, les États membres de l’Union européenne sont incapables de se mettre d’accord sur un objectif clair de décarbonation, au risque de mettre en péril l’accord de Paris. Une situation provoquée par la France, qui cherche à remodeler l’objectif climatique 2040 de l’UE à sa guise.
Les leaders européens nous feraient-ils le coup de la panne ? Longtemps fixée comme une priorité à l’agenda de l’Union européenne (UE), la lutte contre le réchauffement planétaire a depuis été reléguée au profit de la compétitivité et de la course à l’armement.
Ce constat amer découle de l’impasse à laquelle sont actuellement confrontés les Vingt-Sept, dont les ministres respectifs de l’Environnement se sont réunis, jeudi, à Bruxelles, pour tenter d’accoucher d’un objectif climatique européen à horizon 2040. De cette ambition devait être tirée une cible commune de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2035, telle qu’exigée en vertu de l’accord de Paris, aussi nommée les contributions déterminées au niveau national (NDC).
La trajectoire climatique, un point d’achoppement entre les États membres
Les États sont censés les soumettre ou les mettre à jour tous les cinq ans auprès des Nations unies, en l’occurrence d’ici le 24 septembre, à l’occasion de l’Assemblée générale, à New York, mais surtout en vue de la COP30, qui débutera le 10 novembre, à Belém (Brésil).
Alors que les NDC sont un enjeu primordial, avant tout parce qu’elles constituent l’instrument de planification de la baisse des émissions de CO2, force est de constater qu’à l’issue de la réunion des ministres européens de l’Environnement, l’échec est cuisant, tant cette question de la trajectoire climatique à adopter est devenue un point d’achoppement entre les États membres.
La base de négociations étant l’objectif établi par la Commission, à savoir une décarbonation de l’Europe à hauteur de – 90 % en 2040, pour atterrir sur la neutralité carbone en 2050.
Pour sauver les meubles, le Danemark, qui occupe la présidence tournante de l’UE, s’est contenté d’une « déclaration d’intention » : la présentation d’une fourchette de baisse des émissions linéaire pour les dix ans à venir, entre – 66,3 % et – 72,5 % par rapport à 1990. Ce qui permettrait ainsi de gagner un peu de temps et d’espérer arracher un compromis plus précis d’ici le sommet onusien brésilien.
Stratégie gagnante ou vœu pieux ? C’est en tout cas cette fourchette intermédiaire que l’hyperprésidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait porter à l’ONU dès la semaine prochaine. « Au bout du compte, nous continuerons d’être soit les plus ambitieux, soit parmi les plus ambitieux », s’est vanté, jeudi, Wopke Hoekstra, commissaire européen au Climat. C’est ce qui s’appelle se leurrer.
Derrière cette léthargie ambiante se joue un blocage institutionnel mené de front par la France, accompagnée notamment par la Pologne, la Hongrie ou encore l’Italie. Et Berlin a désormais rejoint Paris dans son exigence que « la discussion n’ait pas lieu de manière ordinaire – soit au travers du Conseil des ministres de jeudi – mais au niveau du Conseil européen, avec les chefs d’État et de gouvernement », souligne à l’Humanité Neil Makaroff, directeur du think tank Strategic Perspectives.
Cela impliquerait un vote non plus à la majorité qualifiée des ministres de l’Environnement, mais à l’unanimité des Vingt-Sept, les 23 et 24 octobre prochains. « Il s’agit pour eux de faire monter les enchères pour parvenir à un accord, quitte à le faire capoter, ajoute-t-il. C’est un pari extrêmement risqué pour la crédibilité de l’UE. »
Un backlash écologique en corrélation avec la montée de l’extrême droite
La France cherche en réalité à remodeler l’objectif climatique 2040 de l’UE à sa guise, en réclamant des garanties sur le financement de la décarbonation de l’industrie, sur la réindustrialisation, mais aussi sur la prise en compte du nucléaire – au cœur du mix énergétique français – parmi les sources de décarbonation. Sur cette dernière condition, la Commission lui a concédé des avancées. Mais le compte n’y est toujours pas.
Au-delà d’Emmanuel Macron, pour certains responsables européens tels que le nationaliste Viktor Orbán en Hongrie, le véritable dessein de cette fronde n’est pas d’obtenir de la flexibilité sur les engagements climatiques, mais bien de les torpiller. L’accord de Paris, qui fête cette année ses 10 ans, est donc en train de faire l’objet d’un jeu de dupes. La principale conséquence de ce brouillage est que les États membres « pourraient être les derniers à porter un objectif clair à la COP30 » ou, dans le pire des scénarios, qu’il n’y ait tout simplement « pas d’accord », craint Neil Makaroff.
Le temps où l’Europe était la mieux-disante sur les enjeux climatiques semble révolu. D’autant que cet imbroglio s’ajoute à d’autres reculs, à l’instar du détricotage du Pacte vert par la très droitière Commission européenne, ainsi que du deal inique UE – États-Unis convenu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen dans le dos des Vingt-Sept. Telles sont les occurrences d’un backlash écologique en corrélation avec la montée de l’extrême droite sur le continent. Ce qui est certain, c’est que la perte du leadership européen en matière de climat aura un impact notable à Belém, en novembre.
mise en ligne le 22 septembre 2025
« J’étais le seul à savoir lire et écrire » :
victoire des grévistes du nettoyage chez Vitacuire
Guillaume Bernard sur https://rapportsdeforce.fr/
« J’étais le seul à savoir lire et écrire, les responsables en profitaient », confie Abdoul Traoré, éprouvé par ses six journées de grève sur le site de Vitacuire. Depuis le 9 septembre 2025 au soir, cet agent d’entretien chez Atalian et une dizaine de ses collègues, se sont lancés dans une lutte pour dénoncer leurs conditions de travail. Employés par le donneur d’ordre Vitacuire (fabrication de feuilletés surgelés) à Meyzieux (69), ils sont astreints au nettoyage des machines et du sol. « Nous ne sommes que des étrangers. Une fois, un Français est venu travailler avec nous, il a pris le balais…et il est vite parti tellement il y avait de la poussière », continue Abdoul Traore. Horaires de nuits, travail physique, mépris de ses supérieurs d’Atalian constituent leur quotidien.
« Deux salariés ont été agressés sur leur lieu de travail, aucune mesure à la hauteur des faits n’a été prise par la direction », dénonce la CNT-SO, syndicat qui les a épaulés pendant la grève. « Nous avons tenu le piquet tous les matins de 8 heures à midi. On a reçu beaucoup de soutien et ça nous a fait du bien. Finalement, on a gagné sur toutes nos revendications. » Parmi les prises de grève : augmentation du salaire horaire, mise en place d’un dispositif de primes allant jusqu’à 1000€ brut annuelle, requalifications de CDD en CDI et déclenchement d’une enquête interne sur les conditions de travail.
mise en ligne le 21 septembre 2025
État de Palestine,
le tournant ?
Francis Wurtz sur www.humanite.fr
« Il n’y aura pas d’État palestinien : cet endroit nous appartient » : en prononçant ces paroles sur le lieu le plus emblématique de la colonisation de la Cisjordanie – car destiné à couper le territoire palestinien en deux pour tenter de rendre physiquement impossible l’édification d’un État autre que celui de l’occupant –, Netanyahou ne pouvait pas se montrer plus provocateur face au groupe d’États occidentaux, considérés jusqu’alors comme des alliés indéfectibles d’Israël, mais qui s’apprêtent à leur tour à reconnaître l’État de Palestine.
Les voici – France en tête – placés spectaculairement devant leurs responsabilités : ils vont devoir montrer à toute la communauté internationale ce que vaut leur acte diplomatique, tant de fois repoussé, mais que l’isolement sans précédent de ce pouvoir assassin dans l’opinion mondiale a rendu incontournable. Quelles mesures vont-ils prendre pour que soit mis fin au génocide à Gaza (1) et à l’entreprise coloniale d’Israël dans sa globalité ?
En finir avec l’occupation et la colonisation des territoires palestiniens.
Vont-ils laisser définitivement démonétiser leur parole collective en capitulant ouvertement devant ce politicien hors la loi, ou auront-ils cette fois à cœur de concrétiser leur engagement rituel en faveur de la « solution à deux États » ? Désormais, plus d’échappatoire. Aucune nouvelle lâcheté de leur part ne passera inaperçue. Tous les amis du peuple palestinien, tout comme les militants de la paix en Israël, y veilleront, et, au-delà, quiconque ne supporte plus le « deux poids, deux mesures » en matière de droit international sera, n’en doutons pas, aux aguets.
Emmanuel Macron est, à cet égard, le plus exposé. Lui qui revendique le « leadership » européen en matière de sanctions économiques contre Moscou, de livraisons d’armes à Kiev et d’envoi de troupes au sol en Ukraine, face à « l’ogre qui a besoin de continuer à manger » pour survivre. Que va-t-il proposer concernant l’« ogre » de Tel-Aviv, qui, de Gaza à la Cisjordanie, du Liban à l’Iran, de la Syrie au Yémen et jusqu’au Qatar, sème la mort et attise les tensions alors qu’une seule décision suffirait à créer les conditions d’une paix durable en Israël comme dans toute la région : en finir avec l’occupation et la colonisation des territoires palestiniens, conformément aux résolutions des Nations unies adoptées depuis 1967 !
Observons que, dans ce cas, nul ne demande que l’on recourt, pour obtenir une paix juste, à la livraison de chars, d’avions de chasse, de drones, de missiles ni de munitions aux Palestiniens occupés et martyrisés. Ce que demandent les Palestiniens depuis des décennies n’est autre que l’arrêt de toute vente d’armes à l’agresseur ainsi que l’exercice de pressions économiques et politiques suffisantes sur le pouvoir israélien pour obtenir l’ouverture de véritables négociations de paix sur la base du droit international.
Avec pour objectif l’édification de l’État palestinien à côté de l’État d’Israël, dans des frontières sûres et reconnues. Rendre enfin possible ce rêve simple et raisonnable : c’est tout l’enjeu que la désormais très large reconnaissance de l’État de Palestine remet à l’ordre du jour de l’agenda diplomatique mondial.
Je veux rendre hommage à José Fort, ce grand journaliste de l’Humanité, dont il dirigea longtemps avec compétence et sensibilité la rubrique internationale.
(1) « J’ai refusé pendant des années d’utiliser ce terme : « génocide ». Mais maintenant je ne peux pas m’empêcher de l’utiliser, après ce que j’ai lu dans les journaux, après les images que j’ai vues et après avoir parlé avec des personnes qui y ont été » (David Grossman, écrivain israélien, 1er août 2025).
mise en ligne le 20 septembre 2025
18 septembre :
des agressions
d’extrême droite
à Montpellier
en toute impunité
La rédaction sur https://rapportsdeforce.fr/
Trois personnes ont été blessées à Montpellier dans le quartier des Beaux-Arts ce jeudi 18 septembre, dont deux ont dû être conduites aux urgences. Des militants d’extrême droite ont provoqué de multiples altercations, plusieurs heures durant, sans que la police ne procède à leur interpellation.
Tout commence alors que la manifestation intersyndicale qui a réuni, selon les sources, entre 10000 et 20000 personnes à Montpellier, prend fin sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Non loin de là, devant le lycée Joffre bloqué depuis le matin, des lycéens voient arriver un petit groupe d’hommes au comportement étrange. « Ils ont bougé des poubelles du blocage et sont partis. On les a suivis vers le parking et on les a vu avec des motards de la police » explique Jordan*, lycéen dans l’établissement. Convaincu alors qu’il s’agit de policiers de la BAC, il prévient ses amis sur le blocage. Peu de temps après, une vingtaine d’hommes reviennent en direction du lycée, provoquent les jeunes et sortent un drapeau bleu-blanc-rouge. « Grosse pute, va faire la vaisselle, va te faire pousser les seins… », les insultes sexistes pleuvent, comme en atteste une vidéo que nous avons pu visionner.
Ce n’est que le début de leur périple. Ils se dirigent alors vers la manifestation intersyndicale, où les camions syndicaux sont déjà partis. Alors que quelques centaines de personnes tardent à quitter les lieux, les vingt-cinq jeunes hommes habillés de noir, visage dissimulé pour certains, déboulent d’un pas décidé, rangés derrière un drapeau français. L’inquiétude et la tension montent en un instant parmi les manifestants encore rassemblés. Très rapidement, les slogans « siamo tutti antifascisti » répondent à leur présence et à quelques doigts d’honneur.
Une longue expédition violente
Le groupe en partie cagoulé se dirige et atteint le centre de la place de la Comédie, malgré un dispositif policier hors normes pour la capitale languedocienne. Ils sont suivis par deux cents manifestants qui entonnent des slogans antifascistes. Parmi eux figurent plusieurs militants d’extrême droite,dont Tristan V – le seul à porter un tee-shirt vert au lieu de vêtements sombres. C’est un identitaire du groupe montpelliérain Jeune d’Oc, qui avait participé au service d’ordre de Génération Identitaire avant sa dissolution. Le reste du groupe serait composé de membre de la Butte Paillade – un groupe de supporteur du club de football de la ville – selon plusieurs témoignages que nous avons pu recueillir.
Après quelques minutes d’un face à face tendu, des CRS viennent se placer devant les manifestants, puis exfiltrent le groupe provocateur. Conduits derrière une ligne de gardes mobiles qui bloquent l’entrée dans le cœur de la ville, il n’attendront que 10 minutes avant de pouvoir repartir libre. Malgré leur visage dissimulé pour certains, ils ne semble pas avoir été contraints à décliner leur identité. Questionnée sur ce point, la préfecture de police ne nous a pas répondu, se contentant d’expliquer que « les forces de l’ordre sont intervenues en début d’après midi sur la place de la Comédie à Montpellier pour séparer deux groupes antagonistes (ultra droite et ultra gauche), l’objectif visé était d’éviter tout affrontement sur ce lieu ».
Leurs méfaits auraient du s’arrêter-là, mais il n’en a rien été. Vers 15h, alors que des jeunes manifestants tentent encore des actions de blocage, une partie du groupe est aperçu place de l’Esplanade. Là, trois membres de l’Observatoire des libertés de Montpellier (association qui documente les interventions de la police dans les manifestations) sont agressés, comme en atteste la vidéo publiée par nos confrères du Poing. La police présente au plus près de l’action ne procède à aucune interpellation.
Le groupe violent s’offre son bouquet final peu de temps après. « J’étais attablée avec des amis à la terrasse d’un café sur la place des Beaux-Arts. Là, sont arrivés une vingtaine de mecs qui se sont assis derrière nous. Ils étaient inquiétants, j’ai dit à mes amis « on dirait des fachos », explique Marie*. Elle n’est pas la seule à le penser sur cette terrasse assez déserte à cette heure-là.
«J’ai un ami qui est allé les voir pour leur dire qu’on ne voulait pas de fachos dans notre bar et c’est parti tout de suite » assure Antoine* qui a tenté de calmer les choses et de s’interposer. « L’un deux a donné un coup et ensuite les vingt s’y sont mis » se remémore Marie, encore choquée.
Après une avalanche de coups prodigués par une vingtaine de militants d’extrême droite et de supporteurs de foot, on dénombre trois blessés. Deux d’entre eux ont été conduits aux urgences. L’un souffre de plusieurs fractures au visage. « Quelqu’un a appelé la police qui est arrivée assez rapidement », explique Marie. Effectivement, sur une vidéo que nous avons pu consulter, on voit les assaillants fuir et des policiers leur courir après. Pour autant, là encore, malgré un dispositif conséquent déployé sur l’ensemble de la ville, la préfecture n’indique pas avoir procédé à des interpellations.
« Quand je repasse la scène dans ma tête, ça me fait peur », avoue Antoine. Il envisage de se lancer dans une action collective et de porter plainte une fois sorti de l’hôpital.
* les prénoms ont été modifiés.
mise en ligne le 20 septembre 2025
Une dynamique
est enclenchée !
chronique de Maryse Dumas sur www.humanite.fr
« Tout bloquer », c’était le mot d’ordre du 10 septembre. Si le mouvement né sur les réseaux sociaux pendant l’été est loin d’avoir atteint l’objectif affirmé, il n’en a pas moins marqué la rentrée sociale et politique : 550 rassemblements, 262 blocages ou tentatives recensés par le ministère de l’intérieur, 250 000 manifestant.es selon la CGT, voilà une active mise en bouche pour la journée intersyndicale de grèves et manifestations du 18 septembre. Cette rentrée sociale inédite a déjà à son actif le départ, de son propre aveu, de François Bayrou. Elle conduit aussi le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, à parler de nécessaire « rupture ».
Amusant de la part de quelqu’un qui, sans interruption depuis 2017, a fait partie de tous les gouvernements Macron et s’affirme comme l’un de ses bras droits, bien à sa droite. Pourtant ne boudons pas notre plaisir et remarquons que l’emploi de ce seul mot « rupture », malgré toute l’intention manœuvrière qu’il comporte, reflète la crainte du pouvoir de voir la France populaire et laborieuse se lever pour mettre à bas sa politique.
Du coup, quelque chose change dans le climat ambiant. Les cartes paraissent rebattues : on reparle des retraites, de la pénibilité, de la taxe Zucman sur les plus gros patrimoines, de l’investissement de long terme. Tous sujets totalement écartés par les comptes d’apothicaires de François Bayrou que le 10 septembre et la perspective du 18 viennent de remettre en chantier.
Pour déployer les potentialités nouvelles de la situation, il faut en analyser les caractéristiques. Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement citoyen naît sur les réseaux. Avant « Bloquons tout », il y a eu les « indignés », Nuit debout et pour une part les gilets jaunes. Tous ces mouvements ont pour caractéristique commune de situer leur action dans l’espace public, et non sur les lieux de travail.
Ils interpellent directement le pouvoir politique mais laissent tranquille le patronat. Ils se situent en dehors du périmètre syndical tant du fait de leur dynamique propre, à la frontière du politique et du social, qu’en raison d’une méfiance aiguë vis-à-vis des organisations quand bien même elles sont syndicales, de luttes, et respectueuses de leur autonomie de décision.
Les personnes concernées et agissantes sont elles-mêmes aux frontières du salariat : beaucoup d’autoentrepreneurs, de personnes en précarité ou de salarié·es dépendant de très petites entreprises, voire de particuliers employeurs, pour les gilets jaunes, davantage d’étudiant·es, de lycéen·nes, de personnes du monde de la culture pour Nuit debout ou « Bloquons tout ».
Ce qui est nouveau en cette rentrée, c’est qu’à l’appui de l’expérience du mouvement des retraites, des rencontres ont pu se faire. Les organisations de la CGT ont été fortement sollicitées pour apporter leur concours tant en matière de logistique que de savoir-faire : organiser des rassemblements, des manifs et même des blocages, cela s’apprend. Ces rencontres ont permis des échanges fructueux permettant de dépasser les méconnaissances, voire les méfiances réciproques.
À n’en pas douter cela sera porteur pour la suite. Car ne nous cachons pas que le plus dur est devant nous : gagner la grève sur les lieux de travail et des participations massives aux manifestations intersyndicales. Une dynamique est enclenchée, dans laquelle nous pouvons puiser l’énergie nécessaire pour relever le défi.
mise en ligne le 19 septembre 2025
Après le succès du 18 septembre, l’intersyndicale lance un « ultimatum » au premier ministre Sébastien Lecornu pour le 24 septembre
Julia Hamlaoui sur www.humanite.fr
Après le succès de la mobilisation du 18 septembre, avec un million de manifestants selon les syndicats, le premier ministre Sébastien Lecornu s’est engagé… à de nouvelles « consultations ». Face à l’absence de réponse sur l’exigence de justice fiscale, sociale et écologique qui s’est exprimée avec force jeudi, l’intersyndicale, laisse cinq jours, soit le 24 septembre, au locataire de Matignon pour revenir vers elles avec des propositions qui y répondent. À défaut, une « nouvelle journée de grève et de manifestations » sera décidée.
Un million de manifestants dans plus de 250 rassemblements, selon les syndicats, et le premier ministre s’engage à… de nouvelles « consultations ». « Je recevrai à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent », a écrit sur X Sébastien Lecornu à l’issue de la journée de mobilisation du jeudi 18 septembre. S’il assure – sans plus de détails – que « les revendications portées par les représentants des organisations syndicales et relayées par les manifestants dans les cortèges sont au cœur de (ses) consultations », le locataire de Matignon s’emploie dans la suite de son message, à l’instar du ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, à braquer les projecteurs sur la « violence » qui n’a pourtant pas caractérisé les manifestations.
Pour l’heure sans réponse de l’exécutif face à l’exigence de justice fiscale, sociale et écologique qui s’est exprimée avec force jeudi, l’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires), réunie ce vendredi matin, laisse cinq jours, soit le 24 septembre, au locataire de Matignon pour revenir vers elles avec des propositions qui y répondent. À défaut, une « nouvelle journée de grève et de manifestations » sera décidée.
« La balle est maintenant dans le camp du premier ministre »
Se félicitant du « succès de la journée de mobilisation interprofessionnelle et unitaire du 18 septembre avec un million de manifestant.es et de grévistes dans toute la France », les syndicats estiment, dans un communiqué commun, que celle-ci « démontre que le compte n’y est toujours pas » même si l’exécutif, face à la pression, est déjà revenu sur son intention de supprimer deux jours fériés.
Et de rappeler leurs revendications : « l’abandon de l’ensemble du projet de budget », « la justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines, les très hauts revenus et contraignent le versement des dividendes », « la conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises privées », « des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics », « l’abandon du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans », « des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation ». « La balle est maintenant dans le camp du premier ministre », soulignent les centrales syndicales.
Elles pointent également, dans leur texte, « la responsabilité du patronat et exigent l’ouverture de négociations salariales dans toutes les branches et les entreprises », promettant que « d’ici là, les travailleuses, les travailleurs et leurs syndicats maintiendront la pression par différentes initiatives ». Elles annoncent, en outre, avoir convenu « d’ores et déjà de se revoir très régulièrement pour prendre toutes les initiatives nécessaires afin de mettre le débat budgétaire sous la pression du monde du travail et gagner enfin la justice sociale ».
« Nous exigeons que Sébastien Lecornu réponde à cette démonstration de force. Il faut que ce budget soit enterré. Il n’y aura pas de stabilité politique s’il n’y a pas de justice sociale », avait prévenu la veille depuis le cortège parisien, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, à propos du plan d’austérité présenté en juillet par François Bayrou consistant en 44 milliards d’économie assortis de son lot de casse social, sur lequel le nouveau premier ministre n’a pour l’heure annoncé que de minimes concessions.
« Il s’agit d’une question d’acceptabilité des efforts. Il y a quelque chose d’indécent dans le débat public à s’émouvoir d’une pseudo-stigmatisation des plus riches. Ceux-là ne sont que 2 000, alors qu’on parle de 10 millions de personnes en situation de pauvreté », avait également affirmé Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, en référence à la taxe Zucman.
Le communiqué intersyndical, visible par exemple sur le site de la CGT :
Répondre au million de manifestant·es : l’intersyndicale lance un ultimatum
Communiqué intersyndical de la CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CTFC, UNSA, FSU et Solidaires
L'ensemble des organisations syndicales se félicite du succès de la journée de mobilisation interprofessionnelle et unitaire du 18 septembre avec un million de manifestant·es et de grévistes dans toute la France. Cela confirme la colère et la détermination des salarié·es, privé·es d’emplois, jeunes et retraité·es : les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit !
La mobilisation contre le budget d’austérité a commencé à payer, elle a obligé le pouvoir à abandonner la suppression de deux jours fériés.
La mobilisation massive du 18 septembre démontre que le compte n’y est toujours pas ! Les organisations syndicales, avec les travailleuses et les travailleurs, exigent :
- L’abandon de l’ensemble du projet de budget et notamment le doublement des franchises médicales, l’année blanche (désindexation des pensions, des prestations sociales, des salaires des agent·es de la fonction publique et du budget des services publics), la suppression de 3000 postes de fonctionnaires et la réforme de l’assurance chômage, ainsi que des projets attaquant le code du travail, et le 1er mai ;
- La justice fiscale, avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, et contraignent le versement des dividendes ;
- La conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises privées ;
- Des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics partout sur le territoire ;
- Une protection sociale de haut niveau et l’abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ;
- Des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France, et des mesures contre les licenciements.
La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre. Si d’ici au 24 septembre il n’a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d’une nouvelle journée de grève et de manifestations.
Les organisations syndicales pointent également la responsabilité du patronat et exigent l'ouverture de négociations salariales dans toutes les branches et les entreprises. D'ici là, les travailleuses, les travailleurs et leurs syndicats maintiendront la pression par différentes initiatives, organisations de réunions d’information, assemblées générales du personnel, actions dans les entreprises, les services et administrations…
La réussite du 18 septembre place les travailleuses et les travailleurs en position de force. Les organisations syndicales conviennent d’ores et déjà de se revoir très régulièrement pour prendre toutes les initiatives nécessaires afin de mettre le débat budgétaire sous la pression du monde du travail et gagner enfin la justice sociale.
Le 19 septembre 2025
mise en ligne le 19 septembre 2025
À Calais, les exilés n’abandonnent pas l’idée de rejoindre l’Angleterre
Nejma Brahim sur www.mediapart.fr
Malgré l’accord conclu entre le Royaume-Uni et la France, qui permet aux Britanniques de renvoyer aux Français les exilés arrivés illégalement en « small boat », les femmes et les hommes rencontrés dans le Nord ne renoncent pas à leur projet de migration.
Calais (Pas-de-Calais).– Son rêve, c’est l’Angleterre. Dans le campement de fortune où il survit, Mohamed, 16 ans, se dirige droit vers le camion de distribution alimentaire de l’association Salam. Parti du Sénégal et passé par l’Algérie, puis par le Maroc et l’Espagne, il a rejoint Calais cinq jours plus tôt, et attend désormais de pouvoir passer de l’autre côté de la Manche.
« La France, je n’ai pas trop envie d’y rester, glisse-t-il en français tout en prenant une place dans la file, ce jeudi 18 septembre. C’est vrai que le fait de parler la langue peut aider. Mais j’apprendrai l’anglais, je prendrai des cours là-bas. »
L’accord conclu entre le Royaume-Uni et la France, à l’occasion d’une visite d’Emmanuel Macron en juillet dernier, ne change rien à ses plans. De toute façon, dit-il, il va « passer par camion, alors ça ne s’applique pas ». Son ami a réussi à s’accrocher à l’arrière d’un tel véhicule la veille. Beaucoup d’exilés se blessent, voire perdent la vie ainsi. « C’est très dangereux, et puis il y a des chiens partout pour nous repérer. »
Son voisin, originaire du Bénin, serait bien resté en France. Mais, arrivé par l’Espagne, il serait sans doute « dubliné » : en vertu du règlement Dublin, les personnes doivent demander l’asile dans le premier pays par lequel elles sont entrées dans l’Union européenne (UE). Une balafre sur la joue malgré son jeune âge, il lève les sourcils pour marquer son désarroi : « On n’a pas vraiment le choix, en fait. » Il ne souhaite pas vivre en Espagne, alors ce sera l’Angleterre.
Ici, certains ont eu vent de ce fameux accord visant à éloigner celles et ceux qui chercheraient refuge au Royaume-Uni, d’autres pas. « Ça nous inquiète, bien sûr, mais ça ne va jamais nous décourager », lâche Hamid, un Ivoirien passé par la Mauritanie puis les îles Canaries – une route migratoire dangereuse, soumise à de violents courants.
« La plupart d’entre nous avons traversé la Méditerranée ou l’océan Atlantique, on a déjà risqué la mort. On est lancés, on fonce jusqu’à notre destination. » La France, qu’il considère comme sa maison, « la maison-mère », ne l’intéresse pas : « On a envie de découvrir autre chose. »
Un bâton de plus dans les roues
Après avoir récupéré un encas, une banane et une boisson chaude, les exilé·es s’assoient par terre, sur le bitume de ce parking situé à l’arrière d’entrepôts, devenu leur lieu de vie. Non loin de là, les mouettes sont à l’affût des moindres vivres qu’elles pourraient dérober, tandis que la clinique mobile de Médecins sans frontières reçoit, à tour de rôle, celles et ceux qui cherchent à panser leurs maux en tout genre.
De nombreux Soudanais – uniquement des hommes – vivent dans ce campement parsemé de déchets et où de vieux vêtements sont accrochés dans les barbelés qui le séparent du terrain attenant. Chacun a son histoire, son projet et ses rêves, sourit celui qui se fait surnommer « Tchadio », ses amis disposés en cercle autour de lui. « Mais la plupart ici veulent aller en Angleterre. La France, ce n’est pas bon pour nous. Donc que ce soit par bateau ou par camion, on trouvera le moyen d’y arriver. »
Face à lui, Moubarak, un grand gaillard bourré de timidité, confie qu’il vit à Calais depuis un an et deux mois. « L’accord ne change rien pour nous. On est passés par la Libye, la Tunisie, l’Algérie ou le Maroc. Alors ces choses-là ne nous découragent pas. » L’un d’eux, qui ignorait l’existence de ce nouveau traité, reste perplexe : « Pourquoi ils veulent nous renvoyer en France si on traverse ? Quel est leur objectif dans tout ça ? » Une chose est claire : ils ne retourneront pas dans leur pays d’origine, en proie à la guerre. Et ils ne resteront pas en France.
À midi, un groupe d’exilés se lance dans une partie de foot sur le bitume – les gardiens de but se tiennent prêts, entre deux jerricanes d’eau faisant office de poteaux, à stopper la balle usée que les autres joueurs se disputent. Tout à coup, ils se chamaillent pour savoir si le ballon est entré ou non, face à quelques spectateurs amusés, qui aiment rendre service et aller chercher la balle lorsque celle-ci s’éloigne un peu trop du terrain. Un homme passe sur un vélo de fillette, une doudoune sur le dos, sans dire un mot.
C’est ainsi que va la vie sur les camps : essayer de s’occuper et d’oublier – surtout d’oublier – la misère dans laquelle des personnes souvent éduquées et diplômées ont basculé après avoir dû fuir leur pays. Et ce sont des hommes et des femmes politiques qui n’ont jamais mis les pieds dans un tel lieu de vie, et qui n’ont sans doute jamais adressé la parole à celles et ceux qu’ils qualifient de « migrants », qui entendent décider de leur destinée.
On a traversé beaucoup de choses pour aller en Angleterre. S’ils nous renvoient, on aura tout perdu. Une jeune femme érythréenne
Dans l’enceinte de la gare de Calais, au centre-ville, des panneaux publicitaires estampillés des logos des gouvernements britannique et français mettent en garde : « ATTENTION !, lit-on sur un fond jaune fluo. Il existe un nouveau traité entre le Royaume-Uni et la France. Si vous arrivez illégalement au Royaume-Uni à bord d’un bateau, vous risquez désormais d’être expulsé et vous ne pourrez plus revenir au Royaume-Uni, ni rester en France en situation irrégulière. » Le message est également traduit en anglais.
Sur le quai de la Moselle, à environ dix minutes de la gare, des exilés apprennent en direct qu’une première expulsion a eu lieu depuis le Royaume-Uni vers la France ce jeudi. Ils sont une trentaine à s’être déplacés pour la « session de recharge » organisée par L’Auberge des migrants, une association locale, à 15 heures. Assis côte à côte sur des bancs, face à des cagettes en bois contenant un tas de multiprises, ils profitent de ce rendez-vous en extérieur pour échanger tout en chargeant leur téléphone.
Deux premiers renvois après des couacs
Au milieu des hommes, une Érythréenne âgée de 25 ans, les cheveux tirés en arrière, écarquille les yeux. Celle-ci a vaguement entendu parler de l’accord, sans avoir eu davantage d’informations. Elle a du mal à croire que les expulsions ont débuté. Comme l’a révélé Mediapart, l’application du traité a eu des débuts difficiles, avec plusieurs annulations de dernière minute. Mais après la première expulsion de jeudi, une autre personne a été renvoyée vendredi 19 septembre.
« Priez pour nous ! », répète la jeune femme dans un sourire gêné. Son voisin ajoute : « Ça nous fait peur… On a traversé beaucoup de choses pour aller en Angleterre. S’ils nous renvoient, on aura tout perdu. »
« Pour moi, ça ne change rien », assure un Syrien en apprenant la nouvelle. Face à lui, l’un de ses compatriotes réagit : « Ils ont commencé à renvoyer les gens aujourd’hui ! Tu ne peux pas dire que ça ne change rien. Et si tu traverses et qu’ils te renvoient ? », interroge-t-il, agacé. À 27 ans, cet ingénieur civil se dit inquiet. « C’est un gros problème pour nous. Je veux atteindre mon objectif et commencer une vie décente et sûre. Il est inadmissible qu’après avoir été exposés à de grands dangers, on nous renvoie. »
Faute de choix, il tentera sans doute la traversée de la Manche prochainement, puisqu’une fenêtre météo favorable s’annonce dans les jours qui viennent. « Je sais que c’est très dangereux, mais je n’ai pas d’autre option. » Le jeune homme a bien tenté de s’établir en Allemagne, où il a sollicité l’asile en novembre 2024 et a vécu durant dix mois, le temps du traitement de sa demande.
Mais les autorités ont fini par le dubliner et le renvoyer en Croatie, premier pays par lequel il était entré dans l’UE. Il jure qu’il n’y avait pourtant pas donné ses empreintes, mais il avait présenté ses documents d’identité à des policiers. « Quand l’Allemagne m’a fait ça, j’en ai voulu à toute l’UE. Je ne suis pas quelqu’un de mauvais. Je veux juste avoir des papiers, travailler et payer des impôts. Je n’ai aucune intention d’avoir des aides. »
Il explique avoir entendu de nombreux Allemands et Allemandes tenir ce discours erroné et stigmatisant à l’endroit des étrangers et étrangères. Quant à l’idée de soumettre son dossier pour espérer migrer légalement vers le Royaume-Uni, puisque, après tout, c’est là la contrepartie de l’accord signé avec la France, il n’y croit pas. « J’ai vu plein de gens remplir le formulaire en ligne pour partir comme ça. Sans résultat. Ou alors ils ont eu des refus. »
Près de lui, un Égyptien raconte avoir fait la demande : « Ça fait un mois et sept jours que j’attends, mais toujours rien. » Pour être accepté·es, les exilé·es doivent fournir un document d’identité avec photo et prouver être dans le Nord de la France grâce à la géolocalisation.
Mais ces critères sont difficiles à remplir, comme le souligne Emma, coordinatrice de L’Auberge des migrants. Le Royaume-Uni peut par ailleurs refuser toute demande dès lors que l’équilibre entre les transferts de personnes entre les deux pays n’est pas respecté à ses yeux.
Depuis quelques semaines, le Refugee Legal Support (RLS) organise des sessions de soutien et d’accès aux droits dans les locaux du Secours catholique à Calais, afin d’aider les exilé·es à remplir correctement le formulaire en ligne. Contactées, ses équipes indiquent que pour l’heure, à leur connaissance, personne ne s’est manifesté auprès d’elles ou d’autres ONG « pour dire qu’ils poursuivaient le traitement de leur demande ».
Le Syrien reprend : « Pour moi, ce n’est pas une bonne idée. Ce serait prendre la place d’une personne qui se serait épuisée à faire la traversée par la mer », puisque la France et le Royaume-Uni s’échangent des vies humaines dans le cadre de cet accord. Une façon d’être solidaires les uns des autres, dans une période de plus en plus sombre pour les personnes migrantes en Europe.
mise en ligne le 18 septembre 2025
Grève du 18 septembre à Montpellier : très forte mobilisation sociale
et des blindés dans la rue
Elian Barascud sur https://lepoing.net/
Environ 15 000 personnes ont manifesté à Montpellier ce jeudi 18 septembre dans le cadre d’une journée appelée par l’intersyndicale, surveillée par un dispositif policier massif
Dès 5 h 30 du matin, mobilier et pancartes s’entassent sur des portails de la fac des sciences de Montpellier, dont le blocage avait été voté la veille en assemblée générale. Des lycées, comme Clemenceau, ont fait de même. Deux heures plus tard, ce sont une cinquantaine de cyclistes qui entament une “vélorution” au niveau du rond-point de Jean-Monnet.
De son côté, la coordination du travail social contre les coupes budgétaires avait organisé un rassemblement à 8 heures devant la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). Sur place, cheminots, travailleurs de la culture, de la santé et de la grande distribution se retrouvent. Antoine, travailleur social et syndiqué à Sud Santé-Sociaux, raconte. “Le directeur de la DEETS est descendu nous voir, on a échangé. On a compris qu’on aurait des suppressions de poste dans le social l’an prochain. Notre objectif, c’est la poursuite de la construction d’une grève dure par des assemblées générales de travailleurs, comme ça a été le cas cette semaine dans l’association l’Avitarelle, c’est comme ça que l’on va gagner.” Lui et d’autres travailleurs sociaux montpelliérains feront partie d’une délégation qui ira témoigner de leur expérience de lutte à Marseille le 11 octobre prochain lors des rencontres nationales du travail social.
“Les adhésions au syndicat ne font qu’augmenter”
10 h 30, la manifestation s’apprête à partir. On y croise Laurent Blasco, secrétaire du personnel CGT du Conseil Régional. “Bayrou, Lecornu… tout cela, c’est un processus, une politique capitaliste”, fustige-t-il. “On le voit, dans tous nos services, ce sont des restrictions budgétaires qui s’annoncent. On met ça en parallèle avec les choix politiques de Carole Delga, présidente de Région, qui a annoncé débloquer 200 millions d’euros pour l’industrie de la défense en Occitanie… Cela suit une logique nationale et augmente notre impression de ne pas être entendus.” Chez les agents de la Région, le 10 septembre avait déjà mobilisé : “Il y avait environ 10% de grévistes sur 8 000 salariés. Et là, en ce moment, les adhésions au syndicat ne font qu’augmenter.”
“Ceux qui paient ce budget d’austérité, ce sont les jeunes les travailleurs, les retraités et les malades, avec le doublement de la franchise médicale”, tonne un syndicaliste de la CGT au micro. “Ce qu’on veut, c’est une revalorisation des salaires et l’abolition de la réforme des retraites !” . Selon les syndicats, 20 000 personnes ont battu le pavé. La préfecture, quant à elle, avance le chiffre de 10 000 personnes. “C’est plus que le 10 septembre”, se réjouit un autre syndicaliste, à l’évocation des chiffres au micro. “La date du 18 avait été pensée par l’intersyndicale pour tuer celle du 10, en réalité, ça fait jonction”, analyse-t-il.
La date du 21 septembre (date de la fin de la monarchie en France) circule déjà comme suite de la mobilisation avec l’idée de “prendre les places”. A Montpellier, un rendez-vous a été fixé à 14 heures sur la place de la Comédie.
Des “Centaures” et des lacrymos
François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, avait prévenu : “Des instructions strictes ont été communiquées aux forces de l’ordre pour empêcher toute situation de blocage, intervenir après sommations et interpeller les fauteurs de troubles”. En plus des drones et gendarmes mobiles, deux blindés “centaures” avec caméra thermique et lance-grenades ont été déployés place de la Comédie.
Après la manifestation syndicale, quelques centaines de personnes sont parties en manifestation sauvage derrière la gare puis sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. La police a fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Selon la préfecture, à 16 heures, 10 personnes avaient été arrêtées et sept placées en garde à vue.
mise en ligne le 18 septembre 2025
Ras-le-bol général :
trouble
dans l’ordre des choses
par Pablo Pillaud-Vivien sur www.regards.fr
Budget, Lecornu, Macron : la journée de mobilisation révèle un pays à bout de nerf.
À l’appel de toute l’intersyndicale, ce jeudi 18 septembre, la France vit une nouvelle journée de grèves et de mobilisations. Mais ce serait tromper le réel que de croire qu’il s’agit seulement d’un rendez-vous syndical. Toute la gauche, dans sa diversité, se donne rendez-vous dans la rue.
La séquence s’accélère. Après la crise institutionnelle générée par le défi des députés – un gouvernement introuvable, un premier ministre sans autorité, un pouvoir à bout de souffle – puis la mobilisation spontanée du 10 septembre, voici le nouveau wagon de la contestation. Cette fois, les syndicats prennent le relais mais sans pour autant fixer de cap précis.
Officiellement, la journée est dirigée contre le projet de budget. Mais quel budget au juste ? Celui d’un ministre déjà discrédité, celui d’un exécutif qui n’exerce plus vraiment le pouvoir ? Tout indique que, dans les cortèges, le rejet ira bien au-delà des colonnes de chiffres. C’est le pays qui est à bout de nerfs.
Rarement, les syndicats de travailleurs ont appelé à la mobilisation sans mot d’ordre, sans slogan unificateur, sans plateforme revendicative. Ce fait est révélateur de l’état du moment : permettre l’expression d’un ras-le-bol général.
L’ambiance s’annonce électrique. La colère est diffuse et tenace depuis deux ans et l’imposition au forceps de la réforme des retraites. Défiante aussi. On ne sait pas à quelle sauce le pays va être mangé mais chacun perçoit que cela ne peut pas continuer ainsi. Les gens veulent que ça s’arrête. Pas seulement les prix qui flambent, pas seulement les inégalités qui s’aggravent : ils veulent que s’arrête la vacance de la politique, la fuite en avant, l’impression de dérive permanente.
Il n’y a pas d’interlocuteur. Il n’y aura pas de compromis possible. Tout peut arriver et c’est peut-être cela le plus nouveau : l’incertitude n’est plus seulement dans les institutions, elle est dans la rue.
Le 18 septembre est un test grandeur nature. S’il confirme la lame de fond entrevue le 10 septembre alors la séquence s’ouvrira vers l’inconnu. Une chose est certaine : cette journée ne sera pas un épilogue. Elle sera, au mieux, un commencement. À la gauche de lui offrir un horizon.
mise en ligne le 17 septembre 2025
Taxe Zucman :
panique à bord au Medef
Pierre Jequier-Zalc sur www.politis.fr
Alors que la taxe qui vise à taxer les patrimoines des ultra-riches, s’impose dans le débat public, le patronat monte de plus en plus violemment au front pour s’indigner de cette proposition. Signe d’une panique croissante.
Le vent serait-il en train de tourner ? Cela fait près de dix ans qu’au Medef on se prélasse tranquillement. Depuis le pin’s à « 1 million d’emplois » de Pierre Gattaz, toutes les politiques économiques mises en place leur sont favorables : CICE, suppression de l’ISF, baisse de l’impôt sur les sociétés, aides publiques massives, etc. Au point que toute participation à la solidarité nationale semble être devenue une aberration.
Les ultra-riches payent, en proportion, bien moins d’impôts que n’importe quel contribuable.
Même quand cette contribution est censée corriger une inégalité structurelle du système fiscal français : les ultra-riches payent, en proportion, bien moins d’impôts que n’importe quel contribuable. Cela paraît difficile à entendre, et pourtant les faits sont têtus. Il faut d’ailleurs saluer la mobilisation médiatique et politique d’économistes de premier plan – outre celle de Gabriel Zucman, notons celle de sept Prix Nobel d’économie – pour que ce constat s’impose dans un débat où les arguments néolibéraux de bas étage – ou d’extrême mauvaise foi, au choix – ont le vent en poupe.
Et dans un contexte de déficit budgétaire important, alors que la Macronie plaide pour des efforts massifs de la population, cette inégalité devient de plus en plus intolérable. Injustifiable, même ! Au point qu’on peut déjà estimer que Sébastien Lecornu joue son poste à Matignon sur la mise en place de cette mesure déjà adoptée par l’Assemblée nationale au printemps dernier. Incroyable mais vrai, le patronat – notamment le Medef – se retrouve donc en position de faiblesse. Une première depuis dix ans. Il suffit de lire l’interview de Patrick Martin dans les colonnes du Parisien le week-end dernier pour s’en convaincre.
D’habitude si prompt à jouer au bon père de famille, le patron des patrons a, cette fois, sorti le bazooka néolibéral.
D’habitude si prompt à jouer au bon père de famille responsable et consensuel, le patron des patrons a, cette fois, sorti le bazooka néolibéral. Hors de question de créer une nouvelle taxe, qui serait « une provocation ». Il faudrait plutôt, selon lui, supprimer 70 000 fonctionnaires dès l’an prochain, une mesure « raisonnable » (sic), et doubler la franchise médicale. Affaiblir les services publics et faire payer les malades plutôt que plus de justice fiscale, la ligne est claire.
L’indignation s’accompagne de menaces : « Si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale. » Rassurez-vous, celle-ci sera « républicaine » et les patrons ne descendront « pas dans la rue ». Cela pourrait presque prêter à sourire. Pourtant, la prise de position du président du Medef a rapidement été suivie par divers éditos libéraux, particulièrement virulents.
Un exemple parmi tant d’autres, celui de Nicolas Bouzou dans les colonnes de L’Express. Sans gêne, celui-ci compare les économistes qui portent la taxation des ultra-riches à Didier Raoult – le microbiologiste controversé –, n’hésitant pas à les qualifier d’illettrés économiques. Cocasse quand on sait que le seul fait de gloire de cet économiste est d’avoir été payé par Uber pour faciliter leur implantation en France.
Les puissants sont en train de perdre la bataille de l’opinion.
Cela témoigne aussi de la force de frappe des défenseurs du statu quo. De celles et ceux qui défendent les intérêts des plus riches. Rien d’étonnant quand on sait que la plupart des médias sont, justement, détenus par ceux qui pourraient être soumis à la taxe Zucman. Ce changement de braquet – de l’indifférence à la menace – dans la défense des puissants souligne qu’ils sont en train de perdre la bataille de l’opinion. Les forces progressistes doivent s’en rendre compte.
Pour faire du 18 septembre une journée de mobilisation massive pour plus de justice sociale et fiscale. Pour ne rien lâcher dans les négociations en cours avec Sébastien Lecornu. Et pour, enfin, mettre fin au règne sans partage du patronat sur la politique économique du pays.
mise en ligne le 17 septembre 2025
L’offensive d’Israël sur Gaza-ville, un génocide couvert par les États-Unis
Pierre Barbancey sur www.Humanite.fr
L’armée israélienne a lancé une opération terrestre contre la principale agglomération du territoire palestinien. Pendant ce temps, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, est allé rassurer le Qatar, tout en parlant d’une fenêtre de négociation qui pourrait se refermer très rapidement.
Timing parfait pour Benyamin Netanyahou et Marco Rubio. Le secrétaire d’État états-unien s’était déplacé pour assurer le premier ministre israélien du plein et entier soutien de Donald Trump, quoi qu’Israël fasse, quoi qu’en disent les peuples du monde entier.
Marco Rubio en a profité pour se rendre au Qatar, pays bombardé par Israël la semaine dernière, histoire de minimiser les dégâts. « En fait, nous avons un accord de coopération renforcée en matière de défense, sur lequel nous travaillons et que nous sommes sur le point de finaliser », a-t-il révélé.
L’ONU accuse Israël de commettre un génocide
Un quasi-signal pour le gouvernement d’extrême droite israélien, dont l’armée a lancé, mardi à l’aube, une offensive terrestre majeure, au mépris de la présence de centaines de milliers de civils encore sur place. « Ce qui se passe est très dur, nous a fait savoir la correspondante particulière de l’Humanité sur place, la journaliste palestinienne Maha Hussaini. Maintenant, les Israéliens utilisent des robots chargés d’explosifs non loin de l’endroit où je me trouve. La situation est vraiment très terrifiante. »
Un témoignage recueilli en milieu de matinée, juste avant que ne cesse tout contact avec elle. Cette offensive provoquera « plus de destructions, plus de morts et de déplacements » de la population, a déploré un porte-parole de l’Union européenne. Mais pour les habitants de Gaza, ces lamentations ne changent rien et la mort continue de s’abattre sur eux.
Le même jour que le déclenchement de cette attaque, et pour la première fois, une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU a accusé Israël de commettre un « génocide » à Gaza depuis octobre 2023 avec l’intention de « détruire » les Palestiniens.
Les enquêteurs mettent en cause Benyamin Netanyahou ainsi que d’autres dirigeants. « La responsabilité incombe à l’État d’Israël », a souligné la présidente de cette commission, Navi Pillay. Cette juriste sud-africaine fut présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda et juge à la Cour pénale internationale.
« La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à la campagne génocidaire lancée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Lorsque des signes et des preuves manifestes de génocide apparaissent, l’absence d’action pour y mettre fin équivaut à une complicité », a-t-elle indiqué.
Les États-Unis et Israël continuent pourtant à manœuvrer, car leurs intérêts politiques et économiques – qui se rejoignent sur bien des points – nécessitent cette séquence génocidaire, mais également la mise au pas de toute opposition régionale et mondiale.
D’où le déplacement de Marco Rubio au Qatar où, la veille, se tenait une réunion extraordinaire convoquée par la Ligue arabe et l’Organisation de la conférence islamique (OCI). Une rencontre exceptionnelle, mais qui ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences.
Certains de ces pays sont les principaux exportateurs de gaz et de pétrole, et pourtant ils ne prennent aucune décision concrète pour aider le peuple palestinien. Ils appellent à « revoir » les liens diplomatiques avec Israël, mais ne mentionnent pas ès qualités les accords d’Abraham. Ceux-ci, voulus par les États-Unis, gravent dans le marbre la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël.
Les Émirats arabes unis et Bahreïn les ont déjà adoptés. L’enjeu est maintenant l’Arabie saoudite. La marge est donc réduite pour les pétromonarchies qui doivent apparaître, au moins sur le papier, comme des soutiens au peuple palestinien.
Aucune sanction et aucun cessez-le-feu
Washington le sait bien, qui a besoin de conserver le Qatar comme médiateur dans des négociations, au même titre que l’Égypte. Doha et Le Caire sont bien incapables de tenir tête au géant états-unien. D’ailleurs, les termes mêmes de ces discussions montrent à quel point elles sont instrumentalisées pour permettre la poursuite de la guerre et rejeter la faute sur la partie palestinienne.
« Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas (Gaza-ville). Nous pensons que nous avons une petite fenêtre pour qu’un accord (de cessez-le-feu) puisse être conclu » avec le Hamas, a affirmé Marco Rubio, en évoquant « probablement quelques jours et peut-être quelques semaines ».
Le temps de continuer les massacres. « Gaza brûle », s’est réjoui le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui se pense peut-être dans une séquence biblique. « L’armée frappe d’une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de l’armée se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas », a-t-il lancé. Seule l’arme des sanctions politiques, économiques et financières peut maintenant arrêter ce génocide.
mise en ligne le 16 septembre 2025
Fête de l’Huma :
le fond de l’air était
rouge et unitaire
Catherine Tricot sur www.politis.fr
Les élus ont-ils perçu cette pression qui gronde au sein la gauche ? Comme si chacun s’était saisi du moment révolutionnaire qui vient pour leur en tenir rigueur. Les attentes sont élevés alors… élevons le niveau !
La Fête de l’Huma s’impose comme le rendez-vous incontournable des gauches. Tous les leaders sont venus se frotter au « peuple de gauche » affluant par centaines de milliers. Tous, ou presque. Il ne manquait que Raphaël Glucksmann, envoyant un signal clair : il ne fait pas cause commune avec cette foule-là. En revanche, Olivier Faure comme Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet et même Patrick Martin (le patron du Medef) ont pu humer une atmosphère qui ne trompait pas.
Avant de parler de l’ambiance générale, revenons un instant sur celle qui dominait parmi les proches et les membres du Parti communiste. Les militants étaient bien sûr au rendez-vous. Sans eux, pas de fête. Heureux comme des poissons dans l’eau car, cette année, pas de dingueries lâchées par surprise par Fabien Roussel pour troubler ce moment de retrouvailles. Le secrétaire national s’est fait plus discret et moins de monde est venu l’écouter. C’est le président du groupe communiste à l’Assemblée, Stéphane Peu, qui tenait estrade au côté de Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin et Hadrien Clouet (député LFI). Fabien Gay, le directeur de L’Humanité, marchait sur un nuage en annonçant que la Fête avait dû fermer les accès samedi à 15h. Il était encore tout auréolé de son rapport au Sénat sur les aides publiques versées aux entreprises. L’élu parisien Ian Brossat, très mobilisé sur le combat pro-palestinien, était également porté par ses camarades. Apparaissant comme des militants de l’union sans exclusive des gauches, ces trois visages (masculins) du communisme français étaient plébiscités dans les stands.
Tout au long des débats de la fête, c’est une demande plus radicale qui s’est fait entendre. Les mots et les slogans n’étaient pas toujours là, mais la musique, elle, oui. Le tempo aussi. C’était celui de l’unité. Ce fut d’ailleurs le seul slogan scandé lors du grand débat : « Unité ! unité ! »
Sinon, les débats politiques ont fait le plein. Et il était tout aussi intéressant d’écouter le public que les orateurs. Olivier Faure a eu fort à faire pour convaincre de sa stratégie. La presse a beaucoup insisté sur les sifflets – pas tant que ça en vérité –, ils étaient maitrisés et les slogans méchamment anti-socialistes n’ont pas retenti, à la différence d’autres fois. Le public écoutait et réagissait. Le premier des socialistes a voulu amadouer la foule et a un peu triché en annonçant l’abrogation de la réforme des retraites quand il ne s’agit en fait – dans le projet socialiste – que de sa suspension. La différence ? La réforme avance et l’âge de départ est déjà porté à 63 ans. Olivier Faure a vanté la taxe Zucman, en passe de devenir le symbole d’une politique de gauche. Mais le public ne semble pas y trouver tout son compte.
Tout au long des débats de la fête, c’est une demande plus radicale qui s’est fait entendre. Les mots et les slogans n’étaient pas toujours là, mais la musique, elle, oui. Le tempo aussi. C’était celui de l’unité. Ce fut d’ailleurs le seul slogan scandé lors du grand débat : « Unité ! unité ! » Chahuté quand il dit vouloir un candidat insoumis à l’élection présidentielle, Hadrien Clouet a tenté une ruse : justifier la rupture d’avec les socialistes pour cause de soutien au régime génocidaire d’Israël. Il s’est fait bien ramasser par Olivier Faure.
François Ruffin et Stéphane Peu étaient au barycentre de ce moment à la fois radical et unitaire. Le député communiste a rappelé ce moment où les peuples socialiste et communiste ont forcé leur parti à converger pour faire face au fascisme montant en 1934. Intéressant encore quand il lie politique sociale et combat antifasciste, rappelant que la sécurité sociale n’est pas seulement née de la fraternité de la résistance mais de la conscience parmi les rédacteurs du programme des jours heureux que les peuples d’Europe ont sombré dans la pauvreté et la peur des lendemains avant le désespoir qui conduisit au fascisme.
Jean-Luc Mélenchon tenait meeting à part, dans son stand à lui, devant des centaines de militants serrés. Comme rarement, il a rendu hommage aux communistes, le militant d’aujourd’hui, la dirigeante d’hier, Marie-George Buffet et la charismatique Rosa Luxembourg. Il a même conclu son meeting par « l’Internationale » : il voulait rassembler la famille. Cela ne l’a pas empêché de dire de belles vacheries sur l’ensemble des partenaires de gauche. C’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Laissons cela pour revenir au fond de son propos. Jean-Luc Mélenchon sent le moment. Il le voit révolutionnaire par la conjonction des luttes – en commençant par celles du 10 et du 18 septembre – et des blocages d’en haut. Les sorties du Medef, braqué devant toute contribution des entreprises, alimentent ce diagnostic d’époque révolutionnaire. Mais Jean-Luc Mélenchon rate quelque chose de l’air du temps : la demande puissante d’unité. De tous. De la base aux partis. Il fallait se balader quelques heures dans les travées pour le mesurer comme jamais. Le leader insoumis affirme sa confiance dans le peuple et son unité : voilà ce que le peuple lui demande.
mise en ligne le 16 septembre 2025
Sophie Binet : « Sébastien Lecornu doit abroger la réforme des retraites »
Cyprien Boganda sur www.humanite.fr
Secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet analyse la crise politique et sociale qui secoue le pays et met en garde l’exécutif contre le maintien d’un cap austéritaire.
Le 18 septembre, l’intersyndicale appelle à une journée d’action. À l’époque où cette journée a été décidée, la colère sociale se cristallisait autour d’un projet de budget porté par le gouvernement Bayrou, or ce gouvernement est tombé. Contre quoi allez-vous mobiliser le pays ?
Sophie Binet : Nous avons bien compris la stratégie d’Emmanuel Macron : tout changer pour que rien ne change. Il vient de sacrifier trois chefs de gouvernement en un an pour espérer sauver sa politique.
Nous sommes à un moment où l’histoire s’accélère. Le 18 n’est pas une date comme une autre, c’est une étape décisive, pour nous qui voulons changer la donne. L’ensemble des organisations syndicales appelle à la grève.
Plus de 200 actions sont déjà recensées. Il faut se mobiliser parce que si le premier ministre a changé, le projet de budget 2026, lui, n’est pas tombé. Or ce que nous voulons, ce n’est pas uniquement changer le nom de celui qui est en poste à Matignon, c’est un nouveau budget.
Sébastien Lecornu renonce à remettre en cause les deux jours fériés. Cela ne vous suffit pas ?
Sophie Binet : Non, car nous voulons enterrer définitivement le musée des horreurs qu’est ce budget. Il reste le doublement des franchises médicales, le gel des retraites et de toutes les prestations sociales, le gel du salaire des fonctionnaires, l’austérité pour nos services publics et la suppression de 3 000 postes de fonctionnaire.
Mais le 18 est un mouvement offensif. Nous voulons la justice fiscale. L’argent, il y en a dans les poches du patronat. Il en faut pour nos services publics.
Il n’est plus possible que nos hôpitaux et nos écoles soient à l’os. Et nous luttons pour l’abrogation de la réforme des retraites, cette réforme qui ne passe pas et ne passera jamais. Le 18, on va aussi exiger l’augmentation des salaires et des pensions et l’arrêt des licenciements.
Le nouveau premier ministre a promis une « rupture » avec la politique de son prédécesseur : est-ce crédible, selon vous ?
Sophie Binet : Nommer, pour mener cette rupture, quelqu’un qui a été ministre de tous les gouvernements depuis huit ans, il fallait oser ! Mais que le nouveau chef du gouvernement soit obligé de prononcer le mot « rupture », c’est déjà un signe de l’évolution du rapport de force.
Maintenant, il va falloir des actes immédiats sur l’indexation des retraites, la suppression des postes de fonctionnaire et l’abrogation de la réforme des retraites.
Voilà deux ans que cette réforme est comme le scotch du capitaine Haddock pour Emmanuel Macron. Si nous n’avons pas gagné en 2023, c’est à cause du 49.3. Mais le chef de l’État a ensuite été sanctionné dans les urnes et tous ses premiers ministres ont sauté. Si Sébastien Lecornu ne veut pas connaître le même sort, il doit abroger la réforme des retraites.
En 2017 et en 2022, Emmanuel Macron s’est présenté comme un rempart contre l’extrême droite, et pourtant, aujourd’hui, le RN n’a jamais été aussi proche du pouvoir. Jordan Bardella à Matignon, cette perspective vous inquiète-t-elle ?
Sophie Binet : Clairement. En procédant à la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a joué à pile ou face. Soit il ressoudait sa majorité, soit le Rassemblement national passait. Le Nouveau Front populaire a contrecarré ces scénarios. Depuis, le président de la République multiplie les passages en force car le patronat le pousse à être intransigeant.
Si ce dernier est à ce point radicalisé, c’est parce qu’il sait qu’en cas de d’échec du nouveau premier ministre, voire de départ d’Emmanuel Macron, il existe un plan B avec l’extrême droite. Donc c’est un risque très sérieux. Je rappelle que l’extrême droite n’est jamais parvenue au pouvoir sans un soutien des milliardaires et du capital…
Dans les cortèges, en ce moment, on entend de plus en plus le slogan « Macron, démission » : le président de la République devrait partir, selon vous ?
Sophie Binet : Ça ferait plaisir à tout le monde, bien sûr, car depuis huit ans, il a mis la France dans un état calamiteux et il se montre prêt à organiser le chaos institutionnel pour maintenir sa politique. Mais en tant qu’organisation syndicale, notre enjeu central est bien le contenu des politiques conduites, pas le casting.
On peut avoir la même chose que Macron après lui, ou pire. Souvenez-vous de 2012 : les milieux patronaux ont senti que Nicolas Sarkozy (à l’Élysée depuis 2007 – NDLR) ne repasserait pas. Ils se sont organisés autour de François Hollande pour reprendre la main.
Par la suite, ce sont eux qui ont réclamé au président socialiste qu’il prenne Emmanuel Macron auprès de lui dans son cabinet. Le jour où les milieux patronaux sentiront que Macron est fini, ils se réorganiseront : ils sont déjà en train de le faire autour de l’extrême droite.
L’agence Fitch vient de dégrader la note de la France. Les libéraux expliquent que si on ne règle pas le problème de la dette publique, le pays va connaître le sort de la Grèce. Est-ce que, pour le dire trivialement, 3 300 milliards d’euros de dette, ce n’est pas si grave ?
Sophie Binet : Il y a deux ans, la situation de la dette a déjà servi de justification pour imposer le recul de l’âge légal de départ à la retraite. Et que s’est-il passé ensuite ? La note de la France a dégringolé malgré tout. Les agences financières ont bien vu ce que la CGT et les organisations syndicales ont martelé : les passages en force d’Emmanuel Macron se paient par une grande instabilité politique et une profonde crise démocratique. C’est bien cette instabilité qui explique la dégradation de la note.
Depuis 2017, on a subi une réforme du Code du travail, quatre réformes de l’assurance-chômage, une réforme des retraites… Le bilan, c’est une dette publique qui a augmenté de 1 000 milliards d’euros – soit un tiers supplémentaire !
Sur ces 1 000 milliards de dette supplémentaire, au moins 500 résultent des cadeaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Les déficits publics sont dus à un manque de recettes, pas à un excès de dépenses.
Venons-en à la crise sociale. Il y a pratiquement un an, la CGT alertait sur une vague de plans de suppressions de postes en France, avec une carte de tous les emplois menacés. Où en est-on aujourd’hui ?
Sophie Binet : Nous ne sommes plus très loin des 450 plans de restructuration sur un an. Mais le pouvoir en place ne fait rien. En revanche, grâce à des mobilisations incroyables, les camarades des Fonderies de Bretagne ont réussi à sauvegarder quasiment 300 emplois ; Valdunes, dernier fabricant de roues et d’essieux pour le rail que Bruno Le Maire pensait condamné, tourne aujourd’hui à plein.
On a sauvé Gardanne, cette centrale en reconversion pour répondre aux défis environnementaux dans les Bouches-du-Rhône. Idem pour la papeterie Chapelle Darblay. Le ministère de l’Industrie, lui, n’est plus qu’un ministère des licenciements.
Nous aurions pourtant besoin d’un État stratège, qui utilise les aides publiques comme levier pour agir sur le capital au lieu de signer des chèques pour subventionner les plans de licenciement. Et qui nationalise quand c’est nécessaire, comme à ArcelorMittal ou à Vencorex, où la lutte continue, avec un nouveau projet de coopérative pour garantir la continuité, avec 200 emplois à court terme, 2 000 à moyen terme.
Novasco, l’ancien Ascometal, est en redressement judiciaire : que faire pour le sauver ?
Sophie Binet : Novasco est une aciérie électrique qui produit de l’acier décarboné. Pourtant, on est en train de rayer 800 emplois directs et 3 000 induits. Il faut que l’État tape du poing sur la table. Il a débloqué 85 millions d’euros d’aides publiques pour moderniser la production. Le repreneur, un fonds britannique, n’a déboursé qu’un million sur les 90 promis.
C’est un grand classique. Maintenant, il faut que l’État se fasse respecter. Il y a une clause qui prévoit, dans le contrat qu’ils ont signé ensemble, que si le fonds britannique ne met pas l’argent derrière, tous les actifs basculent à l’État. Cela s’appelle une nationalisation. Il ne reste que quinze jours pour agir.
Quel bilan faites-vous de la journée du 10 septembre ?
Sophie Binet : Rappelons-nous tout d’abord que le mot d’ordre du 10 a d’abord été lancé par des militants souverainistes et qu’on entendait alors beaucoup résonner des slogans du type de « Nicolas qui paie » (dénonciation du matraquage fiscal que subiraient les jeunes actifs, au profit des retraités et des étrangers – NDLR), extrêmement dangereux car émanant de l’extrême droite.
Nous avons su recentrer cette mobilisation sur le rejet du budget Bayrou et des politiques de soutien aux plus riches : en réalité, c’est Nicolas, Mohamed et Fatimata qui paient, pour que Bernard (Arnault) et Vincent (Bolloré) puissent dormir tranquilles !
À l’arrivée, le 10 fut une très belle réussite et une magnifique dynamique pour le 18. Nous avons réussi à éviter tous les pièges tendus par le pouvoir de la mise en opposition entre mobilisation citoyenne et syndicale. Les mobilisations doivent se conjuguer, elles se nourrissent, même si elles sont de nature différente.
Et puis, le 10 septembre, ça a marché aussi parce que chacun a joué son rôle, y compris la CGT. Nous nous y sommes inscrits à partir de ce que nous savons faire : pour bloquer le pays, il faut faire grève. Nous avons recensé plus de 1 000 appels au débrayage ce jour-là. On a vu des gens se mobiliser pour la première fois. Cela a été le cas, par exemple, chez les magasins Action, une chaîne low cost surexploitant ses salariés. Eh bien, pour la première fois, des magasins Action ont baissé le rideau ce jour-là.
Et en même temps, ce qui s’est exprimé dans la rue ce jour-là, c’est une forme de lassitude, si ce n’est de défiance, à l’égard des mots d’ordre syndicaux classiques : sur les boucles Telegram de « Bloquons tout », on lisait beaucoup que les manifestations « ne servent à rien » car le pouvoir ne les entend plus…
Sophie Binet : Je précise quand même que ce qui a marché le 10, ce sont d’abord les grèves, les rassemblements et les manifestations ! Nous n’avons rien contre la diversité des modes d’action, bien au contraire. Mais je rappelle que deux facteurs sont essentiels à la réussite des mouvements sociaux.
D’abord, le nombre. La radicalité, ce n’est pas mener des actions très dures, c’est mener des actions rassemblant le plus de monde possible. Ensuite, il faut impérativement peser sur l’économie, d’où l’importance centrale de la grève. Ce sont bien ces deux éléments qui dérangent réellement le pouvoir.
Vous soulignez l’importance de la grève : pourtant, depuis plusieurs années, les grèves ont beaucoup de mal à prendre lors des grandes mobilisations, à l’exception de quelques secteurs…
Sophie Binet : Il n’y a pas de grève sans syndicat. La baisse relative du nombre de grèves est liée à l’insuffisance de l’implantation syndicale : plus de 60 % des entreprises du secteur privé ne comptent aucune section syndicale.
La première chose à faire, c’est donc de se syndiquer, c’est-à-dire s’organiser pour agir, pour transformer sa vie, son travail, redresser la tête et s’émanciper. J’insiste là-dessus : les grèves ne se font jamais d’en haut, ce qui compte, c’est l’ancrage sur le terrain et les revendications concrètes, définies sur les lieux de travail à partir de discussions entre collègues.
Au passage, je voudrais tordre le cou à une idée reçue selon laquelle les syndicats passeraient leur temps à perdre. Regardons les chiffres. Je ne veux pas dénigrer le mouvement des gilets jaunes, qui a été très intéressant à bien des égards.
Mais le mouvement social de 2023 a mobilisé dix fois plus de monde dans la rue qu’en 2018-2019. Plus généralement, les mobilisations qui gagnent sont toujours celles qui conjuguent mouvement social et initiatives citoyennes : on ne peut pas gagner sans les organisations syndicales.