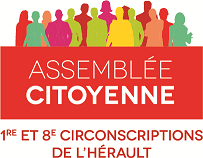débat à gauche - 2025
<<
mise en ligne le 30 décembre 2025
Municipales 2026 : à
gauche,
le risque du jeu de massacre
L'éditorial de Sébastien Crépel sur www.humanite.fr
Loin de nous l’idée de jouer les rabat-joie. Mais la lucidité commande de regarder les choses en face : les élections municipales des 15 et 22 mars prochains s’annoncent très périlleuses. Dans de nombreuses villes où la gauche aurait toutes ses chances en s’unissant, ses forces partiront divisées au premier tour, sans que l’on n’en cerne bien la justification.
Pis encore, elles pourraient aussi s’affronter au second tour, au risque de faire le lit de la droite ou du RN, qui en profiterait alors pour s’imposer dans des triangulaires sans être majoritaire en voix. Cette désunion ne sera pas seulement le fait de villes à (re) prendre à la droite, mais également, dans une poussée quasi suicidaire, de communes actuellement dirigées par des maires de gauche.
Comme souvent en pareille situation, la responsabilité est partagée. Le PS et LFI se disputent la première marche du podium dans la course à qui se montrera le plus inflexible. Dans Politis, Jean-Luc Mélenchon confirmait, en novembre, cette attitude en ne ciblant que ses « partenaires » de gauche.
« Les communistes ne proposent rien si ce n’est la reconduction des sortants », osait le fondateur de LFI, comme si ce principe qui a fait ses preuves pour garder des villes à gauche pouvait être balayé d’un revers de main. Les socialistes ne sont pas en reste en excluant tout « accord national » avec LFI, qui n’espérait que ça. « Comment comptent-ils gagner sans nous ? » raille Jean-Luc Mélenchon.
Ce dernier, comme Olivier Faure, enjoint l’autre de donner des gages entre les deux tours. « Nous n’accepterons pas (de) porter leurs valises », taclait le leader de LFI. « Ce sera à l’insoumis Sébastien Delogu (à Marseille) de dire ce qu’il veut faire », répondait en écho le chef des socialistes dans l’Humanité.
L’oubliée de ces rivalités est la population. À quoi bon la sommer de choisir entre « deux gauches » si c’est pour la livrer à la droite ? La capitale cristallise cette situation, où les sondages font craindre un jeu de massacre. « Il ne faut pas qu’un socialiste soit maire de Paris », a affirmé la tête de liste LFI, Sophia Chikirou. C’est malheureusement une ambition partagée par Rachida Dati.
mise en ligne le 27 décembre 2025
Ugo Bernalicis :
« La première des sécurités, c’est la liberté »
Loïc Le Clerc sur www.regards.fr
Dans le débat omniprésent de la sécurité, que dit la gauche ? Que faire des policiers, de leurs syndicats, de leurs dérives ? Quelle formation et quelles missions ? On en a causé avec le député insoumis Ugo Bernalicis.
D’un pas pressé, Ugo Bernalicis nous amène littéralement « Au Coin de la Rue », à côté de l’Assemblée, pour parler sécurité. C’est le thème de prédilection du député du Nord. Quelques jours plus tôt, lui et ses camarades parlementaires ont fait tomber le gouvernement Barnier. Entre l’excitation politique, un pad thaï et une pinte d’IPA, Ugo Bernalicis développe son programme.
Regards. Ma première question sera très ouverte et peut sembler étrange mais… c’est quoi, une politique de gauche en matière de sécurité ?
Ugo Bernalicis : Une politique de gauche en matière de sécurité, c’est une politique qui vise à traiter les causes plutôt que les effets. Globalement, la gauche, dans tous les domaines, a pour objectif de s’attaquer aux causes profondes des problématiques, plutôt que de se focaliser uniquement sur leurs manifestations. Concernant les causes de la délinquance, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les inégalités sociales, la misère, le manque d’éducation, etc. Dans les déterminants du passage à l’acte, tous ces facteurs pèsent. Il existe des exceptions, bien sûr, mais les études montrent qu’il existe une corrélation claire entre le taux de chômage et le taux d’incarcération. Une politique de sécurité efficace consisterait en une politique de reconnaissance des citoyens, de bien-être, de plein-emploi, d’investissement dans les services publics – remettre des profs dans chaque classe et pas plus de 20 élèves par classe !
À droite, on dit souvent que « la première des libertés, c’est la sécurité » et on accuse la gauche de laxisme, mais on pourrait retourner cet argument en disant que « la première des sécurités, c’est la liberté ». Une autre idée serait de dire que « la première des sécurités, c’est la Sécurité sociale ». D’ailleurs, dans le bloc de constitutionnalité, la seule notion de sécurité explicitement mentionnée est celle de la Sécurité sociale. Pour le reste, on parle de « sûreté ».
Une fois qu’on a ça en tête – et il ne faut pas lâcher ce discours-là –, il faut aussi inclure des mesures préventives. Une politique de gauche ne peut se limiter à une approche purement répressive, c’est un échec absolu qui n’est plus à démontrer. Chaque type de délinquance doit recevoir une réponse appropriée. Celui qui vole parce qu’il a faim ne peut être mis dans le même panier que le crime organisé. Après, ce n’est pas parce qu’on va régler la question sociale qu’on aura tout résolu. C’est peut-être vrai à la fin de l’histoire, mais pas au début !
La gauche répond souvent « police de proximité », comme une formule magique. C’est aussi la proposition de La France insoumise. En quoi est-ce que ça consiste concrètement ?
Ugo Bernalicis : En effet, il est important de mettre en place une police nationale de proximité. Mais pas en tant qu’un groupement à part du reste de la police. Une police de proximité n’a aucun sens si l’on maintient les brigade anti-criminalité (BAC). Cette police de proximité doit, en fait, être la base de fonctionnement de la police. La « police de proximité », c’est « la police », nationale et municipale, composée de 50 ou 60 000 policiers et, à côté, il y a des polices spécialisées qui font leur travail en fonction de leurs domaines de compétence.
On a déjà un bon exemple de ce que devrait être la police de proximité, c’est la gendarmerie nationale. Elle est, par construction, de proximité. Les gendarmes travaillent pour une caserne et vivent à quelques kilomètres de celle-ci, ils s’occupent d’un territoire à taille humaine, leurs enfants vont dans l’école du coin, ils font leurs courses dans les mêmes supermarchés que tout le monde, etc. Résultat : les gendarmes connaissent les gens et vice versa. Du coup, il y a beaucoup moins de dérives en gendarmerie.
« Ce n’est pas le job de la police de proximité d’arrêter les grands bandits ou les individus les plus dangereux, c’est celui des polices spécialisées comme la police judiciaire. Un policier n’est ni la BRI, ni le RAID. »
Faire un travail de proximité, c’est assumer que le temps de répression n’est pas la principale activité du policier. C’est un temps de présence dans l’espace public et le quotidien, de discussion avec les gens. Être là, tout simplement. Ensuite, quand il y a des problèmes, la police est là pour essayer de les résoudre. Pour ça, il faut être en lien avec les mairies, les bailleurs, être inséré dans le tissu social. Néanmoins, la police de proximité doit rester dans son rôle de répression pour les premiers niveaux d’infraction : tapage, vol à la tire, etc. Car son rôle n’est pas non plus dans la prévention et l’assistance sociale. Pour se faire, il y a deux conditions : la première est que cette police ait peu ou pas d’armes à feu. Quant à l’argument comme quoi « c’est pas votre police de proximité qui va arrêter un mec avec une kalachnikov », je réponds : oui, exactement ! Ce n’est pas le job de la police de proximité d’arrêter les grands bandits ou les individus les plus dangereux, c’est celui des polices spécialisées comme la police judiciaire. Un policier n’est ni la BRI, ni le RAID, par contre, il est la première source de renseignements des enquêteurs.
La deuxième condition pour une véritable police de proximité, c’est de libérer les policiers des deux principales actions qui nuisent à sa mission : les contrôles d’identité – censés lutter contre l’immigration illégale mais qui ne produit que racisme et bavures – et la répression contre le cannabis – qui pèse pour 20% de l’activité policière et oblige les policiers à maintenir la stratégie du harcèlement des points de deal et des consommateurs sans que le trafic ne soit impacté. Ça redonnerait un temps de travail incroyable aux policiers. Et là, tout le problème réside dans les ordres qu’on donne aux policiers.
Côté police, il faut tout réformer, du sol au plafond. Du super-pouvoir des syndicats, à Beauvau comme dans chaque commissariat, jusqu’à la façon dont on recrute et forme les policiers… Mais par où commencer ?
Ugo Bernalicis : Demain, on arrive au pouvoir, on a 240 000 policiers et gendarmes à diriger, on leur dit quoi ? Qu’on part des besoins de la population. On oblige que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance – auxquels on invite aussi les gens ! – se réunissent une fois par an afin que les habitants posent des questions, expriment leurs demandes et que les policiers rendent des comptes. Il faut qu’il y ait des aller-retours entre la police et les citoyens.
Concernant les effectifs, on ne va pas virer tous les policiers en fonction au prétexte qu’ils sont sous-formés, qu’ils ont une culture néfaste et que la majorité d’entre eux votent pour l’extrême droite. Les policiers sont conditionnés à une chose : obéir, qu’importe si les syndicats essaient de tout saboter – on n’a pas besoin d’eux, le rapport de force qu’on leur donne n’est que celui qu’on veut bien leur céder – ou si un certain nombre démissionne. On a l’exemple de Pierre Joxe : on ne va pas nous faire croire que quand il arrive au ministère de l’intérieur, les policiers sont tout-gentils et qu’ils n’ont pas été travaillés depuis des années par la droite. S’il faut virer des policiers, ce ne peut être pour leurs idées, mais pour leurs actes : racistes, sexistes, etc. Le cadre permet déjà de sanctionner, pour peu qu’il y ait une volonté politique. La gauche doit assumer que la police, en tant que service public, doit être plus contrôlée que d’autres. Parce qu’elle a des prérogatives qui ne sont pas celles de n’importe quel fonctionnaire : ils ont des armes et la capacité de faire un usage légal de la force.
« On ne gagne pas une présidentielle en parlant mieux que les autres de sécurité. Mais on peut perdre si on en parle moins bien. Ce sera la même chose quand on gouvernera le pays : on ne sera pas jugé sur notre bonne gestion de la police, mais on sera sanctionné si on la gère mal. »
Ensuite vient la question du recrutement et donc de la formation. Ça commence par ouvrir des écoles de police et par rallonger la formation initiale à deux ans, dans un premier temps, puis à trois ans. Il faut assumer de ne plus recruter n’importe qui avant de les lâcher dans la nature sans même connaître les bases des droits et des libertés publiques. Mais ce qui pèse le plus dans les pratiques professionnelles aujourd’hui, ce n’est pas la formation mais le mimétisme des pairs, dont le racisme, le sexisme, les violences, etc.
Début décembre, le site d’informations Basta a publié une enquête montrant que « la France présente les chiffres les plus élevés [d’Europe, ndlr] : entre 2020 et 2022, le pays a enregistré 107 décès en garde à vue ou lors d’interventions policières ». Comment s’extirpe-t-on de cette situation ?
Ugo Bernalicis : On a aussi les chiffres les plus élevés en prison. On n’a pas le temps de changer la culture violente de la police. Donc, dans un premier temps, on va donner des ordres : fin des contrôles d’identité – autant d’outrages en moins – et fin des gardes-à-vue pour outrage – c’est ce que font les Allemands. Les gardes-à-vue pour flagrant délit, terminé aussi ! Aujourd’hui, il y a des indicateurs de performance au ministère de l’intérieur sur le nombre de garde à vues. La politique du chiffre n’a jamais été supprimée. Avant de mettre quelqu’un en garde à vue, je suis pour que le policier prévienne le parquet et attende son avis. Ça changerait beaucoup de choses ! Je suis aussi pour que le parquet vienne dans les commissariats plus souvent et, dans l’idéal, je suis même pour qu’il y ait un procureur dans chaque commissariat pour assumer son autre mission qui est celle du contrôle de la police, de la régularité, de la légalité de son action. Enfin, s’il faut mettre du pognon dans la police, ça ne doit pas être pour acheter des LBD mais pour avoir des locaux de garde à vue qui soient corrects, dignes. En Écosse, un modèle en la matière, les cellules ressemblent à des chambres, les détenus ont un repas chaud et pour quelle conséquence ? Quasiment pas de violence en garde à vue, ni de la part des policiers ni des détenus.
Et quid du « sentiment d’insécurité » ? Selon une étude Ifop de novembre 2024, « 8 français sur 10 déclarent avoir le sentiment que la délinquance a augmenté ». Fantasme ? Que répondre à ces gens-là ?
Ugo Bernalicis : Éteignez la télé. Ce sondage ne montre que la puissance de feu médiatique. Plus sérieusement, on a les enquêtes de victimations qui sont faites par l’Insee et le ministère de l’intérieur, les seules enquêtes dont la valeur et la viabilité permettent de construire une politique publique. C’est insuffisant et il faut recréer ce qu’Édouard Philippe a supprimé : l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (qui avait été créé par Joxe). Il s’agit d’une structure scientifique, autonome, chargée d’évaluer l’action publique et de faire des propositions. Mais il faut aller encore plus loin et déployer ce modèle à l’échelle locale, par le biais des CLSPD évoqués plus avant. Ainsi, on partirait des besoins des habitants pour adapter la politique de sécurité selon les territoires. Un tel outil nous permettrait d’éviter les erreurs de Chevènement et de Jospin. Quand ils ont remis en place un peu de police de proximité, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes. Ils ont été incapables d’expliquer le phénomène et la droite a gagné en dénonçant une augmentation de la délinquance dûe à leur politique !
Pourquoi la gauche est inaudible sur ces questions ?
Ugo Bernalicis : La question de la sécurité est victime d’un clivage et ce n’est pas le clivage gauche-droite. C’est celui où, d’un côté, il y a les tenants d’un système – le capitalisme – et de l’autre les « irresponsables ». Il suffit d’agiter le foulard de la peur, à grands coups de reportages sur des faits divers, de dire que la police les protège et de discréditer immédiatement toute personne qui critique la police. Et ça fonctionne hyper bien électoralement, sans parler une seconde des questions sociales. On ne gagne pas une présidentielle en parlant mieux que les autres de sécurité. Mais on peut perdre si on en parle moins bien. Et je pense que ce sera la même chose quand on gouvernera le pays : on ne sera pas jugé sur notre bonne gestion de la police, mais on sera sanctionné si on la gère mal. Je crois que le fond est là, la gauche n’a rien à gagner à parler sécurité, mais elle a tout à perdre.
<<
mise en ligne le 22 décembre 2025
Extrême droite :
la combattre sans compter
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Face à Marion Maréchal sur LCI, Marine Tondelier a vacillé. Pour la gauche, l’alerte se confirme.
LCI organise des grandes émissions politiques avec de possibles candidats à l’élection présidentielle. Déjà ! Marine Tondelier, désignée candidate des Ecologistes pour la primaire des gauches, était l’invitée ce vendredi de la chaîne d’infos. Elle était notamment opposée à Marion Maréchal. A écouter ce face-à-face, on peut être inquiet de la solidité de la gauche, surtout après le fiasco de Glucksman face à Zemmour dans la même émission.
Marine Tondelier n’est pas la moins expérimentée ni la moins assurée dans les débats politiques. Mais cela n’a pas suffi. L’échec va au-delà de celui d’une personne.
Le thème proposé par Marion Maréchal, auquel Marine Tondelier avait consenti, était celui de l’immigration, de l’insécurité et de la laïcité. Chacune est venue préparée et bardée de chiffres. Marine Tondelier a tenté de corriger, rectifier et faire des mises au point sur les données mises en avant par son adversaire. Mais c’est Marion Maréchal qui a imposé les termes du débat et le cœur de son discours : les immigrés sont la cause première de l’insécurité ; ils compromettent la laïcité et l’égalité femmes-hommes, chères à notre nation.
Le problème central n’est pas que Marion Maréchal manipule la réalité, même si c’est bien sûr ce qu’elle fait. Le problème est qu’elle organise et impose un discours. Elle donne une cohérence idéologique à des données sélectionnées, exagérées ou sorties de leur contexte. Elle ne cherche pas seulement à avoir raison : elle structure son récit et le rend crédible.
On ne peut s’opposer à cette structure idéologique renforcée depuis des décennies en lui opposant d’autres chiffres. Rétablir des vérités partielles ne suffit pas à neutraliser l’efficacité d’une vision partout répétée. L’extrême droite ne gagne pas parce que ses chiffres sont exacts. Elle gagne parce qu’ils viennent confirmer une lecture du réel qui donne sens à des angoisses. Tant que cette lecture ne sera pas remplacée par une autre, elle continuera de prospérer.
Il faut prendre garde à la manière dont on répond aux logiques déployées par l’extrême droite. C’est le cas lorsque l’on répond que les immigrés délinquants ne le sont pas parce qu’ils sont immigrés mais parce qu’ils sont des pauvres. Ainsi, soutenir, comme trop souvent à gauche, qu’il y a davantage d’immigrés dans les prisons parce qu’ils sont les plus pauvres est un argument inflammable… quand bien même il ne serait pas neuf. Il est, en fait, catastrophique. Il vise sans le vouloir la masse des hommes jeunes des quartiers populaires, immigrés ou non, à la fois exclus et en révolte contre ce monde qui ne leur fait pas de place. Donc on admettrait que les pauvres étant potentiellement délinquants, il faut les contrôler, les reléguer et les réprimer ? Au lieu de s’en tenir à la logique policière de la suspicion et de la contrainte, il est plus juste d’user d’une autre logique.
Ce n’est pas en assimilant classes populaires et classes dangereuses qu’on a pu contenir la tentation désespérée du hors-la-loi et de la violence. C’est quand on cesse de reléguer, qu’on intègre, qu’on ouvre à la possibilité de progression sociale, qu’on rompt le cycle infernal de la mise à l’écart et de la violence. Désigner les immigrés comme des délinquants potentiels contribue à exacerber leur ressentiment, leur désespérance et à nourrir l’idée qu’il n’y a pas d’autre solution que l’écart à l’égard de la loi. La politique anti-immigrée n’écarte pas la violence : elle la nourrit, la légitime et ouvre la possibilité de son extension sans fin.
Face au projet d’extrême droite qu’il faut désigner comme tel, et qui se traduit en projet de tri, d’exclusion, de hiérarchisation des vies, la question pour la gauche est celui d’affirmer valeurs, principes, finalités. En l’occurrence, dire qu’il faut une politique d’accueil des migrants aujourd’hui abandonnée. Et exprimer que la gauche vise la construction d’une France, d’un monde où chacun peut prendre place et nourrir l’espoir d’une vie meilleure. C’est le fond de notre projet et de la lutte contre la criminalité.
S’en tenir à discuter et corriger les chiffres sans proposer un autre récit revient à perdre la bataille avant même qu’elle ne commence. Ce qu’il faut opposer à Marion Maréchal, ce n’est pas seulement une meilleure lecture des données, c’est un projet alternatif. Une autre explication globale de ce qui produit l’insécurité, les tensions sociales, la violence.
L’impréparation évidente de la cheffe des écologistes est aussi le symptôme que la force des punchlines ne suffit pas quand il faut combattre une extrême droite solide. On ne va pas à un débat de cette nature sans savoir précisément ce que l’on veut y défendre. Dans un débat politique, celui qui sait où il va a toujours un avantage sur celui qui improvise ses réponses en défense. Le passage sur la question du voile des petites filles était une caricature : il ne fut même pas opposé à Marion Maréchal qu’elle ne s’intéresse au sort des femmes qu’au seul sujet du voile et qu’elle défend une vision archaïque des rôles sexuels ; que la gauche entend défendre les libertés pour toutes face à leurs ennemis, fascistes de tout poils, islamistes compris et qu’elle défend une laïcité qui permet à chacun de vivre selon ses convictions.
Ce débat n’est pas un accident médiatique mais un symptôme. On ne peut affronter l’extrême droite sans un projet et une vision solide, alternative au monde qui va mal. Les chiffres ne viennent qu’éclairer cette proposition politique et les punchlines, l’ancrer dans les mémoires. Pas l’inverse.
mise en ligne le 22 décembre 2025
Quatre luttes victorieuses en 2025 : pourquoi ça peut marcher
Guillaume Bernard sur https://rapportsdeforce.fr/
Mobilisation populaire contre la fermeture d’une ligne de train, grève éclaire contre un milliardaire d’extrême droite…Les luttes victorieuses existent et passent trop souvent sous les radars. Bien que rares, elles sont pourtant riches en enseignements. Quatre exemples en 2025.
La période est morose pour les luttes. Depuis les grèves de 1995 contre le plan Juppé, le gouvernement ne recule quasiment plus. Le grand mouvement contre la réforme des retraites de 2023 n’a pas permis d’obtenir son abrogation et, depuis, aucun mouvement social d’ampleur n’a emporté le pays. Ce constat général peut faire oublier que la lutte sociale est aussi une réalité locale.
Si la grève est rare dans les petites entreprises, plus d’un tiers de celles de plus de 500 salariés ont connu une grève en 2022, selon le service statistique du ministère du travail. À cela s’ajoutent de nombreux conflits environnementaux locaux et mobilisations contre les discriminations. Ainsi, quotidiennement, une multitude de luttes sont menées et des victoires sont obtenues. Pas toujours franches ou éclatantes, souvent arrachées grâce à des sacrifices, elles démontrent qu’une bataille n’est jamais perdue d’avance, et sont riches d’enseignements.
1 – Dans le Morvan, la population sauve sa ligne de train
Ils n’ont jamais été aussi nombreux sur le quai de la gare de Clamecy. Le 8 février 2025, deux cent cinquante personnes manifestent dans cette petite gare de la Nièvre. Ils n’attendent pas vraiment le train, ils veulent tout simplement conserver leur ligne. « C’est une question de survie de notre territoire. Alors, forcément, les habitants étaient très mobilisés », constate Nicolas Bourdoune, maire de Clamecy (PCF). Une semaine plus tard, ils seront près du double à manifester en gare d’Avallon.
La ligne du Morvan relie la petite commune de Deux-Rivières (1200 habitants) à la gare de Paris-Bercy, en 2h30. Une aubaine selon l’édile. « C’est un territoire très enclavé. Mais avec l’installation de la fibre et le premier confinement, beaucoup de cadres et d’artistes franciliens qui peuvent télétravailler l’ont réinvesti. Ils réhabilitent notre immobilier, s’investissent dans la vie locale…redynamisent le territoire ! La ligne était aussi utilisée pour les consultations médicales chez les spécialistes, dont notre territoire manque terriblement. » Or, fin novembre 2024, la Région Bourgogne-Franche-Comté annonce qu’elle n’a plus les financements pour maintenir la ligne au vu des investissements nécessaires. « On comprend que si rien ne bouge au printemps 2025, lors du prochain vote du budget de la région, c’est cuit. » La mobilisation commence.
De nombreux acteurs mobilisés
La lutte pour le maintien de la ligne du Morvan impressionne par la diversité des acteurs qui l’ont menée. Et c’est en partie ce qui explique son succès. « Il y avait d’abord des habitants et des élus locaux, décrit Nicolas Bourdoune, mais aussi des collectifs d’usagers du train ou encore des syndicats de cheminots et des partis politiques ». Le 1er mai 2025, « Ligne à défendre », association opposée à la fermeture, organise un trail depuis la gare de Corbigny jusqu’à Bercy. Les participants, qui se relaient, doivent parcourir 376 km en 3 jours. « C’était exactement ce qu’il fallait faire. Il y avait du monde, on a eu une belle médiatisation et ça a mis la pression à la Région, qui aurait voulu faire passer la fermeture en douce », salue le maire.
À l’arrivée de la course, c’est Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud-Rail qui les accueille. « On était déjà venu à plusieurs manifestations. Les petites lignes qui ferment, ça a un coût écologique, puisque ça pousse les habitants à reprendre leur voiture, ça enclave un territoire, pour nous cheminots, c’est une perte d’emploi. Et ça s’inscrit dans notre programme de lutte contre l’extrême droite car on sait que la fermeture de services publics fait monter le Rassemblement national. Certains de leurs cadres venus aux réunions publiques n’ont pas osé prendre la parole parce qu’on était là », explique-il. En septembre, Jérôme Durain, fraîchement élu à la tête de la Région, annonce finalement 3,6 millions d’euros d’investissement. La ligne est sauvée, pour le moment. « On a gagné un répit, mais on sait que dans 5 ans il faudra des investissements beaucoup plus lourds ». La bataille n’est donc pas terminée.
2 – Huit grévistes font plier un milliardaire d’extrême droite
Mobiliser tout un territoire n’est pas la seule recette pour gagner une lutte. C’est ce que rappelle la grève éclaire menée par des intermittents du spectacle contre le milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin. Le 6 octobre 2025, ils sont seulement 8 à refuser de monter la scène prévue pour la Nuit du Bien Commun, à Aix-en-Provence. Une soirée de mécénat à destination d’associations en accord avec la ligne réactionnaire de Stérin. Tous sont membres de « l’équipe road » : des salariés embauchés uniquement à la journée quand leurs collègues sont engagés sur le reste de la tournée.
« Quand on est arrivés ce matin-là, on a fortement douté du fait qu’on arriverait à bloquer la soirée qui devait se tenir à 20h. On a essayé de convaincre nos collègues d’arrêter le boulot mais rien n’y faisait », explique Nono*, syndicaliste au Stucs (syndicat de la culture et du spectacle de la CNT-SO).
Les grévistes installent donc leur piquet devant la salle de concert…puis sur la scène en train d’être montée. « Peu à peu, la situation est devenue très étrange. On était sur scène avec nos drapeaux syndicaux mais tout le monde bossait à côté de nous, comme si nous n’existions pas », sourit Nono*. A la mi-journée, la scène est installée, mais les grévistes ne bougent pas, curieux de voir comment ils seront mis à la porte. Un membre des renseignements territoriaux vient finalement les prévenir : une intervention policière les guette.
« Sauf que dehors, une manifestation de 250 personnes nous soutenait. C’est sans doute ce qui a découragé les organisateurs d’aller au bout. Ils risquaient un tel bazar si les policiers intervenaient que de toute façon leur soirée était fichue », estime Nono*. La soirée se transforme en visio lancée depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence. « Une salle moche où il y avait une quarantaine de personnes… Et sur le chat du live il y avait plus d’opposants que de soutiens », se réjouit Nono*. Loin d’être une simple action isolée, la grève d’Aix-en-Provence a donné du baume au cœur à tout le mouvement anti-stérin, qui a désormais pris une ampleur nationale.
3 – Femmes de chambre de Suresnes : 9 mois avant la victoire
Les luttes victorieuses d’une demi-journée sont des exceptions. Neuf longs mois de luttes ont été nécessaires pour gagner aux femmes de chambre de Suresnes (Hauts-de-Seine). « Et à la fin, on a toutes obtenu des CDI », sourit Kandé Tounkara, déléguée syndicale à la CGT-HPE. Le 19 août 2024, une petite vingtaine d’employées de Louvre Hôtels Groupe, propriétaire des marques Campaniles et Premières classes, qui disposent de deux bâtiments en bord de Seine, entrent en grève. Comme souvent dans les conflits du nettoyage, l’immense majorité d’entre elles sont des femmes originaires d’Afrique.
« On s’est d’abord levées contre une injustice qui touchait notre collègue Samia*, licenciée alors qu’elle travaillait à l’hôtel depuis dix ans », précise la syndicaliste. Durant ses vacances au Mali, cette femme de chambre était restée bloquée dans son pays par la perte de ses papiers, incapable de se rendre à son travail. « La direction était informée de sa situation mais l’a tout de même convoquée à un entretien préalable à licenciement… Comme elle ne pouvait toujours pas venir, ils l’ont virée sans le lui dire ! » Lorsque Samia* revient début août 2024, c’est la police qui la dégage des lieux. « C’était notre collègue ! On ne pouvait pas laisser passer un tel mépris. On s’est donc mises en grève. Mais on était un petit groupe : 17 sur 74 », témoigne Kandé Tounkara.
Une question de dignité
Secrétaire générale de l’union départementale CGT du 92, Élisabeth Ornago a épaulé les grévistes pendant toute la durée de la grève. « Au départ, la direction rejetait toutes leurs demandes », explique-t-elle. Outre la réintégration de leur collègue, les femmes de chambre, payées au SMIC, revendiquent des augmentations. Mais les grévistes s’obstinent. « Tous les jours, on était devant l’hôtel, même sous la pluie. On chantait, on lançait des slogans. On a reçu beaucoup de soutien de militants… pas trop des voisins. »
Outre le mépris du patron, les grévistes subissent aussi une pression policière. « Deux d’entre elles sont parties en garde à vue pour des nuisances sonores ! », s’offusque Élisabeth Ornago. « La grève était minoritaire et la direction jouait l’épuisement. » Les grévistes font donc évoluer leurs revendications. Plutôt que des augmentations de salaire, elles demandent des CDI à temps plein. Elles reçoivent également l’aide déterminante de la sous-préfète chargée de l’égalité des chances. « Elle a organisé plusieurs médiations avec la direction du groupe. Au bout de la troisième, on a pu sortir du conflit par le haut », estime Elisabeth Ornago. « On n’a rien lâché et on a obtenu des CDI, des temps plein, mais aussi des formations en langue française payées par notre direction », se réjouit Kandé Tounkara. La direction n’a toutefois pas cédé sur la réintégration de Samia*, mais lui a proposé une transaction, qu’elle a finalement acceptée.
4 – Geodis Gennevilliers, la victoire se construit sur des années
C’est un petit entrepôt qui résiste encore et toujours à son patron. En 2022, 2024 et 2025, les ouvriers de la plateforme logistique Géodis de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ont mené trois grèves victorieuses pour leurs salaires. Pour cela, pas besoin de potion magique, mais d’un collectif extrêmement soudé et capable de se mobiliser sur la durée.
Sur les 200 salariés que compte cette filiale de la SNCF, 130 sont ouvriers. Des réceptionnaires, des agents de quais, des manutentionnaires dont l’objectif est de parvenir à livrer « tout ce qui ne rentre pas dans une boîte aux lettres » en moins de 24 heures. Leur travail est éprouvant, exposé au froid et soumis à des horaires de nuit, dans la poussière et le bruit. « Mais lorsqu’on appelle à la grève, 95% d’entre eux nous suivent. Et sur la durée ! », souligne Laurent Sambet, élu CGT sur le site.
En mars 2025, après trois semaines à tenir le piquet, ils obtiennent 150 euros d’augmentation mensuelle de salaire, la hausse de leur prime d’ancienneté (de 5% à 10%) et même le défraiement du carburant sur le trajet domicile-travail pour les salariés véhiculés. Des avancées considérables pour des ouvriers dont les grilles de salaire commencent quasiment au SMIC. « Mais une goutte d’eau pour une boîte qui a réalisé des bénéfices record pendant le Covid, en livrant des masques, quand nous étions en première ligne », rappelle Laurent Sambet.
Habitude de la lutte et collectif soudé
Ce collectif si soudé ne s’est pas formé en un jour. En 2022, les ouvriers de Geodis Gennevilliers assument 6 semaines de grève. « Ca nous a permis de nous rencontrer. Alors qu’ils n’avaient pas trop le temps de se parler, les gars se sont rendu compte qu’ils avaient les mêmes vies… et donc les mêmes intérêts », poursuit le syndicaliste. En pleine grève, les salariés se mettent à distribuer les photocopies des fiches de paie de leurs dirigeants. « Les mêmes qui ne voulaient pas nous lâcher une centaine d’euros avaient des primes d’objectif annuel de 300 000€ ! Rien de mieux pour souder un collectif que de comprendre qu’une poignée de personnes se fout ouvertement de votre gueule », s’indigne Laurent Sambet. Depuis, le cégétiste explique tout faire pour maintenir ce dialogue avec et entre les salariés. « On est en discussion constante, tout comme la plateforme, notre local syndical est ouvert 24 heures sur 24. »
La récurrence des grèves sur la plateforme a aussi permis aux ouvriers de Géodis de lier des solidarités avec d’autres collectifs de lutte comme les Soulèvements de la Terre, des Gilets Jaunes ou encore les étudiants de l’université de Nanterre. « On s’est fait des amis et on va même les soutenir sur d’autres luttes, comme le projet Greendock, qui concerne aussi la logistique », explique Laurent Sambet.
mise en ligne le 21 décembre 2025
Jérôme Durain :
Face au narcotrafic,
« criminaliser tout le monde est
contre-productif »
Emilio Meslet sur www.humanite.fr
À la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté, l’ex-sénateur socialiste Jérôme Durain a présidé la commission d’enquête sur le narcotrafic, puis porté la loi transpartisane sur le sujet. Après le meurtre de Mehdi Kessaci, il revient sur les défis que pose le commerce illégal des stupéfiants.
Assiste-t-on, avec l’assassinat de Medhi Kessaci, à une bascule dans la prise de conscience de l’emprise du narcotrafic dans notre société ?
Jérôme Durain : Oui, plus personne ne peut désormais ignorer cette réalité. La bascule a néanmoins démarré le 14 mai 2024, date de la remise de notre rapport sénatorial sur le sujet et de l’évasion du trafiquant Mohamed Amra. Entre-temps, la presse locale a rapporté une litanie de faits graves entre les crimes, les saisies ou encore la corruption. Tout vient corroborer le constat de notre rapport : nous faisons face à un tsunami de la drogue.
Il est inquiétant à plusieurs titres : la place des jeunes dans les organisations criminelles, l’angle mort du numérique, la hausse du phénomène corruptif, l’extension territoriale du crime, la déstabilisation des institutions… Il ne faut pas oublier les territoires ultramarins, notamment la Guyane et les Antilles, où la situation est encore pire que dans l’Hexagone.
Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ?
Jérôme Durain : C’est l’histoire de la grenouille dans la casserole d’eau en ébullition : nous ne nous sommes pas rendu compte que nous étions en train de cuire. Il y a eu des lanceurs d’alerte, comme Amine Kessaci, des familles de victimes, des maires, des policiers, des douaniers, etc. Ils sont en première ligne et voient cette emprise. Mais il a fallu une multiplication des « narcomicides » et que des gens se fassent tuer dans nos rues pour une prise de conscience plus large. Désormais, ce problème est au sommet de la pile des priorités.
Amine Kessaci dit que nous sommes dans une « lutte à mort » entre l’État et les trafiquants. Qu’en pensez-vous ?
Jérôme Durain : Je comprends pourquoi il le dit. Nous ne sommes pas encore au point où la puissance publique bascule au stade de narco-État à cause de la corruption, mais la situation est préoccupante. Tout a commencé avec une corruption de basse intensité, entre menaces et appât du gain, visant les petits maillons de la grande chaîne de production économique et administrative. Un gendarme, un greffier, un docker, un douanier, un élu, un agent de la pénitentiaire…
L’impunité génère une perte de confiance des citoyens dans les institutions : si l’État n’est pas capable de nous protéger, à quoi sert l’État ? Il est difficile d’entendre qu’un trafiquant puisse continuer à gérer son business depuis sa cellule parce qu’on n’arrive pas à empêcher les téléphones portables d’entrer dans nos prisons. Désormais, il y a la crainte de voir la corruption et la violence toucher des cadres plus haut placés et de voir les institutions directement attaquées.
Sommes-nous assez armés pour mener ce combat sur les plans policier, juridique, diplomatique et social ?
Jérôme Durain : Avec la loi narcotrafic, nous avons fait dans le lourd sur le juridique comme sur le policier. Le texte brasse large : prisons, organisation des ports, gel des avoirs, création d’un parquet national dédié… Il n’a pas encore produit tous ses effets, mais on a fait le boulot. Sur le volet diplomatique, un travail est en cours, promettent Gérald Darmanin (ministre de la Justice) et Jean-Noël Barrot (ministre des Affaires étrangères).
Il reste deux priorités. La première concerne la police judiciaire et sa capacité d’investigation. Avec nos moyens actuels, il semble difficile d’attraper autre chose que les petites mains quand nous voudrions cibler les gros bonnets. On a besoin de moyens. La seconde problématique, c’est la prévention.
Avec le Sénat, où la droite est majoritaire, c’était impossible de le faire dans la loi narcotrafic mais il faut aussi tarir la consommation et soigner les malades, par exemple avec des haltes soins addictions (des salles de shoot – NDLR). Criminaliser tout le monde est contre-productif.
Le type qui fume un joint dans son salon, le gosse embarqué de force dans le trafic et le gros bonnet exilé à Dubaï n’ont pas la même responsabilité. Il y a donc urgence à parler de la situation sociale de notre pays. Prenons la cocaïne qui a vu sa consommation multipliée par deux en quelques années.
Elle est devenue une drogue bon marché. Il faut arrêter de penser qu’il s’agit d’une consommation de CSP + et du showbiz. Les métiers où l’on en prend le plus sont ceux dont la Dares nous dit qu’ils sont les métiers les plus en souffrance, comme le BTP ou la restauration.
L’explosion du narcotrafic questionne l’abandon des quartiers populaires par l’État. Qu’est-ce que la République a raté ?
Jérôme Durain : Quand on voit les dealers faire de l’action sociale en achetant des jeux et des fournitures scolaires aux enfants, ils prennent une place laissée libre pour acheter la confiance des populations. C’est l’échec du pacte républicain. Ce constat est aujourd’hui difficilement audible, car la droite dénonce une prétendue « culture de l’excuse ».
Pourtant, c’est une réalité : l’État ne leur laisse aucun autre débouché que celui de subir la menace. Cela se couple avec le développement d’une forme de pop culture criminelle violente, faisant le récit de l’argent facile, qui dévoie complètement notre idéal de société.
mise en ligne le 20 décembre 2025
La lutte contre les inégalités exige une révolution dans la gestion des entreprises
par Bernard Paranque, économiste sur www.humanite.fr
La démonstration des inégalités sociales qui sont renforcées par les inégalités devant l’impôt, les super-riches payant proportionnellement beaucoup moins d’impositions que les autres citoyens, exposé par Gabriel Zucman et Emmanuel Saez (Le triomphe de l’injustice, Points Essais, 2020), est argumentée de manière convaincante.
Toutefois la force de cette argumentation repose en partie sur le fait d’accepter un mythe (ou un hold-up idéologique) sur la question de la gestion des entreprises. Ce mythe est né dans les années 1970 avec l’affirmation que les entreprises devaient avoir un seul objectif, créer – il serait plus juste de dire « capter » – de la valeur pour les actionnaires (école de Chicago).
La réalité des pratiques managériales et de gestion des entreprises depuis plus de cinquante ans, a érigé ce mythe en dogme accepté par tous par la force de la domination culturelle et médiatique. La bataille idéologique a été perdue sur ce terrain-là.
Les actionnaires gèrent et considèrent l’entreprise comme si elle leur appartenait, avec l’aide des managers, des responsables, des dirigeants, formés dans les écoles de commerce et les universités, nourris au biberon de l’école de Chicago. Les cadres ainsi formés sont allés appliquer ces recettes et ces principes dans les entreprises, transformant ce mythe en réalité.
Ainsi a été validée la confusion savamment élaborée entre détention d’une créance, d’un titre de participation sur/dans une entreprise, et propriété de l’entreprise. Or l’entreprise créée sous forme de capitaux (SA, SAS, SCA) est une personne morale à la différence des entreprises individuelles, en nom personnel, et donc dotées d’une personnalité juridique rendant impossible toute appropriation par autrui (Refonder l’entreprise, Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Seuil, 2012).
Ce sont bien les premières qui comptent, celles qui pèsent sur la création de valeur, sur les marchés financiers, sur les contraintes budgétaires, sur les contraintes de financement de l’ensemble des (autres) entreprises. À partir de là, on entérine le fait que seuls les actionnaires ont leur mot à dire. Si à court terme il est nécessaire de se battre pour une fiscalité plus juste, il est tout aussi important, si on veut réellement lutter contre les inégalités, de s’attaquer au cœur du système, c’est-à-dire la gestion des entreprises.
Cela a été tenté dans les années 1980-1990 par Paul Boccara et un certain nombre d’autres économistes, issus de la section économique du PCF et de celle de la CGT, pour intervenir dans les gestions avec d’autres critères que ceux utilisés. Il s’agissait de ne plus se centrer sur le profit, mais sur la valeur ajoutée, ses conditions de production, de répartition, et les finalités des financements auxquels elle doit servir pour la société.
Cette fenêtre d’opportunité s’était ouverte avec les lois Auroux de 1982, reconnaissant aux comités d’entreprise de nouvelles prérogatives en matière économique. Cette bataille a été elle aussi perdue du fait d’un double mouvement. Le premier était celui de la domination des enseignements des écoles de commerce et universitaires en matière de conseils aux entreprises qui considéraient de fait que les entreprises appartenaient aux actionnaires, et donc qu’il fallait « simplement » que l’entreprise soit bien « gérée selon les intérêts des actionnaires ».
Le second prend sa source dans l’histoire du mouvement syndical qui considère que la gestion des entreprises n’est pas l’affaire des salariés. Les conséquences de cela sont qu’alors on en est réduit à déléguer aux dirigeants de l’entreprise et à l’État, la gestion du système productif et de ses entités, et de la lutte contre les inégalités.
C’est d’autant plus dommageable qu’il existe un certain nombre d’exemples et de structures comme les coopératives ouvrières de production ou les trusts du monde anglo-saxon, comme Duralex ou John Lewis Partnership en Angleterre, qui non seulement sont fondées sur le principe d’« un homme, une voix », et non pas « une action, une voix », mais surtout, montrent qu’il est possible de s’organiser et de s’émanciper de cette domination impérialiste de la création de valeur actionnariale, de sa maximisation, qui va de pair avec la lutte pour une fiscalité plus juste en réduisant, entre autre, les possibilités d’évasion fiscale.
mise en ligne le 18 décembre 2025
Le PLF 2026 doit répondre à l’exigence d’une politique du logement
sociale et solidaire
sur https://www.cgt.fr/a
Nous, CGT, Indecosa-CGT, CNL, CFE-CGC, CFDT et FSU, appelons à une réorientation profonde des choix budgétaires et des priorités pour restaurer l’investissement public et garantir un droit effectif pour toutes et tous.
La crise du logement, déjà profonde, s’aggrave dans notre pays. Se loger ne doit pas être un privilège. Le logement constitue aujourd’hui le premier poste de dépense des ménages en France, représentant en moyenne 27 % de leurs revenus et pouvant atteindre jusqu’à 50 % pour certains foyers, en particulier pour les locataires dans les zones tendues, selon l’Insee (2023).
Le logement est bien plus qu’un toit : c’est la condition première de la dignité, de la sécurité et de l’intégration sociale. Sans logement stable, comment travailler, étudier, accéder aux soins ou tout simplement vivre dignement ? Le diagnostic social est aujourd’hui alarmant, des millions de personnes sont mal logées ou menacées par l’insécurité résidentielle : logements surpeuplés, inadaptés à la perte d’autonomie, loyers trop élevés, précarité énergétique. Le droit au logement ne peut rester une déclaration, il doit se traduire par des investissements publics forts, à la fois pour la construction de logements sociaux – 2,9 millions de ménages sont en attente d’un logement social –, pour l’adaptation à la perte d’autonomie et la rénovation énergétique durable. Or le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 n’apporte pas de réponse à la hauteur des enjeux sociaux. Les annonces budgétaires récentes témoignent d’un désengagement financier encore accru de l’État, qui fragilise toujours plus les plus précaires et sacrifie la solidarité.
Pourtant, plusieurs propositions faciles à mettre en œuvre auraient un impact fort :
-
amender le PLF 2026 sur le renforcement de la taxation des logements vacants pourrait renforcer la loi et dissuader les rétentions prolongées ;
-
améliorer le « statut du bailleur privé » proposé via un amendement gouvernemental. Ce dispositif, s’il peut être utile afin de favoriser les investissements privés en faveur de logements, doit se déployer avec de réelles contreparties sociales, comme le plafonnement des loyers dans la durée ;
-
être vigilants face au déploiement du logement intermédiaire, qui ne peut être la seule réponse à la crise du logement. Un amendement propose d’étendre le régime du logement locatif intermédiaire (LLI) aux investisseurs particuliers, mais rien ne garantit une vocation sociale ou une modulation des loyers selon les revenus ;
-
renforcer la taxation des logements vacants et des logements meublés, timide aujourd’hui : l’amendement évoque une taxation progressive, mais l’échelle et la portée restent limitées au regard de l’urgence sociale.
La remise en question des aides publiques au logement, contenue dans le PLF 2026 et qui prévoit des économies générales sur la dépense publique, pourrait peser sur les financements de la mission « aide au logement ».
Nous dénonçons une vision réductrice : le logement est traité comme une charge budgétaire, et non comme un levier de cohésion sociale et de justice ! Il est inacceptable que la solidarité nationale ne bénéficie pas à toutes et tous : certaines mesures laissent même craindre une exclusion des plus fragiles. Les financements pour la rénovation urbaine et la politique de la ville doivent également être maintenus.
Le PLF 2026 révèle une ambition faible pour le logement social et une priorisation de l’austérité sur la solidarité. C’est un choix politique : nous refusons qu’il se traduise par un recul du droit au logement.
Nous appelons le Parlement, les élu·es locaux et les citoyen·nes à se mobiliser pour réorienter ce budget, restaurer l’investissement public dans le logement et garantir un droit effectif à un logement digne pour toutes et tous.
Nous, organisations signataires, appelons à une réorientation profonde des choix budgétaires et des priorités, pour une vraie politique du logement.
Cela nécessite de sanctuariser les crédits publics pour le logement social. Pour cela, il faut mettre un terme à toute baisse structurelle des dépenses affectées au logement social ; et lancer dès 2026 un grand plan pluriannuel de construction de logements sociaux, en lien avec les collectivités territoriales, afin de répondre rapidement à la demande, en France métropolitaine et ultramarine, avec notamment un retour substantiel de l’État dans leur financement.
Il faut renforcer l’aide au logement et la rendre universelle en garantissant l’accès à des « aide personnalisée au logement » (APL) revalorisées, sans discrimination : les aides doivent bénéficier à toutes et tous, y compris aux étudiant·es étranger·ères précaires.
La rénovation énergétique doit être encouragée avec justice en augmentant massivement les moyens publics pour la rénovation thermique des logements, en priorisant le patrimoine locatif social, les foyers modestes et en soutenant les bailleurs sociaux pour faire face à ce chantier. Il faut s’assurer que les dispositifs d’aide (primes, subventions) ne soient pas rabotés au profit de la logique d’austérité.
Une véritable réforme de la fiscalité immobilière en faveur du bien commun doit promouvoir la progressivité de la taxe sur la vacance des logements : plus la vacance dure, plus la taxe monte, de manière dissuasive et juste. Il faut aussi conditionner tout avantage fiscal aux propriétaires (amortissements, TVA réduite, etc.) à des obligations de loyers modérés ou à des critères de mixité sociale.
L’application définitive de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain – NDLR) doit permettre la construction de 25 % de logements sociaux dans toutes les communes concernées, et le renforcement des amendes payées par les collectivités réfractaires, qui se mettent en porte-à-faux de la solidarité nationale.
Il faut enfin décider une gouvernance démocratique et participative en instaurant des consultations systématiques avec les associations de locataires, les syndicats et les associations d’élu·es, pour l’élaboration et le suivi des politiques du logement.
mise en ligne le 10 décembre 2025
Les 8 mesures phares
du budget de la Sécu 2026
Ludovic Simbille et Guillaume Bernard sur https://rapportsdeforce.fr/
Ce 9 décembre, le budget de la Sécurité sociale pour l’année 2026 a été adopté à une courte majorité. Les plus grandes régressions sociales prévues par le gouvernement ne verront pas le jour. Mais si le pire a été évité, ce budget ne prévoit que de très faibles améliorations et quelques régressions notables. Rapports de Force fait le point.
C’est passé. De treize voix. Mais c’est passé. Ce 9 décembre les députés ont adopté à une courte majorité parlementaire (247 pour, 234 contre, 93 abstentions) le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2026.
Après des semaines de négociations, de dépôts d’amendements et de tractations, les parlementaires ont réussi à accoucher d’un budget de compromis. Les mesures les plus violentes socialement, comme le doublement des franchises médicales, le gel des prestations sociales et des pensions de retraites, ou encore le grand coup de rabot passé dans le budget des hôpitaux ne verront pas le jour. Mais si le pire a été évité, ce budget ne prévoit que de très faibles améliorations et quelques régressions notables.
Ce vote est important car la version définitive du PLFSS pourrait bien être celle adoptée ce 9 décembre par l’Assemblée nationale. En effet, même si le texte doit encore repasser par le Sénat, le gouvernement a toujours le pouvoir de demander aux députés de statuer définitivement, en application de l’article 45 de la Constitution.
1 : Budget quand même à la baisse pour l’assurance maladie
Au cœur des débats parlementaires, encore une heure à peine avant le vote du texte : l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Et pour cause, la première version du PLFSS annonçait le pire budget de l’hôpital depuis quinze ans, avec un ONDAM qui n’augmentait que de 2,1 % en 2026. Or l’augmentation des maladies chroniques et l’inflation font naturellement grimper les dépenses de santé d’environ 4 % chaque année. Toute augmentation inférieure implique donc des économies sur la santé. Au bout des débats parlementaires, l’ONDAM a finalement été porté à 3% par un amendement du gouvernement. Il reste toutefois inférieur à l’ONDAM de 2025 qui était de 3,6%.
2 : Abandon du gel des minimas sociaux et du doublement des franchises
Parmi les mesures les plus controversées pour maîtriser ces dépenses de santé : le doublement des franchises médicales et de la participation forfaitaire sur les médicaments, les consultations, les actes paramédicaux et pour le transport sanitaire. Autant sénateurs que députés ont voté contre cette augmentation du reste à charge au patient.
Autre mesure polémique non retenue en seconde lecture à l’Assemblée nationale : le gel des minimas sociaux. Sébastien Lecornu préconisait à l’origine une « année blanche » pour les prestations sociales (allocations familiales, RSA, prime d’activité, APL…) et pensions retraites. Traduction : les montants de ces prestations et pensions devaient être gelés en 2026, et non pas indexés sur l’inflation comme c’est le cas chaque année pour éviter une perte de pouvoir d’achat.
3 : Léger décalage de la réforme des retraites
Une autre mesure a été au centre des attentions, celle qui a fait dire à Marylise Léon, secrétaire général de la CFDT, qu’il faut « absolument voter », ce PLFSS. Il s’agit du décalage -et non de la suspension- de la réforme des retraites mise en place en 2023 par Élisabeth Borne. C’est l’aboutissement d’un compromis entre le gouvernement et le Parti socialiste, qui a permis la non-censure de Sébastien Lecornu et de son équipe.
L’augmentation d’un trimestre par an de l’âge légal de départ à la retraite, prévu initialement jusqu’à 2030, s’interrompt cette année. L’actuel âge légal de départ reste donc à 62 ans et 9 mois. Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein est lui aussi gelé. Il restera à 170 trimestres au lieu de 172. Le dégel de la réforme est prévu au 1er janvier 2028. En attendant, les personnes nées entre 1964 et 1968, qui devraient partir à la retraite entre 2026 et 2030 pourront partir plus tôt que prévu. Mais seulement de trois mois.
4 : Retraites des mères
Autre amendement qui promet un léger mieux, cette fois pour les mères. Leur retraite ne sera plus forcément calculée sur les 25 meilleures années. Si la future retraitée a un enfant, les 24 meilleures années seront prises, si elle en a 2 ou plus, seules les 23 meilleures années seront prises en compte. De quoi rehausser quelque peu le montant de leur retraite. Pour rappel, la retraite des femmes est inférieure de 27% à celle des hommes, selon l’OCDE.
Le PLFSS 2026 prévoit un accès légèrement facilité au dispositif de carrière longue pour les femmes salariées du privé. Ces dernières pouvaient comptabiliser 8 trimestres, au titre de la naissance, de l’éducation ou de l’adoption d’un enfant. Mais ces trimestres étaient dits « non cotisés » et n’entraient pas dans le calcul pour un départ anticipé. Le PLFSS prévoit d’en transformer deux en trimestres cotisés. Pour les fonctionnaires, un amendement permettrait par ailleurs aux mères fonctionnaires de bénéficier d’un trimestre de bonification pour chaque enfant né à compter de 2004.
5 : Plafonnement des arrêts de travail : un mois d’arrêts de travail
Avant d’être à la retraite, un changement non négligeable attend les salariés au 1er janvier. Celles et ceux qui cessent pour la première fois le travail à cause d’une maladie ou d’un accident devront retourner voir leur médecin un mois après. En deuxième lecture, les députés ont rétabli la limitation du premier arrêt de travail à une durée d’un mois et à deux mois lors d’un éventuel renouvellement. Selon les situations, les médecins pourront déroger à cette règle en le motivant sur leur feuille de prescription. Le Sénat avait rejeté cette mesure au motif qu’elle encombrait les professionnels de santé déjà surchargés. A l’origine, le gouvernement prévoyait de limiter à 15 jours le premier arrêt de travail s’il est prescrit par un médecin de ville et 30 jours s’il est à l’hôpital.
Jusqu’à présent, les salariés n’étaient soumis à aucune durée maximale lors d’une mise en pause professionnelle. Hors ALD, les indemnités maladies pouvaient être perçues pendant 360 jours par période de trois ans. Au prétexte d’un suivi médical régulier, le gouv18 pternement cherche ainsi à restreindre la hausse de l’absentéisme au travail et à maîtriser les dépenses d’indemnités journalières. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), celle-ci ont augmenté de 28,9 % entre 2010 et 2019, puis de 27,9 % entre 2019 et 2023. Un autre bon moyen d’éviter les répétitions de ces arrêts serait d’améliorer des conditions de travail, pour rappel, un salarié sur deux s’estime en détresse psychologique.
6 : Un nouveau congés naissance
C’est peut-être la réelle avancée créée par le PLFSS pour les travailleuses et travailleurs de ce pays. La version 2026 prévoit l’entrée en vigueur d’un congé de naissance. Chacun des nouveaux parents pourra prendre deux mois de congés pour accueillir le nouveau-né, soit d’affilée, soit en fractionné.
De ce que prévoyait le gouvernement, le premier mois serait indemnisé à 70% du salaire, le second à 60%. Prévu pour entrer en vigueur en 2027, les députés ont finalement avancé l’échéance au 1er janvier prochain. Ce nouveau temps dédié à l’arrivée du nouvel enfant se cumulera avec les congés maternité et paternité, déjà existant. Cette promesse d’Emmanuel Macron, formulée dès 2024, entre dans sa stratégie de relance de la natalité, désormais en berne en France.
7 : Défiscalisation des heures sup’
Les déductions de cotisations patronales sur les heures supplémentaires ont été étendues aux entreprises de plus de 250 salariés par l’Assemblée nationale. Cette réduction de 0,50 euro par nouvelle heure provient d’un amendement issu des rangs Les Républicains (LR). Censé récompenser « la France qui travaille », celle « de l’effort et du mérite », ce dispositif « a fait ses preuves sous Sarkozy », croit savoir Thibault Bazin, à l’origine de la mesure.
Alors président de la République, Nicolas Sarkozy avait en effet mis en place cette mesure en 2007. Le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Pourtant, l’impact de cette « défiscalisation » sur la quantité d’heures travaillées, sur l’emploi, ou le revenu des ménages les plus modestes n’avait pas été démontré. En revanche, « employé et employeur peuvent s’accorder pour déclarer chaque mois des heures supplémentaires fictives afin de bénéficier des allègements et se partager cette manne fiscale », écrit le cercle des économistes. Défiscalisez, défiscalisez, défiscalisez, en restera-t-il quelque chose ?
8 : Hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine
Via un amendement du Parti socialiste, l’Assemblée nationale souhaitait augmenter la CSG sur les revenus du patrimoine (Contribution sociale généralisée). Cet impôt, qui finance la Sécurité sociale, devait passer de 9,2% à 10,6%. Le sénat, majoritairement à droite, s’y était opposé. En seconde lecture à l’Assemblée nationale, un compromis a finalement été trouvé.
Un amendement a exclu de cette hausse les revenus liés à l’épargne et l’investissement locatif (assurance-vie, plus-values immobilières, PEL, plan d’épargne populaire, etc.), qui restent taxés à 9,2 %. Forcément, cette hausse d’impôt rapporte moins que prévu à la Sécu : 1,5 milliards d’euros au lieu de 2,8.
mise en ligne le 9 octobre 2025
« Si les macronistes ne veulent pas la dissolution, c’est la cohabitation » : après la déclaration de Lecornu, PS, PCF et Écologistes poussent leur candidature à Matignon
Florent LE DU sur www.humanite.fr
L’entretien du premier ministre démissionnaire à France 2 n’ayant pas apporté de réels enseignements, chaque parti de gauche reste depuis sur ses positions. La revendication de former un gouvernement de cohabitation à gauche pour les uns, l’appel au départ du chef de l’État pour les autres.
Les concessions sont si rares, en huit ans de Macronie au pouvoir, qu’il faut savoir les exploiter. Mercredi soir, sur France 2, Sébastien Lecornu n’est pas allé jusqu’à lâcher quoi que ce soit pour convaincre la gauche, mais il a concédé, sur la réforme des retraites, la nécessité « que le débat ait lieu ». En 2023, celui-ci avait été empêché par le 49.3 d’Élisabeth Borne, arme que le premier ministre démissionnaire a recommandé de ne pas utiliser pour le futur vote du budget.
Le parti socialiste y a vu une brèche dans laquelle s’engouffrer. « J’entends de la voix du Premier ministre démissionnaire qu’il y a un certain nombre de fenêtres d’opportunité qui s’ouvrent sur la question de la réforme des retraites, sur la question d’un débat parlementaire apaisé avec l’abandon du 49.3 », a jugé sur LCI le secrétaire général du PS Pierre Jouvet. Pour lui, cela ne peut ouvrir que sur une solution : « Nommer un Premier ministre de gauche et des Écologistes pour mener à bien la réconciliation du pays ».
En marge de la journée de mobilisation de la CGT Santé, Sophie Binet a également souligné cette référence à la réforme de 2023 : « Nous sommes en position de force depuis qu’Emmanuel Macron a fait passer en force la réforme des retraites, nous avons déjà enterré cinq premiers ministres. Il n’y aura pas de stabilité politique sans justice sociale et sans abrogation de la réforme », clame la secrétaire générale de la CGT.
« Rien n’est clair, tout reste nébuleux »
L’autre enseignement de cette prise de parole est que Sébastien Lecornu et probablement Emmanuel Macron par extension sont persuadés qu’il est encore possible d’éviter de nouvelles législatives anticipées. « Il y a une majorité absolue à l’Assemblée nationale qui refuse la dissolution », a indiqué le premier ministre démissionnaire pour justifier qu’un nouveau gouvernement soit nommé, d’ici vendredi soir. « Si les macronistes ne veulent pas la dissolution, je n’ai qu’une seule solution pour eux, c’est la cohabitation », a rebondi la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier.
Des interprétations faussement naïves des paroles de Sébastien Lecornu. En réalité, la gauche n’est pas dupe : « Si les Français attendaient une clarification de la part du premier ministre démissionnaire, ils ont dû être déçus. Rien n’est clair, tout reste nébuleux, remarque Ian Brossat, sénateur et porte-parole du PCF. La seule chose qui en ressort, c’est la volonté des macronistes de rester coûte que coûte au pouvoir pour poursuivre la même politique, moyennant quelques aménagements. Si tel devait être le cas, le couperet de la censure tomberait rapidement. »
La France insoumise, qui ne croit pas en la nomination d’un gouvernement de gauche en l’état et donc ne revendique pas Matignon – « il faut cesser de croire à cette farce », a encore déclaré Manuel Bompard mercredi soir – a elle aussi cherché à prendre aux mots Sébastien Lecornu.
En particulier lorsque ce dernier a glissé que la question des retraites « s’invitera à l’élection présidentielle ». Une manière de la repousser à plus tard ? « Puisque le Premier ministre a indiqué ce soir qu’aucun sujet ne pouvait être tranché pendant 18 mois en attendant l’élection présidentielle de 2027, nous proposons, nous, comme solution, que le peuple français puisse décider de son avenir dès maintenant et qu’avec le départ d’Emmanuel Macron, il puisse y avoir une présidentielle anticipée », a alors réagi Mathilde Panot, présidente du groupe insoumis à l’Assemblée nationale. En attendant de voir la couleur du gouvernement que va choisir Emmanuel Macron, chaque parti de gauche reste donc sur ses positions.
mise en ligne le 9 octobre 2025
« Taxer un peu plus les riches, ça nous parle » : dans la Loire, des grévistes victorieux se démarquent de l’instabilité politique
Mathilde Goanec sur www.mediapart.fr
Les salariés de JDE Peet’s, qui fabriquent les capsules de café L’Or près de Saint-Étienne, viennent de remporter une manche pour un meilleur partage des richesses dans leur entreprise. S’ils regardent souvent de loin les débats partisans du moment, ils appellent à s’inspirer de leur « solidarité ».
Andrézieux-Bouthéon (Loire).– Son téléphone sonne sans arrêt, tout le monde vient aux nouvelles. Mais mercredi 8 octobre, ce n’est pas de l’éventuelle nomination d’un nouveau premier ministre ou d’une éventuelle suspension de la réforme des retraites qu’on parle à Jérôme Stravianos, délégué syndical CFDT de l’usine JDE Peet’s à Andrézieux-Bouthéon.
« Ouais, on vient de signer à l’instant, c’est bon », répond invariablement le responsable syndical du site situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Saint-Étienne. Après seize jours de grève, une semaine de blocage des camions à l’entrée de l’usine et un rond-point occupé jour et nuit, la direction de cet énorme groupe de café basé à Amsterdam et coté en Bourse a enfin lâché sur les augmentations de salaires que réclamaient les grévistes – 180 personnes au pic de la mobilisation, soit la moitié de l’usine et la quasi-totalité du personnel de production et de maintenance.
Il était temps, « la fatigue commençait à s’installer », raconte Jérôme Stravianos, près du monticule de palettes qui brûlent pour quelques heures encore. Les salarié·es ont obtenu 160 euros brut supplémentaires par mois, contre les 50 proposés au début de la négociation, ainsi qu’une prime annuelle de 1 500 euros, 500 euros de mieux que ce que la direction proposait au départ.
Une « victoire » revendiquée par les grévistes, qui éclipse l’agitation politique du moment et que l’on célèbre en se tapant dans le dos. Même si les salarié·es sont lucides sur le poids réel des sommes en jeu. Le commerce du café est florissant et JDE Peet’s a engrangé 422 millions de bénéfices au cours des six derniers mois, dont 350 millions reversés aux actionnaires. Du haut de ces montagnes de profits, les augmentations arrachées au forceps ne constituent qu’une poussière.
Car si le groupe néerlandais, qui se donne pour mission incongrue de « libér[er] le potentiel du café et du thé pour créer un avenir meilleur », est inconnu du grand public, ses marques sont célèbres : L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre, Grand’Mère, Maxwell House… L’usine d’Andrézieux-Bouthéon fabrique principalement les capsules de café L’Or qui sont vendues dans toute l’Europe.
Le partage des richesses, donner à chacun sa part du gâteau, c’est aussi tout ce dont les gouvernements successifs ne veulent pas. Christophe, salarié de JDE Peet’s
Christophe dit que le conflit social, auquel il a pris part avec constance, l’a « réveillé ». Et il assure que l’enjeu local « résonne complètement » avec la situation politique qui prévaut au niveau national, et la litanie de blocages institutionnels dans lesquels la France s’englue depuis deux ans. « Le partage des richesses, donner à chacun sa part du gâteau, c’est aussi tout ce dont les gouvernements successifs ne veulent pas, trop occupés par leurs petites personnes », estime le salarié.
Patrice Badiou, qui représentait la CGT dans la négociation, a quant à lui pensé au débat sur la taxe Zucman tandis qu’il bataillait sec pour ses collègues. « Nous faisons face à une société qui est la championne de l’optimisation fiscale, et qui nous a transformés en “centre de coûts” [un site qui concentre les pertes – ndlr] pour payer le minimum d’impôts en France, analyse-t-il. Donc taxer un peu plus les riches, et voir l’opposition que cela soulève, cela nous parle. »
Une « faille » dans le système
Afin d’occuper le rond-point en continu, les salarié·es en cinq-huit (cinq équipes se relaient sur des plages de huit heures) ont reproduit les rotations de l’usine, celles qui avalent régulièrement leurs soirées, leurs nuits et leurs week-ends. Pendant la grève encore, les un·es ont relevé les autres dans un ballet bien rodé. Mais Leila s’est « régalée » de ces moments nouveaux, hors de la routine, à discuter des heures durant avec les collègues.
Bien sûr, la conversation a parfois roulé vers la politique et l’instabilité à la tête de l’État. « S’ils ne réussissent pas à former un gouvernement, ce n’est quand même pas nous qui allons le faire ! Mais ce serait bien que les choses changent, considère la gréviste. Il y a une faille dans le système, ceux qui s’enrichissent, ce sont toujours les mêmes. » Ses collègues et copines ironisent : « Le plein de courses, il est à 300 euros net, et ça, ça ne change pas ! »
C’est une forme d’indifférence qui domine pourtant face aux tractations politiciennes de ces derniers jours. « C’est sûr, on était “focus” sur ce qui nous arrive à nous, mais nous sommes aussi lassés de la politique, explique Slimane. Macron, il change de ministre toutes les cinq minutes, on n’arrive même plus à tenir le compte ! »
L’homme, « douze ans de boîte », préfère évoquer les « vingt balles » seulement d’augmentation obtenus en 2024 malgré des résultats déjà record, l’intéressement qui se réduit comme peau de chagrin en raison d’objectifs à atteindre trop élevés, mais aussi ces « 80 millions d’euros perdus par ligne de production et par jour » quand les ouvriers d’Andrézieux-Bouthéon ont décidé de s’arrêter. « Le moyen d’action, il est ici », revendique Slimane.
« C’est le chaos à Paris, mais les gens vivent leur fin de mois ici, confirme Patrice Badiou. Je suis syndicaliste, je ne dis pas que le système politique actuel et la bataille qu’on mène ici ne sont pas liés. Mais disons que si on regarde l’énergie qu’il faut déployer, on pense que cela a plus de sens de la mettre dans le genre de lutte que nous avons menée ici. »
De cette grève chez JDE Peet’s, historique par sa durée pour celles et ceux qui l’ont conduite, Christophe veut avant tout retenir la solidarité qu’il a ressentie et expérimentée pendant deux semaines. « Et la solidarité, tout là-haut, patrons ou politiques, ils n’aiment pas ça, cingle-t-il. Ce n’est pas facile à gouverner, un peuple solidaire. Et parfois, ça coupe des têtes. »
mise en ligne le 8 octobre 2025
Le progrès social,
seule issue à la crise !
Communiqué CGT sur https://www.cgt.fr/
Le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce lundi sa démission 27 jours seulement après sa nomination, avant même d’avoir prononcé son discours de politique générale et présenté son budget. Depuis sa nomination, les travailleurs et les travailleuses se sont mobilisés à trois reprises pour dénoncer la violence du budget en préparation et exiger des réponses sociales, écrivant ainsi une rentrée sociale inédite.
Au lieu de revoir sa copie, de renoncer aux reculs sociaux (année blanche, réforme de l’assurance chômage, doublement des franchises médicales…), au lieu de mettre en place la justice fiscale et d’abroger la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a préféré maintenir le budget et le gouvernement de son prédécesseur. Il n'a pas eu le courage d'affronter les grands patrons et les plus riches et de rompre avec la politique de l'offre d'Emmanuel Macron.
Il est donc le 5e Premier ministre en 2 ans à être contraint à la démission du fait de la violence sociale de sa politique
Encore une fois, au lieu de changer de politique le président de la République fait le choix du chaos institutionnel. Il prend le risque de transformer une crise sociale et démocratique en crise de régime. Le Medef, quant à lui, en multipliant les gesticulations pour empêcher toute justice fiscale et sociale, porte une lourde responsabilité.
Cette décision est d'autant plus grave dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, alors que l'extrême droite représente un danger central pour les démocraties, les libertés et les droits sociaux en France et dans le monde.
Les travailleuses et les travailleurs, les jeunes et les retraité·es ont construit une mobilisation historique pendant 2 ans et demi contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait le choix de l'ignorer et d'imposer sa réforme par 49-3. Il a donc été sanctionné par les urnes et a perdu toute majorité suite à sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale. Les travailleurs et les travailleuses, et la population doivent être entendus. Les dénis démocratiques et les passages en force doivent cesser.
Comme la CGT le martèle : il n'y aura pas de stabilité sans justice sociale
Face à l'irresponsabilité du président de la République, du gouvernement et de leurs alliés patronaux, la CGT appelle au rassemblement des forces de progrès social pour barrer la route à l’extrême droite et gagner enfin la réponse aux urgences sociales et environnementales :
-
Mettre en place la justice fiscale
-
Débloquer les moyens nécessaires pour nos services publics et pour la transformation environnementale
-
Abroger la réforme des retraites
-
Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux
-
Arrêter les licenciements, réindustrialiser et décarboner le pays
-
Mettre fin à la chasse aux travailleuses et travailleurs sans papier et à la stigmatisation des étrangers et des précaires
Dans ce contexte d'instabilité maximum, la CGT continuera à prendre toutes ses responsabilités pour que le monde du travail soit enfin entendu
Plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, privé.es d'emploi, jeunes retraité.es se sont déjà mobilisé·es les 10, 18 septembre et 2 octobre dans le cadre d'une rentrée sociale d'ampleur historique. Le 9 octobre, à l’initiative des professionnels de la santé et de l’action sociale, de la sécurité sociale et du médicament une manifestation nationale aura lieu pour exiger un tout autre budget de la Sécurité sociale à la hauteur des besoins.
La CGT appelle les travailleuses et les travailleurs à continuer leurs actions dans les entreprises pour les salaires, l’emploi et les conditions de travail.
La CGT continuera à travailler pour renforcer l’unité syndicale et permettre les mobilisations les plus larges.
mise en ligne le 6 octobre 2025
En Gironde, un dimanche révélateur des divisions « délétères » de la gauche
Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Pendant que Raphaël Glucksmann faisait sa rentrée à La Réole en réitérant son rejet de toute alliance avec La France insoumise, un collectif citoyen manifestait dans une commune voisine contre le Rassemblement National. Face à l’extrême droite qui convoite cette circonscription rurale gagnée par LFI en 2024, la demande d’unité à gauche n’a pas disparu.
La Réole, Saint-Macaire (Gironde).– Bernard n’est pas un fervent défenseur des partis de gauche. Béret vissé sur la tête, le retraité a plutôt tendance avec l’âge à se radicaliser plus à gauche qu’eux. Syndiqué à la CGT quand il officiait comme technicien du spectacle, il a fini par rejoindre l’anarchiste Confédération nationale du travail (CNT). Et pourtant, dimanche 5 octobre à Saint-Macaire, village de 2 500 habitant·es en Gironde dans lequel il réside depuis vingt ans, il défend l’union de la gauche.
« Du NPA [Nouveau Parti anticapitaliste – ndlr] jusqu’à certains du PS [Parti socialiste – ndlr], on est tous solidaires contre un même ennemi », dit-il en choisissant ses mots. Cet ennemi, c’est l’extrême droite qui tisse sa toile dans le département, comme partout en France. Ce jour-là, le militant a donc encore une fois pris le chemin de la rue pour protester, alors qu’Edwige Diaz, députée de la 11e circonscription de Gironde et vice-présidente du Rassemblement national (RN), tient une réunion publique dans la salle municipale François-Mauriac.
Officiellement, l’événement fait office de bilan de mandat pour l’élue d’extrême droite, mais la présence de François-Xavier Marques, ancien candidat aux législatives et référent du RN dans la 9e circonscription, ne trompe personne sur la volonté du parti de s’implanter là où il n’est pas encore installé. Dans la 12e circonscription, dont Saint-Macaire fait partie, une députée de La France insoumise (LFI), Mathilde Feld, a été élue de justesse – avec 480 voix d’écart – face au RN en 2024, sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).
« C’est une députée aux abois, elle se sait extrêmement menacée sur sa circonscription en cas de dissolution », a déjà eu l’occasion de dire Edwige Diaz à son sujet. Les élections municipales sont aussi dans le collimateur du parti de Marine Le Pen. Pour assister à la réunion de Saint-Macaire, il fallait s’inscrire. Manière de se constituer un fichier à l’approche de cette échéance, en mars 2026, et en cas d’imprévu – une dissolution, que la composition du nouveau gouvernement révélée dimanche soir et la démission du premier ministre, Sébastien Lecornu, dès le lendemain, ne font que rendre plus probable à terme.
Une résistance locale unitaire
Bernard a répondu à L’Appel du 18 mai, un collectif citoyen formé depuis les élections européennes de 2024, dont le tract très neutre en apparence et vierge de tout logo a essaimé partout dans le village : « Nous sommes la majorité ! Nous ne voulons pas que le fascisme et le racisme prospèrent dans nos sociétés », se concluait-il. Environ 150 personnes ont suivi son exemple. « RN, parti corrompu », « Marre des fachos », lit-on sur les pancartes confectionnées pour l’occasion.
« La résistance locale doit se construire. On n’a pas la garantie que Mathilde Feld soit reconduite si on ne se mobilise pas dès maintenant pour les municipales », prévient au micro Jacques, un membre du collectif, avant que des militant·es reprennent des airs connus avec des paroles engagées à la manière des Goguettes, sous le kiosque à musique du village. La réunion du RN commence à quelques dizaines de mètres de là, sous les huées et le regard patibulaire du service de sécurité. Quelques retardataires entrent, parfois une capuche sur la tête pour se cacher – ici tout le monde se connaît.
Des crânes rasés et des chaussures coquées ont aussi été aperçus. Deux mondes se font face. Le maire Cédric Gerbeau a fait valoir dans un communiqué « le principe d’égalité et la liberté de réunion », précisant que la majorité municipale « s’oppose fermement à tous les préceptes développés historiquement par ce parti politique d’extrême droite ». La réservation de la salle n’avait pas été faite au nom du RN. Sylvain Capelli, adjoint au sport présent au contre-rassemblement, fait face aux récriminations des militant·es de gauche en pointant le manque de solidarité des élu·es locaux du département.
Ces derniers craignent de braquer un électorat qui se manifeste toujours plus massivement dans les urnes. Bernard l’admet : « Dans les milieux ruraux, les gens ne s’informent que par la télé, et on sait ce que c’est devenu : des médias clairement d’extrême droite, qui font de la propagande et tournent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je connais dans le coin des gens qui se laissent laver le cerveau en regardant ça. » Entre deux slogans lancés devant la salle municipale, qui s’est remplie d’une centaine de personnes, Annie Descot, militante à Attac, rapporte le même constat : « Dans mon village, ce sont les mêmes qui votaient François Hollande il y a quinze ans. »
Si l’on suit son regard, la responsabilité de l’ancien président socialiste, dont le quinquennat a dévasté la gauche, est engagée. Celle d’Emmanuel Macron, qui n’a accédé à aucune des revendications des Gilets jaunes, aussi. « La colère est profonde », dit-elle en espérant « que le NFP gardera sa structuration » en cas de dissolution. Pour elle, seul un « rassemblement le plus large possible de la gauche » permettrait de résister. « Et pas des sociaux-libéraux », précise-t-elle.
« Les gens veulent une gauche combative »
Au même moment, à quinze kilomètres de là, le long de la Garonne, Raphaël Glucksmann concluait ses journées de rentrée à La Réole. Le fondateur de Place publique a lui aussi l’hypothèse d’une dissolution en tête, mais il martèle qu’il n’y aura plus d’alliance avec LFI. « Si le seul objectif est de barrer la route au RN, alors avoir un candidat LFI est la pire des choses possibles », assumait-il devant des journalistes, samedi 4 octobre. Le credo de Place publique a fini par infuser dans une bonne partie du PS, qui avait envoyé une délégation de représentant·es.
Mais même chez les sympathisant·es de l’eurodéputé, l’idée fait grincer des dents. Gaétan Loustalot, jeune élu de 23 ans au conseil municipal de La Réole – ville dirigée par le maire Place publique Bruno Marty –, n’a pas oublié les tags retrouvés à la mi-septembre dans la commune de 4 500 habitant·es : une flopée d’insultes racistes et un vœu sinistre : « Bardella 2027 », « RN 2027 »… « Le climat n’a pas beaucoup évolué dans le territoire depuis les législatives de 2024, mais en cas de dissolution, s’il n’y a pas une alliance à gauche, la circonscription peut basculer. Si la députée sortante fait face à une candidature PS, ce sera compliqué », dit-il, un peu gêné.
« C’est certain que cela pénaliserait la gauche, alors que des pans entiers de la population penchent très fort vers le RN, abonde Guillemette Tracou, investie dans la vie associative locale. Beaucoup de gens ont été déçus que Bruno Marty ne soit pas investi en 2024, mais Mathilde Feld est aussi une femme de valeur. »
Lors d’une table ronde dimanche 5 octobre sur les « petites communes », le sujet de la montée du RN était en arrière-plan, sans que la réponse politique de la gauche soit abordée. Bouchra Talsaoui et Khalid Benjilali, qui tiennent le Café de la gare de La Réole depuis 2021, ont pourtant été marqués par l’épisode des tags. Ils rapportent que des client·es assument désormais un vote RN, ce qui n’était pas le cas avant. « Il faut que la gauche soit unie, c’est clair, dit Khalid, qui y intègre LFI. Vu le contexte économique, les gens veulent une gauche combative, une gauche qui retrouverait son projet initial. La division serait délétère. »
En 2022, le maire Bruno Marty s’était présenté aux législatives en dissidence à la candidature de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), déjà représentée par Mathilde Feld. Il avait obtenu 9,7 % des suffrages exprimés. En 2024, il n’avait pas réitéré. Que fera-t-il aux prochaines échéances, alors que Raphaël Glucksmann n’arrête pas de répéter que la rupture avec LFI est « définitive » ?
« Quand on discute avec les gens, ils ont l’impression qu’on leur demande de faire un choix entre l’extrême gauche et l’extrême droite. Dans le monde rural, le discours de LFI, souvent orienté vers la France des banlieues, ne passe pas. Il faut que la ligne politique soit claire, sinon les gens de gauche finiront par s’abstenir, voire voter RN », déclare l’édile. À propos du rassemblement contre le RN à Saint-Macaire, il commente : « Ces initiatives sont importantes, mais ça ne fera pas tout. Il faut parler aux Français, on a besoin d’une gauche qui ne juge pas le monde rural. »
À La Réole ce week-end, Raphaël Glucksmann, persuadé qu’il ne faut pas laisser le sujet de l’identité française au RN, avait teinté son discours de patriotisme : « Il y a dans ce pays une angoisse sur ce que veut dire être français, il faut y répondre. » L’angoisse tout aussi réelle sur ce que voudrait dire une gauche divisée, ou qui tournerait le dos à ses engagements, était absente.
mise en ligne le 5 octobre 2025
En Espagne,
l’État providence rapporte
un pognon de dingue
Luis Reygada sur www.humanite.fr
Le gouvernement de coalition de gauche mené par Pedro Sanchez fait figure de meilleur élève européen en menant des politiques inverses aux diktats néolibéraux et austéritaires. L’État providence espagnol fait recette. Étonnant ?
Fort d’un bilan économique qui se distingue très clairement dans une Europe atone, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, pouvait, fin juillet, lors de la présentation de son bilan annuel, affirmer que le pays qu’il dirige depuis juin 2018 « traverse l’une des périodes les plus prospères de son histoire démocratique ».
Exagération de la part du chef d’État socialiste, qui assume en plus vouloir continuer à renforcer sa politique d’« État providence », pour le bénéfice de la plus grande partie de la population ? N’en déplaise à son opposition, les chiffres lui donnent raison, et certains vont même jusqu’à parler de « miracle espagnol ».
Le royaume ibérique fait d’ailleurs office de locomotive de l’Union européenne (UE), paraissant laisser loin derrière les conséquences des crises économiques liées à la pandémie de Covid (récession) puis à la guerre en Ukraine (inflation). Même la guerre commerciale déclarée par les États-Unis paraît à peine effleurer l’économie espagnole.
Des statistiques au beau fixe
L’année dernière, le produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne – la quatrième économie de la zone euro – avait bondi de 3,5 %, soit une progression quatre fois supérieure à la moyenne de l’UE. Pour 2025, le taux de croissance ne devrait atteindre « que » 2,7 %, alors que la Commission européenne prévoit une croissance moyenne de 0,9 % dans l’UE.
L’Espagne devance ainsi toutes les grandes économies voisines (0 % de croissance prévue pour l’Allemagne, 0,6 % pour la France et l’Italie) et va même jusqu’à représenter à elle seule 50 % de la croissance de la zone euro.
En parallèle, le déficit public de l’Espagne affiche sa quatrième année consécutive de baisse (2,8 % du PIB, soit 44,6 milliards d’euros), une tendance que suit aussi la courbe du chômage : même si, avec 10,3 %, son taux reste bien plus élevé que la moyenne européenne (6 %), il est actuellement à son plus bas niveau depuis 2008.
Aujourd’hui, le pays – qui accumule le quart des nouveaux emplois créés dans l’UE durant ces cinq dernières années – compte 2,3 millions d’emplois de plus qu’avant la pandémie, tandis que son PIB par habitant a augmenté de 16,4 %.
Le pouvoir du pouvoir d’achat
Pour atteindre ce niveau de dynamisme, l’Espagne s’appuie sur plusieurs leviers. Un commerce extérieur avec le vent en poupe et peu dépendant des États-Unis (son 6e partenaire commercial), des entreprises qui investissent (+ 2,1 %), un tourisme (2e place mondiale) qui bat tous les records avec 94 millions de visiteurs étrangers en 2024 (+ 10 %) et 126 milliards d’euros dépensés par ceux-ci (+ 16 %).
Les aides de l’UE jouent aussi un rôle considérable : avec 55 milliards d’euros reçus depuis 2021, Pedro Sanchez a fait de l’Espagne le premier pays bénéficiaire depuis le lancement des divers plans de relance destinés à aider les États membres de l’UE à se remettre de la pandémie de Covid.
Le gouvernement a très clairement fait de la captation de ces ressources une de ses priorités, facilitant les démarches aux différents niveaux administratifs pour ne pas laisser échapper la manne bruxelloise.
Néanmoins, ce sont surtout la hausse de la consommation des ménages (+ 2,8 % annuels) ainsi que de la consommation publique (+ 18,4 % depuis l’avant-pandémie, 7 points de plus que la moyenne de l’UE) qui sont les facteurs réellement déterminants de l’autre côté des Pyrénées.
L’austérité n’est pas un passage obligé
Pour la gauche au pouvoir en Espagne, c’est avant tout l’inverse du modèle néolibéral promu par Bruxelles qu’il fallait surtout suivre, et mettre en place au contraire une politique de la demande, basée sur le moteur qu’est l’emploi.
« À partir de 2020, avec l’arrivée du premier gouvernement de coalition, un changement de stratégie clair s’est opéré en matière de politique économique. La politique d’austérité et de dévaluation salariale – imposée après la crise financière de 2008 et très coûteuse en termes de bien-être social – a été abandonnée au profit d’une politique budgétaire expansionniste », explique l’économiste Ignacio Alvarez Peralta, secrétaire d’État aux Droits sociaux entre 2020 et 2023 et actuellement professeur à l’université autonome de Madrid.
Pour lui pas de doute : avec une hausse du pouvoir d’achat à la suite d’un bond de 60 % du salaire minimum en cinq ans (1 184 euros net par mois aujourd’hui) et une réforme du travail, en 2022, qui a notamment transformé 1,5 million de CDD en CDI tout en renforçant une série de droits pour les travailleuses et les travailleurs, difficile d’échapper à une « phase de croissance remarquable »…
Soutenues par une augmentation de la consommation publique (croissance réelle de 40 % des dépenses publiques entre 2019 et 2024) et de la consommation privée, ainsi que des recettes fiscales (+ 10 % durant le premier semestre 2025), notamment grâce à de nouveaux impôts visant les revenus du capital et les plus hauts contributeurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
L’emploi, source de richesse
En définitive, les performances économiques de l’Espagne n’ont rien d’un miracle, et c’est plutôt du côté du dynamisme de l’emploi qu’il faut se pencher, ainsi que du rôle positif et clairement assumé par le gouvernement que joue l’immigration, primordiale pour maintenir sur le long terme le marché du travail à flot ainsi que l’équilibre financier du système des retraites.
« Plus d’emplois, c’est plus de richesses susceptibles d’être distribuées sous forme de salaires, plus de cotisations sociales, plus de rentrées fiscales, et plus d’investissements publics », souligne Denis Durand, membre de la commission économique du PCF.
Pour cet ancien directeur adjoint à la Banque de France, les points forts de l’économie espagnole révèlent combien les politiques économiques menées dans la zone euro – compression et précarisation des emplois, obsession de la baisse du coût du travail, appauvrissement des services publics – « sont aberrantes ».
L’immigration facteur de croissance ?
« La contribution des travailleurs migrants à notre économie, notre système social ou à la soutenabilité des retraites est fondamentale. Pour l’Espagne, la migration est synonyme de richesse, de développement et de prospérité », déclarait Pedro Sanchez l’année dernière.
Dans une récente étude, le think tank Terra Nova s’est penché sur la question en montrant « comment un pays garde-frontière de l’Europe a su transformer l’immigration en levier de croissance et de vitalité démographique », en misant notamment sur des régularisations d’ampleur de travailleurs sans papiers, l’inclusion par le travail et le dialogue social. Le tout encadré par des choix politiques, économiques, démographiques ainsi qu’une approche humaniste assumés par Madrid, et largement soutenus dans l’opinion publique.
Salaire, emploi, temps de travail... Comment l'Espagne a tourné la page du néolibéralisme ? Réponses du député de Sumar Manuel Lago
Luis Reygada sur www.humanite.fr
Pour le député de Sumar Manuel Lago, le gouvernement espagnol prouve que les politiques de progrès social favorisent à la fois les travailleurs et l’économie.
Comment expliquez-vous le dynamisme de l’économie espagnole ?
Manuel Lago : Nous sommes face à ce que j’appelle un cercle vertueux, multifactoriel, mais principalement stimulé par les moteurs que sont l’emploi et le travail, c’est-à-dire à contre-courant du modèle classique libéral. L’élément clé de notre croissance est la demande intérieure.
Cette demande est stimulée par la consommation des ménages, l’investissement, les dépenses publiques…
Manuel Lago : Effectivement, mais à cela s’est ajouté un changement de paradigme en matière de relations de travail. La crise financière de 2008 avait été suivie d’une décennie d’austérité pendant laquelle le modèle promu par l’Union européenne consistait à dévaluer le facteur travail, pour « être compétitif ». L’arrivée de la gauche au pouvoir a entraîné une réorientation radicale.
Qu’entendez-vous par « changement de paradigme en matière de relations de ravail » ?
Manuel Lago : Avec l’arrivée au pouvoir de partis à la gauche du Parti socialiste – d’abord avec la coalition Unidas Podemos (en janvier 2020) puis avec Sumar (depuis novembre 2023 avec l’actuel gouvernement Sanchez III – NDLR) –, les politiques de précarisation, d’emploi mal rémunéré et de réduction des droits ont été abandonnées au profit d’une nouvelle orientation reposant sur trois axes.
D’abord, une intervention de l’État face à la crise provoquée par la pandémie de Covid, avec des mesures visant à protéger les emplois et le tissu productif. Auparavant, toute crise entraînait chez nous des licenciements massifs (3,5 millions d’emplois détruits après 2008).
Ensuite, un changement en matière de politique salariale, avec un salaire minimum qui est passé de 736 euros par mois en 2019 à 1 184 euros aujourd’hui, soit une augmentation de 61 %. Le troisième axe est la réforme du travail, approuvée en février 2022.
Il s’agit du décret-loi « pour la garantie de la stabilité de l’emploi et la transformation du marché du travail »…
Manuel Lago : Tout à fait. Il est le fruit d’un accord atteint par le gouvernement représenté par la ministre du Travail, Yolanda Diaz, après plusieurs mois de dialogue social avec les syndicats de travailleurs et patronaux. Ce texte a modifié les relations de travail, notamment en privilégiant les contrats à durée indéterminée plutôt que ceux à durée déterminée. Depuis, le taux de CDD est passé de 30 % à 12 %.
Quelles sont les conséquences de la politique de sécurisation de l’emploi ?
Manuel Lago : Avoir de la stabilité change la vie de millions de personnes. Nous sommes passés d’un modèle néolibéral socialement très injuste à un modèle avec des emplois stables, mieux rémunérés et offrant davantage de droits. Cela favorise la consommation, et si l’on ajoute les augmentations des retraites (10 millions d’ayants droit) ainsi que des allocations perçues par les chômeurs (2 millions d’ayants droit), nous atteignons ce cercle vertueux dans lequel la population a plus de pouvoir d’achat et consomme davantage, principalement dans sa communauté, générant une demande et une activité accrues pour les entreprises locales, qui, à leur tour, embauchent…
Qu’en est-il du poids du secteur touristique dans le PIB ou du rôle de l’immigration dans la croissance ?
Manuel Lago : Ce cercle vertueux a aussi enclenché un début de changement dans notre structure productive. Le relèvement des normes du travail élimine du marché les entreprises qui s’appuient sur la surexploitation des travailleurs, et renforce au contraire les entreprises les plus solides.
S’il est vrai que le tourisme joue un rôle très important, ce ne sont plus la construction, le commerce et l’hôtellerie qui sont les secteurs où l’emploi augmente le plus, mais bien les activités productives qui génèrent le plus de valeur. Le chômage vient d’atteindre son taux le plus bas depuis 2008 (10,3 % – NDLR) ; les migrants qui viennent en Espagne trouvent du travail car il y a une croissance et des entreprises qui recherchent de la main-d’œuvre.
Les grandes entreprises se portent en effet très bien, et la Bourse de Madrid bat des records…
Manuel Lago : Je pense que c’est la grande leçon que donne l’Espagne, en mettant en œuvre ce que l’on pourrait appeler un « keynésianisme de gauche du XXIe siècle ». Nous démontrons que les politiques de progrès social améliorent non seulement la vie d’une part importante de la population, mais ont aussi un impact positif sur l’ensemble de la société.
Notre formule n’est pas parfaite, mais elle fonctionne. Nous sommes le gouvernement le plus progressiste d’Europe, avec un modèle dont la force et le succès résident dans l’unité de la gauche.
Quels sont les prochains chantiers de ce gouvernement ?
Manuel Lago : La réduction du temps de travail, pour passer de 40 à 37,5 heures hebdomadaires sans réduction salariale. Ce projet de loi a déjà été approuvé par le Conseil des ministres et doit maintenant être débattu au Congrès. Il s’agit d’une mesure qui profitera tant aux travailleurs qu’aux entreprises et qui met en jeu la justice sociale.
mise en ligne le 5 octobre 2025
La Sécu
contre l’absurdité libérale
Sébastien Crépel sur www.humanite.fr
Quoi de mieux qu’une mobilisation interprofessionnelle pour l’anniversaire de notre bonne vieille Sécu, qui souffle ses 80 bougies le 4 octobre ? La journée d’action et de grève du 2 octobre ne pouvait tomber plus à propos pour rappeler que la Sécurité sociale n’est pas une banale administration. Encore moins un appendice d’un « État providence ». Elle est le bien commun des travailleuses et des travailleurs, conquis de haute lutte à la Libération et financé par une fraction de leur salaire mutualisé. Un modèle « inspiré du souci de confier à la masse des travailleurs, à la masse des intéressés la gestion de leur propre institution », exposait le 8 août 1946 aux députés le ministre communiste Ambroise Croizat, à l’origine de cette création.
C’est cette marque de propriété collective qui lui vaut les attaques incessantes de ceux qui veulent récupérer l’argent et sa gestion, en les étatisant d’abord, pour mieux les privatiser ensuite. Les deux ne sont pas antinomiques, au contraire. D’abord élus directement par les salariés, les administrateurs de la Sécu ont intégré des représentants patronaux en 1967, avant que les élections soient supprimées après 1983, tandis que l’État prenait l’essentiel du contrôle financier en substituant les impôts (la CSG et la TVA, notamment) aux cotisations et en contraignant les budgets.
L’absurdité libérale est à son comble : on compterait aujourd’hui 1,7 milliard de combinaisons de barèmes de cotisations possibles.
Le casse du siècle a pu s’opérer tranquillement : à partir de 1993 sont apparus les fameux « allègements de charges » sociales exonérant les employeurs du versement des cotisations qui font partie intégrante du salaire. Ces exonérations ont culminé à 77 milliards d’euros en 2024, jusqu’à devenir « le troisième budget de l’État hors charge de la dette après la défense et l’enseignement scolaire », selon la commission sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises. Soit plus de 35 % des 211 milliards d’euros toutes aides confondues chiffrés par le rapporteur de la commission, Fabien Gay, également directeur de « l’Humanité ».
L’absurdité libérale est à son comble : on compterait aujourd’hui 1,7 milliard de combinaisons de barèmes de cotisations possibles avec les différents dispositifs d’allègement. Plus qu’il n’existe d’entreprises sur Terre. Pour un résultat sur l’emploi inversement proportionnel aux moyens dépensés. Ainsi, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), impulsé par François Hollande à partir de 2013 et intégré au barème des cotisations comme baisse pérenne en 2019, aurait permis, selon France Stratégie, la création de 100 000 à 400 000 emplois pour un coût de 18 milliards en 2016. Soit une aide de 45 000 à 180 000 euros par an et par emploi, c’est-à-dire davantage que la totalité des salaires versés.
Les cotisations représentent désormais moins de la moitié (49 %) des recettes des régimes de base de la Sécu, contre 82 % en 1993. Les travailleurs sont peu à peu dépossédés de leur bien commun : la gestion, le financement, et pour finir leurs droits leur sont progressivement retirés. On a vu où cela conduit avec l’assurance-chômage, qui « n’est plus du tout financée par les cotisations des salariés, relevait Emmanuel Macron devant le congrès du Parlement en 2018. Cette transformation, il faut en tirer toutes les conséquences, il n’y a plus un droit au chômage, au sens où l’entendait classiquement. »
L’anniversaire de la Sécurité sociale, avec les colloques et la littérature qui l’accompagnent, peut être l’occasion de reprendre collectivement la main. Le bouillonnement social autour du contrôle des aides aux entreprises et de la taxe Zucman sur le capital y invite. Le rapport de force idéologique place les dépeceurs de la Sécu sur la défensive. C’est le moment de regagner le terrain perdu.
Carte vitale d’alimentation, sécurité sociale funéraire… Quelle Sécu pour le XXIe siècle ?
Cyprien Boganda sur www.humanite.fr
La Sécurité sociale, qui fêtera ses 80 ans ce samedi 4 octobre, subit des attaques sans précédent. Ses défenseurs – partis de gauche, syndicats, associations – rivalisent de propositions pour étendre son champ d’action, en restant fidèle aux objectifs de ses fondateurs.
Ce n’est pas tous les jours qu’on célèbre l’anniversaire d’une conquête sociale. Ce 4 octobre, une vieille dame toujours verte fêtera quatre-vingts ans d’une histoire tumultueuse, jalonnée d’avancées exemplaires et de reculs douloureux, qui ont transformé le visage du pays.
Aujourd’hui comme hier, la « Sécu » se retrouve sur la ligne de front d’une bataille idéologique : la gauche, qui y voit une réponse à la toute-puissance du marché, veut la protéger contre vents et marées ; les plus libéraux la vouent aux gémonies pour les mêmes raisons. L’immense majorité des assurés, eux, ont conscience de son utilité sans forcément prendre la mesure de ce qu’ils lui doivent : combien savent, par exemple, que sans elle, un accouchement leur coûterait 2 500 euros ?
Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d’une ambition aussi louable que titanesque (« en finir avec la peur du lendemain »), la Sécurité sociale n’est pas qu’une institution à préserver ou une vieillerie à chérir, c’est un horizon politique à conquérir, une idée à défendre et à réinventer sans cesse.
1. Une Sécu de la naissance à la mort
Henri Raynaud, ancien dirigeant de la CGT, fixait ainsi le cap, en 1947 : « Il s’agit de couvrir (les travailleurs) de tous les risques, de tous les cas dans lesquels leur salaire ou le fruit de leur travail se trouve diminué. » Vaste programme !
Aujourd’hui, les promoteurs de cette institution rêvent d’élargir sa palette en garantissant à l’ensemble des travailleurs une couverture complète contre l’ensemble des risques, de la naissance à la mort en passant par la retraite ou la maladie. À l’heure où les gouvernements ne parlent que de « déremboursement » de soins, la CGT plaide ainsi pour une « prise en charge à 100 % », ce qui supposerait de refonder l’offre de soins (développement de centres de santé pluriprofessionnels employant des médecins salariés, création d’un pôle public du médicament, etc.).
« Dans le cadre du « 100 % Sécu », les coûts liés aux activités de soins sont pris en charge, résume le syndicat. Il n’y a plus de mécanisme de remboursement dans la mesure où les actes médicaux sont réalisés par des personnels payés directement par la Sécu et où les médicaments et produits de santé sont produits et distribués directement par la Sécurité sociale. » Dans les faits, cela permettrait de dire adieu aux franchises et autres dépassements d’honoraires. Ce qui n’a rien d’un détail, quand on sait que les seuls dépassements d’honoraires ont représenté la somme astronomique de 4,3 milliards d’euros en 2024.
La « démarchandisation » s’étendrait aussi à la prise en charge de la dépendance. « Les aides à domicile seraient salariées directement par la Sécurité sociale et les familles n’auraient plus à faire d’avance, explique Cécile Velasquez, secrétaire générale de la CGT Organismes sociaux. Aujourd’hui, cela coûte environ 23 euros de l’heure en moyenne, c’est très cher. Demain, c’est la Sécu qui prendrait en charge. »
Pour parachever une Sécu couvrant la totalité des risques de l’existence, le député LFI Hadrien Clouet entend déposer une proposition de loi actant la création d’une sécurité sociale du funéraire. « Nous avons calculé qu’une cotisation de 0,3 point sur le salaire brut permettait de couvrir l’ensemble des frais moyens des obsèques, qui s’élèvent à environ 4 000 euros », indique le parlementaire.
Et d’ajouter, pour étayer son raisonnement : « Le risque de mourir étant par définition imparable, c’est un risque social que l’on doit couvrir légalement. Il est urgent de démarchandiser le secteur du funéraire, géré à 40 % aujourd’hui par trois entreprises uniquement, qui proposent des tarifs exorbitants. Avec notre système, il y aurait demain des pompes funèbres conventionnées, dont les actes seront pris en charge par la Sécu. »
2. L’alimentation, nouvel enjeu ?
Certains défenseurs de l’institution voudraient couvrir les assurés contre des risques non pris en charge aujourd’hui. C’est le cas de la précarité alimentaire, qui frappe des millions de personnes (jusqu’à 16 % de la population selon certaines études).
Le projet de Sécurité sociale alimentaire (SSA), portée par diverses associations (Confédération paysanne, Ingénieurs sans frontières Agrista, Réseau salariat…) repose sur une idée simple : permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des produits alimentaires de qualité, en allouant 150 euros par mois et par personne (c’est la « carte vitale d’alimentation ») qui permettront d’acheter des aliments de producteurs et structures conventionnés.
Reste que le coût du dispositif (120 milliards d’euros tout de même) implique de mener un vaste débat sur son financement. Les promoteurs de la SSA privilégient la cotisation sociale, tout en se disant ouvert au débat.
3. La question centrale du financement
De toute façon, renforcer la Sécu suppose de trouver des ressources nouvelles. Les libéraux expliquent depuis des années que le financement de notre modèle de protection sociale reposerait trop sur le travail, d’où la nécessité selon eux de transférer une part croissante de ce financement vers d’autres prélèvements, comme la TVA par exemple. À gauche, on rétorque que la TVA est par nature le plus inégalitaire des impôts (les plus pauvres consacrent une part proportionnellement plus importante de leurs revenus à la consommation), et on insiste sur la primauté de la cotisation sociale.
« Il faut que la Sécu reste majoritairement financée par la cotisation, c’est-à-dire la richesse produite par le travail, rappelle Yannick Monnet, député PCF. Et il faut absolument constitutionnaliser ce principe, car cela permettra de mettre fin à la dérive du financement de la Sécurité sociale par l’impôt : cette dérive transforme la Sécurité sociale en système assurantiel, dans lequel on paye en fonction de ses moyens et où on reçoit aussi en fonction de ses moyens. »
La CGT avance une série de propositions : intégration des rémunérations comme l’intéressement et la participation dans le salaire (entre 4,1 milliards d’euros et 5,7 milliards d’euros de ressources nouvelles), hausse d’un point de cotisation (10,5 milliards d’euros), lutte contre la fraude aux cotisations sociales du fait du travail dissimulé (au moins 6 milliards d’euros), etc.
4. Des caisses gérées par les travailleurs
À l’origine, la Sécu était gérée par les travailleurs eux-mêmes, ou plus exactement par leurs représentants siégeant au sein des différents conseils d’administration (CA). Le patronat avait aussi des représentants, mais dans des proportions très inférieures. L’avènement du paritarisme, en 1967, mettra un terme à cette parenthèse (presque) autogestionnaire.
« Aujourd’hui, la Sécu est gouvernée par l’État de la Ve République, c’est-à-dire un État à la fois très centralisé et autoritaire, qui a tendance à servir davantage les intérêts du capital que ceux du travail, explique Nicolas Da Silva, économiste spécialiste de la santé. Un exemple parmi d’autres : dans la santé, l’État développe le marché et finance son extension, à travers le soutien aux cliniques privées, à l’industrie pharmaceutique, etc. À l’inverse, si la Sécu était gouvernée de manière plus démocratique, le sens des politiques publiques serait peut-être différent. »
Exemple : une Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pilotée par des représentants de salariés et des associations d’usagers aurait-elle validé l’application de la réforme des retraites de 2023 ?
Aujourd’hui, beaucoup plaident pour démocratiser la Sécu en redonnant le pouvoir aux représentants de salariés, même si les modalités diffèrent en pratique : faut-il confier la gouvernance aux seules organisations de salariés, comme le réclame la CGT ? Ou bien y faire entrer des représentants du patronat, des indépendants, voire des associations de patients ? Tous s’accordent en revanche sur la volonté d’exclure progressivement l’État de la gestion de la Sécurité sociale.
« Ça n’a jamais été autant le désordre que depuis que l’État, via le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFFS), met les mains dans le budget de la Sécu, martèle le député Yannick Monnet. Il faut que cette valeur ajoutée créée par le monde du travail soit gérée par le monde du travail. Et que nous, parlementaires, n’ayons plus à y revenir. »
« Quelle que soit la répartition du pouvoir dans les CA, le plus important, c’est que la Sécu soit gérée par les assurés eux-mêmes, résume de son côté le député Hadrien Clouet. L’autonomie des caisses est centrale, car elle permettra d’ouvrir de nouveaux espaces d’exercice du pouvoir, en dehors de l’État. C’était l’ambition originelle de la Sécu. »
mise en ligne le 29 septembre 2025
La « marche des résistances », nouveau levier de la convergence des luttes
Mathias Thépot sur www.mediapart.fr
Associations, syndicats et partis de gauche ont manifesté ensemble dimanche 28 septembre contre les crises écologique, sociale et démocratique. Face à la montée de l’extrême droite et à la toute-puissance des milliardaires, l’idée est de faire front commun.
À l’approche de la COP30, qui se déroulera au Brésil en novembre, plusieurs milliers de manifestant·es se sont mobilisé·es dimanche 28 septembre dans plus de 70 villes de France, de Paris à Marseille, en passant par Nantes, Montpellier et même Saint-Pierre sur l’île de La Réunion, pour affirmer qu’un autre avenir était possible face aux crises écologique, sociale et démocratique.
Dans la capitale, le cortège, composé d’une foule compacte, s’étalait sur un peu plus de 500 mètres. Il est parti de la gare du Nord pour rejoindre la place de la République en passant par les grands boulevards.
Cette « marche des résistances », réalisée à l’appel d’une douzaine d’organisations qui luttent contre le changement climatique (Alternatiba, Attac, Greenpeace, Réseau action climat, ActionAid, 350.org…), affichait pour slogan « Climat, justice, libertés ! ». Les partis de gauche, notamment La France insoumise et Les Écologistes, étaient aussi présents dans les cortèges.
Cette mobilisation du 28 septembre, précise Dahlia Stern, porte-parole d’Action justice climat, voulait s’inscrire « dans la lignée du mouvement “Bloquons tout” du 10 septembre, et de la mobilisation syndicale du 18 septembre ».
Nouveauté : la CGT – qui se positionnait jusqu’ici plutôt en marge des marches pour le climat – a participé à l’organisation de l’événement. « Dans un contexte où les discussions budgétaires vont s’engager, nous pensons qu’il faut plus de moyens pour protéger les travailleuses et les travailleurs des dégâts causés par le changement climatique. Et de manière plus profonde, en tant que syndicalistes, nous nous posons la question des modes de production », explique Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris, présent en tête de cortège avec ses camarades.
La question de la convergence des luttes sociales et écologiques, qui font souvent l’objet d’événements séparés, était au centre des discussions. « Nous ne pouvons plus aujourd’hui avoir les manifestations des organisations écologistes d’un côté, et celles des syndicats de l’autre », estime le porte-parole de Greenpeace, Jean-François Julliard.
Il justifie : « Les émissions de gaz à effet de serre remontent dans le monde et les inégalités sociales se creusent. Or, en parallèle, il y a une offensive réactionnaire et autoritaire, en alliance avec les industries polluantes et les milliardaires. D’où la nécessité de travailler tous ensemble pour lutter. » « Il n’y a pas de justice sociale sans justice écologique, et inversement », résume la porte-parole d’Attac, Youlie Yamamoto, elle aussi présente.
Les milliardaires dans le viseur
Dans les rangs du cortège parisien, les principaux sujets dénoncés par les manifestant·es étaient donc l’inaction climatique des gouvernant·es, la montée de l’extrême droite, la sous-imposition des ultrariches et la guerre génocidaire menée par l’État d’Israël à Gaza.
Les personnes d’Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Donald Trump, de Benyamin Nétanyahou, ainsi que le PDG de Total Patrick Pouyanné et les milliardaires Vincent Bolloré et Bernard Arnault étaient les plus ciblés comme responsables du marasme actuel. « Ils détruisent, on s’unit », pouvait-on lire sur les banderoles.
« Nous dénonçons les responsables de la crise climatique que sont le système capitaliste, les multinationales, mais aussi la France, qui ne prend pas sa part, notamment dans ses soutiens à destination des pays du Sud », lance Veronica Velásquez, porte-parole d’ActionAid, une association de solidarité internationale.
De nombreux panneaux dénonçant la crise écologique étaient brandis, comme celui-ci, où l’on pouvait lire : « Fin de l’empoisonnement : abrogation loi duplomb et plan chlordécone, maintenant ! » Les slogans anti-extrême droite tels que « Rage against the Fascism » faisaient aussi mouche dans les rangs du cortège.
Mais le sujet de loin le plus abordé sur les banderoles concernait l’imposition des milliardaires. Preuve que tout le débat autour de la taxe Zucman a imprégné les consciences. Entre autres messages : « Pour notre survie : taxez les riches, financez la transition » ou « Bernard [Arnault], passe ton RIB pour la dette écologique ».
« C’est aux ultrariches et aux multinationales d’encaisser l’austérité !, estime Youlie Yamamoto, d’Attac. C’est pourquoi nous soutenons, dans le cadre du projet de budget 2026, la taxe Zucman, et aussi la retour d’un ISF [impôt sur la fortune] avec un volet climatique. »
Les militant·es écologistes étaient enfin présent·es pour mobiliser sur les enjeux de la COP30, qui débutera le 10 novembre 2025 dans la ville de Belém. Seront abordés le sujet des aides financières apportées par les pays riches aux pays les plus menacés par le réchauffement climatique, mais aussi les questions de déforestation et d'exploitation pétrolière, deux thèmes qui sont très sensibles au Brésil, où un énorme projet pétrolier est notamment en cours.
Au-delà des dégâts écologiques qu’ils génèrent, la déforestation et les nouveaux projets d’exploitation des combustibles fossiles ont des conséquences directes sur l’habitat et la santé des populations autochtones, aux revenus souvent très modestes.
L’activiste brésilienne Andressa Dutra, pour Rio sans pétrole et Greenfaith, était présente dans le cortège parisien pour sensibiliser sur la violence extrême générée dans son pays par les enjeux climatiques. « Il faut que les communautés autochtones au Brésil, qui sont les premières victimes de l’exploitation des combustibles fossiles, gagnent en visibilité grâce à la tenue de la COP. Elles subissent directement le racisme environnemental. » Et de rappeler que « le Brésil est le deuxième pays où l’on tue le plus les activistes de l’environnement ».
mise en ligne le 27 septembre 2025
Budget : la bataille est aussi idéologique
L'éditorial de Fabien Gay sur www.humanite.fr
Rupture. Le mot est lâché par le premier ministre, Sébastien Lecornu. Les consultations des forces politiques semblent convaincre le nouveau locataire de Matignon de faire autrement. Mais le sempiternel discours sur la « méthode » ne fonctionne plus. Barnier, Bayrou comme Lecornu, illégitimes au regard du vote populaire, ne sont prêts en réalité à aucune concession.
On sait que le mot rupture ne dit rien en soi. La vraie et l’unique rupture doit être sur le fond contre ces projets d’austérité, saupoudrés de poussées autoritaires et de remises en cause de l’État de droit voulues par Bruno Retailleau et l’extrême droite. Dans ce contexte, la bataille idéologique fait rage. Les soutiens des droites coalisées à l’extrême droite matraquent en permanence leur discours sur l’immigration, l’insécurité et l’islam, relayés par des puissants médias détenus par quelques milliardaires. Ils le doublent maintenant d’un discours sur la dette, promettant du sang et des larmes aux travailleurs.
Et pourtant, malgré ce matraquage en continu, la politique de l’offre et la théorie du ruissellement sont rejetées massivement. Il faut dire qu’avec 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qu’avec des cohortes de privés d’emploi subissant les dégâts de la désindustrialisation et des réformes successives de l’assurance-chômage, le bilan macroniste n’est pas glorieux. Il y a une soif de justice sociale et fiscale qui émerge, comme le démontrent les mobilisations récentes.
Les principes de contrôle de l’argent public versé aux grandes entreprises, au lieu de nourrir les actionnaires, comme une taxation plus élevée des ultra-riches, qui ont largement profité de la crise, sont largement partagés. La taxe Zucman, un impôt plancher de 2 % sur les revenus du patrimoine au-delà de 100 millions, comme le contrôle des 211 milliards d’aides publiques aux grandes entreprises aujourd’hui versés sans transparence, ni suivi ni évaluation, sont désormais des revendications populaires. Rien ni personne ne peut arrêter une idée qui s’empare des masses.
Fébrile, le camp du capital contre-attaque et tente de discréditer, caricaturer, moquer ou invisibiliser ces deux propositions. Tour à tour, le patronat, Bernard Arnault en tête, et les éditorialistes libéraux tentent d’éteindre le feu. Leur morgue démontre leur fébrilité. La colère est grande face à celles et ceux qui veulent faire croire que l’austérité est la seule voie, sans s’interroger sur leur propre responsabilité quant au manque d’argent dans les caisses de l’État.
Celles et ceux qui sont en colère ne sont pas des irresponsables qui voudraient le chaos, ce ne sont pas de doux rêveurs qui planeraient face à des pragmatiques réalistes quant à la situation économique. Ce sont des hommes et des femmes qui sont lucides sur les dégâts causés, partout dans la société, par des années de politiques libérales.
La foule est aux trousses du couple exécutif et prépare l’après-Macron. Le peuple fera de l’examen budgétaire un temps fort de notre démocratie. Le futur gouvernement n’aura d’autre choix que d’écouter pour répondre aux besoins populaires. Ils sont acculés, au bout de leur logique libérale et antidémocratique.
La gauche a marqué des points dans la bataille idéologique. Et chacun sait qu’elle est le préalable à toute victoire électorale. Il faut donc unir nos forces pour transformer l’essai et répondre à cette volonté populaire, qui s’est exprimée successivement le 10 septembre, puis à la Fête de l’Humanité, et le 18 septembre dernier, pour en faire une victoire politique durable.
mise en ligne le 20 septembre 2025
Une dynamique est enclenchée !
chronique de Maryse Dumas sur www.humanite.fr
« Tout bloquer », c’était le mot d’ordre du 10 septembre. Si le mouvement né sur les réseaux sociaux pendant l’été est loin d’avoir atteint l’objectif affirmé, il n’en a pas moins marqué la rentrée sociale et politique : 550 rassemblements, 262 blocages ou tentatives recensés par le ministère de l’intérieur, 250 000 manifestant.es selon la CGT, voilà une active mise en bouche pour la journée intersyndicale de grèves et manifestations du 18 septembre. Cette rentrée sociale inédite a déjà à son actif le départ, de son propre aveu, de François Bayrou. Elle conduit aussi le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, à parler de nécessaire « rupture ».
Amusant de la part de quelqu’un qui, sans interruption depuis 2017, a fait partie de tous les gouvernements Macron et s’affirme comme l’un de ses bras droits, bien à sa droite. Pourtant ne boudons pas notre plaisir et remarquons que l’emploi de ce seul mot « rupture », malgré toute l’intention manœuvrière qu’il comporte, reflète la crainte du pouvoir de voir la France populaire et laborieuse se lever pour mettre à bas sa politique.
Du coup, quelque chose change dans le climat ambiant. Les cartes paraissent rebattues : on reparle des retraites, de la pénibilité, de la taxe Zucman sur les plus gros patrimoines, de l’investissement de long terme. Tous sujets totalement écartés par les comptes d’apothicaires de François Bayrou que le 10 septembre et la perspective du 18 viennent de remettre en chantier.
Pour déployer les potentialités nouvelles de la situation, il faut en analyser les caractéristiques. Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement citoyen naît sur les réseaux. Avant « Bloquons tout », il y a eu les « indignés », Nuit debout et pour une part les gilets jaunes. Tous ces mouvements ont pour caractéristique commune de situer leur action dans l’espace public, et non sur les lieux de travail.
Ils interpellent directement le pouvoir politique mais laissent tranquille le patronat. Ils se situent en dehors du périmètre syndical tant du fait de leur dynamique propre, à la frontière du politique et du social, qu’en raison d’une méfiance aiguë vis-à-vis des organisations quand bien même elles sont syndicales, de luttes, et respectueuses de leur autonomie de décision.
Les personnes concernées et agissantes sont elles-mêmes aux frontières du salariat : beaucoup d’autoentrepreneurs, de personnes en précarité ou de salarié·es dépendant de très petites entreprises, voire de particuliers employeurs, pour les gilets jaunes, davantage d’étudiant·es, de lycéen·nes, de personnes du monde de la culture pour Nuit debout ou « Bloquons tout ».
Ce qui est nouveau en cette rentrée, c’est qu’à l’appui de l’expérience du mouvement des retraites, des rencontres ont pu se faire. Les organisations de la CGT ont été fortement sollicitées pour apporter leur concours tant en matière de logistique que de savoir-faire : organiser des rassemblements, des manifs et même des blocages, cela s’apprend. Ces rencontres ont permis des échanges fructueux permettant de dépasser les méconnaissances, voire les méfiances réciproques.
À n’en pas douter cela sera porteur pour la suite. Car ne nous cachons pas que le plus dur est devant nous : gagner la grève sur les lieux de travail et des participations massives aux manifestations intersyndicales. Une dynamique est enclenchée, dans laquelle nous pouvons puiser l’énergie nécessaire pour relever le défi.
mise en ligne le 16 septembre 2025
Fête de l’Huma :
le fond de l’air était
rouge et unitaire
Catherine Tricot sur www.politis.fr
Les élus ont-ils perçu cette pression qui gronde au sein la gauche ? Comme si chacun s’était saisi du moment révolutionnaire qui vient pour leur en tenir rigueur. Les attentes sont élevés alors… élevons le niveau !
La Fête de l’Huma s’impose comme le rendez-vous incontournable des gauches. Tous les leaders sont venus se frotter au « peuple de gauche » affluant par centaines de milliers. Tous, ou presque. Il ne manquait que Raphaël Glucksmann, envoyant un signal clair : il ne fait pas cause commune avec cette foule-là. En revanche, Olivier Faure comme Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet et même Patrick Martin (le patron du Medef) ont pu humer une atmosphère qui ne trompait pas.
Avant de parler de l’ambiance générale, revenons un instant sur celle qui dominait parmi les proches et les membres du Parti communiste. Les militants étaient bien sûr au rendez-vous. Sans eux, pas de fête. Heureux comme des poissons dans l’eau car, cette année, pas de dingueries lâchées par surprise par Fabien Roussel pour troubler ce moment de retrouvailles. Le secrétaire national s’est fait plus discret et moins de monde est venu l’écouter. C’est le président du groupe communiste à l’Assemblée, Stéphane Peu, qui tenait estrade au côté de Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin et Hadrien Clouet (député LFI). Fabien Gay, le directeur de L’Humanité, marchait sur un nuage en annonçant que la Fête avait dû fermer les accès samedi à 15h. Il était encore tout auréolé de son rapport au Sénat sur les aides publiques versées aux entreprises. L’élu parisien Ian Brossat, très mobilisé sur le combat pro-palestinien, était également porté par ses camarades. Apparaissant comme des militants de l’union sans exclusive des gauches, ces trois visages (masculins) du communisme français étaient plébiscités dans les stands.
Tout au long des débats de la fête, c’est une demande plus radicale qui s’est fait entendre. Les mots et les slogans n’étaient pas toujours là, mais la musique, elle, oui. Le tempo aussi. C’était celui de l’unité. Ce fut d’ailleurs le seul slogan scandé lors du grand débat : « Unité ! unité ! »
Sinon, les débats politiques ont fait le plein. Et il était tout aussi intéressant d’écouter le public que les orateurs. Olivier Faure a eu fort à faire pour convaincre de sa stratégie. La presse a beaucoup insisté sur les sifflets – pas tant que ça en vérité –, ils étaient maitrisés et les slogans méchamment anti-socialistes n’ont pas retenti, à la différence d’autres fois. Le public écoutait et réagissait. Le premier des socialistes a voulu amadouer la foule et a un peu triché en annonçant l’abrogation de la réforme des retraites quand il ne s’agit en fait – dans le projet socialiste – que de sa suspension. La différence ? La réforme avance et l’âge de départ est déjà porté à 63 ans. Olivier Faure a vanté la taxe Zucman, en passe de devenir le symbole d’une politique de gauche. Mais le public ne semble pas y trouver tout son compte.
Tout au long des débats de la fête, c’est une demande plus radicale qui s’est fait entendre. Les mots et les slogans n’étaient pas toujours là, mais la musique, elle, oui. Le tempo aussi. C’était celui de l’unité. Ce fut d’ailleurs le seul slogan scandé lors du grand débat : « Unité ! unité ! » Chahuté quand il dit vouloir un candidat insoumis à l’élection présidentielle, Hadrien Clouet a tenté une ruse : justifier la rupture d’avec les socialistes pour cause de soutien au régime génocidaire d’Israël. Il s’est fait bien ramasser par Olivier Faure.
François Ruffin et Stéphane Peu étaient au barycentre de ce moment à la fois radical et unitaire. Le député communiste a rappelé ce moment où les peuples socialiste et communiste ont forcé leur parti à converger pour faire face au fascisme montant en 1934. Intéressant encore quand il lie politique sociale et combat antifasciste, rappelant que la sécurité sociale n’est pas seulement née de la fraternité de la résistance mais de la conscience parmi les rédacteurs du programme des jours heureux que les peuples d’Europe ont sombré dans la pauvreté et la peur des lendemains avant le désespoir qui conduisit au fascisme.
Jean-Luc Mélenchon tenait meeting à part, dans son stand à lui, devant des centaines de militants serrés. Comme rarement, il a rendu hommage aux communistes, le militant d’aujourd’hui, la dirigeante d’hier, Marie-George Buffet et la charismatique Rosa Luxembourg. Il a même conclu son meeting par « l’Internationale » : il voulait rassembler la famille. Cela ne l’a pas empêché de dire de belles vacheries sur l’ensemble des partenaires de gauche. C’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Laissons cela pour revenir au fond de son propos. Jean-Luc Mélenchon sent le moment. Il le voit révolutionnaire par la conjonction des luttes – en commençant par celles du 10 et du 18 septembre – et des blocages d’en haut. Les sorties du Medef, braqué devant toute contribution des entreprises, alimentent ce diagnostic d’époque révolutionnaire. Mais Jean-Luc Mélenchon rate quelque chose de l’air du temps : la demande puissante d’unité. De tous. De la base aux partis. Il fallait se balader quelques heures dans les travées pour le mesurer comme jamais. Le leader insoumis affirme sa confiance dans le peuple et son unité : voilà ce que le peuple lui demande.
mise en ligne le 3 juillet 2025
PS, PCF, écolos, LFI…
Pourquoi tant de haine ?
Lucas Sarafian sur www.politis.fr
Derrière les volontés hégémoniques, les ambitions personnelles et les divergences stratégiques, certains ne cessent d’invoquer un supposé fossé idéologique entre toutes les composantes de la gauche française. Qu’en est-il vraiment ? Politis fait les comptes.
Elles semblent nombreuses, à gauche, les questions qui fâchent. Nucléaire, police, laïcité, modèle européen, antisémitisme… Pourtant, sur bien des points, les fossés entre les partis n’apparaissent pas si infranchissables : la suppression de la réforme des retraites fait consensus, l’augmentation du Smic ou une meilleure reconnaissance du travail aussi. L’articulation des questions écologiques et sociales également… Et si les gauches, débarrassées des querelles de chapelles, n’étaient pas si irréconciliables qu’il y paraît ? Tour d’horizon en sept thématiques.
Unanimes ! Socialistes, écologistes, insoumis et communistes demandent la suppression pure et simple de la réforme des retraites défendue par Élisabeth Borne, adoptée par 49.3 le 16 mars 2023. Un texte qui a provoqué un mouvement social de plusieurs mois partout en France. Depuis, le sujet est revenu plusieurs fois à l’Assemblée. Et la gauche a quasiment toujours été alignée. Dernièrement, lors de leur journée d’initiative parlementaire du 5 juin, les communistes ont porté une proposition de résolution d’abrogation. Les quatre groupes du Nouveau Front populaire (NFP) ont fait bloc et le texte a été adopté. Est-ce suffisant pour gommer les divisions ?
En réalité, deux positions se distinguent. Si une écrasante majorité de la gauche souhaite l’abrogation pure et simple de cette réforme et le retour à un âge de départ à 60 ans, la position est plus complexe du côté du Parti socialiste (PS). L’aile gauche du parti au poing et à la rose souhaite bien le retour de l’âge légal à 60 ans. D’autres, moins nombreux, sont plutôt ouverts à un système par points. Mais le reste de la formation est plutôt attaché au maintien de l’âge légal de départ à 62 ans.
On est attachés à la réforme Touraine. B. Vallaud
Certains, comme Boris Vallaud, se sont publiquement exprimés en faveur du maintien de la réforme Touraine, qui a eu pour effet, en 2013, d’allonger progressivement le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. Sur Franceinfo, quelques jours avant la journée d’initiative parlementaire insoumise, le 28 novembre dernier, le patron du groupe rose a expliqué sa position : « On est attachés à la réforme Touraine, qui s’accompagne aussi de mesures sur les carrières longues et la pénibilité. Et le gouvernement Macron en a supprimé quatre critères. »
Raphaël Glucksmann est moins assertif. Selon le projet de Place publique présenté le 23 juin, l’eurodéputé défend bien l’abrogation de la réforme de 2023 mais rêve d’une nouvelle réforme aux contours flous. Un texte qui prendrait mieux en compte les carrières pénibles et les parcours hachés, convergerait vers une « simplification des régimes » et aurait pour objectif d’arriver à un « meilleur équilibre budgétaire ». Mais, surtout, le héraut de la social-démocratie souhaite décentrer le débat public focalisé sur la question de l’âge de départ, qui, d’après lui, « produit l’injustice » : « Certains doivent pouvoir partir à la retraite à 60 ans, d’autres devront travailler davantage. »
La synthèse entre toutes ces composantes reste à trouver. Et la tâche semble ardue. Les négociateurs du NFP avaient néanmoins trouvé une formulation consensuelle dans le programme commun signé en juin 2024 : « Réaffirmer l’objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. » Socialistes, écolos, insoumis et communistes s’étaient entendus sur une petite mesure simple : le rétablissement des facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron. La suite de l’arrangement sur l’épineuse question des retraites doit donc encore être écrite.
Une division… philosophique. Entre les sociaux-démocrates et les écologistes, plutôt fédéralistes, et une tendance plus radicale, construite en rupture avec le modèle actuel de l’Union européenne (UE), la gauche se coupe en deux. Si tout le monde s’accorde sur la critique de l’Europe, à la fois sur sa construction et sur ses orientations politiques, les approches divergent concernant la ligne de conduite à tenir face à Bruxelles. Que faire devant le pacte de stabilité et de croissance, et les règles budgétaires des 3 % de déficit et des 60 % de dette publique ?
D’un côté, les socialistes et les écologistes croient toujours au projet européen, « l’outil de notre souveraineté retrouvée » pour les roses, « une nécessité » pour les verts. Même s’ils souhaitent une réorientation européenne davantage sociale et environnementale. De l’autre, les insoumis veulent une « rupture concertée » avec les traités pour renégocier des textes « compatibles avec les urgences climatiques et sociales ». Mais, surtout, ils pensent désobéir aux traités actuels pour appliquer leur programme. Une démarche sensiblement partagée par les communistes.
Désobéir ou espérer faire changer l’Europe de l’intérieur, un grand clivage ? Le programme du NFP indique que l’alliance aurait refusé le pacte budgétaire, les traités de libre-échange et le droit à la concurrence lorsqu’il menace les services publics. Une forme de désobéissance déjà inscrite dans le programme de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) deux ans plus tôt : « Il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles. Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif. »
On mène des combats au quotidien ensemble au Parlement européen, contre le glyphosate, contre les accords de libre-échange… M. Aubry
La question ukrainienne coupe aussi la gauche en deux. Plus ouverts devant l’hypothèse de l’adhésion de Kiev à l’UE, les socialistes et les écologistes auraient voulu que la France s’engage plus franchement dans le soutien militaire à l’Ukraine : renforcement des sanctions contre la Russie, envoi d’armes et de munitions, arrêt des activités des entreprises françaises qui pourraient soutenir le Kremlin, confiscation des avoirs russes… Insoumis et communistes, opposés à la perspective de l’entrée du pays dirigé par Volodymyr Zelensky dans l’union des Vingt-sept, refusent d’accepter une logique atlantiste. Ils plaident pour la voie diplomatique. Coûte que coûte. Clauses de sécurité mutuelle, traité de sécurité ? Qu’importe. Ils rêvent de l’ouverture de négociations.
À Bruxelles, ces nombreux différends n’empêchent pas les eurodéputés français de gauche de s’entendre. « On mène des combats au quotidien ensemble au Parlement européen, contre le glyphosate, contre les accords de libre-échange, pour la taxation des superprofits, pour l’accueil des exilés. On vote à plus de 80 % la même chose, ce qui est plus qu’à l’Assemblée », expliquait l’insoumise Manon Aubry alors qu’elle tentait de convaincre les écolos, les socialistes et les communistes de faire une liste commune pour les européennes de 2024.
Durant la campagne des européennes, Raphaël Glucksmann affirmait voter à 80 % avec le groupe macroniste, mais aussi « à 86 % avec Marie Toussaint et les Verts, et même à 76 % avec Manon Aubry et La France insoumise ». Une désunion aujourd’hui insurmontable ?
Gauche du travail contre gauche des « allocs » : depuis quelques années, Fabien Roussel fait de cette opposition une pierre angulaire de son discours. Le patron du Parti communiste français (PCF) considère que la gauche doit faire de cette « valeur travail » la question centrale de sa pensée. Dans son dernier livre, Le Parti pris du travail (le Cherche Midi, 2025), le premier des communistes souhaite supprimer le RSA. Une aide qui serait remplacée, en principe, par une toute nouvelle Sécurité sociale de l’emploi et de la formation.
La mesure n’a pas vraiment été appréciée à gauche. Mais elle permet de faire renaître un débat : la rémunération doit-elle dépendre uniquement du travail ? En portant l’idée d’un revenu universel d’existence en 2017, Benoît Hamon posait la question d’une rémunération qui ne serait pas systématiquement liée au travail. La mesure a alimenté les débats, mais le candidat socialiste n’a pas percé, finissant avec un score de 6,36 %.
Le salaire doit-il dépendre de son travail ? La question ne crée pas un clivage structurant. Seule l’écolo Sandrine Rousseau voudrait, en plaidant pour un « droit à la paresse », extirper la pensée de gauche de ces questions. « Pourquoi serait-il interdit de penser en dehors du travail ? », se demandait-elle auprès de Politis en décembre dernier.
Au regard des propositions présentes dans leurs programmes respectifs, socialistes, écologistes, insoumis et communistes défendent une revalorisation des salaires, une augmentation du Smic à des degrés divers, une meilleure reconnaissance du travail, une plus grande considération pour le mal-travail, la sauvegarde des emplois menacés par les plans de licenciements à la chaîne dans le pays.
Sur le fond, quand les partis de gauche parlent du travail, ils parlent du niveau des salaires et de la protection sociale. S. Palombarini
De ce point de vue, « les divergences politiques à gauche sont largement surjouées, selon Stefano Palombarini, maître de conférences à l’université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis et membre du conseil scientifique de l’Institut La Boétie. Sur le fond, quand les partis de gauche parlent du travail, ils parlent du niveau des salaires et de la protection sociale. Pas de la prise de contrôle des outils de production, de la qualité du travail ou de son pouvoir sur son propre travail, qui sont des thèmes plus radicaux. » Alors, pourquoi tant de haine ?
L’atome de la discorde. Le programme du NFP omet même volontairement le sujet. Aucune proposition concernant la fermeture des centrales nucléaires. Dans ce contrat de législature figure seulement une loi énergie-climat dans les cent premiers jours de sa mandature. Sans plus de précisions sur ce texte.
La raison est simple : les gauches semblent impossibles à réconcilier sur la question énergétique. Les communistes souhaitent toujours développer la production d’électricité d’origine nucléaire, ils défendaient même en 2022 la construction de six EPR « au minimum ». Les socialistes ne veulent pas construire de nouveaux réacteurs, se donnent pour objectif de parvenir à 100 % d’énergies renouvelables, mais voient l’atome comme une « énergie de transition ».
Du côté de Raphaël Glucksmann, le projet de Place publique est encore plus modéré : l’eurodéputé désire « conforter le rôle du nucléaire, énergie pilotable et décarbonée, en assurant la sûreté des centrales existantes et la construction à temps de nouvelles unités », tout en plaidant pour un renforcement de la recherche et de l’innovation sur le traitement des déchets.
Plus fermes vis-à-vis de cette question, les écolos et les insoumis sont aussi plus compatibles sur le sujet. Ces deux familles politiques plaident pour une sortie pure et simple, par la fermeture progressive des réacteurs, l’abandon des projets d’EPR, la planification des démantèlements et la reconversion des sites. Cette fission (nucléaire) éteindra-t-elle les espoirs de l’union des gauches ?
1905 : une date gravée dans le marbre. On ne trouve personne pour y toucher. Des insoumis aux sociaux-démocrates en passant par les écologistes et les communistes, les gauches font de la loi de séparation des Églises et de l’État un totem à défendre. En comparant les derniers programmes, on voit qu’il n’existe pas de fracture idéologique claire. Rattachement des cultes au ministère de la Justice, création d’un observatoire indépendant de la laïcité, refus des financements publics pour la construction d’édifices religieux, d’activités cultuelles ou d’établissements confessionnels, augmentation des moyens de la Miviludes, etc. Des nuances existent entre les différents projets, mais il n’y a aucun fossé insurmontable.
Néanmoins, des clivages apparaissent lorsque des sujets surgissent dans l’actualité. Devant la volonté, en mars dernier, de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin d’interdire le port du voile dans le sport, toute la gauche a dénoncé cette campagne à caractère islamophobe et sexiste. À une exception près : Fabien Roussel. Sur CNews, le 25 mars, le secrétaire national du PCF s’est dit favorable à l’inscription, dans un texte législatif, des « principes de la charte olympique. Pas de manifestation, pas de démonstration religieuse ou politique dans le sport ».
Alors que la droite et l’extrême droite se sont lancées dans une surenchère anti-voile depuis plusieurs années, de nombreuses figures de gauche adoptent plutôt une posture « utilitariste », selon le terme utilisé par le politiste et sondeur Adrien Broche dans Portrait moderne de la gauche française (L’Aube, 2025). Traduction : interdire le foulard serait contre-productif, cette mesure ne ferait qu’alimenter la polémique permanente.
Jamais une émancipation n’est obtenue par l’interdiction d’un vêtement. Jamais on ne force les femmes à s’émanciper. S. Rousseau
Sur Europe 1 le 1er septembre 2021, Sandrine Rousseau l’affirme : « Le voile, la burqa sont des vêtements sexistes. Par contre, jamais une émancipation n’est obtenue par l’interdiction d’un vêtement. Jamais on ne force les femmes à s’émanciper. Donc il faut leur laisser le chemin seules, c’est à elles de faire ce chemin. » La laïcité, un sujet de discorde plus philosophique que programmatique ?
19 mai 2021. Devant les grilles de l’Assemblée, des milliers de policiers dénoncent le prétendu « laxisme » de la justice lorsqu’un policier est victime d’une agression. À la tribune, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d’Alliance, crie : « Le problème de la police, c’est la justice. » Au milieu de cette manifestation menée par les organisations majoritaires Unité SGP Police-FO, Alliance et Unsa-Police, quelques visages de gauche. Parmi eux, le patron du PS, Olivier Faure, l’eurodéputé écolo Yannick Jadot et le chef de file du PCF, Fabien Roussel. Les insoumis manquent à l’appel. Jean-Luc Mélenchon refuse de se mêler à cette « manifestation à caractère ostensiblement factieux ».
Une affaire de slogan ? Certains socialistes ne supportent pas des expressions comme « la police tue », assumée par les insoumis condamnant les violences policières. Malgré le désaccord, toute la gauche s’est pourtant retrouvée lors d’une conférence de presse organisée à la Chambre basse, le 24 juin, sur l’affaire Souheil El Khalfaoui, ce jeune homme de 21 ans tué par un tir policier à Marseille, le 4 août 2021. Autour de la famille de la victime, qui dénonçait la perte de neuf scellés dans le dossier (retrouvés le 26 juin), la communiste Elsa Faucillon, les socialistes Olivier Faure et Mathieu Hanotin (maire de Saint-Denis), les insoumis Mathilde Panot et Manuel Bompard ou encore l’écolo Cyrielle Chatelain.
Toutes les chapelles de la gauche critiquent la politique du chiffre installée depuis des années.
En regardant les programmes, il est difficile de voir une réelle division. Toutes les chapelles de la gauche critiquent la politique du chiffre installée depuis des années, réclament plus de moyens et plaident pour une refonte de la police. Toutes sont favorables, par exemple, au retour d’une police de proximité. Écologistes et insoumis sont d’accord pour que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) soient remplacées par un organisme indépendant. Les communistes comme les mélenchonistes veulent revoir la politique du maintien de l’ordre… Tous souhaitent augmenter les moyens de l’enquête et fonder une politique davantage concentrée sur le terrain.
Néanmoins, le sujet de la loi Cazeneuve de 2017, qui a aligné les règles d’ouverture du feu des policiers sur celles des gendarmes, a, dans l’histoire récente, créé des divisions. Les socialistes n’ont jamais plaidé ouvertement pour une abrogation, contrairement aux insoumis. Le programme du NFP a tenté de trancher : les gauches souhaitent aujourd’hui « réviser la loi et la doctrine sur l’ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d’obtempérer ». Et, localement, la question de l’armement de la police municipale et l’utilisation de la vidéosurveillance créent des remous dans certaines municipalités de gauche. Le clash peut-il prendre fin ?
Le 7 octobre 2023 a scindé la gauche en deux blocs. Sur la question israélo-palestinienne, les forces progressistes, humanistes et écologistes semblent condamnées à se diviser. Les insoumis reprochent au reste de la gauche de soutenir de façon « inconditionnelle » le gouvernement de Benyamin Netanyahou, et le reste de la gauche accuse les insoumis de « relativiser » l’attaque terroriste, de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël et, de ce fait, de cultiver une certaine ambiguïté vis-à-vis de l’antisémitisme. En refusant de qualifier le Hamas d’organisation terroriste, le procès en antisémitisme des insoumis a été relancé. Tous se souviennent encore de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur cet antisémitisme « résiduel en France ».
L’usage du terme « génocide » cristallise aussi les tensions. Mais toute la gauche s’est désormais convertie à la position insoumise. Le 26 mai, lors d’un rassemblement au Trocadéro, Olivier Faure a parlé de « génocide ». Jusque-là, il n’avait jamais assumé pleinement l’appellation. Éternelle guerre des mots ? Depuis, la réconciliation n’a pas eu lieu.
Pourtant, leurs revendications politiques sont les mêmes. Cessez-le-feu, respect du droit international, libération des prisonniers palestiniens comme des otages israéliens… Socialistes, insoumis, écolos, communistes défendent de façon unanime la reconnaissance d’un État palestinien. Et depuis longtemps. En 2014, le PS, les écologistes et le PCF avaient fait adopter au Parlement une résolution invitant le gouvernement socialiste à reconnaître un État palestinien.
À l’Assemblée, les divergences sont presque uniquement tactiques.
Sur les questions internationales comme sur bien d’autres, la gauche expose ses fractures au grand jour. Des divisions de fond importantes qu’elle aurait tort d’ignorer. Ukraine, Gaza, Europe, nucléaire, retraites : sur ces sujets, les lignes sont divergentes. Et pourtant, 650 mesures ont émergé à la suite des 13 jours et 13 nuits de négociations en 2022. Deux ans plus tard, un contrat de législature est signé.
Ces deux accords reconnaissent, au moins en partie, les divisions idéologiques. Mais ils statuent aussi sur tout le reste, ces sujets où les mésententes n’existent pas. À l’Assemblée, les divergences sont presque uniquement tactiques. Et les divisions reposent surtout sur des questions stratégiques. Censurer ou pas ? Conflictualiser chaque débat ou pas ? Après les slogans, les postures et les anathèmes, la gauche saura-t-elle, le moment venu, mettre ses différences de côté ?
mise en ligne le 2 juillet 2025
Marine Tondelier : « Il faut rallumer la flamme et tenir la promesse du NFP »
Emilio Meslet sur www.humanite.fr
Lucie Castets réunit, mercredi 2 juillet, une partie des formations du Nouveau Front populaire mais sans LFI, ni le PCF, ni Place publique. Une absence que déplore Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qui souhaite avancer vers une candidature commune.
Un an après son arrivée en tête des législatives anticipées, le Nouveau Front populaire (NFP) est en miettes. Mais Lucie Castets, longtemps candidate de la coalition pour Matignon, veut le réveiller pour permettre une candidature commune à la présidentielle. Elle réunit, mercredi, le PS, Les Écologistes, Debout !, L’Après et Génération.s à Bagneux (Hauts-de-Seine). Défenseure acharnée du rassemblement, la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, soutient l’initiative que sèchent LFI, le PCF et Place publique. Entretien.
Qu’attendez-vous de ce rendez-vous ?
Marine Tondelier : Il faut rallumer la flamme de l’été dernier – pas celle du RN qu’on va éteindre – pour tenir la promesse du NFP. C’est ce que veulent les sympathisants de gauche et écologistes qui voient le RN continuer de grimper dans les sondages, les reculs anti-écolo des macronistes se multiplier et l’absence de justice sociale se confirmer. Ils ont besoin d’entrevoir la lumière au bout du tunnel. Notre travail, c’est de leur offrir cette perspective de victoire.
L’absence de LFI, du PCF et de Place publique ne tue-t-elle pas dans l’œuf cette l’initiative ?
Marine Tondelier : J’ai lu l’interview de Fabien Roussel dans le Parisien : il est dans une stratégie de négociation pour les municipales. Il en a le droit, même si cela paraît un peu politicien. Mais la maire PCF de Bagneux a accepté d’accueillir l’événement, et je m’en réjouis. Je sais, pour militer avec eux depuis longtemps dans le Pas-de-Calais, à quel point les communistes ont l’antifascisme chevillé au corps et qu’à la fin ils seront à nos côtés.
Concernant les deux autres formations mentionnées, je pense que les absents auront tort. Elles restent les bienvenues pour la suite. Si on attend que tout le monde se donne la main pour avancer, on n’ira pas loin. L’antifascisme, dont Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann parlent si bien, ce n’est pas de la rhétorique.
On ne peut pas en parler avec emphase et adopter des stratégies individualistes qui mettent le pays dans le mur de l’extrême droite, et dont les politiques toucheront en particulier celles et ceux qui comptent sur nous pour l’en empêcher. Si à la fin ces deux candidats décident de se mettre en travers du chemin de la victoire de notre camp politique, ils en porteront la responsabilité.
Sur quelle base politique doit se faire l’union ?
Marine Tondelier : Pour changer la vie vraiment, chacun a conscience de la nécessité d’un programme de rupture. Il n’y a aucune raison de jeter à la poubelle le projet du NFP mais il y a des sujets qu’il faut urgemment retravailler, comme les questions internationales qui n’étaient pas un sujet des législatives anticipées.
Ce programme s’écrira avec celles et ceux qui sont là, dans un processus très ouvert. À l’issue de cette réunion, nous annoncerons une méthode dans laquelle tout le monde aura sa place comme expert, élu local, haut fonctionnaire, politique ou simple citoyen.
En tant qu’écologiste, nous serons bien sûr vigilants sur les sujets environnementaux et pour porter des mesures de justice fiscale comme la taxe Zucman qui rapporterait entre 10 et 25 milliards d’euros. Cela pourrait financer, par exemple, la rénovation thermique des 5 000 à 12 000 écoles par an. Notre programme doit être enthousiasmant, crédible et chiffré.
Pensez-vous vraiment pouvoir construire des compromis sur deux sujets qui ont fait voler en éclats l’union de 2022, comme l’Europe ou les relations internationales ?
Marine Tondelier : Nous n’avons pas le choix. La situation nous y oblige. Alors oui, certaines discussions seront un peu plus intenses que d’autres mais il faut arrêter de jouer au jeu des sept différences et trouver des convergences.
Cette réunion peut donner l’impression d’un huis clos entre appareils, sans le peuple de gauche ni la société civile…
Marine Tondelier : C’est l’inverse ! La matinée sera consacrée à des échanges avec des personnalités de la société civile syndicale, associative ou de mobilisation électorale. Pour ce qui est des citoyens, nous faisons exactement ce qu’ils attendent, tout en créant les conditions pour leur donner la parole afin de contribuer au projet et trancher sur la personne qui sera candidate. Mais il faut bien se retrouver entre partis pour organiser cela.
Pour quel mode de désignation plaidez-vous ?
Marine Tondelier : On verra après. Il faut d’abord faire selon la méthode de l’entonnoir, qui est un outil très pratique… à condition de s’en servir dans le bon sens. Commençons par les sujets évidents pour mettre tout le monde dedans, et ensuite la gravité aidera à ce que personne n’en sorte. L’idée est de trancher le mode de désignation d’ici à la fin de l’année.
Primaire, conclave, convention citoyenne : quel système a votre préférence ?
Marine Tondelier : Je ne suis pas une primaire béate. J’aimerais que nous puissions nous mettre d’accord par consensus comme nous l’avons fait pour trouver une candidature pour Matignon. Si cela n’est pas possible, alors faisons une primaire. Mais il faudra alors y aller à fond pour permettre une participation massive.
Je n’en peux plus de donner l’impression d’une gauche nombriliste qui passe son temps à se parler à elle-même. Je rêve d’une primaire qui occupe le terrain, d’une primaire pour créer un collectif façon VIe République, une primaire des territoires avec des débats décentralisés. Depuis quand la gauche ne s’est-elle pas adressée à chacun de nos territoires spécifiquement en adressant le quotidien, les besoins, les envies de celles et ceux qui y vivent et qui diffèrent ?
Votre parti a voté pour qu’il n’y ait qu’une seule candidature écologiste dans ce processus. Vous réfléchissez à vous lancer ?
Marine Tondelier : Évidemment que beaucoup m’en parlent. Ma priorité, c’est que ce cadre commun existe, et j’en suis l’une des garantes logiques au vu de ce qu’il s’est passé l’été dernier.
En tant que secrétaire nationale des Écologistes, je tiens aussi à ce qu’il y ait une incarnation écologiste dans ce processus, dont nous déciderons collectivement en temps voulu. Nous portons un projet singulier et nous avons bien compris que personne ne portera l’écologie à notre place.
Comment être audible sur l’union en 2027 sans la faire aboutir pour les municipales 2026, alors que des listes écologistes se présenteront contre des maires de gauche sortants ?
Marine Tondelier : Notre congrès a décidé que nous irions chercher partout les alliances les plus larges. À ce stade, nous en faisons la démonstration par les actes, même s’il y a parfois des villes où la situation est compliquée. Actuellement, je fais un tour de France des villes de droite qui pourraient basculer grâce à l’union.
À Auxerre, Nice, Cholet, Lorient, Limoges, Tourcoing, Roubaix, Toulouse ou encore Saint-Étienne, ensemble, nous pouvons gagner. Pour cela, certains partis doivent arrêter de refuser d’être dans la même pièce que d’autres. Vous pouvez compter sur Les Écologistes pour continuer à faire fonctionner l’union.
Quel objectif vous fixez-vous pour ces municipales ?
Marine Tondelier : Les villes écologistes doivent rester écologistes. Les gens voient qu’on améliore leur quotidien et qu’on rend possible leur lendemain. Avec les températures record du moment, croyez-moi, je préférerais vivre dans une municipalité écologiste qui a anticipé les choses.
Souvent, d’ailleurs, avec les moyens du bord puisque l’État a supprimé une grosse partie du fonds vert, lequel permet de s’adapter au dérèglement climatique. Avec nos petits bras, nous avons permis aux enfants de manger bio et local dans les cantines, de partir en vacances.
Nous avons aussi construit des milliers de kilomètres de pistes cyclables, rénové des logements sociaux et végétalisé l’espace public. Certaines politiques innovantes ont même vu le jour dans des mairies écologistes comme à Strasbourg. Jeanne Barseghian y a lancé l’ordonnance verte, c’est-à-dire un panier de fruits et légumes bio offert à toutes les femmes enceintes. Cela a permis d’injecter 650 000 euros dans l’agriculture locale et de protéger la santé des femmes et de leur enfant à naître.
À l’heure de la canicule, comment jugez-vous l’action du gouvernement en matière d’écologie ?
Marine Tondelier : Ils parlent tout le temps d’écologie punitive mais ce sont leurs économies budgétaires qui punissent chaque jour les Français. Le gouvernement s’apprêtait quand même à suspendre les aides pour isoler thermiquement les logements, c’est vrai que c’était le moment ! Nous voulons une écologie qui protège, contrairement à ceux qui n’ont que le mot « sécurité » à la bouche sans avoir de résultats en la matière.
Prenons la loi Duplomb : elle va réintroduire sur le marché français les néonicotinoïdes, dont l’acétamipride. Il s’agit d’un neurotoxique qui affecte les fœtus en franchissant la barrière placentaire, qu’on retrouve aussi dans le liquide céphalorachidien des enfants et qui donc impacte leur cerveau. C’est un scandale sanitaire mais aussi démocratique puisque le débat a été confisqué à l’Assemblée. Que le président fasse un référendum avec un débat transparent, étude contre étude. Nous avons confiance dans la réponse des Français.
Comment faire face à ces régressions ?
IMarine Tondelier : l y en a tellement – plus de 40 rien depuis le début de l’année – que les gens ne savent plus où donner de la tête. Mais ils se rendent bien compte que l’austérité conduit aujourd’hui à fermer des écoles en raison des fortes chaleurs. Clairement, « l’écologie » mise en place aujourd’hui par le gouvernement qui coupe des aides directes aux Français n’est pas la nôtre.
Le monde politique est immature sur les sujets écologiques. Je suis en revanche persuadée qu’un écologiste sommeille, certes parfois profondément, en chaque Français. En 2025, personne ne peut ignorer le réchauffement climatique. Mais nous sommes face à ce que les neurosciences appellent le syndrome de l’autruche, un mécanisme qui verrouille le cerveau pour le protéger émotionnellement de nouvelles trop dures. Une sorte de déni. Nous devons travailler à partir de ce constat.
Le RN a refusé, mardi, de censurer François Bayrou sur les retraites après l’échec du conclave. Qu’en pensez-vous ?
Marine Tondelier : Le RN est une escroquerie et ses électeurs doivent ouvrir les yeux. Ce parti prétend, le verbe haut, être antisystème mais il se défile à chaque fois. Présentement, le système ne tient plus que grâce à eux ! Drôle de manière de faire de la politique !
On parle ici des retraites, avec 4 millions de travailleurs potentiellement concernés par les mesures en discussion sur la pénibilité (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques…). Des maraîchers, des carreleurs, des aides-soignantes… Et là l’extrême droite offre quatre mois de plus, jusqu’au budget, à François Bayrou, Bruno Retailleau et les autres. Chaque jour de plus passé avec ce gouvernement sera aussi à mettre sur le compte pénibilité des Français.
Si le gouvernement venait tout de même à être censuré dans les prochaines semaines, la gauche revendiquerait-elle toujours Matignon ?
Marine Tondelier : On ne peut pas renoncer à l’exercice du pouvoir. Il n’a même jamais été aussi urgent pour les Français que nous l’exercions ! Si l’occasion se présentait, j’ose espérer que nous arriverions à nous mettre d’accord pour gouverner. Après deux mandats à subir les soi-disant « Mozart de la finance », je pense qu’on a urgemment besoin d’un ou d’une Mozart de l’empathie.
Le PCF ne participe pas à la réunion de Lucie Castets
Fabien Roussel explique dans un courrier à Lucie Castets pourquoi le PCF ne participera pas à son initiative du 2 juillet : « L’heure n’est pas à faire un tour de table de potentiels candidats (…) à l’élection présidentielle de 2027 quand tant de divisions demeurent à gauche aux élections municipales de 2026 ! » Selon le secrétaire national du PCF, il est surtout temps pour une gauche, « loin d’être majoritaire », de s’unir pour 2026 et de se mobiliser sur « des mesures fortes pour l’emploi, contre la vie chère ». Réuni lundi, l’exécutif du PCF estime aussi que « mettre le doigt dans une primaire dépossède de la décision, allonge le temps présidentiel, personnalise à outrance les débats ».
mise en ligne le 27 juin 2025
Avec « Comment le fascisme
gagne la France »,
le sociologue Ugo Palheta veut « réveiller les consciences »
Diego Chauvet sur www.humanite.fr
Sociologue spécialiste des extrêmes droites, Ugo Palheta analyse dans son dernier ouvrage l’accélération du processus de « fascisation » en France. Il appelle à un sursaut et à un débat stratégique au sein de la gauche.
Le sociologue spécialiste des extrêmes droites vient de publier un nouveau livre. Comment le fascisme gagne la France est une version largement remaniée et augmentée d’un premier opus, la Possibilité du fascisme, paru en 2018. Ugo Palheta y note une progression des thèses racistes et xénophobes, tout en réfutant l’inéluctabilité d’une victoire prochaine du Rassemblement national. À condition de « renouer avec l’antifascisme ».
Qu’est-ce qui a changé depuis « la Possibilité du fascisme » paru en 2018 pour justifier cette nouvelle édition ?
Ugo Palheta : Le changement tient surtout à l’amplification de dynamiques que j’avais identifiées à l’époque, et pour commencer la progression électorale du Rassemblement national (RN). En 2018, on croyait encore que le RN avait atteint un plafond de verre. Après le débat raté de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2017 et les mauvais scores du parti aux législatives qui avaient suivi, beaucoup pensaient que l’extrême droite était durablement affaiblie. En réalité, elle a depuis poursuivi une dynamique de renforcement. Aujourd’hui, elle constitue le seul bloc en expansion dans un paysage politique tripolaire, aux côtés du pôle néolibéral-autoritaire (Macronie-LR) et du pôle de gauche. Autre amplification majeure : le durcissement autoritaire de l’État.
Cela avait commencé sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais cela a pris une ampleur inédite avec Emmanuel Macron : répression brutale des mobilisations (gilets jaunes, quartiers populaires, Sainte-Soline…), surarmement de la police, interdictions croissantes de manifester, marginalisation du Parlement… Ce basculement s’accompagne de la banalisation et de la radicalisation du racisme d’en haut. Non seulement les politiques anti-immigrés ont été considérablement durcies par les droites au pouvoir, mais les partis et médias dominants n’ont cessé de construire l’islam et les musulmans comme ennemi de l’intérieur. Les deux meurtres récents visant explicitement des musulmans nous rappellent une fois de plus que ce racisme tue.
Pourquoi le discours sécuritaire et xénophobe de la droite et du centre ne siphonne-t-il pas l’électorat de l’extrême droite ?
Ugo Palheta : En fait, ces stratégies ne neutralisent pas l’extrême droite. Au contraire, elles banalisent ses idées et les rendent hégémoniques. Prenons 2007 : Nicolas Sarkozy a capté une partie de l’électorat du Front national, mais ça n’a été que provisoire. En reprenant les thèmes de l’extrême droite, les partis traditionnels déplacent le centre du débat public vers ses obsessions : immigration, islam, insécurité. Être hégémonique pour une force politique, c’est, notamment, parvenir à imposer les termes du débat, donc que les autres forces débattent ou légifèrent à partir de ce qui fait « problème » pour vous. Ainsi, quand la droite ou le centre gauche reprennent les obsessions de l’extrême droite, ils contribuent à bâtir les conditions de son hégémonie. À court terme, ils peuvent grappiller des points aux élections mais, à moyen et long terme, c’est l’extrême droite qui rafle la mise.
Vous notez également une part de responsabilité de la gauche. Quelle est-elle ?
Ugo Palheta : Le premier problème, c’est que la gauche dite de gouvernement a elle-même mené des politiques destructrices socialement : austérité sous François Mitterrand (la « rigueur »), privatisations massives sous Lionel Jospin, politique de l’offre sous François Hollande. Ces choix ont généré précarité, insécurité sociale, concurrence généralisée. Mais, si cette insécurité sociale a pu favoriser l’extrême droite, c’est que les politiques néolibérales, de droite comme de gauche, se sont accompagnées de discours et de politiques anti-immigrés et plus tard islamophobes. Si bien que les incertitudes et les peurs croissantes (de la précarité, du déclassement, etc.) ont été politisées selon un schéma xénophobe et raciste, orientées vers des boucs émissaires fournis notamment par toute l’histoire coloniale de ce pays : immigrés, musulmans, quartiers populaires.
La gauche n’a pas troqué les immigrés contre la classe ouvrière. Elle a durci son discours et ses politiques d’immigration au moment même où elle abandonnait les travailleurs. Mais il y a eu aussi des reculs idéologiques : outre l’acceptation de l’idée qu’il y aurait « trop d’immigrés », tout le discours historique de gauche autour de l’exploitation et de la lutte des classes a disparu dans ces années au profit d’une rhétorique vaguement « citoyenniste » ou contre l’exclusion, qui ne désignait plus aucun ennemi et épargnait ainsi la bourgeoisie. Or ce vide a été comblé par les récits identitaires de l’extrême droite : la nation menacée, l’islam contre la République, l’étranger comme ennemi intérieur.
Vous évoquez un basculement de l’État social vers un État pénal. En quoi cela relève-t-il d’une fascisation plutôt que d’un simple durcissement sécuritaire ?
Ugo Palheta : On parle souvent de « dérive », mais cela atténue la portée du phénomène. Mon hypothèse, c’est que ce qui se cherche ou se prépare n’est pas juste un État capitaliste démocratique un peu plus répressif, mais un État d’exception : suspension de l’État de droit, dissolution d’organisations, écrasement de toute contestation, etc. En outre, certains groupes – Roms, migrants, musulmans – subissent d’ores et déjà un traitement d’exception. Ce qui commence à la marge finit par s’appliquer à tous, sous la forme d’un État policier.
Cette évolution repose aussi sur une alliance renforcée entre autoritarisme et pouvoir économique. Des secteurs entiers du capital – industries fossiles, sécurité, armement, Big Tech, agrobusiness – parient désormais sur des stratégies autoritaires. Bien sûr, ce durcissement a pour objectif d’imposer la refonte néolibérale des rapports sociaux et de relancer l’accumulation du capital, mais il a aussi des visées banalement électorales : si, dès 2017, Macron a opéré un virage autoritaire et raciste, c’était pour capter l’électorat de droite, élargir sa base sociale et ainsi se maintenir au pouvoir en 2022.
Cette fascisation ne résulte-t-elle pas d’une stratégie réussie de la part du RN ?
Ugo Palheta : Le RN a mené une stratégie bien pensée de respectabilisation (dite « dédiabolisation »), mais certaines conditions ont favorisé leur succès. D’abord, cette stratégie n’aurait jamais fonctionné à ce point sans un haut niveau de complicité politique et médiatique, acceptant l’idée même que le RN d’aujourd’hui n’aurait plus rien à voir avec le FN d’autrefois. En outre, le RN prospère sur un terreau d’instabilité et d’incertitudes produit par des politiques néolibérales, face à une gauche impuissante ou carrément complice là encore. Dans ce contexte, un électorat s’est structuré à partir des années 1980, composé pour l’essentiel de gens qui n’ont jamais été politisés à gauche et qui sont imprégnés profondément par des rhétoriques de droite et d’extrême droite (mêlant refus du prétendu « assistanat » et refus de l’immigration).
Pour revenir au FN-RN, Marine Le Pen a cherché à se démarquer des déclarations antisémites et négationnistes de son père (qu’elle avait toujours acceptées jusque-là), tout en conservant l’essentiel de son idéologie. Elle a aussi habilement ajouté plusieurs notes à sa gamme ethno-nationaliste, par exemple en instrumentalisant la cause des femmes à des fins racistes (les immigrés et les musulmans seraient responsables de la persistance du patriarcat et des violences de genre) ou encore la lutte contre l’antisémitisme, prétendant que les ennemis des juifs seraient aujourd’hui les musulmans et la gauche.
Faut-il considérer la progression de l’extrême droite comme inéluctable ? Peut-on encore infléchir cette dynamique ?
Ugo Palheta : Le récit de l’inéluctabilité est lui-même un facteur de défaite. En juillet 2024, l’ensemble des sondages donnaient le RN largement gagnant. Pourtant, ce n’est pas ce qui s’est passé. Certes, il a progressé, mais c’est la gauche qui a obtenu une majorité relative grâce notamment à une forte mobilisation militante. Cela montre que la mécanique peut être brisée. « Ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu », écrivait Brecht.
Un certain volontarisme est nécessaire, même si l’action en elle-même ne suffit pas : nous avons aussi besoin d’un débat stratégique sérieux pour savoir comment employer nos forces, quelles alliances sont nécessaires pour vaincre et changer la société. Ce livre ne propose donc pas un constat désespéré ou une énième lamentation. Il vise à réveiller les consciences, mais surtout à comprendre comment nous en sommes arrivés là et, à partir de là, à définir une stratégie.
Justement, quel est cet antifascisme avec lequel vous appelez à renouer ?
Ugo Palheta : D’abord, cela suppose de refuser la normalisation du RN, sa banalisation. Employer le terme de fascisme, c’est rompre avec un récit anesthésiant et nommer clairement le danger. On le voit avec Netanyahou, Poutine ou Trump, l’extrême droite, ce ne sont pas que des discours, ce sont des actes : massacres (jusqu’au génocide à Gaza), arrestations et expulsions arbitraires, assassinats ciblés, etc.
Renouer avec l’antifascisme, c’est donc d’abord défendre notre camp social, qui inclut l’antiracisme, le féminisme, l’écologie sociale, toutes les luttes contre les dominations. Cette autodéfense est concrète : face aux agressions d’extrême droite, mais aussi pour protéger les droits fondamentaux des plus vulnérables. Mais l’antifascisme ne peut se limiter à la défense. Il doit redevenir un moteur politique, un point de ralliement. L’été dernier, un front commun a brièvement émergé à partir du ciment que constitue l’antifascisme et il faut prolonger cette dynamique : parce que l’extrême droite s’en prend à tout le monde, il nous faut l’unité des mouvements d’émancipation contre elle.
Le problème, c’est que cela est resté cantonné aux élections. Le Nouveau Front populaire n’a pas donné lieu à des campagnes de terrain durables, faute de volonté commune et de travail collectif. Or la gauche est forte quand elle fait vivre les luttes, toutes les luttes : dans les quartiers, les villages, les universités et bien sûr les lieux de travail.
Il faut enfin livrer une bataille culturelle. Pas seulement démonter les mensonges du RN, mais convaincre qu’une politique alternative est possible. Beaucoup partagent nos idées mais n’y croient plus. Il faut restaurer cette confiance, mais aussi articuler les propositions d’urgence à un horizon positif. Ne pas se contenter de dire non aux politiques néolibérales ou répressives, mais formuler le projet d’une société libérée de l’exploitation, du racisme, du patriarcat. C’est ce que le mouvement ouvrier a longtemps su faire : relier les luttes immédiates à un projet global de transformation.
Comment le fascisme gagne la France, d’Ugo Palheta, la Découverte, 380 pages, 20,90 euros.
mise en ligne le 24 juin 2025
Malgré sa diabolisation,
La France Insoumise maintient
sa stratégie du conflit
Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Les cadres du mouvement jugent illusoire l’idée qu’en changeant de stratégie sur la forme, leur disqualification médiatico-politique cesserait. Face à l’intensification des attaques et des accusations d’antisémitisme, ils s’adaptent pour ne pas donner d’« accroches ».
« Il faut essayer de comprendre le phénomène dans une dynamique politique. » Pour Manuel Bompard, la diabolisation de La France insoumise (LFI) est une évidence qui nécessite désormais de prendre de la hauteur. C’est pour le coordinateur national du mouvement une forme de « harcèlement permanent », un « deux poids et deux mesures » médiatique, politique et institutionnel qui vise à abattre le premier parti de gauche de France en s’affranchissant de la raison et des faits. On ne peut donc en faire qu’une lecture politique, sous l’angle de la fusion des droites et de la bollorisation des médias.
Cette analyse est en partie partagée au-delà des rangs insoumis. Même Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) qui défend désormais une candidature commune de la gauche hors LFI à la présidentielle, s’est inscrit en faux contre ce phénomène, qui n’est plus seulement l’apanage de la droite et de l’extrême droite. Il l’a dit à la tribune du congrès du PS à Nancy (Meurthe-et-Moselle) le 15 juin : « Je ne répondrai pas aux injonctions de la droite et de l’extrême droite qui rêvent de blanchir leurs convergences coupables en diabolisant la gauche radicale ! »
Les causes de cette répudiation peuvent être considérées comme lointaines. Dès qu’il s’est émancipé du PS, Jean-Luc Mélenchon a théorisé sa relation conflictuelle aux médias en anticipant, selon sa propre vision politique, la guerre à outrance immédiate que lui livrerait le capital s’il arrivait au pouvoir. Ce parti pris s’est traduit par de multiples outrances, du « petite cervelle » lancé à un étudiant en journalisme en 2010, aux journalistes de « Quotidien » interdits de couvrir ses meetings en 2019 – il reprochait à l’émission les images filmées lors de la perquisition au siège de son parti en 2018 –, en passant par de régulières attaques ad hominem contre des journalistes de presse écrite sur son blog.
La médiatisation du fondateur de LFI ne pouvait donc qu’être un terrain d’affrontement durable. Dès 2013, le chercheur en histoire visuelle André Gunthert consacrait d’ailleurs un article à la « généalogie de la diabolisation visuelle » de Jean-Luc Mélenchon.
Depuis, le triple candidat à la présidentielle a parfois mis le populisme de gauche en mode mineur, facilitant l’union des gauches en 2022 et une accalmie médiatique, comme l’analysait le politiste Arthur Borriello. Pôle émergent à gauche au début des années 2010, LFI a été propulsée au premier plan politique, ce qui aurait pu produire un changement d’optique. « Si la stratégie du “bruit et de la fureur” permet de marquer des points idéologiquement, elle peut aussi donner des munitions à nos adversaires et rabougrir notre propre base », prévenait le député Hendrik Davi, avant d’être purgé de LFI.
Une puissante mécanique de délégitimation
Mais la rupture avec le Nouveau Front populaire (NFP), dont le Parti socialiste (PS) est rendu seul responsable en raison de son abstention sur la motion de censure début 2025, a remis la stratégie du conflit au goût du jour. Et ce retour coïncide avec une période nouvelle de la diabolisation de LFI commencée après le 7-Octobre. La création d’une commission d’enquête parlementaire « contre LFI » obtenue le 18 juin par le patron des député·es Droite républicaine (DR) Laurent Wauquiez, sur ses supposés liens avec « l’idéologie islamiste », en est le symptôme le plus criant.
Mais déjà lors de l’hommage à Robert Badinter en février 2024, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, arrivé tôt, était apparu seul, les bras croisés, tel un symbole de l’ostracisation du mouvement – et il y en a eu d’autres –, tandis qu’Éric Ciotti, futur allié de Marine Le Pen, serrait des mains à tout-va.
Le débat sémantique assumé par la direction de LFI sur le caractère « terroriste » des attaques du Hamas et les fautes de Jean-Luc Mélenchon sur l’antisémitisme n’y sont pas pour rien. Mais la nature des attaques déversées depuis sur l’ensemble du mouvement – parfois à grand renfort de fausses informations et qui se sont traduites par la dégradation du domicile de Jean-Luc Mélenchon et des demandes de déchéance de nationalité contre l’eurodéputée Rima Hassan –, l’ont fait basculer dans une dimension quasi orwellienne.
Le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon, qui a frôlé les 22 % de suffrages exprimés à la dernière présidentielle, est ainsi érigé en repoussoir politique et moral. Et sa mise au ban dépasse largement les seuls médias d’extrême droite. De la base au sommet, des militant·es et des responsables de LFI, qui subissent les conséquences de la diabolisation, s’interrogent donc sur la manière d’y résister. Ne faudrait-il pas chercher à désarmer l’animosité ?
« Il y a une maccarthysation du débat public. On est revenus à une période de criminalisation de la parole contestatrice, et ça va bien au-delà des rangs de LFI », préfère considérer Manuel Bompard, pensant notamment au sort réservé à l’éditorialiste Jean-Michel Aphatie.
Le chercheur Johan Faerber, auteur de Militer. Verbe sale de l’époque (Autrement, 2024), qui étudie finement la fabrique du « réprouvé » en politique, partage en partie cette analyse : « LFI est assimilée au parti de l’étranger, une fable d’extrême droite qui procède depuis le XIXe siècle avec les mêmes mécanismes de délégitimation, et qui bénéficie aujourd’hui d’une puissance économique avec un réel pouvoir – notamment celle de Pierre-Édouard Stérin [un milliardaire ultraconservateur qui rêve de porter l’extrême droite au pouvoir – ndlr]. LFI est prise dans les mailles du filet d’un récit antimilitant, anti-opposition », résume-t-il.
Il n’y a pas d’alternance tranquille. Danièle Obono, députée LFI
Mais ce diagnostic devrait, aux yeux du chercheur, pousser les Insoumis à réagir : « Cela ressemble à une submersion. LFI est privée de son propre récit, elle ne peut plus rien énoncer, et ne peut que dénoncer. C’est très difficile à rétablir car pour faire des propositions, il faut être audible, or plus personne ne veut ni ne peut les écouter. »
Les cadres de LFI interrogé·es insistent pourtant d’abord sur la « dynamique politique » qui les place dans cette situation. « La diabolisation, la détestation de La France insoumise, est le ferment de la recomposition politique en cours, c’est-à-dire du rapprochement de la droite et de l’extrême droite », estime Manuel Bompard. Élu président du parti Les Républicains (LR), Bruno Retailleau a bien déclaré : « Nos seuls adversaires, c’est la gauche de Mélenchon », plaçant de manière subliminale le RN au rang de potentiel allié.
« On ne peut pas faire cette analyse sur la diabolisation sans penser en termes de radicalisation du bloc bourgeois, qui est prêt à s’allier avec les fascistes », explique aussi la députée LFI Danièle Obono. « Nous sommes pris pour cibles par les aspirants au pouvoir d’extrême droite parce qu’on représente l’organisation de gauche qui peut prétendre au pouvoir. Il n’y a pas d’alternance tranquille », ajoute-t-elle, rappelant que Léon Blum comme le Parti communiste français (PCF) ont fait l’objet des mêmes stigmatisations en leur temps.
Le boomerang de la conflictualité
Cette analyse, si elle s’appuie sur une droitisation réelle des élites médiatiques et politiques, fait abstraction des provocations des cadres du mouvement ces dernières années, qui ont permis à leurs adversaires de faire le vide autour de LFI. Le mouvement en avait tiré les conséquences après les législatives de 2024 en modifiant l’attitude du groupe à l’Assemblée nationale, englué dans les polémiques à répétition.
C’est sur ce point de clivage, entre autres, que François Ruffin a fini par rompre avec LFI, comme Clémentine Autain et leurs camarades de L’Après.
Dans une longue émission d’« Au Poste » le 30 mai 2024, Manuel Bompard revendiquait une « stratégie du coup de pied dans la porte » en matière de communication médiatique et de diffusion des idées. « Vous tapez un bon coup de pied dans la porte et après vous pouvez rentrer, vous pouvez développer vos arguments de manière tranquille », disait-il.
Réinterrogé à ce sujet par Mediapart quelques mois plus tard, le député nuançait : « Ce n’est pas la même chose de s’emparer de sujets qui fâchent en assumant de casser des unanimismes, et de passer son temps à répondre à des polémiques inventées de toutes pièces. Je vois bien qu’il y a des tentatives de diversion du système, et qu’il vaut donc mieux bien choisir ses angles de conflictualité. »
La stratégie de la première force de gauche en 2025 n’est pas si éloignée de celle des origines, quand au Parti de gauche en 2013 Danielle Simonnet théorisait : « Le conflit crée de la conscience. »
Si cette stratégie est malgré tout maintenue, c’est parce que les Insoumis sont convaincus que la conflictualité leur permet d’atteindre un électorat éloigné de la politique – le fameux « quatrième bloc », celui des abstentionnistes, comme l’analysait Jean-Luc Mélenchon au sortir du premier tour de la présidentielle de 2022. Un électorat auquel il faut s’adresser longtemps avant l’élection afin qu’il se mobilise le cas échéant, et permette à la gauche d’accéder au second tour.
« Pour ça, il faut rompre un peu avec le ronron médiatique et produire une conflictualité forte, qui peut temporairement faire douter des gens qui aspirent à une proposition politique plus consensuelle. Mais la question se pose à la fin, pas au milieu du chemin », estime Manuel Bompard. « Est-ce qu’il y a des gens qui sont influencés par ces campagnes de dénigrement médiatique et se disent que nous sommes allés trop loin ? Ça peut arriver, évidemment. La question, c’est de savoir si c’est durable. Or je pense que personne, dans l’espace politique qu’on aspire à rassembler, ne pense sincèrement que La France insoumise est un mouvement qui promeut l’antisémitisme », poursuit-il.
Preuve que les conséquences de la diabolisation des Insoumis sont désormais prises très au sérieux par l’état-major du parti, l’Assemblée représentative du mouvement, organisée le week-end du 21 et 22 juin à Paris, a donné lieu à une kyrielle de nouvelles mesures internes pour parer au problème.
Considérant que « la riposte face aux attaques est devenue indispensable », LFI a décidé de se structurer sur ce point. Outre la mise en place d’une plateforme internet dédiée où les militant·es et les cadres pourront trouver des arguments de « désintox », le mouvement promet de développer des « dispositifs pour assurer la sécurité des militants et leur accompagnement juridique » dans un contexte de « fascisation » de la société.
De nouvelles équipes de service d’ordre seront ainsi mises en place dans plusieurs départements et des formations seront entreprises « afin de pouvoir partout mener la bataille politique et faire face aux intimidations et aux menaces ». Enfin, afin d’éviter les « procédures bâillons », LFI annonce qu’elle mettra à disposition « une équipe nationale de juristes qui pourra accompagner et conseiller celles et ceux qui pourraient être visés par des poursuites judiciaires, ou qui voudraient faire des recours contre tel ou tel abus ou manquement administratif ».
Pauline Graulle
La stratégie de la première force de gauche en 2025 n’est ainsi pas si éloignée de celle des origines, quand au Parti de gauche (PG) en 2013 Danielle Simonnet, alors proche de Mélenchon, théorisait : « Le conflit crée de la conscience. » Or, si LFI a depuis progressé à l’intérieur de la gauche, elle n’y est pas hégémonique et n’a pas endigué la progression du RN. Plusieurs député·es sortant·es LFI ont perdu face au RN ou à l’extrême droite ciottiste en 2024 : Caroline Fiat, Pascale Martin, Léo Walter, Charlotte Leduc, Martine Étienne, Sébastien Rome, Catherine Couturier, Michel Sala ou encore Florian Chauche.
Il y a donc des moments où le doute s’immisce, et des erreurs qui amènent à une relative introspection. L’affaire du visuel aux codes antisémites de Cyril Hanouna, retiré en catastrophe des réseaux sociaux du mouvement, a fortement secoué ses cadres et ses militant·es. Interrogé sur la manière de répliquer aux accusations d’antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon avait dans un premier temps répondu sèchement – « On ne peut rien contre ça. Bien faire notre travail et laisser braire. C’est une offensive politique » –, avant de hurler sur le journaliste qui le questionnait. Mais la virulence des attaques qui ont suivi et les interpellations en interne de militantes et militants juifs heurtés par le visuel n’ont pas été neutres.
Le député Aymeric Caron avait diffusé le message suivant dans la boucle du groupe LFI à l’Assemblée : « Merci de tenir compte du fait que chaque membre du groupe est impacté, une fois de plus, par ces communications catastrophiques, qui se multiplient. » « Ce visuel n’aurait jamais dû exister », confiait, sous couvert de l’anonymat, un autre député, ajoutant sur le ton du regret : « On sait qu’on est dans un environnement hostile, mais il y a un état d’esprit spontanéiste. C’est presque un système. »
Les leçons d’une erreur
Depuis, les Insoumis assurent avoir tiré des leçons, même si le cadre médiatique dominant est jugé trop hostile pour pouvoir les exposer. « Sur ce sujet-là comme sur d’autres, on a été bousculés car des personnes concernées nous ont dit que notre positionnement n’allait pas. C’est un mensonge de dire qu’on ne veut rien faire dessus », relate Danièle Obono, qui a assuré ces dernières années une formation interne sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et qui répète que cet épisode était « une erreur », « un manque de vigilance ».
« On est un mouvement qui a dix ans à peine, avec ses forces et ses limites. Il faut faire avancer des gens avec des niveaux de formation différents, travailler nos angles morts pour que ça ne serve pas à créer des accroches. On a commencé ce travail et on va le continuer », assure la députée, qui distingue le « débat critique » légitime de l’« offensive politique » malhonnête. S’ils dénoncent d’un côté l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme à des fins de criminalisation des mobilisations pour la Palestine ou d’affaiblissement de LFI, les Insoumis reconnaissent tout de même un besoin de s’améliorer, dont les autres partis de gauche ne sont pas non plus exempts.
« Le racisme, l’antisémitisme, le sexisme sont des phénomènes qui existent dans la société de manière générale. Aucun corps social ne peut considérer qu’il en est, par principe, immunisé, affirme ainsi Manuel Bompard. Toutes les formations politiques ont un travail à faire sur ces oppressions. Mais moi, je le mène en dehors des caméras et des interviews. Le cadre médiatique est trop gangrené par les instrumentalisations pour pouvoir avoir une discussion sereine sur le sujet. »
Pris en étau entre la nuance et le temps long nécessaires à certains débats aussi complexes que cruciaux d’un côté et, de l’autre, la conflictualité érigée en stratégie dans un cadre médiatique qui ne fonctionne qu’à l’indignation, LFI cherche un difficile équilibre.
Mais, sur le fond, elle considère sa diabolisation inévitable en raison de ses positions, et alerte donc le reste de la gauche : « Le problème des gens qui nous attaquent, ce n’est pas La France insoumise, c’est le programme de rupture qu’on porte. Si, à un moment, ils ont l’impression qu’ils sont débarrassés de La France insoumise, ils s’attaqueront aux autres, prévient Manuel Bompard. C’est une constance de l’histoire. »
mise en ligne le 23 juin 2025
Face
aux nouveaux fascismes,
construire la digue
Edwy Plenel sur https://blogs.mediapart.fr/
L’association unitaire Visa (Vigilance et initiatives syndicales antifascistes) publie chez Syllepse un remarquable manuel internationaliste de résistance aux nouveaux fascismes que j’ai volontiers accepté de préfacer.
Créée en 1996, Visa est une association intersyndicale qui regroupe plus de 300 structures syndicales. Si la CGT, Solidaires et la FSU y prédominent, on y retrouve aussi le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ainsi que des syndicats de la CFDT, de la CNT, de la CNT-SO, de FO, de l’UNSA et de l’Union pirate. Nouveaux fascismes, ripostes syndicales qui vient de paraître chez Syllepse synthétise et actualise le travail de réflexion et d’information de ce réseau unitaire face à la menace d’extrême droite.
Sa grande originalité, outre évidemment sa documentation du cas français, est sa dimension internationale à l’heure où cette menace est devenue globale, sous ses divers avatars. Grâce aux solidarités syndicales, Visa offre ainsi un inventaire par pays quasi exhaustif, dans cet ordre : Italie, Hongrie, Finlande, Pays-Bas, Pologne, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Bélarus, Russie, Ukraine, Iran, Inde, Argentine, Brésil, Israël/Palestine, Syrie, États-Unis. J’ai volontiers accepté la demande de Visa de soutenir ce livre par une préface, que je republie dans ce billet.
Son propos rejoint celui d’autres initiatives d’esprit unitaire et internationaliste, semblables au travail constant de Visa. Ainsi, le jour où j’écrivais à Lisbonne cette préface intitulée « Construire la digue », le député écologiste Pouria Amirshahi lançait à Paris « La Digue », reprenant la même image avec la même démarche : fédérer pour résister. Toutes les précisions sont à retrouver ici. Sous l’intitulé « Ni Trump ni Poutine, construire la digue », Pouria Amirshahi et d’autres parlementaires (notamment Elsa Faucillon, Tristan Lahais et Chloé Ridel) présenteront leurs premières réalisations au Festival des idées de La Charité-sur-Loire, vendredi 4 juillet en soirée, lors d’un débat animé par Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent.
Construire la digue
Ne nous racontons pas d’histoire : l’époque n’est pas réjouissante tant les ombres menacent.
Le week-end qui a précédé l’écriture de cette préface, une victoire de l’extrême droite a été évitée in extremis à l’élection présidentielle en Roumanie – mais elle a progressé en suffrages –, tandis que la droite extrême est arrivée en deuxième position au premier tour de l’élection présidentielle en Pologne – elle risque de bénéficier au second du renfort des voix d’extrême droite –, alors que l’extrême droite supplantait une gauche en déclin aux élections législatives au Portugal – au point de devenir la première force d’opposition à la coalition conservatrice au pouvoir.
Ces trois résultats électoraux surviennent dans un paysage géopolitique non seulement européen mais mondial où, sous divers atours selon les contextes nationaux, une extrême droite xénophobe et raciste, autoritaire et populiste, cynique et violente, impose son agenda idéologique. Cette radicalisation des classes dominantes, pour défendre leurs privilèges indus et perpétuer les injustices qui les garantissent, enfante une fuite en avant guerrière dont l’agression russe contre l’Ukraine et la destruction israélienne de la Palestine sont les dramatiques illustrations, ouvrant la voie à une sauvagerie générale où des civilisations prétendument supérieures nourrissent leurs propres barbaries, jusqu’aux crimes contre l’humanité tout entière.
Solution de rechange d’un capitalisme du désastre qui refuse toute limite à son avidité destructrice, cette extrême droite mondialisée a évidemment le visage de Donald Trump qui, redevenu président des États-Unis, s’attaque à tous les principes démocratiques, aussi imparfaits et inaccomplis soient-ils, proclamés à la face du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la conscience des catastrophes produites par le règne de l’argent, la loi du plus fort et le désir de puissance. Le trumpisme et tous ses avatars, dont les versions françaises fédèrent désormais tout le camp conservateur jusqu’au centre-droit, s’attaquent aux libertés et droits fondamentaux en arguant de leur seule légitimité électorale qui l’emporterait sur tout autre pouvoir ou contre-pouvoir – l’État de droit, l’indépendance de la justice, le respect du syndicalisme, la liberté de la presse, l’auto-organisation populaire, le pouvoir du Parlement, etc.
C’est ici qu’intervient l’apport décisif de ce livre issu du travail collectif de Visa, ce réseau de « Vigilance et initiatives syndicales antifascistes ». Refusant l’abattement et la résignation que peut générer la lucidité sur l’ampleur et l’urgence du péril, il documente le véritable chemin de résistance, le plus sûr, le plus solide, le plus durable. Les exemples étrangers cités précédemment nous le rappellent : surtout en France où l’élection présidentielle réduit la volonté de tous au choix d’un seul, on ne peut plus se contenter de faire barrage par nos votes, pour empêcher le pire, au risque de laisser advenir des pouvoirs qui lui font la courte échelle comme ce fut le cas, depuis les scrutins de 2017 et de 2022, avec Emmanuel Macron. Non, plutôt que d’être réduits régulièrement à faire barrage, ce manuel de résistance nous indique comment construire la digue.
C’est une digue sociale, unitaire et internationaliste. Sociale, car tout syndicaliste le sait : c’est dans les luttes, au plus près du concret et du quotidien, des lieux où l’on vit, habite et travaille, que se construisent des résistances progressistes qui mobilisent et rassemblent au-delà des premiers convaincus. Unitaire, car tout antifasciste l’a appris : c’est grâce aux divisions fratricides des tenants de l’émancipation, aux querelles des forces partisanes qui en font la diversité, donc la richesse, que l’extrême droite réussit à s’imposer, en pariant sur la démobilisation et la démoralisation. Internationaliste enfin, car toute l’histoire des luttes l’enseigne : c’est par une conscience aigüe des causes communes de l’égalité qui unissent les peuples, leurs espérances de justice et de dignité, que peut se construire une résistance sans frontières, sans nations propriétaires et sans « campismes » borgnes, aux dominations des pouvoirs économiques et étatiques.
Cet internationalisme est sans doute l’apport le plus original de ce livre, sans équivalent dans le débat politique tant, à gauche, s’est longtemps égaré ce fil originel de la cause ouvrière et du mouvement social. Ici, on apprend des autres, des ailleurs et des lointains. « Agis en ton lieu et pense avec le monde » : cette recommandation d’Édouard Glissant convient bien à la démarche de Visa alors que l’émergence de nouveaux fascismes accompagne la violence ravageuse de pouvoirs oligarchiques et mafieux. Poète du Tout-Monde et penseur de la Relation, ce Martiniquais fut lui-même de tous les combats des émancipations, aussi bien contre l’aliénation coloniale que contre la prédation capitaliste. Si je convoque ici cette lucidité, c’est parce qu’elle me semble résumer l’esprit même du syndicalisme qui unit, dans sa pluralité, ce réseau antifasciste unitaire.
Ainsi entendu, le syndicalisme est une école de solidarité et d’humilité, où l’auto-organisation est indissociable d’une autodidaxie. L’espérance d’égalité, de justice et de dignité, n’y est pas une doctrine assénée d’en haut par des clercs qui en seraient les gardiens, voire les propriétaires au nom d’une prétendue juste ligne. Non, elle se construit toujours par en bas et par l’expérience, durant ces moments précieux où l’on se retrouve autour de causes partagées, dans un heureux déplacement où l’on s’échappe des immobilités et des fixités, des fatalités du destin et des assignations à résidence.
À rebours de la politique professionnelle et élective, où l’engagement risque trop souvent de devenir un métier carriériste et une ambition personnelle, le syndicalisme originel s’est ainsi affirmé comme une philosophie concrète de l’action, ancrée dans le vécu quotidien des premiers concernés. Nul hasard d’ailleurs si, à sa source première, l’on trouve une tradition aujourd’hui trop mésestimée, libertaire et anti-autoritaire, qui se méfiait instinctivement des avant-gardes autoproclamées qui prétendent savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui.
C’est ce que propose Visa face à l’extrême droite : construire la digue avec la société, dans la société, pour la société. Même si le vote est évidemment l’un des moyens de l’empêcher d’arriver au pouvoir, il serait irresponsable de s’en contenter, de ne parier que sur lui, de n’avoir que cet objectif en tête. Même une heureuse surprise électorale ne mettra pas fin, tel un coup de baguette magique, à son emprise idéologique sur le débat public, dans un engrenage ravageur qui ruine tout monde commun avec pour premières cibles les discriminé·es, les racisé·es, les minorités, les femmes…
Aussi bien à l’intérieur d’une même nation qu’à l’échelle du monde entier, la cause des opprimés, exploités et dominés, est forcément sans frontières. Tout repli identitaire – nationaliste, xénophobe, sexiste, masculiniste, etc. – est une concession faite aux ennemis de l’égalité des droits, de la justice sociale et de l’émancipation collective. Car c’est bien cela que l’extrême droite, unie sur l’essentiel quelles que soient ses chapelles, entend combattre : l’égalité des droits, cette proclamation qui est au point de départ de tous les droits conquis, inventés, défendus, imaginés, que ce soit hier, aujourd’hui ou demain. Droits politiques, droits sociaux, droit des femmes, droit des peuples, droit international, droit de la nature, etc. : contre ces tenants de l’inégalité naturelle qui sont nos adversaires de toujours, en tout temps et sous toute latitude, il s’agit de défendre cette égalité radicale, sans distinction d’origine, de naissance, de culture, de croyance, d’apparence, de sexe, de genre.
« Là où croit le péril croît aussi ce qui sauve » : empruntée au poète Hölderlin, cette formule convient bien au travail de Visa, aussi nécessaire que salutaire. Il n’y a jamais de fatalité. Tout dépend de nous, de nos lucidités et de nos responsabilités. En ce sens, toutes et tous, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes.
Lisbonne, le 22 mai 2025
Nouveaux fascismes - Ripostes syndicales
Éditions Syllepse Collection : « Mauvais Temps »
Coordinateur : Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (Visa)
204 p - 12 €
mise en ligne le 19 juin 2025
Ça a eu lieu !
Catherine Tricot sur www.regards.fr
Il y a un an le président dissolvait l’Assemblée nationale. Retour sur ce moment qui rassembla la gauche.
Ce fut un choc, un traumatisme national, souvent vécu intimement : on se souvent de l’endroit où l’on se trouvait lorsqu’Emmanuel Macron est apparu sur les écrans ce 9 juin 2024 vers 21 heures. Au soir de l’élection européenne où l’extrême droite française venait de rassembler plus de 31% des suffrages et les macronistes moins de 15%, le président de notre Ve République annonçait sa décision : l’Assemblée nationale est dissoute.
Dans la ville où je vis, Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, ce fut un vent d’angoisse. Comment Macron pouvait-il nous faire ça !? Lui semblait s’amuser : il voulait « balancer une grenade dégoupillée dans les jambes des partis. Maintenant on va voir comment ils s’en sortent ». Nous, on voyait déjà le RN à Matignon et tout le monde anticipait la poussée des haines racistes, les expulsions, les agressions homophobes, les attaques « contre les wokistes et les gauchistes ». Ce fut cette épouvantable anticipation qui a poussé des centaines de milliers d’entre nous à exiger l’union de tous les partis de gauche. Les militants politiques n’étaient pas les plus présents dans ces premiers moments, marqués par les divisions. Glucksmann pavoisait avec un peu plus de 13% ; Mélenchon était ravi que LFI frôle les 10%, les écologistes respiraient d’avoir franchi la barre fatidique des 5% ; les communistes n’avaient toujours pas la clef pour sortir de leur marginalité… La gauche politique qui rassemblait autour de 30% était à ses affaires.
Mais, dès cette nuit-là, devant les sièges des partis, sur les réseaux, par tous les moyens (pétitions, note de blogs, appels…), la gauche profonde se mobilisait. La proposition fut d’abord formulée par François Ruffin : il fallait un « nouveau front populaire », avec les partis, les assos, les syndicats… tout le monde pour barrer la route au RN. Un programme, partout des candidats communs sous la bannière NFP malgré quelque dissidences et de méchantes purges. Au final, hausse spectaculaire de la participation et à la surprise générale, le NFP arrive en tête. Les partis de gauche s’enferment alors à huis clos pour trouver un nom qui fasse consensus pour Matignon. Que ces 10 jours furent longs et pathétiques. Et ce fut l’inconnue et inattendue Lucie Castets ! Fantastique ! Nous avons donc de la ressource humaine.
La suite, on la connait. Elle commence par cette incroyable fête concoctée par Thomas Jolly et sa bande. Sur la Seine, aux yeux du monde et pour ouvrir les Jeux olympiques, c’est notre France qui s’avance. Belle, inattendue, dangereuse et créative. On est heureux. Comme le dit l’historien Patrick Boucheron, qui était de l’aventure aux côtés de Thomas Jolly, à propos de tous ces moments : « Ça a eu lieu ». Et c’est là l’essentiel.
L’acharnement à éteindre ce feu n’a pas été vain. Macron a procrastiné pendant 3 mois pour éviter que la gauche ne vienne défaire « sa belle et grande politique de l’offre ». Barnier fut nommé. Rien ne fut demandé aux millions d’entre nous qui ont voté NFP. Les partis de gauche se sont un peu plus entredéchirés. Comme si Bardella avait gagné, Retailleau a pu dire et faire ses dingueries et le premier ministre Bayrou parler sans honte de submersion migratoire. Gaza se meurt et il se passe si peu. On promet désormais la retraite à 66 ans. Et Macron recommence à se parer des vertus de l’écologie. La tristesse est revenue. Glucksmann et Mélenchon se préparent, loin de nous, de nos peurs et de nos espoirs.
Mais nous savons que ça a eu lieu.
mise en ligne le 2 juin 2025
Gauche : la cata de 2027,
ça commence maintenant
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
La présidentielle est dans deux ans. La gauche prend le risque d’une division et d’une énième défaite. La débâcle se joue dès aujourd’hui.
La semaine dernière fut catastrophique. L’Assemblée nationale a défait des acquis vieux de plusieurs années, en faveur de la biodiversité et de la qualité de l’air. Des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles sont réintroduits, l’imperméabilisation des sols est tolérée, les ZFE sont remisées. Dans le même temps, le gouvernement obtenait un jugement qui autorise la reprise du chantier de l’autoroute A69. Tout ceci a été fait sous l’impulsion de la droite et de l’extrême droite en opposant les intérêts des agriculteurs, des catégories populaires, des populations d’un territoire à celui de l’environnement. La gauche et les écologistes ont été dans l’incapacité de faire face, se payant même le luxe de se diviser sur le vote des ZFE.
On a déjà déploré, ici, cette logique de lutte systématique qui marginalise la gauche, la rend inaudible et inefficace. Quelle misère quand s’annonce le pire quant à la protection sociale et son financement. C’est toujours cette recherche de la différenciation qui a mis toute la gauche, depuis de longs mois, dans l’incapacité d’organiser des rendez-vous puissants pour soutenir les Palestiniens et contrer le génocide perpétré par le gouvernement israélien.
Le jeu de massacre qui s’installe à gauche pèsera en 2027. Il prépare l’élimination du second tour et assure l’élection d’un président d’extrême droite, de droite extrême ou de droite radicalisée. Mais inutile d’attendre 2027 pour en subir les conséquences. Le refus de convergences pour mieux justifier les candidatures adversaires s’est payé cash cette semaine. En 2026, cela se traduira sans nul doute par la multiplication des listes concurrentes aux municipales.
La mécanique qui peut aboutir à la destruction de la gauche est lancée à plein régime. C’est tout à fait irresponsable et délétère. Ce jeu de massacre programmé doit à tout prix s’arrêter.
Les différences à gauche sont connues et sont structurelles. On ne peut les éluder. On a su vivre avec à de nombreuses reprises dans l’histoire. Hier encore. La gravité des défis impose que l’on trouve une façon de gérer ces désaccords.
Une logique de concurrence à mort jusqu’en 2027 nous laminera tous. Quand bien même il resterait, comme dans les Monty Python, un valeureux combattant sans bras et sans jambe.
Il a été proposé par François Ruffin, par des maires de toutes sensibilités, de s’engager dans une grande consultation de toute la gauche pour départager les logiques qui existent. De fait, c’est ce qui s’est passé en 2017 et en 2022. C’est Jean-Luc Mélenchon qui a remporté cette compétition entre les gauches et les écologistes. Sur la base de ses succès électoraux, Jean-Luc Mélenchon proposa une alliance qui reposait sur les grandes lignes de son programme : ce fut la Nupes puis le NFP. On ne peut pas recommencer cette procédure, classique à gauche, de départage au premier tour de l’élection. Dans un moment de fragilité, les conséquences sont trop destructrices. Il faut anticiper et éviter à tout prix que s’éternise le climat actuel.
Le soutien apporté par Boris Vallaud à Olivier Faure permet d’imaginer un PS ouvert au rassemblement de la gauche. Il ne peut se concevoir dans un périmètre qui exclut sa principale force : les insoumis. Les désaccords ne sont certes pas aux marges. Oui, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann n’ont pas le même projet. Peuvent-ils se passer l’un de l’autre pour gagner et gouverner ? Peuvent-ils prendre la responsabilité au nom de leurs certitudes de nous affaiblir tous ? Il n’y a de rassemblement possible qu’au terme d’une procédure sincère et ouverte qui permet d’exposer les projets et d’acter les différences, d’avancer vers des compromis. Ceux qui, par principe, refuseraient de participer à ce qui est tellement attendu par les électeurs de gauche porteraient le poids politique et historique.
mise en ligne le 29 mai 2025
Politis a trouvé
de l’argent magique !
Pierre Jequier-Zalc sur www.politis.fr
À l’aide de nombreux travaux d’économistes, Politis recense cinq mesures qui permettraient de trouver plus de 50 milliards d’euros par an. Davantage que le montant recherché par François Bayrou. Un bonus exceptionnel – pour seulement un an – rapporterait 100 milliards d’euros additionnels.
Le gouvernement de François Bayrou est tellement désemparé face à la nécessité de trouver 40 milliards d’euros supplémentaires pour le prochain budget qu’on ne serait même plus étonné qu’une cagnotte en ligne soit ouverte par les équipes du premier ministre. Comment ne pas les comprendre ?
Enfermés dans une politique de l’offre dogmatique, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont baissé les recettes fiscales, quoi qu’il en coûte. Et ils ne veulent surtout pas faire machine arrière. À ce niveau-là, et même si bon nombre de ministres aiment se poser en apôtres de la laïcité, tout indique que c’est bien la croyance en une religion néolibérale décomplexée (et surtout sa pratique) qui nous a conduits au bord d’une crise de la dette majeure. Dans leur logiciel, il ne reste donc qu’une seule solution : baisser, encore, les dépenses sociales, après trois réformes brutales de l’assurance-chômage et la hausse de l’âge légal de départ à la retraite.
Politis compile ci-dessous quelques idées simples et efficaces pour résoudre l’équation à laquelle les gouvernements successifs, depuis 2017, ne veulent pas répondre. Alors que plus de 9 millions de Français sont en situation de pauvreté, et que ce nombre est en hausse, nous estimons extrêmement périlleux et irresponsable de tailler plus encore dans les dépenses sociales. Pour faciliter la vie de François Bayrou, nous lui proposons ici de quoi faire entrer plus de 50 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an dans les caisses de l’État.
Des propositions chiffrées et sourcées par des économistes reconnus et spécialistes qui, selon toute vraisemblance, ne mettraient en péril ni les emplois ni la santé économique du pays – rappelons, à ce titre, que notre croissance est atone depuis plusieurs années. En revanche, certaines reviennent sur des politiques publiques mises en place depuis 2017 et ayant conduit à aggraver la situation économique de la France.
1 – Appliquer la taxe « Zucman » : 20 milliards d’euros
C’est la mesure la plus médiatisée, notamment du fait du vote par les parlementaires, en février, d’une proposition de loi du groupe Écologiste et Social reprenant le principe de cette taxe pensé par Gabriel Zucman, éminent spécialiste de la fiscalité des plus riches. L’idée est simple et part d’un constat mis au jour par une note de l’Institut des politiques publiques dont Politis vous parlait déjà en 2023 : l’impôt sur le revenu devient régressif pour les plus riches de notre société. Ainsi, les 0,0002 % plus grandes fortunes du pays ne paient que 26 % d’impôt sur leur revenu, contre 50 % pour les 10 % les plus aisés.
En parallèle, le patrimoine des grandes fortunes a explosé ces dernières années, notamment parmi les plus riches des plus riches. Comment expliquer, dans un pays dont la devise contient le mot « égalité », que les plus fortunés payent proportionnellement moins d’impôts que les autres ? Gabriel Zucman propose donc de remédier à cette injustice en instaurant une taxe sur le patrimoine – et non sur le revenu ! – pour les ultra-riches. Cela ne concerne que les foyers fiscaux détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine – soit une infime partie de la population. Un impôt à hauteur de 2 % du patrimoine de ces immenses fortunes permettrait, selon le chercheur, de faire entrer environ 20 milliards d’euros par an dans les caisses publiques.
L’argument ultime des néolibéraux – « si on les taxe, les riches vont partir » – relève du préjugé.
Surtout, cela n’appauvrirait pas ces foyers : en effet, le rendement de leur capital – c’est-à-dire ce que leur fortune leur rapporte en plus chaque année – est de près de 7 % par an en moyenne sur les quarante dernières années, net de l’inflation. Inutile de souligner que les salaires n’ont pas connu une telle hausse. Enfin, l’argument ultime des néolibéraux – « si on les taxe, les riches vont partir » – relève du préjugé et a été maintes fois contesté (lire ci-dessous).
ZOOM : L’exil des riches, peur infondée et facilement résoluble
Si un impôt sur le patrimoine des plus riches est mis en place, ceux-ci auraient le loisir de quitter le territoire pour y échapper : cet argument est répété inlassablement par ceux qui refusent la création de cette taxe. Il suffirait pourtant, afin d’empêcher ce contournement fiscal, de mettre en place un « bouclier anti-exil ». « L’idée est simple : si une personne a vécu longtemps en France, y est devenue immensément riche, et déménage dans un paradis fiscal, alors la France devrait – et pourrait facilement – continuer à taxer cette personne après son départ », explique, sur Instagram, Gabriel Zucman. Loin d’être saugrenue, cette idée est déjà mise en pratique par les États-Unis, par exemple.
2 – Réformer l’héritage et les droits de succession : 19 milliards d’euros
C’est certainement la manne de richesses la plus importante dans laquelle l’État pourrait puiser : les héritages. Dans les quinze prochaines années, 9 000 milliards d’euros de patrimoines détenus par les Français les plus âgés seront transmis à leurs héritiers. Un chiffre énorme, qui témoigne d’une réalité de mieux en mieux documentée ces dernières années. La France du XXIe siècle redevient une société d’héritiers, comme au XIXe siècle. Aujourd’hui, la fortune héritée représente 60 % du patrimoine national, contre 35 % seulement au début des années 1970.
Le flux successoral représente chaque année environ 400 milliards d’euros de patrimoine transmis. Fondation Jean-Jaurès
Étudié par de nombreux économistes, le principe de la succession reste pourtant profondément injuste et très inégalement réparti au sein d’une population où le patrimoine est de plus en plus concentré dans les mains d’une petite minorité – les 10 % les plus riches en détiennent plus de la moitié. « Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail », souligne une étude du Conseil d’analyse économique (CAE), un collège d’économistes qui conseille le premier ministre.
Malgré cela, les successions restent très faiblement taxées. « Le flux successoral représente chaque année environ 400 milliards d’euros de patrimoine transmis, et la fiscalisation de ces donations et successions rapporte autour de 20 milliards d’euros à la collectivité (soit environ 5 % du total des transmissions) », rappelle ainsi une note de la Fondation Jean-Jaurès.
La faiblesse de ce pourcentage est notamment due à l’existence de nombreuses niches fiscales : pacte Dutreil (exonération de la transmission des biens professionnels), assurance-vie, etc. Autant de dispositifs qui permettent à bon nombre de successions d’éviter l’imposition. « Le système de taxation français […] est […] mité par des dispositifs d’exonération ou d’exemption dont les justifications économiques sont faibles », explique les économistes du CAE.
Au vu de ce constat, s’attaquer à une réforme d’ampleur des droits de succession s’apparente à une nécessité démocratique pour rétablir de l’égalité et de l’équité. Ce serait surtout une aubaine pour renflouer efficacement les caisses publiques. Les économistes du CAE ont fait des simulations : ils estiment qu’une réforme ambitieuse, qui s’attaquerait frontalement aux dispositifs qui mitent les droits de succession aujourd’hui, rapporterait 19 milliards d’euros par an à l’État. Une telle réforme n’augmenterait nullement les droits de succession des petits patrimoines, argument régulièrement utilisé par le pouvoir pour ne pas s’attaquer à ce sujet.
3 – Légaliser le cannabis : 2,8 milliards d’euros
Le chiffre pourrait paraître énorme. Pourtant, il est vraisemblablement sous-estimé car fondé sur des estimations très approximatives – et sans doute inférieures à la réalité – de la consommation actuelle de cannabis. Pour donner un ordre d’idée, les recettes fiscales sur la vente de cigarettes étaient de près de 13 milliards d’euros en 2024.
C’est, une nouvelle fois, une note du Conseil d’analyse économique, rattaché à Matignon – qu’on ne peut donc que difficilement qualifier de bolchevique –, qui aboutit à cette estimation : légaliser le cannabis permettrait à l’État d’engranger 2,8 milliards de recettes supplémentaires. Cette somme prend en compte l’ensemble des taxes qui encadreraient la vente du cannabis. En revanche, elle n’intègre pas d’éventuelles nouvelles recettes issues d’un changement des politiques publiques.
En effet, si le cannabis est légalisé, plus besoin de mener des politiques répressives – spécialité hexagonale sur ce sujet. « Même si on fait abstraction des nouvelles recettes fiscales, les politiques de légalisation et de dépénalisation ont un effet positif sur les finances publiques dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices. La plupart des études trouvent que les gains en termes de coûts de répression et de justice liés aux usagers sont plus élevés que les coûts d’encadrement du marché et que l’augmentation hypothétique des coûts de santé », écrivent les auteurs de la note.
Outre l’aspect purement financier, la légalisation du cannabis – sujet auquel Politis a consacré un dossier complet en février – permettrait de mieux encadrer et de réduire les risques liés à la consommation de cette substance.
4 – Revoir les politiques sur l’apprentissage : 10 milliards d’euros
« Apprentissage : quatre dispositifs pour reprendre le contrôle » : le titre de l’étude de l’économiste Bruno Coquet pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ne fait pas dans le subjectif. Les dépenses publiques liées à l’élargissement massif du dispositif de l’apprentissage sont hors de contrôle. Désormais près de 25 milliards d’euros par an. Un coût faramineux dont la quasi unique justification est le souhait d’Emmanuel Macron de pouvoir présenter un bilan d’un million de nouveaux apprentis par an – et, ainsi, de jouer artificiellement – sur le taux de chômage des jeunes. Un objectif d’ores et déjà presque atteint. Mais à quel prix ?
En 2023, un apprenti générait en moyenne plus de 26 000 euros par an de dépenses publiques. B. Coquet
Si Emmanuel Macron s’est attaqué dès 2018 au sujet de l’apprentissage, le tournant majeur date d’après le premier confinement, en 2020. Dans le but de relancer à tout-va l’économie, le président de la République et son gouvernement instaurent une « aide exceptionnelle » pour les entreprises concernant l’apprentissage. Une aide qui va « bien au-delà de toutes les bonnes pratiques en matière d’emplois aidés », pour l’économiste de l’OFCE. En effet, celle-ci élargit massivement le dispositif, notamment pour les étudiants en études supérieures, alors qu’auparavant il ciblait les formations de niveau bac ou inférieur. Pour une entreprise, le coût d’embauche d’un étudiant en apprentissage devient infime. Il « a été réduit d’environ 90 % pour les apprentis du supérieur », note Bruno Coquet.
Autant d’aides qui aboutissent à une situation « incontrôlée » selon l’économiste : « En 2023, un apprenti générait en moyenne plus de 26 000 euros par an de dépenses publiques, soit environ deux fois le coût moyen d’un étudiant du supérieur suivant une voie classique. » « Du point de vue de l’insertion en emploi des apprentis, l’efficience du dispositif est très faible », nuance l’économiste. Ainsi, il propose de revenir à la formule de 2018, concentrée sur les apprentis qui en ont le plus besoin pour s’insérer sur le marché du travail. Cela permettrait à l’État d’économiser 10 milliards d’euros par an, aujourd’hui versés sans contrôle ni distinction aux entreprises, sans autre objectif qu’un chiffre, certes mirobolant, mais qui n’est ni efficient ni intéressant économiquement.
5 – Baisser les exonérations de cotisations sur les bas salaires : 3 milliards
C’est une mesure qui a failli être votée lors du dernier budget. Mais les macronistes, fidèles à leur mantra « ne pas augmenter le coût du travail » et soucieux de ne pas fâcher le patronat, ont finalement réussi à la vider de son sens.
De quoi parle-t-on ? Aujourd’hui, le Smic et les très bas salaires (jusqu’à 1,6 Smic) bénéficient d’exonérations de cotisations patronales. Ce qui peut créer ce qu’on appelle une « trappe à bas salaires » : les entreprises n’ont aucun intérêt à augmenter les bas salaires car cela leur coûte doublement, à la fois par la hausse du salaire et par le surplus de cotisations dont elles étaient exonérées avant l’augmentation. Le phénomène a été, ces derniers mois, de plus en plus mis en avant du fait d’une « Smicardisation » de la société.
Début 2023, 17,3 % des salariés français étaient payés au Smic, un niveau inédit en trente ans. La raison : avec l’inflation, le Smic a continué d’augmenter, rattrapant les bas salaires, qui, eux, ont stagné. Or, avec le système actuel d’allègements de cotisations pour les salaires autour du Smic, il n’existe aucune incitation – au contraire même – à augmenter les bas salaires.
Fin 2024, deux économistes proches du gouvernement, Antoine Bozio et Étienne Wasmer, ont rendu un volumineux rapport sur cette question. Et leur conclusion, même si elle reste policée, est claire : « En termes de politiques d’exonérations de cotisations sociales, une inflexion est nécessaire. » D’autant plus nécessaire que le coût de ces exonérations, entre 70 et 80 milliards d’euros par an, est très important. Infléchir légèrement la politique actuelle sur les très bas salaires – comme l’a, un moment, envisagé le gouvernement – pourrait ainsi rapporter, a minima, 3 milliards d’euros supplémentaires par an.
Bonus : taxer la hausse des richesses des ultra-riches : une mesure exceptionnelle à 100 milliards
« En France, les 500 plus grandes fortunes ont progressé de 1 000 milliards d’euros depuis 2010, passant de 200 à 1 200 milliards. » Dans une note de son blog sur Le Monde, Thomas Piketty, l’économiste des inégalités et auteur du Capital au XXIe siècle, pose ce constat particulièrement éloquent. Et propose une mesure sur cette augmentation faramineuse. « Il suffirait d’une taxe exceptionnelle de 10 % sur cet enrichissement de 1 000 milliards pour rapporter 100 milliards, c’est-à-dire autant que la totalité des coupes budgétaires envisagées par le gouvernement pour les trois prochaines années. »
Rien dans la Constitution n’interdit n’imposer une taxe exceptionnelle sur l’enrichissement des milliardaires. T. Piketty
La proposition, au vu du contexte économique et politique, paraît assez peu crédible. Pourtant, aucun argument ne permet de la balayer d’un revers de main. Les milliardaires partiraient-ils ? Avec la création d’un bouclier contre l’exil fiscal, ils ne pourraient pas. Une mesure anticonstitutionnelle ? « Rien dans la Constitution n’interdit n’imposer une taxe exceptionnelle sur l’enrichissement des milliardaires, et plus généralement d’imposer le patrimoine, qui est un indicateur pertinent pour évaluer la capacité contributive des citoyens, au moins autant que le revenu », réfute Thomas Piketty. « Que certains juges constitutionnels ignorent tout cela et tentent parfois d’utiliser leur fonction pour imposer leurs préférences partisanes ne change rien à l’affaire : il s’agit d’un débat politique et non juridique. »
Un débat politique qu’il est de plus en plus urgent d’avoir pour éviter les cures austéritaires à répétition promises par le gouvernement, et pour, enfin, réinvestir dans nos services publics et dans la transition climatique.
mise en ligne le 25 mai 2025
Gaza : à quand une grande mobilisation en France ?
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Au sommet des États et dans les rues, le monde sort peu à peu du silence face au déchaînement de bombes qui accable les Palestiniens. Mais en France, la gauche peine à organiser un rassemblement.r
Face à la famine qui gagne, à l’intensification des bombardements et aux toujours plus nombreux morts palestiniens, les réactions internationales commencent timidement à se faire entendre. Parmi les dirigeants les plus actifs, on trouve le gouvernement irlandais, qui s’était associé à la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, accusant l’Etat hébreu de « génocide » à Gaza.
Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol affirmait ce week-end dans une allocution au sommet de la Ligue arabe qu’il faut « intensifier notre pression sur Israël pour arrêter le massacre à Gaza, notamment par les voies que nous offre le droit international ». Il précisait que l’Espagne allait présenter un projet de résolution à l’ONU pour que la Cour Internationale de Justice « se prononce sur le respect par Israël de ses obligations internationales » et une autre pour qu’Israël mette « fin au blocus humanitaire imposé à Gaza » et garantisse « un accès complet et sans restrictions à l’aide humanitaire » dans le territoire palestinien.
Les premiers ministres anglais et canadien ainsi que le président français prévenaient hier qu’ils ne resteraient pas « les bras croisés face aux actions scandaleuses ». Avec 19 autres chefs d’État et de gouvernement, ils exigent une « reprise complète de l’aide de Gaza, immédiatement ». Benyamin Netanyahou leur a répondu ce lundi même : « Nous prendrons le contrôle de tout le territoire de Gaza » et, dans un cynisme atroce, il a affirmé qu’il ne fallait pas laisser mourir de faim les Gazaouis pour « des raisons pratiques et pour des raisons diplomatiques ».
Les opinions publiques, les foules manifestantes aussi se font entendre. Ce week-end, ils étaient près d’un demi-million dans les rues de Londres ; 100 000 manifestants vêtus de rouge à La Haye, aux Pays-Bas pour appeler le gouvernement néerlandais à condamner Israël. Le week-end précédent, 50 000 personnes défilaient dans les rues de Madrid, comme dans une centaine d’autres villes d’Espagne. Les manifestants scandaient : « Ce n’est pas la guerre, c’est un génocide ! », « Boycottez Israël ! ». Il y a un mois, ils étaient 15 000 à Milan. En mars, Lisbonne connaissait des manifestations massives. Les Américains sont sous la coupe de la terreur Trump et n’ont pour le moment pas trouvé le chemin pour renouer avec les protestations qui ont tant irrité les Républicains. Dans le monde arabe aussi, les opinions publiques pèsent sur les dirigeants. On se souvient que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane confiait à des législateurs américains au sujet de l’accord de normalisation avec Israël : « Si je signe, mon peuple me tue ».
Et en France ?
Ça bouge un peu sur le plan diplomatique. Emmanuel Macron a redit en avril que l’hypothèse de la reconnaissance d’un État palestinien par la France est sur la table. Décidée par l’Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron co-présidera avec l’Arabie saoudite en juin une « conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États », à New York.
Et dans la rue ? Tous les samedis à Paris et dans quelques villes se tiennent des rassemblements de soutien, souvent trop clairsemés. Le collectif Urgence Palestine, constitué il y a moins d’un an et aujourd’hui menacé de dissolution par le gouvernement, a rassemblé les plus militants sans parvenir à élargir au-delà. L’insuffisance de la mobilisation est comme un paradoxe dans ce pays historiquement favorable à la cause palestinienne.
De fait, seuls 17% des Français – selon le dernier sondage qui remonte à juin 2024 – s’opposent à la création d’un État palestinien. Malgré l’écœurement face au génocide en cours bien au-delà des cercles militants, aucune grande manifestation à l’horizon. Les logiques répressives mise en place par l’exécutif pèsent. Il y a bien une question spécifique à la France. Dans un paysage où les associations de solidarité avec la Palestine sont faibles, c’est traditionnellement la gauche politique – le PCF, les Verts, LFI – qui conduit les mobilisations. La fracturation de la gauche, là aussi, produit ses effets.
La France insoumise s’est mise aux avant-postes du combat dans une gestion cohérente avec sa stratégie de différenciation par rapport au reste de la gauche. Son choix de propulser Rima Hassan comme figure politique en est l’expression et a produit ses effets. La juriste franco-palestinienne s’interroge, comme beaucoup d‘intellectuels, sur la solution à deux États. Elle s’est fait connaitre en défendant la solution d’un état binational : « From the river to the sea ». Une proposition légitime, souvent avancée au sein de la gauche, israélienne, palestinienne et internationale. Mais elle n’est pas admise par tout le monde, loin de là. Le passage d’intellectuelle à porte-parole puis figure de proue de la campagne des européennes a produit un brouillage, un clivage politique là où la gauche était rassemblée sur la revendication de deux États et d’une reconnaissance par la France de la Palestine. Aucune manifestation unitaire n’a dès lors été possible. Le poison d’une assimilation du soutien aux palestiniens à un combat d’antisémites a fait le reste : la rue a été désertée.
Est-ce que cela excuse les autres forces de la gauche ? En aucune façon. Si la cause palestinienne est devenue un identifiant LFI, c’est aussi parce que le reste de la gauche – de toute la gauche – n’a pris aucune initiative de masse.
Cela étant dit, il faut maintenant tourner la page de cette division. Et appeler à manifester contre le génocide, pour la solution à deux États, pour l’aide humanitaire, maintenant… Une telle initiative, en coordination avec les autres mouvements européens, serait une idée formidable. Et vite, s’il vous plaît.
mise en ligne le 24 mai 2025
« Nos alliés se trompent » : à gauche, des voix s’opposent à l’aide à mourir
Caroline Coq-Chodorge sur www.mediapart.fr
Sara Piazza est psychologue en soins palliatifs et coautrice d’un livre qui prend à partie la gauche, dont elle se réclame. À ses yeux, en soutenant l’aide à mourir, la gauche renonce à agir sur les inégalités des conditions de vie et d’accès aux soins qui créent du « mal mourir ».
L’Assemblée nationale a adopté, mardi 20 mai, les quatre premiers articles du projet de loi sur l’aide à mourir avec les voix presque unanimes de la gauche dans toutes ses composantes. Mais dans le camp progressiste, il existe aussi des voix qui s’opposent farouchement à cette légalisation.
La psychologue Sara Piazza est l’une d’elles. Elle exerce en unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Avec Isabelle Marin, médecin de soins palliatifs dans le même hôpital, elle a publié en 2023 le livre Euthanasie : un progrès social ?.
À cette question, elles répondent fermement par la négative. Et elles dénoncent les partis de gauche qui tous, à l’exception du Parti communiste, se sont engagés à légaliser l’aide à mourir dans leur programme pour la présidentielle de 2022.
Leurs mots sont tranchants : à leurs yeux, l’aide à mourir est « le faux nez d’un ultralibéralisme mortifère qui permettrait de résoudre des problèmes économiques et mettrait en œuvre une fin de vie rapide et pas chère pour les plus fragiles ». Explications de Sara Piazza.
Mediapart : À l’Assemblée, la très grande majorité des députés de gauche défend la légalisation d’une aide à mourir, comme un nouveau droit, une « liberté ultime », celle des malades en fin de vie confrontés à des souffrances réfractaires. Vous êtes au contraire farouchement opposée à cette légalisation, au nom de valeurs de gauche. Comment vivez-vous cette position minoritaire ?
Sara Piazza : C’est difficile. C’est véritablement un enjeu de vie et de mort, une question politique cruciale, et on pense que nos alliés se trompent. Cela rend même virulent, à la mesure de l’enjeu et de notre incompréhension. Le logiciel de la gauche, il me semble, c’est de prendre en compte les conditions socioéconomiques de vie des personnes, les inégalités en matière d’éducation, de justice, et de santé notamment. Être de gauche, c’est rappeler que nous ne sommes pas tous égaux pour exercer notre liberté. C’est la base, quand même.
Mais, d’une part, on entend la prise de parole de collectifs de gauche contre l’euthanasie, à partir de positions marxistes, matérialistes et intersectionnelles, et notamment de collectifs antivalidistes, dans le paysage [lire cette tribune sur le Club de Mediapart – ndlr]. Et d’autre part, on voit de plus en plus de députés de gauche qui commencent à douter sérieusement, en privé, mais aussi quelques-uns qui ont le courage de le dire publiquement.
Cette légalisation de l’aide à mourir bénéfice pourtant d’une très large majorité à l’Assemblée, une convention citoyenne s’est clairement exprimée en sa faveur, et l’opinion publique y est largement favorable. Cela ne vous fait-il pas douter ?
Sara Piazza : J’ai du mal avec la manière dont, systématiquement, on nous dit : « les Français pensent que… » Quand on regarde les sondages de façon fine, en réalité les gens ne savent pas de quoi on parle. Beaucoup de gens continuent de parler, dont certains députés, de la situation de Vincent Lambert. Or précisément, la loi Claeys-Leonetti de 2016 était faite en partie pour répondre à ce genre de situation, en permettant d’arrêter les traitements et de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Aujourd’hui, la loi permet d’arrêter le maintien en vie artificiel d’une personne inconsciente ou dans des états de conscience minimale s’il n’y a pas de perspective de récupération.
La douleur est une construction complexe. Quand on est seul, mal accompagné, qu’on n’a pas les soins qu’il faut, on a mal.
Le principal problème aujourd’hui est que cette loi est mal connue et mal appliquée. Et qu’il y a un dévoiement de l’usage des mots et des représentations. On entend encore dans les discours qu’on meurt de faim et de soif. On peut critiquer la sédation profonde et continue jusqu’au décès, c’est-à-dire en toute fin de vie mettre une personne dans un coma artificiel et arrêter tout ce qui la maintient en vie, dont la nutrition et l’hydratation artificielles. Mais dire qu’on meurt de faim et de soif, c’est une contre-vérité. C’est donner à penser qu’il y a de la souffrance. Or les gens sont profondément endormis, comme lors d’une anesthésie générale.
Des proches de malades et des soignants témoignent de leur traumatisme face à des agonies qui peuvent durer des heures, voire des jours, dans le cadre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. N’est-ce pas un problème ?
Sara Piazza : C’est difficile d’accompagner des personnes en fin de vie. L’euthanasie serait-elle moins difficile à vivre ? On peut aujourd’hui soulager une personne qui veut arrêter sa ventilation, son alimentation ou son hydratation artificielle. Le problème est que la loi actuelle est mal appliquée, parce qu’il n’y a pas assez de moyens, parce que les médecins et les soignants ne sont pas assez formés aux soins palliatifs, aux questions d’éthique.
C’est difficile d’annoncer à un malade droit dans les yeux qu’il a un cancer. Il faut travailler avec les médecins et les soignants pour les soutenir dans ces pratiques dures, les aider aussi à se taire et à écouter ce que pensent et veulent leurs patients. C’est ce qu’on essaie de faire tous les jours. C’est difficile de dire à un patient où il en est de sa maladie, ce qu’on peut lui proposer, être au clair et compréhensible sur les conséquences possibles d’une opération, d’un traitement. Le patient peut dire jusqu’où il peut supporter que la médecine intervienne.
Vous questionnez aussi la pratique d’une aide à mourir dans l’état actuel du système de santé : le manque de personnel, les déserts médicaux. Pour vous, des malades demandent-ils à mourir faute de soins ?
Sara Piazza : On ne peut pas faire comme si les personnes malades étaient dans une bulle. Si des gens ont aujourd’hui envie de mourir, cela ne tombe pas du ciel. Les conditions de vie, matérielles et symboliques, comptent. Quels sont les revenus, la possibilité d’avoir une aide à la maison, un médecin traitant, un accompagnement soutenu à l’hôpital ou en ville ? Quel est l’entourage ? A-t-on des amis, des proches qui viennent nous voir ? Il faut entendre par exemple les collectifs antivalidistes qui décrivent le combat pour tenter de vivre « dignement » comme on dit, tous les jours. On ne cesse de nous décrire les conditions de vie désastreuses dans certains Ehpad. Les conditions de vie des personnes qui tombent malades comptent.
La proposition de loi fixe un cadre : l’aide à mourir ne serait accessible qu’aux personnes ayant une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » et dont la souffrance physique ou psychologique est « réfractaire aux traitements ». N’est-il pas suffisamment restrictif ?
Sara Piazza : Une affection grave et incurable, c’est très large. Quant à la question de la souffrance, là aussi, on considère qu’elle serait, dans la maladie grave, isolée du reste. Il y a plusieurs composantes de la douleur, tout le temps. Dont une part psychique et même sociale.
Prenons l’exemple d’une vieille dame isolée, qui a une affection grave et incurable, qui vit au 6e étage, et dont l’ascenseur ne marche pas : est-ce qu’elle ne vit pas dans certaines conditions qui expliquent aussi son rapport à sa maladie et à sa souffrance ? La douleur est une construction complexe. Quand on est seul, mal accompagné, quand on n’a pas les soins qu’il faut, on a mal.
L’euthanasie laisse espérer qu’on puisse regagner le contrôle sur ce qui nous échappe. Je crois que c’est une illusion.
La Haute Autorité de santé s’est prononcée, après avoir auditionné de nombreux experts, sur la question du pronostic vital engagé à moyen terme. Et ils ont conclu que cela n’était pas possible. On peut éventuellement prédire la mort de quelqu’un à quelques heures ou quelques jours.
Le terme de « phase avancée » est finalement retenu. La Haute Autorité de santé en a donné cette définition : « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie », reprise par les députés. La personne malade qui demande l’aide à mourir devra encore obtenir l’accord d’un médecin qui doit s’assurer, « si la personne le souhaite », qu’elle ait « accès de manière effective » aux soins palliatifs. Ce médecin doit obtenir l’accord d’un autre médecin et d’un soignant qui accompagne le malade. Ces garde-fous ne sont-ils pas suffisants ?
Sara Piazza : Vous me parlez d’un système de soins qui n’est pas celui dans lequel je travaille. À Saint-Denis, il n’y a pas de consultation antidouleur. Dans vingt et un départements, il n’y a pas d’unité de soins palliatifs qui sont les lieux spécifiques pour la prise en charge notamment des patients avec des douleurs réfractaires. 50 % des patients n’ont pas accès aux soins palliatifs. Comment on assure cet accès ? Avec une baguette magique ? Avec quelles ressources ? Avec quel personnel ?
Je ne sais pas dans quelle réalité on imagine les choses. Pour moi, ces patients qui auraient accès à tous les traitements pour soulager leurs douleurs sont virtuels. Ou alors ils habitent à Paris et ont les bons contacts. Et encore, le délitement du système de soins touche même les personnes les plus aisées maintenant.
Dans votre livre, vous reconnaissez que les soins palliatifs peuvent accompagner correctement les patients en phase terminale « la plupart du temps ». L’aide à mourir ne pourrait-elle pas répondre aux exceptions ?
Sara Piazza : Pour moi, on ne fait pas de loi pour une exception. La loi comporte une dimension normative qui renvoie un message, d’une part, et ne peut jamais répondre à toutes les situations, d’autre part. Les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté sont légitimes, mais je crois qu’il faut que la société continue de dire qu’elle ne peut pas y répondre.
Pour la très grande majorité des soignants de soins palliatifs qui accompagnent les personnes en fin de vie, la loi actuelle est suffisante. On a déjà un arsenal législatif qui interdit l’obstination déraisonnable. Depuis 2002, les patients ont le droit de refuser n’importe quel traitement, même s’ils les maintiennent en vie. Il faut surtout développer notre réflexion face à ce que permet la médecine en termes de traitements invasifs.
En Belgique, la plupart des demandes d’euthanasie ne vont pas au bout : les personnes finissent par mourir sans y avoir recours. Mais c’est un soulagement pour les malades de savoir qu’ils peuvent demander une euthanasie si leur situation devenait insupportable. Qu’en pensez-vous ?
Sara Piazza : Cela ne m’étonne pas, l’euthanasie laisse espérer qu’on puisse regagner le contrôle sur ce qui nous échappe. Mais je crois que c’est une illusion et je trouve que ce n’est pas une raison pour légaliser. Je pense qu’on peut proposer un autre modèle où les personnes malades et dépendantes seront mieux accompagnées. Et où on s’assure qu’on fera tout pour qu’elles n’aient pas mal.
Je pense que des médecins, représentant la société, ne doivent pas symboliquement dire « d’accord » à une personne qui demande à mourir. Peut-être qu’elle pense être un trop grand poids pour ses enfants par exemple ? En l’état actuel du projet de loi, le médecin a quinze jours pour répondre à une demande d’aide à mourir. Si sa réponse est positive, le malade a un délai de réflexion de deux jours de réflexion. Pour se faire ligaturer les trompes, c’est un mois...
Quand on est malade, qu’on sait qu’à un moment donné on va mourir, on peut être angoissé. On a peur d’avoir mal, de devenir dépendant. Je sais que c’est un discours qui est difficilement audible, mais l’angoisse, la souffrance, la détresse font partie de l’expérience humaine, il n’est pas question pour moi de mettre fin à cette expérience, mais bien de proposer sans relâche des solutions pour apaiser.
« Non, l’euthanasie
n’est pas une avancée sociale ! »
sur https://www.politis.fr/
Plusieurs organisations et des personnalités interpellent la gauche favorable à la proposition de loi sur l’aide à mourir en pointant les dérives antivalidistes du texte, dans un système de santé plus que dégradé.
Dans les milieux de gauche, pourtant attachés à l’émancipation, à la solidarité et à la justice sociale, les voix critiques de l’euthanasie restent marginalisées, ignorées, voire disqualifiées. Depuis plusieurs années, ces voix s’élèvent, celles de personnes malades, handicapées, âgées, soignantes, citoyennes, qui méritent d’être écoutées sans être renvoyées aux silences et autres sous-entendus nauséabonds.
Notre indignation est pourtant tenace et notre colère intacte. La mal-nommée « aide active à mourir » s’adresse, dans les faits, à celles et ceux que notre société considère comme inutiles, indésirables ou trop coûteux. Elle est un symptôme à combattre et ce combat ne peut se confondre avec les discours de la droite réactionnaire et néofasciste, des Églises traditionnalistes et de leurs tendances abusives. Elle repose sur des représentations validistes et âgistes qui rendent la mort volontaire de certains acceptable.
Faut-il rappeler à la gauche que l’accès aux soins est en voie d’effondrement ?
Nous sommes contre « l’aide active à mourir », à savoir l’euthanasie et le suicide assisté, en particulier dans la société française actuelle.
Faut-il rappeler à la gauche que l’accès aux soins est en voie d’effondrement, dans tous les domaines : soins palliatifs, psychiatrie, pédiatrie, oncologie, entre autres ? Que le renoncement aux soins s’amplifie partout sur le territoire ? Faut-il rappeler à la gauche le contexte politique national et international et la montée de l’extrême droite, la dégradation des conditions de vies d’un nombre de plus en plus grand de personnes, le repli de notre société, de plus en plus fermée et réactionnaire ?
Faut-il se souvenir que le droit à la santé et aux soins est l’un des droits fondamentaux et qu’il ne peut se réduire à un droit à obtenir la mort médicalement assistée ? Faut-il encourager le nihilisme thérapeutique sans prendre en compte l’extension systématique des indications de l’euthanasie dans tous les pays qui l’ont légiférée ?
Nous devons lutter contre les logiques prédatrices et utilitaristes qui ont contaminé l’ensemble des lieux d’accompagnements et de soins.
Soutenir la mort médicalement prescrite et/ou administrée, supposément « digne », sans s’opposer à l’actuelle indignité voire l’inaccès des soins, c’est répondre à la souffrance en supprimant celui qui souffre plutôt qu’en repensant les modalités de vies qui l’amènent à souffrir. C’est renoncer à l’exigence éthique de prendre le temps de saisir l’ensemble de la problématique. Une problématique au croisement de l’individuel et du collectif, du politique et du technique, du soin et du pouvoir.
C’est également prendre tout à l’envers : proposer la mort à l’individu plutôt que repenser le soin et l’accompagnement au niveau politique et collectif. Nous avons besoin d’une reconstruction de services publics dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, dans tous les territoires.
Nous devons lutter contre les logiques prédatrices et utilitaristes qui ont contaminé l’ensemble des lieux d’accompagnements et de soins. En finir avec la tarification à l’activité, valoriser la prévention et les soins sur les seuls diagnostics et évaluations. Créer des lieux où les soignants retrouveront leur mission première : soigner, et où les patients pourront user de leur droit à se soigner. Faut-il rappeler que l’État nous doit les services publics ?
Nous soutenons sans condition les droits des femmes, l’IVG, la contraception, l’auto-détermination des personnes et leurs émancipations.
Nous soutenons sans conditions que toute vie vaut la peine d’être vécue selon ses propres normes et que ce n’est ni aux soignants ni aux gouvernants de décider, de trier, quelles sont les vies qui valent, quelles sont celles qui ne valent pas.
Peut-on émanciper une société sans transformer les racines même du mal ?
Dans le domaine de l’euthanasie, nous sommes pour un esprit des lois – une réflexion politique sur ce que signifie, dans une société fracturée, l’institutionnalisation d’une mort médicalement prescrite ou administrée – et non pour un droit positif qui, comme partout ailleurs où il existe, s’applique d’abord aux personnes considérées comme inutiles car non-productives.
Peut-on émanciper une société sans transformer les racines même du mal : les profondes inégalités d’accès aux soins et à l’accompagnement, l’injustice sociale et fiscale ? Penser que l’euthanasie est une avancée sociale, c’est confondre exclusion et émancipation. La gauche ne peut s’y résoudre.
-
Mathieu Bellahsen, psychiatre
-
André Bitton, président du CRPA et ancien président du Groupe information asile – Collectif Lutte et Handicap pour l’Egalité et l’Emancipation
-
Isabelle Hartvig, résidente d’Ehpad et militante
-
Geneviève Hénault, psychiatre
-
Odile Maurin, pour le collectif Handi Social
-
Sara Piazza, psychologue, pour le collectif JABS
-
Laetitia Rebord, Les Dévalideuses
-
Elisa Rojas, avocate et militante
mise en ligne le 13 mai 2025
Jean-François Tamellini, syndicaliste belge : « Derrière la course aux armements, le véritable enjeu est la répartition capital-travail »
sur www.humanite.fr
Sous la houlette de la Commission européenne, les Vingt-Sept ont engagé une course aux armements. Les syndicalistes du continent livrent des clés pour la construction d’une économie de paix. Par Jean-François Tamellini, Secrétaire général de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) wallonne.
(Les intertitres et la mise en gras sont du fait de 100-paroles)
Guerre, racisme et néofascisme pour masquer l’échec du capitalisme ?
Massacres à Gaza, en Ukraine et au Soudan, avènement de l’extrême droite et de la ploutocratie, surenchère agressive et cacophonie médiatique trumpistes, protectionnisme nationaliste, austérité budgétaire et guerre aux pauvres… Une fois de plus, et comme toujours, le capitalisme nous mène droit dans le mur. Et ne nous propose comme seule sortie de crise que la fuite aveugle dans la guerre économique et l’économie de guerre.
La seconde élection de Trump a marqué un tournant. Une véritable guerre culturelle a été engagée par l’internationale réactionnaire. La fenêtre d’Overton s’est transformée en baie vitrée, les cordons sanitaires sont rompus et la droite « classique » poursuit sa mue vers l’extrême droite. La technique utilisée est la montée des nations les unes contre les autres. Patriotisme économique et nationalisme culturel sont imposés comme des références absolues.
L’étranger, l’étrangère, toute personne considérée comme différente est présentée comme un danger. Les luttes pour l’égalité et la justice sociale sont traitées de « wokistes », la nouvelle insulte passe-partout des réactionnaires. Une cacophonie et un confusionnisme savamment entretenus pour dissimuler le véritable enjeu : la répartition capital-travail.
Cette guerre culturelle n’a en effet qu’un objectif : relancer les politiques néolibérales et la course à la maximisation des profits. En s’attaquant à tout ce qui pourrait freiner la captation de parts de marché par les actionnaires privés : services publics, sécurité sociale, syndicats, mutuelles, ONG, associations luttant contre les discriminations… Dans ce contexte troublé et inquiétant, on nous enjoint d’ailleurs de préparer des kits de survie, mais aussi et surtout de repenser notre modèle industriel à l’aune du réarmement.
En Belgique, le ministre de la Défense – un nationaliste flamand flirtant ouvertement avec l’extrême droite – prône la reconversion de l’usine Audi à Forest 1 en une usine d’armement. Une fuite en avant militariste sans projet politique, social ou industriel sérieux, mais qui fait le bonheur – et les clics – des sites d’actualité en continu et de leurs réseaux.
Politique de défense et protectionnisme : oui éventuellement, mais au service de qui ...
Soyons clairs, adopter une stratégie de défense est important. La stabilité et la sécurité sont des conditions de base pour construire ou consolider des démocraties. Une politique industrielle publique de l’armement, régulée et coordonnée au niveau européen, pourrait être déployée, dans une logique semblable à celle qui avait mené à la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca) au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a une énorme différence entre une stratégie de défense visant à favoriser les conditions de paix entre États et une politique va-t-en-guerre visant à enrichir les actionnaires privés d’entreprises d’armement.
Soyons clairs, encore : le protectionnisme, dans le système capitaliste actuel, ne doit pas être un tabou. Encore faut-il qu’il soit pensé dans une optique de progrès social et environnemental. Si elles servent à freiner le shopping fiscal, social et environnemental des multinationales, à relocaliser l’économie, à garantir la souveraineté sur les besoins fondamentaux, et non à asservir d’autres peuples, les taxes ont clairement un rôle à jouer. Mais on est alors à l’opposé du modèle nationaliste de Trump.
Ces quarante dernières années, le démantèlement de l’industrie européenne est allé de pair avec celui des systèmes de sécurité sociale, entraînant une précarisation de l’emploi, des salaires et des conditions de travail. Pour affronter la guerre commerciale et financer le réarmement, les va-t-en-guerre libéraux voudraient aujourd’hui sabrer une fois de plus dans la sécurité sociale et les services publics. Militarisme et austérité, un beau projet d’avenir…
Le devoir de la gauche
Face à cette radicalisation de la droite, la gauche, dans son ensemble et sa diversité, doit reprendre les clefs du débat, réaffirmer ses valeurs et la pertinence de ses analyses. Remettre au premier plan le rapport de force capital-travail, en repensant le modèle sur la base des besoins fondamentaux des populations.
C’est sur cette base qu’avait été créée la Sécurité sociale après guerre, un modèle qui a permis aux corps de se redresser et à l’économie de se développer, grâce au travail de la classe ouvrière, parmi lesquels de nombreux travailleuses et travailleurs migrants. Il nous faut aujourd’hui aller plus loin et travailler à une transformation radicale de l’économie au service du progrès social, de la protection de l’environnement et du renforcement de la démocratie.
La guerre économique et l’économie de guerre ne sont que des impasses mortifères. Il est indispensable de recréer les vraies conditions qui assureront une paix durable au niveau mondial : le rétablissement d’un cordon sanitaire inviolable à l’égard de l’extrême droite et une meilleure répartition des richesses.
En ajoutant l’indispensable dimension environnementale aux conditions qui avaient rendu possible le pacte social d’après guerre, rappelant aux fous de ce monde que le combat pour préserver la planète prime sur leur capitalisme de guerre et leurs guerres commerciales. Revendiquer, militer et lutter pour une meilleure répartition des richesses doit être une priorité pour les forces de gauche. La réduction des inégalités et le progrès social sont les meilleures armes contre l’extrême droite, ses idées et ses logiques guerrières.
mise en ligne le 9 mai 2025
« La France est exposée
au scénario
qui a vu gagner Trump »
Fabien Escalona sur www.mediapart.fr
Avec « Le Miroir américain », le journaliste Cole Stangler met en garde contre les risques d’une dégradation de la démocratie française, non pas identique mais analogue à celle qui frappe de l’autre côté de l’Atlantique. Il appelle la gauche à défendre « des avancées concrètes et rapidement visibles ».
Cole Stranger, journaliste franco-américain et auteur de l’enquête sur la radicalisation des droites françaises et américaines, « Le Miroir américain », aux éditions Les Arènes.
En dépit du caractère hors norme de la grande parade trumpiste, la France est peut-être le pays européen qui a le plus à apprendre des évolutions de la vie politique aux États-Unis. C’est la conviction du journaliste Cole Stangler, qui a publié mercredi 7 mai Le Miroir américain. Enquête sur la radicalisation de la droite et l’avenir de la gauche (éditions Les Arènes).
Lui-même franco-américain, bien placé pour constater les différences qui séparent les deux formations sociales, il souligne aussi les ressemblances qui les rapprochent, et participent des « échos » qu’il a perçus de part et d’autre de l’Atlantique lors de ces dernières années.
« Même si elles n’ont pas réussi à réaliser pleinement leurs promesses, écrit-il, nos deux républiques sont des modèles d’universalisme qui ont inspiré d’innombrables luttes […]. Les États-Unis et la France se sont tous les deux construits sur l’immigration, avec des identités nationales modelées par l’arrivée de personnes venues d’ailleurs et de cultures façonnées par le brassage et la mixité […]. Et ici comme là-bas, la grandeur de nos mythes fondateurs nous empêche parfois de voir les moments sombres de nos histoires respectives. »
Ces mythes et leurs angles morts participent, aujourd’hui, d’une attractivité électorale de démagogues d’extrême droite qui nous serait apparue sidérante il y a quelques années. C’est pour comprendre de manière sensible cette attractivité, et en creux les obstacles rencontrés par la gauche, que Cole Stangler a sillonné les États-Unis en 2024. Son livre est le récit de ses rencontres, rapprochées d’entretiens antérieurs réalisés en France et de travaux académiques qui éclairent son propos.
Mediapart : Votre ouvrage s’ouvre sur les conséquences politiques de la désindustrialisation, aux États-Unis comme en France. Comment les décririez-vous ?
Cole Stangler : Il existe bien sûr de la détresse sociale dans les grandes villes et les campagnes, mais celle qui est vécue dans les zones désindustrialisées est spécifique, dans la mesure où les gens ont connu autre chose, ou du moins leurs parents. Ils vivent non seulement la souffrance sociale, parce qu’il y a moins d’emplois et que ces emplois sont précaires, mais ils savent aussi très bien qu’il y a vingt ou trente ans, l’endroit était plus prospère, offrait d’autres perspectives de vie. On retrouve cela dans la Rust Belt [« ceinture de rouille », surnom de la zone de déclin de l’industrie lourde américaine dans le Nord-Est – ndlr] aux États-Unis, comme dans le nord et l’est de la France.
Politiquement, cette configuration a des conséquences importantes, parce qu’elle favorise chez de nombreuses personnes une forme de nostalgie et de rancœur. Elles reprochent à l’État de les avoir abandonnées, ou d’avoir été complice du processus qui a conduit au déclin économique du territoire. Ce déficit de confiance envers la puissance publique est un fort moteur de décrochage vis-à-vis du monde politique, et donc d’abstention.
Dans beaucoup de ces zones, les classes populaires qui votent le font davantage en faveur de l’extrême droite que de la gauche. Pour le comprendre, il faut regarder le bilan de cette gauche, ainsi que ses choix politiques. Aux États-Unis, la perte d’audience des démocrates dans les milieux populaires ne résulte pas d’une fatalité, mais de la décision consciente de donner la priorité à d’autres électeurs. Et puis c’est bien connu : en contexte économique dégradé, on recherche facilement des boucs émissaires. Le Parti républicain et le Rassemblement national (RN) ont trouvé le leur : l’immigré.
On sent aussi que la politisation à droite de ressentiments et de préjugés est rendue possible par le caractère « impensable » d’une alternative économique et sociale. On le comprend aisément après la présidence de François Hollande en France, mais le bilan de Joe Biden n’était-il pas plus substantiel ?
Cole Stangler : J’ai en effet beaucoup rencontré le sentiment que l’économie était un sujet trop complexe pour être changé politiquement. La gauche de gouvernement, en ralliant les politiques « pro-capital » de l’ère néolibérale, à partir des années 1980, a favorisé ce sentiment. Par conséquent, elle a aussi permis à la conflictualité politique de se déplacer sur d’autres terrains, notamment celui des « guerres culturelles ».
Aux États-Unis, celles-ci se sont typiquement déployées à propos des armes à feu, de la place de la religion dans la société, des droits des homosexuels et des droits à l’avortement. Les offensives contre le « wokisme », qui se sont aussi déclinées en France ces dernières années, s’inscrivent dans cette veine.
Les États-Uniens ont entendu beaucoup de promesses et de grands chiffres, mais dont les effets sont encore impalpables. Et, entre-temps, ils ont subi une inflation violente.
Alors oui, il y a eu du changement sous Biden, avec de l’investissement dans les infrastructures et une tentative de réindustrialisation « verdie ». Le problème, c’est que ces politiques prennent du temps et ne rompent que partiellement avec le legs néolibéral.
C’est ce que je montre à travers le cas d’un bassin sidérurgique en Virginie-Occidentale, qui s’est complètement étiolé, et en face duquel une usine de batteries électriques a été financée grâce aux programmes de l’administration Biden. Or cette usine ne comptera pas autant d’emplois, ils n’ont pas encore tous été créés, et rien ne garantit qu’ils auront la même « qualité » en termes de droits des salariés.
En résumé, les États-Uniens ont entendu beaucoup de promesses et de grands chiffres, mais dont les effets sont encore impalpables. Et, entre-temps, ils ont subi une inflation violente, tandis que les mesures de Biden les plus appréciées du public, après le covid, ont pris fin, au motif qu’elles avaient été pensées comme temporaires.
Revenons au mouvement de radicalisation de la droite, que vous observez de part et d’autre de l’Atlantique. Vous insistez sur les sources anciennes du phénomène, masquées par les figures de droite les plus « traditionnelles » pendant des années.
Cole Stangler : Trump et le trumpisme ne viennent clairement pas de nulle part. On peut citer des prétendants malheureux à la présidentielle, qui ont assemblé des ingrédients encore bien présents aujourd’hui.
Je pense à George Wallace, à la fois très critique de la guerre du Vietnam et défenseur de la ségrégation au tournant des années 1960-70. Je pense aussi à Pat Buchanan, candidat à la primaire républicaine de 1992, durant laquelle il fit campagne contre le multiculturalisme et le libre-échange, tout en mobilisant une base de chrétiens évangéliques autour des guerres culturelles. À la convention du parti, il évoqua une « bataille pour l’âme de l’Amérique » dans un discours perçu comme extrême, mais devenu la norme aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier non plus la présidence de George W. Bush (2000-2008). Déjà à l’époque, il avait contesté le recomptage des voix en Floride, et des militants étaient parvenus à empêcher les opérations par leur pression physique. Lui aussi soutenu par une base religieuse évangélique, il a provoqué des dégâts immenses avec sa « guerre contre le terrorisme » (l’invasion d’un pays souverain, la pratique de la torture en dehors des conventions internationales) et avait souhaité passer une loi radicale contre l’immigration.
Dans le cas français, le RN qui menace d’arriver au pouvoir est dans le paysage depuis cinquante ans. Sa progression s’est également faite grâce à une conjonction de facteurs de longue durée : les préjugés et les discriminations qui circulaient déjà dans la société ; la désindustrialisation, qui a favorisé la bascule des milieux populaires ; et des attentes plus fortes encore envers l’État dans ce pays, qui ont nourri des déceptions à la hauteur. Sans compter la contribution active de la droite classique à faire de l’immigration et de l’identité des enjeux de campagne permanents.
Le parallèle entre le Parti républicain aux États-Unis et le RN en France tient-il jusqu’au bout ? Le RN pâtit encore, même si c’est de moins en moins le cas, d’être issu des marges du système politique.
Cole Stangler : Peut-être, mais nos deux pays ont un système présidentiel dans lequel l’électorat est sommé de choisir entre deux camps, ou du moins entre deux options finales dans le cas de la présidentielle en France. Les effets peuvent être dévastateurs, même quand la société n’est pas majoritairement située à l’extrême droite.
C’est ce qui est intéressant et troublant avec les électeurs de Trump : certains ne sont pas d’accord avec tout et pointent même ses excès, mais ils l’ont choisi plutôt que Kamala Harris. Trump se retrouve à prendre des décisions très radicales mais avec un taux d’approbation historiquement faible pour un président, alors qu’il vient d’être réélu avec plus de voix que son adversaire.
La France est exposée à ce genre de scénario. Dans le livre, je cite une propriétaire de restaurant qui me dit que la gauche est une option impossible pour elle. Le Pen, Bardella… : elle se fiche de l’identité du candidat RN mais sait qu’elle votera pour une candidature clairement « antigauche ».
Les gauches françaises se cherchent encore dans leur attitude vis-à-vis de médias comme CNews. Les progressistes états-uniens, confrontés précocement à des médias de masse porteurs de désinformation et d’idées d’extrême droite, ont-ils des leçons à partager ?
Cole Stangler : Honnêtement, je ne sais pas s’il y a grand-chose à prendre. À ce stade, de plus en plus de journalistes à gauche ont estimé qu’il fallait construire d’autres médias non traditionnels pour combattre des chaînes ultraconservatrices comme Fox News. Il en résulte une fragmentation de l’espace médiatique particulièrement prononcée, avec des podcasts, des lettres d’information sur Substack, des chaînes YouTube…
C’est une évidence absolue que pour gagner, la gauche doit mobiliser de larges pans des milieux populaires par-delà les espaces géographiques, qu’ils soient très urbanisés ou plus ruraux.
Il y a bien eu la tentative de bâtir un Fox News de gauche, avec MSNBC, mais ses dirigeants ne sont pas parvenus à imiter le style populiste qui a fait le succès de la première. Ils ont repris les codes des classes moyennes supérieures dans les grandes villes, qui les cantonnent à un certain public. Cette question du « style » est trop négligée en France pour comprendre l’attrait de ces chaînes. Si on ne fait que répéter qu’elles mentent, on ne parviendra pas à contrer leur succès.
Un débat stratégique s’est esquissé entre François Ruffin, alertant sur la faiblesse de la gauche dans « la France des bourgs », et les Insoumis, théorisant l’existence d’un « quatrième bloc » abstentionniste à mobiliser pour emporter des élections. Là encore non sans échos avec les États-Unis. Quelles conclusions tirez-vous de vos propres recherches et rencontres ?
Cole Stangler : Dans son dernier livre, Jean-Luc Mélenchon écrit que « la conscience politique urbaine est la forme de conscience politique la plus avancée ». Malgré la tonalité radicale du langage, cela me fait penser aux stratégies du Parti démocrate en 2016, lorsque les stratèges expliquaient que chaque voix perdue dans la Rust Belt allait être gagnée en banlieue ou dans les villes.
Pour moi, c’est une évidence absolue que pour gagner, la gauche doit mobiliser de larges pans des milieux populaires par-delà les espaces géographiques, qu’ils soient très urbanisés ou plus ruraux. Pour transcender ces frontières, le discours de Bernie Sanders est resté le même depuis des années : un programme universaliste pour défendre les intérêts du plus grand nombre, en mettant en avant les questions sociales et en affirmant simultanément qu’une attaque contre une personne, que ce soit en raison de ses origines, de son apparence ou de son orientation sexuelle, est une attaque contre tous.
Ce qui me donne espoir, c’est le renouveau du syndicalisme aux États-Unis, même si la tendance est encore modeste. Il est intéressant d’observer les résistances salariales permises par les campagnes de syndicalisation dans le sud des États-Unis, dans les usines installées en raison du coût du travail moins élevé que dans les États du nord avec un passé syndical plus fort. Cela a suscité des réactions très violentes chez les républicains, ce qui montre bien qu’ils le vivent comme une menace.
Un pays davantage syndiqué est un pays dans lequel les classes populaires ont des valeurs plus ancrées à gauche, et il s’agit de développer ce militantisme dans de nouveaux secteurs, comme ceux de la logistique et de la distribution. L’enjeu est semblable en France : j’ai été marqué par ma rencontre avec un jeune syndicaliste qui travaillait chez Amazon au sud de Montélimar, dans une zone commerciale qui a quelque chose de très américain. Il doit braver l’isolement des employés, le turnover, etc.
La réponse stratégique de fond, au-delà du marketing électoral à chaque scrutin, consiste bien à retisser le lien à la base. C’est un travail de longue haleine, peu spectaculaire mais finalement plus important que tel ou tel slogan ou telle ou telle alliance, en tout cas sur le long terme. Les liens de confiance vous rendent en effet plus enclin à écouter des messages progressistes, parce qu’ils sont émis ou relayés par des gens qui vous ressemblent, vous connaissent et vous défendent.
mise en page le 6 mai 2025
Gauche, syndicats :
la pureté de chacun causera la perte de tous
Loïc Le Clerc sur www.politis.fr
La gauche peut-elle se payer encore longtemps le luxe de ses divisions intestines ? Quand le monde brûle, on ne débat pas de la couleur de l’extincteur.
Prédation sur les droits des chômeurs, des retraités, des jeunes, des prisonniers, austérité budgétaire, défense des valeurs traditionnelles, attaques incessantes contre les minorités religieuses, atteintes à l’environnement et à la recherche, fermeture d’un tiers des agences de l’État, taxation des plus modestes pour payer les cadeaux fiscaux des plus riches, remise en cause de symboles des victoires sociales comme le 1er mai chômé. Qui ça ? Donald Trump ? Non, Emmanuel Macron. Rien que pour ces dernières semaines.
Steve Bannon, l’ex-stratège de Donald Trump, aficionado de saluts nazis, avait théorisé la tactique du président américain et se réjouit de la voir à l’œuvre en son pays : « Je pense que vous voyez maintenant l’aboutissement de tout le travail qu’on a fait. Vous assistez à ce que j’appelle « l’inondation de la zone » et il n’y a pas de meilleur moment pour être en vie que maintenant, quand on voit les fruits de ce grand effort. »
« Inonder la zone », ça veut dire bombarder le monde d’infos, de déclarations, de décisions politiques, attaquer à tout-va tous les pans de la société, à la seule fin de créer un tel désordre, une telle dispersion des forces et des esprits qu’aucune union ne sera possible. Et donc aucune réaction, aucune contre-attaque de poids.
Donald Trump le fait et son efficacité fait des émules. Et pas seulement auprès de ses amis argentin, hongrois ou italien. En France aussi, la Macronie mitraille. Sous le tapis de « bombes Banon », il est impossible de tenir son bout de barricade sans regarder ce qu’il se passe pour les autres. La Commune de Paris n’a-t-elle pas été vaincue, bastion après bastion ?
Mais pendant que les droites et les extrêmes droites mondiales organisent leur contre-révolution, les gauches se tirent dans les pattes. Quel que soit le sujet, la division l’emporte. L’écologie ? Oui, mais le nucléaire… Le travail ? Oui, mais le RSA… L’islamophobie ? Oui, mais l’antisémitisme… Comme si le camp d’en face n’allait pas tout brûler.
Ce jeudi 1er mai, les manifestations furent à la fois inquiètes, festives et empreintes de gravité devant l’ampleur des luttes à mener. Le spectacle affligeant des guéguerres intestines, les prises de parole politique qui voulaient voler la vedette aux syndicats, les violences à l’encontre du PS et de ses élus à Paris, montrent que le chemin sera long et périlleux.
La pureté ne vaudra pas grand chose quand on sera tous morts.
En France, les écologistes et les socialistes sont trop occupés par leurs batailles d’appareil que d’idées, il n’est pas question. Le PCF, François Ruffin, Clémentine Autain cherchent, dans des styles différents, une manière d’exister au milieu de l’étau social-démocrate – insoumis. LFI n’est obsédé que par son hégémonie sur le tas de cendre. Tous se contorsionnent pour se démarquer de l’autre.
L’électorat, lui, n’attend plus les lendemains qui chantent, le temps des cerises ou le grand soir. Simplement que ses représentants lui inspirent un peu de joie, un peu moins de honte mais surtout la possibilité de mener des luttes. La pureté ne vaudra pas grand-chose quand on sera tous morts. Et il est à parier que même le choix du cercueil sera objet de controverses !
mise en ligne le 4 mai 2025
Sans syndicat, pas de salut : la gauche absente là où le salariat est abandonné
Pablo Pillaud-Vivien sur www.regards.fr
Les dernières élections professionnelles confirment une réalité inquiétante : là où les syndicats sont affaiblis ou absents, la gauche peine à convaincre.
On s’en doutait, les chiffres le confirment. Les élections professionnelles 2024 dans les fonctions publiques et dans le privé ont reconduit une tendance qui s’installe dangereusement : une baisse générale de la participation, une fragmentation accrue de la représentation, et surtout, une corrélation frappante entre la défaite syndicale et l’effacement politique de la gauche.
Dans les services publics et les industries (ou ce qu’il en reste parfois…), là où les bastions syndicaux tiennent bon — enseignement, santé, transports, collectivités — la gauche garde encore un ancrage. Mais dans les zones grises du salariat contemporain, dans les entreprises sous-traitantes, les entrepôts de la logistique, les plateformes numériques, le petit commerce, les sociétés de nettoyage ou de sécurité, la gauche est introuvable. Et pour cause : ces secteurs sont aussi ceux où les syndicats sont les plus faibles, parfois absents, souvent réprimés.
Le lien est clair : sans organisation collective du travail, sans culture de la lutte, sans relais syndicaux, les salariés sont livrés à eux-mêmes. L’individualisme forcé — celui de la survie économique, du contrat précaire, de la peur du licenciement — rend toute politisation difficile. Dans ces zones d’ombre, la gauche parle une langue étrangère, souvent inaudible. Le développement des très petites entreprises (près de 5 millions aujourd’hui quand il y en avait moins de la moitié moins il y a 10 ans) affiche un taux de participation aux élections professionnelles éloquent : sous les 5%. Les relations de classes y sont complexes car les relations patrons-salariés intriquées, les revendications sont difficiles à faire entendre, les solidarités professionnelles prennent d’autres formes que dans les grandes entreprises.
On retrouve ce même abandon dans le monde agricole. Les dernières élections aux chambres d’agriculture ont vu une nouvelle fois triompher la FNSEA, syndicat historiquement proche du pouvoir et des logiques productivistes. Le tout avec moins de la moitié des suffrages des agriculteurs… En face, la Confédération paysanne — seule voix clairement ancrée à gauche, écologiste et sociale — peine à élargir sa base. Pourquoi ? Parce que la gauche, trop longtemps déconnectée du monde rural, a déserté les campagnes. Or, l’agriculture est un champ de bataille social comme un autre : endettement massif, précarité des salariés agricoles, isolement, suicides… Et surtout incompréhension des réalités d’un monde pourtant d’une nécessité absolue pour notre société. Là encore, là où la gauche syndicale ne s’organise pas, c’est la droite et l’extrême droite qui prospèrent.
Autre exemple, ce sont près de 40% des salariés qui travaillent, selon le ministère du travail, dans les professions intermédiaires ou employées. Parmi eux, la grande majorité sont des personnels administratifs, de l’agent d’accueil au secrétaire de direction, en passant par toutes les fonctions dites supports qui sont le coeur battant des entreprises et des services publics. Pour ces travailleurs là, ni la gauche syndicale ni la la gauche politique n’offre de propositions de projet adapté. Autrement dit : bien sûr qu’il est important de mettre en avant les caristes et les chauffeurs Uber, les soignants et les postiers, les professeurs et les ouvriers des hauts fourneaux, mais quid de tous ceux qui remplissent les tableaux Excel et les agendas, répondent aux emails et au téléphone ?
Pire : là où les syndicats sont faibles, c’est souvent l’extrême droite qui avance. À force d’abandonner les salariés précaires, de mal comprendre les réalités du travail fragmenté, la gauche a laissé un vide que d’autres s’empressent de combler — par la haine et le ressentiment. Le repli identitaire prospère là où le combat social ne se donne plus les moyens de lutter – et de comprendre ! Le RN se fout du monde du travail – ou plutôt fait le strict minimum pour faire croire mensongèrement qu’il est du côté des travailleurs – mais il offre une grille de lecture du monde qui dépasse le poste de travail : le problème, y compris pour le travailleur, c’est l’arabe, le musulman, l’étranger. Au fond, sa réussite tient aussi du fait que les responsables du parti ont compris qu’un salarié ne devait pas se réduire à ses conditions matérielles de travail mais qu’il avait des rêves et des peurs – ce sur quoi ils ont décidé de capitaliser.
Il y a donc ici une urgence stratégique. Réarmer la gauche politiquement passe nécessairement par un réarmement syndical. Et il ne sert à rien de fustiger, de l’extérieur, une soi-disant « bureaucratie syndicale » selon l’adage trotskiste vieux comme Léon. Les fédérations continuent de structurer un espace qu’elles sont les seules à investir. Mais il est aussi besoin d’un patient travail d’organisation de ce salariat oublié voire négligé : syndiquer dans l’intérim, dans les entrepôts, chez les aides à domicile et les personnels administratifs. Il ne peut y avoir de stratégie électorale sans stratégie d’organisation. Mieux : on ne peut penser la société si on n’a pas des représentants de tous ses espaces pour y travailler.
La gauche qui gagne est une gauche qui s’ancre. Et s’ancrer, aujourd’hui, c’est retourner là où elle a déserté : les lieux de travail. Sans mépris pour ceux que l’on considérerait comme non-nécessaires ou concentration univoque sur ceux qui sont d’ores et déjà les atouts de la gauche. Sinon, elle restera ce qu’elle devient peu à peu : une force bavarde et impuissante.
Pour aller plus loin – car oui, certains s’y attèlent ! – : https://laviedesidees.fr/Travailler-mieux-un-recueil-de-propositions
mise en ligne le 3 mai 2025
L’État à l’encan
Par Jean-Christophe Le Duigou sur www.humanite.fr
Les choix d’une austérité renforcée qui s’annoncent font peser une incertitude quant au devenir de l’État pour la période qui s’ouvre. Sa situation financière dégradée, qui se manifestera au fil des budgets par un coût de la dette publique croissant, comptera beaucoup. Les marchés financiers vont faire peser une hypothèque sur les dépenses utiles. Il ne suffira pas dès lors au président de la République d’invoquer, au fil de ses interventions sa conviction que « l’État tient la Nation ». L’addition risque d’être lourde. À l’opposé, l’irrésistible montée des besoins de services, donc aussi de services publics, ne pourra être ignorée.
L’avenir de la puissance publique
Le devenir de la puissance publique sera largement influencé par la nature des arguments que les forces sociales auront la capacité d’imposer. Le mouvement syndical et plus largement le mouvement social et politique sont légitimes à imposer une véritable confrontation sur l’avenir de la puissance publique. Le peuvent-ils ?
Au-delà des luttes tenaces qui marquent un certain nombre de secteurs (hôpital, recherche, université, poste, finances…), au-delà des batailles pour relégitimer des politiques publiques dignes de ce nom comme en matière industrielle, d’énergie, de transport, de logement, quelques initiatives transversales sont nées dans la dernière période.
Ces initiatives, qui participent pleinement du mouvement d’opposition aux mises en cause des services publics, peinent cependant à déboucher sur des mobilisations massives, en tout cas suffisantes pour créer le rapport de force indispensable. Est en cause notre capacité collective à définir et porter les lignes directrices d’une véritable réforme de l’État. Cet effort de proposition est pourtant indispensable. Il implique de répondre à une série de questions nouvelles qui balisent la voie pour un nouveau modèle de pouvoir.
Le nouveau profil du pouvoir de demain va se jouer en fait autour de plusieurs questions essentielles qui renvoient aux fondements des missions publiques : que peut apporter la puissance publique à une nouvelle logique de développement ? Quels seront le sens et la place de la loi et de la gestion publique ? Que sera l’intervention publique notamment dans les champs économiques et sociaux ? Quel sera le rapport entre droits individuels et systèmes collectifs de solidarité ?
Ne s’agit-il pas en fait, après « l’État monopoliste social » de tracer les contours d’un nouveau type d’État, « l’État-social-développeur ».
mise en ligne le 5 mars 2025
La gauche,
la guerre et la paix
Roger Martelli sur www.humanite.fr
Sortir de la tutelle des puissants ou de la rigidité des camps, écarter les va-t-en-guerre et les affairistes et replacer le droit international au cœur du règlements des conflits. Roger Martelli propose une réponse à la force des armes.
La gauche va-t-elle se fracturer sur l’aide à l’Ukraine ? Le Monde suggérait hier que le grand écart est déjà amorcé. Dans Regards, Catherine Tricot faisait plutôt remarquer que les désaccords sur les retraites étaient sans doute plus grands que sur le dossier international. Elle notait en outre que le revirement américain offrait l’occasion de se débarrasser enfin des vieux clivages nés de la guerre froide. De fait, dans la crise politique qui est notre toile de fond nationale, la gauche est dans l’obligation de rendre compatibles ses propositions. Ce n’est pas hors de portée.
Ne pas occulter les contradictions du réel
Le point de départ consisterait à différencier ce qui est simple et ce qui ne l’est pas.
- 1 .. Ce qui a servi à justifier l’offensive de Moscou se trouve dans la crainte russe d’une extension de l’Otan aux frontières de l’État et dans le sentiment d’avoir été rabaissé par « l’Occident » depuis la disparition de l’URSS. Mais, dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, il y a un agresseur russe et un agressé ukrainien. Rien ne peut justifier l’agression, quand bien même elle a des causes qu’il vaut mieux décrypter soigneusement. Aucune paix durable n’est donc possible, si le fait de l’agression est entériné en droit.
Si tu veux la paix, prépare la guerre, disait le vieil adage latin. Mais quand la préparation à la guerre a-t-elle rendu possible la paix ?
- 2 .. La Russie n’est plus la superpuissance de l’après-1945. Mais le retrait américain crée un déséquilibre dans le rapport des forces proprement militaire. L’Otan n’étant plus le parapluie invoqué depuis 1949, l’Europe est contrainte de faire face. Qu’elle envisage de renforcer ses capacités de défense n’a en soi rien de scandaleux.
A minima, cela pourrait s’envisager à la double condition de ne pas rogner sur les dépenses civiles utiles (au risque d’aviver les ressentiments internes et les dérives antidémocratiques) et de ne pas se résigner à une course au surarmement qui met d’ores et déjà en péril l’équilibre du monde. En 2024, les dépenses mondiales d’armement ont augmenté pour la 9ème année consécutive (+7%) pour dépasser les 2400 milliards de dollars.
La mesure sur ce point est d’autant plus raisonnable que l’on sait, depuis au moins un siècle, que la spirale du surarmement n’empêche pas les guerres : elle accroit simplement les capacités de destruction mutuelle. Améliorer les capacités de défense d’un territoire, national ou continental ? Pourquoi pas, mais jusqu’à quel point, pour quoi faire et contre qui ?
- 3 .. Il ne sert à rien de s’abriter derrière les raisonnements binaires : ou bien accepter les capitulations devant l’agresseur, ou bien se préparer à la guerre au risque du cataclysme nucléaire. Si tu veux la paix, prépare la guerre, disait le vieil adage latin. Mais quand la préparation à la guerre a-t-elle rendu possible la paix ?
On évoque souvent l’exemple de la conférence de Munich, à l’automne 1938, pour dénoncer à juste titre la lâcheté et l’inefficacité des capitulations devant l’agresseur. Mais au moment de la crise des Sudètes, le choix ne se réduisait pas à deux termes : céder devant les diktats d’Hitler ou faire la guerre avec l’Allemagne. Il y avait à l’époque un moyen pour faire reculer l’agresseur et pour éviter un conflit généralisé : l’alliance diplomatique et militaire de la France, du Royaume-Uni et de l’Union soviétique contre les menaces des fascismes. Cette solution ne fut pas retenue, parce que les cynismes, les préventions, les méfiances et les calculs égoïstes l’ont emporté sur l’esprit de convergence. Il fallut attendre 1941, un monde embrasé des destructions, des souffrances et des horreurs ineffaçables, pour que se constitue le seul rempart contre la barbarie. Nul ne sait ce qui serait advenu si l’alliance s’était conclue en 1939. Mais cela aurait valu la peine qu’on expérimente alors ses effets.
Que faire ?
- 1 .. Par principe, la gauche n’aime pas les va-t-en-guerre, mais son pacifisme ne va pas jusqu’à l’acceptation de l’asservissement, pour son propre peuple et pour tous les peuples du monde. Accepter l’agression imposée à un peuple, c’est accepter de légitimer par avance toutes les agressions.
Mais la gauche sait aussi que, si la guerre est parfois imposée, il n’y a pas de solution proprement militaire à un conflit, surtout s’il peut s’étendre bien au-delà de la querelle entre deux États. Si tu veux la paix, créée les conditions pour écarter tout ce qui nourrit l’esprit de guerre… L’Europe doit s’engager pour défendre l’Ukraine ; elle doit toutefois le faire au nom de notre commune humanité, pas pour écraser ou humilier la Russie, ou pour affirmer la puissance européenne.
Il ne manque pas de forces, dans les sociétés civiles, les institutions internationales et les États, pour décourager l’agresseur, écarter les va-t-en-guerre et les affairistes et replacer le droit international au cœur du règlements des conflits.
Si l’Europe veut faire entendre sa voix efficacement à l’échelle mondiale, ce n’est pas d’abord en étalant sa puissance, mais en faisant valoir sa capacité à rassembler ses propres peuples, à conforter sa fibre démocratique, à stimuler une citoyenneté européenne encore balbutiante, à souder sa communauté de destin sur des valeurs d’égalité, de citoyenneté et de solidarité.
L’Europe, par ses caractéristiques, son histoire et ses ressources, peut être un intermédiaire entre les États et un monde qui peine à gérer ses interdépendances dans la sobriété et la justice. Mais pour que cet intermédiaire fonctionne, il doit devenir lui un cadre de souveraineté démocratique et partagée. Si la gauche a une originalité à faire valoir, c’est dans sa capacité à montrer qu’elle pense de la même façon cohérente la triple maîtrise démocratique du national, du continental et du planétaire.
- 2 .. Si l’Europe veut se faire entendre, ce n’est pas en désignant les Grands Satans, mais en proposant largement de se rencontrer, de débattre, de trouver des solutions communes. Si l’ONU n’est provisoirement plus le meilleur lieu pour cette rencontre, l’Europe pourrait proposer de la compléter par des cadres provisoires, intercontinentaux par exemple. Et si le trumpisme met à l’écart le continent américain – mais il n’a pas le pouvoir d’écarter toutes les Amériques -, elle peut cultiver le dialogue eurasiatique… en attendant mieux.
Pourquoi se résigner à penser le monde en termes de camps, en « Nord global » et en « Sud global ». Avec le revirement étasunien, ce simplisme est en train de se brouiller, de tous les côtés. Tant mieux, mais à condition de se tourner vers les États qui peuvent préférer le dialogue à la tension, la négociation plutôt que le rapport des forces permanents. Seule une telle convergence, sans exclusive a priori, peut éviter le pire et apaiser durablement un espace planétaire devenu explosif, et pas seulement en Ukraine ou à Gaza.
Il faut bien qu’une voix forte se fasse entendre, pour rappeler aux Trump, Vance, Milei, Poutine et autres que les agressions militaires, les chantages impériaux et l’extension sans fin des alliances militaires de « blocs » ne peuvent en aucun cas être des bases de discussion. Le but de la négociation ne doit pas plus être de « désoccidentaliser » que « d’occidentaliser », mais de rétablir et même d’instituer le droit international en base unique de régulation des rapports entre les peuples.
- 3 .. Ce n’est pas par la force des armes que l’Europe a le plus de chance de se faire entendre et de peser sur le devenir de notre planète. Les voix du cynisme, de la force et de l’exclusion ont de l’écho aujourd’hui, parce que les synthèses de l’après-1945 – celles du Welfare state et de l’État-providence – se sont érodées, par l’action consciente des puissances d’argent, les facilités technocratiques et l’échec des grands mouvements d’émancipation.
L’Europe peut user de ce qu’il y a de mieux dans son histoire – la double piste de la culture démocratique et de la fibre ouvrière et populaire – pour proposer de nouvelles synthèses. Elle ne serait pas seule dans cette quête. Dans les publications issues de la « société civile » comme dans les documents d’instances onusiennes, des propositions existent, construites à partir de larges consensus. Elles contiennent souvent une charge subversive étonnante contre la dictature des marchés, la gabegie productiviste, la froideur technocratique et le cynisme de la force.
- 4 .. Il ne manque donc pas de forces, dans les sociétés civiles, les institutions internationales et les États, pour décourager l’agresseur, écarter les va-t-en-guerre et les affairistes et replacer le droit international au cœur du règlements des conflits. Les peuples du Sud qui aspirent à la dignité, les mouvements sociaux qui luttent pour l’égalité, la citoyenneté et la solidarité, les engagements multiples pour la reconnaissance des droits et la primauté des besoins humains : tout cela crée la possibilité de nouvelles alliances, hors de la tutelle des puissants ou de la rigidité des camps.
Que cela s’accompagne de la prudence et du droit imprescriptible de défendre la souveraineté des nations et les équilibres continentaux peut s’envisager. Mais pas au prix d’un cataclysme qui risque d’anéantir tout ce qui fait notre humanité.
mise en ligne le 4 mars 2025
Assemblée nationale :
on s’engueule plus sur les retraites que sur l’Ukraine
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Nos politiques ont débattu dans l’hémicycle, ce lundi 3 mars, au sujet du bellicisme russe et du basculement diplomatique américain. Des discours qui cherchent à se démarquer, malgré des convergences de vue.
Le débat à l’Assemblée nationale prend un écho renforcé à l’aune des décisions trumpiennes de la nuit : suspension avec effet immédiat de l’aide militaire américaine à l’Ukraine ; hausse des droits de douane à 25% avec le Mexique et le Canada et 20% avec la Chine ; licenciement sur le champs de la plupart des salariés de USAid qui dispensaient près de la moitié de l’aide humanitaire mondiale.
Introduit par un discours du premier ministre, formellement très réussi et aux convictions franches, les échanges entre les groupes parlementaires ont confirmé des positions contrastées. François Bayrou a, bien plus nettement que les dirigeants européens, affirmé le changement d’époque. Contrairement aux Anglais ou Polonais, pas une fois il n’a voulu se référer à l’amitié historique et aux liens entre la France et les États-Unis. Ceux-ci n’ont bien sûr pas disparu mais pour l’exécutif français, ils ne peuvent plus être la boussole : il faut acter la rupture. La suite de son plaidoyer portait sur la force des Européens. Il a voulu convaincre, au-delà de l’enceinte des députés, de la possibilité pour l’Europe de se constituer en puissance autonome :« Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles ».
La suite des interventions a montré que ce discours puissant ne suffisait pas à lever désaccords et objections. L’union nationale n’est pas au programme. Le clivage est plus fort sur les retraites et le droit du travail que sur l’Ukraine. Les différences de sensibilités se sont clairement énoncées hier dans l’hémicycle. Mais les positions ne sont pas apparues aussi clivées que bien des fois. Le ton des différents orateurs était grave et l’attention soutenue. Le poids de l’histoire nationale s’est fait sentir. Et l’ombre du général de Gaulle a plané dans bien des discours.
Laissons de côté Éric Ciotti et ses obsessions minables sur l’immigration. De façon attendue, la droite et l’extrême droite ont fait porter leurs critiques sur la question du parapluie nucléaire, affirmant qu’il ne saurait être partagé. En fait, personne ne le dit ni ne le propose. Après les tentations trumpistes de Jordan Bardella, Marine Le Pen a éludé toute analyse sur les États-Unis et n’a pas eu un mot sur la responsabilité de la Russie. Mais elle a dû commencer son discours par un soutien aux Ukrainiens.
Les interventions de Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste, et de Boris Vallaud, président du groupe socialiste, étaient emprunts du soutien à l’Ukraine. Tous les deux ont dit leur conviction que la Russie ne doit pas gagner et ont réaffirmé leur foi dans l’espace européen. Le porte-parole des insoumis, Aurélien Saintoul, a livré un discours solide, ne pouvant se priver d’une arrogance mal placée « qu’il est douloureux d’avoir eu raison 20 ans durant » – avant même les insoumis, que c’est drôle ! Mais il démontrait la vanité d’une défense européenne quand les armes sont américaines et l’appareil productif dévasté. Le porte-parole du groupe communiste et ultramarin, Jean-Paul Lecoq, a fait le lien entre les enjeux sociaux et les efforts demandés : si les premiers ne sont pas assurés alors les seconds seront mal compris. En clair, 5 milliards pour les retraites ne peuvent être un mur infranchissable quand 40 milliards de plus pour l’armement serait une exigence. Aurélien Saintoul relevait lui aussi le paradoxe à propos des moyens mobilisés pour le climat. L’orateur communiste, à la différence de tous et singulièrement du premier ministre, insista sur les transformations du monde au-delà de la déflagration Trump : « Penser la paix ne pourra se faire qu’entre européens. De nombreux pays ont à cœur que l’Ukraine retrouve la paix ». Et de citer l’initiative conjointe Brésil-Chine pour des négociations de paix.
Relevons que la fin de l’atlantisme, actée par les uns et les autres, permet de nouveaux espaces de convergence en particulier au sein de la gauche. Les différends sur la construction européennes entre socialistes et écologistes d’une part, communistes et insoumis d’autre part, demeurent. Mais ils ne sont plus lestés de cette ombre portée américaine qui enserrait la pensée et le projet dans une histoire et un système économique, le capitalisme sous toutes ses formes.
L’heure est très grave, « la plus grave depuis la fin de la seconde guerre mondiale » a dit François Bayrou. Le pouvoir doit en prendre la mesure, pas seulement militaire. La gauche doit s’en convaincre et travailler à sa convergence, nécessaire et davantage possible.
Guerre en Ukraine : à l’Assemblée,
les macronistes poussent l’agenda fédéraliste pendant que la gauche se fracture
Gaël De Santis sur www.humanite.fr
Lors du débat consacré à la guerre à l’Assemblée nationale lundi 3 mars, Gabriel Attal a estimé que Kiev « vaincra », invitant avec le premier ministre à renforcer l’Union européenne.
Pour le camp présidentiel, rien ne doit changer dans la politique de la France. Le premier ministre n’a offert, lors du débat qui se tenait lundi à l’Assemblée nationale, aucune perspective de négociation entre la Russie et l’Ukraine. Et ce, malgré le lâchage de cette dernière par Donald Trump, en direct dans le bureau Ovale, le 28 février. « Pour l’honneur de l’Europe, le président Zelensky n’a pas plié et nous pouvons lui manifester de la reconnaissance », a salué François Bayrou, qui a prévu une aide à l’Ukraine, en matière militaire, politique, et diplomatique.
« Nous, les Européens, sommes plus forts que nous ne le croyons. Nous nous comportons comme si nous étions faibles », a-t-il déploré, avant de donner des chiffres à l’avantage de l’Europe concernant le PIB, les effectifs militaires, la démographie. « Le monde libre a besoin d’un nouveau leader », après les déclarations de Donald Trump, a estimé Gabriel Attal. « C’est à nous, la France et les nations européennes, de prendre enfin la relève », a lancé le président du groupe Renaissance, appelant à construire l’indépendance du Vieux Continent, notamment via une relance des dépenses militaires. « L’Ukraine vaincra, l’Europe sera », a-t-il claironné.
Fracture à gauche
De telles déclarations ont permis à l’extrême droite de répliquer en faisant valoir son agenda souverainiste. Marine Le Pen a qualifié de « tromperie » la promesse faite à l’Ukraine d’une intégration future dans l’Union européenne (UE) et dans l’Otan. Elle appelle à une conférence de paix entre nations qui ont intérêt à la pacification de la région, mais pas « les instances supranationales comme l’UE ou l’Otan ».
À gauche, une vraie ligne de fracture apparaît. Boris Vallaud, chef du groupe PS à l’Assemblée nationale, invite à « investir l’Otan ». « Les socialistes appellent de leur vœu un grand plan stratégique de l’Europe » en matière militaire et industrielle, a-t-il précisé. Pour lui, la dissuasion nucléaire « sera d’évidence un des éléments de la construction d’une sécurité commune européenne ». L’élu PS appuie l’idée de l’envoi de troupes françaises en Ukraine, le moment venu. Pour Les Écologistes, Cyrielle Chatelain a aussi appelé à renforcer le volet militaire de l’UE.
L’insoumis Aurélien Saintoul a en revanche accusé certaines forces politiques, sans les nommer, d’avoir conduit la politique de sécurité de la France dans le mur, en rejoignant le commandement intégré de l’Otan en 2008. « Nous voici dans une situation de dépendance des États-Unis devenant critique », s’est-il plaint.
Le député communiste Jean-Paul Lecoq a, lui, refusé l’augmentation des budgets de la défense alors que l’argent manque pour les services publics. Il appelle à prendre ses distances avec les États-Unis et à dialoguer, y compris avec la Russie, ce que refusent pour l’heure Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères. « On se croirait dans une cour d’école. L’hypothèse d’une troisième guerre mondiale n’est pas un jeu », rappelle-t-il, invitant à la cohérence en faisant respecter le droit international partout, y compris en Palestine et au Sahara occidental. « Il faut obtenir l’arrêt des combats pour organiser une conférence internationale sur la sécurité et la coopération en Europe conduisant à un accord de paix », conclut-il.
mise en ligne le 27 février 2025
Vincent Tiberj : « Social, économie : la gauche doit rejouer à domicile ! »
Par Pierre Joigneaux sur https://fakirpresse.info/
« Pourquoi diable les ouvriers et employés votent plus RN qu’à gauche ? Comment fait-on pour les ramener ? » La question taraude Vincent Tiberj. Sa réponse ? Non, les citoyens français ne se sont pas droitisés, mais la gauche doit ramener le débat sur le social et l’économie pour retrouver les classes populaires. Le sociologue détaille tout ça dans son ouvrage La droitisation française, mythe et réalité (PUF, 2024). Un livre qui ouvre un espoir pour le combat.
Fakir : La fameuse note Terra Nova de 2011 s’est basée en partie sur vos travaux, sur vos données, pour envisager un abandon des classes populaires et une nouvelle stratégie pour le PS : s’adresser aux minorités.
Vincent Tiberj : Cette note est très symbolique, mais l’abandon des classes populaires date de bien avant ! Oui, ça s’est accéléré pendant le quinquennat Hollande, mais cet abandon remonte à la fin des années 90 déjà, quand les idées de la troisième voie incarnée par Clinton-Blair-Schroëder sont arrivées au sein du PS.
Fakir : Votre ouvrage démontre pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, que les attentes des citoyens, y compris des classes populaires, sont loin de se droitiser, et que la gauche aurait tort d’abandonner les thématiques sociales.
Vincent Tiberj : La note de Terra Nova laisse penser que le culturel suffira. Mais les électeurs de gauche sont à la fois de gauche socialement et culturellement. On ne peut pas abandonner le social. Il faut rappeler qu’il y a des demandes de protection très fortes du monde du travail, pour une meilleure vie. On l’a vu pendant le mouvement des retraites l’année dernière. C’est énorme, comme thème, cette question du travail.
Fakir : Vous expliquez dans votre livre que les citoyens français sont de plus en plus tolérants. Et même, si on prend les données sur quarante ans, que le seuil de tolérance grimpe, sur l’acceptation de l’homosexualité ou sur l’ouverture à l’immigration. Pourtant « la part de Français estimant que le racisme est présent dans la société française atteint un niveau record à 85 % » selon la dernière enquête Fractures française…
Vincent Tiberj : De plus en plus de gens répondent que « oui », il y aurait de plus en plus de racisme. Mais si on prend les données sur trente ou quarante ans, oui les enquêtes montrent l’inverse. Les choses ont même considérablement progressé. Quelques chiffres, des données issues de nos enquêtes avec la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH). Sur le droit de vote des étrangers : 34 % de soutien en 1984, 58 % en 2022. Sur « les immigrés sont une source d’enrichissement culturel » : 44 % en 1992, 76 % en 2022. Sur « il y a trop d’immigrés en France » : 69 % en 1988, 53 % en 2022, 52 % en 2021, 48 % en 2024. Sur la baisse du racisme biologique : en 2002, 14,5 % des répondants considéraient encore « des races supérieures à d’autres », en 2022 ils ne sont plus que 4 %.
Fakir : Comment expliquez-vous cette différence entre ces chiffres et les ressenti, du coup ?
Vincent Tiberj : Il faut dissocier les interactions par en bas, de moins en moins racistes, et ceux qui parlent de cette société par en haut. On nous présente les médias comme une machine qui écraserait tout sur son passage, mais les résistances sont sacrément impressionnantes. Oui ils tiennent l’agenda, le cadrage dominant. Mais regardez, si on prend la séquence octobre / novembre 2023 : attentats du Hamas, Crépol, loi immigration... Le baromètre de la CNCDH montre toujours plus de tolérance. Le seuil de tolérance progresse depuis quarante ans. Oui la force de frappe du groupe Bolloré mobilise et pèse sur les électeurs de droite. Mais en revanche, ça n’essaime pas dans l’ensemble de la population. La société génère ses propres anticorps. Beaucoup pensent que l’extrême droite a gagné la bataille du récit. Peut-être en haut, dans la sphère médiatique. Mais en bas, ça résiste bien. Regardez la mobilisation contre « Bardella Premier ministre ». Le barrage a eu lieu par en bas : les associations, les syndicats, les militants et collectifs citoyens… On a tendance à oublier tous ces gens qui se sont déplacés. La société résiste extrêmement bien. Mais il n’empêche qu’on continue à parler à longueur d’antenne d’immigration, et très peu des inégalités sociales face au dérèglement climatique par exemple. L’avantage pour le RN, c’est qu’on reste sur leurs thèmes. Ils jouent à domicile. Mais il faut rappeler que Cnews, c’est seulement 3,1% de la part d’audience (ndlr : en novembre 2024). Arte c’est 3%. Pourquoi Cnews serait la chaîne représentative du peuple ? Pourquoi les obsessions des médias Bolloré serait représentatives des attentes des gens ?
Fakir : Justement : vous montrez dans le livre des attentes fortes pour une redistribution du capital vers le travail, avec même un soutien très fort sur une batterie de mesures (89 % pour la hausse du SMIC, 91 % pour que le système de retraites reste public…). Mais vous montrez aussi la fin d’un « nous », d’une conscience de classe, avec l’atomisation et la précarisation du travail, l’effondrement du syndicalisme et du PCF... Et ce malgré des moments forts de conscientisation comme le mouvement des Gilets Jaunes ?
Vincent Tiberj : C’est pour moi un enjeu majeur : pourquoi diable ces ouvriers et employés vont plus voter RN qu’à gauche ? Comment fait-on pour les ramener ? Comment fait-on pour les entendre ? C’est un des vrais soucis qu’on a, à gauche. Il fut un temps où les partis de gauche et les syndicats avaient des ramifications dans les milieux populaires…
Fakir : Il y a encore des bastions de résistance, non ?
Vincent Tiberj : Oui mais aujourd’hui, il y a des zones blanches syndicales incroyables. Dans les grandes usines il y a encore un peu de monde syndiqué, mais c’est un no man’s land chez les petits. Pendant ce temps-là, dans les partis, c’est une lutte entre élus, entre collaborateurs...
Fakir : Quel message leur feriez-vous passer ?
Vincent Tiberj : Vous êtes déconnectés : prenez du temps, allez bosser. Sortez de la bulle médiatique. Des polémiques. Je vis à Bordeaux, vous, vous êtes à Amiens, eh bien ce ne sont pas les problèmes parisiens qui animent les gens hors de la capitale. Twitter a en plus un effet de renforcement des prédispositions. Si vous ne suivez que des RN, ou des insoumis, ou des macronistes, vous renforcez ce que vous êtes, vous ne voyez plus rien d’autre, vous êtes dans une bulle. Il faut lire Michelat et Simon sur le vote de classe : les ouvriers votaient à gauche car ils se pensaient comme des ouvriers, comme la classe ouvrière, comme un « nous ». Mais le sentiment d’appartenir à une classe a baissé. Aujourd’hui, il y a un fort sentiment d’appartenance à la classe moyenne, une atomisation de la situation sociale. Mais on peut reconstruire le « nous » : comme vous le dites, on l’a vu au moment des Gilets jaunes : la re-création, par en bas, de demandes de solidarité, de justice sociale et environnementale, et surtout le Référendum initiative citoyenne (RIC). Les Gilets jaunes, ça devrait être une leçon d’humilité pour les partis politiques : prenez le temps de descendre.
Fakir : Bernie Sanders, Naomi Klein, Serge Halimi… Certains à gauche ont tiré des enseignements de la victoire de Trump en l’expliquant notamment par l’abandon des classes populaires par le parti démocrate, son abandon de la question économique, du pouvoir d’achat, de la bataille pour protéger le travail du capital. Un terrain économique sur lequel s’est engouffré Trump. Vous êtes d’accord avec leurs analyses ?
Vincent Tiberj : Le PS a gagné en 2012 grâce au discours du Bourget. Les électeurs y croyaient. On ne peut pas faire comme si les électeurs n’avaient pas de mémoire. Les trahisons, les gens sont capables de s’en souvenir : dire « Mon ennemi, c’est la finance », pour terminer par mener une politique de l’offre, faire marchepied à Macron... Aux États-Unis, Obama a parlé de redistribution, de protection sociale, il y est allé culturellement et socialement. Kamala Harris est restée très prudente sur les enjeux culturels, et a été totalement absente sur les questions économiques. Trump gagne avec le vote populaire, mais ce n’est pas non plus un raz-de-marée. C’est parce qu’un nombre croissant d’électeurs ne se sont pas déplacés pour voter démocrate. Jusqu’aux années 80, les partis et candidats de gauche parlaient des conditions économiques des plus pauvres… ne serait-ce que pour obtenir leur suffrage ! Aujourd’hui, leur quotidien, leurs conditions d’existence, leurs difficultés, sont invisibilisées. Dès lors qu’on ne parle plus d’eux, comment ne peuvent-ils pas se sentir abandonnés, se détourner de la politique ?
Fakir : Vous me faites la transition : dans la deuxième partie du livre, vous parlez d’une « grande démission ». Vous montrez que les abstentionnistes ne sont pas des « sans-avis », mais bien des citoyens déçus par les élus et les partis : 80 % des Français ne font pas confiance aux députés, 86 % des Français ne font pas confiance aux partis politiques (Fractures françaises 2024 pour Le Monde). Ce dégoût croissant, on l’entend partout sur le terrain, en reportage, ce dégoût des « politicards déconnectés », des professionnels de la politique, il vient d’où, selon vous ?
Vincent Tiberj : Déjà, on est face à une institution problématique, le système présidentiel. Comme si la solution était d’élire un sauveur suprême, un césar, un tribun… mais déjà l’Internationale refusait ces trois-là [NDLR : et le chant date de 1871 !]. Premier point : sortir de la vision d’un guide qui nous sauverait. Deuxième point : la culture française a énormément de mal avec la base, l’horizontalité. 2005, c’est assez terrible symboliquement [NDLR : la victoire du « non » au référendum sur la Constitution européenne, puis finalement le passage en force du texte avec le traité de Lisbonne deux ans plus tard]. En France on ne choisit pas, on élit. On dit : « Vous avez voté pour Macron », alors que beaucoup ont d’abord voté contre. Au bout d’un moment, ça énerve les gens cette impression de ne pas être écouté. Ils se disent : « Si je veux agir, être utile, contrairement à tous ces guignols, je vais dans une asso faire des maraudes. » Nous avons des citoyens de bien meilleure facture qu’ils n’ont jamais été, mais qu’on n’écoute pas. Nous avons un modèle politique vertical, qui ne peut pas continuer à tourner en vase clos. Vous avez des pays comme la Suisse ou l’Irlande où c’est beaucoup plus horizontal, même si ça apporte d’autres problèmes. En France, on le voit aujourd’hui, vous pouvez arriver au pouvoir en étant ultra minoritaire. C’est quoi cette démocratie ?
Fakir : Vous écrivez : « le peuple qui s’exprime dans les urnes des législatives a de plus en plus un accent upper class et riche ». c’est le « Cens caché » 2.0, une nouvelle forme de vote censitaire ?
Vincent Tiberj : Quand Daniel Gaxie parle de « cens caché » dans les années 70, c’est moins un problème de participation qu’un problème de domination. Aujourd’hui, les biais sociaux de participation sont énormes : parmi les boomers, qui se mobilisent beaucoup dans les urnes, ce sont les ouvriers et les employés qui décrochent. Nous avons donc affaire à une grave crise du système représentatif. Une vraie crise de légitimité des politiques en France qui ne se retrouve pas dans d’autres pays. Or le RN et la droite sont moins touchés par cette grande démission. La gauche, en revanche, l’est beaucoup plus touchée : elle s’est coupée des classes populaires favorables à la redistribution.
Fakir : Si la gauche stagne, ou perd du terrain par rapport au RN, c’est parce qu’elle ne parle plus assez de la redistribution et de la solidarité ?
Vincent Tiberj : Oui. un des enjeux centraux pour la gauche, c’est de retrouver une crédibilité sur la question de la redistribution. La dernière fois que les électeurs y ont cru, c’était en 2012. Ce qui s’est passé dans les années 2010, ce n’est pas une montée de la droite, mais c’est une baisse de la gauche dans les urnes. Il y a toute une crédibilité à reconstruire, et ça passera par la capacité à comprendre ce qui se passe dans les milieux populaires, recréer du lien entre la gauche et les milieux populaires. Notre hypothèse principale : un défaut d’incarnation, à gauche. On fait face à un rejet de ses responsables politiques, non des valeurs ou des idées. Il ne faudrait donc pas se tromper sur le sens de la causalité. Trop souvent, parmi les intellectuels et les organisations traditionnelles de la gauche, on déplore le recul de ces idées telles que la redistribution et la solidarité dans l’opinion. Pourtant, n’est-ce pas plutôt que les partis censés les incarner ont préféré les faire passer au second plan ? Si les électeurs s’éloignent de la gauche, n’est-ce pas avant tout pour cette raison ?
Fakir : Le sociologue Benoit Coquard nous a décrit cette déconnexion de la gauche et des classes populaires (lire notre entretien ici). Vous documentez vous aussi ce long glissement vers le RN. Au premier tour des législatives de juin 2024, 57 % des ouvriers qui se sont déplacés ont voté RN. Si ce sont les trahisons du PS au pouvoir qui marquent un tournant entre la gauche et les classes populaires, on peut remonter à 1983…
Vincent Tiberj : Oui mais entre la gauche et les classes populaires, il y a un vrai tournant entre 2012 et 2014. Il y a d’abord une sortie du jeu de pans entiers de la société, notamment chez les ouvriers et employés. Une sortie du jeu partisan, du champ politique, pour entrer dans le dégoût, ça c’est vraiment super important. Dans les années 1970, le groupe qui penche le plus à gauche est celui des ouvriers. Jusqu’à l’élection de François Mitterrand, ils étaient entre 43 % et 47 %, et seulement 20 % à droite. Jusqu’à l’élection de François Hollande en 2012, la gauche est encore présente dans les catégories populaires.
Fakir : Mais la droite, une fois au pouvoir, a aussi déçu les classes populaires – comme sous le quinquennat Sarkozy. Et aujourd’hui, on fait face à une déception des professionnels de la politique dans leur ensemble, et à l’explosion de « sans partis ».
Vincent Tiberj : Oui ! On constate un refus de l’offre politique dans son ensemble, un rejet des partis et des candidats. Une explosion d’un « non alignement ». Et quand on va encore voter, on vote avant tout par rejet, par défaut, négatif. On vote avant tout « contre » des ennemis, beaucoup plus que par adhésion à un programme.
Fakir : On vote pour le moins pire ?
Vincent Tiberj : Oui, et ce rejet s’accélère. On constate une négativation dans la France de l’après réélection d’Emmanuel Macron. La situation s’est encore dégradée pour tous les partis, à l’exception du RN. Par exemple, le RN est désormais moins rejeté que LFI : quinze points de rejet supplémentaires pour la FI depuis la présidentielle, quand le RN continue de progresser... Le RN a bénéficié de la comparaison avec Reconquête, qui a accéléré la dédiabolisation de Marine Le Pen. Pour la FI, la façon dont elle est cadrée médiatiquement et sa logique interne jouent. Il y a aussi une stratégie de la polarisation portée par un certain nombre de ses acteurs, on le voit au moment où émergent des polémiques. Et puis, le système a besoin de se renouveler. Marine Le Pen face à Mélenchon, ou face à Hollande, c’est le même match qui se joue depuis 2012. Je l’ai dit à l’institut la Boétie : il est minuit moins le quart. L’explosion du vote RN entre 2022 et 2024, ça m’inquiète beaucoup. Le RN n’a plus besoin d’être majoritaire en voix : on n’est vraiment pas loin de leur arrivée au pouvoir.
Fakir : Si le RN est aussi proche du pouvoir, c’est peut-être aussi parce que les thèmes abordés dans le débat public pénalisent la gauche et le favorisent ? Vous écrivez : « Si la campagne avait lieu sur les inégalités et les valeurs socio-économiques, l’électorat de Le Pen serait alors divisé, tandis que la gauche en bénéficierait. » La priorité serait donc d’emmener le RN sur le terrain socio-économique ?
Vincent Tiberj : Oui ! La priorité est d’emmener le RN sur le terrain socio-économique, évidemment. Il faut insister là-dessus. Souligner par exemple le revirement de Bardella sur les retraites. Aller sur ce terrain socio-économique, ça permettrait à la gauche de jouer à domicile. De parler d’enjeux dont on ne parle pas assez. Le RN a tout intérêt à ne pas parler d’économie, d’inégalités sociales. À nous de faire jouer le RN à l’extérieur.
mise en ligne le 23 février 2025
Thomas Coutrot, économiste :
« L’entreprise est un bastion d’autoritarisme »
Mélanie Mermoz sur www.humanite.fr
En liant enquêtes sur les conditions de travail et résultats électoraux, l’économiste Thomas Coutrot montre combien le manque d’autonomie dans la sphère professionnelle, mais aussi l’absence de possibilité d’expression à son sujet nourrissent le vote d’extrême droite. Il invite à refaire du travail un enjeu de débat démocratique.
Dans l’analyse des motivations du vote RN et de l’abstention, l’impact du travail est trop souvent un angle mort. L’étude publiée par l’économiste Thomas Coutrot intitulée « le Bras long du travail : conditions de travail et comportements électoraux » s’attaque à cet impensé. Pour cela, il a croisé les données des enquêtes de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) sur les conditions de travail de 2016-2017 et 2019 avec les résultats des élections présidentielle de 2017 et européenne de 2019, qu’il a enrichies avec des indicateurs statistiques par commune, calculés par Thomas Piketty et Julia Cagé. L’absence d’autonomie dans le travail et l’impossibilité de donner son avis sur celui-ci s’avèrent déterminantes sur les comportements civiques.
Depuis quand s’intéresse-t-on à l’impact de l’organisation du travail sur la politique ?
Thomas Coutrot : Dès le XVIIIe siècle, aux prémices de la révolution industrielle, Adam Smith dénonce déjà l’impact du travail répétitif sur les capacités cognitives des travailleurs. D’un côté, il se félicite des gains de productivité économique que permet la division du travail, mais, de l’autre, il s’inquiète du fait qu’en passant d’un travail artisanal à un travail ouvrier ultrarépétitif, on abîme le psychisme des ouvriers. Il dit de ceux-ci : « Ils deviennent aussi stupides et ignorants qu’il est possible à une créature humaine de le devenir. »
Au XIXe siècle, John Stuart Mill dénonce le régime d’usine – Marx parle, lui, de « despotisme d’usine ». Pour Mill, il est contradictoire avec la possibilité d’être un citoyen éclairé et de participer à la vie de la cité. C’est la raison pour laquelle cet économiste et philosophe britannique, libéral économiquement, considère que les coopératives sont le seul mode d’organisation de la production cohérent avec un régime démocratique.
En Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, cette idée est portée par le socialisme de guilde, dont le penseur le plus connu est G. D. H. Cole. Celui-ci écrit qu’un régime de servilité dans l’industrie ne peut que donner un régime de servilité dans la sphère politique. Ce courant partisan des coopératives est favorable à la gestion des entreprises par les travailleurs ; il en fait une condition de la vie démocratique dans la cité.
Comment se prolonge cette réflexion au XXe siècle ?
Thomas Coutrot : Au cours des années 1930-1940, le philosophe américain John Dewey développe l’idée que la démocratie n’est pas un régime d’institutions, mais un mode de vie. C’est une société où les individus sont socialisés dans une norme d’interrogation des pouvoirs existants, d’enquête permanente sur le monde. C’est exactement ce que dit aussi Castoriadis : la démocratie n’est pas une société sans hiérarchie ni pouvoirs, mais une société où ceux-ci sont sans arrêt questionnés.
Au cours des années 1970, dans la continuité de Dewey, la politiste Carole Pateman consacre plusieurs livres à la démocratie participative. Pour elle, la démocratie ne peut pas se limiter à la liberté d’expression et au droit de vote, elle doit reposer sur des habitudes quotidiennes enracinées dans les rapports sociaux élémentaires. La démocratie délégataire, qui consiste à élire périodiquement ceux qui nous gouvernent, est une illusion.
Pour être vivante, la démocratie doit s’ancrer dans une participation continue des citoyens aux décisions, une culture quotidienne qui doit pénétrer toutes les sphères de la vie sociale (famille, école, travail…). L’entreprise est un bastion d’autoritarisme dont l’existence et la place centrale dans la vie des personnes sapent les fondements même du régime politique démocratique.
D’élection en élection, nous assistons à un renforcement de l’abstention. Quel est le facteur professionnel le plus observé chez les abstentionnistes ?
Thomas Coutrot : La variable liée aux conditions de travail qui joue le plus fortement chez les abstentionnistes est le manque d’autonomie dans le travail. C’est vraiment le marqueur d’une condition de subordination dans le travail qui prédispose à une passivité politique. Depuis une vingtaine d’années, à travers la montée des procédures, du « reporting », nous observons une érosion de l’autonomie au travail, associée à une série d’innovations techniques et organisationnelles («lean », « new public » managements…).
Les algorithmes et l’IA ne font que sophistiquer des méthodes de contrôle numérique et informatique du travail et de standardisation déjà largement diffusées. L’érosion de l’autonomie n’est en effet pas une question de technologie, mais d’organisation. Ce ne sont pas les outils numériques qui sont en eux-mêmes porteurs d’un appauvrissement du travail, mais les finalités en vue desquelles ils sont conçus et mobilisés. L’accroissement du contrôle, de la standardisation, n’est pas une stratégie d’efficacité économique, mais de pouvoir et de domination.
L’abstention est aussi nettement corrélée à la précarité de l’emploi. Vivre dans l’incertitude du lendemain, être accaparé par les tâches de survie ne favorise pas l’intérêt pour la chose publique, ni la croyance de pouvoir par son vote modifier la situation. Les politistes nomment « sentiment d’efficacité politique » la perception que sa parole compte, que son vote est important. Chez les plus précaires, ce sentiment d’efficacité politique est très faible. Être précaire signifie n’avoir pas de maîtrise de sa vie personnelle, encore moins de la vie collective.
Dans le travail, quel est le marqueur déterminant dans le vote RN ?
Thomas Coutrot : Le fait de ne pas pouvoir donner son avis sur son travail lors de réunions régulières est clairement associé à une propension beaucoup plus forte à voter RN (+ 10 points), même toutes choses égales (diplôme, métier…). L’enquête ne distingue pas le type de réunions – entre collègues, avec les manageurs, avec les élus du personnel ou dans un cadre syndical. C’est d’ailleurs un point qu’il faudrait creuser.
Elle ne dit pas non plus si ces réunions débouchent sur un changement réel. Environ 45 % des salariés participent à des réunions sur leur travail, les cadres et les plus diplômés y sont plus fréquemment associés, même si d’autres catégories sociales peuvent aussi y participer. Il existe également une dimension de genre ; les femmes ont moins la possibilité que les hommes de donner leur avis sur leur travail.
Le fait de travailler de nuit ou à des horaires atypiques est l’autre marqueur déterminant du vote RN (+ 10 %). On observe aussi que les femmes qui votent RN sont celles qui ont la plus forte participation aux tâches ménagères. Cela traduit sans doute une plus forte adhésion aux stéréotypes de genre.
Lors des enquêtes sociologiques par entretien, les questions liées au travail sont-elles abordées par les électeurs RN ?
Thomas Coutrot : Non, ce qui va apparaître dans le discours des électeurs RN, c’est la concurrence des immigrés, le sentiment de mépris dans lequel ces personnes se sentent tenues par les élites, la question des solidarités locales. En revanche, les enjeux du travail, son organisation, le fait de se lever très tôt le matin n’apparaissent jamais, à ma connaissance en tout cas, dans les discours des électeurs RN, et donc dans les analyses des sociologues ou des politistes qui travaillent sur ce sujet.
Les mécanismes de domination ou de mépris au travail, difficiles à vivre mais qu’ils ne parviennent pas forcément à verbaliser, produisent de façon inconsciente des affects d’extrême droite. C’est une espèce de rationalisation a posteriori. Ces mécanismes de domination ne sont pas conscientisés. Ils sont peut-être même naturalisés. Beaucoup d’électeurs du RN ont une vision assez viriliste du monde et donc, pour eux, avoir un chef autoritaire peut même sembler positif…
Côté travail, existe-t-il des similitudes entre abstentionnistes, électeurs FI et ceux du RN ?
Thomas Coutrot : L’électorat FI est caractérisé, comme les abstentionnistes et l’électorat RN, par une faible autonomie dans le travail. Le profil des électeurs RN et LFI est assez proche sociologiquement, même s’il est plus divers chez LFI. C’est un profil plus ouvrier et moins diplômé que la moyenne. Mais il se distingue vraiment sur la capacité d’expression sur le travail. Si les électeurs RN sont très peu sollicités pour parler de leur travail, le fait de pouvoir discuter de son travail est au contraire nettement associé à un vote de gauche, notamment FI.
Un résultat apparaît surprenant, c’est la forte proportion de syndiqués parmi les électeurs RN…
Thomas Coutrot : Une forme de révolte sociale, de colère qui s’exprime en partie par le vote RN, peut aussi se manifester par l’adhésion à un syndicat. Ce phénomène s’observe plutôt chez les adhérents ou les sympathisants que chez les militants. La forte différence entre mes résultats et ceux des sondages « sortie des urnes », qui indiquent un moindre vote RN pour les syndiqués, pourrait s’expliquer par une forme de honte des syndiqués à avouer à un enquêteur qu’ils votent RN.
Ils seraient ainsi les seuls à maintenir le biais de sous-déclaration observé il y a encore une dizaine d’années chez l’ensemble des électeurs. Contrairement au reste de la société, le vote pour le RN n’est pas devenu totalement banalisé dans les milieux proches des syndicats. L’ensemble des directions syndicales communiquent, en effet, beaucoup auprès de leurs adhérents sur le sujet, ce qui n’est pas sans créer des tensions sur le terrain.
Les syndicalistes avec lesquels j’ai échangé n’étaient pas étonnés de ce résultat. Plusieurs militants m’ont ainsi raconté avoir, pendant la campagne des législatives, essuyé des remarques quand ils allaient distribuer des tracts contre le RN à la porte des entreprises. Des sympathisants, voire des adhérents, leur disaient : « Pourquoi le syndicat se mêle de ces histoires-là ? Il n’a pas à faire de politique ».
Comment refaire du travail un enjeu démocratique ?
Thomas Coutrot : Ni le patronat ni les dirigeants de la fonction publique ne souhaitent mettre le travail en débat. Une politique du travail tournée vers la libération de la parole des salariés, et de l’organisation de cette parole, devrait être mise à l’ordre du jour des politiques de gauche. Malheureusement, les partis politiques n’ont jusqu’à présent guère de réflexion sérieuse sur ces questions. C’est au sein du mouvement syndical que des initiatives intéressantes se lancent.
Par exemple, la CGT, depuis une quinzaine d’années, a mis en chantier une réflexion sur ce qu’elle appelle la démarche revendicative à partir du travail. Elle consiste à recueillir la parole des salariés sur leur travail pour les faire s’exprimer sur ce à quoi ils tiennent, ce qui pourrait changer dans leur travail pour qu’il corresponde à leurs valeurs, qu’il réponde aux vrais besoins de leurs clients ou usagers. Cela implique un véritable changement de pratique militante, mais ça permet de retisser des liens forts et de reconstruire du collectif.
En savoir plus Thomas Coutrot :
Chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales, Thomas Coutrot a dirigé jusqu’en 2022 le département conditions de travail et santé à la Dares. En mars 2024, l’économiste et statisticien a publié une enquête intitulée « Le Bras long du travail, conditions de travail et comportements électoraux ». Il coanime l’association Ateliers et Démocratie.
Le Bras long du travail : conditions de travail et comportements électoraux, par Thomas Coutrot, Document de travail, Ires, numéro 1.2024.
mise en ligne le 21 février 2025
Guerre en Ukraine : face au risque d’un deal Trump-Poutine, Emmanuel Macron cherche à enrôler les partis
Gaël De Santis sur www.humanite.fr
Le président français lance une offensive politique pour préparer les esprits à un réarmement, à l’heure d’un potentiel deal entre Poutine et Trump. Il a reçu ce jeudi les chefs de parti.
Emmanuel Macron en appelle à la mobilisation générale. Le président de la République et le premier ministre ont reçu, ce jeudi à l’Élysée, les douze chefs des partis représentés au Parlement. La réunion s’est ouverte avec une présentation détaillée par les responsables de l’état-major et des services de la menace « existentielle » que représenterait la Russie pour l’Europe sur les plans militaires, hybrides et informationnels. Cette rencontre se tient dans un contexte où le président des États-Unis, Donald Trump, a ouvert des négociations sur l’avenir de l’Ukraine avec son homologue russe Vladimir Poutine, sans les Européens ni les Ukrainiens.
« C’est une lecture un peu biaisée de la géopolitique mondiale », déplore Fabien Roussel. « N’aborder que la Russie met de côté l’autre menace que représente l’administration des États-Unis qui, elle aussi, cherche à déstabiliser l’Europe », en menaçant d’annexer le Groenland danois, en taxant l’acier européen ou en s’ingérant dans les élections allemandes notamment, ajoute le secrétaire national du PCF.
« Il faut une parole forte de la France »
Les responsables de gauche étaient pourtant aussi venus écouter ce que le président avait à dire sur les États-Unis. « Pour la première fois, les Américains ne sont pas avec nous mais jouent par-dessus nos têtes », a confié à son arrivée Olivier Faure, premier secrétaire du PS. « Je souhaite parler des sujets d’ingérence dans la vie politique française devant Louis Aliot, représentant du RN à la cérémonie d’investiture de Trump », avait aussi déclaré Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qui considère le parti lepéniste comme « pro-Trump et pro-Poutine ».
Avant la rencontre, Manuel Bompard, coordinateur de la FI, a appelé à « sortir d’une forme de naïveté » et « de l’idée que les intérêts français nécessitaient un alignement permanent sur les intérêts américains ». « Nous avons été plusieurs à pointer les ambiguïtés de la politique française. Nous avons dit qu’il faut avoir une parole forte de la France, indépendante », rapporte Fabien Roussel, qui estime qu’il faut « parler avec Vladimir Poutine » en vue de parvenir à un « accord de paix et de sécurité ». Cela doit prévoir « le retrait des troupes russes, la neutralité de l’Ukraine et une force d’interposition sous l’égide de l’ONU ».
« Une augmentation des dépenses militaires »
« Le président de la République pointe le danger immense que représente la Russie. Il met en avant la nécessité de se réarmer encore plus fortement pour préparer une économie de guerre accentuée », dénonce Fabien Roussel. Cette rencontre s’inscrit d’ailleurs dans une campagne de l’exécutif pour organiser un réarmement en Europe.
« Le réveil européen passe par une augmentation des dépenses militaires » et cela aura « des conséquences pour nos finances publiques », a expliqué avant la réunion Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Deux réunions de chefs de gouvernement européens ont été organisées en ce sens cette semaine. Un débat au Parlement doit se tenir début mars. De son côté, la presse britannique fait état de discussions entre Paris et Londres sur la création éventuelle d’une force de 30 000 hommes capables de se déployer en Ukraine en cas de cessez-le-feu.
mise en ligne le 21 février 2025
En Allemagne, le parti de gauche Die Linke veut créer la surprise aux législatives
Nils Wilcke sur www.regards.fr
Le parti de gauche enregistre un bond de ses adhésions face à la menace de l’extrême droite, avant les élections dimanche 23 février. Reportage.
Depuis quelques semaines, les dirigeants du parti Die Linke affichent un réel optimisme. Le Parti de gauche allemand connaît un regain de popularité dans les sondages, comme en témoignent les derniers chiffres, qui le créditent de 6 à 9% des voix aux élections législatives anticipées ce dimanche 23 février. Un scrutin qui intervient après la chute du gouvernement Scholz, une coalition « en feu tricolore » entre les sociaux-démocrates du SPD, les Écologistes et les Libéraux du FDP, suite à un vote de défiance du Bundestag, le parlement allemand, le 14 décembre dernier. « Nous avons doublé notre nombre d’adhérents, de 300 à 600 militants au niveau local », se réjouit Vinzenz Glaser, candidat à Fribourg-en-Brisgau, une ville bourgeoise et étudiante, à une heure de route de Strasbourg, dans le Land du Bade-Wurtemberg. Bonnet vissé sur la tête et piercing au nez, ce travailleur social de 32 ans brigue un mandat de député au Bundestag, le Parlement allemand, porté par « la dynamique Die Linke. »
Justice sociale et thèmes du quotidien
Au niveau national, le parti revendique 30 000 adhésions supplémentaires en un an, passant de 52 000 à 82 000 membres, soit son plus haut niveau depuis 15 ans, selon les médias allemands. Ce qui a obligé la direction à chercher des locaux de campagne plus grands au cours des deux dernières semaines pour accueillir un public plus nombreux lors de ses meetings. Mieux encore, un sondage Yougov publié le 18 février a révélé que le parti arrivait en tête parmi les adolescents et les jeunes adultes, avec 20,84% des voix. « Les gens sont enthousiastes et veulent s’engager à nos côtés pour s’occuper des vrais problèmes, comme le plafonnement des loyers et la baisse du coût de la vie », assure M. Glaser à Politis. Nos voisins d’Outre-Rhin sont eux aussi aux prises avec une inflation galopante, dans un parallélisme troublant avec la France avant la révolte des gilets Jaunes en 2018. Or, Die Linke a opportunément orienté sa campagne sur « quelques thèmes du quotidien », comme l’explique notre interlocuteur. Cette stratégie concentrée sur la défense de « la justice sociale » participe à cette dynamique sondagière. Pour donner l’exemple, les dirigeants du parti ont ainsi réduit leur salaire à 2 850 euros, soit le salaire moyen d’un travailleur qualifié en Allemagne. Une mesure « populiste », comme l’affirme en grinçant le reste de la gauche. Peut-être, mais redoutablement efficace pour frapper les esprits.
Mais c’est surtout la mobilisation contre la rupture du cordon sanitaire à l’égard de l’AfD, le parti d’extrême droite allemand, qui a eu le plus d’écho, en particulier chez les jeunes électeurs. Et ce, après l’intervention passionnée d’Heidi Reichinek, jeune députée, tête de liste du parti et candidate à la chancellerie. L’élue de 36 ans maîtrise à la perfection les codes des réseaux sociaux. Capable de rapper son programme en musique, elle compte plus de 420 000 followers sur Instagram et 540 000 abonnés sur Tik Tok. Son vibrant discours devant le Bundestag fin janvier, pour s’opposer à la rupture de la règle du cordon sanitaire anti-AfD par Friedrich Merz, le patron de la CDU/CSU, est devenu viral sur les réseaux sociaux avec plusieurs millions de vues.
« Les vrais antifascistes, c’est nous » Die Linke
Cette séquence a fait d’elle « une quasi pop star », observe auprès de Politis le professeur Uwe Jun, politologue et enseignant en Sciences politiques à l’université de Trèves, en Allemagne. « Il y a eu un avant et un après cette prise de parole », reconnaît Vinzenz Glaser. Die Linke a su capter l’air du temps et surtout, la crainte d’une résurgence du fascisme en Allemagne, après 80 ans de paix. Leur rival conservateur, M. Merz, s’est aliéné les autres partis en draguant ouvertement l’AfD pour faire passer une motion en faveur de la fermeture des frontières, puis une loi contre le regroupement familial, provoquant un sursaut citoyen face à l’extrême droite.
Outre un gain médiatique immédiat, cet épisode a aussi permis à Die Linke de marquer sa différence avec son ancienne leader, la très controversée Sahra Wagenknecht. L’élue a claqué la porte du parti en 2023 pour fonder sa propre formation politique « BSW » sur son nom propre (Bündnis SahraWagenknecht) en entraînant avec elle « de nombreux militants très actifs ». Mais cette dernière, qui se présente elle aussi aux législatives, dévisse dans les enquêtes d’opinion pour avoir prôné une « ligne dure » sur l’immigration, semblant s’aligner sur l’AfDsur ce sujet.
Pour la remplacer, la direction a subi un lifting, avec un tandem paritaire et rajeuni, l’ex-journaliste Ines Schwerdtner et le député Jan Van Haken, un ancien de Greenpeace. « Les vrais antifascistes, c’est nous », martèlent-ils dans la presse, un refrain répété avec aplomb sur le terrain par les autres candidats. Die Linke n’hésite pas non plus à critiquer le bilan des écologistes – die Grüne – et les sociaux-démocrates du SPD qui se sont alliés aux libéraux dans la dernière coalition.
« Les Verts ont déçu pas mal de gens » le candidat Die Linke à Fribourg.
« Ils font des promesses qu’ils ne tiennent pas une fois arrivés au pouvoir », affirme Vinzenz Glaser. Un argumentaire qui ulcère ses rivaux. «Faire du bruit ne suffit pas, il faut aussi assumer les responsabilités pour gouverner », répond sèchement le candidat des Verts à la chancellerie et ancien ministre de l’Economie dans le gouvernement Scholz, Robert Habeck, lors d’un entretien au podcast allemand Table Today ce jeudi 20 février. Rien à faire, les écologistes, usés par trois années au gouvernement, plafonnent à 14% dans les sondages. « Les Verts ont déçu pas mal de gens », observe le candidat Die Linke à Fribourg.
Démonstration à Lahr, dans le district de Fribourg, mardi 18 février, un jour de marché avec Maria. A 20 ans, cette étudiante en économie va voter pour la première fois pour Die Linke ce dimanche alors qu’elle ne se situe pas « fondamentalement à l’extrême gauche. » Ce qui l’a convaincue, c’est la «bataille contre l’extrême droite à mener pour éviter que l’Allemagne ne retombe entre les griffes des « Nazis », explique la jeune femme. Elle trouve les partis de gauche « trop mous » face au danger incarné par l’AfD, qui a fait plus de 20% des voix dans le canton aux dernières élections européennes.
« L’électorat de Die Linke est plutôt jeune et surtout, féminin », confirme le politologue Uwe Jun. Seul bémol selon cet expert, « ce parti a tendance à toucher plutôt l’électorat des grandes métropoles, souvent doté d’une formation universitaire. » Il n’empêche, Die Linke se refuse à « stigmatiser » les électeurs de l’AfD. « Beaucoup d’entre eux sont prêts à se tourner vers l’extrême droite par désespoir ou par provocation », soutient Vinzenz Glaser, qui veut « convaincre les mécontents et les ramener à gauche. » Verdict ce dimanche.
mise en ligne le 16 février 2025
Contre le trumpisme
et ses avatars,
passer à l’offensive
Romaric Godin sur www.mediapart.fr
Le combat contre l’extrême droite en voie de trumpisation ne peut pas s’enfermer dans une simple logique défensive. Comme il y a 80 ans, la résistance au nouvel autoritarisme doit réfléchir aux causes du désastre pour proposer les conditions d’une société démocratique renouvelée.
Le choc est évidemment terrible. Les États-Unis, jusqu’à peu présentés comme l’exemple absolu du lien indéfectible entre démocratie et capitalisme, basculent en ce début d’année 2025 dans un autre monde. Les premiers actes de l’administration Trump trahissent un coup d’État de facto visant à rendre caduque la Constitution des États-Unis.
L’irruption d’un régime à caractère néofasciste dans la principale puissance militaire et économique du monde cause une sidération naturelle et entraîne un réflexe bien compréhensible : celui de tenter de sauvegarder « le monde d’avant » qui, naturellement, paraît plus clément que celui promis par Donald Trump et Elon Musk. On s’efforce donc là-bas de sauvegarder les cadres de l’État de droit et ici, en Europe, de sauvegarder ce même État de droit des griffes des thuriféraires et des fondés de pouvoir du nouveau régime états-unien.
Tout cela est évidemment hautement nécessaire et urgent. Mais ce mouvement de résistance ne doit pas se contenter d’une simple posture défensive ou nostalgique. Il ne doit pas viser le retour à une forme de statu quo ante idéalisé. Pour vaincre le retour de l’hydre autoritaire de façon efficace et durable, il faut analyser les conditions de sa réémergence et proposer une alternative démocratique crédible, c’est-à-dire capable d’éviter la répétition du pire.
La référence ici doit ainsi être la Résistance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en menant la lutte, partout, contre les fascismes allemand, italien et japonais, a mené la réflexion pour construire un monde libéré des conditions d’émergence du fascisme. Et une fois celui-ci vaincu, le combat s’est poursuivi pour construire une société nouvelle.
En France, le Conseil national de la résistance (CNR) a pris acte que la source du péril fasciste était l’abandon des populations face aux crises capitalistes. La lutte antifasciste a donc débouché sur la mise en place d’un État social qui a profondément modifié la société.
On peine aujourd’hui à en prendre conscience, mais la France d’après 1945 est en rupture totale avec celle de l’avant-guerre, qui avait un filet de sécurité sociale parmi les plus réduits d’Occident. Ce changement a été le produit d’une lutte contre les racines de la guerre et du fascisme autant que contre le fascisme lui-même. Et c’est cette démarche qui doit désormais hanter celles et ceux qui entendent s’élever contre la puissance du capitalisme autoritaire contemporain.
Les racines économiques du trumpisme
Pour y parvenir, il faut donc commencer par identifier les racines du coup d’État actuel. Elles se trouvent dans les besoins des secteurs rentiers de l’économie états-unienne et, au premier chef, de celui de la technologie.
C’est, rappelons-le, le produit d’une histoire plus longue, celle d’un ralentissement de l’économie mondiale après la crise de 2008, qu’aucune mesure n’a été capable de conjurer et qui a donné lieu à des méthodes prédatrices dont la conclusion naturelle est la prise de contrôle de l’État états-unien. Incapable de produire de la valeur par les moyens habituels, le capital s’est réfugié dans les secteurs rentiers, où l’on capte la valeur sans passer par les marchés. Mais ces secteurs, pour poursuivre leur accumulation, ont besoin de contrôler la société dans son ensemble, de la soumettre à la pseudo-réalité de leurs algorithmes.
C’est ici que la violence antidémocratique et impériale trumpiste prend sa source.
Les observateurs mainstream qui, jusqu’ici, se complaisaient dans l’apologie d’un capitalisme qu’ils croyaient source de liberté et de démocratie se retrouvent stupéfiés face à l’émergence, pour eux soudaine, d’une « oligarchie », comme l’écrit Serge July dans Libération. Mais il est important de noter combien cette stupeur même est le produit d’une erreur. La position apologétique du capitalisme, validée par le rejet de tout « économicisme », a conduit à un aveuglement sur les forces à l’œuvre depuis un demi-siècle.
Le premier écueil est de croire que le capitalisme néolibéral serait l’antidote à la bascule fascisante d’un Trump.
Ceux qui ont défendu la contre-révolution néolibérale qui, précisément, a cherché à mettre à bas les effets de la lutte antifasciste de l’après-guerre, s’étonnent aujourd’hui de la « contre-révolution » trumpiste, comme le titrait Le Monde du 11 février.
Mais cette rupture est la conséquence logique de la précédente. Puisque le rêve néolibéral d’un marché encadré parfait et efficace a débouché sur le désastre de 2008 et s’est révélé incapable de redresser la productivité et la croissance, les gagnants de ce marché ont pris les choses en main et tentent de construire un monde soumis à leurs intérêts.
Le premier écueil de l’époque est donc de croire que le capitalisme néolibéral serait l’antidote à la bascule fascisante d’un Trump. La tentation peut être réelle d’idéaliser le régime précédent, non seulement parce qu’il était démocratique et moins violent, mais aussi parce qu’on pourrait penser que pour lutter contre les oligarques de la tech, la concurrence et le marché seraient une réponse adaptée. On relancerait donc là le mythe du « capitalisme démocratique », où le fonctionnement d’une économie de marché encadrée serait le socle de la démocratie libérale.
L’ennui, c’est que c’est bel et bien ce « capitalisme démocratique » qui a enfanté de la monstruosité trumpo-muskienne. La sacro-sainte « économie de marché » qui, depuis quarante ans, est parée de toutes les vertus par les intellectuels à la mode est en réalité dans une crise permanente qui ne pouvait déboucher que sur une conclusion autoritaire et monopolistique.
Les marchés « disciplinés »
La concurrence, présentée comme une solution à tous les maux de la société par les néolibéraux, n’est jamais qu’une solution temporaire. Elle débouche inévitablement sur des concentrations, par le jeu même des marchés, et les grands groupes issus de ce phénomène n’ont alors qu’une obsession : préserver leurs positions. Lorsque la croissance est de plus en plus faible, comme aujourd’hui, ils le font par la prise du pouvoir politique et la mise au pas de la société. Lutter contre le trumpisme en réactivant les illusions néolibérales serait dès lors la plus funeste des erreurs.
Ce serait oublier que les populations se sont tournées vers l’extrême droite en grande partie parce que les néolibéraux ont échoué, parce qu’ils n’ont pas tenu leurs promesses d’amélioration des conditions de vie et n’ont pas hésité, lorsque le besoin s’en est fait sentir, à recourir à des méthodes musclées.
La dégradation de la démocratie libérale et sa réduction croissante à une formalité électorale ne sont pas une nouveauté trumpiste.
L’échec néolibéral est le berceau même de la xénophobie et du racisme de l’extrême droite.
Depuis les années 1980, les néolibéraux s’acharnent à réduire le rôle des syndicats, à réduire le rôle du collectif dans le travail, à marchandiser les rapports sociaux, à coloniser les imaginaires à coups d’héroïsation des « entrepreneurs ». Le but de ce mouvement est évidemment de contrôler les votes pour éviter toute remise en cause de l’ordre social.
Et si cela ne suffisait pas, les néolibéraux n’ont pas hésité à verrouiller la démocratie en inscrivant dans le droit constitutionnel ou dans les traités internationaux les fondements de leur doctrine. En cas de besoin, la « discipline de marché » venait frapper les sociétés, à l’image de ce qui s’est produit en Grèce depuis 2010. Et, pour finir, le régime néolibéral n’hésitait pas à avoir recours à la répression. Des mineurs britanniques aux « gilets jaunes », la matraque a souvent eu le dernier mot face à la contestation.
Cette politique, par ailleurs inefficace, a pavé la voie à l’horreur trumpiste comme précédemment à la dictature de Vladimir Poutine en Russie, et comme elle a affaibli les démocraties européennes face aux extrêmes droites. Elle a préparé les esprits à la violence, au déni de démocratie, aux situations d’exception, en un mot à la soumission de la société aux intérêts du capital. Logiquement, lorsque l’extrême droite propose une politique sur mesure pour les ploutocrates, une grande partie de la population ne s’en émeut guère.
Enfin, l’échec néolibéral est le berceau même de la xénophobie et du racisme de l’extrême droite. Pour deux raisons. D’abord, parce que, depuis 2008, en voulant se maintenir au pouvoir, les partis néolibéraux n’ont pas hésité à se saisir du thème de l’immigration et à l’instrumentaliser.
Le cas d’Emmanuel Macron qui, par ailleurs, aime à se présenter comme un « anti-Trump », est éloquent. Depuis 2017, le président français joue avec les thèmes de l’extrême droite, jusqu’à la fameuse loi immigration de fin 2023, avec pour seul résultat de faire de cette même extrême droite la première force du pays.
Ensuite, parce qu’en échouant à faire rebondir productivité et croissance, les néolibéraux ont construit une économie de « jeu à somme nulle » où les enjeux de redistribution sont désormais des enjeux de concurrence au sein même de la société. Pour obtenir plus, les groupes sociaux doivent prétendre « prendre » aux autres. Et comme les néolibéraux refusent toute redistribution du haut vers le bas et ont, pour ce faire, détruit tout sentiment de classe sociale, ce sont logiquement les appartenances ethniques ou raciales qui ont repris le dessus. Et ceux qui proposent une redistribution sur ces bases, ce sont les partis d’extrême droite.
On conçoit alors la folie que représenterait une résistance au trumpisme qui chercherait à préserver les conditions de l’émergence de cet autoritarisme ploutocratique. Sa seule ambition serait de gagner un peu de temps avant que l’inévitable bascule se produise à nouveau. C’est pourtant le cœur de la politique défensive qui est menée dans les pays occidentaux depuis des années : « faire barrage » à l’extrême droite sans chercher à s’attaquer aux sources de son succès, et attendre la prochaine échéance avec angoisse. Chacun semble se retrouver dans la peau de la du Barry réclamant, avant son exécution : « Encore un instant, monsieur le bourreau. » C’est de cette funeste logique qu’il faut sortir.
La démocratie comme antidote
Pour sortir de cette ornière, il faut prendre conscience que le cœur du problème est dans l’évolution récente du capitalisme. Progressivement, le capitalisme démocratique s’est vidé de son sens. La démocratie est devenue un obstacle à l’accumulation du capital. Et cela n’est pas seulement vrai pour les géants de la tech, mais aussi pour le reste du capitalisme, qui entend imposer des politiques qu’il juge nécessaires, quoi qu’il arrive.
Aucun secteur du capital ne viendra au secours de la démocratie. Ceux qui dépendent des aides publiques pour maintenir leur taux de profit entendent imposer une austérité sur les dépenses sociales et les salaires, sans se soucier d’aucune validation populaire. C’est ce que le débat budgétaire français a clairement montré récemment.
Dès lors, la tâche de la résistance est, comme voici quatre-vingts ans, de proposer les conditions nouvelles d’existence de la démocratie. En 1945, il était devenu évident que la démocratie ne pouvait pas subsister sans une forme d’État social agissant comme une protection pour les citoyens et citoyennes. L’enjeu aujourd’hui est de comprendre quelles sont les conditions sociales capables de soutenir une démocratie réelle.
Il est indispensable de redéfinir les besoins des individus au regard non plus des besoins de l’accumulation, mais des besoins sociaux et environnementaux.
Car ce que le trumpisme, comme le melonisme, nous apprend, c’est bien ceci : la forme démocratique réduite au vote n’est pas la démocratie réelle. Celle-ci doit pouvoir s’appuyer sur une société civile forte elle-même fondée sur la diversité, le respect des minorités, des débats de fond, une liberté individuelle consciente de ses limites sociales et environnementales. Autrement dit, les conditions sociales de production du vote sont plus importantes que le vote lui-même.
On peut continuer à croire que démocratie et capitalisme sont indissociables en s’appuyant sur un capitalisme régulé et encadré. Mais dans le capitalisme actuel, de telles régulations ressemblent à des leurres. La course à l’accumulation risque d’emporter ces barrières avec ce qu’il reste de démocratie.
Réduire la puissance des plus riches est une nécessité, mais est-elle suffisante pour freiner le désastre ? Rien n’est moins sûr, parce que les besoins du capital resteront centraux dans la société. Si le Conseil national de la Résistance (CNR) peut être un modèle de méthode, il faut toujours avoir à l’esprit que les conditions de réalisation de son projet régulateur ne sont pas celles d’aujourd’hui. Le moment historique actuel demande sans doute un pas plus ambitieux.
Si le capitalisme est la source du trumpisme et de ses avatars d’extrême droite, alors le combat de la résistance doit porter sur une redéfinition de la démocratie libérée de la logique d’accumulation.
Cela signifie que les conditions de création des opinions doivent être libérées des exigences du capital. Pour y parvenir, il est indispensable de redéfinir les besoins des individus au regard non plus des besoins de l’accumulation, mais des besoins sociaux et environnementaux. Et les conditions de cette redéfinition résident dans l’élargissement de la démocratie elle-même, notamment aux sphères de la production et de la consommation. Ce sont les conditions de l’émergence d’une conscience dont l’absence conduit le monde au désastre.
Face à la « liberté d’expression » brandie par l’extrême droite, qui n’est que la liberté de se soumettre aux ordres du capital et de leurs algorithmes, la résistance nouvelle doit proposer une liberté plus authentique, qui se réalise dans une solidarité renouvelée et une conscience des limites planétaires et sociales. C’est à cette condition que la démocratie pourra à nouveau avoir un sens.
Tout cela peut et doit faire l’objet de discussions. Le CNR est aussi le produit d’un débat intense dans la Résistance. Mais ce qu’il faut conserver à l’esprit, c’est que, s’il est normal et légitime, en cette période sombre, de chercher à sauver ce qui peut l’être, ce n’est qu’une partie de la tâche de la résistance nouvelle. Cette tâche défensive ne doit faire oublier l’autre, essentielle, celle de se projeter vers l’avenir. Pour passer, enfin, à l’offensive.
mise en ligne le 15 février 2025
Appel de syndicalistes
pour un sursaut unitaire
à gauchE
sur www.humanite.fr
Tribune - Appel de syndicalistes pour la justice sociale, écologique et démocratique. Le sursaut unitaire est possible, construisons-le ensemble !
Syndicalistes, actifs et retraités, engagés en défense du monde du travail, en lutte pour la justice sociale, pour l’égalité femmes-hommes, pour les services publics, en solidarité avec les travailleurs immigrés, pour des politiques respectueuses de l’environnement… nous sommes en colère.
Nous sommes en colère d’avoir vu le Président de la République bafouer le résultat des législatives, tourner le dos au front républicain qui avait barré la route à l’extrême droite, ignorer l’arrivée en tête du Nouveau Front populaire (NFP), pour lui préférer, avec M. Barnier et son gouvernement, puis avec celui de M. Bayrou, un front antirépublicain chargé de poursuivre, sous la surveillance du Rassemblement national (RN), la même politique néolibérale de régression sociale et d’injustice fiscale répondant aux intérêts du patronat et de la finance, d’absence de politique industrielle ambitieuse, d’ignorance de l’urgence écologique et de stigmatisation des immigrés.
Nous sommes en colère d’avoir vu le RN dicter ses injonctions au gouvernement et consolider ses possibilités de conquête du pouvoir. Ses idées réactionnaires et racistes sont reprises par la droite au pouvoir, elles occupent les médias, les classes dirigeantes se font petit à petit à son arrivée aux affaires et la purge sociale que promeuvent la droite et les macronistes ne peut que lui profiter.
Nous sommes aussi en colère et inquiets devant le spectacle donné par le NFP, miné par des forces centrifuges, incapable de prendre des initiatives collectives et d’engager un dialogue avec les mouvements sociaux pour se nourrir de leurs réflexions et exigences, pour incarner une alternative crédible. Certes, au parlement, ses député.es ont agi ensemble dans le débat budgétaire. Certes au niveau local, les initiatives existent pour essayer de faire vivre l’unité. Mais cela ne suffit pas à relancer la dynamique populaire qui permettrait au NFP d’élargir son assise pour l’emporter.
Dans ce contexte inquiétant, l’unité syndicale, son renforcement et son approfondissement, sont essentiels pour faire entendre des exigences fortes dans le débat public. Au-delà, le dialogue à rétablir et la convergence d’exigences partagées entre partis, associations, syndicats et simples citoyen.es aspirant à une logique transformatrice doit permettre, dans le respect de l’indépendance des fonctions et de l’égalité des responsabilités, de créer une nouvelle dynamique dans la société. Certes les réticences des mouvements sociaux à s’engager dans une telle démarche sont compréhensibles tant pèse lourd l’instrumentalisation dont ils ont été l’objet dans le passé. Mais, face à l’extrême droite aux portes du pouvoir, rester sur son quant-à-soi risque de se payer très cher pour tous et toutes.
Dans le contexte actuel, une condition pour gagner la majorité est d’affirmer la nécessité d’une rupture avec les politiques néolibérales menées depuis des décennies. Mais cela ne suffit pas. Aux paniques identitaires dont se nourrit le RN pour proposer des réponses réactionnaires et racistes, nous devons opposer la perspective d’une société désirable fondée sur l’égalité pour toutes et tous, la justice sociale et environnementale, le dépassement des fractures territoriales, le renouveau des services publics, la sécurité dans tous ses aspects, la solidarité et la démocratie. Bref un nouvel imaginaire émancipateur auquel le mouvement social peut contribuer.
Enfin pour que les partis de la gauche et de l’écologie politique aient une chance de l’emporter électoralement, il faut évidemment qu’ils restent unis, ce qui suppose en particulier de se doter d’une candidature unique, désignée en commun pour la prochaine élection présidentielle. Mais cette unité des partis, pour indispensable qu’elle soit, ne suffit pas. Pour gagner il faut être capable de rassembler au-delà et de créer une dynamique populaire unitaire
C’est pourquoi, avant qu’il ne soit trop tard, nous appelons l’ensemble des citoyennes et citoyens, organisations et partis qui se reconnaissent dans les valeurs sociales, écologiques et démocratiques, à s’engager ensemble dans ce combat pour reprendre la main sur notre destin collectif. Nous appelons les militants syndicaux, associatifs et citoyens engagés à renforcer les collectifs unitaires sur le terrain, à les multiplier et à les coordonner dans les départements et les régions, à réfléchir à de grands meetings régionaux avec des personnalités unitaires, à participer et à s’associer aux différents appels et initiatives portant la même exigence d’unité, à intensifier les rencontres avec la population afin de construire avec elle les exigences qui serviront de base à la constitution d’une alternative.
Si rien n’est encore joué, le temps presse. Le sursaut unitaire est possible. Construisons-le ensemble !
Pour signer : https://framaforms.org/appel-de-syndicalistes-pour-un-sursaut-unitaire-a-gauche-1738060906
Les premiers signataires :
Gérard ASCHIERI, éducation, ancien responsable national – Claude DEBONS, transports, ancien responsable national – Pierre KHALFA, télécoms, ancien responsable national et membre du CESE – Bernard THIBAULT, cheminot, ancien responsable confédéral – Patrick ACKERMANN, Télécoms Idf, ancien responsable national – Alain ALPHON-LAIR, secteur santé 30 – Verveine ANGELI, Télécoms IdF, ancienne responsable nationale – Michel ANGOT, FP territoriale 94, ancien responsable départemental – Nathalie ARGENSON, militante secteur santé 30 – Handy BARRE, magasinier cariste, responsable syndical Rouen 76 – Jean-Paul BEAUQUIER, militant éducation 13 – Jacques BENNETOT, militant syndicaliste paysan 76 – Eric BEYNEL, libraire, ancien responsable national secteur douanes – Walid BEYK, cheminot retraité 26 – Gérard BILLON, secteur construction, 92 Malakoff, ancien responsable national
mise en ligne le 10 février 2025
Pour le mathématicien Cédric Villani, « l’IA est au mieux une difficulté supplémentaire, au pire une catastrophe »
Stéphane Guérard sur www.humanite.fr
Dès 2018, le mathématicien Cédric Villani plaidait pour que les questions autour de l’intelligence artificielle sortent des cénacles des spécialistes pour irriguer le débat démocratique. Il espère que le sommet mondial de Paris, qui s’ouvre lundi, joue ce rôle.
Le lauréat 2010 de la médaille Fields posait déjà en 2018 la question de « donner un sens à l’intelligence artificielle » dans un rapport parlementaire. Sept ans plus tard, l’état des rapports de force internationaux le rend sceptique sur l’évolution des technologies numériques.
L’intelligence artificielle peut-elle être un outil de progrès ?
Cédric Villani : Il y a deux façons très différentes de répondre. Soit vous l’abordez du point de vue intellectuel, universitaire et c’est un sujet absolument fascinant. Il s’agit d’une aventure scientifique parsemée de grands esprits, depuis Alan Turing. La question de l’adaptation des usages rend encore plus passionnant le débat autour des métiers, de notre perception et de notre représentation du monde en fonction des moyens de communication.
Même les plus réticents à l’IA ressortent de ces débats intellectuels en se disant que tout ceci est passionnant. Mais si l’on pose la question du progrès que l’on peut tirer à partir des usages de l’IA, il est impossible d’avoir une réponse aussi tranchée. Par rapport à la paix, l’équité et la trajectoire écologiquement viable, les trois questions qui forment les grands critères actuels de progrès, l’intelligence artificielle représente au mieux une difficulté supplémentaire, au pire une catastrophe, au même titre que la bombe nucléaire pouvait constituer à la fois un sujet scientifique et intellectuel passionnant, mais aussi une invitation à la destruction de l’humanité.
Pourquoi tant de scepticisme ?
Cédric Villani : On ne peut pas dire que les questions que pose l’IA se résolvent par la réponse « tout dépend de ce que nous allons en faire ». Si l’on prend en compte les rapports de force actuels, son utilisation accroît nos difficultés. L’IA apporte une nouvelle façon de faire la guerre, génère de nouvelles rivalités sur le contrôle de l’information comme de nouvelles tensions géopolitiques pour le contrôle des ressources.
En tant que telle, elle ne m’empêche pas de dormir. En revanche, les tensions mondiales entravent nos efforts en faveur du désarmement et de la solidarité internationale. Mais pour toutes les forces de progrès, ne pas user de ces outils revient à laisser les armes aux adversaires.
Les cas d’usages d’IA qui concourent à une société plus juste sont légion, des travaux du Giec aux économies d’énergie, au recyclage comme à la préservation des écosystèmes… Par ailleurs, le modèle du logiciel libre mène la compétition avec le modèle de l’IA fermée. Ce n’est pas pour rien qu’Elon Musk s’en prend à Wikipédia. Mais tous ces cas d’usage de progrès représentent peu en proportion des cas d’usage nocifs.
À quoi sert ce sommet mondial de l’IA à Paris ?
Cédric Villani : Le buzz alimenté par ce sommet permet d’attirer l’attention sur les vrais problèmes. Parler d’IA, c’est parler des déchets numériques dont on sous-traite la destruction à des travailleurs ghanéens sous-payés. Parler d’IA, c’est rappeler les injustices fondamentales entre les femmes et les hommes. Pourquoi n’y a-t-il pas suffisamment de femmes dans les mathématiques, les écoles d’ingénieurs et d’informatique ?
C’est aussi parler de recherche : pourquoi laisse-t-on piller notre force de formation par les universités américaines ? Et puisqu’il est actuellement question de rapports de puissance entre les États-Unis et la Chine, parler d’IA, c’est parler taille et forces. Nous concernant, la réponse doit être l’Europe, du fait de son marché et des moyens qu’elle peut mobiliser. En 2022, l’irruption de ChatGPT avait tout changé médiatiquement et permis que tous ces sujets jusque-là traités entre experts parviennent au grand public. Ce sommet de Paris nous en donne une nouvelle occasion.
En matière d’intelligence artificielle, où en est la France ?
Cédric Villani : La France a des atouts réels. Historiquement, elle possède avec l’Allemagne, la Russie et, maintenant, les États-Unis l’une des plus grandes communautés de mathématiciens. Elle reste un grand pays d’algorithme et une référence pour la qualité de ses programmeurs.
Nous n’avons pas rempli tous les objectifs de notre feuille de route numérique, mais nous nous sommes dotés d’une infrastructure de calcul qui permet à nos chercheurs de travailler en France et de ne plus aller voir les Gafam. Mais il est dérisoire voire puéril de proclamer, comme nous l’entendons à l’occasion de ce sommet, que la France va faire faire un pas de géant à elle toute seule. Il est d’ailleurs symptomatique de voir l’Europe si peu associée à l’événement.
L’Union européenne s’est pourtant dotée d’un ensemble réglementaire cohérent et ambitieux qui fait qu’elle est la plus protégée. Notre défi, c’est la production de hardware (matériel, puces) comme de software (logiciels, programmes), qui demande une politique coordonnée de soutien en faveur de la recherche, de l’enseignement supérieur, des programmes communs de données. Mais au vu des coupes dans les budgets, la France ne va pas dans la bonne direction. La politique européenne est aussi décevante. Pour le numérique comme pour l’écologie, on constate un recul des ambitions.
Comment remettre de l’humain dans l’intelligence artificielle
Stéphane Guérard, Pauline Achard , Samuel Gleyze-Esteban et Alexandra Chaignon sur www.humanite.fr
Paris accueille le Sommet pour l’action sur l’IA lundi 10 février. Emmanuel Macron promet des annonces pour renforcer la compétitivité de la France. Syndicats, partis, scientifiques et ONG revendiquent de redonner du sens à cette révolution technologique.
Remettre la France en majesté, et lui par ricochet. Accro aux événements en mondovision, Emmanuel Macron a proposé l’année dernière de voir Paris succéder à Bletchley (Royaume-Uni) et Séoul (Corée du Sud) pour accueillir le regroupement international des experts en intelligence artificielle (IA). Mais à la sauce tricolore.
Fini les symposiums de spécialistes de la spécialité devisant uniquement de cybersécurité. Après deux « journées scientifiques » puis un « week-end culturel », le Sommet pour l’action sur l’IA s’ouvre ce lundi 10 février. Dans une redite des réceptions annuelles Choose France à Versailles, le président de la République a invité tout ce que le numérique compte d’oligarques et de grands argentiers à s’exprimer sous la verrière du Grand Palais. Puis à annoncer au cours d’un « business day » à la Station F de Xavier Niel une pluie d’investissements dans l’Hexagone. Les implantations de data centers ont déjà la cote auprès des Émirats arables unis (30 à 50 milliards d’euros) et du fonds canadien Brookfield (20 milliards).
Mais la vocation de l’événement n’est pas que commercial. Dès avant son intervention au 20 heures dimanche 9 février, Emmanuel Macron avait lancé dans la presse française : « Est-ce que l’on est prêt à se battre pour être pleinement autonomes, indépendants, ou est-ce qu’on laisse la compétition se réduire à une bataille entre les États-Unis d’Amérique et la Chine ? » Chiche, lui ont répondu des scientifiques, ONG, syndicats et partis de gauche qui appellent à faire des IA un bien commun et à remettre leurs usages dans le sens de l’intérêt général. Pour cela, cinq conditions doivent être réunies.
De la démocratie dans les rouages
Face aux géants états-uniens ou chinois qui, pour l’heure, monopolisent les grandes avancées, de ChatGPT à DeepSeek, comme les annonces de centaines de milliards de dollars d’investissements, Emmanuel Macron plaide pour « plus de patriotisme économique et européen » et pour « aller à fond ». Oublié le temps des régulations.
Il faut multiplier comme des pains les centres de données nécessaires à l’entraînement des IA ou les supercalculateurs, dont la présidente de la Commission européenne doit communiquer un plan de déploiement.
En ces temps d’austérité, ouvrons les vannes des subventions. La BPI projette de débloquer 10 milliards d’euros d’ici à 2029. Tout cela devant conduire au déploiement de ces outils numériques dans les entreprises comme dans les services publics. « Il s’agit pour la France de se doter d’avantages comparatifs en se positionnant sur quelques briques technologiques et quelques maillons de la chaîne de valeur », résume le rapport de la commission IA 2024.
L’accaparement des richesses
La France courant derrière son retard de « compétitivité », comme un coq sans tête ? C’est ce que craint une coalition d’associations, syndicats et collectifs français. Dans son manifeste « Hiatus », publié le 6 février, elle constate que « tout concourt à ériger le déploiement massif de l’intelligence artificielle en priorité politique », alors que cette généralisation sert l’accaparement des richesses par quelques-uns et asservit aussi bien les pays du Sud que les services publics, entre autres griefs.
« La prolifération de l’IA a beau être présentée comme inéluctable, nous ne voulons pas nous résigner. (…) Nous exigeons une maîtrise démocratique de cette technologie et une limitation drastique de ses usages, afin de faire primer les droits humains, sociaux et environnementaux », conclut le texte.
Une forme de gouvernance mondiale de l’IA est aussi demandée dans d’autres appels, pour éviter une « perte de contrôle » par les humains. Il y a deux ans à peine, Elon Musk et des centaines d’experts réclamaient déjà une pause après la mise en ligne de ChatGPT pour évaluer les conséquences de cette révolution…
Des IA pour les travailleurs, pas contre
L’intelligence artificielle, un outil d’émancipation des travailleurs ? Demandez aux « petites mains » de l’IA, à Madagascar ou au Kenya, payées moins de deux dollars l’heure pour entraîner ces algorithmes survitaminés. Pour ces ouvriers du numérique, la grève est la seule arme pour tenter d’améliorer leur quotidien.
Et le recours en justice. Pour avoir viré des modérateurs de contenu qui s’étaient révoltés contre leur exploitation et la « torture psychologique » qu’ils enduraient, Facebook a été condamnée en 2023. Depuis, la société de Mark Zuckerberg a tranché… en mettant fin à la modération.
En France, les relations de subordination sont certes bien moins violentes. Il n’en reste pas moins que les syndicats revendiquent, eux aussi, des garde-fous. Car côté employeurs, les motivations pour généraliser ces outils numériques relèvent de l’amélioration de la productivité et la réduction des coûts de main-d’œuvre (selon l’enquête « Usages et impact de l’IA sur le travail » publiée par le ministère du Travail).
Les organisations de salariés appellent donc leurs homologues patronales à ouvrir les négociations dans les entreprises et les branches. « Le plus souvent, les directions ne négocient tout simplement pas l’implantation de ces technologies dans leur entreprise, arguant que c’est trop compliqué, pointe Charles Parmentier (CFDT). Beaucoup de salariés ne savent même pas qu’ils travaillent avec. »
Du numérique glouton à un usage frugal
Développement de l’IA et transition écologique font très mauvais ménage. Une simple question posée à ChatGPT consomme un demi-litre d’eau, selon une étude de l’université de Riverside, en Californie, publiée en novembre, et dix fois plus d’énergie qu’une recherche classique sur Internet. Car il faut bien refroidir les centres de données, en surchauffe face à la multiplication des requêtes. L’électricité consommée par ces sites devrait doubler dans le monde d’ici à 2026 et représenter celle réunie de la France et l’Allemagne, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Dans l’Hexagone, le nucléaire limite le bilan (en 2022, les générateurs des centres de données ont tout de même consommé 1 159 mètres cubes de fioul et 21 930 tonnes de batteries). Les Gafam parient aussi sur l’atome : Microsoft remet en état une centrale états-unienne et Amazon mise sur des petits réacteurs modulaires. Mais en Chine, les infrastructures du numérique tournent à 75 % au charbon ou au gaz, de même qu’aux États-Unis ou dans les pays du Golfe, biberonnés aux hydrocarbures. Or, l’AIE alerte déjà : les nouvelles capacités des énergies renouvelables ne suffiront pas à suivre la cadence.
L’IA n’est donc pas soutenable sans adaptations majeures. Des chercheurs développent cependant de nouvelles architectures de puces électroniques qui permettraient de limiter la gloutonnerie. En France, l’IA dite « frugale » figure ainsi parmi les axes du second volet de la stratégie nationale sur le sujet. Outre son efficience, elle comprend une minimisation des données ou l’optimisation des algorithmes.
Surveillance généralisée… des atteintes aux droits humains
Le développement du recours des IA de surveillance montre déjà l’impact délétère que cette technologie peut avoir sur les libertés et les droits fondamentaux. Comme le souligne Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté au sein d’Amnesty International France, « les personnes racialisées, les personnes vulnérables, les personnes en déplacement sont davantage exposées à ces technologies qui accentuent des discriminations existantes ».
Pourtant, les systèmes d’intelligence artificielle ont le potentiel de renforcer la protection des droits humains. Pour rester dans le contexte migratoire, les innovations technologiques « pourraient potentiellement assurer un transit sûr et des procédures aux frontières plus ordonnées », avance ainsi Ana Piquer, directrice du programme Amériques d’Amnesty International.
Dans un avis paru en amont de l’adoption de la proposition de règlement de l’Union européenne sur le sujet, la Cour européenne des droits de l’homme invitait les pouvoirs publics à promouvoir « un encadrement juridique ambitieux », recommandant d’interdire certains usages de l’IA jugés « trop attentatoires aux droits fondamentaux » (comme l’identification biométrique). Amnesty ne dit pas autre chose, appelant à « conditionner tout effort de réglementation à des priorités en matière de droits humains », et non par des objectifs d’harmonisation du marché ou de compétitivité. En prenant notamment en compte « les préjudices croisés » (par exemple à la fois liés au sexe, à l’origine ethnique, au statut migratoire et à l’appartenance religieuse). Et en donnant des moyens d’agir aux personnes concernées.
De nouveaux droits pour les créateurs
Pour les auteurs, musiciens, artistes visuels, comédiens, doubleurs et tous les autres métiers de la création, le danger se dessine de plus en plus clairement. Nées dans un vide juridique, les IA génératives menacent de reproduire le travail des artistes plus vite et dans des quantités potentiellement infinies.
À leur création, les modèles d’IA se développent dans un flou juridique, comme c’est le cas en Europe avec la directive sur le droit d’auteur de 2019, qui autorise la reproduction d’œuvres « en vue de la fouille de textes et de données », alors mal définie. Les machines s’entraînent donc sur des jeux de data gigantesques dont une grande partie n’est pas libre de droits, s’asseyant ainsi sur le respect de la propriété intellectuelle.
L’enjeu premier, pour les créateurs, est de pouvoir refuser que leurs œuvres soient utilisées dans l’entraînement des IA. Il est difficile de garantir l’expression de ce droit sur les milliards d’images, de textes ou d’enregistrement sonores déjà aspirés. Mais « la question du retrait se pose pour les futurs contenus susceptibles, demain, d’être reproduits par les modèles d’IA », explique Stéphanie Le Cam, juriste et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Ce droit ne s’envisage en outre pas sans transparence des outils : en 2023, la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) plaidait déjà pour « une obligation d’information sur les œuvres ayant été exploitées ».
Sans attendre les détails de la nébuleuse « concertation nationale sur l’émergence d’un marché éthique respectueux du droit d’auteur », annoncée samedi par la ministre de la Culture Rachida Dati, des développeurs comme Spawning AI proposent en alternative un modèle d’« opt-in », qui pose pour principe le refus de l’utilisation de son œuvre par son créateur, sauf expression contraire. Mais le changement de paradigme induit par l’IA appelle à une redéfinition plus juste du statut de l’artiste, au-delà d’un système de licence permettant une redistribution globale aux créateurs des revenus générés par l’utilisation de l’IA. Ce débat permet de remettre sur le métier le sujet de la continuité des revenus des artistes-auteurs, une revendication partagée par de nombreux collectifs et syndicats
mise en ligne le 8 février 2025
Ce qui manque !
Patrick Le Hyaric sur www.humanite.fr
Le budget imposé par un nouveau 49.3 marque une nouvelle dégradation de la situation des travailleurs et des familles populaires. Face à cette offensive du capital et à la montée de l’extrême-droite, la gauche ne peut pas proposer comme débat essentiel la question de savoir s’il faut attendre 2027 pour déposer un bulletin dans l’urne ou s’il faut voter le plus vite possible. L’histoire montre qu’aucun progrès social et humain n’a été possible sans que les travailleuses et travailleurs ne s’en mêlent dans l’action unitaire. Pour la gauche, l’urgence est donc l’unité, la bataille des idées, des élaborations communes nouvelles et l’aide à l’action populaire.
Jamais, sans doute, une telle artillerie – mêlant ministres, grande presse propriété des oligarques et oligarques eux-mêmes –, en osmose avec la Commission européenne, ne se sera tant mobilisée pour le vote du budget d’austérité de la nation.
Car, c’est de cela qu’il s’agit : l’austérité pour celles et ceux qui n’ont que leur travail ou leurs retraites, ou, pour beaucoup, de maigres prestations sociales, pour vivre. Malheureusement, ce ne sont pas eux, pas elles, pas celles et ceux qui n’ont rien sur leurs comptes en banque au milieu du mois, celles et ceux qui triment dur au travail, placés sous la menace du chantage à l’emploi et aux délocalisations, qui verront leur sort s’améliorer.
Non. Ce budget va encore aggraver leur situation de deux manières qui vont se cumuler.
Moins de services publics, avec le dogme de la réduction des dépenses
Même la prétendue concession sur les 4 000 postes d’enseignants est un immense bluff, car le gouvernement Barnier avait renoncé à cette saignée. Dans le budget, cela fait 50 millions d’euros en apparence restitués, mais le gouvernement Bayrou réduit encore ce budget de 200 millions d’euros sur d’autres chapitres, dont la formation des enseignants.
D’un côté, le pouvoir prétend être revenu sur le déremboursement de plusieurs médicaments, mais, de l’autre, en prélevant un milliard d’euros sur les mutuelles, il fait augmenter les cotisations de celles-ci d’au moins 6 %. On fait semblant de revenir sur le non-paiement des jours de carence des agents publics pour mieux diminuer l’indemnisation de leurs arrêts maladies. Dans ce tour de passe-passe, le Premier ministre fait croire qu’il restitue 200 millions d’euros alors que le moindre remboursement lui fait engranger 800 millions d’euros. On peut ainsi multiplier les exemples.
En y ajoutant la violence du veto de M. Bayrou à la moindre augmentation du SMIC et l’augmentation continue des impôts indirects indexés sur l’augmentation des prix des produits de première nécessité, il est certain que la situation des familles populaires va encore se dégrader.
La seconde raison du caractère négatif du budget tient aux effets pervers qu’il va produire. En effet, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a calculé que la reconduction à l’identique du budget de l’année 2024 aurait permis une croissance d’environ un point, tandis que le remède imposé par la loi de finances 2025 conduira à une croissance négative. En d’autres termes, l’application de la loi spéciale aurait été moins négative que le budget imposé au marteau du 49.3. En effet, en refroidissant l’activité, en réduisant la création de richesses, les recettes fiscales sont diminuées. Une telle politique budgétaire augmente donc la dette financière tout en augmentant la dette écologique faute d’investissements dans la bifurcation environnementale.
La réduction de la création de richesses répondant aux besoins sociaux et écologiques est trop sous-estimée comme cause de la mauvaise situation financière du pays et de L’Europe.
Or, d’immenses chantiers devraient être ouverts pour une réindustrialisation d’un type nouveau, tenant compte des enjeux environnementaux et des besoins humains, des nécessités d’une bifurcation agro écologique permettant l’installation de centaines de milliers de jeunes paysans et l’amélioration de la santé. Une autre manière de produire et de consommer, assortie d’un ambitieux programme public européen de développement du numérique.
Seulement, quand le budget coupe les moyens pour la recherche de plus d’un milliard d’euros, le pouvoir sacrifie l’avenir. C’est bien cette création de richesses nouvelles et l’assurance pour chacune et chacun d’avoir un travail – non aliénant –, ainsi que la fin des cadeaux fiscaux et sociaux indus aux grandes entreprises qui permettraient d’améliorer les budgets de l’État et de la Sécurité sociale.
Tout l’argumentaire de la grande bourgeoisie, contre les dépenses publiques et le « coût du travail » vise plus que jamais à détruire l’État social, les services publics et la sécurité sociale. Autrement dit, des conquis typiquement communistes (au sens originel du projet) qui entravent aujourd’hui la liberté totale d’accumulation du capital. Faire croire aux salariés que la baisse de leurs cotisations sociales améliorerait leur salaire vise avant tout à diminuer la part de richesses consacrées au bien commun pour augmenter les profits et à ouvrir du même coup la voie à une protection sociale financée par la capitalisation avec des assurances privées qui se gaveraient encore plus. Ajoutons que la bataille contre les impôts de production (ou sur le capital) cache la volonté d’augmenter à terme la TVA.
Une grande campagne d’explication et d’aide à l’action
La lutte des classes que mène le grand capital nourrie d’une violente et permanente guerre idéologique sur ces enjeux doit être partout révélée, décortiquée, combattue avec constance.
Les organisations syndicales, les associations comme ATTAC, la Fondation Copernic, Oxfam, les journaux progressistes, les partis de gauche et écologistes, composant ensemble le Nouveau Front populaire (NFP), devraient lancer une contre-offensive, une grande campagne d’explication et d’aide à l’action pour que les travailleuses et les travailleurs, les citoyens dans la diversité de leurs sensibilités progressistes puissent intervenir, agir pour obtenir de réelles améliorations.
Les conciliabules avec les ministres qui n’ont d’autres soucis que de vendre leur vinaigre dans une bouteille portant la fausse étiquette de miel n’aboutissent qu’à désarmer le mouvement populaire qui a réclamé l’unité et qui attend des parlementaires du NFP qu’elles et ils votent, ensemble, sur la base du programme sur lequel elles et ils ont été élus. Le puissant mouvement de masse qui s’est levé pour barrer la route de Matignon à l’extrême droite au mois de juillet répondrait à l’appel s’il était aidé pour intervenir sur les débats qui ont lieu au Parlement.
Voilà ce qui manque ! Créer les conditions pour que les citoyennes et citoyens puissent intervenir, et exercer pleinement leur souveraineté sur leur vie et leur avenir. Une telle démarche pose forcément la question de la nature de l’apport des partis et autres forces du NFP pour aider à faire vivre un mouvement populaire conscient, déterminé pour la victoire.
Quand les chefs de file du grand capital français se mobilisent à ce point, la gauche ne peut pas proposer comme débat essentiel la question de savoir s’il faut attendre 2027 pour déposer un bulletin dans l’urne ou s’il faut voter le plus vite possible. Procéder ainsi, c’est désarmer le mouvement en étalant des divisions et en tombant dans le piège de la Ve République qu’on prétend combattre, en faisant de l’élection présidentielle le moment cardinal. Or, aucun progrès social et humain n’a été possible sans que les travailleuses et travailleurs ne s’en mêlent dans l’action unitaire. C’est une leçon fondamentale des acquis obtenus lors du Front populaire de 1936. A contrario, c’est l’enseignement de ce qui a manqué le plus en 1981 et a permis à la composante principale de la gauche d’enfiler les habits du libéralisme. C’est là que la sève de l’extrême droite a monté sans discontinuer.
La question n’est donc pas l’élection présidentielle mais l’aide au déploiement d’un mouvement populaire et politique si puissant qu’il devienne irrésistible.
De même, aucun parti ne devrait aborder les élections municipales avec le souci de « prendre » comme il se dit, la gestion de villes et de villages là où il y a déjà un maire de l’une des forces issues du nouveau Front populaire. Le souci devrait être double : dans l’unité, gagner sur la droite et l’extrême droite et, avec les citoyens, construire un municipalisme progressiste bouclier contre le grand capital et fer de lance d’un nouveau rapport de force pour les classes laborieuses et la jeunesse.
Si la majorité de celles et ceux qui aspirent à mieux vivre se sent impuissante, non écoutée par les forces de gauche et écologique, le risque de l’élargissement du chemin de l’Élysée pour l’extrême droite est plus important que jamais. Il l’est d’autant plus que les forces qui sont au pouvoir et le grand capital banalisent les nauséabondes et insupportables idées de l’extrême droite et les reprennent à leur compte.
Une large partie des puissances d’argent font mine de s’émouvoir des choix nationaux capitalistes et autoritaires de Trump pour nous exhorter à franchir un nouveau cap dans des politiques de dérégulation tous azimuts. Autrement dit, dans certains milieux, pour l’instant, la critique de Trump sert aux glissements permettant de mettre en œuvre sa politique au nom du combat contre le nouveau roi de l’imperium.
Nous aurions tort de sous-estimer les effets délétères de cette campagne idéologique sur celles et ceux qui souffrent déjà des coups de canif portés contre l’État social et contre les régulations destinées à sauvegarder l’environnement et la nature.
Dans cette bataille, il nous faut rendre coup pour coup et animer le combat de classe avec tous les moyens d’information et de partage dont nous disposons.
Dans leurs diversités, les forces du Nouveau Front Populaire ont la capacité de mener cette bataille politique, culturelle et idéologique. Face aux multiples dangers, face à la volonté de noyer le mouvement populaire dans les larmes des désillusions et des désespérances, il devient urgent de combler ensemble les manques : l’unité, la bataille des idées, des élaborations communes nouvelles et l’aide à l’action populaire.
Ne voit-on pas les nuées de cet orage qui menace ?
mise en ligne le 7 février 2025
Gauches : laisser le vote de la censure nous diviser serait une erreur fatale
Les députés du groupe Ecologiste et Social sur https://blogs.mediapart.fr/
Nous alertons avec gravité : le risque est grand de voir se dessiner comme solution l’autoritarisme et le rejet grandissant de la démocratie. Dans ce contexte, l’union des forces de la gauche et de l’écologie est impérieuse : les désaccords stratégiques ne sauraient se transformer en détestation. Nous refusons de faire du vote sur la censure celui qui définit les contours du Nouveau Front Populaire, alors que nous connaissons un point de bascule historique. Par le groupe écologiste et social.
L’inquiétude liée à un monde fragile, incertain et violent est celle de beaucoup de nos concitoyens. Dans ce contexte, nous savons que le vote d’une motion de censure n’est ni simple, ni banal. Nous ne faisons donc pas de cet acte parlementaire un mode d’opposition anodin. Nous choisissons d’en expliquer ici les raisons avec clarté, transparence et, toujours, un esprit constructif.
Le réchauffement planétaire et la conquête du pouvoir par les néofascistes sont les deux grandes menaces qu’affrontent nos générations. Tandis que la géopolitique nous rattrape, la situation intérieure se dégrade fortement : Mayotte et l’Ille-et-Vilaine n’échappent pas aux calamités provoquées par notre modèle de développement, le chômage augmente, les licenciements industriels reprennent, les collectivités locales s’appauvrissent, les services publics les plus essentiels – l’école et les hôpitaux – se dégradent.
En responsabilité le groupe Écologiste et Social a participé pendant plusieurs jours aux discussions avec le gouvernement. Nous avons plaidé pour des compromis autour d’un budget qui mette à contribution les plus riches, donne à la France les moyens de la transition écologique, défende les collectivités locales et suspende sans délai la réforme inique des retraites à 64 ans, que nous n’acceptons toujours pas.
En guise de réponse, coupes brutales dans les services publics, renoncement aux politiques environnementales et recul des droits sociaux. Quelques illustrations des rabots brutaux : division par deux des moyens pour la rénovation des logements, pour l’aide à l’achat de véhicules moins polluants, gel du barème des bourses étudiantes, disparition progressive des emplois aidés, baisses des moyens du pass culture et du pass sport, baisse de près de 40% du budget de l’aide au développement, -929 millions pour la recherche, -800 millions sur les solidarités et l’insertion...
Le cas des auto-entrepreneurs est en cela emblématique. En abaissant le seuil d’exonération de TVA à 25.000€, le budget 2025 met 200 000 micro-entrepreneurs en difficulté. Ceux-ci auront donc le choix entre impacter cette hausse sur le consommateur, ou réduire leur rémunération de peu à rien.
Enfin, le gouvernement a décidé de tourner le dos à celles et ceux qui font vivre nos services publics : professeurs, infirmières, éboueurs, policiers… autant de fonctionnaires qui verront leur salaire réduit lorsqu’ils et elles sont malades.
Ce budget fera prendre du retard à la France car plutôt que d’aller chercher les recettes nouvelles nécessaires, le gouvernement fait le choix de coupes budgétaires qui feront mal au pays, pénaliseront une majorité de français.es et ne permettront pas les investissements d’avenir. Il y a pourtant urgence. Autant de raisons de rejeter le budget, ce qui ne saurait nous être reprochés, a fortiori après avoir joué le jeu de la concertation en transparence. Nous aurions pu uniquement voter contre ce budget, quoi de plus normal pour une opposition en démocratie ?
Mais en choisissant d’user deux fois en une après-midi de l’article 49.3 de la constitution et de priver le Parlement de vote, force est de constater que le gouvernement a brutalement fermé la porte. Pire, en jetant l’immigration et la figure de l’étranger en pâture à la satisfaction des obsessions identitaires de l’extrême-droite, François Bayrou, issu d’une longue tradition démocrate-chrétienne, foule aux pieds le sursaut républicain du 7 juillet ; en contribuant aux attaques répétées contre l’ADEME, l’office français de la biodiversité ou l’ANSES, le gouvernement emboite le pas au climato-scepticisme du Rassemblement national.
Les impasses choisies par l’exécutif - qui figent le pays dans l’impuissance - continueront à nourrir l’image dégradée qu’ont les Français des élus et des politiques. Beaucoup s’interrogent : pourquoi voter si rien ne change voire si la violence sociale s’aggrave ?
Nous alertons ici avec gravité : le risque est grand de voir se dessiner comme solution l’autoritarisme et le rejet grandissant de la démocratie, dans un pays déjà malade du présidentialisme, de ses institutions verticales et atrophiées et des conséquences de la violence sociale et de l’inaction climatique des gouvernements successifs.
Dans ce contexte, l’union des forces de la gauche et de l’écologie est impérieuse : les désaccords stratégiques ne sauraient se transformer en détestation au risque de nous entraîner dans des turbulences bien plus graves. L’obsession de l’élection présidentielle, anticipée ou à échéance de 2027, est paralysante. Elle laissera des traces qui viendront ajouter à nos lourdes difficultés à faire face à la progression de l’extrême-droite et ses alliés de plus en plus nombreux à droite, qui est le principal danger auquel tous les démocrates sincères doivent faire face avec force. Surtout, aucune stratégie ne pourra être gagnante sans l’union de toute la gauche et des écologistes.
Laisser ce vote nous diviser serait donc une erreur fatale. C’est unie - dans sa diversité qui est une chance - que la gauche a mis un terme au gouvernement Barnier. Et si des concessions dans ce budget ont pu être obtenues, c’est parce que la gauche dans son ensemble a peséde tout son poids, à l’Assemblée et au Sénat.
Aucun parti n’est propriétaire de notre union, celle-ci est le bien commun de nos électrices et électeurs. Nous refusons donc de faire du vote sur la censure celui qui définit les contours du Nouveau Front Populaire, alors que nous connaissons un point de bascule historique… et peut-être demain dramatique. Nous aurons besoin de toute la gauche pour être demain en capacité d’agir pour une autre politique.
Signataires :
Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Ecologiste et Social
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoit Biteau
Nicolas Bonnet
Arnaud Bonnet
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique Voynet
mise en ligne le 6 février 2025
À gauche, les unitaires attendent (à nouveau)
leur heure
Mathieu Dejean sur www.mediapart.fr
Les partisans de l’unité à gauche, qui voient le fossé se creuser entre socialistes et Insoumis, s’activent désespérément pour conjurer la rupture du Nouveau Front populaire. Si les clivages ne sont pas factices, ils doivent s’éclipser derrière le danger mortel d’une victoire de l’extrême droite en 2027, défendent-ils.
Youlie Yamamoto pèse ses mots lorsqu’elle parle de politique, mais pour décrire le paysage global, le couperet tombe sévèrement : « L’heure est grave. » Deux raisons au moins nourrissent l’inquiétude de la porte-parole d’Attac.
L’une est évidente mais se passe en coulisses. Si le Rassemblement national (RN) a échoué à s’imposer aux élections législatives anticipées de 2024 après qu’une centaine de candidat·es investi·es ont été épinglé·es pour leurs propos haineux et complotistes, il ne répétera pas la même erreur. « Le parti est prêt, les tocards des législatives ne seront plus là, le RN dispense des formations et fait du lobbying auprès des institutions pour se constituer un vivier de cinq cents hauts fonctionnaires à nommer aux postes clés – il en a déjà la moitié », alerte-t-elle.
L’autre raison s’étale à l’inverse sur les réseaux sociaux à grand renfort d’invectives et sur les bancs de l’Assemblée nationale où le Parti socialiste (PS) va s’abstenir une nouvelle fois sur la motion de censure déposée par La France insoumise (LFI) pour faire chuter le gouvernement de François Bayrou. « Les vieilles histoires des partis de gauche reviennent, le débat entre la ligne de rupture et la ligne réformiste prend le dessus sur tout le reste, comme si cette affaire n’était pas réglée. Que fait-on de ça ? », interroge la militante, qui s’était mobilisée avec des centaines d’organisations du mouvement social pour le Nouveau Front populaire (NFP) l’été dernier.
« La gauche ne gagnera que sur une ligne claire de rupture. Si on donne l’impression d’être en soutien de la Macronie, comme le fait le PS, on sera emportés. On se bat depuis quinze ans pour éviter une situation à l’italienne [où la gauche a disparu du paysage politique – ndlr] », explique Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, pour justifier le bras de fer qui se joue avec les socialistes.
Dans la société civile mobilisée, le désarroi dispute toutefois la volonté de bousculer des partis revenus à leurs réflexes identitaires. En un mois, leur désunion ouverte ou latente s’est soldée par deux défaites cuisantes à des élections partielles, à Grenoble (Isère) et à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). « Il faut rappeler les partis à la raison : pendant qu’ils se disputent, même sur des batailles de fond, c’est la société civile qui trinque alors qu’ils sont censés porter ses revendications. Nous sommes des millions de militantes et de militants, et on a la sensation que notre avenir est joué », décrit Youlie Yamamoto.
Bousculer les partis
Pour conjurer ce sinistre avenir, des partisan·es de l’unité à gauche s’activent avec des armes légères. Le 29 janvier, Lucie Castets, ex-candidate à Matignon du NFP, organisait une soirée militante à Pantin (Seine-Saint-Denis) avec des protagonistes de la société civile et des représentant·es des quatre partis de gauche. Environ un millier de personnes s’y sont rendues.
« Après cette soirée, je suis convaincue qu’il y a un espace politique central au NFP, qui refuse de s’enfermer dans un hypothétique duel entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande et la mise en scène qu’il implique. Ne nous laissons pas enfermer là-dedans et renforçons cet espace, avec ou sans eux », dit-elle à Mediapart.
L’ex-directrice des finances à la ville de Paris, partisane de la censure du gouvernement Bayrou sur un budget qui « dépasse une multitude de lignes rouges, en particulier sur nos services publics », mais aussi pour son « infâme convocation de l’idée de submersion migratoire », ne dramatise pas la différence d’attitude du PS sur cette question. « Les désaccords stratégiques sont une caractéristique de l’union de la gauche depuis toujours, explique-t-elle. Mais il ne faut pas que les querelles d’intérêts des partis prennent le dessus sur l’union. »
Ce n’est pas possible d’aller sciemment dans le mur avec la reconstitution de deux blocs qui se haïssent à gauche, alors qu’on a les fascistes en face. Clémentine Autain, députée, membre de L’Après
Pour cimenter cette union, Lucie Castets a entrepris un travail collectif sur trois axes : l’approfondissement du programme, les mobilisations locales et le processus de désignation d’une candidature commune. Le politiste Rémi Lefebvre s’est attelé à cette dernière tâche – la plus sensible. « On n’a pas beaucoup de temps, on ne sait pas quand les élections auront lieu et c’est long à mettre en place », justifie Lucie Castets.
À contre-courant de la dynamique centrifuge qui dilapide le NFP, de petits partis unionistes tentent aussi de peser : la Gauche démocratique et sociale (GDS, animée par Gérard Filoche) a fusionné avec L’Après (le mouvement qui regroupe les ex-Insoumis purgés en 2024) le 1er février. Mais le microscope est encore de rigueur pour observer le « parti des gauches unitaires ». « Je ne vois pas ce qu’on peut faire d’autre que de faire grandir cette force. Ce n’est pas possible d’aller sciemment dans le mur avec la reconstitution de deux blocs qui se haïssent à gauche, alors qu’on a les fascistes en face », commente la députée Clémentine Autain, membre de L’Après.
C’est cette même angoisse qui anime l’avocat Raphaël Kempf, ex-candidat aux législatives à Paris, investi par LFI : « Ce à quoi on assiste en termes de division est assez difficile à vivre pour moi, en qualité d’ancien candidat du NFP. L’unité me paraît indispensable dans une situation aussi tragique, avec la libération de la parole xénophobe, raciste, et la normalisation de l’extrême droite largement entamée par la loi immigration », explique-t-il.
On s’engueulera (encore) plus tard
Alors que la municipale partielle à Villeneuve-Saint-Georges a créé un précédent potentiellement traumatique à gauche, certains veulent faire des échéances municipales de 2026 une démonstration politique des vertus de l’unité.
C’est le cas de Romain Jehanin, porte-parole de Génération·s et conseiller municipal d’opposition à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où la gauche se présentera unie pour la première fois sous le label « Asnières en commun ». « Ce n’est pas parce que demain nos camarades, nationalement, devaient s’invectiver qu’on le ferait localement », assure l’élu, qui appelle les forces de gauche à cesser de se déchirer en public. « Si demain il y avait des législatives anticipées, il faudrait s’y présenter unis derrière un programme qui nous a déjà rassemblés en 2022 et en 2024 ! », rappelle-t-il.
Les clivages à l’intérieur de la gauche ne sont pas factices, mais cela ne doit pas passer par-dessus toute autre considération. Roger Martelli, historien du communisme
Dans un contexte international marqué par la victoire de Donald Trump et l’influence grandissante de Javier Milei, et alors qu’une tripartition politique caractérise désormais le paysage politique français, pour ces unionistes l’heure n’est donc plus au débat des gauches. « Les clivages à l’intérieur de la gauche ne sont pas factices, ils renvoient à des univers profondément différents et il n’est pas indifférent de savoir qui donne le ton, mais cela ne doit pas passer par-dessus toute autre considération », explique l’historien du communisme Roger Martelli, bon connaisseur de l’époque où le secrétaire général du Parti communiste français (PCF), Georges Marchais, s’affrontait lourdement avec François Mitterrand.
« Aujourd’hui, le déséquilibre entre la gauche et la droite est infiniment plus grand qu’il ne l’était entre 1977 et 1981, et le centre de gravité de la droite s’est déporté vers l’extrême droite. L’enjeu n’est donc plus simplement de savoir qui va donner le ton dans un cadre démocratique, mais si nous allons rester dans ce cadre démocratique, ou si la France va basculer dans une nouvelle ère qu’il vaut mieux ne pas expérimenter », développe-t-il.
C’est la raison pour laquelle, passé la sidération dans laquelle la société civile organisée semble avoir été plongée après le coup de force démocratique d’Emmanuel Macron – qui a tout fait pour empêcher le NFP de gouverner –, celle-ci semble se ressaisir doucement.
Un appel à « renforcer les collectifs unitaires sur le terrain » a par exemple été lancé par des militant·es et responsables syndicaux, qui exhortent à l’unité pour constituer une alternative politique. « Face à l’extrême droite aux portes du pouvoir, rester sur son quant-à-soi risque de se payer très cher pour tous et toutes », écrit ce collectif. « On est dans une position d’attente pour réagir au bon moment, que ce ne soit pas un coup d’épée dans l’eau, mais il va y avoir une fenêtre et on va s’en saisir », conclut Youlie Yamamoto.
mise en ligne le 5 février 2025
Pour le Nouveau Front Populaire, y aura-t-il
une vie après le budget ?
Gaël De Santis sur www.humanite.fr
Les formations de gauche sont parties pour se diviser sur le vote crucial d’une censure du budget de François Bayrou. Le PS entend faire bande à part, et la FI menace de présenter des candidats face aux députés qui ne voteraient pas avec elle. Écologistes et communistes tempèrent et appellent à surmonter ce désaccord.
Le fond de l’air est plus frais en ce début février, y compris à gauche, où il se fait glacial. Alors que François Bayrou veut imposer son budget à coups de 49.3, les formations alliées au sein du Nouveau Front populaire (NFP) sont parties pour faire chemin séparé lors du scrutin crucial de ce mercredi 5 février : les socialistes n’entendent pas voter la censure du gouvernement, contrairement aux insoumis, aux écologistes et aux communistes. Ce désaccord aura-t-il la peau du NFP ?
Beaucoup, à la France insoumise, considèrent que le choix du PS acte une rupture. « Le budget est le seul texte présenté à l’Assemblée nationale qui détermine si vous appartenez à la majorité ou à l’opposition », prévient Éric Coquerel, député FI. Sa présidente de groupe, Mathilde Panot, estime même que « ceux qui ne voteront pas les motions de censure seront des soutiens de fait du gouvernement ». Pour les prochaines législatives, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon envisage d’ailleurs de présenter des candidats « fidèles au programme du NFP » face aux députés de gauche qui ne voteraient pas la censure.
« Le NFP n’est pas un parti unique »
Le PS, pour sa part, explique ne pas avoir changé de ligne programmatique et assure ne pas avoir tourné le dos au NFP. Si les socialistes considèrent que ce n’est pas sur le budget qu’il faut faire tomber le gouvernement Bayrou, ils se déclarent toujours comme membres de l’opposition.
« Nous avons dit que si le budget était présenté, nous voterions contre », rappelle Emmanuel Grégoire, député de Paris, qui justifie la non-censure dans l’immédiat : « Nous ne voulons pas prendre le risque de ne pas doter la nation d’un budget. » Des élus PS soulignent également qu’il faut savoir entendre « les appels multipliés de maires et de présidents d’association qui confient à quel point ils sont en difficulté faute de budget ».
Il n’empêche que les communistes et les écologistes fulminent eux aussi devant la copie du gouvernement et regrettent le choix du PS. Sans pour autant considérer que cette division acte la mort du NFP, ou bien sa poursuite sans les socialistes. « Nous avons déjà eu des désaccords sur la stratégie parlementaire, tempère Léa Balage El Mariky, porte-parole des députés écologistes. Le NFP n’est pas un parti unique, mais une coalition électorale. Ce n’est pas un cahier des charges avec 92 questions. C’est la promesse faite aux électeurs que nous avions la capacité de gouverner, de changer leur vie. »
« Ce désaccord ne marque pas une rupture »
« Ce désaccord ne marque pas une rupture. Dans une coalition, il est normal que nous ayons des différences, sinon ce serait un parti », relève Stéphane Peu. Le communiste rappelle que le NFP n’était pas à l’unisson concernant la participation aux discussions sur le budget avec le gouvernement. « Nous ne le sommes pas non plus sur la question de la censure », modère-t-il. « Je regrette la décision des socialistes. Je ne la sous-estime pas. Mais je ne suis pas pour que le NFP éclate », ajoute Alexis Corbière.
L’élu de l’Après (Association pour une République écologique et sociale) souligne que cette union de la gauche « est née afin de contrer l’extrême droite » et mesure que les coups portés au NFP peuvent venir de différents côtés, en rappelant, par exemple, que la volonté de la FI de ne fusionner ni au premier, ni au second tour de l’élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ces derniers jours conduit à la fois à la division et à la défaite.
Plusieurs élus écologistes, PCF, Génération.s ou membres de l’Après signalent enfin qu’ils refusent l’idée selon laquelle il existerait deux « gauches irréconciliables » et appellent le NFP à rester uni. La FI, de son côté, travaille déjà à une candidature derrière Jean-Luc Mélenchon pour 2027, ce que les autres forces du NFP refusent.
Les votes du PS et de la FI sur la censure ou non du gouvernement sont d’ailleurs également à analyser de ce point de vue : les insoumis entendent provoquer la tenue d’un scrutin présidentiel le plus vite possible (une chute de François Bayrou pouvant entraîner, selon eux, celle d’Emmanuel Macron), quand les socialistes craignent d’être pris de vitesse ou de voir le RN l’emporter en pareil cas.
Les divergences de ton et de stratégie, le PS estimant que la FI s’est abîmée et qu’une place est à prendre pour incarner une gauche dite « respectable » et « de gouvernement », composent aussi l’équation. Reste une question tout entière : si la gauche venait à exploser à terme du fait de ses désaccords, lui resterait-il seulement une chance pour la gauche de battre la droite et l’extrême droite ?
mise en ligne le 4 février 2025
Des contorsions
et deux 49.3
pour un budget austéritaire
Anthony Cortes sur www.humanite.fr
François Bayrou a dégainé, ce lundi, deux 49.3 pour faire adopter respectivement le projet de loi de finances de l’État et celui de la Sécurité sociale. Deux motions de censure ont été déposées par une partie de la gauche, le Parti socialiste a annoncé qu’il ne les votera pas.
On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Ce n’est pas le cas du 49.3. Ce lundi 3 février, à la tribune de l’Assemblée nationale, le premier ministre François Bayrou a annoncé y recourir pour engager la responsabilité du gouvernement sur deux textes : le budget de l’État et celui de la Sécurité sociale.
« Nous voici à l’heure de vérité et de responsabilité, a-t-il annoncé en introduction de sa prise de parole. Est-ce que ce budget est parfait ? Non, mais c’est un équilibre. Nous sommes tous ensemble face à notre devoir : dans les dix jours, la France aura ses budgets. » Deux textes qui, selon lui, ont « trois géniteurs » : « Le gouvernement de Michel Barnier, le gouvernement constitué depuis le 23 décembre et le Parlement dans ses deux chambres. »
Une façon d’insister sur la volonté de « compromis » qui l’animerait. « Le mot compromis ne doit plus être une insulte dans la vie politique française, a renchéri David Amiel, député macroniste et rapporteur du budget. Nous sommes tous intoxiqués à un fait majoritaire qui ne mène qu’à l’impuissance et à la crise. »
« C’est un budget pire que celui de Michel Barnier »
Des propos qui ne correspondent pourtant en rien à la réalité. Si le projet de loi de finances (PLF) a fait l’objet de débats à l’occasion d’une commission mixte paritaire (CMP), sa composition était largement acquise au camp gouvernemental et à ses priorités. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), lui, n’a même pas eu ce piètre honneur puisque les discussions à son propos n’ont repris que la semaine dernière. Elles sont interrompues par ce coup de force qui permet à François Bayrou de contourner le Parlement.
Dans les deux cas, le caractère largement austéritaire du PLF et du PLFSS frappe. Cela malgré les propositions des forces du Nouveau Front populaire (NFP) pour augmenter la part des recettes plutôt que la recherche d’économies dans le fonctionnement de l’État.
« C’est un budget pire que celui de Michel Barnier, déplore Éric Coquerel, président FI de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. L’Observatoire français des conjonctures économiques chiffrait que le budget du précédent premier ministre aurait un effet récessif de 0,8 point. Celui de François Bayrou, avec 23,5 milliards de coupes budgétaires, nous coûtera encore plus cher ! Les faibles concessions ne sont qu’un arbuste qui cache la forêt austéritaire. »
Par conséquent, Mathilde Panot, cheffe de file des députés insoumis, a annoncé le dépôt de deux motions de censure. Causeront-elles la chute de François Bayrou et de ses ministres ? Il faudrait pour cela la mobilisation de l’ensemble du Nouveau Front populaire, mais aussi les voix de l’extrême droite. Cela n’en prend pas le chemin.
Une autre motion pour dénoncer les propos de Bayrou sur la « submersion migratoire »
À la mi-journée, quelques heures avant la prise de parole du premier ministre, le bureau national du Parti socialiste (PS) a annoncé qu’il ne censurerait pas le gouvernement. Au total, 59 voix se sont prononcées en ce sens, contre 54 à la veille de la précédente motion de censure visant François Bayrou, le 16 janvier.
Une position qui concerne autant le vote de la motion de censure correspondant au PLF que celle du PLFSS. Au prix de quelques contorsions. « Cela n’empêche pas que nous nous opposons politiquement à l’action du gouvernement, précise Béatrice Bellay, députée socialiste de la Martinique. Nous écoutons simplement les remontées de terrain de nos élus qui nous font part de leurs difficultés sans budget. Mais nous continuons à dire que ce budget ne va pas dans le bon sens avec, par exemple, deux milliards en moins pour l’habitat. »
Reste à savoir si l’ensemble du groupe socialiste se rangera derrière cette volonté. Au mois de janvier, huit députés avaient refusé de s’aligner sur la position du parti. Il en faudrait plus d’une vingtaine pour causer la chute du gouvernement si le Rassemblement national (RN) et ses alliés votent également la censure. Ces derniers ont fait savoir qu’ils annonceront leur position ce mercredi. Le temps de tenter d’obtenir quelques concessions du premier ministre ?
Malgré cette décision du bureau national, les socialistes ont réaffirmé qu’ils continueraient à s’opposer à un « gouvernement qui participe à la trumpisation du débat public ». En cause, ses « attaques contre le pacte vert au niveau européen », la remise en cause du droit du sol à Mayotte et en Guyane, le durcissement des critères de régularisation des sans-papiers, la diminution des crédits de l’aide médicale d’État ou de l’aide publique au développement, ainsi que les propos de François Bayrou sur une prétendue « submersion migratoire ».
Ces derniers seront à l’origine du dépôt, par les députés socialistes, d’une motion de censure spontanée sur « les valeurs de la République ». La démarche est loin de calmer la déception des autres groupes du NFP devant leur refus de voter la censure. La motion socialiste sera en effet rejetée par le camp gouvernemental comme par l’extrême droite et n’a donc aucune chance d’aboutir.
« Piétiner » et « humilier » la démocratie
« Je suis choquée par leur décision, fait savoir Aurélie Trouvé, députée FI de Seine-Saint-Denis, à propos du refus socialiste de s’associer aux deux motions. Les socialistes ont été élus sur un programme, celui du NFP, construit pour proposer autre chose que le macronisme. Notre motion servira à déterminer qui est dans le soutien du gouvernement et qui est dans l’opposition. C’est une question de fidélité pour nos électeurs. »
« Ce choix n’est à mon avis pas le bon, estime pour sa part Benjamin Lucas-Lundy, député du groupe Écologie et social. C’est un mauvais budget qui prolonge la politique d’Emmanuel Macron depuis 2017 et qui est à l’opposé des grandes orientations que nous devons prendre pour le pays, en particulier en matière de bifurcation écologique ou de justice sociale. »
« Ce budget est pire que le précédent. Il est honteux d’obliger des députés à voter la censure pour pouvoir s’exprimer, parce qu’on leur a retiré toute prise sur le budget », s’agace le communiste André Chassaigne, coprésident du groupe GDR. Et le député PCF Nicolas Sansu de se désoler également du recours au 49.3, qui « piétine » et « humilie » la démocratie. Un outil constitutionnel dont toutes les composantes du NFP avaient exigé en vain l’abandon, auprès de François Bayrou, contre un accord de non-censure.
mise en ligne le 3 février 2025
Villeneuve-Saint-Georges,
la gauche
la plus triste du monde
Roger Martelli sur www.regards.fr
Ce dimanche se tenait le second tour de l’élection municipale partielle. Elle avait valeur de test, notamment à gauche. Le député LFI Louis Boyard y a perdu sèchement contre la droite.
Avec 24,9 % au premier tour, l’insoumis Louis Boyard avait pris l’ascendant sur son concurrent communiste Daniel Henry (20,7 %) qui réunissait sur sa liste communistes, socialistes, radicaux et écologistes. Mais, alors que la droite abordait le second tour avec deux listes concurrentes, le jeune député du Val-de-Marne n’a pas réussi son pari de devenir maire. Avec 38,5 %, il a été nettement distancé par sa concurrente de droite (49 %). Il perd 127 voix et 9,4 % sur le total des gauches du premier tour.
Il avait pourtant beaucoup d’atouts, et pas seulement son allant et sa notoriété médiatique. Aux législatives de 2022 et 2024, il avait propulsé la France insoumise sur le devant de la scène locale. En 2017, les insoumis sont certes déjà en tête de la gauche mais dépassent tout juste les 15 %. En 2022, Jean-Luc Mélenchon réalise 46,2 % sur la ville. Louis Boyard devient alors le candidat Nupes-LFI et rassemble 40,2 % au premier tour ; il écrase la droite et l’extrême droite au second tour avec 62,4 % sur la ville. En 2024, candidat NFP-LFI, Louis Boyard fait mieux que récidiver en obtenant 56 % au premier tour et 61,2 % au second. Il améliore ainsi le résultat de la liste de Manon Aubry et de Rima Hassan aux européennes de 2024 (39,2 %).
C’est fort de ces résultats qu’il tente le pari audacieux de conquérir la ville à l’occasion de l’élection partielle. Il ne cherche pas l’alliance avec le reste de la gauche et part seul au premier tour. Faisant fonction d’éclaireur, il teste la stratégie, pour les municipales de 2026, d’une France insoumise qui espère s’emparer, entre autres, d’une large part du « communisme municipal ». Dans son combat, il reçoit le soutien des dirigeants du mouvement, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui se déplacent à Villeneuve-Saint-Georges et font meeting avec lui.
Dès hier soir, Mélenchon et à sa suite les dirigeants de la France insoumise ont répété, tous avec les mêmes mots, que la liste de Boyard venait de recueillir 11 points de plus que la maire communiste sortante en 2020, Sylvie Altman. Mais, alors que les communistes avaient repris en 2008 la ville de tradition cheminote qu’ils avaient perdue en 1983, Louis Boyard ne parvient pas à terrasser l’équipe de droite sortante, alors qu’elle avait accumulé toutes les fautes qui auraient dû la conduire à sa perte. Au fond, tout laissait présager que le « dégagisme » cher aux insoumis allait leur profiter. Cela n’a pas été le cas, alors même que la droite locale se déchirait et que deux listes se maintenaient au second tour.
En 2022 et en 2024, lors des législatives, Louis Boyard a su profiter de l’union réalisée à Villeneuve-Saint-Georges, sous l’étiquette de la Nupes, puis du Nouveau Front populaire. Il a pensé qu’il pouvait réitérer à une élection municipale. Il imaginait pouvoir imposer ses conditions ou faire porter le chapeau de la désunion à ses partenaires de la gauche. Il l’a fait avant le premier tour et, plus surprenant encore, il a récidivé entre les deux tours, réclamant une prime majoritaire insoumise, au nom de la nécessité d’avoir une majorité solide pour appliquer son programme. Étrange demande de la part de LFI qui la refuse en général lors des fusions, préférant avec raison la méthode démocratique d’une représentation proportionnelle des listes.
Ce dimanche encore, la liste insoumise a fait ses meilleurs scores dans les cités populaires, là où se concentrent la jeunesse, la pauvreté, la discrimination et la relégation. Elle a donc contribué à de la politisation à gauche, là où la gauche a perdu les bases de son influence d’autrefois. Mais, faute d’esprit d’ouverture, en multipliant les oukases et les rejets, la campagne de LFI n’a pas permis que convergent tous les électeurs de gauche ni toutes les catégories qui s’éloignent du vote et se désespèrent de la gauche. Ajoutons que, même dans les quartiers où Louis Boyard fait ses meilleurs résultats, les insoumis sont en recul, plus ou moins sensible, par rapport aux scores de 2022 et 2024.
Villeneuve-Saint-Georges aurait pu être un exemple faisant émerger une gauche capable de s’ancrer dans les valeurs émancipatrices sans tracer des lignes de partage irréductibles. Ce n’est pas cette gauche-là que nous avons vue à l’œuvre dans la ville la plus pauvre du Val-de-Marne (un taux de pauvreté deux fois supérieur à celui du département), mais la gauche de la guerre des camps, une fois encore.
Aux municipales 2026 comme pour les autres élections à venir, il ne faudra surtout pas refaire Villeneuve-Saint-George, c’est-à-dire mobiliser les talents pour écarter, et perdre à l’arrivée.
mise en ligne le 29 janvier 2025
Une gauche
au bord de la rupture
Roger Martelli sur www.regards.fr
La gauche cherche toutes les occasions de s’écarteler. Est-ce vraiment de saison ?
C’est quoi cette mauvaise blague ? Trump est en train de tout casser chez lui ; Milei propose de revenir avant la période des Lumières (voir notre article) ; l’extrême-droite se déploie partout. Et pendant ce temps-là, on rejoue la guerre des gauches. Hier, Marchais contre Mitterrand ; aujourd’hui, Mélenchon contre Hollande, « madame Irma » contre « le capitaine de pédalo ».
Le grand cirque ne se limite pas aux noms d’oiseaux. Toutes les occasions semblent bonnes pour aviver les clivages les plus insurmontables. L’arrogance impériale de Trump menace l’Europe ? La gauche ressort ses vieux affrontements. Dans une récente tribune publiée par Le Monde une partie de la gauche (la plus à droite de la gauche) se prononce en faveur d’une Europe fédérale au risque de ranimer les préventions d’une autre partie (les plus à gauche de la gauche) qui redoute cette logique, surtout quand l’influence de l’extrême droite est en dynamique dans toute l’Europe. Mais comment constituer un front efficace contre le trumpisme, s’il n’y a pas d’Europe, si l’Europe se contente de rester ce qu’elle est, ou si elle se fédéralise sur la base du pire ?
La guerre des deux gauches pour légitimer deux candidatures à la présidentielle
S’il n’y avait que cela… Selon les jours, l’essentiel serait de choisir entre la gauche sociale et la gauche sociétale, entre la gauche des tours et celle des bourgs, entre la gauche du communautarisme et celle de la laïcité. Tout ça pour quoi? Pour légitimer le fait que, à la prochaine et inéluctable présidentielle, on doit se préparer à deux candidatures au moins : une insoumise et une sociale-démocrate bon teint. Et pour faire bonne mesure, on inscrit cet affrontement dans les localités. À Villeneuve-Saint-Georges, les insoumis arrivés en tête n’ont pas su faire de place à l’autre liste de gauche. Il n’y aura donc pas de fusion des deux listes de gauche. Pathétique.
Ce n’est pas à Regards que l’on récusera l’idée que la gauche est historiquement polarisée. D’un côté, la conviction que l’égalité ne peut se déployer pleinement au sein de logiques capitalistes qui la nient absolument ; de l’autre, l’idée que la seule voie réaliste est de tenter dans le système de réduire le champ des inégalités. Cette polarité est une réalité. Elle est aussi une source de dynamisme, si elle n’est pas marquée par un déséquilibre trop grand.
Le débat à gauche doit être assumé. La gauche y est parvenue dans le passé : pourquoi n’y parviendrait-elle pas dans le présent, dans une situation profondément changée. La question n’est plus de déterminer qui, de la droite ou de la gauche, est la mieux placée pour assumer la gestion de l’État dans le cadre républicain installé. L’enjeu est de dire si ce cadre sera maintenu ou si nous allons entrer dans une phase nouvelle, post-démocratique et « illibérale ». Certains à gauche ont pu rêver que venait le temps du grand chambardement, du dégagisme libérateur, propice à toutes les ruptures. S’il y a du chambardement et du dégagisme, c’est vers la pire des régressions qu’il est en train de nous porter. Inutile de croire que l’expérience du pire remettra l’histoire dans le bon sens, comme les communistes ont pu croire, au début des années 1930 : l’exercice du pouvoir par les fascismes n’a pas relancé l’onde révolutionnaire.
La tension entre les deux sensibilités à gauche peut tourner au désastre
Dans le passé, il y avait concurrence à l’intérieur de la gauche, mais la gauche et la droite formaient deux ensembles de force globalement équivalente et la droite, plus ou moins libérale, restait républicaine. Aujourd’hui, la gauche est cruellement affaiblie et c’est l’extrême-droite qui domine.
Dès lors, la tension entre deux sensibilités à gauche peut tourner au désastre. Si « deux gauches » doivent se partager les maigres ressources électorales de la gauche tout entière, autant admettre que seule une personnalité de droite peut l’emporter face au Rassemblement national. Or ce calcul n’a rien d’assuré. Et même si, à l’arrivée, la droite « classique » l’emporte, ce serait une droite dont le point d’équilibre est déplacé vers son extrême.
À la différence d’autres périodes où la concurrence à gauche au premier tour préparait le rassemblement du second tour, la question de l’union tend à devenir première, notamment dans la perspective d’une élection présidentielle. Si la gauche veut ne pas être cornérisée, elle doit se rassembler. Et si elle veut regagner une majorité, elle doit écarter les logiques politiques qui l’ont privée du soutien populaire. Ainsi, elle doit s’écarter de la logique qui s’est amorcée en France autour de 1982-1983, qui s’est déployée dans le cadre européen du « social-libéralisme » et qui a connu son apogée entre 2012 et 2017, avec le quinquennat de François Hollande. Y revenir, au nom du « réformisme » et du « réalisme », serait une aberration.
En 2017 et 2022, les scores de Jean-Luc Mélenchon et le camouflet enregistré par les autres candidatures à gauche ont déplacé le curseur vers la gauche. Cela a débouché à deux reprises sur un rassemblement à gauche, sous l’étiquette de la Nupes, puis du NFP. À deux reprises, ce rassemblement s’est appuyé sur un programme, marqué par le poids électoral de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Au-delà du détail des propositions, ce programme est un corps cohérent de propositions qui se nourrit de ce que la gauche de gauche a accumulé depuis 2002. Dira-t-on que c’est un programme de « rupture » ? Ce n’est pas un programme qui décide de la rupture avec un système, mais la logique générale de mobilisation qui suit ou ne suit pas la victoire électorale du programme. En 1936, c’est la grève qui impose la réalisation des grandes mesures du Front populaire ; après 1981, c’est l’atonie du mouvement social qui rend possible le retournement vers la « rigueur ».
Ce n’est pas un programme qui décide de la rupture
Depuis 2022, la domination écrasante de Jean-Luc Mélenchon a déterminé la rapidité et l’allure générale du rassemblement. Il procédait de l’idée que les catégories populaires ne pouvaient être regagnées que par un retour aux valeurs fondatrices de la gauche. La base du rassemblement existe donc. Peut-être lui manque-t-il l’esprit et l’ambition d’un projet. La force de la gauche n’est ni dans un individu, ni dans un parti, mais dans un esprit d’unité et dans un projet dont le maître mot devrait être l’émancipation humaine. Si, au moment électoral décisif, ce n’est pas ce projet que nous mettons au cœur de la controverse publique, si l’enjeu énoncé est de savoir qui domine à gauche, nous n’aurons plus que les larmes pour pleurer.
Cette conviction doit l’emporter. Chacun, à l’intérieur de la gauche, peut jouer sa partition, en fonction de son histoire et de ses convictions. Mais, à l’arrivée, ce ne seront pas « les » gauches qui se partageront les votes mais « la » gauche qui triomphera ou qui mordra la poussière.
mise en ligne le 20 janvier 2025
La gauche
repart comme en 14
Catherine Tricot sur www.regards.fr
Comment bien commencer la semaine ? Par un truc sympa ? On a hésité : allez, va pour la gauche. On vous réserve l’investiture de Donald Trump pour demain.
Le week-end fut celui de l’étalage des tensions au sein de la gauche ; il s’achève avec une élection partielle à Grenoble et une lourde défaite du candidat LFI/NFP. Lyes Louffok perd par 35% contre 65% pour la candidate macroniste qui a fait le plein. La circonscription n’est certes pas un bastion de la gauche ; il y eut longtemps un député socialiste passé à la macronie, Olivier Véran. Mais ce n’est pas non plus une terre de mission. Le député sortant était LFI/NFP, élu dans une triangulaire. Et si on cumule les résultats des listes de gauche aux européennes, la circonscription pointe à la 57eme place pour la gauche.
Cette défaite n’a pourtant rien d’inattendue. Au soir du premier tour, il était difficile de croire à une victoire. Surement que l’abstention du groupe socialiste lors de la censure a désemparé une partie de l’électorat NFP… mais pas au point d’aller voter LFI. Bien que sympathique, la candidature d’un combattant pour le droit des enfants n’est pas parvenue à mobiliser et l’abstention fut forte -comme souvent lors des partielles. Pour finir, le NFP perd 6% en 6 mois. Dans l’affrontement sans retenue, la gauche désespère. Parce qu’elle est faible politiquement au double sens du terme : on ne sait pas trop ce qu’elle dit ni si elle peut gagner, surtout face à la marée montante de l’extrême droite.
Les socialistes ont justifié leur non-vote de la censure par une étrange formule de leur secrétaire national à la tribune de l’Assemblée « faire la politique du pire c’est faire la pire des politiques, celle qui conduit Marine le Pen au pouvoir ». Cette appréciation sera sans doute la même dans 6 mois, dans un an. Conduira-t-elle à ne jamais censurer le gouvernement, quel que soit sa politique et son budget ? On ne fera pas le reproche aux socialistes d’avoir de l’inquiétude face à ce qui semble chaque jour une menace plus pressante. Il y a une folie à relativiser le risque, à présumer de ses forces face au danger immense.
Mais alors, quand on est un parti qui compte, qui se veut responsable, on se doit d’avoir une stratégie. La procrastination n’en est pas une. La fracturation de la gauche non plus. Et ça vaut aussi pour les Insoumis. Les noms d’oiseaux qui fusent n’ont pour effet – et sans doute pour volonté – que d’inscrire cette division et de légitimer plusieurs candidatures présidentielles. Magnifique les gars !
Les Insoumis disent une chose claire : il faut une autre logique, une rupture sinon on va dans le mur : celui du climat, de la pauvreté, de la mise à mal de la démocratie. D’autres murs se dressent aussi : la guerre, la corruption, le désespoir de la jeunesse. Ils ont un projet et un programme. Ils se préparent à les défendre lors d’une présidentielle qu’ils croient imminente. Ils ne sont pas obligés de chercher à embarquer leurs partenaires dans un désir d’accélération du calendrier. Si Macron doit démissionner il le fera parce que la situation est totalement bloquée et qu’il y sera contraint. Pas parce qu’on l’aura provoqué. En revanche, ils ont raison de se préparer : le rythme des évènements nous échappe. Pourquoi n’adoptent-ils pas une politique rassembleuse ? Pourquoi prétendre que les socialistes sont alliés au RN pour sauver macron ? C’est un peu rustre comme analyse. En vérité, ces mots heurtent même ceux qui n’ont pas le vote socialiste chevillé au corps (ils ne sont plus si nombreux). Les Insoumis devraient se défaire de leur assurance d’avoir, in fine et au bout du compte, le vote des classes moyennes … A Grenoble cela ne s’est pas produit. Pas du tout même. Ils pourraient même douter que ces invectives sont attendus par le monde populaire.
Quant aux socialistes, ils devraient se convaincre de la faible attractivité de la logique du moindre mal, celle qui veut qu’éviter la suppression de 4000 postes d’enseignants est mieux que leur suppression ; que la non mise en œuvre des jours de carences est mieux que leur mise en œuvre, etc… Ces temps-là sont révolus. Parce que les dangers sont évidemment bien plus grands qu’une dette et qu’une mauvaise note des agences de notation. Parce que les blocages ne se lèveront que par une autre politique. Et que la gauche ne peut laisser au RN le discours de la rupture. Les socialistes semblent y renoncer et se faisant, ils valorisent même à leur corps défendant la solution d’extrême droite.
Il reste quelques semaines pour se ressaisir.
mise en ligne le 16 janvier 2025
La censure
reste pour après
Roger Martelli sur www.regards.fr
François Bayrou a échappé à la censure, comme prévu. Il ne perd rien pour attendre. Mais la gauche a trébuché sur ce coup. Il ne faut pourtant pas se résigner au pire.
Le PS a fini par décider de ne pas voter la censure du gouvernement Bayrou. Il a tort. La politique annoncée par François Bayrou reste ouvertement dans la lignée de son prédécesseur qui, lui, avait été sanctionné par la représentation parlementaire. Il a écarté toutes les demandes de fond venues de la gauche, sociales, institutionnelles ou écologiques. Il s’est contenté de lâcher des miettes et de faire des promesses… de gascon. En ne se joignant pas à la censure proposée par leurs partenaires, les socialistes ne gagneront aucune sympathie sur leur droite, mécontenteront du côté gauche et ajouteront une nouvelle pelletée de sable dans la machine déjà grippée du Nouveau front populaire.
Faut-il pour autant hurler à la trahison à la brisure irrémédiable de l’alliance à gauche ? Ce n’est pas raisonnable. Tout d’abord parce qu’il y a, dans une décision de censure ou de non-censure, une part inextricable de choix de fond et de tactique. C’est l’avenir qui dira si la décision finale de la direction socialiste annonce un changement de cap, voire un retour à la case François Hollande, ou si elle est simplement un geste pour ne pas apparaître comme des facteurs de blocage et d’aggravation de la crise politique. Le PS doit simplement savoir que si son choix d’un jour ne signe pas inéluctablement la mort du NFP, il aggrave un peu plus le doute populaire sur la solidité de l’alliance et sur sa capacité à contenir la menace persistante du Rassemblement national.
On peut donc regretter la décision socialiste et ne pas acter pour autant la fin de l’espoir qu’avaient suscités les alliances bienvenues de 2022 et de 2024. Nul ne doit oublier que la gauche ne peut espérer atteindre la majorité que si elle écarte les conceptions funestes des « deux gauches » irréconciliables et si elle se persuade qu’elle a l’obligation de cultiver en même temps sa diversité et son unité.
Le PS doit donc au plus vite montrer, par des actes significatifs, qu’il reste dans l’esprit d’un abandon des errements du social-libéralisme à la mode hollandaise. Quant aux autres forces de gauche, à commencer par la France insoumise, elles se doivent d’écarter tout espoir de tirer profit du dérapage socialiste. Au jeu du chat et de la souris, c’est la gauche tout entière qui risque d’en payer un peu plus le prix.
Au fond, ce que dit avant tout le nouvel épisode parlementaire, c’est que le faiseur et le tombeur de rois est toujours le Rassemblement national. La gauche est une force qui compte dans l’arène parlementaire. Elle n’en est pas moins très minoritaire parmi celles et ceux qui votent et elle n’a pas contredit pour l’instant le fait que les catégories populaires ont perdu pour l’essentiel la confiance en elle qui faisait sa force.
Convainquons-nous plutôt de ce que la reconquête ne passera ni par la radicalité de la posture, au risque de l’enfermement minoritaire, ni par la modération affectée, au risque de la compromission. Ou bien la gauche rassemblée fait la démonstration patiente qu’elle a un projet fidèle à ses valeurs et novateur dans son approche, une perspective indissociablement combative et rassurante, ou bien elle laisse à la pire des solutions la capacité à imprimer sa marque sur le cours des choses
mise en ligne le 14 janvier 2025
Le PS retourne-t-il
à ses vieilles lunes ?
Et faut-il s’en réjouir ?
Catherine Tricot sur www.regards.fr
Que vont décider les socialistes dans les prochains jours, les prochains mois ? Une nouvelle « clarification à gauche » avec l’éclatement du NFP, est-elle un passage obligé ?
A la veille de la déclaration de politique générale, le suspens est entier : que dira François Bayrou, notamment au sujet des retraites ? Abrogation ? Suspension pour 6 mois ? Suspension du recul de l’âge de départ ? Quel sera le point d’équilibre du budget de l’État ? Les concessions, s’il y en a, permettront-elles aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement, eux qui veulent éviter une présidentielle anticipée ?
A gauche, bruisse à nouveau l’accusation de trahison faite aux socialistes. Ceux qui reviennent de très loin (Anne Hidalgo a engrangé 1,75% des voix à la présidentielle de 2022), vont-ils repartir aussi loin que les avait menés le quinquennat de François Hollande ? Bon débarras ? Clarification ? Faut-il se réjouir de voir les socialistes revenir clairement à une politique dont la raison serait celle des marchés ? On n’en est pas là. Depuis 2022, le PS a fait le choix de s’allier aux autres forces de gauche et de se réinscrire dans cet espace. Mais une telle évolution droitière est une possibilité inscrite dans leur histoire.
Si le PS revenait aux logiques sociales-libérales, celles qui font de la bonne santé du capital le moteur de la dynamique des sociétés, ce serait affligeant. Mais quand et où le PS a-t-il produit un travail pour penser autrement l’avenir ? Ne cherchez pas : il en va du droit d’inventaire du mandat Hollande comme de celui des mandats de Mitterrand : on attend toujours.
Prenons du recul : cette éventualité d’un PS qui lâche la gauche est-elle réjouissante ? Quand les socialistes abandonnent la gauche, celle-ci peut, parfois, voir son flanc gauche se conforter. Mais aujourd’hui, elle recule globalement et se trouve encalminée dans une minorité politique particulièrement dangereuse.
Demain ou après-demain, lors des prochaines élections présidentielles, il faut que la gauche soit solide sur ses valeurs et ses objectifs pour faire face à la menace de l’extrême droite. Le mieux serait que la gauche soit unie. Pour cela, il faudrait qu’elle s’en occupe sérieusement, c’est-à-dire pas seulement du casting et pas au dernier moment.
Mais si elle ne devait pas être unie, si le PS part à la dérive comme on l’appréhende, sera-t-il possible de gagner une dynamique majoritaire pour s’opposer à Le Pen/Bardella ? Quand le PS dévisse, il ne dévisse pas seul. Une partie de ses soutiens se cramponne à gauche ; une partie l’accompagne ; la plupart abandonnent. Le PS paierait cher cette évolution. La candidature insoumise élargirait peut-être son espace mais, en tout état de cause, la possibilité de victoire serait lourdement affectée.
Voir le PS tout lâcher pour préserver la stabilité et éviter une présidentielle anticipée n’est pas souhaitable. Le PS doit revenir à la raison et se convaincre définitivement que l’espace social-libéral est tout petit et déjà pris et que l’extrême droite engrange sur le désespoir social et sur la faiblesse d’une gauche de changement.
Le choix des communistes et des écologistes comptera. Leurs attitudes et leurs positions détermineront le centre de gravité : tout pour la stabilité ou tout pour dégager une autre voie ?
Ceci dit, l’entêtement de la droite, des macronistes et du Président pourrait bien conduire les socialistes à abandonner leurs chimères. Le pire n’est jamais certain et la gauche peut se ressouder.
mise en ligne le 8 janvier 2025
Le Parti socialiste en quête d’un compromis fécond
Bernard Marx sdur www.regards.fr
Le PS a entamé des négociations avec les ministres de l’économie et des comptes publics. À quelles fins ?
Ce mardi, Olivier Faure en a posé les enjeux de ces pourparlers sur France Inter avec une argumentation en 3 points :
-
1. Il faut un budget pour la France.
-
2. Le PS est ouvert au compromis parce que « s’il n’y a pas ce dialogue fécond, cela conduit à ce que l’extrême droite soit appelée au pouvoir, comme c’est le cas, en ce moment même, en Autriche ».
-
3. Les négociations vont porter essentiellement sur les retraites, les dépenses de services publics (éducation, santé…), le pouvoir d’achat et la justice fiscale.
En clair, si les négociations aboutissent, le PS ne voterait pas la censure, ni après la déclaration de politique générale de François Bayrou le 14 janvier, ni sur le budget 2025. Il continuerait de s’opposer et de combattre la politique du gouvernement et notamment celle du duo Retailleau-Darmanin.
Le cas de l’Autriche est effectivement parlant. Mais la montée et l’arrivée de l’extrême droite à la direction du gouvernement autrichien ne sont pas seulement dues à l’échec des négociations entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Elles sont d’abord la conséquence des politiques qu’ils ont conduit ensemble ou séparément. Elles tiennent ensuite au renversement d’alliances décidé par les conservateurs qui ont choisi celle avec l’extrême droite. Elle sont dues, enfin, comme le souligne Romaric Godin dans Mediapart (voir plus bas), aux milieux économiques qui soutiennent ce renversement d’alliances. Elon Musk est loin d’être seul au monde.
S’agissant de l’Autriche, cela ne nous rajeunit pas. Mais s’agissant de la France, cela peut nous faire réfléchir. La censure, en janvier ou en mars du gouvernement Bayrou, l’enfoncement dans la crise politique et économique, voire la démission rapide d’Emmanuel Macron avec de nouvelles élections présidentielles dans l’urgence, ne seront pas propices à empêcher l’accession au pouvoir de l’extrême droite française.
Il aurait fallu pour cela que le Nouveau Front populaire ait sérieusement labouré le terrain d’un projet, d’un programme, d’une mobilisation active de la société. Bref qu’il ait fait Front populaire. Mais un compromis sur le budget ne créera pas en soi une situation plus favorable. Cela risque tout aussi bien d’être « encore un instant, monsieur le bourreau ». Qui pourrait prédire autre chose qu’une arrivée au pouvoir de l’extrême droite en France si le dialogue entre le « socle commun » du gouvernement Bayrou et la gauche social- démocrate ne change pas la trajectoire d’une politique qui enfonce le pays et une grande majorité de la population dans un déclin sans espérance ?
Le chef de l’extrême droite appelé à former un gouvernement en Autriche
Romaric Godin sur www.mediapart.fr
Herbert Kickl, président du FPÖ, a été chargé par le président autrichien de constituer un gouvernement. Il devrait s’allier avec les conservateurs, dont l’aile proche des milieux économiques a soutenu ce renversement des alliances.
Par un renversement spectaculaire des alliances, l’extrême droite autrichienne arrive aux portes du pouvoir. Lundi 6 janvier, le président fédéral de la République d’Autriche, Alexander Van der Bellen, a reçu Herbert Kickl, chef du parti d’extrême droite FPÖ, dans son palais de la Hofburg. Il lui a officiellement confié la charge de constituer un nouveau gouvernement. S’il y parvient, Herbert Kickl sera le premier chancelier d’extrême droite de la république alpine depuis la Seconde Guerre mondiale.
La pilule a dû être délicate à avaler pour le président autrichien, ancien porte-parole des Verts, élu comme candidat indépendant en 2016 face au candidat du FPÖ, et réélu au premier tour en 2022. Alexander Van der Bellen a toujours été perçu comme un rempart contre l’extrême droite. Mais la situation politique ne lui laissait plus le choix. « Une des plus importantes charges constitutionnelles du président fédéral est de s’assurer que le pays dispose d’un gouvernement fédéral qui fonctionne », a précisé le communiqué de la Hofburg annonçant la nomination de Herbert Kickl.
Ce dernier va désormais mener des négociations avec la droite conservatrice autrichienne de l’ÖVP qui, dimanche, par la voix de son secrétaire général, Christian Stocker, s’est dite « prête à répondre à une invitation » du FPÖ pour former un gouvernement. L’affaire semble donc entendue : le FPÖ est arrivé en tête des élections fédérales du 29 septembre 2024, avec 28,9 % des voix contre 26,2 % à l’ÖVP. Les deux partis disposent d’une majorité au Conseil national, la chambre basse du Parlement.
Ces événements peuvent évoquer ce qui s’est passé en 2000, lorsque le conservateur Wolfgang Schüssel, pourtant arrivé troisième des élections fédérales de 1999, avait dirigé une alliance avec le FPÖ de Jörg Haider. La stratégie de l’ÖVP était alors de confronter l’extrême droite au pouvoir afin de lui faire perdre de la crédibilité. Le pari avait été temporairement réussi, et le FPÖ s’était fracturé et affaibli, retombant à 10 % des voix.
En réalité, la situation est très différente. Le FPÖ a soldé sa crise des années 2000. Il est devenu le premier parti d’Autriche en se radicalisant. Et c’est lui qui va diriger le gouvernement. Le potentiel chancelier fédéral, Herbert Kickl, est connu pour ses liens avec les milieux néonazis et identitaires. La volte-face de l’ÖVP n’est pas, comme en 2000, un choix tactique, c’est un choix stratégique qui consiste à fermer les yeux sur la nature du FPÖ pour conserver le pouvoir dans des domaines que les conservateurs jugent essentiels. L’ère politique qui s’ouvre en Autriche est donc complètement nouvelle.
L’échec de la coalition à trois
Comment en est-on arrivés là ? La tragédie s’est jouée en cinq actes, comme c’est de rigueur. Après les élections du 29 septembre, le premier acte met en scène une tentative de coalition excluant le FPÖ. Cet essai est mené par le chancelier conservateur sortant, Karl Nehammer. À ce moment, l’ÖVP exclut toute alliance avec l’extrême droite, insistant précisément sur le caractère infréquentable de Herbert Kickl.
En décembre, Christian Stocker affirme ainsi : « Ceux qui collaborent avec l’extrême droite en Europe sont intolérables en tant qu’hommes politiques. » S’adressant à Herbert Kickl, il ajoute : « Monsieur Kickl, personne ne veut de vous dans cette maison [la chancellerie – ndlr] et personne n’a besoin de vous non plus dans cette république. »
L’ÖVP entame donc des négociations à trois avec les sociaux-démocrates du SPÖ et le petit parti libéral Neos. L’idée est de construire un gouvernement fédéral disposant d’une majorité assez large et faisant barrage au FPÖ. Mais les négociations traînent en longueur. La construction d’un budget, notamment, pose problème. ÖVP et SPÖ défendent des positions très éloignées. Après soixante-quatorze jours de négociations, le 3 janvier, Neos décide de quitter la table des discussions. Pour les libéraux, celles-ci ne sont pas à la hauteur des « défis du moment ». Dans les faits, Neos ne parvient pas à faire valoir ses idées de vastes réformes fiscales.
Le deuxième acte s’ouvre. Karl Nehammer et le chef du SPÖ, Andreas Babler, décident de tenter de renouveler la « grande coalition ». Mais les discussions sont toujours aussi délicates sur le plan budgétaire.
ÖVP et SPÖ sont d’accord sur la nécessité d’une consolidation budgétaire. Pourtant, le déficit public autrichien n’est pas alarmant. En 2023, il a atteint 2,6 % du PIB, contre 3,3 % en 2022. Le problème de l’Autriche est bien plutôt sa croissance qui, sur un an, a stagné au troisième trimestre (− 0,1 %) et, plus largement, son modèle économique. Mais en Autriche, la pression des milieux économiques, et notamment financiers, pour réduire le déficit est très forte.
Reste que l’ÖVP et le SPÖ ne sont pas d’accord sur la méthode à employer pour réduire le déficit. Les sociaux-démocrates réclament que les plus riches soient mis à contribution et proposent une taxe bancaire alourdie et la réduction des subventions au diesel. Tout cela est inacceptable pour l’ÖVP, qui veut repousser l’âge de départ à la retraite et relever la TVA.
Rapidement, une partie de l’ÖVP semble juger le compromis avec le SPÖ impossible. Selon les révélations de la presse autrichienne, ce sont les milieux économiques au sein du parti conservateur qui ont alors mené la danse.
Samedi 4 janvier, alors que les sociaux-démocrates ont déjà abandonné deux points importants de leur programme – le rétablissement d’un impôt sur les successions et d’un impôt sur le patrimoine –, l’ÖVP, et notamment son « aile économique », rejette toute demande de surtaxe bancaire. En fin d’après-midi, après une suspension de séance, Karl Nehammer annonce à Andreas Babler qu’il rompt les négociations. Dans la foulée, il annonce sa démission de la chancellerie fédérale et de la direction de l’ÖVP.
La volte-face des milieux économiques
S’ouvre alors le troisième acte, celui du retournement des alliances de l’ÖVP. Un des artisans de cette ouverture des conservateurs à l’extrême droite semble être Wolfgang Hattmannsdorfer, nouveau président de la Chambre économique, une structure qui représente les entreprises auprès du monde politique. Il est favori pour remplacer Karl Nehammer à la tête de l’ÖVP et, peut-être, pour devenir vice-chancelier.
Le scénario qui semble s’être dessiné est que « l’aile économique » de l’ÖVP a considéré que le prix à payer pour une grande coalition, notamment une augmentation de la taxe bancaire, était trop élevé. Elle a trouvé des appuis parmi certains dirigeants du parti qui gouvernent déjà des Länder avec le FPÖ, et sont habitués à manier une rhétorique xénophobe. C’est notamment le cas de Johanna Mikl-Leitner, présidente de la région de Basse-Autriche, qui vient de déclarer qu’elle engage un « combat contre l’islam ». Selon le quotidien viennois Der Standard, elle aurait soutenu le tournant au sein de l’ÖVP.
En finir avec la grande coalition pour accepter de rejoindre un gouvernement avec le FPÖ supposait évidemment de sacrifier Karl Nehammer, défenseur de la ligne dure contre l’extrême droite. En passant, cela permettait de faire avancer l’agenda personnel d’un Wolfgang Hartmannsdorfer tout en préservant les intérêts des secteurs économiques protégés par l’ÖVP. Logiquement, Christian Stocker a traduit cette nouvelle orientation de la droite autrichienne par son invitation à la négociation avec le FPÖ.
Le quatrième acte se joue à la Hofburg, dimanche 5 janvier. Alexander Van der Bellen peut-il jouer ce rôle de rempart qui lui a valu ses deux élections à la présidence fédérale ? En octobre, il avait pu éviter de charger Herbert Kickl de former un gouvernement, en dépit de la première place du FPÖ, parce que l’ÖVP de Karl Nehammer avait exclu toute alliance avec lui. Malgré ses 27 %, le FPÖ était isolé et incapable de former un gouvernement.
Les programmes économiques de l’ÖVP et du FPÖ sont concordants. Georg Knill, président de l’Alliance industrielle autrichienne
Avec la révolution de palais chez les conservateurs, les choses ont changé. Dans une conférence de presse, dimanche 5 janvier, le président doit le reconnaître en constatant que les voix contre une alliance avec l’extrême droite « se sont faites plus silencieuses » ces derniers jours. Une litote pour constater le renversement des alliances de l’ÖVP. Dès lors, ses options étaient limitées.
Sa première possibilité aurait été de dissoudre le Conseil national. Mais cette dissolution n’est possible, selon l’article 29 de la Constitution, qu’une seule fois pour le même motif. Autrement dit, si Alexander Van der Bellen dissout le Conseil national et que les élections renvoient un Parlement de même facture, il devra se soumettre et nommer Herbert Kickl chancelier. Or les enquêtes d’opinion laissaient entrevoir un renforcement du FPÖ. Cette dissolution, intervenant trois mois après le dernier scrutin, n’aurait pas sorti le pays de la crise politique.
Nommer un gouvernement technique non plus, dans la mesure où l’ÖVP, désormais mûr pour une alliance avec le FPÖ, ne l’aurait pas nécessairement soutenu. Un tel gouvernement aurait été un moyen de forcer une grande coalition après l’échec des négociations. Il ne restait donc que deux options à Alexander Van der Bellen : sa propre démission ou la nomination de Herbert Kickl. Dimanche soir, en invitant ce dernier à la Hofburg, il a choisi cette deuxième option. Et il l’a confirmée lundi matin.
Un profil inquiétant
Le cinquième acte s’écrit en ce moment. C’est la construction de cette nouvelle alliance sur des bases qui restent à définir, mais qui semblent devoir découler des événements précédents. L’ÖVP a choisi de s’allier avec le FPÖ sur la base de priorités économiques. C’est sur ce point qu’il va défendre ses positions. Il pourra compter sur un appui prononcé des milieux économiques. Le président de l’Alliance industrielle autrichienne, Georg Knill, qui n’avait eu de cesse de fustiger le programme « ennemi de l’économie » du SPÖ durant la campagne électorale, s’est réjoui lundi que les programmes économiques de l’ÖVP et du FPÖ soient « concordants ».
Le FPÖ devra sans doute abandonner quelques promesses économiques, sur les retraites ou le salaire des fonctionnaires, mais le jeu en vaut la chandelle. D’abord parce que les milieux économiques, du moins ceux de l’ÖVP, seront sans doute ravis de lutter contre ce que Herbert Kickl appelle le « communisme du climat » : réduction des subventions aux énergies vertes et réduction des normes environnementales.
Mais surtout, il y a fort à parier que l’ÖVP lui laisse les coudées franches sur la question de la répression policière, des migrants, des discriminations. Alexander Van der Bellen a certes posé des limites au nouveau gouvernement : respect de la séparation des pouvoirs, de l’État de droit, des droits des minorités, de l’indépendance des médias et de l’appartenance à l’Union européenne.
Mais l’exemple italien et surtout l’exemple hongrois montrent bien que la stratégie de l’extrême droite est moins d’instaurer directement une dictature que de détruire sournoisement les fondements de la démocratie. Souvent avec l’appui de la droite traditionnelle.
De ce point de vue, le profil du FPÖ de 2025 est inquiétant. Son programme et ses propos visent les demandeurs et demandeuses d’asile et les minorités sexuelles et de genre, mais aussi les mineurs de moins de 15 ans condamnés qu’il veut envoyer en prison. Herbert Kickl défend la déchéance de nationalité pour les Autrichiens naturalisés condamnés, le retour aux méthodes éducatives des années 1950 ou encore l’établissement de « traîtres au peuple ».
Le point le plus délicat à résoudre sera sans doute la politique étrangère. Le FPÖ, allié du Rassemblement national (RN) au Parlement européen, est encore très eurosceptique, et il est surtout ouvertement prorusse.
En mars 2023, les députés de ce parti ont ainsi quitté les bancs du Parlement qui accueillait le président ukrainien. Mais il semble qu’il y ait de la bonne volonté des deux côtés. Ce sera sans doute un point de friction avec l’ÖVP, qui est un parti europhile et très largement pro-occidental. Mais au regard de leur volte-face, les conservateurs semblent prêts à faire bien des concessions pour éviter toute levée sur les banques ou les plus riches.
Le cas autrichien confirme donc une tendance qui semble s’accélérer depuis les derniers mois de 2024. Une part croissante du monde économique semble s’être radicalisée pour défendre ses intérêts. Dans des économies stagnantes comme l’Autriche, le capital est déterminé à ne faire aucune concession qui puisse réduire sa rentabilité. En cela, l’extrême droite, qui est, de son côté, prête à respecter les intérêts des puissances économiques et qui bénéficie d’un soutien croissant de la population, devient son alliée naturelle et utile
mise en ligne le 7 janvier 2024
Reprenons le travail
MattiefloNogi sur https://blogs.mediapart.fr/
(les intertitres et la mise en gras sont le fait de 100-paroles)
Ils nous ont volé « la République », ils nous ont volé « la laïcité », ne leur laissons pas « le travail ». Au sens propre, comme au figuré, reprenons le travail !
Ce billet d'un simple sympathisant de la gauche et des écolos propose quelques réflexions, bien inspirées par les idées de F. Ruffin.
Aux côtés de la “république” et de la “laïcité” et probablement d’autres, la notion “travail” est depuis quelques années victime d’une récupération réactionnaire. De Sarkozy à Macron, ils semblent ne plus avoir que “la valeur travail” en tête. Autrefois, notion essentielle des forces humanistes et du progrès, elle devient désormais un totem de la droite, des libéraux, voire de l’extrême-droite. Projet émancipateur, source de statut, de revenus, de protection et de fierté, le travail est en train de basculer et il devient progressivement un marqueur important dans la bataille d’idées qui fait rage.
Le travail selon la droite
Exemple révélateur, les macronistes ont presque toujours ce mot à la bouche. Lors de son discours de politique générale en janvier 2024, G.Attal déclarait : « Ma première priorité, ça va être de continuer à soutenir la France qui travaille. Il y a beaucoup de Français qui sont au rendez-vous de leurs responsabilités tous les jours, qui travaillent, parfois dans des conditions difficiles, qui font tourner le pays. »
Notons déjà le “continuer à soutenir”, avec un sens de l’ironie qu’on ne lui soupçonne pas, il fait sans doute référence à la retraite à 64 ans, mesure rejetée par 90% des travailleurs. “Des français qui sont au rendez-vous de leur responsabilité” ; le bon travailleur pour eux c’est donc celui qui surtout ne se plaint pas, prend ses responsabilités et travaille sans rien attendre en retour. L’apologie de l’effort, un peu surannée, mais qui va si bien avec leur conservatisme, n’est pas loin. Il faut comprendre, en creux, que l’adversaire c’est bien sûr celui qui ne veut pas travailler, le fainéant qui se gave d’allocations, mais jamais l’actionnaire dont les dividendes explosent (ici).
Pour eux, défendre le travail, c’est pour qu’il paye plus que l’inactivité (ex : ici). Le sous-entendu est clair, il y a ceux qui travaillent dur et ceux qui profitent. Pas question évidemment d’augmenter les salaires pour qu’ils rapportent plus, la cible désignée à la vindicte populaire c’est celui qui ne travaille pas : le demandeur d’emploi, forcément bénéficiaire d’allocations, alors que dans les faits, seulement un chômeur sur deux bénéficie d’allocations chômage. Naturellement, il est responsable, voire coupable de sa situation, puisqu’il “suffit de traverser la rue”. Pourtant les chercheurs nous rappellent qu’en aucun cas, les allocations chômage ne peuvent rapporter plus que le salaire (lire ici).
Les bénéficiaires du RSA? Ce sont forcément des profiteurs. Plutôt que de les voir comme des privés d’emploi aux situations personnelles complexes, ils sont de plus en plus fréquemment considérés comme des parasites. Grâce au gouvernement actuel, pour recevoir le RSA (607€ pour une personne seule et c’est déjà trop pour eux) le bénéficiaire devra faire 15 heures d'activité par semaine. Comment ? Avec qui ? Peu importe, l’enjeu c’est de créer une démarcation entre les allocataires et ceux qui travaillent durement : “La France qui se lève tôt”. Il s’agit d’insister sur la responsabilité individuelle, plutôt que d’offrir une solidarité minimale alors même que la société ne peut offrir un emploi décent à tous. C’est le principe des politiques dite “d’activation”, si chères à nos gouvernants, qui ont pour finalité de forcer les bénéficiaires à accepter n'importe quel emploi. Peu importe que l’effet sur le terrain soit nul (lire ici), ce qui compte c’est l’affichage.
La logique est la même avec le projet du gouvernement de réduire la durée des allocations pour les plus de 55 ans. S’ils sont au chômage c’est un choix. Il faut donc réduire la durée de leur allocation. Encore une fois, il s’agit de montrer du doigt des coupables.
En prétendant “défendre la valeur travail” (jamais les travailleurs d’ailleurs, terme trop daté pour leur novlangue de cabinet de conseils), c’est bien le travail au quotidien qu’ils attaquent : report de l’âge de la retraite, réduction du pouvoir des salariés dans l’entreprise (ordonnance Macron de 2017 qui réduit l’importance des délégués du personnel), baisse de la protection contre le chômage… Il s’agit finalement d’exiger toujours plus aux travailleurs et de réduire leur protection.
Difficile de comprendre dans ces conditions ce qu’ils défendent au juste. Il apparaît clairement que leur objectif est autre : instaurer un clivage entre les travailleurs et créer un ennemi de l’intérieur ; celui qui ne travaille pas. Dans “Je vous écris du Front de la Somme”, F. Ruffin souligne qu’à l’ancienne division “nous” contre “ils” c’est-à-dire les travailleurs contre les capitalistes, ils veulent ajouter une troisième ligne de rupture “eux” : les profiteurs, les chômeurs, bien souvent les immigrés voire les fonctionnaires. Glorifier le travail comme le font les libéraux et l’extrême droite n’a qu’un objectif : sauvegarder l’ordre établi et la domination du capital, et morceler le “camp des travailleurs”.
Quand on regarde de plus près l’état du travail en France après leurs années de politique qui vise à défendre le travail, il n’y a pourtant pas de quoi pavoiser.
Le terme “smicardisation” s’entend de plus en plus fréquemment. Pour cause, le réveil est difficile : en 2022, 17,3% des salariés sont au SMIC. Ils n’étaient que 10% en 2012. Beau résultat pour ceux qui veulent que le travail paie. Lorsqu’ils souhaitent “désmicardiser” la France, il s’agit sans aucun doute de supprimer le SMIC, une lourdeur de plus pour ceux qui veulent tout libérer (“libérer”, une autre notion probablement victime de la récupération réactionnaire).
A crier partout que le travail doit payer plus que l’inactivité, ils oublient sciemment de dire que le travail ne paie pas suffisamment. Un salarié sur six est au salaire minimum, incontestablement les salaires décrochent. Le constat est pire si on se limite aux salariés à temps-partiel : ils sont 37% au salaire minimum. Petits revenus et temps partiel subi ; le halo du chômage regroupe environ 13% de la population (ici), l’emploi est avant tout un “mal-travail”. Pire, les revenus baissent à cause de l’inflation : Le salaire mensuel a baissé de 2,6% en 2 ans, alors qu’en 2008-2009 et 2012-2013, au plus fort de la précédente crise, les salariés n’avaient pas perdu de pouvoir d’achat. Cette perte de revenus ne vient pas de nulle part : les dividendes explosent en France depuis la fin du Covid.
Au-delà de la question du salaire, et sans doute avant elle, il y a celle de la sécurité au travail et de sa pénibilité, terme que notre Président “n’adore pas” (ici).
Et pourtant le travail fait souffrir en France. Premièrement, il tue : environ 700 morts chaque année, soit deux par jours (ici). Ensuite, il abîme de plus en plus : comme le souligne F.Ruffin (ibid.) : "En 1984, il y avait 12% des salariés qui subissaient trois contraintes physiques, aujourd’hui c’est 34%.” Deux morts par jour, un tiers des salariés qui font face à des contraintes physiques, il faudrait sans doute ajouter au tableau les nombreux cas de mal-être, de burn-out, de perte de sens. Évidemment, cela ne concerne pas tous les salariés, et nombreux sont ceux pour qui le travail peut encore être une source d’épanouissement. Malheureusement, ils ne sont plus que la moitié à considérer qu’ils peuvent encore avoir une influence sur les décisions qui les concernent dans leur entreprise, contre 65% dans le reste de l’Europe (dossier Alternatives Économiques février 2024).
Pourtant, les français sont attachés à leur travail et ils en attendent beaucoup.
C’est une particularité des français, qui explique sans doute notre relation complexe avec le travail, entre 1999 et 2018, plus de 60 % des Français déclaraient que le travail était très important dans leur vie, contre 50 % pour les Danois, les Hollandais, les Allemands ou les Britanniques (source : Bigi, M., Méda, D. Prendre la mesure de la crise du travail en France. SciencesPo, laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques.) Cette appréciation est partagée en France par toutes les catégories de population, y compris par les étudiants et les retraités qui sont généralement moins concernés par le sujet.
La France est ainsi « l’un des pays européens où les attentes par rapport au travail sont les plus élevées : au-delà du salaire, les Français attendent de leur travail qu’il soit intéressant et leur fournisse un cadre fort de sociabilité”. (source ibid.)
Des attentes très fortes vis-à-vis du travail font ainsi face à des salaires insuffisants, une pénibilité qui va croissante, et un sens au travail qui s’étiole. Le cocktail s’avère explosif. Pourtant nos gouvernants ne semblent pas considérer ces sujets comme essentiels. Ils semblent oublier que la plupart des travailleurs ont à coeur de bien faire leur métier. “Le plaisir du travail bien fait” et “l’art du métier” sont une composante majeure du dynamisme des entreprises, et à trop maltraiter le travail, les risques de décrochage sont importants comme le montrait il y a quelques années Jacques Généreux dans “la Déconommie”.
Face à cela, que serait-il possible de faire pour défendre le travail dans les faits et non dans les mots? Proposons, en toute modestie, quelques pistes.
Tout d’abord, il est indispensable de poursuivre la bataille des idées, “tenir la tranchée” et rappeler inlassablement à quel point les gouvernements successifs ont abîmé le travail. Face aux offensives des médias aux mains de millionnaires, aux éditorialistes au service des puissants, il faut rappeler partout que le chômeur ne choisit pas de l’être, mais subit un système qui n’offre pas sa chance à tout le monde, que le bénéficiaire du RSA n’est pas un profiteur mais qu’il bénéficie d’une solidarité pour faire face à une situation difficile, que le fonctionnaire n’est pas un fainéant mais œuvre comme il peut au bien commun, que le migrant n’est pas là pour voler notre travail mais contribuer à la richesse nationale, que les cotisations sociales ne sont pas des charges mais des contributions pour assurer la protection de tous face aux aléas de la vie, et enfin que le salaire n’est pas un coût mais une richesse. Là où ils cherchent à nous diviser, à cliver, il faut rassembler largement tout ceux qui n’ont que leur travail pour vivre et qui, le plus souvent, souhaitent le faire bien.
Ensuite, il semble important de soutenir l’aspiration de tous ceux qui souhaitent travailler mieux. Un mouvement porté par une jeune génération en quête de sens, de nombreuses organisations, le secteur de l’ESS, le mouvement coopératif (une belle illustration avec les Licoornes) et tous ceux qui souhaitent entreprendre autrement, et qui intègrent d’ambitieux principes de démocratie, de partage, de défense de l’environnement ou de relocalisation dans leurs modèles. Il s’agit de ne pas d’être dupes, et dénoncer ceux qui pratiquent seulement l'affichage et le greenwashing (lire ici) en maintenant un système destructeur fondé sur l’exploitation de la nature, mais bien de valoriser et défendre, ceux qui sont intègres dans leur démarche peut contribuer à asseoir leur place dans l'économie et redonner du sens pour de nombreux travailleurs.
Enfin, évidemment, il faudra réclamer haut et fort la défense des salaires et des conditions de travail, en sortant du piège tendu par les modèles type “prime Macron” ou baisse des “cotisations sociales” qui donnent d’un côté et reprennent de l’autre. Cela est essentiel. Il peut s’agir de limiter les écarts de salaires de 1 à 20 dans l’entreprise ou encore d’indexer les salaires sur l’inflation. Augmenter les salaires peut toutefois être inutile dans un contexte de forte inflation. Une piste intéressante, peut-être plus efficace et vertueuse pour notre démocratie, pourrait être d’agir du côté des charges incompressibles de tout un chacun en portant une politique ambitieuse de renforcement des services publics : le logement en premier lieu (logements sociaux, rénovation…), éducation et soins de qualité et gratuits, politique pour les transports en commun et les mobilités alternatives, voire renforcement du service public de l’énergie… Les services publics sont bien “le capital de ceux qui n’en ont pas” et apportent de précieux moyens à tous les citoyens.
Face aux risques politiques, économiques, sociaux et climatiques qui nous font face (précédent billet : quel est le moment ?), reprendre le travail ouvre un horizon supplémentaire pour proposer une alternative mobilisatrice.
mise en ligne le 6 janvier 2025
Mayotte, la gauche attendue
par Catherine Tricot sur www.regards.fr
Macron, Bayrou et Le Pen se sont rendus à Mayotte et ont fait entendre leurs visions de la reconstruction de l’île. Bien vite, sûrement, entendrons-nous les visions de la gauche.
Comment reconstruire Mayotte ? Les réponses deviennent l’emblème des différents projets politiques. Premier à s’être rendu sur place, Emmanuel Macron était mal préparé, a apporté des vivres en quantité symbolique (quatre tonnes) et a eu des mots brutaux pour intimer aux Mahorais davantage de reconnaissance envers la France. Comme une loupe sur son empêchement d’agir qui le rend encore plus désagréable.
Deux semaines plus tard, le premier ministre et une partie de son gouvernement sont venus avec un plan d’urgence qui sera présenté ce mercredi en conseil des ministres et sous 15 jours au parlement. Il annonce des prêts garantis par l’État avec différé de remboursement, l’électricité d’ici la fin janvier, une rentrée scolaire adaptée, des lois dérogatoires en matière économique (type zone franche) et de droit de la construction.
Emmanuel Macron comme François Bayrou relancent le débat sur la remise en cause du droit du sol pour faire face à l’ampleur de l’immigration illégale venues des Comores. Ils sont validés par de très larges pans médiatiques. Daniel Cohn-Bendit a apporté sa contribution en parlant absurdement de « grand remplacement » qui menace Mayotte.
Dans ce contexte politiquement très favorable, Marine Le Pen débarque sur l’île. D’ores et déjà les dirigeants du RN expriment sur les antennes l’approche de la cheffe de l’extrême droite : remise en cause du droit du sol, rentrée scolaire maintenue avec évacuation des écoles occupées par des Mahorais sans logement, non reconstruction des bidonvilles, déploiement de l’armée. Marine Le Pen dira sûrement que la France a manqué à ses devoirs vis-à-vis de Mayotte et elle s’inscrira dans la logique des propositions de François Bayrou.
La fin des vacances sera, on l’espère, l’occasion d’entendre les propositions de la gauche. Aujourd’hui, elle rappelle à bon droit que l’ampleur des désastres est liée à l’extrême précarité des constructions et à la grande misère, et que tout cela nourrit le vote d’extrême droite. Certes. Mais face aux discours autoritaires et dérégulateurs, on aimerait de franches positions de gauche sur la reconstruction.
Mayotte ne sera pas reconstruite ni contre ni sans les Mahorais. Cela ne fait aucun sens d’annoncer l’interdiction de la reconstruction des bidonvilles. Il faut aider les Mahorais à rebâtir des maisons plus solides, mieux contreventées, évidemment avec les tôles qui sont leur trésor. Il faut livrer du bois de construction et enclencher un processus de solidification de ces villes précaires. Là se joue l’action de la puissance publique. Comme ailleurs dans le monde, comme en France dans les banlieues du début du 20ème siècle, cela passe par la réalisation de routes et non de chemin de terre avec de l’éclairage public, des réseaux d’électricité, d’eau et d’égouts. Cela passe par des services de ramassage des ordures. C’est dans ces services publiques que se joue, ici comme partout, une possible vie digne.
Cela ne fait aucun sens non plus de prétendre faire une rentrée scolaire « normale », même différée d’une semaine. 70% des écoles sont a minima endommagées, les professeurs touchés, choqués ; les enfants traumatisés et démunis. Il faut inventer (en fait, s’inspirer d’autres expériences) l’école hors les murs avec délicatesse.
Cela ne fait aucun sens de couper Mayotte de son archipel. Alors que les liens sont séculaires, la rigidité des autorisations de séjours à Mayotte alimente le désastre des clandestins. Il faut revenir à la raison : alors que 10% des personnes présentes illégalement sont évacuées chaque année, on ne réglera rien en passant à 20, 40, 50% d’évacuations. Aussi difficile et inhabituel que cela soit, il faut penser ensemble Mayotte et les Comores. Et avec les dirigeants islamistes des Comores, aussi détestables qu’ils soient. Il faut obtenir des nouvelles de la mission de recensement des morts… Enfin, il faut cesser les prétentions absurdes qui ne font qu’accroitre l’incrédulité et la défiance à l’égard du discours public.
L’État doit mobiliser une diplomatie créative, déployer des moyens techniques et matériels pour réparer écoles et bâtiments publics, reconstruire l’île et ses habitants. Mais il doit surtout changer d’approche : faire avec les Mahorais et appeler à une large mobilisation, partout en France, celle des bâtisseurs (architectes, ingénieurs, étudiants), des professeurs, des soignants. Une société ne se reconstruit pas seulement par l’État, encore moins quand il suscite de la défiance. Les ressources fondamentales sont en nous : tel pourrait être un projet et un discours de gauche sur la Nation et sur les fonctions de l’État.