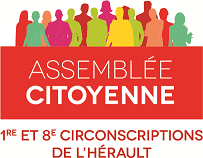environnement - 2025
<<
mise en ligne le 26 septembre 2026
Le coût des pesticides
sur le système de santé inquiète des mutuelles
Par Nicolas Malarte sur https://reporterre.net/
Vingt mutuelles françaises et belges se mobilisent contre l’usage des pesticides en Europe. Responsables de maladies chroniques, ces produits participent au déséquilibre budgétaire du système de santé.
Une agriculture sans pesticides, c’est une perspective souhaitable, autant pour la santé humaine... que pour les dépenses des mutuelles. Lors d’un point presse tenu le 23 septembre aux côtés d’organisations écologistes [1], l’association Mutuelles pour la santé planétaire a rappelé la menace que les produits phytosanitaires font peser sur leurs budgets.
Ces vingt mutuelles françaises et belges (Aésio, Mutualis, Solimut...) représentent plus de 12 millions de personnes et appellent à tendre vers un futur européen sans pesticides. Suppléant la Sécurité sociale, les mutuelles sont des sociétés à but non lucratif, qui gèrent notamment les complémentaires santé de leurs membres.
Au vu de la tendance d’austérité qui entoure le futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, l’association mutualiste s’inquiète. « Dernièrement, les PLFSS visaient à transférer les déficits de la Sécurité sociale vers les mutuelles, donc les assurés », explique la trésorière de l’association, Jocelyne Le Roux. Selon elle, interdire les pesticides pourrait permettre de réduire les dépenses et ne pas faire peser ce coût sur les cotisations des assurés.
Les pesticides favorisent les maladies chroniques
Parmi ces dépenses qui inquiètent, ce sont surtout les traitements des maladies chroniques, ou affections de longue durée (ALD), qui sont ciblés. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a établi un lien entre exposition aux pesticides et plusieurs ALD. Entre autres, sont listés la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs et le cancer de la prostate.
Leurs traitements et soins associés sont totalement couverts par le système de santé français, dont elles constituent le plus gros poste de remboursement. En 2022, près des deux tiers des dépenses de l’assurance-maladie ont été adressées aux assurés ALD, soit 126 milliards d’euros.
Ce régime concernait 13,8 millions de personnes en France cette année-là, un nombre qui ne fait qu’augmenter selon Martin Rieussec-Fournier, président de l’association mutualiste. « On voit une augmentation des maladies dégénératives et hormonales », dont sont en partie responsables les pesticides et les perturbateurs endocriniens qu’ils contiennent, avance-t-il.
La situation fait donc peser un risque sur le système de santé, surtout dans un contexte budgétaire serré. S’appuyant sur un rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale, Jocelyne Le Roux rappelle l’importance d’interdire les pesticides. « Sur le déficit annuel de la Sécu, qui devrait dépasser 20 milliards d’euros en 2025 [...] 10 milliards viendraient des maladies chroniques », auxquelles l’exposition aux pesticides contribue.
Le coût caché des pesticides
Ainsi, s’attaquer à l’utilisation des pesticides est une façon pour ces vingt mutuelles de baisser le coût qu’ils induisent sur la santé et la société. Un coût caché « qui met en danger la Sécu et les mutuelles, mais qui reste difficile à estimer », selon Martin Rieussec-Fournier.
En 2022, un rapport du Bureau d’analyse sociétale d’intérêt collectif (Basic) considérait que les effets de ces produits phytosanitaires avaient généré au moins 372 millions d’euros de dépenses publiques pour l’année 2017 en France. Sur cette somme, 48,5 millions d’euros correspondent aux dépenses de santé (la majorité de la part restante est liée au traitement de l’eau).
Si les travailleurs agricoles sont les premières victimes des effets des produits phytosanitaires, le président des Mutuelles pour une santé planétaire rappelle que tout le monde est touché : « On retrouve des résidus dans l’air, les aliments non bio, l’eau du robinet... » La situation concerne par exemple les riverains d’exploitations viticoles, comme en témoigne une étude parue en septembre. Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a enregistré une hausse de 43 % des demandes en 2024.
Garder le cap européen
Les Mutuelles pour la santé planétaire et leurs associations partenaires entendent élargir la mobilisation au niveau européen. Elles appellent notamment à appliquer la législation européenne sur l’évaluation de la toxicité des pesticides et à maintenir les objectifs de réduction de moitié des pesticides d’ici à 2030, comme le prévoyait le Pacte vert européen, et 100 % pour 2050.
Ces demandes seront portées par l’Odyssée pour notre santé, une caravane à vélo qui traversera l’Europe d’ici à 2027 pour « toucher le grand public sur les problématiques des pesticides et proposer des alternatives », explique Martin Rieussec-Fournier. Organisée par les quatre associations, la caravane partira du Parlement européen de Bruxelles, samedi 27 septembre, à 14 heures.
mise en ligne le 22 septembre 2025
COP30 : la trajectoire climatique européenne s’embourbe, la faute à la France qui trouble le jeu
Antoine Portoles sur www.humanite.fr
COP30 - À moins de deux mois du prochain sommet onusien sur le climat, les États membres de l’Union européenne sont incapables de se mettre d’accord sur un objectif clair de décarbonation, au risque de mettre en péril l’accord de Paris. Une situation provoquée par la France, qui cherche à remodeler l’objectif climatique 2040 de l’UE à sa guise.
Les leaders européens nous feraient-ils le coup de la panne ? Longtemps fixée comme une priorité à l’agenda de l’Union européenne (UE), la lutte contre le réchauffement planétaire a depuis été reléguée au profit de la compétitivité et de la course à l’armement.
Ce constat amer découle de l’impasse à laquelle sont actuellement confrontés les Vingt-Sept, dont les ministres respectifs de l’Environnement se sont réunis, jeudi, à Bruxelles, pour tenter d’accoucher d’un objectif climatique européen à horizon 2040. De cette ambition devait être tirée une cible commune de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2035, telle qu’exigée en vertu de l’accord de Paris, aussi nommée les contributions déterminées au niveau national (NDC).
La trajectoire climatique, un point d’achoppement entre les États membres
Les États sont censés les soumettre ou les mettre à jour tous les cinq ans auprès des Nations unies, en l’occurrence d’ici le 24 septembre, à l’occasion de l’Assemblée générale, à New York, mais surtout en vue de la COP30, qui débutera le 10 novembre, à Belém (Brésil).
Alors que les NDC sont un enjeu primordial, avant tout parce qu’elles constituent l’instrument de planification de la baisse des émissions de CO2, force est de constater qu’à l’issue de la réunion des ministres européens de l’Environnement, l’échec est cuisant, tant cette question de la trajectoire climatique à adopter est devenue un point d’achoppement entre les États membres.
La base de négociations étant l’objectif établi par la Commission, à savoir une décarbonation de l’Europe à hauteur de – 90 % en 2040, pour atterrir sur la neutralité carbone en 2050.
Pour sauver les meubles, le Danemark, qui occupe la présidence tournante de l’UE, s’est contenté d’une « déclaration d’intention » : la présentation d’une fourchette de baisse des émissions linéaire pour les dix ans à venir, entre – 66,3 % et – 72,5 % par rapport à 1990. Ce qui permettrait ainsi de gagner un peu de temps et d’espérer arracher un compromis plus précis d’ici le sommet onusien brésilien.
Stratégie gagnante ou vœu pieux ? C’est en tout cas cette fourchette intermédiaire que l’hyperprésidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait porter à l’ONU dès la semaine prochaine. « Au bout du compte, nous continuerons d’être soit les plus ambitieux, soit parmi les plus ambitieux », s’est vanté, jeudi, Wopke Hoekstra, commissaire européen au Climat. C’est ce qui s’appelle se leurrer.
Derrière cette léthargie ambiante se joue un blocage institutionnel mené de front par la France, accompagnée notamment par la Pologne, la Hongrie ou encore l’Italie. Et Berlin a désormais rejoint Paris dans son exigence que « la discussion n’ait pas lieu de manière ordinaire – soit au travers du Conseil des ministres de jeudi – mais au niveau du Conseil européen, avec les chefs d’État et de gouvernement », souligne à l’Humanité Neil Makaroff, directeur du think tank Strategic Perspectives.
Cela impliquerait un vote non plus à la majorité qualifiée des ministres de l’Environnement, mais à l’unanimité des Vingt-Sept, les 23 et 24 octobre prochains. « Il s’agit pour eux de faire monter les enchères pour parvenir à un accord, quitte à le faire capoter, ajoute-t-il. C’est un pari extrêmement risqué pour la crédibilité de l’UE. »
Un backlash écologique en corrélation avec la montée de l’extrême droite
La France cherche en réalité à remodeler l’objectif climatique 2040 de l’UE à sa guise, en réclamant des garanties sur le financement de la décarbonation de l’industrie, sur la réindustrialisation, mais aussi sur la prise en compte du nucléaire – au cœur du mix énergétique français – parmi les sources de décarbonation. Sur cette dernière condition, la Commission lui a concédé des avancées. Mais le compte n’y est toujours pas.
Au-delà d’Emmanuel Macron, pour certains responsables européens tels que le nationaliste Viktor Orbán en Hongrie, le véritable dessein de cette fronde n’est pas d’obtenir de la flexibilité sur les engagements climatiques, mais bien de les torpiller. L’accord de Paris, qui fête cette année ses 10 ans, est donc en train de faire l’objet d’un jeu de dupes. La principale conséquence de ce brouillage est que les États membres « pourraient être les derniers à porter un objectif clair à la COP30 » ou, dans le pire des scénarios, qu’il n’y ait tout simplement « pas d’accord », craint Neil Makaroff.
Le temps où l’Europe était la mieux-disante sur les enjeux climatiques semble révolu. D’autant que cet imbroglio s’ajoute à d’autres reculs, à l’instar du détricotage du Pacte vert par la très droitière Commission européenne, ainsi que du deal inique UE – États-Unis convenu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen dans le dos des Vingt-Sept. Telles sont les occurrences d’un backlash écologique en corrélation avec la montée de l’extrême droite sur le continent. Ce qui est certain, c’est que la perte du leadership européen en matière de climat aura un impact notable à Belém, en novembre.
mise en ligne le 3 juillet 2025
Le Haut conseil pour le climat appelle à « relancer l’action climatique en France » dans son dernier rapport
Jessica Stephan sur www.humanite.fr
Dans son 7e rapport, le Haut conseil pour le climat constate un affaiblissement des politiques publiques climatiques, alors que les impacts du réchauffement s’aggravent. L’institution appelle à les relancer et à davantage de lisibilité.
Pour qui suit les aléas politiques en matière de réglementation environnementale, le constat n’est pas surprenant : « le pilotage de l’action climatique s’affaiblit », alors que « les impacts du changement climatique s’aggravent ». Le 7e rapport du Haut conseil pour le climat sur l’action publique de la France en la matière, que l’institution a pour mission d’évaluer, fait état ce jeudi 3 juillet d’un bilan peu reluisant, au sortir d’un épisode de canicule intense.
« Nous sommes inquiets », confie Jean-François Soussana, président du Haut conseil pour le climat, lors de la présentation du rapport. En termes de rythme de la décarbonation, « le cadre de l’action publique a pris un retard important », indique-t-il encore. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), documents cadres qui fixent les trajectoires, se font toujours attendre. Ce qui, selon le Haut conseil, engendre un manque de lisibilité et des difficultés pour les acteurs concernés à engager des actions.
L’action climatique au point mort
Les enjeux climatiques sont aujourd’hui « évidents, plus réels et tangibles », selon Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche en sociologie au CNRS et membre du Haut conseil pour le climat, et représentent une réelle préoccupation pour les citoyens. Mais ces enjeux sont « instrumentalisés dans le débat politique », dans une société aujourd’hui « extrêmement polarisée », déplore-t-elle.
D’autant que sur le territoire métropolitain, « le réchauffement observé atteint 2,2 °C en 2015-2024 » par rapport à l’ère préindustrielle, rappelle l’institution. L’Union européenne et la France en particulier se réchauffent plus vite que le reste du globe. « Nous avons des besoins d’adaptation croissants », souligne Jean-François Soussana, qui insiste : « il ne peut y avoir de transition si elle n’est pas pour tous. » D’autant que les mesures existantes en termes d’adaptation, notamment dans le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3), sont selon le rapport « encore en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins ».
L’institution « appelle à relancer l’action climatique en France ». Manière de dire, en creux, qu’elle se trouve au point mort. Un constat inquiétant, dans un contexte géopolitique difficile. Car même si le Haut conseil n’œuvre qu’à l’échelle nationale, le contexte international et la guerre climatosceptique de l’administration Trump aux États-Unis est dans tous les esprits. Jean-François Soussana espère « un sursaut au niveau mondial » pour cet enjeu majeur qui dépasse les frontières.
La sortie des énergies fossiles est cruciale
La France n’est pas exemplaire. Entre 2022 et 2023, les émissions nationales de gaz à effet de serre brutes avaient baissé de 6,7 %. Mais en 2024, la décroissance freine, n’atteignant que de 1,8 % par rapport à 2023. Et, stipule le rapport du Haut conseil, une grande partie de cette baisse s’explique par des facteurs conjoncturels, liés au secteur nucléaire, à un hiver doux, et à la diminution de l’élevage en raison de difficultés socio-économiques. Le troisième budget carbone du pays – la quantité de gaz à effet de serre que peut émettre la France pour la prochaine période – sera donc « plus difficile à atteindre », précise Jean-François Soussana, et les objectifs à horizon 2030 risquent fort d’en pâtir.
Les combustibles fossiles représentent les deux tiers des émissions de la France. Pour les baisser, la sortie des énergies fossiles est donc cruciale. Mais là encore, l’action publique est à la traîne. Alors que les transports comptent pour 34 % des émissions nationales, « il nous manque un plan sur la mobilité longue distance », atteste Jean-François Soussana. Pour atteindre les objectifs à horizon 2030 du projet de Stratégie nationale bas carbone, il faudrait, selon le rapport, que la baisse des émissions soit en moyenne quatre fois plus forte que celle observée entre 2023 et 2024.
Si rien n’est fait, le nombre de jours de canicule par an pourrait se voir multiplié par trois d’ici 2030, par cinq d’ici 2050, et par dix d’ici 2100 – l’équivalent de plus de deux mois par an – par rapport à la période 1976-2005. Ce rapport signe un nouveau rappel de l’urgence climatique, en cette année anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat et à quelques mois de la COP30 à Belém, au Brésil.
mise en ligne le 30 juin 2025
Loi Duplomb :
les agriculteurs sont
les premiers malades
des pesticides
sur https://lareleveetlapeste.fr/
Alors que la loi Duplomd doit être examinée en Commission mixte paritaire à partir de ce lundi 30 juin, la Ligue contre le Cancer dénonce « un recul majeur pour la santé publique ». Et notamment pour celle des agriculteurs, premières victimes de l’exposition aux pesticides.
Des manifestations ont eu lieu tout le weekend contre la loi Duplomb : en Anjou, paysan-es et habitant-es ont bloqué un site de production de pesticides. A Paris, environ un millier de personnes se sont réunies à l’appel du Collectif Nourrir, et 10 000 sur l’ensemble du week-end dans 60 villes, à la veille de l’examen du texte en commission mixte paritaire.
A huis clos, sept députés et sept sénateurs se réunissent, ce lundi 30 juin en début d’après-midi au Sénat, pour trancher sur la proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », et prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire de certains néonicotinoïdes. Or, une large majorité d’élus (dix contre quatre) sont favorables au texte.
Si elle était adoptée, cette loi serait « un recul majeur pour la santé publique » selon la Ligue contre le Cancer. L’association a demandé le retrait des articles réautorisant un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l’acétamipride, particulièrement toxique pour la biodiversité, mais aussi les agriculteurs, fleuristes et riverains des zones d’épandage.
En effet, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) « établit depuis 2013 un lien entre l’exposition aux pesticides et certains cancers, lien reconfirmé en 2021 ». La présomption d’un lien est « forte » pour « les lymphomes non hodgkiniens (cancers du système lymphatique), le myélome multiple (cancers du sang), les cancers de la prostate ainsi que les cancers de l’enfant suite à une exposition pendant la grossesse », « moyenne » pour les leucémies.
Michel est un ancien technicien agricole qui a survécu à un lymphome, reconnu maladie professionnelle. « J’ai employé du glyphosate, des désherbants avec du petit matériel mais sans les protections parce qu’au début, nous n’avions pas conscience du tout que ce soit dangereux à ce point-là. »
En France, depuis le milieu des années 2000, la cohorte AGRIculture & CANcer (AGRICAN) a permis de valider les effets d’expositions professionnelles agricoles – incluant les pesticides – sur les cancers de la prostate, de la vessie, du côlon et du rectum, du système nerveux central, des ovaires ainsi que pour les myélomes multiples ou les sarcomes.
« Cette loi sacrifie le principe de précaution, qui devrait commander à toute décision en matière de santé publique, sur l’autel du court-termisme », affirme Francelyne Marano, toxicologue et présidente du comité de pilotage cancer et environnement de la Ligue, citée par le communiqué. « Nous risquons de payer un jour ou l’autre les surcoûts liés aux futurs cancers », estime-t-elle.
« L’impact des facteurs environnementaux sur la santé fait d’ailleurs l’objet d’inquiétudes légitimes de plus en plus grandes, comme en témoigne la suspicion, en mars dernier, de nouveaux clusters de cancers pédiatriques autour de La Rochelle » note la Ligue.
En mai 2025, la ligue contre le Cancer dévoilait dans une étude un nombre de cancers pédiatriques anormalement élevés sur plusieurs territoires de Charente-Maritime. En cause : l’utilisation intensive des pesticides, notamment pour la viticulture.
Le réseau France Eau publique, qui regroupe 123 collectivités et opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement, a mis en garde les quatorze membres de la CMP contre « la dégradation des milieux naturels, avec des conséquences lourdes sur les pollinisateurs, les sols, la santé humaine – notamment le développement neurologique des jeunes enfants – et bien sûr les ressources en eau, vecteurs majeurs de diffusion de ces substances ».
Pire, le changement continu de molécules de pesticides par les industriels, pour échapper à la régulation, brouille les pistes sur leur niveau de dangerosité car cela ne laisse pas le temps aux scientifiques de l’étudier.
Reste donc à voir ce que va advenir de ce texte de loi : en cas d’accord lors de la CMP, il sera soumis au vote de chaque Chambre du Parlement.
mise en ligne le 27 juin 2025
Réchauffement climatique : la marche arrière promue par Donald Trump contamine l’Europe
Antoine Portoles sur www.humanite.fr
L’année 2025 est synonyme de « backlash » pour la préservation de la planète, avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Cette tentation de la marche arrière, présente en Europe depuis plusieurs années, risque de s’amplifier sous l’effet des armes et du business.
Le backlash. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis, quand, dans les années 1990, la journaliste et essayiste Susan Faludi décrivait les vents contraires dont étaient victimes les mouvements féministes. Voilà qu’il fait florès depuis plusieurs mois, cette fois-ci au sein des mouvements écologistes. Que ce soit contre les femmes, les minorités ou les droits des travailleurs, droite et extrême droite versent, comme toujours, dans l’escalade réactionnaire. Leur nouvelle proie : la transition écologique.
Alors que l’urgence climatique devrait au contraire appeler à accélérer les efforts, ils sont parvenus à instiller dans l’opinion publique l’idée que nous serions allés trop loin pour sauver l’habitabilité de la planète et qu’il faudrait donc faire marche arrière. Ce discours fallacieux a été catalysé par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en janvier. Cinq mois après le début de son second mandat, le leader nationaliste a déconstruit méthodiquement la politique climatique états-unienne : coupes budgétaires draconiennes et licenciements parmi la communauté savante, retrait derechef de l’Accord de Paris de 2015 et des négociations multilatérales sur le climat, mais surtout relance du charbon et boom des forages pétrogaziers. Dernière trouvaille de l’administration trumpiste : l’ouverture à l’exploitation de 23 millions d’hectares de forêts encore intactes et protégées depuis un demi-siècle.
En sus de leurs impacts dévastateurs sur les émissions de gaz à effet de serre – les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial derrière la Chine –, ces décisions s’assoient sur la science et galvanisent les climatosceptiques. Sur ce point, « la radicalité de Trump est difficilement entendable en Europe », estime Théodore Tallent, doctorant au Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Mais il craint que « les discours anti-science » finissent à terme par se propager.
« Cela fait cinq ou six ans déjà que l’extrême droite européenne fait petit à petit sa mue anti-climat, car ça marche d’un point de vue électoral, et cela, Trump l’a compris avant eux », considère Emiliano Grossman, chercheur et professeur associé à Sciences Po. Les droites dites « modérées » s’engouffrent à leur manière dans la brèche, en relativisant l’urgence climatique. En réalité, « si Trump a accéléré la délégitimation des discours écolo, ce phénomène est apparu il y a déjà environ deux ans avec la montée des discours sur la simplification administrative et sur la dérégulation dans le bloc central européen », rappelle Théodore Tallent.
Arrivée à la tête de la Commission européenne en 2019, Ursula von der Leyen avait, dans la lignée de l’Accord de Paris 2015 et des manifestations sur le climat, promu un plan européen de décarbonation certes imparfait, mais ambitieux. Le « pacte vert », comme on l’appelle, était alors soutenu y compris dans les rangs du Parti populaire européen (PPE), dont la présidente est issue. Réélue pour un second mandat l’an dernier, elle a, depuis, tourné casaque. L’UE a retardé d’un an une réglementation destinée à éradiquer la déforestation sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. Les constructeurs automobiles ont obtenu deux années de plus pour respecter les objectifs de pollution. Les ONG environnementales sont menacées de voir leurs financements gelés. Et cette semaine, une loi anti-greenwashing a carrément été enterrée, sous la pression de la droite et de l’extrême droite.
Le pacte vert saboté
L’heure est à la dérégulation tous azimuts, au nom de la sacro-sainte compétitivité. Le pacte vert reposait essentiellement sur deux directives : la CSRD, sur le reporting de durabilité ESG (standards environnementaux, sociaux et de gouvernance) et la C3SD, sur le devoir de vigilance des entreprises. La Commission européenne avait prévu de reporter leur application d’un an, soit à partir de 2028. Mais lundi, le Conseil européen est allé encore plus loin. Les Vingt-Sept sont parvenus à fixer les grandes lignes de la directive Omnibus, censée réduire la portée des deux précitées.
S’agissant de la C3SD, les seuils des sociétés concernées ont été relevés à 5 000 salariés (contre 1 000 auparavant) et à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires net (450 au départ). La vigilance sera cantonnée aux seuls fournisseurs directs et, surtout, la responsabilité civile de l’entité ne pourra plus être mise en cause. Même sabotage pour la CSRD, circonscrit aux entreprises de plus de 1 000 salariés générant 450 millions d’euros de chiffre d’affaires ; 85 % des sociétés sortent ainsi de son champ d’application.
L’UE a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, avec une baisse des émissions de CO2 de 55 % en 2030 par rapport à 1990, et de 90 % dès 2040. Alors que se tient ce jeudi le sommet des chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles, Emmanuel Macron veut mettre le sujet sur la table… Au risque de semer la zizanie. « On garde l’objectif (de 2050), mais on est pragmatique sur les trajectoires », a rapporté un proche du président de la République au Monde.
Tandis que plusieurs États membres – tels que la Hongrie de Viktor Orbán, biberonnée à la doctrine anti-climat de Trump – s’en remettent à la COP30 de Belém (Brésil) en novembre, d’autres, comme l’Espagne ou le Danemark veulent garder le cap ambitieux de 2040. Un objectif que la France accueille avec réserve, soucieuse de préserver son mix énergétique. Côté allemand, la coalition menée par le chancelier Friedrich Merz, récemment élu, plaide, comme la France, pour une décarbonation accompagnée de flexibilité.
Derrière l’enjeu de la compétitivité se cache surtout celui de la défense européenne, propulsé par la guerre en Ukraine. Là aussi, Trump mène la danse : lors du sommet de l’Otan qui s’est déroulé les 24 et 25 juin à La Haye, le président états-unien a réussi à soumettre les membres européens de l’Alliance Atlantique à une hausse historique de leurs dépenses militaires à hauteur de 5 % de leur PIB. « L’écologie est traitée en silo. Dès lors qu’elle est concurrencée par les questions de réarmement, elle passe à la trappe », constate Théodore Tallent. Mais celui qui est également chercheur affilié au centre de recherches de l’Université de Cambridge soutient une tout autre approche : « Il faut être l’idiot utile de Trump et de Poutine pour ne pas comprendre que la transition écologique nous rend justement indépendants d’eux. »
mise en ligne le 24 juin 2025
Accès à l’eau potable en Outre-Mer : dix associations dénoncent une « discrimination environnementale territoriale »
Jessica Stephan sur www.humanite.fr
Boire, se laver, manger… Autant de gestes du quotidien qu’une partie des citoyens français des Outre-Mer ont des difficultés à réaliser, en raison des problèmes d’infrastructure, des contaminations ou des tarifs de l’eau. Les associations dénoncent une « discrimination environnementale territoriale »
En matière d’eau potable, l’égalité territoriale est loin d’être respectée. Trois millions de personnes en France subissent des difficultés pour y accéder, rappelle un rapport de plusieurs ONG, rendu public ce lundi 23 juin. Intitulé « Soif de justice », il dénonce les inégalités d’accès à l’eau dans les Outre-Mer et tire la sonnette d’alarme sur les conséquences en termes sanitaires ainsi que pour les droits fondamentaux.
Dix associations, locales et nationales, sont à l’origine de cette alerte, déterminées à dénoncer une « discrimination environnementale territoriale » : L’ASSAUPAMAR (Martinique), le Collectif des luttes sociales et environnementales, Guyane Nature Environnement, Kimbé Rèd F.W.I. (Antilles), Lyannaj pou dépolyé Matinik, Mayotte a soif, Mayotte Nature Environnement, Notre Affaire à Tous, Sillages (La Réunion), et l’association VIVRE (Guadeloupe). Selon elles, la situation ne pourra pas être résolue tant qu’elle ne sera pas pleinement reconnue en tant que discrimination.
Plusieurs causes pour une même difficulté
Leur rapport sera donc transmis au rapporteur spécial des Nations Unies sur l’accès à l’eau potable pour « donner un éclairage international sur cette discrimination territoriale structurelle, et pousser la France à se prononcer et à avancer sur ces questions », indique Emma Feyeux, responsable de projet au sein de Notre Affaire à Tous.
Difficultés techniques ou d’infrastructures engendrant des coupures d’eau régulières, pollutions, tarification très élevée… Plusieurs causes sont pointées pour une même difficulté : l’accès à l’eau potable, pourtant reconnu comme un droit fondamental par le droit international et européen.
« Une des causes profondes de ces situations relève de la discrimination systémique entre les territoires ultramarins et l’Hexagone », dénonce Sabrina Cajoly, fondatrice de Kimbé Rèd FWI. Pour preuve, explique-t-elle, les « territoires français des Outre-mer sont exclus d’un traité des droits de l’homme, la Charte sociale européenne, qui porte sur tous les droits économiques et sociaux, y compris l’accès à l’eau. »
« En Guadeloupe, il y a eu du chlordécone dans l’eau du robinet »
En cause également, selon les ONG, un manque de mobilisation au niveau national et de compréhension de ces problématiques, mais également une dilution des compétences : « En matière d’accès à l’eau potable, il reste très difficile d’agir en responsabilité de manière globale du fait du nœud de compétences » estime Emma Feyeux. L’État renvoie aux collectivités, qui sont compétentes en la matière mais manquent de moyens. Et de nombreux acteurs interviennent : « Il reste difficile de remonter la chaîne des responsabilités », poursuit-elle.
Alors que les impacts sont multiples : sur le droit à la dignité humaine, la santé, la vie privée… Et les conséquences très concrètes, rappelle Sabrina Cajoly, sur la base de travaux de l’Unicef : « En Guadeloupe, les enfants perdent plus d’un mois de cours par an en moyenne du seul fait des coupures d’eau et de pollution de l’eau à l’école. » Les conséquences sont également sanitaires, comme dans le cas des contaminations au chlordécone, un pesticide utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993 et aux effets nocifs sur la santé pourtant connus.
« En Guadeloupe, il y a eu effectivement du chlordécone dans l’eau du robinet », explique Régis Huyet, militant au sein de Lyannaj pou dépolyé Matinik. Or, les politiques publiques sont à tout le moins insuffisantes. Le Plan Chlordécone IV, fustige-t-il, « affiche clairement qu’il ne cherche pas à faire une dépollution. Le but est de faire en sorte que les Antillais apprennent à vivre avec le chlordécone. »
« Un véritable sous-investissement chronique dans les territoires de l’outre-mer »
Pour s’attaquer à cette inégalité, le rapport insiste sur la nécessité d’un changement de paradigme, vers une justice environnementale, d’autant que ces difficultés seront encore accentuées par le changement climatique. Et demande des moyens, qui sont aujourd’hui largement insuffisants rappelle Sabrina Cajoly : « En Guadeloupe, pour l’accès à l’eau potable, le budget annoncé est de 320 millions d’euros sur quatre ans. Il est présenté comme colossal, alors qu’une enquête parlementaire évalue à 1,5 à 2 milliards le budget nécessaire pour remédier à la question de l’eau potable seulement en Guadeloupe. »
Quant à la pollution au chlordécone, la situation est « pire », souligne-t-elle. « Le budget total, pour Guadeloupe et Martinique, donc plus de 750 000 personnes, est de 130 millions sur cinq ans, et concerne tous les domaines : tant l’impact environnemental que la pollution de l’eau, de la santé, l’indemnisation des personnes. »
Un scandale qui ne date pas d’hier, analyse Sabrina Cajoly : « Il y a un véritable sous-investissement chronique dans les différents territoires de l’outre-mer, historique mais qui est toujours d’actualité. » Ce nouveau rapport vient le rappeler, pour inciter les pouvoirs publics à agir à la hauteur de la situation.
mise en ligne le 18 juin 2025
Marqué par les reculs environnementaux,
le projet de loi « simplification » est adopté
Lucie Delaporte sur wwwmediapart.fr
Le projet de loi sur la simplification de la vie économique, qui comporte d’importantes régressions sur le front de l’écologie, a été adopté de justesse mardi 17 juin contre la majorité macroniste qui le jugeait trop éloigné de ses intentions initiales.
« C’est« C’est une victoire culturelle du Rassemblement national contre l’écologie punitive. » Tout sourire, à l’instar de tous les députés de son parti au sortir de l’hémicycle, Pierre Meurin parade.
Le texte sur la simplification de la vie économique, adopté mardi 17 juin au terme d’un parcours chaotique, est incontestablement une victoire pour la droite et l’extrême droite qui ont très largement réécrit le texte initial en le transformant en loi de retour en arrière sur l’écologie.
Suppression des zones à faibles émissions (ZFE), détricotage du « zéro artificialisation nette », recul sur la protection des espèces protégées… Il aura finalement très peu été question de la vie des entreprises dans ce texte bourré de cavaliers législatifs, avec des sujets n’ayant bien souvent rien à voir avec l’économie.
La mine réjouie des députés du Rassemblement national (RN), dont les 120 députés ont voté comme un seul homme pour ce texte, montrait aussi leur satisfaction d’avoir fait capoter le plan des macronistes qui, au dernier moment, avaient annoncé qu’ils voteraient contre un texte pourtant à l’initiative du gouvernement Attal.
À la tribune pour le groupe Ensemble pour la République (EPR), la députée Marie Lebec explique ce revirement. Il faut dire que pour la troisième fois en un mois, les macronistes s’apprêtent à voter contre un texte qu’ils ont eux-mêmes défendu… Elle dénonce donc un projet de loi « disloqué et vidé de sa cohérence, par les circonstances d’alliances contraires », en référence notamment à la suppression des ZFE votée tant sur les bancs de la droite et de l’extrême droite que de La France insoumise. « C’est un texte qui fragilise ce que nous avons construit depuis huit ans » sur l’environnement, assure celle qui a pourtant voté pour la suppression des ZFE. Comprenne qui pourra.
Au moment du vote, le groupe EPR s’est d’ailleurs fracturé puisque près d’un tiers des députés macronistes ont voté avec la droite et l’extrême droite pour le texte ou se sont abstenus. Le MoDem de François Bayrou a voté en faveur de ce texte de grande régression écologique, offrant la victoire sur le fil – 275 voix contre 252 – à l’alliance RN-LR-Horizons.
Espèces protégées en danger
Face à des députés RN surmobilisés, les macronistes ont souvent brillé par leur absence lors de l’examen du projet de loi, pourtant annoncé en grande pompe comme un texte fondamental par Bruno Le Maire.
Déposé il y a plus d’an, le projet de loi, examiné par petits bouts ces derniers mois, a largement été réécrit, se colorant peu à peu de l’air du temps anti-écolo.
« On a bien vu le traumatisme au moment où l’A69 a été jugée illégale par le tribunal administratif de Toulouse. Là, on a eu une pluie d’amendements pour pouvoir bétonner tranquillement, détaille la députée LFI Anne Stambach-Terrenoir. Au final, on est arrivé à un texte d’inspiration trumpiste mené par la droite et l’extrême droite. »
Ce texte a ouvert la voie à toutes les obsessions anti-écolo, antidémocratiques, antisociales du moment. Charles Fournier, député Les Écologistes
L’examen du texte en commission avait ouvert le bal du grand n’importe quoi avec la proposition de supprimer des centaines d’agences et d’organismes tels que l’Ademe, l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Contrôleur général des lieux de privatisation de liberté… Des milliers d’amendements – étrangement jugés recevables – avaient alors été introduits, faisant complètement dérailler le projet de loi initial.
Si les propositions les plus baroques ont été écartées, le texte vient défaire des pans entiers de la loi « climat et résilience », adoptée lors du premier mandat Macron.
Il comporte notamment des reculs importants sur la protection des espèces protégées qui ne doit plus être un frein aux projets d’infrastructures diverses ou à la vie économique. À l’heure de la sixième extinction de masse, il ne faudrait pas gêner les projets autoroutiers et autres constructions de data centers. Ces derniers, comme tout un tas de projets de construction, pourront être qualifiés d’intérêt général majeur, ce qui les exonère d’un certain nombre de règles sur la biodiversité.
Difficile de résumer pour le reste le contenu d’un texte fourre-tout qui se sera préoccupé de l’octroi des licences IV dans les buvettes comme des massifs coralliens. Pointant les coups de canif portés aux études d’impact sur l’exploration minière, le député Les Écologistes Charles Fournier fustige « un texte qui a ouvert la voie à toutes les obsessions anti-écolo, antidémocratiques, antisociales du moment ». « C’est ubuesque et en même temps très grave », affirme-t-il, en expliquant que son groupe va porter des recours au Conseil constitutionnel contre les cavaliers législatifs. « Qu’on m’explique ce que les mesures contre la pollution de l’air ont à voir avec la vie économique », s’agace-t-il, certain que plusieurs pans de la loi tomberont devant cette instance.
Sur les ZFE, les écologistes vont déposer ce jour une proposition de loi pour rétablir le dispositif et l’améliorer, au vu des critiques portées par la gauche sur l’absence d’alternative à la voiture et le caractère excluant de la mesure pour les ménages modestes.
Si la ministre chargée du commerce et des PME, Véronique Louwagie (LR), s’est félicitée d’un texte « fortement attendu par le monde économique », la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle expliqué dans un communiqué agacé que « la santé publique et la lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions ne devraient pas être les variables d’ajustement de calculs politiques à la petite semaine ».
Le texte fera l’objet d’un examen en commission mixte paritaire en septembre.
Derrière la simplification,
une régression sociale et économique
sur https://www.cgt.fr/
Sous couvert de simplification administrative, le projet de loi « simplification de la vie économique » actuellement examinée à l'Assemblée nationale menace le droit du travail, affaiblit les contre-pouvoirs et aggrave la crise écologique. Décryptage CGT
Alors que le gouvernement vante une nouvelle étape de simplification administrative pour les entreprises, le projet de loi actuellement débattu à l’Assemblée nationale cache mal une offensive contre les droits des salarié·es, la démocratie sociale et la protection de l’environnement. Décryptage d’une loi qui fait peser de lourdes menaces sur le monde du travail.
Des attaques en règle contre les droits des salarié·es
Derrière la « simplification », plusieurs mesures contenues dans ce texte s’en prennent directement au droit du travail et au fonctionnement démocratique des instances représentatives du personnel :
-
possibilité de généralisation de la visioconférence pour les réunions du CSE, au détriment de la qualité des échanges en présentiel et du lien collectif, pourtant essentiels à une démocratie d’entreprise vivante ;
-
suppression de l’agrément régional pour les organismes de formation syndicale, ouvrant la voie à une mise en concurrence et à une baisse de la qualité des formations pour les élu·es du personnel ;
-
réduction du délai d’information des salarié·es en cas de cession d’entreprise, de deux mois à un seul. Cela affaiblit la capacité des salarié·es à se mobiliser pour des projets alternatifs de reprise, alors que la désindustrialisation s’accélère ;
-
allègement de nombreuses procédures de déclaration et d’autorisation, avec pour conséquence une remise en cause de garanties en matière de santé, de droits collectifs et d’environnement.
Certain·es député·es de droite ont même tenté d’aller plus loin, avec des amendements – fort heureusement jugés irrecevables – visant à :
-
réduire le nombre de CSE et de défenseur·ses syndicaux·les ;
-
limiter à trois ou six mois le délai de recours devant les prud’hommes pour contester un licenciement ;
-
supprimer l’exigence du consentement du ou de la salarié·e en cas de prêt de main-d’œuvre.
Moins d’instances, moins de démocratie sociale
Autre aspect alarmant du projet : la suppression de 25 comités, commissions et instances consultatives, parmi lesquels :
-
la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
-
l’Observatoire national de la politique de la ville ;
-
le Comité de suivi des mesures liées au Covid-19 ou à la guerre en Ukraine ;
-
et surtout, la Commission du label diversité, un symbole alors que les discriminations au travail explosent.
Même si la mobilisation a permis le maintien de certaines instances clés où siège la CGT (conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, CNDP, Haut-Conseil de l’Assurance maladie…), la vigilance reste de mise. Le texte prévoit :
-
la suppression automatique des instances n’ayant pas « justifié leur utilité » au bout de trois ans ;
-
un principe de « deux suppressions pour une création » pour toute nouvelle instance ministérielle ;
-
Une baisse continue des financements, comme c’est le cas pour l’Ires.
Un recul écologique préoccupant
En matière environnementale, le projet aggrave les dérégulations. en effet, il élargit les projets d’intérêt national majeur aux infrastructures routières et ferroviaires (autoroutes…), qui ne seront plus comptabilisés dans l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols. Une grave remise en cause des engagements climatiques et agricoles.
Plusieurs organismes chargés de l’évaluation environnementale et sanitaire sont supprimés :
-
Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ;
-
Observatoire des espaces naturels et agricoles ;
-
Commission sur les démantèlements nucléaires ;
-
Commission sur la déontologie des alertes environnementales…
Une mobilisation syndicale large et unitaire
Face à cette offensive, sept organisations syndicales nationales (CGT, CFE-CGC, CFTC, FO, FSU, Solidaires, Unsa) ont publié le 7 avril un communiqué intersyndical appelant les parlementaires à rejeter les amendements les plus dangereux.
« Pour réduire les droits sociaux dans l’entreprise, on simplifie le Code du travail. Pour rendre illisible la solidarité à l’œuvre sur la fiche de paye, on la simplifie. Et pour capter toujours plus de richesses créées par les travailleur·ses, on simplifie la vie économique… »
Au nom de la simplification, c’est en réalité une mise en coupe réglée du droit du travail, des contre-pouvoirs démocratiques et de la transition écologique qui est à l’œuvre.
mise en ligne le 6 juin 2025
Gardanne,
Chapelle-Darblay :
le deux poids, deux mesures
de la réindustrialisation
Thomas Coutrot sur www.politis.fr
Une subvention de 800 millions d’euros accordée pour relancer une centrale biomasse à la réussite douteuse. Et cinq ans d’attente pour un prêt de 27 millions d’euros visant à redémarrer une usine de recyclage de papier. Comment expliquer cette différence de traitement ?
En novembre 2024, l’État a annoncé une subvention de 800 millions d’euros pour la relance de la centrale biomasse de Gardanne. Ce soutien massif contraste étrangement avec son refus, toujours persistant à ce jour, d’accorder un simple prêt de 27 millions d’euros via la Banque publique d’investissement (BPI) pour la relance de la papeterie Chapelle-Darblay à Grand-Couronne (Seine-Maritime), fermée depuis cinq ans.
La centrale biomasse de Gardanne est pourtant dénoncée par les associations environnementales comme un désastre écologique : elle brûle 450 000 tonnes de bois par an, dont un tiers importé, avec un rendement énergétique inférieur à 30 %. Autrement dit, deux arbres brûlés sur trois ne font qu’émettre du CO2 sans produire d’électricité. Elle émet des particules fines sur le territoire avoisinant et pousse à un extractivisme forestier, comme le dénoncent de nombreuses associations locales. Une enquête publique se déroule en ce moment auprès de 324 communes touchées, et pourrait renforcer la mobilisation citoyenne.
En revanche, l’impact écologique positif de la relance de Chapelle-Darblay ne fait pas débat. L’usine pourrait recycler 480 000 tonnes de papiers usagés pour produire du carton et stopperait l’aberration écologique actuelle : depuis cinq ans, le contenu des poubelles jaunes de l’Ouest de la France est envoyé par camions en Allemagne et en Italie pour y être recyclé.
Dans les deux cas, la CGT locale et nationale s’est mobilisée pour défendre l’emploi et l’environnement. La CGT de Gardanne a élaboré, en lien avec des ONG, un projet industriel réduisant fortement l’usage de la biomasse et prévoyant le développement de la production de biogaz. La CGT de Chapelle-Darblay a travaillé avec Greenpeace pour présenter une argumentation irréfutable sur les bénéfices environnementaux de la relance de la papeterie.
L’État s’est fortement engagé pour Gardanne, mais n’a pas conditionné son soutien à la mise en œuvre du projet alternatif porté par la CGT. Les emplois pourraient être sauvés mais pas l’environnement. Comment expliquer ce deux poids deux mesures ? L’actionnaire de Gardanne est EPH, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a fait fortune en rachetant des centrales à charbon en fin de vie. Il dispose d’un fort poids politique, notamment via son groupe de presse. Il a fermé la centrale à charbon de Gardanne en 2021 au profit de celle à biomasse, conformément aux promesses du candidat Macron en 2017. Élu président, celui-ci veille à assurer la survie de la nouvelle centrale, même si son bilan écologique est à peine moins désastreux.
La Chapelle-Darblay dispose manifestement de moins d’amis dans les hautes sphères gouvernementales.
À la Chapelle-Darblay, l’actionnaire est le groupe canadien Fibre Excellence, soutenu par les collectivités locales, qui ont même réquisitionné le foncier pour empêcher la vente de l’usine par son précédent actionnaire. Mais le projet dispose manifestement de moins d’amis dans les hautes sphères gouvernementales. Lassé d’attendre, Fibre Excellence a lancé un ultimatum à l’État, soutenu par les syndicalistes CGT (1). Souhaitons qu’ils soient enfin entendus.
mise en ligne le 30 mai 2025
Après 7 ans de fiasco,
les députés enterrent les ZFE
Par Alexandre-Reza Kokabi sur https://reporterre.net/
Du Rassemblement national pro-voitures à LFI, qui pointe le manque d’alternatives pour les plus précaires, les ZFE ont cristallisé les colères. Leur suppression illustre l’échec d’une écologie déconnectée des réalités sociales.
C’est un vote au goût de renoncement. Mercredi 28 mai, les députés ont adopté un article du projet de loi sur la simplification de la vie économique qui prévoit la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Portée par le député d’extrême droite Pierre Meurin (RN), la mesure a été adoptée par 98 voix contre 51, scellant une alliance hétéroclite allant du Rassemblement national à La France insoumise (LFI), en passant par Les Républicains et quelques élus de la majorité. Le gouvernement, qui tentait de sauver les meubles en restreignant l’obligation a ux seules métropoles de Paris et Lyon, a échoué.
Créées en 2018, les ZFE visaient à améliorer la qualité de l’air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Déjà mises en place dans une dizaine de villes (Nice, Rouen, Paris...) elles devaient pleinement entrer en vigueur en 2025. À peine amorcé, ce chantier est aujourd’hui mis à l’arrêt. Un recul net par rapport aux ambitions affichées par Elisabeth Borne, qui voyait dans ces zones un dispositif « irréversible ».
Un fiasco programmé
Ce revirement spectaculaire sanctionne un long enlisement. Imaginées comme un levier structurant de transition écologique, les ZFE ont souffert d’un double défaut originel : un pilotage centralisé, déconnecté des réalités locales, et une mise en œuvre sans véritable accompagnement. « On a mis la charrue avant les bœufs en disant aux gens de ne plus prendre leur voiture, sans proposer d’alternatives », résumait le député LFI Sylvain Carrière, en avril, dans Reporterre. La prime à la conversion s’est effritée, les transports publics en dehors des grandes métropoles sont restés sous-financés, le leasing social a fait long feu. Le gouvernement, sous pression, avait bien promis de réserver au moins 10 % des 50 000 véhicules électriques accessibles pour 100 euros par mois aux habitants concernés par des ZFE. Pas de quoi changer la donne : à l’écologie incantatoire a succédé le vide opérationnel.
Sur le terrain, le rejet s’est peu à peu cristallisé. En 2023, seuls 51 % soutiennent les ZFE, selon l’institut CSA, en baisse de 6 points par rapport à 2022. L’extrême droite s’est engouffrée dans la brèche, dénonçant une « écologie punitive » et une mesure « séparatiste ». Le RN a imposé un récit efficace : celui d’un pouvoir déconnecté, qui culpabiliserait les classes populaires pour leur dépendance à la voiture. À gauche, LFI a dénoncé l’hypocrisie d’une politique environnementale qui ne s’accompagne pas d’investissements suffisants dans les alternatives.
Les ZFE, des « zones de forte exclusion » ?
C’est dans les territoires les plus fragiles que le rejet a été le plus profond. En Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, 3 voitures sur 4 étaient menacées d’interdiction. À La Courneuve, ce chiffre grimpait même à 80 %. « Les ménages précaires motorisés sont plus fréquemment détenteurs de véhicules anciens », expliquait à Reporterre Daphné Chamard-Teirlinck, du Secours catholique. Et les aides, souvent complexes ou insuffisantes, n’ont pas permis de répondre à l’ampleur du défi.
À Pavillons-sous-Bois, Chloé, infirmière en addictologie et mère célibataire, continuait de rouler dans sa Peugeot Crit’Air 5 : « Avant de changer de voiture, il faut remplir le frigo, payer le loyer, les factures. » À Drancy, Oumayma, étudiante de 24 ans, évoquait un choix de survie : « Dans nos quartiers, la voiture est un moyen de sortir du piège. Elle nous permet d’aller aux entretiens, au médecin, de faire les courses quand les transports nous lâchent. » Pour beaucoup, la ZFE a surtout été perçue comme une « zone de forte exclusion », où les injonctions écologiques viennent heurter de plein fouet la précarité.
Le résultat, c’est une colère sourde, teintée de résignation. « Je gruge tant que je peux », confiait Chloé. À Montreuil, Guénolé, régisseur dans l’événementiel, ironisait : « Une voiture électrique, je la branche où dans ma cité ? Je suis censé tirer une rallonge depuis ma fenêtre ? » Le sentiment d’injustice a nourri un rejet de la mesure, attisé par le manque d’information, les cafouillages réglementaires et l’abandon progressif de l’État. « Il a tout remis dans les mains des collectivités sans leur donner les moyens », déplorait encore Daphné Chamard-Teirlinck.
La pollution de l’air tue
Et pourtant, les premiers effets des ZFE étaient tangibles. À Lyon comme à Paris, la concentration de dioxyde d’azote a chuté d’un tiers. « Ce sont des avancées concrètes pour la santé publique », rappelait le Secours catholique dans une note de positionnement, que Reporterre a pu consulter. Chaque année, la pollution de l’air provoque 40 000 morts prématurées en France, selon Santé publique France. Et ce principalement dans les zones où vivent les populations les plus défavorisées. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a déploré une « décision regrettable », contraire au « droit de vivre en bonne santé ».
Selon Le Monde, la suppression des zones à faibles émissions autoriserait la remise en circulation de 2,7 millions de véhicules parmi les plus polluants dans les grandes agglomérations.
À ce coût sanitaire s’ajoute un risque juridique. La France a déjà été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour dépassement des seuils de pollution. En février dernier, elle a de nouveau été mise en demeure par la Commission européenne. Supprimer les ZFE, c’est s’exposer à de potentielles sanctions financières.
« On va droit dans le mur du réchauffement climatique en klaxonnant »
Le vote de l’Assemblée doit encore être confirmé en commission mixte paritaire. Mais l’élan politique semble brisé. Le gouvernement a tenté, lors des derniers débats, de sauver les ZFE a minima, en limitant leur obligation à Paris et Lyon. En vain. « Reprise des travaux de l’A69, suppression des ZFE, on va droit dans le mur du réchauffement climatique en klaxonnant », a réagi sur le réseau social Bluesky le professeur de droit public Serge Slama.
Reste à savoir ce que deviendront les ZFE déjà mises en place dans les métropoles les plus avancées, comme Paris, Lyon, Grenoble ou Montpellier. À défaut d’une impulsion nationale, certains élus espèrent maintenir localement le dispositif, en le réinventant : en misant sur les aides ciblées et un meilleur maillage des transports publics. Mais sans cadre clair, la lutte contre la pollution risque de dépendre, une fois encore, de la géographie politique.
mise en ligne le 26 mai 2025
Loi Duplomb
à l'Assemblée nationale :
la dérégulation à tout-va
Clara Gazel sur www.humanite.fr
Examiné à partir de ce lundi à l’Assemblée nationale, le texte porté par deux sénateurs de droite promet de « lever les contraintes » pesant sur les paysans. Cher à la FNSEA, il multiplie les saillies contre les normes environnementales et regorge de mesures contre-productives, comme la ré-autorisation de néonicotinoïdes.
Les porteurs du texte pensent se poser en sauveurs du monde paysan. Débattue ce lundi à l’Assemblée nationale, après son adoption au Sénat, la proposition de loi (PPL) Duplomb – du nom de l’un de ses coauteurs – ambitionne de « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Un titre prometteur bien loin de faire l’unanimité dans la profession et qui soulève de vives contestations des associations environnementales.
En cause, des mesures controversées, parmi lesquelles la réintroduction de néonicotinoïdes et l’assouplissement des normes environnementales pour l’élevage intensif. Autant de mesures chères à la FNSEA qui seront examinées jusqu’au 31 mai et qui font l’objet de plus de 3 500 amendements. Sauf si par un tour de passe-passe législatif, les députés favorables au texte défendent une motion de rejet du texte. En effet, si une majorité de députés la vote, le texte sera immédiatement considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale, donc sans examen dans l’Hémicycle. Il ferait ensuite l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP). Mais en partant de la version du Sénat. « L’unique but de cette manœuvre est de faire passer en force, sans débat démocratique en séance, les dispositions ignobles de cette proposition de loi », a réagi l’association de défense de l’environnement Générations futures dans un communiqué.
Une loi « terriblement rétrograde »
Si les défenseurs de cette PPL brandissent l’argument de l’intérêt général, elle ne satisfait pas l’ensemble du monde paysan. « Elle ne répond en rien aux vrais enjeux comme l’accès à la terre, les revenus ou l’installation, fustige Astrid Bouchedor, chargée de plaidoyer chez Terre de liens. À la place on a plus de pesticides, moins de contrôle et plus de concentration des terres. »
Fanny Métrat, porte-parole de la Confédération paysanne, dénonce une loi « terriblement rétrograde » qui ne répond pas aux causes structurelles de la crise agricole – les mêmes qui avaient déclenché la vague de contestation de l’hiver 2024. « On nous impose un faux narratif selon lequel les normes environnementales seraient responsables de nos souffrances. »
Pire : pour Mathieu Courgeau, coprésident du collectif Nourrir, organisme agricole et citoyen qui œuvre à la refonte du système agricole, la loi détourne l’agriculture de l’indispensable transition écologique. « Elle ne propose rien pour adapter notre modèle aux dérèglements climatiques, qui sont pourtant la deuxième préoccupation des agriculteurs après le revenu. »
Les pesticides érigés en totem
Parmi les mesures les plus décriées, l’article 2 autorise, pour trois ans, des dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes, autorisés ailleurs en Europe. « C’est un choix purement politique, qui n’a rien de scientifique. Les risques pour la santé humaine et la biodiversité sont bien documentés dans la littérature académique », rappelle Yoann Coulmont, chargé de mission plaidoyer chez Générations futures.
Pour Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, « il faut en finir avec le ”pas d’interdiction sans solution”, chiffon rouge agité pour les filières noisette et betterave, qui ont des alternatives et dont la majorité des récoltes est exportée ».
Autre point sensible : la suppression de la séparation entre vente et conseil des pesticides. Un danger clair pour Générations futures, qui rappelle que les vendeurs ont « des intérêts économiques évidents ». Quant à la volonté de soumettre l’Anses – qui délivre les autorisations pour les pesticides – à un comité d’orientation agricole, écartée en commission à l’Assemblée, elle pourrait revenir par voie réglementaire. « C’est une stratégie de diversion de la ministre Genevard », tance Yoann Coulmont.
Encourager les méga-fermes
La PPL prévoit d’abaisser les seuils déclenchant une étude environnementale pour les projets d’élevage intensif. « Pour les volailles, le seuil passerait de 40 000 à 85 000. En dessous, plus d’étude systématique », explique Sandy Olivar Calvo, de Greenpeace. Un soutien affiché à l’élevage intensif et un « appel d’air pour la concentration des fermes », selon Stéphane Galais, de la Confédération paysanne. À qui profiterait cette mesure ? « À une infime minorité car moins de 2 % des exploitations sont au-dessus de ces seuils », répond Sandy Olivar Calvo.
Prévue dans le texte sénatorial, la mesure facilitant la construction de mégabassines a été retoquée en commission. Mais le gouvernement prévoit déjà de la réintroduire par amendement, sous pression de la FNSEA, qui dénonce un texte « détricoté ».
Pressions de la FNSEA sur les élus
Le syndicat, qui soutient ce texte « vital », agite la menace de nouvelles actions ce lundi, aux côtés des Jeunes agriculteurs. Pour faire pression, certains membres n’ont pas hésité à harceler de messages des députés ou à dégrader des permanences dans les Hautes-Pyrénées, l’Hérault ou le Cher. « Contrairement aux pratiques mafieuses des dirigeants de la FNSEA, on va soutenir les élus opposés à la loi en déposant des fleurs, symbole de biodiversité, devant les permanences », réagit Thomas Gibert, porte-parole de la Confédération paysanne.
Le syndicat fustige le « forcing de la FNSEA », qui a conduit à l’adoption de la procédure accélérée pour cette PPL, « loin de faire l’unanimité chez les députés du bloc central ». Autant dire qu’elle a du plomb dans l’aile, suscitant même des divergences entre ministères : début mai, la ministre de la Transition écologique qualifiait la réintroduction d’un néonicotinoïde de « fausse solution », quand sa collègue de l’Agriculture saluait un texte « équilibré ». Rappelons qu’Annie Genevard vient des rangs LR, comme Laurent Duplomb, coauteur de la loi et ancien élu de… la FNSEA.
Comme si les reculs environnementaux ne suffisaient pas, Annie Genevard a annoncé le 20 mai une coupe drastique de 15 millions d’euros dans le budget alloué à l’Agence bio, chargée de structurer la filière. Un « signal délétère », dénoncent professionnels et associations. « On veut sortir du marasme dans lequel on est, lance Fanny Métrat. On n’en peut plus de ces discours qui nous montent les uns contre les autres et nous isolent des citoyens. » Des citoyens qui, en grande majorité, rejettent cette loi, rappelle Sandy Olivar Calvo : « Les députés doivent se souvenir qu’ils n’ont pas été élus par la FNSEA, mais par des citoyens très inquiets des dangers qu’elle porte. »
Agriculteurs, ils disent
non à la loi Duplomb
Par Fanny Marlier sur https://reporterre.net/
Aides fléchées pour les élevages industriels, pesticides à gogo... La loi Duplomb ne bénéficiera qu’à une poignée de gros agriculteurs, insistent les paysans interrogés par Reporterre.
Supposé « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », ce texte pourrait bel et bien accélérer la fin de la profession. C’est le sombre constat dressé par nombre d’agriculteurs qui espèrent arriver à instaurer un rapport de force en amont de l’examen de la loi Duplomb, qui débute lundi 26 mai à l’Assemblée nationale. Les partisans du texte vont déposer aujourd’hui une motion de rejet pour contourner les amendements déposés par les écologistes et insoumis. Si cette motion est votée, l’examen de la loi passera directement en commission mixte paritaire (CMP), réunissant qu’un petit nombre de députés et sénateurs pour travailler sur la version du Sénat.
Dans le détail, le texte écocidaire pourrait réintroduire des pesticides dangereux, encourager l’épandage par drones, favoriser la construction de mégabassines, détruire les zones humides, ou encore, affaiblir l’indépendance de l’Anses, l’agence nationale chargée d’évaluer et d’autoriser la mise sur le marché des pesticides.
« Cette proposition de loi ne répond pas aux attentes du monde agricole fustige Thomas Guibert, porte-parole du syndicat agricole la Confédération paysanne. Ce texte ne bénéficiera qu’à une poignée de très gros agriculteurs, toujours les mêmes, c’est-à-dire ceux notamment ceux qui dirigent la FNSEA. »
En sous-texte, le syndicaliste souligne combien cette loi découle des demandes de la FNSEA, le syndicat qui défend une agriculture productiviste intensive avide de produits phytosanitaires. Derrière ce texte, le sénateur Les Républicains (LR), Laurent Duplomb, est d’ailleurs lui-même un ancien élu de la FNSEA. À l’opposé, la loi constituerait une menace pour l’agriculture paysanne, « celle qui relocalise, respecte les sols et tente de préserver les ressources en eau », souligne la Confédération paysanne.
Au-delà des effets pour la santé et la biodiversité, parmi les dispositifs qui inquiètent les agriculteurs, il y a aussi celui facilitant l’essor des élevages industriels. Selon le niveau de danger qu’elles représentent pour la santé et l’environnement, certaines catégories d’installations, appelées les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont soumises à une réglementation particulière nécessitant une demande d’autorisation préalable. On y trouve des industries, des usines, mais aussi de grands élevages.
Mégapoulaillers industriels
La loi Duplomb vise à élever les seuils de ces élevages soumis à autorisation, en passant par exemple d’un élevage de 40 000 volailles à 85 000 volailles. En 2024, près de 19 000 sites étaient soumis à ce régime d’autorisation, soit moins de 5 % des exploitations agricoles françaises.
« La mesure concerne très peu d’exploitations mais elle pourrait avoir des conséquences environnementales majeures, notamment en termes de pollution de l’eau, pointe Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace. Sans compter que l’accélération des élevages industriels se fait toujours au détriment d’autres exploitations, plus petites, et entraîne généralement leur chute. »
Le nombre d’agriculteurs et de fermes en France ne cesse, en effet, de baisser. À tel point qu’en dix ans, entre 2010 et 2020, la France a perdu 101 000 exploitations agricoles. En cause, le coût des installations, les faibles rémunérations, les conséquences du changement climatique, la difficulté à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
« L’accélération des élevages industriels se fait au détriment des petites exploitations »
Les grandes exploitations, autour de 136 hectares, sont les seules à avoir vu leur nombre augmenter. Les exploitations ne cessent de s’agrandir et de se spécialiser. Sur la décennie, la taille moyenne des exploitations est passée de 55 hectares en 2010 à 69 hectares en 2020.
Plus de pesticides, moins de contrôle
« La loi Duplomb propose uniquement d’utiliser davantage de pesticides, d’alléger les contrôles, et de faciliter les concentrations », résume Astrid Bouchedor, responsable de plaidoyer de Terre de Liens.
Avec quelles conséquences ? Thomas Guibert, de la Confédération paysanne, donne un exemple d’un effet domino délétère. La réintroduction de certains pesticides va nuire aux abeilles et donc nuire aux apiculteurs... qui doivent déjà faire face à « des importations cassant les prix ». Sans parler des baisses de rendement dues à une pollinisation des fruits et légumes en baisse.
Surtout, la loi Duplomb ne répond pas aux demandes issues du monde agricole, martèlent ces agriculteurs. Un sondage Ifop, du Collectif Nourrir réalisé en février 2024 auprès de 600 agriculteurs indiquait qu’à peine 4 % des répondants sont préoccupés par les restrictions sur les pesticides.
Détricotage des mesures favorables à l’environnement
Au total, 52 % citaient le contexte économique comme source de préoccupation majeure, en particulier l’augmentation des coûts (18 %), l’instabilité des marchés (16 %), et des prix de vente insuffisants (12 %). Autre point important : 60 % des agriculteurs interrogés disaient vouloir se tourner vers l’agroécologie et la bio.
En guise de besoins urgents, Astrid Bouchedor, de Terres de liens cite pêle-mêle : la création d’une grande loi foncière facilitant l’accès à la terre, ainsi que la réorientation des aides, comme celles de la PAC, davantage fléchées vers des fermes agroécologiques « à tailles humaines ».
Pour l’heure, le gouvernement ne semble pas prêt d’y répondre favorablement. Mardi 20 mai, l’Agence bio chargée du développement de la promotion des produits bio a appris la suppression des 5 millions d’euros à son budget dédié aux campagnes de communication, ainsi que la réduction de 10 millions d’euros de la dotation de son fonds Avenir bio, destiné à soutenir des projets de développement de filières biologiques.
Quoi qu’il en soit, la loi Duplomb s’inscrit dans la lignée des politiques de détricotage des mesures favorables à la protection de l’environnement et à la santé des citoyens à l’œuvre depuis plusieurs mois. « Il est incompréhensible de voir aujourd’hui les députés débattre d’un texte qui met en péril notre capacité à produire demain et à assurer un environnement et une alimentation saine pour tout le monde », insiste Mathieu Courgeau, éleveur et coprésident du Collectif Nourrir.
Et de conclure : « Alors que les agriculteurs et les citoyens appellent de leurs vœux à une transition de notre système agricole et alimentaire, cette loi est à contre-courant de l’histoire, des réalités scientifiques et des attentes de la société. »
Derrière la loi Duplomb,
le lobby antisciences
Vanina Delmas sur www.politis.fr
La proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » est examinée à partir d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Elle nie la protection essentielle du vivant et les expertises scientifiques.
Le 5 mai, plus de 1 200 médecins, chercheurs et scientifiques ont signé une lettre ouverte adressée aux ministres de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Environnement, à propos des menaces pour la santé, l’environnement et l’expertise scientifique que fait peser la proposition de loi visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Portée par le sénateur Les Républicains (LR) de la Haute-Loire, Laurent Duplomb, elle a été largement adoptée en janvier en première lecture par le Sénat.
Elle est présentée par la droite et une partie du gouvernement comme un complément de la loi d’orientation agricole et une réponse à la colère du monde agricole. Ou plutôt d’une partie du monde agricole : la minorité qui déclare les normes environnementales comme la source de tous leurs problèmes. Parmi ses huit articles, la « PPL Duplomb » en compte plusieurs qui nient totalement les dizaines d’expertises scientifiques réalisées ces dernières années.
Risque de retour des néonicotinoïdes ?
L’article 2 fait courir le risque d’une réautorisation de certaines substances néonicotinoïdes, des pesticides « tueurs d’abeilles » interdits en France depuis 2018 comme l’acétamipride, le sulfoxaflor et le flupyradifurone. L’ONG Générations futures (GF) a décidé de « remettre les faits et la science au cœur des débats » afin de lutter contre la désinformation et les contre-vérités notamment sur l’acétamipride, autorisé ailleurs en Europe et présenté comme moins toxique que les autres. GF pointe les multiples défaillances des évaluations au niveau européen, que ce soit sur sa persistance dans l’environnement que sa toxicité pour les abeilles et la santé humaine.
« Nous avons identifié au moins 23 nouvelles études universitaires parues ces deux dernières années, apportant de nouvelles preuves de la toxicité significative de cette substance sur les abeilles, précise Pauline Cervan, toxicologue. De plus, l’évaluation réglementaire a été particulièrement lacunaire : les risques chroniques n’ont pas été correctement évalués, les effets sur les abeilles solitaires et les bourdons n’ont pas du tout été évalués, tout comme les effets sublétaux qui troublent les comportements, les capacités de reproduction des populations et conduisent à leur disparition. »
Un syndicat agricole industriel et certains élus utilisent ce sujet de l’acétamipride pour mettre un pied dans la porte. P. Grandcolas
Concernant les impacts sur la santé humaine, l’ONG signale l’existence de plusieurs études dans la littérature académique indiquant un effet neurotoxique pour le développement, qui ont été globalement ignorées par les agences européennes d’évaluation des risques. Générations futures et Pesticide Action Network (PAN) Europe vont un cran plus loin en appelant à interdire totalement l’acétamipride pour tous les usages en Europe, agricoles et biocides.
Pour Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie et Environnement au CNRS, l’adoption de cette loi serait un recul catastrophique sur le plan écologique alors que « la France était pionnière sur l’interdiction des néonicotinoïdes ». « Même s’il faut argumenter sur leur dangerosité, et les problèmes liés aux filières qui poussent pour leur retour – la betterave et la noisette – je pense qu’il y a un enjeu plus fort derrière : un syndicat agricole industriel et certains élus utilisent ce sujet de l’acétamipride pour mettre un pied dans la porte et enclencher le début d’une déréglementation plus générale », analyse le chercheur.
Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste et président de l’association Alerte des médecins sur les pesticides juge cette proposition de loi « hors-sol » : « Une expertise collective de l’INRAE de 2022 montre que tous les milieux sont contaminés par ces substances (air, sol, eau, flore, ) et que tous les niveaux d’organisations biologiques, du ver de terre aux mammifères sont impactés. Or, si vous perdez 70 % de la biomasse des insectes, combien d’années faut-il pour que cela impacte l’agriculture ? Pas beaucoup. Comment peuvent-ils en faire abstraction ? »
Côté santé humaine, plusieurs expertises de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) – en 2013 et 2021 – démontrent clairement les liens entre pesticides et pathologies graves chez les agriculteurs et les enfants exposés aux pesticides : cancers du sang, de la prostate, maladie de Parkinson, troubles du développement neuropsychologique et moteur de l’enfant, troubles cognitifs et anxio-dépressifs de l’adulte…
Dans son cabinet de médecin généraliste à Limoges, Pierre-Michel Périnaud constate de plus en plus de troubles de la fertilité, de cancers, de maladies métaboliques, des troubles du neurodéveloppement chez les enfants… Des maladies multifactorielles qui devraient faire l’objet d’études approfondies de la part des agences d’homologation des produits, comme par exemple l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Nous pensons que non seulement les agences doivent être maintenues dans leurs rôles mais faire encore mieux. P-M. Périnaud
« Face à des défis comme l’effondrement de la biodiversité, ou l’allongement de la liste des maladies touchant les professionnels exposés aux pesticides, la contamination générale de la population, les agences ont un rôle important à jouer ! Nous pensons que non seulement elles doivent être maintenues dans leurs rôles mais faire encore mieux, et s’ouvrir à des questions scientifiques comme celle de l’effet cocktail », explique-t-il.
Une vision des choses à l’opposé de l’esprit de la PPL Duplomb. Dans sa première version, elle tentait de « mettre sous tutelle » l’Anses, chargée depuis 2014 de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Une lourde responsabilité qui incombait auparavant au ministère de l’Agriculture. L’article 2 remettait donc en cause l’indépendance scientifique de l’Anses et visait à modifier profondément ses modalités de fonctionnement. L’idée était que le gouvernement lui soumette des dossiers à examiner en priorité, à partir de l’avis d’un « Conseil d’orientation pour la protection des cultures », notamment composé de représentants du monde agricole et des industries agrochimiques.
Ces produits peuvent avoir des effets sur le long terme, des effets cocktails avec d’autres produits, leur dégradation peut être toxique. P. Grandcolas
Lors d’une audition devant la commission des Affaires économiques, le directeur général de l’Anses, Benoît Vallet, avait affirmé sa volonté de démissionner si la loi était adoptée en l’état. Cet article a finalement été écarté par les députés de la commission des affaires économiques. Mais, selon le média Contexte, un décret du gouvernement pourrait quand même interagir sur la « hiérarchisation des demandes d’autorisation en fonction des risques de maladies pesant sur les récoltes d’une filière. »
Pierre-Michel Périnaud reste très vigilant sur ce point et attend des garanties en séance plénière sur l’indépendance de cet outil précieux de sécurité sanitaire. « Depuis environ un an et demi, les gouvernements ont un certain nombre d’agences dans le collimateur : l’Ademe, l’OFB, l’Agence bio et l’Anses. Lorsque l’Anses a interdit le métolachlore en 2023, c’était une victoire pour nous, mais l’agence européenne le recommandait depuis 20 ans. Cette décision a été vigoureusement contestée par le ministre de l’Agriculture de l’époque, Marc Fesneau. Ça préfigurait le projet de loi Duplomb ! »
Philippe Grandcolas déplore la méconnaissance de la société sur les données scientifiques et sur la notion de risque lié aux pollutions. « La plupart des interlocuteurs (politiques, agriculteurs, entreprises, citoyens…) ont une représentation erronée de la toxicité. Ils ne la perçoivent que comme une exposition simpliste, à un instant T. Ils ne comprennent pas que ces produits peuvent avoir des effets sur le long terme, des effets cocktails avec d’autres produits, que leur dégradation peut être toxique, qu’ils peuvent se concentrer dans les réseaux alimentaires de la biodiversité, et s’accrocher aux graisses afin de rester dans le corps humain… » Après des cours sur le changement climatique, peut-être que les scientifiques devraient organiser des séances de rattrapages en sciences de la vie et de la terre pour les députés.
Pesticides :
comment la loi Duplomb menace notre santé
Par Émilie Massemin sur https://reporterre.net/
Une proposition de loi vise à réduire l’indépendance de l’Anses, l’agence qui autorise la mise sur le marché de produits contenant des pesticides, « au mépris des exigences sanitaires », dénoncent des scientifiques.
« Agriculteurs, riverains, citoyens ne veulent plus servir de cobayes. » Dans une lettre ouverte adressée lundi 5 mai aux ministres de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de la Transition écologique, 1 279 médecins, chercheurs et scientifiques alertent sur la menace pour la santé publique que représente la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Portée par le sénateur (Les Républicains) de la Haute-Loire Laurent Duplomb, elle prévoit entre autres la réautorisation de certains néonicotinoïdes, les fameux pesticides « tueurs d’abeilles ».
Surtout, elle corsète plus étroitement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), l’établissement public qui évalue les risques sanitaires et délivre les autorisations de mise sur le marché des pesticides. Adoptée par le Sénat le 27 janvier, cette proposition de loi est examinée en commission du développement durable à l’Assemblée nationale les 6 et 7 mai.
« Faire primer les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales »
Depuis 2015, l’Anses délivre, refuse et retire les autorisations de mise sur le marché des produits contenant des pesticides. Mais la proposition de loi prévoit qu’elle soit tenue d’informer ses ministères de tutelle — Santé, Agriculture, Travail et Environnement — avant de délivrer ses avis et recommandations.
Elle crée aussi un Conseil d’orientation pour la protection des cultures, qui doit indiquer à l’agence les pesticides sur lesquels ses décisions sont attendues en priorité, en fonction des difficultés rencontrées par les filières. Cette nouvelle instance serait majoritairement composée de représentants des filières agricoles, de l’industrie des pesticides et des instituts techniques, selon un projet de décret consulté par Le Monde.
« Trumpisation de nos institutions »
« Ce conseil pourrait essayer de faire primer les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales, comme c’est le cas actuellement avec la demande de réautorisation des néonicotinoïdes au nom de la crise de la betterave ou de la noisette », s’alarme Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste et président de l’association Alerte des médecins sur les pesticides. « Cette priorisation va s’imposer à l’Anses au mépris des exigences sanitaires. C’est une véritable trumpisation de nos institutions, effrayante dans sa rapidité et la violence de ses mesures », renchérit l’historienne des sciences et vice-présidente d’Alerte pesticides Haute-Gironde Sylvie Nony, elle aussi signataire.
Ce n’est pas la première fois qu’une partie de la classe politique cherche à brider l’Anses. En mars 2023, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau (MoDem) avait demandé à l’agence sanitaire de revenir sur l’interdiction du S-métolachlore, un herbicide très utilisé dans la culture du maïs, du tournesol et du soja et responsable d’une contamination quasi-généralisée des nappes phréatiques. En novembre, c’est sa successeuse, Annie Genevard (Les Républicains), qui avait elle-même annoncé la création du Conseil d’orientation pour la protection des cultures.
« Cela pourrait fragiliser le système de sécurité sanitaire dans son ensemble »
Contactée par Reporterre, l’Anses n’a pas souhaité s’exprimer. Mais, le 10 avril, son comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts s’était ému du fait qu’un conseil d’orientation pourrait « remettre en cause le fonctionnement actuel et les garanties de transparence sur les avis et d’indépendance des décisions » de l’agence. Fin mars, le directeur de l’Anses, Benoît Vallet, avait annoncé son intention de démissionner si la proposition de loi Duplomb était adoptée.
« Cette réforme pose un problème déontologique, car les industriels pourraient influencer les décisions. Cela pourrait fragiliser le système de sécurité sanitaire dans son ensemble », avait-il alerté en février pendant le Salon de l’agriculture, rappelant que « les agences sanitaires ont justement été créées pour séparer les intérêts économiques et sanitaires ».
La contamination de l’environnement est généralisée
L’Anses est attaquée alors que les preuves s’accumulent sur la dangerosité des pesticides. Publié en 2021, le rapport de synthèse Pesticides et effets sur la santé de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale confirme la « présomption forte » d’un lien entre exposition aux pesticides et lymphomes non hodgkiniens, myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique chez les agriculteurs.
Un lien est également observé entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central, ainsi que des troubles du développement neuropsychologique et moteur.
Ces conséquences sanitaires sont d’autant plus préoccupantes que la contamination de l’environnement aux pesticides est généralisée. D’après une enquête du Monde, les pesticides et leurs sous-produits sont présents et quantifiés dans 97 % des stations de contrôle de la qualité de l’eau, et dépassent les normes dans près de 20 % d’entre elles.
Plutôt que d’affaiblir l’agence sanitaire, les signataires de la lettre ouverte préconisent le renforcement de l’évaluation des risques liés aux pesticides. « En juin 2023, l’État français a été condamné pour des failles dans les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, notamment parce qu’il ne tenait pas compte des données scientifiques les plus fiables et des résultats de la recherche les plus récents », rappelle à Reporterre Florence Volaire, chercheuse en écologie à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et signataire de la lettre.
Le texte des scientifiques formule ainsi plusieurs recommandations : mettre en œuvre une « véritable médecine préventive » et un suivi effectif de la santé au travail pour l’ensemble des travailleurs agricoles, y compris précaires ; rendre automatique la communication en temps réel des pesticides épandus à l’échelle de la parcelle vers une base de données accessible aux chercheurs ; prendre en compte les études réalisées par des universitaires indépendants, en complément des évaluations fournies par les industriels ; étudier la toxicité chronique et l’effet cocktail des formulations avant leur autorisation de mise sur le marché, « une obligation introduite par le règlement 1107/2009 de l’Union européenne, que la France ne respecte toujours pas », souligne Sylvie Nony.
mise en ligne le 19 mai 2025
À l’Assemblée, la réintroduction des néonicotinoïdes revient
par la petite porte
Amélie Poinssot sur www.mediapart.fr
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a achevé vendredi 16 mai l’examen de la proposition de loi « Duplomb ». Elle a réintroduit la plupart des reculs écologiques qui avaient été retirés en commission développement durable.
Deux salles, deux ambiances. Examinée cette semaine par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, la proposition de loi « Duplomb » – du nom du sénateur Les Républicains (LR) qui l’a initiée – a retrouvé une bonne partie des reculs écologiques qu’elle contenait à l’origine. Un vote qui vient contrebalancer celui de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, les 6 et 7 mai, où plusieurs élu·es, allant de la gauche à la droite, avaient retoqué la plupart des dispositions critiques.
Cette fois-ci, LR et les macronistes d’Ensemble pour la République (EPR) – à l’exception de la présidente de la commission développement durable Sandrine Le Feur, venue soutenir ses amendements auprès de ses collègues des affaires économiques – ont voté d’une même voix pour rétablir les textes les plus critiques, se rapprochant des positions du Rassemblement national (RN), qui tient une ligne claire depuis le début des discussions en faveur des pesticides, de l’élevage intensif et des mégabassines.
Seul le MoDem est apparu divisé, les uns votant avec la gauche et le groupe écologiste pour maintenir les avancées de la semaine dernière, les autres s’alignant sur le reste de la Macronie, la droite et l’extrême droite en faveur d’une agriculture productiviste le moins limitée possible par la nécessité de préserver biodiversité et santé de la population.
Principale disposition au cœur du texte, la possibilité d’un retour des néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d’abeilles, est ainsi revenue en force. Inscrite à l’article 2 de la proposition de loi, elle permettrait par décret, « à titre exceptionnel », « de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ». Ces produits toxiques, interdits en France depuis 2018, avaient bénéficié d’une dérogation jusqu’au début de 2023.
Le RN pro-pesticides
Au cours des débats qui se sont achevés vendredi 16 mai, le rapporteur de la loi Julien Dive (LR), élu de l’Aisne, l’un des départements les plus gros producteurs de betteraves, a fermement soutenu la réintroduction de l’insecticide. Pour l’encadrer, il a simplement porté un amendement qui limite cette autorisation à trois ans, tout en donnant un « avis favorable » à un amendement du RN qui rendait cette durée renouvelable. Ce dernier amendement, toutefois, n’a pas emporté la majorité. Le RN a même tenté, sans y parvenir, de faire entériner le retour de l’ensemble des néonicotinoïdes, y compris ceux interdits par l’Union européenne.
Pour les élu·es favorables à ce type d’insecticide dit systémique – il se diffuse dans toutes les parties de la plante, y compris le pollen et le nectar –, la cause est entendue : il s’agit simplement de réintroduire l’acétamipride pour traiter les noisetiers. Il s’agit de l’une des trois molécules encore autorisées sur le sol européen. « Ce sera juste pour une durée précise, pour une molécule précise, et à certaines conditions », a plaidé Julien Dive à plusieurs reprises. « Quand bien même on ne le ferait que pour la noisette, ça vaut le coup de le faire », a assuré de son côté Jean-Luc Fugit, député macroniste du Rhône.
Pour sauver la filière noisette ou la filière betterave, on accepte de siffler la mort de la filière apicole. Pierrick Courbon, député PS de la Loire et apiculteur
Le texte, cependant, ne précise à aucun endroit que seule cette molécule est concernée, et que seule la filière de la noisette pourrait en bénéficier. Autrement dit, c’est une porte grande ouverte pour le retour de substances dont la toxicité n’est plus à démontrer.
Au cours des débats, les député·es pro-pesticides ont avancé la nécessité de faire le poids face aux concurrents de la France sur la noisette, Italie et Turquie en tête. « 65 % de la production de noisette de mon département est partie à la poubelle », fait valoir Hélène Laporte, députée RN du Lot-et-Garonne, auprès de Mediapart.
Élue dans le fief du syndicat de la Coordination rurale, qui s’oppose violemment aux mesures environnementales, elle rappelle que le retour de l’acétamipride est porté depuis longtemps par son parti : c’était déjà l’objet, il y a deux ans, d’une proposition de loi de son collègue, Timothée Houssin. Et l’extrême droite n’entend pas se cantonner à la noisette. « Il y a la fraise aussi… »
Les chiffres brandis pendant les débats pour défendre le retour de la molécule toxique sont le plus souvent fantaisistes. La réalité, c’est que malgré les attaques de la « puce diabolique », contre laquelle l’acétamipride est parfaitement efficace, les rendements des noisetiers français restent nettement supérieurs à ceux de l’Italie et de la Turquie, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
La gauche de la commission n’est pas dupe et dénonce le tour de passe-passe : privilégier les intérêts d’une filière au détriment du principe de précaution et de la préservation des insectes, voilà qui est curieux, relèvent les uns et les autres au cours de la discussion. « Pour sauver la filière noisette ou la filière betterave, on accepte de siffler la mort de la filière apicole », regrette le socialiste élu de la Loire Pierrick Courbon, lui-même apiculteur. « En vingt ans, le miel a perdu deux tiers de sa production. »
L’élue des Deux-Sèvres Delphine Batho (Générations Écologie) avance les dernières données scientifiques : « L’acétamipride se retrouve dans le liquide céphalorachidien d’enfants atteints de cancers, il franchit la barrière placentaire, se transmet dans le lait maternel, il y a une suspicion importante de son impact sur les troubles du développement… »
Quant à la députée d’Ille-et-Vilaine Mathilde Hignet (La France insoumise), elle refuse « d’être complice d’un système qui bousille les vies des agriculteurs » et profite du débat pour rendre hommage à Christian, cet agriculteur breton atteint de leucémie, « qui nous a quittés le 10 avril dernier ».
RN et FNSEA
Si l’ensemble de la gauche tient, avec constance, une ligne d’opposition aux pesticides et dénonce un texte qui n’améliore en rien les conditions de vie dans le monde agricole, elle échoue à faire passer la plupart de ses amendements.
Parmi les rares dispositions progressistes adoptées, signalons cependant celle portée par le député gersois David Taupiac (groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, Liot), voté avec la gauche et en dépit d’un « avis défavorable » du rapporteur : les exploitants agricoles subissant des pertes en cas d’interdiction d’un produit phytosanitaire devront être indemnisés.
L’autre sujet clé du texte, le processus d’autorisation des pesticides par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses), se voit quant à lui largement amendé, faisant apparaître l’indépendance de l’expertise scientifique comme une ligne rouge pour la Macronie. Dans le texte adopté en janvier par le Sénat, la tutelle du ministère de l’agriculture était renforcée et l’Anses se voyait dotée d’un « conseil d’orientation pour la protection des cultures » dans lequel pouvait être intégrés, par voie de décret, des représentants des firmes de l’agrochimie.
La commission développement durable avait rejeté l’ensemble de ces dispositions ; celle des affaires économiques les a corrigées. Il n’y a plus de « conseil d’orientation », mais un « comité des solutions » où les firmes ne pourront pas siéger, mais être auditionnées.
Une majorité a également voté pour des facilitations concernant les bâtiments d’élevage, notamment par la voie de deux amendements déposés par le RN explicitement travaillés « en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles [FNSEA] ».
La commission affaires économiques n’a pas pu revenir, en revanche, sur un point important sur lequel la commission développement durable avait été saisie « au fond » et qu’elle avait rejeté : la simplification de la construction de mégabassines.
La discussion sur le stockage d’eau devrait toutefois revenir en séance plénière, à partir du 26 mai. C’est en tout cas ce qu’ont promis, du côté des macronistes, Jean-Luc Fugit, et pour LR, l’élu de Haute-Loire Jean-Pierre Vigier : ils prévoient de déposer des amendements en ce sens. Le backlash écologique est loin d’être terminé.
mise en ligne le 13 mai 2025
L’Europe sacrifie l’Asie centrale pour trouver son énergie « verte »
par Manon Madec sur https://reporterre.net/
L’Union européenne multiplie les investissements visant des minerais et la production d’énergie en Asie centrale. Malgré son discours sur une stratégie « gagnant-gagnant », l’environnement et les populations locales sont menacés.
Almaty (Kazakhstan), correspondance
À l’ouest du Kazakhstan, des bancs de sable remplacent la mer Caspienne, tandis qu’à Karaganda, dans le centre du pays, la neige vire au noir chaque hiver. En Ouzbékistan, le désert de Kyzylkoum grignote les terres autrefois fertiles de la région de Navoï. L’Asie centrale porte les stigmates de décennies d’exploitation pétrolière, gazière et minière. Pour la population, les ressources ne sont pas non plus une bénédiction : depuis les années 1990, leur exploitation est contrôlée par les majors étrangères et les élites locales, qui se partagent les rentes.
Aujourd’hui, ce sont les ressources dites « vertes » qui attirent l’attention sur la région. Lithium, nickel, uranium, terres rares : l’Asie centrale regorge de matières premières critiques, utilisées pour fabriquer des technologies bas carbone. Et ce n’est pas tout : avec son potentiel solaire, éolien et hydraulique, l’Asie centrale est un terrain idéal pour produire de l’hydrogène vert, qualifié ainsi car obtenu par électrolyse de l’eau, un procédé réalisé à partir d’énergies renouvelables et peu émetteur de CO2.
Ces ressources subiront-elles le même sort que les hydrocarbures ? Aujourd’hui, les États de la région les mettent aux enchères, en quête d’investisseurs qui ne se contentent pas de les extraire, mais participent aussi à la montée en gamme de l’industrie locale. Et ça, l’Union européenne (UE) l’a bien compris. À Samarcande (Ouzbékistan), lors du sommet UE-Asie centrale du 4 avril, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis des « partenariats mutuellement bénéfiques », fondés sur la création d’industries locales et d’emplois, ainsi que la production et l’exportation d’énergie verte.
Lithium kazakh et uranium ouzbek
Bénéfiques, ces projets le seront à coup sûr pour l’Europe, dont la demande en matériaux critiques ne fera qu’augmenter, prévient la Commission, alors que l’offre, elle, reste très restreinte. Échanger avec l’Asie centrale réduirait sa dépendance à la Chine, son principal fournisseur. Depuis les accords signés avec le Kazakhstan en 2022 et l’Ouzbékistan en 2024, elle a déjà investi dans le graphite et le cuivre via ses bras financiers, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle ne cache pas son intérêt pour les terres rares. En parallèle, l’Allemagne lorgne le lithium kazakh pour ses batteries. La France, qui importe déjà de l’uranium du Kazakhstan, accélère la production en Ouzbékistan.
Pour alimenter ses industries avec de l’énergie « propre », l’UE compte importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert par an dès 2030, dont 2 millions du Kazakhstan. En 2023, l’entreprise germano-suédoise Svevind a investi dans un gigantesque site de production à Mangystau, près de la mer Caspienne.
Doté de parcs éoliens et solaires, le site produirait, dès 2030, 40 gigawattheure d’électricité, sans compter celle issue de l’électrolyse. « C’est plus que la capacité actuelle de tout le pays, dit Vadim Ni, fondateur de l’ONG Save the Caspian Sea. Mais la totalité servira à produire l’hydrogène exporté vers l’Allemagne. »
« Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale »
De cette énergie verte produite sur son sol, le Kazakhstan ne verra pas la couleur. Pour en bénéficier, il faudrait moderniser un réseau électrique hérité de l’époque soviétique, conçu pour des centrales à charbon et inadapté aux renouvelables. Des investissements considérables qui ne sont pas, pour l’instant, à l’agenda européen.
Le pays, à l’instar de l’Ouzbékistan, aurait pourtant besoin d’accélérer sa transition. L’électricité y est toujours produite au charbon pour l’un, au gaz pour l’autre. En 2024, alors qu’il a les objectifs de réduction des émissions de CO2 les plus ambitieux de la région, le Kazakhstan a investi davantage dans de nouvelles capacités charbon que dans les renouvelables, rapporte le Global Energy Monitor.
Une dépendance aggravée par l’exploitation des matières critiques. Car les usines de transformation des minerais tournent au charbon, explique Dimitry Kalmykov, directeur du musée écologique de Karaganda. « Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale », affirme Vadim Ni.
« Préjudice irréversible à la biodiversité »
Pire encore, « les projets extractifs menacent d’accroître une pollution de l’air déjà critique », s’inquiète Dimitry Kalmykov. Cendres, métaux lourds, ammoniac : plusieurs études, dont une communication scientifique présentée en 2020, établissent un lien direct entre industrie minière et dépassement des seuils toxiques.
Quant au projet hydrogène, Kirill Ossin, fondateur de l’ONG EcoMangystau, prévient qu’il risque de porter un « préjudice irréversible à la biodiversité ». Construit dans la réserve naturelle d’Ustyurt, dans le sud-ouest du Kazakhstan, le parc détruirait l’habitat des gazelles et couperait les corridors empruntés par l’aigle des steppes, le koulan — un âne sauvage — et le léopard de Perse.
Il ne subsiste à l’état sauvage que 1 000 léopards de Perse, dont le milieu naturel est menacé par un projet d’extraction d’hydrogène vert au Kazakhstan. Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0 DE / Marcel Burkhard
S’y ajoute la saumure issue du dessalement de l’eau de mer, nécessaire à l’électrolyse. Plus chaude et plus salée que l’eau d’origine, elle pourrait perturber les écosystèmes marins si elle était rejetée dans la Caspienne. Une étude de faisabilité commandée par le gouvernement allemand, coécrite par Svevind, évoque un traitement « durable » des rejets, sans en préciser les modalités.
Vieux réflexes extractivistes
Les habitants aussi pourraient en faire les frais, car neuf litres d’eau seront pompés pour produire chaque kilo d’hydrogène, dans une région aride où l’accès à l’eau est déjà conflictuel. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : la mer Caspienne a baissé de deux mètres en vingt ans, et pourrait en perdre jusqu’à 14 de plus d’ici à la fin du siècle. C’est la pêche, l’agriculture et la consommation domestique qui sont menacées.
L’étude allemande admet une « situation critique » et reconnaît que l’hydrogène « accentuera la pression sur les ressources en eau ». Anticipant les critiques, l’UE a lancé le plan d’investissement Team Europe pour améliorer la gestion de l’eau. Cependant, signalent certains chercheurs : les financements sont insuffisants et sa mise en œuvre repose sur la bonne volonté des élites locales.
« La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés »
Malgré leurs zones d’ombre, les projets ne sont pas rejetés en bloc par les activistes. Sous conditions, ils admettent qu’ils pourraient profiter à la transition comme aux habitants. « C’est un projet prometteur, attractif, avec des retombées économiques importantes », reconnaît Kirill Ossin à propos de l’hydrogène. Mais tous dénoncent l’approche européenne qui perpétue les vieux réflexes extractivistes, par « peur de passer à côté de ressources dont elle a besoin », dit Mariya Lobacheva, directrice d’Echo, une ONG kazakhe pour la transparence et la participation citoyenne.
Craintes d’une répétition du scénario des années 1990
Vadim Ni regrette que l’UE « s’en remette aux autorités locales, alors même qu’elles ne sont pas toujours compétentes ». En 2021, le Kazakhstan s’est doté d’un Code de l’environnement censé contraindre les entreprises à limiter leur empreinte écologique. Mais, faute de moyens, « le système d’évaluation environnementale stratégique n’est pas appliqué », explique-t-il.
Derrière la vitrine démocratique, Mariya Lobacheva fait un constat amer : « La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés. » La société civile peine donc à jouer un rôle de garde-fou. « Personne ne fait pression sur les investisseurs ou le gouvernement. Les gens ne croient pas à leur capacité à changer les choses », dit Dimitry Kalmykov.
Mariya Lobacheva redoute une répétition du scénario des années 1990, lorsque les contrats signés avec les majors pétrolières ont été conclus sans consultation publique. Même les emplois promis par l’UE ne réveillent pas son enthousiasme : « Il n’y a aucune transparence sur les conditions et les niveaux de qualification des postes réservés aux Kazakhs. »
Pour convaincre l’Asie centrale de ses bonnes intentions, l’UE doit passer à l’acte. En commençant par ouvrir le dialogue avec les habitants, scientifiques et écologistes, « seule façon de garantir des partenariats gagnant-gagnant », affirme Kirill Ossin.
mise en ligne le 6 mai 2025
« Un recul pour la santé publique » : 1 300 médecins
et scientifiques dénoncent la réintroduction de pesticides interdits
Clara Gazel sur www.humanite.fr
1 279 chercheurs, médecins, soignants publient ce lundi 5 mai une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la proposition de loi Duplomb. Débattu cette semaine en commission à l’Assemblée nationale, le texte prévoit notamment de réintroduire des pesticides interdits, dont des néonicotinoïdes.
Plus d’un millier de chercheurs et scientifiques alertent sur les dangers de la proposition de loi Duplomb, qui doit être soumise au vote de l’Assemblée nationale fin mai 2025. Ils publient ce lundi 5 mai une lettre ouverte aux ministères de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Environnement, les quatre tutelles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), dans laquelle ils alertent sur les risques majeurs que ce texte ferait peser sur la santé publique, l’environnement et l’indépendance de l’expertise scientifique.
Initiée par Médecins du Monde et le collectif Alertes des médecins sur les pesticides, cette lettre est publiée à la veille de l’examen du texte par les députés en commission du développement durable. Les signataires – parmi lesquels le biologiste du muséum d’histoire naturelle Marc André Selosse et le président de Médecins du Monde Jean-François Corty – pointent les effets néfastes des pesticides interdits sur la santé, et redoutent en particulier la « ré-autorisation de certains néonicotinoïdes, ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2016 », qui inquiètent à la fois les professionnels de santé et les apiculteurs.
L’Anses remise en cause, son président menace de démissionner
Autre motif d’alerte pour les signataires : la création d’un « comité d’orientation pour la protection des cultures », inscrit dans la proposition de loi. « Nous nous opposons à la création d’un Conseil d’orientation agricole qui dessaisirait l’Anses d’une partie du contrôle scientifique et de la responsabilité assortie », dénoncent-ils.
Ce nouveau conseil aurait la possibilité d’identifier les pesticides jugés essentiels, ceux pour lesquels il est estimé qu’il n’y a pas d’alternative. Dans ce cas, le ministère de l’Agriculture pourrait passer outre l’avis de l’Anses, pourtant chargée jusqu’ici d’évaluer les dangers des pesticides et de délivrer les autorisations.
Pour le millier de chercheurs et scientifiques, la création de ce « conseil » serait « un recul pour la santé publique » s’il venait à imposer l’autorisation de pesticides « sans considération suffisante pour les risques sanitaires et environnementaux ». Avant d’exhorter les ministres à « garantir l’indépendance de l’Anses et de son expertise scientifique face aux pressions économiques et politiques. »
Le directeur général de l’Anses, Benoît Vallet, avait menacé lors de son audition à l’Assemblée le 25 mars de démissionner en cas d’adoption de la loi Duplomb. Après son examen en commission, la proposition de loi doit être débattue en séance à la fin du mois de mai par les députés.
Des pesticides interdits
toujours utilisés en France
sur https://reporterre.net/
Des insecticides et herbicides interdits dans l’Union européenne, parfois depuis plus de vingt ans, sont encore « régulièrement source d’intoxications » en France. C’est ce que révèle un rapport de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), publié le 5 mai. Ces pesticides ont pu être stockés ou importés de pays qui les autorisent toujours.
L’Anses a analysé 599 expositions et intoxications enregistrées par des centres antipoison sur le territoire, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. 150 produits phytopharmaceutiques sont impliqués, dont 64 substances actives non approuvées. Les trois quarts de ces expositions ont été accidentelles, et un quart relevait de « conduites suicidaires », précise l’agence.
Parmi les principaux produits en cause figurent surtout des insecticides (60 %), des herbicides (19 %) et des taupicides (5 %). La moitié de ces produits, fabriqués à base de dichlorvos (insecticide et acaricide), ont été achetés en France auprès de vendeurs à la sauvette sur des marchés, dans des commerces ou sur internet. Près de 80 % des expositions au dichlorvos concernaient le Sniper 1 000, un insecticide utilisé pour l’agriculture en Afrique, importé illégalement en France contre les punaises de lits et les cafards.
Les zones les plus touchées sont des territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et La Réunion), l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie.
mise en ligne le 5 mai 2025
Énergie : quelle société voulons-nous ?
Jade Lindgaard sur www.mediapart.fr
La production et la consommation d’énergie en France, pour les dix ans qui viennent, sont en discussion à l’Assemblée lundi 28 avril. Derrière les effets de manche et les provocations politiciennes, les enjeux sont énormes et interrogent notre modèle de société.
Quand on ouvre la proposition de « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE), ce document planifiant la production et la consommation d’électricité et d’hydrocarbures jusqu’en 2035 en France, la première chose qui frappe, ce sont les chiffres.
Dans sa version mise en consultation jusqu’au 5 avril, dite « PPE 3 », et dans l’attente de l’arbitrage définitif du gouvernement par décret, les objectifs pour 2035 sont nombreux : jusqu’à 708 térawattheures (TWh) d’électricité décarbonée – contre 390 en 2022 – dont au moins 360 d’électricité nucléaire et si possible 400 ; jusqu’à 90 gigawatts (GW) de photovoltaïque – contre 16 en 2022 ; vingt fois plus d’éolien en mer qu’aujourd’hui, et au moins le double en éolien terrestre.
D’ici dix ans, il faudrait aussi beaucoup plus de « biocarburants » et d’hydrogène. Et réduire la consommation énergétique de 30 % en 2030, avant une baisse de 50 % en 2050.
À titre de comparaison, le pétrole et le gaz comptent pour plus de la moitié (58 %) de la consommation finale d’énergie en France. Or, 73 % des gaz à effet de serre sont dus à l’énergie (en 2022). Ces importations d’hydrocarbures représentent entre 25 et 80 milliards d’euros de déficit commercial chaque année depuis quinze ans.
Le gouvernement va devoir s’en expliquer lundi 28 avril à l’Assemblée nationale. Un débat sur « la souveraineté énergétique » mais sans vote, concédé par François Bayrou pour apaiser les protestations et menaces de censure, notamment du Rassemblement national (RN). La PPE aurait dû faire l’objet d’une loi, et donc d’un vote parlementaire. Mais face au risque de rejet du texte, l’exécutif y a renoncé et a directement rédigé un décret. Sa version finale devrait être publiée après la discussion à l’Assemblée.
La stratégie française sur l’énergie, critiquée pour ses insuffisances par les ONG écologistes, le Haut Conseil pour le climat, et l’Autorité environnementale, se fixe un triple objectif : développer l’indépendance énergétique (la « souveraineté »), décarboner, renforcer la compétitivité. Agir de concert pour le climat, la croissance économique et la puissance géopolitique : ces objectifs peuvent évidemment entrer en contradiction et tracent une trajectoire d’équilibriste pour qui veut s’efforcer de répondre à cette commande très politique.
Nouvelle révolution industrielle
Pour y parvenir, il faudra fournir un « effort inédit dans notre histoire énergétique » de réduction de la consommation et de production énergétiques, explique le rapport en annexe du décret de la PPE. Les investissements requis sont « sans précédent depuis la première révolution industrielle » au XIXe siècle. Et l’objectif est de faire de la France « le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles ».
Mais les chiffres ne sont que des outils de mesure. S’en tenir à un débat sur la quantité de CO2, le volume de gaz ou le nombre de gigawatts d’électricité est tristement réducteur.
Cela empêche d’ouvrir la discussion qui devrait nous agiter, trois ans après le début de la guerre en Ukraine, sept ans après les « gilets jaunes », et en pleine bataille des droits de douane menée par les États-Unis de Donald Trump : en matière d’énergie, quelle société voulons-nous ?
Le climat dans la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie)
En 2024, la baisse des gaz à effet de serre a été insuffisante, autour de − 1,8 %. Ce fut pourtant l’année la plus chaude jamais mesurée dans le monde. Le dérèglement climatique avance inéluctablement, les gouvernements ayant trop tardé à réagir. La gravité de ses effets dépendra de la quantité d’émissions de CO2 qu’ils vont réussir à empêcher dans les années qui viennent.
Le chiffrage de la PPE jusqu’en 2035 s’appuie sur des modélisations de l’administration et, pour l’électricité, sur le rapport « Futurs énergétiques 2050 », de RTE, gestionnaire des réseaux transportant le courant électrique. La PPE est établie pour cinq ans, donc jusqu’en 2030, puis actualisée pour les cinq années suivantes, jusqu’en 2035. Elle doit permettre la sécurité d’approvisionnement du pays, l’amélioration de l’efficacité énergétique – utiliser moins d’énergie pour un besoin –, le développement des énergies renouvelables, l’équilibre des réseaux, la préservation du pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des prix.
Une société dans laquelle les besoins vitaux de toutes et tous sont satisfaits, à un prix abordable pour les plus précaires, et sans dégrader les écosystèmes ? Ou est-ce qu’attirer les industries et leur offrir une énergie abondante et décarbonée (« Plug baby, plug ») est ce qui compte le plus, quelles qu’en soient les conséquences sociales et environnementales ?
Il en va de l’énergie comme de l’alimentation et de la santé : c’est avant tout une réflexion profondément humaine, qui touche au cœur de la vie quotidienne et des aspirations de chacune et de chacun. Mais les instrumentalisations politiciennes et populistes ont tué dans l’œuf des questionnements essentiels. Il n’est pas trop tard pour les réactiver.
Système public ou privatisation ?
L’économie de la « transition énergétique », expression aussi galvaudée que critiquée, crée un énorme effet d’aubaine pour l’industrie et la finance. Le phénomène assez ahurissant des start-up nucléaires, alléchées par le robinet intarissable de subventions pour les SMR, ces « petits » réacteurs atomiques en projet un peu partout, en est un exemple.
Mais ce n’est pas le seul secteur sensible pour la « souveraineté énergétique » qui suscite l’engouement des industriels : usines de batteries du groupe Bolloré, mines de minerais d’Eramet et Imérys, sites de STMicroelectronics et Soitec pour la fabrication de puces, parc éolien flottant en Méditerranée remporté par Engie et le groupe portugais EDP, éoliennes d’Iberdrola au large de Saint-Brieuc, usines d’hydrogène, etc.
Du côté de la consommation électrique, les gros opérateurs de data centers (Equinix, Digital Realty…), encore plus énergivores avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), et les entreprises du numérique deviennent des acteurs publics importants aux yeux de l’Élysée, qui leur a consacré un sommet.
Dans un contexte politique où les régulations environnementales et sociales sont violemment attaquées par la droite, l’extrême droite et une partie de l’industrie, est-il soutenable de continuer de confier au privé des investissements si importants pour le sort collectif ?
À l’inverse, l’idée de créer des « communs de l’énergie », autour d’un service public renforcé et impliquant les collectivités locales, fait consensus sur un large spectre politique : de la CGT et de représentant·es syndicaux d’EDF et Enedis, à des élus locaux et associations comme Énergie partagée, des chercheuses comme Fanny Lopez, sans oublier l’Union européenne (et ses « communautés énergétiques citoyennes »), et même l’ancien PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy.
Loin d’être seulement théorique, ce débat est très concret puisqu’il concerne le sort des barrages, dont l’Union européenne veut ouvrir les concessions à la concurrence. Et aussi le marché de l’électricité, dont l’économiste Anne Debregeas, porte-parole de Sud Énergie, propose de sortir en créant un opérateur public. Celui-ci détiendrait les grands moyens de production et facturerait l’ensemble des consommateurs et consommatrices selon une grille tarifaire qui permettrait de recouvrir les coûts.
Veut-on ou non des énergies renouvelables ?
C’est le nouveau jeu de massacre, à coups de posts sur les réseaux sociaux : accuser les énergies renouvelables d’être responsables de « surproduction » d’électricité et de déstabiliser le réseau – qui doit en permanence équilibrer offre et demande, à la seconde près. Le haut commissaire à l’énergie atomique, Vincent Berger, réclame que « la croissance du photovoltaïque [soit] revue à la baisse ». Une prise de position qui vient après la tribune d’anciens dirigeants d’EDF et de l’ex-président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, et qui appelle à l’arrêt de « la politique ruineuse » de soutien à l’éolien et au solaire.
Une autre, signée par des parlementaires, souhaite un moratoire sur les subventions aux renouvelables. À ce stade, le ministre de l’industrie et de l’énergie, Marc Ferracci, maintient les objectifs les concernant – avec une baisse sur le photovoltaïque par rapport à la première version de la PPE. Mais la chute des tarifs d’achat ainsi qu’un durcissement des périmètres d’installation des éoliennes inquiètent les professionnels du secteur.
Le Rassemblement national tente de s’approprier les oppositions locales à l’éolien.
Le fait est que la consommation est trop basse pour absorber toute la production d’électricité quand elle atteint des pics – dernier épisode en date, mi-avril. Il faut alors vendre ces électrons sur le marché européen. Quand ils ne trouvent pas preneur, se produit, dans certains rares cas, un phénomène baroque de « prix négatifs » que les antirenouvelables adorent monter en épingle. Invendu, ce courant coûte à l’opérateur.
RTE a temporisé, le 17 avril, expliquant que « la France est un pays exportateur net d’électricité » et « a donc, sauf rare exception, toujours produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme », et notamment grâce à son parc nucléaire. En 2024, le solde exportateur de la France a atteint un record historique de 89 TWh – soit 89 milliards de kilowattheures –, rapportant 5 milliards d’euros.
De dossiers du Point aux éditos de Valeurs actuelles, les énergies renouvelables sont devenues une cible privilégiée de la droite, tandis que le Rassemblement national tente de s’approprier les oppositions locales à l’éolien. À force de lobbying, ces arguments créent un effet diffus d’intimidation.
Pourtant, la matérialité des faits est simple : plus d’électricité disponible, c’est moins de gaz naturel liquéfié à importer de la Russie de Poutine – importations qui ont explosé en France en 2024 – et des États-Unis de Donald Trump. C’est bon pour le climat et mieux pour la démocratie. Les nouveaux réacteurs nucléaires EPR de Penly, Gravelines et Bugey, s’ils voient le jour, ne sont pas prévus avant 2038. D’ici là, pour produire plus d’électricité décarbonée, il n’y a pas d’autre voie que les renouvelables. « Se résigner à ce que la conversion du fossile vers l’électrique ne se fasse pas est un discours décliniste et anticlimatique qu’il faut combattre », résume l’expert Nicolas Goldberg, qui a cosigné une tribune pour cesser d’opposer nucléaire et renouvelables.
Autre rappel à la réalité, économique cette fois : les coûts des renouvelables sont en deçà de ceux du nucléaire. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) devrait estimer, d’ici à l’été, le coût complet du nucléaire autour de 67 euros par mégawattheure, selon Les Échos. Or le parc éolien en construction au large de Dunkerque (Nord) a été attribué par appel d’offres en juin 2019 pour un coût de 44 euros le mégawattheure. D’ici à 2050, le coût de production devrait être de l’ordre de 30 euros le mégawattheure pour le solaire au sol, d’environ 45 euros pour les grandes toitures et, d’ici vingt-cinq ans, l’éolien terrestre devrait produire des électrons à un peu moins de 40 euros, selon RTE. La Cour des comptes estime le coût total du réacteur EPR construit à Flamanville (Manche) à 23,7 milliards d’euros. Le coût de production de son électricité s’établirait entre 110 et 120 euros par mégawattheure, en valeur de 2015, pour une hypothèse de rentabilité – basse – de 4 %, soit entre 132 et 144 euros en comptant l’inflation. Il monterait à 176 euros par mégawattheure, pour un taux de rentabilité de 7 %.
Quelle « neutralité technologique » ?
C’est une expression que l’on entend de plus en plus à Bruxelles : la « neutralité technologique » apparaît à plusieurs reprises dans le Pacte pour une industrie propre présenté par la Commission européenne. Dans le contexte européen, cette formulation signifie que chaque État doit rester maître du choix de ses sources d’énergie, du moment qu’elles lui permettent de réduire ses émissions de CO2 – l’objectif est de baisser de 90 % les gaz à effet de serre d’ici à 2040. La France y tient beaucoup, car elle garantit la place du nucléaire dans les réglementations de l’UE, et, potentiellement, son accès aux financements.
Mais pourquoi limiter l’idée de neutralité aux rejets de CO2 et ne pas y faire entrer celle des déchets ? Tous les équipements industriels, y compris les composants d’éoliennes et de photovoltaïques, génèrent des déchets in fine. Une tendance nourrie par la numérisation de l’économie et des pratiques. Mais la gestion des déchets du nucléaire est à l’origine de toute une infrastructure d’équipements particulièrement polluants, comme sur le site d’Orano à La Hague (Manche), et coûteux. Le projet d’enfouissement en couche géologique profonde à Bure (Meuse) est toujours en cours d’instruction et soulève de lourdes questions éthiques.
Enfin, ne serait-il pas plus réaliste de prendre en compte le sujet des combustibles ? Par définition, les éoliennes et les panneaux solaires n’en ont pas besoin. C’est ce qui rend leur coût si bas une fois qu’ils sont installés : ils n’ont besoin que de vent et de lumière, fournis gratuitement par la planète. C’est leur immense avantage sur les centrales à gaz et les chaudières à fioul, mais aussi sur les réacteurs nucléaires, qui nécessitent du combustible en uranium, que la France doit importer à 100 % et transformer par un processus générateur de pollutions et de risques liés au transport.
En 2019, Emmanuel Macron avait créé une Convention citoyenne pour le climat pour sortir de la crise des gilets jaunes. Ces résultats ont été ignorés sans scrupule par le pouvoir. Mais elle fut un événement politique qui continue de faire date, démontrant in vivo qu’une délibération démocratique et informée sur le climat et l’énergie peut conduire à formuler des propositions politiques fortes. Peut-être est-il temps de former une convention citoyenne des besoins énergétiques. Et de le faire par le bas, en partant des innombrables collectifs et associations engagés dans la transformation écologique et sociale.
mise en ligne le 22 février 2025
Désastreuse pour la biodiversité,
la loi d’orientation agricole est adoptée
sur https://reporterre.net/
Le projet loi adopté constitue un net recul sur les pesticides, les espèces protégées ou la préservation des forêts.
Pile à l’heure pour l’ouverture du Salon de l’agriculture, samedi 22 février à Paris. La loi d’orientation agricole a été définitivement adoptée, jeudi 20 février, après un ultime vote du Sénat dans l’après-midi. Le texte, issu d’un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire mardi soir, avait déjà été approuvé largement par l’Assemblée nationale mercredi, avec les voix macronistes, de la droite et du Rassemblement national.
Élaborée comme une réponse à la colère des agriculteurs, la loi ne répond même pas à son objectif principal : le renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire. Très critiqué par les associations environnementales et la gauche, le texte est une catastrophe pour l’écologie.
L’agriculture, « intérêt général majeur »
L’article 13, dénoncé comme « un permis de détruire la biodiversité », dépénalise les atteintes aux espèces protégées lorsqu’elles ne sont pas commises « de manière intentionnelle », au profit d’une simple amende administrative de 450 euros maximum ou du suivi d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement.
Une autre mesure prévoit de « s’abstenir d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne » en l’absence d’alternatives viables. Une traduction du principe « pas d’interdiction sans solution », mantra de la FNSEA sur les pesticides. L’agriculture est élevée au rang d’« intérêt général majeur », la loi imposant ainsi une vision productiviste. Elle s’attaque aussi aux forêts en affirmant le principe selon lequel toute gestion forestière serait vertueuse pour la nature. Or, c’est faux : « Une coupe rase dans une forêt peut défoncer les sols et mettre en péril les espèces qui y vivent », expliquait à Reporterre Bruno Doucet, chargé de campagne forêts françaises à l’association Canopée.
Loi d’orientation agricole :
comment le texte sacrifie la biodiversité
Jessica Stephan sur www.humanite.fr
Le projet de loi d’orientation agricole a été voté par les députés et les sénateurs les 19 et 20 février, actant de nets reculs en matière de protection de l’environnement.
La guerre contre la protection de l’environnement s’accélère. Dernière offensive en date, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole voté par l’Assemblée nationale le 19 février et le Sénat le 20, juste avant l’ouverture du Salon de l’agriculture, le 22 février. Pesticides, espèces protégées, forêts… Au-delà de ses insuffisances en matière de revenus agricoles et de renouvellement des générations, ce texte constitue un retour en arrière majeur pour la protection de la biodiversité.
D’abord, sur l’usage des pesticides, dont les effets néfastes sur la biodiversité et la santé humaine sont de plus en plus documentés, en inscrivant dans la loi le principe du « Pas d’interdiction sans solution ». Ensuite, sur les atteintes aux espèces protégées. Le texte, considérablement durcit par les sénateurs, n’a guère été nuancé par la commission mixte paritaire dans sa version finale, sous couvert d’aider les agriculteurs. En témoigne son article 13, qui acte la dépénalisation de la destruction d’espèces protégées, une brèche qui laisse un goût bien amer aux défenseurs de l’environnement.
« Faire des normes environnementales un bouc émissaire »
« La volonté de renouveler nos générations nous a aussi imposé de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur. Pour ce faire, ce projet de loi permet une dépénalisation des atteintes non intentionnelles, et strictement non intentionnelles, à l’environnement », a justifié la ministre de l’Agriculture Annie Genevard lors du vote du texte final au Sénat, le 20 février.
La ministre a donc ainsi sous-entendu que le principal obstacle à l’installation serait la protection de l’environnement. Un chiffon rouge savamment agité, si l’on en croit Laure Piolle, chargée des questions agricoles au sein de l’association France Nature Environnement (FNE) : « Cela va dans le sens du discours instrumentalisé par la FNSEA et le gouvernement suite à la crise agricole de l’année dernière, qui est de faire des normes environnementales un bouc émissaire de tous les problèmes de l’agriculture pour éviter de se pencher sur les vraies questions : celles du revenu agricole. » Laure Piolle dénonce vivement cette loi : « Derrière l’idée de simplification, il faut vraiment entendre le recul majeur du droit de l’environnement. »
« Un sentiment d’impunité »
Car cet article décrié par les ONG change considérablement la législation. Jusqu’alors, les infractions « non intentionnelles » pouvaient aller jusqu’à 150 000 euros d’amende et une peine maximale de trois ans d’emprisonnement, comme le stipule le Code de l’environnement. Le Sénat a abaissé cette disposition à une simple sanction administrative, jusqu’à 450 euros d’amende. La Commission mixte paritaire a maintenu cette orientation, mais en a limité l’application aux personnes physiques. En pratique, essentiellement les agriculteurs et les chasseurs.
Il faudra donc dorénavant prouver que la destruction a été volontaire et déterminée pour obtenir une condamnation. Un amoindrissement de la législation qui aura des conséquences délétères, prévoit Laure Piolle : « Cela crée un sentiment d’impunité : il n’y a plus besoin de faire attention, de prudence, de se renseigner. » Et, poursuit-elle, cette disposition empêchera de fait les condamnations : « Il est impossible de prouver par exemple l’intentionnalité d’un chasseur qui aurait tué une espèce protégée à la place d’un sanglier. »
D’autant que sa pertinence n’est pas avérée pour les agriculteurs. Comme le rappelle la chargée des questions agricoles à FNE : « Actuellement, très peu de sanctions pénales sont prononcées envers les agriculteurs, encore moins des sanctions pénales fortes. Et le juge est déjà garant de la proportionnalité des peines. Il n’applique pas la même peine à un chasseur qui tue un aigle et à un agriculteur qui a coupé sa haie au mauvais moment en détruisant un nid. »
« Un problème de sécurité juridique »
Cette nouvelle loi va plus loin. L’article 13 bis AAA, ajouté au dernier moment par le Sénat, stipule que « les travaux forestiers réalisés dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leur exploitation sont considérés comme indispensables à la préservation des écosystèmes ». Des activités que le texte déclare « reconnues d’intérêt général et sécurisées juridiquement tout au long de l’année ».
Cette disposition risque de créer des difficultés, selon Aurore Dubarry, animatrice du réseau forêt au sein de FNE : « Dans sa rédaction, il pose un vrai problème de sécurité juridique. Il entend sécuriser les activités listées, mais cela pose la question de l’articulation avec d’autres codes, notamment le code de l’environnement. »
Un ajout qui interroge. « Au départ, ce texte ne parlait pas de travaux forestiers, il restait centré sur l’agriculture et la souveraineté, précise Aurore Dubarry. On a l’impression que l’objectif est d’éviter les contentieux, notamment avec les associations environnementales. Les citoyens s’indignent de plus en plus des coupes rases, par exemple. »
L’article semble ainsi fermer la voie aux recours contre celles-ci comme aux autres actions de gestion forestière. Mais à cet égard, il pourrait cependant s’avérer contre-productif, prévoit Aurore Dubarry : « Il risque d’y avoir beaucoup de contentieux au contraire, ne serait-ce que pour comprendre l’article et son articulation avec les autres codes. »
Au Sénat, le 18 février, la ministre avait précisé : « Nous ne sommes pas, évidemment, indifférents à la cause de l’environnement. » Alors que les effets du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité sont largement documentés par les scientifiques, ce serait bien le minimum ; pourtant, au vu de cette loi, il est permis d’en douter.
mise en ligne le 9 février 2025
La confédération européenne des syndicats refuse de discuter du plan « boussole de Compétitivité » d'Ursula von der Leyen, en l’état
Lina Sankari sur www.humanite.fr
Après la présentation de la « boussole de compétitivité » par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les organisations représentatives appellent à reconstruire le « modèle social » européen plutôt que de continuer à le démanteler.
La boussole pointe vers l’Ouest et les syndicats européens ne s’y sont pas trompés. Au prétexte de doter le continent des armes économiques pour faire face aux États-Unis et à la Chine, la « boussole de compétitivité » présentée ce 29 janvier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, semble profiter de l’accélération de la dérégulation côté états-unien, et des pressions exercées en ce sens par Donald Trump, pour hâter le mouvement côté européen.
Profitant du retour du milliardaire à la Maison-Blanche et des alertes lancées sur la désindustrialisation du continent, l’Union européenne s’engage dans une nouvelle course au moins-disant social. Si l’Union européenne (UE) se targue de vouloir préserver son modèle, elle semble plutôt axer sa stratégie sur « la satisfaction des besoins des entreprises », analyse la Fédération européenne des Transports.
De fait, Ursula von der Leyen propose un « choc de simplification » pour les entreprises qui vise à alléger la législation de 25 %. Bien qu’elle prétende vouloir préserver le Pacte Vert, malgré les pressions insistantes de son camp politique pour se défaire de ce qu’il considère comme un obstacle aux affaires, la dirigeante conservatrice suggère de se défaire des normes de durabilité, de respect des normes environnementales et des droits humains pour les donneurs d’ordre (devoir de vigilance et « comptabilité sociale et environnementale » du CSRD).
« L’Europe sociale » en miettes
Selon la Fédération européenne des Transports, « la Commission accepte que l’UE ne s’adapte qu’aux normes de compétitivité définies en dehors de l’Europe, au lieu de définir ses propres normes ». Plutôt que d’être préservé, le modèle social nécessiterait d’être reconstruit, concluent les organisations représentatives des travailleurs. « Le modèle social de l’UE s’est érodé au cours des dernières décennies. Certaines mesures risquent de démanteler davantage ce qui reste de l’« Europe sociale », ajoute la Fédération européenne des Transports. Et pour cause, l’UE envisage de se doter d’un régime spécifique permettant aux entreprises innovantes de s’émanciper du droit du travail national.
Le document présenté par la Commission se gargarise pourtant de constituer une « feuille de route pour des emplois de qualité » quand, à l’autre bout de l’échelle, elle définit les bonnes conditions de travail comme liées à la seule attraction des travailleurs sur le marché et à l’augmentation de la productivité.
Avec pour corollaire, un recul de l’âge de départ à la retraite. De son côté, la Confédération européenne des syndicats (CES) annonce qu’elle ne peut discuter du plan en l’état et demande un rendez-vous « urgent » avec Ursula von der Leyen : « les négociations sur la proposition auraient dû avoir lieu avant la publication », rappelle la CES. L’union continentale regrette également que de l’argent public soit une nouvelle fois déversé dans les entreprises sans aucune condition tout en risquant d’exposer les salariés à de nouveaux dangers dans les lieux où ils opèrent du fait d’une législation moins contraignante.
Climat : la droite,
l'extrême droite et
le patronat bien décidés
à couler le pacte vert européen
Antoine Portoles sur www.humanite.fr
Le paquet de mesures adopté par les Vingt-Sept pour lutter contre le réchauffement climatique est aujourd’hui dans le viseur du patronat et de l’extrême droite, biberonnés à la dérégulation plein gaz promise par Donald Trump aux États-Unis.
Le Green Deal est-il voué à finir à la déchetterie ? Aussi appelé pacte vert pour l’Europe, cet ensemble de mesures, présenté en 2019 par la Commission européenne puis entériné l’année suivante, est censé permettre au continent d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, en vertu de l’accord de Paris de 2015.
Il s’agit aussi pour les Vingt-Sept, à plus court terme, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Porté par la vague écologiste au Parlement européen en 2019, qui a ensuite reculé aux élections de 2024 au profit des conservateurs, le pacte vert est aujourd’hui menacé de toutes parts.
Les appels à détricoter les normes environnementales essaiment partout en Europe. « C’est une question de curseur et d’équilibre politique au Parlement. Il est clair que le Green Deal n’est plus considéré comme la priorité des priorités », résume Olivier Costa, politologue et directeur de recherche au Cevipof. Durant le premier mandat de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, bien que l’Union européenne ait cherché à prendre le leadership mondial sur la protection de l’environnement, le consensus autour de la lutte contre le changement climatique s’est petit à petit effrité, cédant la place à la recherche de croissance et de compétitivité.
Une « boussole pour la compétitivité » qui sacrifie le climat
« Le rapport Draghi parlait justement du déclin économique de l’Europe par rapport aux États-Unis, il y avait tout un plaidoyer pour remettre la compétitivité au centre du jeu et simplifier les réglementations européennes », analyse-t-il. Cette idée n’a pas échappé à Ursula von der Leyen. Sous la pression du patronat pour infléchir la politique environnementale de l’UE, le plan « boussole pour la compétitivité » est dans les cartons de la Commission.
Certains textes du Green New Deal – que les grandes entreprises estiment inapplicables – risquent d’être assouplis, par exemple ceux « sur la fin des moteurs thermiques en 2035, sur la CSRD (directive qui exige des entreprises qu’elles intègrent des informations sur la durabilité dans leurs rapports de gestion – NDLR), sur la déforestation importée, ou encore sur les questions de recyclage ou d’économie circulaire ». Même sursis pour la directive sur le devoir de vigilance pour les entreprises européennes de plus de 500 salariés en matière de droits humains et environnementaux.
Le pacte vert est aujourd’hui pris en étau sur fond de distorsion de la concurrence et de tensions commerciales croissantes avec la Russie, avec les États-Unis, ou encore avec la Chine. Un sursis alimenté par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. « Il n’en a strictement rien à faire des enjeux environnementaux, il quitte tout un tas d’instances internationales, ce qui relance la course à la compétitivité, rappelle Olivier Costa. Sa stratégie trouve un écho particulier auprès des extrêmes droites européennes, qui voient en lui la validation de leur ligne politique. »
La neutralité carbone s’éloigne
Les conservateurs européens n’ont jamais caché leur climatoscepticisme, pas plus que leur défense des intérêts des industries les plus polluantes. Mais leur fascination pour le président états-unien pourrait vite tourner court au vu de ses intentions préjudiciables à l’égard de l’Europe. Parmi ces leaders, l’Italie de Giorgia Meloni et la Hongrie de Viktor Orban mènent la charge contre le Green Deal.
En France, sans pour autant vouloir y renoncer, le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, interrogé sur France Info, a plaidé pour « la simplification et la suspension d’un certain nombre de directives. Si on investit dans la transition environnementale en accompagnant nos entreprises, (…) faisons-le de façon pragmatique, avec bon sens, en écoutant les acteurs ». Si la France a « globalement soutenu le pacte vert, elle subit aujourd’hui un backlash écologique comme partout en Europe, notamment dans l’industrie automobile », souligne Olivier Costa. Ce refrain sur l’UE qui tuerait l’économique à coups de normes se manifeste aussi dans l’Hexagone avec la crise agricole.
Wopke Hoekstra, responsable de la politique climatique de l’UE, a déclaré jeudi que la Commission européenne envisagerait d’exempter 80 % des entreprises de la taxe communautaire sur les émissions de carbone aux frontières de l’UE prévue en 2026, justifiant que seules 20 % d’entre elles étaient responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.
« Notre raisonnement actuel, qui consiste à faire peser une charge énorme sur les entreprises, qui doivent alors remplir beaucoup de paperasse, avoir beaucoup de choses à faire, sans aucun mérite, ne peut pas être la solution », a-t-il expliqué. Derrière le sabordage du Green Deal, ce sont les objectifs européens en matière de neutralité carbone qui sont remis en question.
mise en ligne le 28 janvier 2025
Le Sénat, voix de la FNSEA
Pierre Jequier-Zalc sur www.politis.fr
Ces 27 et 28 janvier, le Sénat a examiné une proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Mégabassines, pesticides, etc., celle-ci s’attaque violemment aux normes environnementales, au plus grand bonheur de la FNSEA.
Depuis le 7 juillet dernier, tous les yeux sont rivés sur l’Assemblée nationale. Encore ces dernières semaines, chaque jour est rythmé par des tractations politiques concernant le vote du budget. Censure ? 49.3 ? Dans ce flux continu de rebondissements, une actualité parlementaire est plutôt restée dans l’ombre. Une proposition de loi, que le Sénat a examinée ces 27 et 28 janvier. Pourtant, celle-ci, visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » (sic), est explosive.
Et pour cause, elle surfe sur la colère agricole pour prendre des mesures à rebours de toute considération environnementale : réautorisation des néonicotinoïdes, soutien aux projets de mégabassines, remise en cause des autorités environnementales et sanitaires, le texte ne fait pas dans le détail. Et comment s’en étonner ? À l’initiative de celui-ci, on retrouve Laurent Duplomb, et Franck Menonville, deux sénateurs de droite. Le premier, qui porte à bout de bras cette proposition de loi, a ainsi été… président FNSEA de la chambre d’agriculture de Haute-Loire.
Parce que c’est bien cela qu’il faut voir derrière cette attaque en règle contre l’environnement et l’avenir même du métier d’agriculteur : la marque de la FNSEA. Toutes ces mesures sont fortement inspirées d’un texte de loi rédigé par le syndicat agricole majoritaire à la fin de l’été et transmis aux parlementaires. Intitulé « Entreprendre en agriculture », celui-ci promet un « projet global » permettant de « donner une réelle ambition à l’agriculture française ». Et les mesures proposées par les deux sénateurs de droite y figurent, sans surprise, presque toutes. En novembre, sur la préfecture de Gap, la FNSEA avait même affiché une banderole : « PPL [proposition de loi, N.D.L.R.] Duplomb : la solution ».
Pourtant, comment croire une seule seconde que cette PPL est « de nature à répondre aux demandes du monde agricole », comme l’indique la FNSEA ? Depuis plus d’un an désormais, de nombreux paysans témoignent d’une importante colère. Celle-ci a d’ailleurs émergé en marge du syndicat majoritaire, pris de court l’hiver dernier. Au cœur des revendications des protestataires, figure la question du revenu dans une profession marquée par de très fortes inégalités.
L’idiocratie est en marche. D. Salmon
Ne cherchez pas plus longtemps, aucun article ne contient ne serait-ce qu’une demi-mesure pour tenter d’améliorer les revenus des agriculteurs les plus pauvres. « La méthode Duplomb c’est le moins-disant social et environnemental. Et, au bout du bout, c’est l’économie qui prend le pas sur la santé humaine et sur le vivant », raille Daniel Salmon, sénateur écolo, pour qui ce texte est l’illustration que « l’idiocratie est en marche ».
Comment ne pas lui donner raison, alors que le dérèglement climatique touche en premier lieu les agriculteurs, notamment les plus petits ? Peu importe, finalement, pour la majorité des sénateurs qui ont donc décidé de violemment s’attaquer aux normes environnementales pour promouvoir une agriculture intensive et productiviste à bout de souffle.
Une telle loi serait dramatique pour l’environnement comme pour l’agriculture de notre pays.
Surtout, dans un contexte d’instabilité politique chronique, rien ne dit que ce texte ne soit pas rapidement transmis au Palais-Bourbon. La ministre actuelle de l’Agriculture, Annie Genevard, du même bord politique que Laurent Duplomb, est tout aussi attentive que son collègue aux demandes de la FNSEA. Et celui-ci a d’ailleurs mis en garde le gouvernement en novembre dernier, assurant qu’il « ne serait pas rapporteur de la loi d’orientation agricole » sans la garantie d’un examen rapide du texte. Il faut espérer qu’il n’ait pas obtenu gain de cause car le passage d’une telle loi serait dramatique pour l’environnement comme pour l’agriculture de notre pays.
mise en ligne le 23 janvier 2025
Dans l’eau du robinet, une contamination massive par les polluants éternels
par Alexandre-Reza Kokabi sur https://reporterre.net/
L’eau du robinet est largement contaminée par les PFAS, selon une enquête menée dans 30 communes par UFC-Que choisir et Générations futures. La réglementation française est loin des standards adoptés dans d’autres pays.
L’eau du robinet est massivement contaminée aux PFAS, révèlent UFC-Que choisir et Générations futures. L’association de consommateurs et l’ONG publient une étude alarmante sur la présence des PFAS, ces « polluants éternels », dans l’eau en France. Les analyses ont été menées sur trente communes. 96 % des échantillons présentent des traces de ces substances perfluorées, connues pour leur persistance dans l’environnement et leurs effets toxiques potentiels. Des études lient déjà certaines à des risques accrus de cancers, de maladies thyroïdiennes ou de troubles hormonaux.
Parmi les trente-trois PFAS recherchés, le TFA (acide trifluoroacétique), issu de la dégradation de pesticides fluorés et d’autres composés industriels, se révèle particulièrement préoccupant. Il a été détecté dans vingt-quatre des trente échantillons analysés, avec des concentrations records dans le Xe arrondissement de Paris (6 200 nanogrammes par litre), à Lille (290 ng/l) et Lyon (120 ng/l). Certaines zones, comme Tours ou les environs de Rouen, affichent des « cocktails » impressionnants de polluants : jusqu’à onze PFAS différents relevés dans un seul prélèvement.
La faute aux rejets industriels et agricoles
« L’eau du robinet est le premier aliment que nous consommons. Or, nous constatons qu’elle est systématiquement contaminée par ces substances issues de décennies de rejets industriels et agricoles dans les cours d’eau et les nappes phréatiques », dit Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l’UFC-Que choisir. Et si des dispositifs de filtration et de dépollution de l’eau du robinet existent, « ils ne permettent pas d’éliminer efficacement les PFAS », déplore-t-il.
Malgré cette présence généralisée, ces concentrations en PFAS restent conformes à la législation française — bien moins stricte que celles d’autres pays. Elle fixe un seuil de 100 ng/l pour un ensemble de vingt PFAS, un niveau bien au-dessus des normes danoises (2 ng/l pour 4 PFAS) et étasuniennes (4 ng/l pour 2 PFAS). À titre de comparaison, aux États-Unis, six des échantillons analysés en France seraient jugés non conformes, et avec la norme danoise, ce chiffre grimperait à quinze sur trente.
Alors que certains pays européens ont déjà adopté des seuils drastiques, la France continue d’appliquer des normes peu contraignantes, notamment en ignorant la présence du TFA dans les contrôles règlementaires. « C’est un véritable angle mort. Les autorités ne surveillent pas le TFA, donc elles ne considèrent pas qu’il y a un problème. Pourtant, nos analyses montrent qu’il est présent absolument partout, qu’il s’agit probablement du contaminant le plus répandu dans les robinets de France », constate François Veillerette, porte-parole de Générations futures. Il exige le retrait rapide des pesticides contenant le TFA, comme le Flufenacet.
Une réforme des normes françaises nécessaire
L’UFC-Que choisir et Générations futures plaident pour une réforme profonde des normes en vigueur. Elles demandent un abaissement des seuils autorisés, une évaluation toxicologique du TFA et son intégration dans les contrôles de l’eau potable, ainsi qu’un renforcement des restrictions sur les PFAS, notamment ceux issus de pesticides.
Elles appellent également à une responsabilisation des industriels et des producteurs de pesticides, estimant que le coût de la dépollution ne doit pas reposer sur les consommateurs. Il a été récemment chiffré, par le quotidien Le Monde, à 100 milliards d’euros par an en Europe.
Au-delà des seuils et des chiffres, c’est toute une approche qui doit changer. « Aujourd’hui, les molécules chimiques sont évaluées sur la base des données fournies par leurs fabricants eux-mêmes. Cela crée un biais profond dans l’estimation de leur dangerosité. Il ne devrait pas falloir attendre des décennies de preuves accumulées pour agir », regrette Olivier Andrault.
« Ne pas attendre des décennies de preuves pour agir »
Alors que la directive européenne sur la qualité de l’eau potable entrera en application en 2026, les associations espèrent que la France en profitera pour adopter des mesures plus protectrices. En attendant, elles appellent les parlementaires à relancer la proposition de loi, portée par le député écologiste Nicolas Thierry, visant à interdire ces substances dans les produits du quotidien et à renforcer la responsabilité des pollueurs.
Les ONG alertent aussi sur les pressions des lobbys industriels dans les discussions européennes sur la restriction des PFAS. « Le projet est en train d’être démantelé par une multiplication des dérogations », alerte Olivier Andrault. « Sans volonté politique forte, la contamination de l’eau aux polluants éternels se poursuivra pendant des décennies », prévient François Veillerette.
Paris, Lille, Rouen… Ce que l’on sait sur le polluant éternel qui contamine l’eau du robinet de nombreuses villes
Clémentine Eveno sur www.humanite.fr
Un polluant éternel très compliqué à éliminer de l’eau, l’acide trifluoroacétique (TFA), pouvant avoir des effets sur la fertilité ou favoriser certains cancers, a été retrouvé dans l’eau du robinet d’une large majorité des villes où il a été recherché. Les deux études distinctes à l’origine de ces découvertes, publiées jeudi 23 janvier, ont été menées d’une part par le laboratoire Eurofins et d’autre part par les associations UFC-Que Choisir et Générations futures.
L’Europe devrait débourser 2 000 milliards d’euros sur vingt ans pour supprimer les « polluants éternels » (PFAS, pour substances per- et polyfluoroalkylées) des eaux et des sols. Et l’un d’eux, très compliqué à éliminer, l’acide trifluoroacétique (TFA), est présent dans l’eau du robinet de nombreuses communes de France, et dans la grande majorité des cas à des taux excédant le seuil théorique de qualité.
C’est ce que révèlent deux campagnes de mesures, rendues publiques ce jeudi 23 janvier par le journal Le Monde, et conduites séparément par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG environnementale Générations futures d’une part, et par le laboratoire d’analyse Eurofins d’autre part. La substance a été retrouvée dans l’eau de 24 communes sur 30 par la première campagne, et dans 61 des 63 échantillons lors de la seconde.
Quasi indestructibles, ces « polluants éternels » regroupent plus de 4 700 molécules et s’accumulent avec le temps dans l’air, le sol, les rivières, jusque dans le corps humain. Ils peuvent avoir des effets sur la fertilité ou favoriser certains cancers.
Des normes flottantes
Mais comment peut-on jauger de la toxicité de la concentration de la substance dans l’eau du robinet ? Pour les métabolites de pesticides potentiellement toxiques (dits « pertinents »), la limite de qualité dans l’eau potable est fixée par la réglementation à une concentration de 100 ng/L, rappelle Le Monde.
Problème : dans le cas du TFA, alors même qu’il s’agit bien d’« un métabolite pertinent » en raison de sa « toxicité préoccupante » pour le développement, selon la Commission Européenne, ce n’est pas ce seuil qui est appliqué en France. En effet, la direction générale de la santé (DGS) a choisi de déroger à cette norme, selon une note publiée le 23 décembre 2024, dont le quotidien se fait l’écho.
La DGS annonce ainsi s’aligner sur les valeurs provisoires de l’Allemagne, soit une valeur sanitaire de 60 000 ng/L (au-dessous de laquelle le risque est présumé nul), et « une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10 microgrammes par litre [soit 10 000 ng/L] ».
Ce seuil, rappelle Le Monde, est cent fois plus élevé que le seuil de 100 ng/L, qui s’applique en théorie à tous les métabolites de pesticides problématiques. Il doit s’appliquer à partir de 2026 aux vingt PFAS jugés « prioritaires » dans l’Union européenne, dont le TFA ne fait pour l’instant pas partie. Pour l’heure, les pays européens ont chacun des normes totalement différentes. Ainsi, les Pays-Bas ont établi une valeur guide sanitaire de 2 200 ng/L pour le TFA dans l’eau potable.
Paris arrive au second rang en termes de concentration
Et les résultats des campagnes révélés ce jeudi sont inquiétants. Selon l’étude initiée par Générations futures et l’UFC-Que choisir, l’acide trifluoroacétique (TFA) a été retrouvé dans l’eau de 24 communes sur 30. Il dépasse à lui seul, dans 20 communes, la norme référence en Europe de 100 nanogrammes/litre pour les vingt PFAS réglementés, qui doit entrer pleinement en vigueur en 2026.
Plus en détail, parmi les 30 communes dont l’eau a été analysée, le record est détenu par Moussac (Gard), avec 13 000 nanogrammes par litre (ng/L) de TFA dans l’eau distribuée. Ce qui n’est pas étonnant, souligne l’enquête, étant donné que la commune se situe près de Salindres, où une usine du groupe Solvay produisait du TFA jusqu’en septembre 2024.
Paris arrive au second rang en matière de concentration, avec 6 200 ng/l. L’échantillon a été prélevé en novembre 2024 dans le 10e arrondissement. Il s’agit d’une concentration 62 fois supérieure au seuil de qualité en vigueur pour les métabolites de pesticides pertinents (100 ng/L), auquel le TFA devrait être soumis. La ville de Bruxerolles, dans la Vienne, complète ce podium, avec 2 600 ng/l.
D’autres agglomérations sont également concernées, comme Fleury-les-Aubrais (Loiret), près d’Orléans (1 600 ng/L), ou encore Lille (290 ng/L) et Rouen (250 ng/L).
Des taux élevés de concentration à Nantes, La Rochelle, Palaiseau…
Les résultats de l’autre campagne menée par le laboratoire d’analyse Eurofins sont encore plus alarmants. Dans 61 des 63 échantillons prélevés par le laboratoire dans autant de communes en novembre 2024, le TFA est mesuré à des concentrations supérieures au seuil de 100 ng/L. Jusqu’à 35 fois plus, à Marange-Silvange, près de Metz, en Moselle.
Des concentrations importantes ont été également relevées à Nantes (2 700 ng/L), La Rochelle (2 500 ng/L) ou Palaiseau (2 500 ng/L) en Essonne. Dans le milieu du classement, Rennes (1 100 ng/L), Lyon (920 ng/L), Nancy (830 ng/L) ou Marseille (760 ng/L) se situent sous la valeur sanitaire néerlandaise, mais encore largement au-dessus du seuil des 100 ng/L.
Au-delà de la problématique de la réglementation, si le TFA n’est pas, comme le souligne l’enquête, « aussi dangereux que les PFOA ou PFOS », interdits en Europe depuis plusieurs années, des zones d’ombre subsistent sur la toxicité du TFA et il est « quasi indestructible dans l’environnement », souligne l’étude réalisée par l’UFC-Que Choisir et l’ONG environnementale Générations Futures.
Le TFA est issu de la dégradation d’un perturbateur endocrinien
Or, le TFA est en France « très peu – pour ne pas dire jamais – recherché par les agences régionales de santé lors des contrôles des eaux potables », déplore l’étude de ces deux associations, qui souligne qu’il est souvent issu de la dégradation du flufénacet, herbicide classé comme perturbateur endocrinien fin septembre par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa).
« Si une substance active (ici, le flufénacet) est un perturbateur endocrinien, alors ses métabolites (dont le TFA) doivent être considérés par défaut comme pertinents » et donc contrôlés, estime Pauline Cervan, toxicologue de Générations Futures, citée dans l’enquête.
Le problème, selon Julie Mendret, chercheuse à l’université de Montpellier, réside dans le fait que le TFA est « moins bien retenu » que d’autres PFAS par les techniques de décontamination de l’eau dans les usines d’eau potable, aussi bien celles s’appuyant sur des charbons actifs, que celles à base de filtration membranaire.
mise en ligne le 9 janvier 2025
La CGT contre les PFAS :
« Il faut les interdire pour protéger les salariés ! »
Par Marie Astier sur https://reporterre.net/
Pour protéger les salariés exposés aux polluants éternels, la CGT lance le « collectif PFAS ». « On ne peut pas laisser les industriels être leurs propres gendarmes ! » affirme le syndicaliste Jean-Louis Peyren.
La CGT lance le 6 janvier un « collectif PFAS ». Une première dans le monde syndical, plutôt frileux sur le sujet des polluants éternels. Omniprésents dans nos produits du quotidien (poêles de cuisine, cosmétiques, emballages alimentaires, etc.), ceux-ci sont toxiques pour l’humain. Jean-Louis Peyren participe à la création de ce nouveau « collectif PFAS » , il est secrétaire fédéral à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, en charge des questions santé-travail.
Reporterre : Pourquoi avoir décidé de faire de la question des PFAS un sujet prioritaire à la CGT ?
Jean-Louis Peyren : Les premiers concernés, ce sont les salariés. Ils les fabriquent, les utilisent dans le cadre de leur travail en tant que matière première. Il est légitime que l’on s’intéresse à cette problématique. On peut nous dire qu’on arrive un peu tard, mais c’est un sujet difficile à porter en tant que syndicaliste dans une entreprise.
Nos employeurs disent : « Si vous vous faites trop de bruit, on sera obligés de fermer et vous perdrez votre emploi. » Le salarié qui questionne l’impact des PFAS sur la santé et l’environnement deviendrait presque responsable de la fermeture de la boîte. Alors que les responsables, ce sont les pollueurs.
Les salariés ont plus peur de perdre leur emploi que leur santé. Il va falloir inverser les peurs. C’est aussi pour cela que la CGT a mis du temps à se positionner publiquement ; cela a nécessité de la pédagogie vis-à-vis des salariés. On ne veut pas travailler pour perdre sa santé, mais pour gagner sa vie.
Nous pensons que c’est en dénonçant la situation et en poussant les industriels à trouver des solutions alternatives que l’on sauvera nos emplois.
Pourquoi les travailleurs sont-ils les premières victimes des PFAS ?
Jean-Louis Peyren : Lorsque vous fabriquez un produit, vous y êtes exposé tous les jours. Surtout que les salariés sont mal protégés. Nos employeurs préfèrent aller vers des protections individuelles, par exemple des masques, plutôt que des protections collectives, comme une hotte aspirante. Or, les protections individuelles ne sont pas les plus efficaces. Quand vous êtes sur un poste pouvant être considéré comme exposé à des matières toxiques, vous avez un masque ; mais pas ceux qui gravitent autour. La hotte, elle, protège l’ensemble des salariés.
« Il faut interdire les PFAS ! »
Par ailleurs, le législateur a mis en place ce que l’on appelle les « valeurs limites d’exposition professionnelle ». Cela ne vous empêche pas d’être au contact de ces produits. Et ces valeurs sont établies produit par produit, pas à l’échelle de l’entreprise. Si vous fabriquez plusieurs produits différents, l’effet cocktail n’est pas pris en compte.
Comment réagissent les employeurs à cette demande de meilleure protection des salariés face aux PFAS ?
Jean-Louis Peyren : Quand on voit la levée de boucliers des industriels face à la proposition de loi d’interdire des PFAS… Et que, par exemple, Tefal continue à dire que la substance qui a remplacé le téflon dans ses poêles [le PTFE] n’est absolument pas dangereuse pour la santé... Il écrit même sur son site internet que l’on peut en ingérer de façon accidentelle. Comment voulez-vous qu’il pense à protéger ses salariés ?
Je rappelle quand même que le patron de Tefal a [en avril dernier] réuni les salariés Force ouvrière et CFDT devant l’Assemblée nationale, pour qu’ils disent que le téflon n’est pas si dangereux que cela [la proposition de loi, également approuvée par le Sénat, a en effet exclu les ustensiles de cuisine de l’interdiction des PFAS]. La situation est grave. Certains devront rendre des comptes plus tard.
La législation doit évoluer. Nous devons imposer un rapport de force face au lobbying des industriels.
Comment protéger la santé des salariés ?
Jean-Louis Peyren : Il faut interdire les PFAS ! On ne va pas continuer à fabriquer un produit dangereux simplement pour alimenter l’économie et faire travailler des personnes. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut les remplacer.
Des analyses permettent-elles d’évaluer l’exposition des salariés ?
Jean-Louis Peyren : Des analyses ont été faites chez les salariés d’Arkema [le géant de la chimie] début 2024. Des PFAS ont été retrouvés en grande quantité dans le sang de certains salariés.
« On ne peut pas laisser les industriels être leurs propres gendarmes ! »
Mais il y a deux problèmes. D’abord, c’est l’entreprise qui a choisi les laboratoires d’analyses. Pour des questions de transparence, on demande à ce que ce soit aux organismes externes de les analyser. La médecine du travail, par exemple, peut faire les prises de sang, choisir des laboratoires. On ne peut pas laisser les industriels faire leur autocontrôle, être leurs propres gendarmes !
Par ailleurs, une fois que vous avez une quantité de PFAS mesurée dans le sang, on vous dit tout et son contraire : que certaines études disent que c’est dangereux, d’autres non [il n’y a pas d’interdiction générale des PFAS à l’échelle de l’Union européenne, et la majorité des quelque 12 000 PFAS aujourd’hui recensés passe sous les radars]. À un moment, il va falloir appliquer le principe de précaution, lister les PFAS, et faire reconnaître [par l’État] qu’ils sont dangereux, et peuvent provoquer certaines maladies.
On pourra ainsi faire appliquer le Code du travail, qui indique que l’employeur est responsable de la santé des travailleurs, et faire évoluer le tableau des maladies professionnelles.
En tant que syndicaliste, recueillez-vous des témoignages de malades dans les entreprises utilisant des PFAS ?
Jean-Louis Peyren : C’est difficile à dire. Quand un salarié déclenche un cancer, on peut avoir un doute. Mais il n’y a rien de scientifique dans ce que l’on constate. Par contre, quand on sonne l’alerte, ce serait bien que des scientifiques extérieurs à nos entreprises regardent si, réellement, il y a quelque chose ou pas.
Vous créez un collectif PFAS au sein de la CGT, quel est son but ?
Jean-Louis Peyren : Le but est d’abord de s’organiser, de travailler ensemble, car la CGT regroupe de nombreuses branches et métiers. Les syndicats d’Arkema et de Solvay [une usine chimique] devraient en faire partie, des syndicats de la métallurgie, la Fédération de la métallurgie aussi, l’Union départementale 69 (Rhône) et celle d’Auvergne-Rhône-Alpes.
On va essayer de travailler avec des associations écologistes et de riverains, avec des organismes comme le CNRS [Centre national de la recherche scientifique] et l’Anses [Agence nationale de sécurité sanitaire].
On voudrait commencer par cartographier les plus fortes expositions aux PFAS, les comparer aux valeurs limites d’exposition et informer les salariés que, même quand les seuils ne sont pas dépassés, il peut y avoir un danger. Faire savoir que ces valeurs ne sont pas un blanc-seing pour polluer et mettre en danger les salariés.
Tout est à faire et à construire. Nous sommes comme en 1906, quand le premier médecin a dit qu’il y avait un problème avec l’amiante. Il a fallu attendre 1996 pour qu’elle soit interdite en France.
La CGT annonce la création
d’un collectif Pfas
pour s’attaquer aux polluants éternels
Jessica Stephan sur www.humanite.fr
Le syndicat a annoncé lundi la constitution d’un collectif pour protéger les salariés, qui sont les premiers exposés, et chercher des alternatives aux Pfas, ces substances extrêmement nocives pour la planète. Un enjeu sanitaire, environnemental, mais aussi social.
Textiles, emballages alimentaires, gaz réfrigérant… : les Pfas sont partout. Certains de ces polluants persistants dans l’environnement ont été classés « cancérogènes », d’autres « peut-être cancérogènes » par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) en décembre 2023.
Ces quelque 4 000 substances chimiques, per- et polyfluoroalkylées, sont connues pour leur résistance aux fortes chaleurs, leur imperméabilité, et leurs propriétés antiadhésives. Mais, avant leur arrivée dans nos placards et dans l’environnement, ce sont les salariés des usines qui y sont les premiers exposés. Un problème qui n’est pas sans rappeler celui de l’amiante, et dont la CGT a annoncé se saisir en constituant un « collectif Pfas » le 6 janvier dernier.
« Protéger les salariés, c’est éliminer le risque »
Son premier objectif est clair : « protéger au maximum les salariés », explique Jean-Louis Peyren, secrétaire fédéral à la Fédération nationale des industries chimiques (Fnic) de la CGT et membre du collectif, une nécessité « s’il y a toxicité ».
Dans l’immédiat, le collectif défend des « protections collectives » adaptées à chaque situation de travail. « Par exemple, sur un poste de travail avec des émanations gazeuses de Pfas, la hotte aspirante est une solution », détaille Jean-Louis Peyren, car elle protège le travailleur concerné mais aussi ceux qui gravitent alentour.
Ce collectif naissant – l’idée a germé au printemps 2024 – compte une dizaine de membres : des syndicats CGT de sociétés concernées, la Fnic CGT, des unions et comités au niveau local. Et il a du pain sur la planche : l’omniprésence des Pfas rend la situation complexe. « Dans le meilleur des mondes, protéger les salariés, c’est éliminer le risque. Si le risque, ce sont les Pfas, il ne faut plus de Pfas. Mais on vit dans un monde où ils répondent à des besoins. »
Pour illustrer cela, Jean-Louis Peyren donne un exemple percutant : les combinaisons ignifugées des sapeurs-pompiers, qui en contiennent. « On ne va pas les interdire et dire aux pompiers d’aller sur le feu en chemise de bureau ! »
« Le caillou dans la chaussure dans l’entreprise »
À terme, il s’agit donc aussi de trouver « des alternatives ». Un enjeu sanitaire, environnemental, mais aussi social, selon Jean-Louis Peyren : « Ce n’est pas en niant la situation qu’on va sauver nos emplois, au contraire, c’est en la dénonçant, parce que cela va permettre de trouver des alternatives. » Mais l’argument est parfois difficile à faire entendre. « Derrière la problématique des Pfas, il y a aussi des problématiques sociales qu’on ne doit pas nier, précise-t-il. Il faut concilier les deux, en allant vers de moins en moins de Pfas. »
Le collectif fait face aux inquiétudes et aux attentes suscitées par l’annonce de sa constitution : « On est sollicités par les syndicats CGT pour savoir comment aborder le sujet. » C’est sa première étape de travail : les aider « à aborder le problème des Pfas dans les entreprises avec les salariés », indique Jean-Louis Peyren, qui reconnaît la difficulté en interne : « C’est compliqué. Il faut rassurer nos syndicats. Certains nous alertent parce que les salariés pensent qu’on est en train de supprimer leur emploi. »
D’autant que la mise en cause de ces polluants entraîne parfois des pressions des employeurs, déplore Jean-Louis Peyren : « On nous oppose le chantage à l’emploi. C’est vieux comme le monde… » L’enjeu financier ne se laisse jamais oublier : « Des gros lobbies industriels se mêlent de ces affaires. »
Jean-Louis Peyren prévient : « On va essayer, comme le font les associations et les partis écologistes, les associations de riverains, de faire le caillou dans la chaussure mais en interne, dans l’entreprise. »